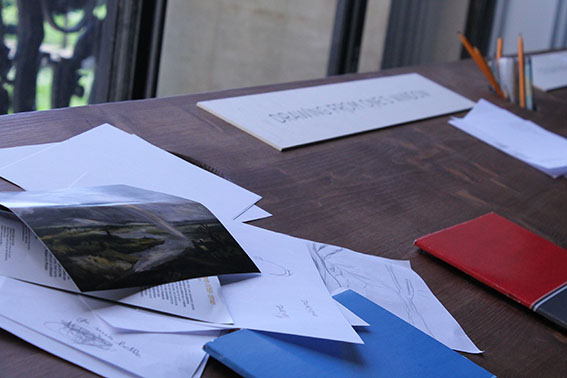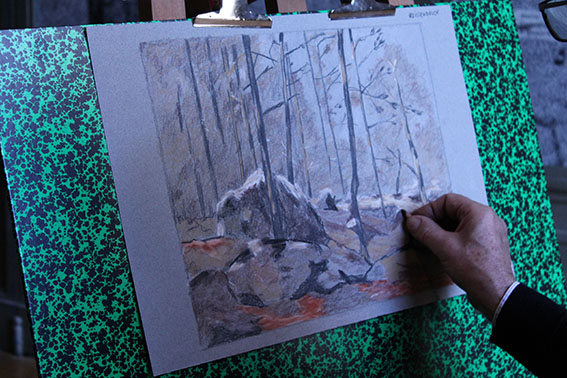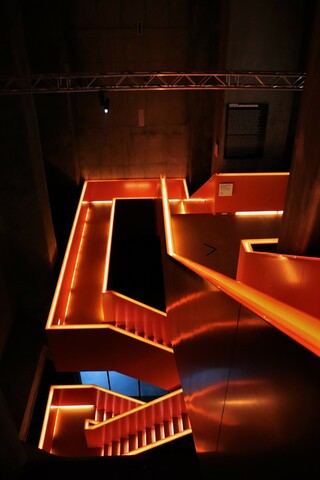Médiations singulières

À nous la glace ! À Montréal.
À nous la glace ! est une exposition pensée et créée à partir des documents d'archives et des collections de la BanQ. Dessinant le portrait vivant de l'univers du hockey amateur au moyen de nombreuses médiations, elle nous propose de s'essayer à une expérience interactive dont le parcours s'inspire d'une partie de hockey. Julie Derouin, Claude Sauvageau et Christophe Lebel nous expliquent les modalités de ce jeu sur tablette.
Envie d'en apprendre plus sur la tablette interactive ? C'est par ici :
https://www.facebook.com/akufenstudio/
https://www.instagram.com/akufenstudio/
Ce projet s’inscrit également dans le contexte de la mise en œuvre d’une mesure du Plan culturel numérique du Québec.
Pour en savoir plus : http://numerique.banq.qc.ca/p/promo/hockey/
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.
Eloïse Canavesio
Elise Mathieu

L’art méditation contemporaine, Destination Recherche Intérieure
Fermez les yeux. Écoutez votre respiration. Inspirez, expirez. Encore une fois. Encore. Encore, jusqu’à pénétrer dans ce temps suspendu, où vous êtes non seulement face à l’œuvre, mais aussi face à vous-même ; à destination de votre moi intérieur.

Visuels de l'exposition Panorama 20 au Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains
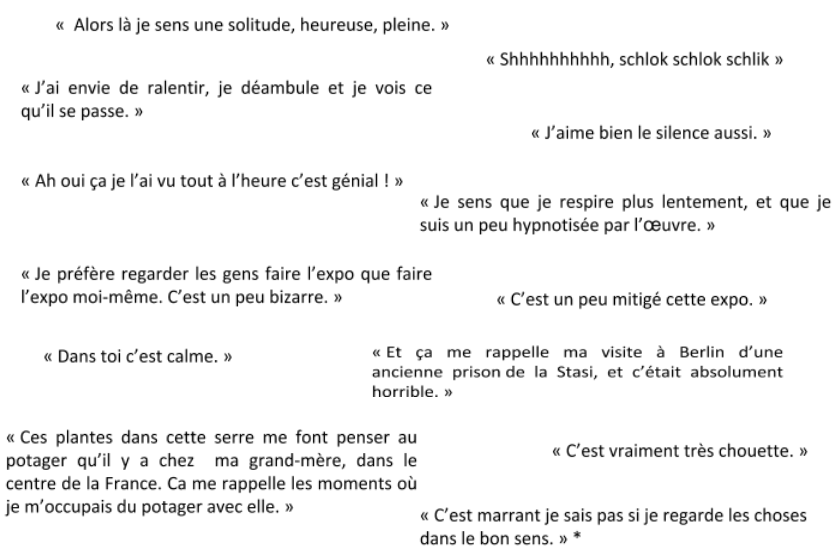
* L'ensemble de ces extraits sont tirés de l'oeuvre de Léonore Mercier, Empreinte Vagabonde.
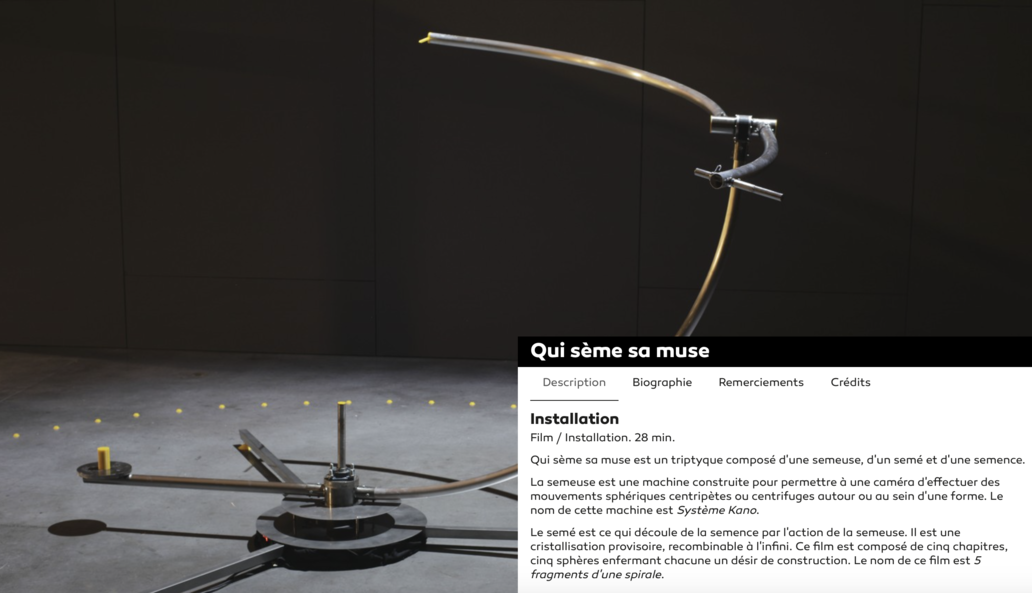
Visuels de l'exposition Panorama 20 au Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains
#mediation
#artcontemporain
#rechercheinterieure

Accrochage numéro 11
Depuis 2008, le Musée des Beaux-arts de La Rochelle a mis en place une politique d'accrochages participatifs. Renouvelé chaque année, le commissariat d'exposition est confié à des citoyens rochelais (dont l’équipe de rugby du stade rochelais, les femmes du quartier de Mireuil, un groupe de détenus de la centrale de Saint-Martin de Ré, des personnes déficientes visuelles), pour proposer au public une sélection d’œuvres de la collection autour d'une thématique préalablement définie.
La 11ème édition de l’opération Accrochage a été confiée à vingt-trois élèves de 1ère en baccalauréat technologique du lycée hôtelier de La Rochelle avec leur professeur de français Dominique Terrier, et la documentaliste de l’établissement et Florence Michaud. Ils vous invitent à découvrir l'exposition qu'ils ont intitulée "Accrochage n°11 - Le Palais des sens" à partir du 18 septembre 2017 jusqu'au 30 juin 2018. A l'heure où la question du participatif dans les musées est au cœur des débats, nous faisons le point avec Annick Notter, directrice du Musée des Beaux-arts.
Pour aller plus loin :
- Site officiel de la Rochelle: http://www.ville-larochelle.
fr/actualites/detail-actualite /b/2/h/638abc161024b3a680be5bc 0b6ec1378/article/accrochage- n11-1.html - Site du Lycée Hôtelier de la Rochelle: http://lycee-hotelier.fr
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube
Mathilde Esquer
#accrochageparticipatif
#cinqsens
#médiationsingulière

Aller au musée, une difficulté pour beaucoup, un droit pour tous
Malheureusement, les visiteurs avec des troubles du spectre autistique (TSA) sont peu représentés dans les musées. Pour beaucoup, les visites au musée ne sont pas compatibles avec les difficultés qu'ils peuvent éprouver, car le musée est vu comme une ouverture sociale alors que, de manière tout à fait caricaturale, les visiteurs neuro-différents sont identifiés comme des individus repliés sur eux-mêmes, et ayant des intérêts culturels restreints.
Les musées américains ont été parmi les premiers à tenter de comprendre ce handicap afin de leur proposer un accueil adapté, comprenant que ces lieux chargés d’histoire sont parfaitement adaptés et adaptables aux visiteurs avec des besoins spécifiques.
Pour l'égalité des chances, la participation des personnes à handicaps
Permettre à ces visiteurs de préparer leur visite sereinement
Le Metropolitan Museum of Art de New York l’a bien compris. Afin de satisfaire ces besoins, il met à disposition des documents permettant aux visiteurs de préparer leur visite en amont (comme le Social Narrative). Ce document raconte comment leur visite va se dérouler dans le détail. Ces pratiques mettent en confiance des publics avec TSA pour l’avant-visite, mais cela ne suffit pas, il est également nécessaire d’apaiser leurs sens lors de la visite du musée pour éviter une souffrance ou un inconfort.
La nécessité d’un apaisement sensoriel pour certains visiteurs
Plein les yeux, plein les oreilles
Car dans le cas de l’hypersensibilité aux stimuli sensoriels qui nous intéresse ici, la réception aux sons, goûts, à la lumière ou à la stimulation tactile peut être plus intense et ainsi être plus difficile à gérer pour certains visiteurs. Ces troubles sensoriels surviennent souvent chez les personnes avec des troubles du spectre autistique (TSA). Comme Cyrielle Leriche l’explique, ces troubles sensoriels peuvent varier en intensité, affecter plusieurs sens, et sont causés par un dysfonctionnement du traitement de l’information par le système nerveux. Or les musées regorgent de stimulations : la lumière parfois vive dans les salles, de nombreuses couleurs, des changements de température voire un bruit envahissant qui peut gêner ou faire souffrir.
Items sensoriels classés par catégories © Cyrielle Leriche
Cette surstimulation sensorielle peut entraîner une anxiété que certains musées tentent d’apaiser en aménageant des espaces calmes ou en créant des circuits évitant les lieux “violents” pour ces visiteurs. C’est le cas du Metropolitan Museum of New York qui, dans sa “Sensory Friendly Map”, recense tous les espaces du musée plus calmes et moins bondés.
Lieux plus et moins fréquentés du MET de New York (Sensory friendly map) © MET Museum
Diminuer les sollicitations sensorielles envahissantes
Outre ces exemples, il existe des dispositifs de médiation permettant de diminuer la sollicitation sensorielle superflue. Les sacs à dos sensoriels du Victoria & Albert Museum de Londres en sont un exemple reconnu. Ils contiennent un casque anti-bruit permettant aux visiteurs sensibles aux bruits ambiants d’apaiser leurs sens et de pouvoir continuer leur visite sereinement. Ces sacs sont prêtés gratuitement à l’accueil du musée, sans condition de ressources et sans avoir à présenter des documents pouvant les déranger, voire amener à une stigmatisation.
Apaiser ses sens, se réapproprier son corps
Pièce multisensorielle © Snoezelen-France
Ces salles multisensorielles gagnent à être associées à des salles de mise au calme, dépourvues de stimulation sensorielle, permettant une rupture avec l’environnement source de stress et d’inconfort. Ces salles peuvent être utilisées en cas de crise ou bien simplement en réponse à une surcharge sensorielle.
Alors en France, on attend quoi ?
Dans les musées français aussi la sursimulation des sens est présente. Prenons la grande galerie de l’évolution du Museum d’Histoire Naturelle de Paris où les visiteurs peuvent activer des haut-parleurs diffusant le barrissement de l’éléphant, ce qui peut déranger les publics malvoyants, autant que les familles et les publics avec TSA, ces sons se rajoutant aux annonces diffusées et au brouhaha naturel de la galerie. C’est là un des principaux problèmes des expositions contemporaines, que l’on veut interactives et sensorielles.
Caravane africaine, Grande Galerie de l'Évolution © MNHN - Agnès Latzoura
# Musée
# Bien-être
# Accessibilité
# Handicap
Sources
- Cyrielle Leriche, « Accueillir les publics autistes au musée », La Lettre de l’OCIM, 186 | 2019.
- Cyrielle Leriche, « Musée et troubles du spectre autistique », Les Cahiers de l’École du Louvre, 14 | 2019.
Fanny Bougenies, Julie Houriez, Simon Houriez et Sylvie Leleu-Merviel, « Musée pour tous : un dispositif de découverte dans les murs et son évaluation », Culture & Musées, 26 | 2015, 115-139.

Balade urbaine à Croix-Rousse : suivre le fil de la soie
Le musée Gadagne nous invite à découvrir l’histoire de Lyon hors de ses murs avec des balades urbaines autour de différents quartiers. Nous vous proposons un retour d’expérience sur une visite consacrée aux innovations dans l’histoire de la soie.
Métier à tisser au sein de la Maison des Canuts. Photographie : M.L.
Le musée Gadagne
Le musée Gadagne est situé dans le Vieux Lyon, quartier historique et touristique de la ville. Pour être plus précis, il faudrait plutôt parler de l’Hôtel Gadagne, un bâtiment dont l’histoire débute au XIVe siècle et qui est loué par le banquier Thomas II de Gadagne à partir de 1538, ce qui donne son nom à cet espace. Le bâtiment est progressivement acheté par la ville de Lyon à partir du début du XXème siècle. Il abrite aujourd’hui deux musées : le musée d’Histoire de Lyon (MHL) et le musée des Arts de la Marionnette (MAM). Toutefois, ce qui nous intéresse aujourd’hui n’est pas ce qui est proposé dans ces lieux mais au contraire, ce que le musée propose en dehors de ses murs.
En effet, le musée Gadagne a mis en place un programme de balades urbaines pour découvrir l’histoire du territoire lyonnais à travers plusieurs thématiques en lien avec des quartiers en particulier : « Derrière les voûtes : redécouvrez les traces de l’histoire industrielle du quartier Confluence », « Gerland – Terreau fertile de la santé : découverte d’un territoire devenu pôle d’excellence initié par la dynastie Mérieux » ou encore « Biodiversité de la voie verte ».
« Partez sur les traces de l’industrie de la soie à Croix-Rousse »

Pentes de la Croix-Rousse. Photographie : M.L.
Profitant de l’effervescence muséal de la Nuit des Musées, j’ai assisté à une balade urbaine consacrée à la fabrication de la soie, son commerce et à son influence sur le territoire lyonnais. Cette balade prenait son départ directement dans le quartier Croix-Rousse sous la statue de Joseph Marie Jacquard, personnalité majeure pour la soie lyonnaise. La médiatrice, chercheuse en histoire, introduit l’histoire du lieu et son développement : l’arrivée des soyeux, propriétaires de maison de commerce de soie et des canuts, qui vendaient leur soie à ces soyeux, qui a développé l’urbanisation du quartier Croix-Rousse. Les quartiers liés à la production de soie ont une hauteur particulière : pour pouvoir installer les métiers à tisser, chaque étage a environ quatre mètres de hauteur sous plafond. De plus, ces immeubles ont de très hautes fenêtres, assez nombreuses pour avoir suffisamment de lumière pour tisser. Si elle était intéressante, l’introduction, de trois quarts d’heure pendant lesquels nous sommes restées statiques et debout, pourrait peut-être plus dynamique dans ce contexte de « balade ». La médiatrice nous a ensuite invitées à nous déplacer dans plusieurs endroits importants du quartier, comme l’ancienne entrée du funiculaire à « un sous » aujourd’hui transformée en métro ou devant les pentes de la Croix-Rousse où ont défilé à plusieurs reprises les canuts pour réclamer plus de droits sociaux. Les commentaires de la visite sont riches : mêlant architecture, urbanisme, histoire sociale et technique, racontant une histoire transversale et illustrée sous nos yeux par le territoire que nous parcourons.

Démonstration d’un métier à tisser à bras monté avec une mécanique Jacquard. Photographie : M.L.
La visite se conclut par un court moment au sein de la Maison des Canuts. Cet ancien siège du Syndicat des Tisseurs et Similaires a été réinvesti à partir des années soixante-dix par la COOPTISS, coopérative de tissage. Nous découvrons enfin un métier à tisser à bras, annoncé pendant la balade ; il est monté avec une mécanique Jacquard (un système de carte perforée qui permet de sélectionner les fils lors du tissage afin de faciliter la réalisation des motifs, cette sélection des fils étant auparavant réalisée à la main). L’intérêt de la Maison des Canuts est d’exposer des métiers en état de fonctionnement ; une médiatrice formée nous fait une démonstration afin de nous expliquer le fonctionnement et d’observer la minutie nécessaire des gestes, de voir danser les fils avec la navette et entendre le fameux « bistanclaque », bruits successifs du métier manipulé pour le tissage. Les tissus réalisés lors des démonstrations entrent ensuite dans les collections de la Maison.

Carte perforée indispensable pour le fonctionnement de la mécanique Jacquard. Photographie : M.L.
L’histoire en balade, une bonne idée ?
Sortir de l’espace du musée peut avoir ses inconvénients : la météo n’était pas avec nous le jour de la balade et il a fallu improviser un abri. C’est aussi un type de médiation qu’il est compliqué de rendre accessible pour toutes et tous puisqu’elle implique d’être debout pendant deux heures. Et, faute de jauge réduite, nous étions une vingtaine : il était parfois compliqué d’entendre tous les commentaires de la médiatrice.
Toutefois, ce type de proposition a de nombreux avantages. Sortir des murs, c’est peut-être l’occasion de toucher un public qui n’est pas forcément à l’aise entre les vitrines et les cartels. C’est aussi nous inviter à être dynamique, ce qui met en place d’autres types d’apprentissages, sollicitant l’ouïe et la compréhension par le corps de manière générale. C’est l’occasion de faire découvrir des savoirs en s’inscrivant directement dans le territoire, d’illustrer une histoire qui devient concrète puisque nous pouvons en observer les traces. C’est aussi permettre de découvrir un espace avec un angle spécifique ou de redécouvrir les espaces fréquentés au quotidien.
En espérant que les beaux jours vous donnent aussi envie de découvrir les musées en dehors de leurs murs, vous trouverez ci-après d’autres idées de balades urbaines muséales !
Marine Laboureau
Pour aller plus loin :
- Et pour une réflexion plus approfondie sur le musée « hors les murs », vous pouvez consulter sur le blog les articles « Lire le musée hors les murs » partie 1 (https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2041-lire-le-musee-hors-les-murs-1-2) et partie 2 (https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2041-lire-le-musee-hors-les-murs-1-2)
- Musée Gadagne : https://www.gadagne-lyon.fr/gadagne/histoire-de-gadagne
- La Maison des Canuts : https://maisondescanuts.fr/histoire/
- Balade urbaine musée Sapeurs Pompiers (Lyon) - https://museepompiers.com/balades-urbaines/
- Balade urbaine Le Rize (Villeurbanne) https://lerize.villeurbanne.fr/vie-du-rize/balades-urbaines-patrimoniales/
- Balade urbaine musée de l'histoire de l'immigration (Paris) - https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2017-10/visites-hors-les-murs
- Balade urbaine musée d’Aquitaine (Bordeaux) - https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/evenement/balade-urbaine-1
- Balade urbaine musée de la Mode de la Province d'Anvers (MoMu) - https://www.momu.be/en/activities/fashion-walk-03-06
#balade urbaine #histoire de la soie #hors les murs

Bébé au musée
Bébés et parents sont les bienvenus au musée du Louvre-Lens pour partager un moment autour d'une oeuvre spécifique. L'animation "Bébé au musée" a été conçu pour vivre ensemble les premiers émois artistiques par le récit, le chant, le dialogue et l'éveil sensoriel. Découvrez le reportage d'Elise sur cette médiation proposée à partir de neuf mois !
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.
Elise Mathieu

Cité Architecture : Sous la Cité, la plage
Le 15 août est passé, mais les vacances ne sont pas encore terminées ! Plus que 2 jours pour aller à la plage, à la Cité de l'architecture et du patrimoine !
Cité Architecture : Sous la Cité, la plage
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.
Noémie Verstraete

Coding goûter
Coding goûter au Musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc, quand le numérique s'invite au musée !
Le musée de Saint-Brieuc propose des après-midi en famille pour découvrir l'univers du numérique au musée ! Inspiré de l'esprit de Museomix, et mis en place en collaboration avec l'association briochine Le phare numérique, l'atelier permet de créer un mini Fab lab au musée ! Les participants sont invités à fabriquer un prototype tous ensemble en une après-midi. Petits et grands mettent la main à la pâte, certains s'initient au code quand d'autres partagent leur talent en dessin et bricolage ! L'important c'est de faire ensemble !
L'atelier peut s'adapter à un sujet, un thème, une exposition, etc. Celui-ci était placé sous le signe du festival Art Rock de Saint-Brieuc et de son exposition Animals !
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.
Justine Faure

Comment nous avons construit une cathédrale
A l’occasion des 800 ans de la cathédrale Notre Dame d’Amiens, la métropole a invité l’artiste Olivier Grossetête à construire une architecture insolite dont il a le secret de fabrication. L’évènement nommé « Les bâtisseurs cartonnent » propose aux habitant.es de participer à la construction d’une cathédrale géante le tout en carton. C’est l’occasion de revenir sur le projet artistique et humain que propose l’artiste au cours de ses interventions à travers le monde.

Affiche de l’évènement « Les bâtisseurs cartonnent » dans la ville d’Amiens.
©AGR
Le concept de l'artiste
Atelier de fabrication et modules d’assemblage.
©AGR
Entre production artistique et médiation collective
Phase de construction sur le parvis de la cathédrale Notre Dame d’Amiens.
©Amiens Métropole
Axelle Gallego-Ryckaert

Conditionnement d'une coiffe au musée de Granville
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.
Lisa Sécheresse
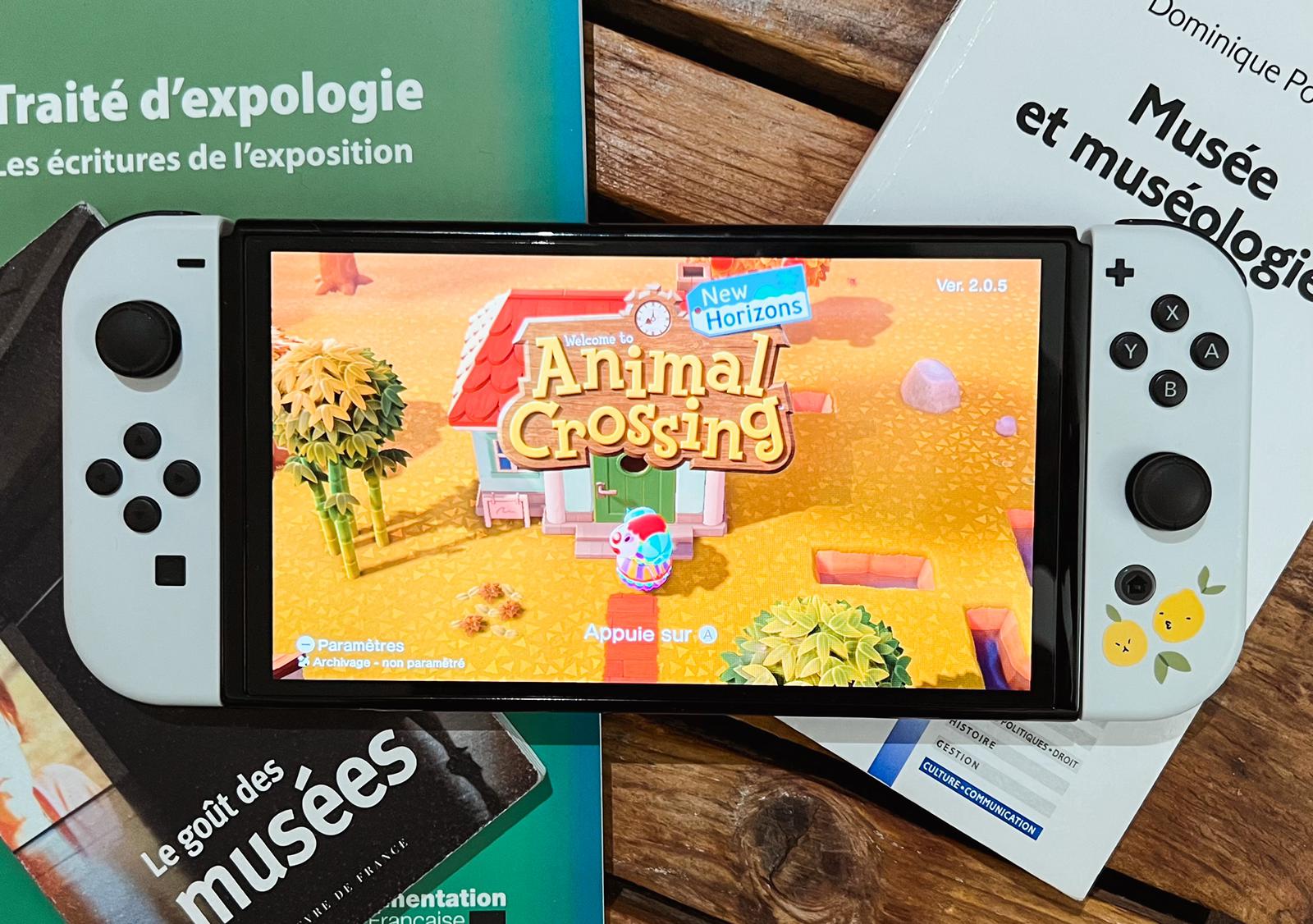
Conquête des publics connectés : où sont les musées ?
Quel avenir pour les musées dans la transition numérique ?
L’engagement numérique des musées les pousse à dématérialiser leurs collections afin de promouvoir l’ouverture culturelle et l’accès au patrimoine. Pour l’instant, peu d'offres de médiations existent réellement avec ces collections numériques. Cependant, les nouvelles problématiques, mises en exergue par la crise sanitaire, ont impliqué les musées dans de nouvelles opportunités sociovirtuelles.
En cherchant à établir un contact avec les internautes, les institutions culturelles répondent par l’accessibilité en ligne de leurs collections. Mais sur le terrain des usages numériques, les musées ne seraient-ils pas en train de passer à côté d’un certain type d'expérience muséale ?
Je vous propose d’évoquer ensemble des actions culturelles menées dans le domaine du numérique : le cas d’Animal Crossing: New Horizon ©.
Crédit image d’intro : Jeu Animal Crossing : New Horizons ©, Nintendo © / Le goût des musées, éditions Le Petit Mercure /Musée et muséologie, Dominique Poulot / Traité d’expologie, Serge Chaumier
Un musée (pas) comme les autres
Replaçons le contexte: nous sommes en mars 2020, en plein premier confinement en France, avec pour principales distractions : instagram, netflix et les jeux vidéo. La coïncidence veut que le dernier jeu Animal Crossing, très attendu, vient de sortir et trouve très rapidement son public dans cet environnement d’attente et d’incertitude.
Édité par Nintendo pour sa console, la Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons est un jeu de simulation de vie avec une nature immersive. Le gameplay est simple: customiser sa propre petite île, tisser des liens amicaux avec ses voisins, des animaux anthropomorphes et explorer les alentours. Le jeu japonais propose également une fonctionnalité qui va ici nous intéresser : la possibilité de compléter les collections du musée de l’île !
Quand il est tard le soir et que toute l'île est endormie, un petit hibou, Thibou, conservateur du musée, est bien réveillé et peut converser avec vous toute la nuit. Il laisse les portes de son musée ouvertes jour et nuit, pour vous permettre de vous balader dans les collections qui invitent à la balade et la rêverie.
Le musée se divise en 4 sections : les fossiles, les animaux marins, les insectes et la section "œuvres d’art” qui est intégrée en mai 2020. Le musée ne se caractérise pas par son implication culturelle sur l’île mais par sa fonction de recensement des ressources vivantes et sa dimension de collection d’objets rares du jeu. Ainsi les joueurs se lancent à la recherche de toutes les espèces différentes en pêchant des poissons, en attrapant des insectes ou en déterrant des fossiles. Mais il peut également acheter des œuvres d’art, auprès du mystérieux personnage de Rounard, qui fait halte sur l’île seulement quelques jours par mois. En moyennant quelques clochettes (monnaie du jeu) et en aiguisant son regard pour ne pas se faire revendre une contrefaçon, le joueur peut acquérir des chefs d'œuvres comme la Joconde ou le penseur de Rodin et les intégrer à son musée. Tel un trafiquant d'œuvres d’arts venu d’une autre réalité, Rounard fait la passerelle entre notre univers culturel et le monde d’Animal Crossing.
Dans un jeu de simulation de vie imitant nos pratiques, le musée est un vecteur de lien entre le monde réel et virtuel. Le jeu, ainsi que ces possibilités, ont conquis les internautes et certains musées. Dans un souci de se rapprocher de ses visiteurs, plusieurs initiatives sont nées des potentiels de médiation qu’offre le jeu.

La section oeuvres d’arts du musée, Jeu Animal Crossing : New Horizons ©, Nintendo©
Léo Tessier, médiateur scientifique au Muséum d’Angers, connaît bien l’univers des musées, il en a fait son métier. Et ce jeu vidéo l’inspire. Il met en place dès avril 2020, des visites virtuelles, sous la bannière de son musée dans la vie réelle. Le Nintendo Switch Online permet aux joueurs de se connecter entre eux et de s’inviter les uns chez les autres pour venir découvrir son île. Léo organise ainsi des visites de 7 personnes maximum (jauge du jeu), connectées en parallèle sur skype, et avec ce groupe réduit il mélange ses deux passions, les musées et les jeux vidéo. Il présente les collections d’Animal Crossing et n’oublie jamais de faire le lien avec son musée, à Angers.
Visite virtuelle par Léo Tessier, Muséum d’Angers / Jeu Animal Crossing : New Horizons ©, Nintendo©
« Je me suis dit que ce serait rigolo de recréer le muséum : la collection est bien sûr différente et moins fournie (une soixantaine d’objets contre 500.000 !). Mais on peut faire des parallèles : dans le jeu, où il y a un vrai souci de réalisme, j’ai par exemple un plésiosaure, ce gros reptile marin de six mètres de long et sa grande mâchoire, également présenté au Muséum. » Livre t’il dans un article pour le magazine 20 minutes.
L’initiative a commencé timidement, avec quelques créneaux, et a rencontré un franc succès. Un planning s’est vite instauré et les visites (complètes) se sont déroulées régulièrement pendant les deux mois du confinement. La visite de Léo Tessier était très pédagogique et inventive, mais également humaine et participative. Le médiateur a su transposer virtuellement une expérience de visite.
Passion culture
Imiter sans égaler
Si l'on peut saluer ces deux initiatives, les musées peinent encore à trouver leur place dans le paysage virtuel dans lequel les collections s’immiscent, mais quid de l’expérience muséale… En effet, si l’intégration, de plus en plus courante, des nouvelles technologies dans les espaces d’exposition s’avère conquérir les publics, les musées semblent encore peu innovants sur leurs propositions dématérialisées.
Voyons le cas du musée du Prado qui a créé sa propre île sur le jeu en reconstituant son propre musée. Dans un souci d’accessibilité pour les personnes ne possédant pas la console ou le jeu, des visites virtuelles sont disponibles sur Youtube. La proposition semble plus éloignée des deux précédentes en cherchant plus à tirer profit d’un effet de mode que de mettre en place une réelle ambition culturelle. En simulant leur musée dans Animal Crossing, le musée du Prado tombe dans l’écueil de simplement transposer ses collections et son identité graphique, sans exploiter l’interaction avec les visiteurs.
Un besoin de réinventer
Deux ans après le premier confinement, la fréquentation des musées n’est toujours pas remontée à sa jauge d’avant pandémie. Un besoin de se réinventer émerge.
Et si le temps était venu de continuer à explorer les espaces numériques et d’apporter des changements dans notre accès à la culture ? Et si les espaces culturels commençaient à créer des liens durables avec le public connecté ?
A l’heure ou la transition numérique est en plein essor, de nombreuses plateformes (jeux vidéo, Instagram, Facebook, …) s’installent dans les pratiques d'accès à la culture et la conditionne. Par leur rôle et leur essence, il devient alors important (peut être vital ?) que les institutions culturelles s’adaptent rapidement aux questions relatives au numérique.
Les musées gagneraient à exporter l'expérience utilisateur plutôt que simplement les contenus. Même si l’accessibilité des collections est une valeur enrichissante pour la communauté, il est intéressant d'appréhender la médiation et l'expérience de visite comme pouvant s’étendre jusque dans les univers virtuels. Les internautes restent des visiteurs, curieux de découvrir et de vivre de nouvelles expériences. Il ne s’agit plus seulement de transposer, mais d'habiter, d’inventer, de faire vivre et vibrer les visiteurs, tant dans les musées, que sur la toile.
Les musées ont toutes les clés pour conquérir les nouveaux espaces numériques, à eux d’en tirer parti.
Drella Hubert
Pour aller plus loin :
- https://experiments.getty.edu/ac-art-generator/
- https://www.rfi.fr/fr/culture/20220108-entre-coup-de-com-et-v%C3%A9ritable-m%C3%A9diation-culturelle-les-mus%C3%A9es-s-allient-aux-jeux-vid%C3%A9o
- https://medium.com/museonum/explorer-les-possibilit%C3%A9s-des-collections-ouvertes-avec-animal-crossing-new-horizons-742e3a60fb4c
#AnimalCrossing #JeuxVidéo #MédiationNumérique #MuséeVirtuel

Dans les musées d'art, on touche avec les yeux ?
Qui n’a jamais rêvé de toucher une sculpture en se baladant dans les ailes du Musée du Louvre ou encore de sentir la douceur du marbre des colonnes du forum antique de Rome sous ses doigts ? Toucher les œuvres dans un musée ou sur un site archéologique est tabou. Entre sécurité des œuvres et satisfaction du public, n’y aurait-il pas un compromis à trouver ?
Le musée d'art, un lieu sacré
Il est interdit de toucher les objets d’art dans un musée pour des raisons de conservation des œuvres. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Pendant la Renaissance, il fallait toucher en plus de regarder pour appréhender l’objet dans son ensemble. Dès le 19e siècle, le nombre de visiteurs s’accroît, et pour préserver les œuvres une interdiction formelle de toucher s’impose dans les institutions muséales. Le monde des musées se professionnalise dans les années 1970 et cinq fonctions principales lui sont attribuées : acquisition, conservation, étude et recherche, interprétation et exposition. Aucune mention du visiteur.
Nous avons déjà tous ressenti cette frustration en nous promenant dans les allées d’un musée de ne pas pouvoir toucher des œuvres dont les matériaux nous intriguent et les couleurs nous appellent. Dans une perspective de développer leur rôle social auprès du public, les musées mettent en place des expériences de visite, notamment en s’appuyant sur le sensoriel. Ainsi, le toucher commence à retrouver une place dans l’appréhension des œuvres par le visiteur.
Toucher pour mieux voir ?
Certains musées ont d’ores et déjà mis en place des dispositifs tactiles au service des visiteurs dans le cadre d’événements ponctuels. Le Musée des Beaux-Arts de Lyon par exemple a pensé une exposition temporaire L’art et la matière. Prière de toucher proposant au visiteur de découvrir les œuvres en les touchant pour comparer les différents matériaux. Dix reproductions d’œuvres d’art sont exposées retraçant l’histoire de la sculpture de l’Antiquité au 20e siècle. En plus d’admirer les œuvres, le public peut exceptionnellement les toucher.

La Galerie tactile du Musée du Louvre © Musée du Louvre, Antoine Mongodin
Des dispositifs tactiles sont également proposés aux personnes malvoyantes et non-voyantes, pour faciliter l’accès à des contenus qu’ils ne pouvaient pas appréhender auparavant. C’est le cas du Musée du Louvre qui a mis au point une galerie tactile mettant à disposition du visiteur des moulages en résine, en plâtre ou en bronze. Il peut ainsi toucher différents matériaux et différentes textures et appréhender les volumes des œuvres en trois dimensions. Un objet d’art peut être lu par des personnes souffrant de déficiences visuelles si on lui en donne les moyens. Dans une perspective de démocratisation culturelle, enjeu au centre des préoccupations muséales, développer ce type de dispositif est une évidence.
Solliciter les sens de manière pérenne

Matériauthèque du Musée National Fernand Léger @ Musée National Fernand Léger
D’autres solutions existent : comme installer une matériauthèque. Un dispositif simple contenant des échantillons de différents matériaux, scellés à un socle et en libre accès pour le visiteur. Le Musée National Fernand Léger a mis en place une salle dédiée à la découverte de différentes pâtes de verre et pierres de mosaïque par le toucher. En visite libre ou en visite accompagnée pour les publics en situation de handicap, ce dispositif raconte l’histoire de la mosaïque monumentale réalisée pour la façade principale du musée en 1960, d’après un projet de décoration murale de Fernand Léger. La matériauthèque permet ainsi au visiteur de découvrir l’œuvre sous un nouvel angle en faisant appel à un autre sens que la vue pour apprendre à regarder différemment. Ludique et demandant plus de concentration car mobilisant un sens supplémentaire, la matériauthèque rend également plus facile la compréhension d’une œuvre et le souvenir que l’on en garde.
Lisa Sécheresse
#toucheraumusée
#expériencesensorielle
#dispositiftactile
Pour aller plus loin :
https://www.louvre.fr/la-galerie-tactile
http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/expositions-musee/l-art-et-la-matiere/l-art-et-la-matiere.
Image de couverture : Vue de l'exposition L'Art de la matière. Prière de toucher au Musée des Beaux-Arts de Lyon © Musée des Beaux-Arts de Lyon
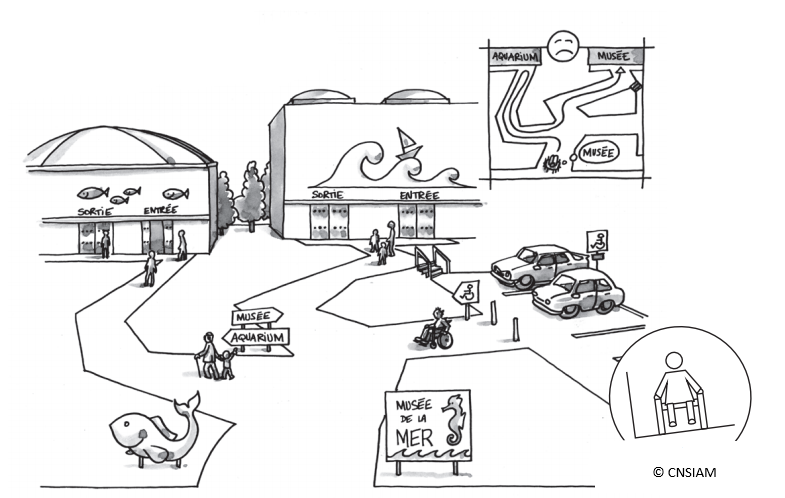
De l’accessibilité à l’inclusion : la conception universelle à l’épreuve des musées
Imaginez que vous souhaitiez vous rendre au musée. Après avoir traversé tout Lille, pris les transports en commun, traversé des routes très fréquentées, vous arrivez enfin devant le musée. Devant vous se dresse une volée de marches pour accéder à l’entrée principale, vous ne pouvez pas les emprunter et devez donc faire un détour pour emprunter une porte isolée. Vous sonnez et attendez qu’un agent vienne vous ouvrir. Pourquoi devriez-vous attendre et effectuer des efforts supplémentaires alors que d’autres peuvent emprunter l’entrée principale ? C’est ce que vivent chaque année des milliers de visiteurs en situation de handicap qui ne peuvent pas emprunter les mêmes entrées ou participer aux mêmes activités que les valides en autonomie.

Entrée PMR à distance de l’entrée visiteurs, Palais des Beaux-Arts de Lille © CHF
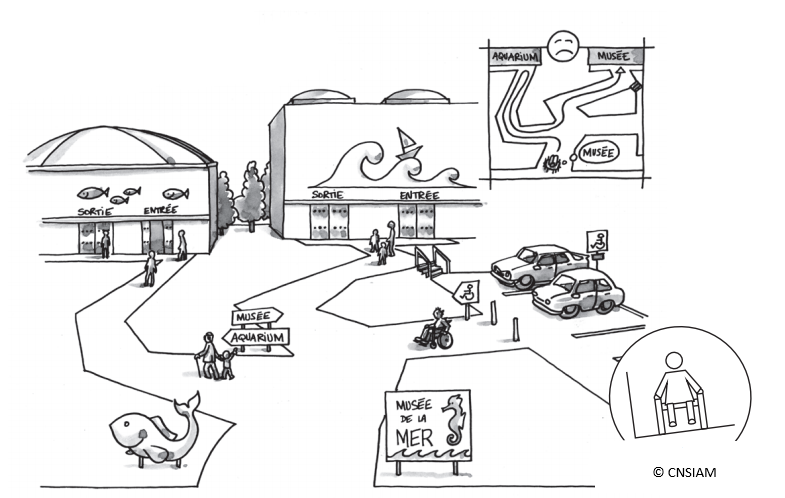
Entrée pour tous, inclusive © CNSIAM
Bien qu’il soit obligatoire d’avoir une entrée accessible aux personnes en situation de handicap, rendre son site accessible en ouvrant un accès PMR n’est pas suffisant. L’accessibilité des prestations et du bâtiment est mise en avant par les lois handicap successives mais la mise aux normes des établissements culturels recevant du public ne suffit pas à offrir une vie culturelle inclusive et confortable aux personnes en situation de handicap.
Dans le domaine de la culture, on entend par inclusion, le mélange de tous les visiteurs, quelle que soit leur origine ou leurs capacités dans une même expérience muséale commune et indifférenciée. Cet idéal paraît utopiste et compliqué à mettre en place, pourtant, en changeant de paradigme et en incluant les usagers dans le processus de création, l’utopie peut devenir réalité.
L’accessibilité, la surface émergée de l’iceberg
« Je ne vais pas très souvent au musée, j’aimais beaucoup avant, mais maintenant j’aime beaucoup moins, vue ma problématique [sa situation de handicap moteur et visuel, ndlr]. Le musée c’est très fatigant quand on n’a pas d’endroit où s’asseoir, quand on n’a pas d’audio description ou pas de choses tactiles. » - Lucienne Landais, visiteuse de musée en situation de handicap visuel.
Rendre sa structure culturelle accessible est une première étape pour permettre aux visiteurs en situation de handicap d’accéder à la culture muséale, mais il s’agit du sommet émergé de l’iceberg. En réalité, la visite culturelle se prépare en amont et commence dès le site internet, en passant par la voirie, les transports en commun jusque dans la structure. Il s’agit de la chaîne de déplacement, ou chaîne d’accessibilité, du domicile de la personne jusqu’à la fin de son expérience culturelle. Les points clés de la chaîne d’accessibilité sont : l’accès à l’information, la sortie du domicile, la voirie, les transports en commun ou le parking, l’entrée dans le bâtiment, l’accueil, les circulations, les sanitaires et la signalétique. Si l’une de ces zones est impraticable ou impossible à passer par le visiteur, alors la chaîne d’accessibilité est brisée, et quand bien même l’offre culturelle est accessible, le visiteur en situation de handicap risque de ne pas se déplacer jusque dans votre structure.
La mise en accessibilité de ces éléments constitue ainsi une amélioration vers une autonomie des personnes en situation de handicap, mais est loin d’être suffisante. En obligeant un usager en situation de handicap moteur à faire un tout autre chemin pour accéder à une offre culturelle ou bien en ne lui donnant accès au lieu qu’à travers une visite guidée, il s’agit d’une pratique ségrégationniste. « On n’a pas tous envie d’une visite guidée, il y a des jours où tu veux être autonome » (Lucienne Landais, visiteuse de musée en situation de handicap visuel). En créant une offre culturelle destinée uniquement aux personnes en situation de handicap et en les mettant ainsi à part des personnes dites « valides », c’est de l’intégration mais pas de l’inclusion, la bulle entre personnes en situation de handicap et personnes « valides » n’est pas rompue. La différence est marquée et renforcée et s’apparente à une ségrégation des personnes en situation de handicap.
Vers la conception universelle, répondre aux besoins spécifiques de certains pour améliorer le confort de tous.
La mise en accessibilité d’une structure peut être coûteuse, pour économiser du temps et de l’argent, et éviter de devoir créer un dispositif par type de handicap ou par profil de visiteur, il ne faut pas penser adaptation mais changer l’angle de vue, le curseur sur le problème. Démultiplier les offres par type de handicap est ainsi chronophage et inutile, c’est pourquoi, lors de la création d’expériences muséales, il convient de créer une offre englobant les besoins de tous, en situation de handicap ou non. C’est la ligne de pensée que revendique Signes de Sens, une association lilloise qui croit que le handicap est un levier d’innovation et que les besoins particuliers des personnes en situation de handicap peuvent être un point de départ à la création d’expériences utiles et bénéfiques à tous. Au lieu de créer un parcours alternatif pour les personnes en situation de handicap, transformez ce parcours alternatif en nouveau parcours pour tous les visiteurs.
C’est ce qu’a fait le Musée de l’Homme à Paris en créant des reproductions d’œuvres ou d’objets accompagnées de dispositifs sonores rendant possible la découverte de la galerie de l’Homme par le toucher et par l’écoute. Ces dispositifs ont été créés en ayant à l’esprit, les besoins des publics en situation de handicap visuel, pourtant, ils ont été placés dans le parcours de visite classique. Les besoins spécifiques des visiteurs en situation de handicap visuel sont ici satisfaits, toutefois, en répondant aux besoins spécifiques des uns, le Musée de l’Homme améliore la visite de tous. En ne passant pas exclusivement par le texte, en permettant aux visiteurs de découvrir le parcours de visite par les sens, le musée de l’Homme et en ne reléguant pas le parcours sensoriel à une salle annexe du parcours, le musée de l’Homme propose une manière intéressante de créer une expérience de visite inclusive et universelle.

Visiteur observant des reproductions à toucher d’ossements dans le parcours d’exposition du Musée de l’Homme © Mon cher Watson
Prenons également l’exemple du musée Carnavalet de Paris. En créant leur exposition temporaire en cherchant avant tout à résoudre les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap et en réécrivant ses documents en écriture claire et facile à lire pour répondre aux besoins d’usagers avec des troubles cognitifs. Les visiteurs avec troubles cognitifs peuvent présenter des difficultés de lecture, notamment avec la lecture des chiffres romains. En effet, dans les règles du FALC (facile à lire et à comprendre), qui consiste à produire des documents accessibles à ces visiteurs, l’usage de chiffres romains est déconseillé. Ainsi, l’équipe a choisi de les traduire en chiffres arabes pour simplifier la lecture pour tous les visiteurs.
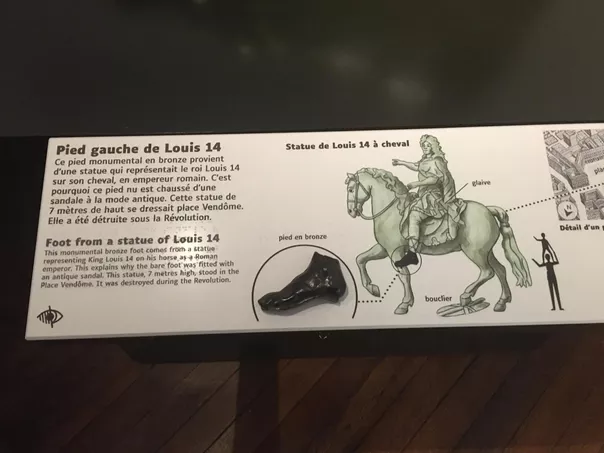
Photographie des cartels du Musée Carnavalet © Le figaro
« C'est uniquement, sur 170 textes, sur un ensemble de 3 000 contenus, qui ont été produits pour le nouveau parcours dans le musée, que nous avons choisi d'appliquer cette mesure d'accessibilité universelle. C'est une recommandation européenne, pour une information facile à lire et à comprendre » - Noémie Giard, cheffe du service des publics au musée Carnavalet – Histoire de Paris
Cette adaptation n’est pas uniquement destinée aux visiteurs en situation de handicap cognitif, mais profite également à l’enfant qui apprend à lire de mieux appréhender les informations, mais également à l’usager de nationalité étrangère d’avoir accès à l’information. Et il servira également aux usagers de structures culturelles qui peuvent, en fin de journée, ne pas avoir envie de lire de longs textes pour trouver l’information qui les intéresse. Ce type de refonte pour une accessibilité universelle des informations a déjà été effectué dans d’autres musées européens comme le Louvre ou le British Museum depuis déjà quatre ans. Cette adaptation de l’écriture des contenus est ainsi née d’un besoin des personnes en situation de handicap cognitif et servira tous les publics à court ou long terme. Le musée Carnavalet se place ici dans une démarche de conception universelle.
Malgré ces initiatives à visée universelle, beaucoup reste à faire pour se diriger vers une expérience muséale inclusive, car nombre de dispositifs inclusifs et universels sont finalement le fruit du hasard et n’ont pas été réfléchis comme tel. Charles Gardou définit la société inclusive comme soutenue par cinq piliers fondateurs dont font partie la prise en compte des besoins de tous mais aussi l’abandon des phénomènes de hiérarchisation, le partage du patrimoine humain et social commun, le droit d’exister au-delà du droit de vivre, ainsi que la reconnaissance de la diversité.
La diversité humaine* se reconnaît au-delà du handicap. En 1983 Edward Gardner théorise que chaque personne a une manière de réfléchir différente des autres, elle peut être musicale, kinesthésique ou encore logico-mathématique. A travers cette théorie des intelligences multiples, il conçoit que chaque personne pense différemment. C’est un des biais par lequel on peut comprendre la conception universelle. Ainsi, en offrant une expérience muséale mobilisant au maximum les 8 intelligences d’Edward Gardner, la structure culturelle touche un panel de visiteurs plus larges, sans handicap, mais également les personnes en situation de handicap. L’intelligence kinesthésique et l’imitation d’une œuvre par son corps par exemple peut aider un visiteur avec troubles du spectre autistique d’appréhender une œuvre ou une exposition, là où l’écrit aurait échoué. Les expositions muséales sont encore aujourd’hui trop visuelles et reposent majoritairement sur l’écrit, l’image et l’objet exposé, alors que les autres sens sont encore sous-exploités. Pourtant, pour qu’un visiteur puisse retirer ce qu’il souhaite de l’exposition (un sentiment, une information …), il lui faut pouvoir passer par le canal qui lui convient le mieux, ce à quoi la pluri sensorialité et les espaces sensoriels dans les musées répondent. D’autant plus qu’une approche tactile, par exemple, bénéficiera à tous les publics. Il est notamment prouvé que l’approche tactile aide à la rétention d’informations par les publics. Elle bénéficie aux personnes en situation de handicap visuel, mais aussi aux voyants : Henri Focillon (Éloge de la main, 1934), « « Mais les voyants eux aussi ont besoin de leurs mains pour voir, pour compléter par le tact et par la prise la perception des apparences ».
« Laissez-nous toucher. Mettez-nous des reproductions, rien que pour avoir le regard de la statue. En touchant, on voit dans notre cerveau. Laissez-nous voir à travers nos mains vos sculptures, mêmes vos tableaux, même un relief de tableau, ça peut nous apporter beaucoup. » - Lucienne Landais, visiteuse de musée en situation de handicap visuel.
Grâce à cette réflexion sur les intelligences multiples, nous nous rendons compte que créer des expériences muséales pour tous, et non plus par handicap, atténue la séparation entre visiteurs en situation de handicap et visiteurs « classiques ». Au-delà d’un gain financier, créer des expériences universelles aide à viser juste. Au sein d’un handicap, il existe une multitude de ressentis personnels. Le trouble du spectre autistique est caractérisé par des symptômes qui sont, par définition, tellement variés qu’ils représentent un spectre de possibilité d’adaptations, cela est moins connu mais c’est également le cas pour les personnes en situation de handicap visuel, auditif ou encore moteur. En effet, à handicap équivalent, deux personnes en situation de handicap visuel n’auront pas les mêmes besoins, l’une préfèrera avoir des dispositifs en braille alors qu’une autre ne saura pas le lire. Produire des expériences universelles ouvre les programmations culturelles à tous ces publics, au-delà de leurs handicaps.
Vers l’inclusion : faire « avec »*, ou comment éviter la maladresse accessible
Créer des contenus en ayant en tête le concept de conception universelle améliore donc non seulement l’accessibilité des structures culturelles au plus grand nombre, mais aussi de gommer les différences entre les différents visiteurs, évitant ainsi de mettre les visiteurs en situation de handicap face à leurs difficultés. La conception universelle initie un premier pas vers l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les musées et vers une expérience universelle et inclusive du musée.
Toutefois, connaître les besoins de ses publics ne suffit pas à créer des dispositifs adaptés. Pour produire des dispositifs fonctionnels et inclusifs, il faut travailler de concert avec les publics concernés, cela permet d’éviter d’oublier des besoins, de mal les comprendre ou encore de viser à côté du besoin en pensant bien faire. Le meilleur exemple reste le braille. De nombreux musées traduisent tous leurs cartels en braille pour rendre accessible leurs contenus aux visiteurs en situation de handicap visuel. Pourtant, sur la totalité des visiteurs malvoyants ou aveugles, seuls 10% lisent le braille. De plus, traduire un cartel en braille n’est pas accessible aux visiteurs malvoyants qui ne savent pas le lire et ont simplement besoin que ces textes soient rédigés en gros caractères.
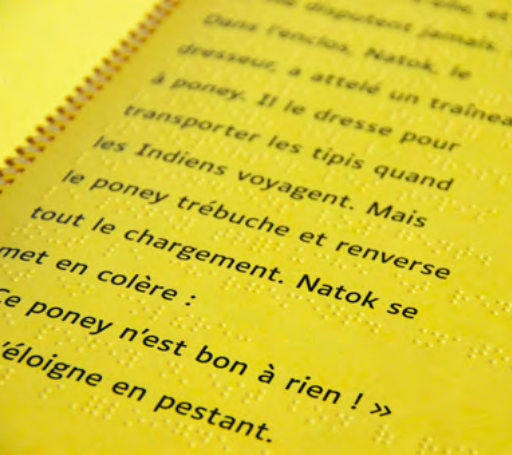
Page de livre en gros caractères et braille, Les belles histoires, Winona, la cavalière des plaines © Mes mains en or
« S’ils font des cartels en braille, qu’ils les fassent aussi en grands caractères. » - Lucienne Landais, visiteuse de musée en situation de handicap visuel.
Cet exemple de cartels uniquement en braille représente parfaitement ce que l’on appelle la « maladresse accessible »*, en voulant bien faire, il est courant de ne pas atteindre son objectif ou que le dispositif ne soit pas inclusif car le public concerné n’a pas été consulté et que des aspects importants de l’accès à l’objet ont été oubliés. C’est pourquoi il est important de garder à l’esprit que, si bienveillant que nous puissions être, si nous ne sommes pas en situation de handicap, nous ne pouvons pas comprendre l’étendue des difficultés rencontrées par nos publics.
« Je pense qu’il y en a beaucoup qui n’imaginent même pas nos difficultés. Nous, en tant que personnes en situation de handicap, on ne montre pas nos difficultés donc ils n’imaginent pas. Il faut côtoyer ou travailler avec des personnes en situation de handicap pour comprendre. » - Lucienne Landais, visiteuse de musée en situation de handicap visuel.
Afin d’éviter cet écueil et la perte de temps et d’argent qui peut l’accompagner, il est important de travailler directement avec les publics ciblés. Cette collaboration est essentielle à la pertinence du dispositif créé et peut se penser à court terme, en faisant appel pour la durée du projet à une personne en situation de handicap, une association, ou à long terme, en constituant un comité à consulter pendant les différents projets de la structure constitué de personnes en situation de handicap et de personnes sans handicap. Ce processus d’inclusion des personnes en situation de handicap dans la création des dispositifs leur étant destiné en premier lieu est une pratique qui bénéficie tant aux destinataires qu’à la structure culturelle.
NB : Les propos rapportés des témoins ne représentent qu’un point de vue sur le sujet et n’ont pas valeur d’universalité.
*: contenus et termes étudiés par Maëlle Bobet, cheffe de projet culture et inclusion chez Signes de Sens, dans le cadre de ses projets au sein de l'association.
#Inclusion #ConceptionUniverselle#Handicap
Pour aller plus loin :
-
Charles Gardou, La société inclusive, parlons-en ! : Il n'y a pas de vie minuscule, Erès 2012
-
http://reglementationsaccessibilite.blogs.apf.asso.fr/tag/universal+design%3B+conception+universelle
-
Exposition et parcours de visite accessibles, guide du ministère de la culture, 2016

Déjeuner au fond de la mine
Une mine d’ardoise au cœur des Ardennes belges
Une fois les blocs remontés à la surface, les fendeurs prenaient la relève. Travaillant à l’extérieur de la mine – un privilège ! – ils étaient chargés de découper les énormes blocs remontés des profondeurs en fines ardoises de 3 à 5 millimètres d’épaisseur prêtes à être posées. Payés au nombre d’ardoises découpées, ils travaillaient jusqu’à 10h par jour, pour sortir quotidiennement plus d’un millier d’ardoises. Celles-ci étaient ensuite chargé directement dans des camions pour être livrés.
Vestiges d'outils dans une galerie ©Chatenet A.
Du paternalisme au renouveau économique
Le système mis en place par les exploitants de la mine correspond complètement au schéma du début de l’industrialisation. Afin d’attirer les travailleurs, la paie est meilleure que celle des journaliers dans les champs et le travail ne dépend pas des saisons, provoquant un petit exode rural. Les salaires sont versés toutes les semaines – sauf pour les porteurs et les fendeurs – en fonction de la production des équipes, encourageant un travail acharné. En contrepartie, toutes les infrastructures appartiennent au patron, notamment le magasin général et surtout le bar, qui récupère ainsi une bonne partie de l’argent investi. Le patron contrôlait alors tous les domaines de la vie du mineur, de l’offre du travail à l’approvisionnement en biens de première nécessité, en passant par le divertissement.
La région de la Wallonie a particulièrement souffert de la fermeture des mines, et de manière plus générale, du déclin industriel de toute l’Europe de l’Ouest. De même qu’en Allemagne de l’Est, en Lorraine ou dans les Hauts-de-France, la disparition des grands employeurs et l’arrêt des usines a provoqué une crise économique et un chômage de masse dont les effets sont toujours visibles de nos jours. De nombreux savoir-faire ont alors disparu en même temps que les métiers, qui sont aujourd’hui remis en valeur comme partie intégrante de notre patrimoine historique.
Pour relever la tête, la Wallonie cherche alors à développer le tourisme, pour profiter de ses retombées économiques, en mettant en valeur à la fois son patrimoine naturel comme la Grotte de Han, et son patrimoine historique tel que le château de Bouillon ou l’abbaye d’Orval. Dans ce contexte de renouveau, d’anciens mineurs réhabilitent l’ardoisière en 1997 en créant « Au cœur de l’ardoise ». Ce ne fut pas une mince affaire ! Il a d’abord fallu pomper une grande partie de l’eau qui avait envahi la totalité de la mine (six mois de pompage furent nécessaires), puis nettoyer les montagnes de déchets envahissant l’espace. Aujourd’hui, seul l’étage le plus haut – à 25 mètres de profondeur – est accessible au public, l’étage intermédiaire servant de zone de sécurité par rapport au niveau de l’eau. La visite est libre, avec l’installation de plusieurs bornes interactives et multilingues (français, néerlandais et wallon), ou guidée. L’option qui vous est proposée ici est plus originale : la visite « mine gourmande ».
La Grotte de Han ©Chatenet A.
Un pari risqué
La salle à manger ©Chatenet A.
Chim Chollin
#AuCoeurDeLArdoise
#MineGourmande
#VisiteInsolite
#PatrimoineIndustriel
Pour réserver votre visite gourmande : http://www.aucoeurdelardoise.be/fr

Des assassins aux Invalides
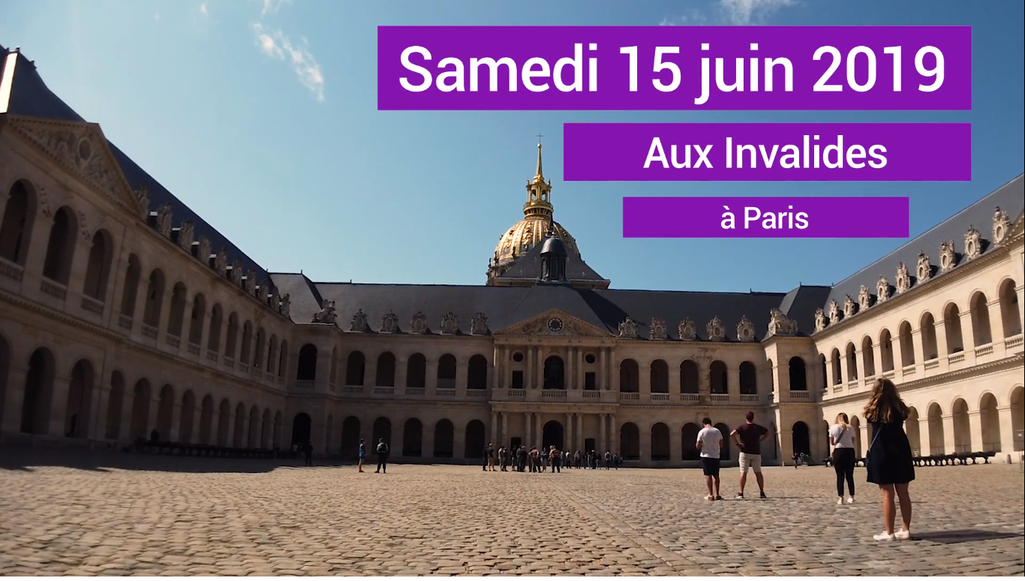
L’expérience Assassin’s Creed a été accueillie à trois reprises par le Musée de l’Armée à l’Hôtel national des Invalides. À elles seules, les deux premières éditions (vacances de Toussaint et de Noël 2018) ont réuni plus de 11 000 participants. Il s’agit là d’un jeu immersif basé sur l’univers d’Assassin’s Creed, un des jeux vidéo phares d’Ubisoft. L’agence Cultival, spécialisée dans la médiation culturelle, s’est chargée de l’élaborer à leurs côtés. Par le biais de cet « escape game » à demi-ciel ouvert, les participants découvrent ou redécouvrent le lieu, ayant même accès à des parties habituellement interdites au public au cours du jeu. Celui-ci, après les explications et modalités énoncées, leur laisse 1h30 pour venir à bout de leur mission et ainsi parcourir ces bâtiments historiques en renouvelant leur regard. Seuls ou accompagnés, ils errent guidés par leurs smartphones (un pour deux, maximum), et force est de constater que le collectif est plutôt préféré …
Attendez. Et si on présentait tout ça autrement … ?
Signe distinctif de participant facilitant l’accès à l’Église du Dôme © Emeline Larroudé
« Dans le tombeau de l’aigle,
Caché sous un autre ciel
Sur lequel les anges veillent
Le fruit défendu attend »
L’année 2018 a vu renaître un conflit historique : celui des descendants d’assassins et de templiers (ou serait-ce les rosicruciens du XXIe siècle ?). Une première vague a vu plus de 11 000 d’entre eux s’affronter, bizarrement un peu avant la Toussaint succédant à la fête des morts … Coïncidence ? De mi-juin à début juillet 2019, ils ont lancé une nouvelle offensive, toujours empreinte de discrétion, à l’ombre de nombreux regards, dans les coulisses de l’Hôtel national des Invalides. Guidés par les astres tant solaires que lunaires, de nuit comme de jour, ils se sont mobilisés pour percer un des secrets les plus énigmatiques de Napoléon 1er : l’emplacement de la Pomme d’Eden. Héritée de la Première Civilisation, on lui prête des pouvoirs inestimables qui auraient, par ailleurs, servis à l’empereur … La détenir reviendrait alors à avoir accès à une puissance incommensurable.
Mais, n’y a-t-il pas là comme un petit problème ? Rien ne vous titille ?

Vues intérieures de l’Eglise du Dôme © Emeline Larroudé
Cette deuxième version est, indéniablement, romancée. Elle mêle fiction et réalité si bien que sa lecture en est floue : comment prendre la mesure de cette porosité ? Qu’est-ce que le lecteur doit vraiment prendre en compte ? C’est peut-être là toute l’ambiguïté de cette expérience. « Enquête très stimulante, mi-historique, mi-fiction », nous dit Le Parisien. J’irai plus loin encore. Trois niveaux de lecture sont possibles : ce qui relève de l’univers Assassin’s Creed créé par Ubisoft ; ce qui relève de l’adaptation de l’univers Assassin’s Creed au lieu et à son histoire ; ce qui relève de l’histoire du lieu. Une fois ce constat établit, comment les distinguer de fait ? L’exercice semble bien ardu. S’il ne paraît pas nécessaire d’avoir déjà parcouru le dit jeu-vidéo pour avoir envie de participer, le faire, et réussir la mission à temps, les amateurs peuvent avoir certaines clés de compréhension supplémentaires qui manqueront aux participants lambda (symboles, univers, … et plus largement ce qui relève de la citation du jeu, notamment AC II ou encore AC Unity). Comment donc cette visite peut-elle alimenter sa culture personnelle lorsque, malgré le bon temps passé et l’attention portée aux différentes énigmes, l’on ne sait pas ce que l’on doit vraiment en retenir ?
Arrêtons-nous sur la devise des Assassins : « Rien n’est vrai, tout est permis ».

Hôtel national des Invalides, et modalités de jeu sur l’application dédiée © Emeline Larroudé
Qui plus est, qui sont ces assassins et templiers des temps modernes ? A l’inverse des institutions culturelles prônant généralement le « tout public » à tel point qu’elles finissent parfois par ne s’adresser à personne, le game design s’attache véritablement à cette question. Il propose alors des projets pertinents qui touchent le public visé, déterminé bien en amont, au lancement. Ici, même si l’expérience est ouverte à tous, il semblerait que le public visé soit plus particulièrement celui des jeunes adultes voire adolescents, adeptes de jeux-vidéos mais pas seulement. Pour résumer, le type de public qui se fait rare dans ces institutions culturelles qui n’arrivent pas à le mobiliser et ne savent comment l’attirer. L’univers emprunté, la durée de l’expérience, le niveau de difficulté des différentes énigmes … Tout est pensé pour eux. Le cadre « ludique », cependant, nuit lui aussi à l’apprentissage. Globalement, le but de ces joueurs est de gagner (c’est aussi le but des organisateurs), qu’ils soient bons ou mauvais perdants. Mais cette quête de la réussite amène parfois à privilégier l’efficacité, la rapidité, à l’attention qui ne se porte alors que peu sur le contenu quant à lui toujours ambigu.

Vues extérieures de l’Hôtel national des Invalides © Emeline Larroudé
Pourquoi, cependant, l’objectif serait-il d’apprendre ? Ne pourrait-on pas se contenter de la venue de milliers de personnes qui, peut-être, ne s’étaient jamais rendues en ce lieu auparavant, voire ne s’y étaient jamais intéressées ? Ces visiteurs, conquis par l’expérience, s’y rendront peut-être à une autre occasion pour tenter de percer ses véritables mystères … Soit. A cet égard, le score de plus de 11 000 participants en seulement deux sessions est remarquable. Par ailleurs, le fait que le Musée de l’Armée ait accueilli trois fois l’expérience est significatif : la plupart des séances (limitées à 20 personnes, mais proposées toutes les demi-heures environ) ont affiché complet, ce qui témoigne d’un engouement réel. Soulignons cependant que, si c’est là le résultat attendu (à savoir de nouveaux visiteurs conquis qui auraient moins de scrupules à pousser les portes du lieu une prochaine fois), malgré une bonne expérience, ludique, ce but est rarement atteint par les organisateurs. Pourquoi ? Peut-être parce que la visite classique n’est pas en mesure de leur apporter les sensations promises, elles, par un escape game ou un de ses cousins, et donc perd de l’intérêt pour eux.
Quoi qu’il en soit, l’expérience a le mérite indéniable d’être singulière et de conquérir les cœurs des participants, primo-visiteurs pour la plupart, qui s’en souviennent comme d’un moment très agréable et qui y associent le lieu, devenant décor 4D du jeu.
Voir la vidéo :
Emeline Larroudé
#museedelarmee
#cultival
#assassinscreed
#experienceassassinscreed
#escapegame
#ubisoft
Liens internet :
https://www.musee-armee.fr/accueil.html
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur notre chaîne youtube

Dialogues photographiques en Asie
L'atelier "Concordances et jeux visuels" invite les visiteurs du musée Guimet de Paris, à aiguiser leur regard sur les oeuvres de la collection permanente du musée national des arts asiatiques (MNAAG).
La photographe Nadia Prete accompagne les participant(e)s de cet atelier grand public dans cette balade photographique. En binôme, chacun(e) parcourt le musée, découvre les formes et les détails : une démarche favorisant un nouveau dialogue visuel.
En savoir plus :
- Photos sur le compte Instagram du musée Guimet
- Collections en ligne du musée national des arts asiatiques
- Conférence le 1er avril sur Margaret Bourke-White, par la photographe Nadia Prete
- Prochains ateliers animés par Nadia Prete les samedis 25 juin et 9 juillet 2017 à 14h.
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.
Jérôme Politi (réalisation vidéo)
Hélène Prigent (article)
29 mars 2017
#jeux
#Asie
#baladeartistique
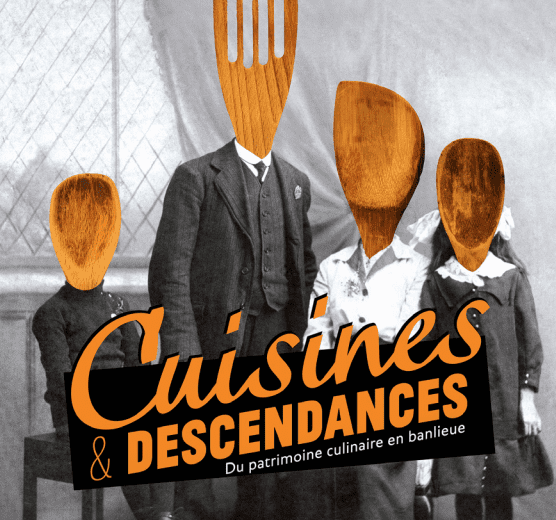
Dispositif participatif : quand le visiteur vient mettre son grain de sel
Rendre une exposition participative grâce à un dispositif suscitant des contributions de la part du public ? Sur le principe, l’idée est riche de potentiel. En pratique, les contributions sont souvent rares et assez peu intéressantes. Au-delà des montagnes de murs de post-it cornés, partons explorer le monde des dispositifs participatifs à la recherche d’une proposition intéressante susceptible de nous inspirer quelques pistes de réflexion.
Des visiteurs apportant leur contribution dans l'exposition Cuisines et Descendances ©RV
L’exposition sera participative ou ne sera pas
Le participatif est au musée ce que la couleur orange est à cette année 2022 : un phénomène de mode. L’idée de participation, de même que dans la vie politique, y est mise à toutes les sauces : on la greffe sur un projet d’exposition, on la tartine sur les documents de communication, on en presse le jus dans des publications et des colloques, on l’invoque jusqu’à en perdre le sens.
Pourtant, l’idée avait de quoi séduire. Si la participation peut susciter un engagement accru de la part du public, pourquoi s’en priver ?
Le concept de participation est apparu dans les années 1970, dans un mouvement de renouvellement du monde muséal qui a trouvé son expression dans l’éco-muséologie. Le principe de cette Nouvelle Muséologie est de donner une place accrue aux publics et aux communautés : le participatif peut y contribuer. C’est même une nécessité selon John Kinard, cité dans le recueil Vagues : Une anthologie de la nouvelle muséologie (1992) : « Si nous voulons que les musées survivent et qu’ils soient le vecteur des nouvelles valeurs culturelles, alors l’impératif majeur est la participation ». Quelques décennies plus tard, la participation a dépassé le monde des écomusées et s’est étendue à tous les champs d’action du musée. Le financement participatif, tel un arbre qui cache la forêt, pourrait nous faire croire qu’ouvrir son porte-monnaie est la seule contribution possible de la part du public. Bien au contraire : on peut contribuer à des inventaires ou des collectes participatives, à des opérations de sciences participatives ou encore à des expériences de commissariat ou de muséographie, elles aussi participatives. D’un parti-pris de rupture propre aux écomusées, l’idée de développer la participation des visiteurs est devenue une tendance installée dans le monde muséal. Le « musée inclusif et collaboratif » fait partie des axes de la Mission Musées du XXIe siècle « Inventer des musées pour demain ». Serions-nous déjà demain ? Le mot « participation » a fait son entrée dans la nouvelle définition du musée adoptée en 2022 par l’ICOM.
Le dispositif participatif, une baguette magique ?
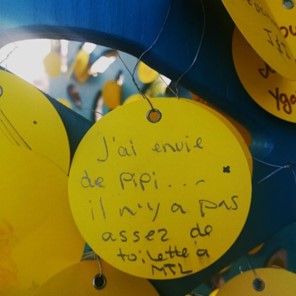
Un dispositif participatif dans l’espace public à Montréal ©RV
Adopter une pratique participative dans les domaines de la gestion des collections ou de la mise en exposition est un défi ardu pour le musée, ne serait-ce que parce qu’il implique de partager une partie de cette autorité muséale dont se drapent certains conservateurs, d’âme et de métier. Pas de panique ! Pour pouvoir cocher la case « participation » à moindre risque, une solution est possible : intégrer à une exposition un dispositif participatif. Un mur d’expression avant la sortie de l’exposition, quelques piles de post-it, trois crayons et dix gommettes, un écriteau « Donnez votre avis » … et le tour est joué ! Les visiteurs vont pouvoir s’exprimer, l’institution aura la conscience tranquille. Pourtant, quelques semaines plus tard, si les post-it tiennent encore au mur – ce qui est loin d’être acquis ! -, le dispositif, lui, tient rarement ses promesses : il faudra se satisfaire de quelques smileys, gribouillages, d’un « Jean-Michel était là » ou de quelques sympathiques « Coucou ! ».
Mais pourquoi donc les visiteurs ne s’emparent-ils pas de cet espace d’expression de manière plus intéressante ? Peut-être parce qu’ils ont senti que le musée ne portait pas grand intérêt à ce qu’ils pourraient y dire. De la même manière qu’un distrait « ça va ? », adressé sans s’arrêter à une lointaine connaissance, n’attend surtout pas d’autre réponse qu’un « oui, ça va » aussi évasif que trompeur, un dispositif participatif sans intérêt appellera des contributions sans intérêt.
Nina Simon, autrice de l’ouvrage de référence The participatoy museum (2010), l’explique lors d’une conférence TEDex : « Je pense que nous avons tous fait l’expérience de commentaires publics qui n’étaient pas très significatifs. […] J'y vois plus une opportunité manquée dans le fait de ne pas les avoir incités à donner du vrai contenu. Je crois que nous tous dans cette salle avons quelque chose de puissant et créatif à donner. Je crois que nous avons tous une histoire à conter, et chacun d'entre vous a probablement quelque chose d'étonnant à partager à ce stade aujourd'hui. Mais je sais aussi que nous pouvons tous être parfois banals. Nous sommes tous un peu stupides parfois. Et pour moi, qui m'efforce d'améliorer la participation, la différence se fait dans la conception de cette invitation à participer. Un bon design peut nous élever à donner le meilleur de nous-mêmes, le contraire est vrai aussi. » (retranscription et traduction française – YouTube)
N'est pas participatif qui le veut
C’est la rançon du succès : le participatif étant à la mode, on veut en mettre partout, au risque d’en perdre le sens et l’intérêt initial. Les écrits théoriques sont nombreux sur la co-conception, ils sont beaucoup plus rares à étudier les dispositifs participatifs. Cela induit une difficulté à cerner les contours de cette notion, d’autant plus que la participation, de manière générale, est difficile à définir. Comme l’écrit Alexandre Delarge dans Le musée participatif, l’ambition des écomusées, « Le mot « participation » englobe de nombreuses acceptions, ce qui peut conduire à des contresens, voire à des conflits ».
On qualifiera ici de participatif un dispositif suscitant l’engagement du visiteur en lui proposant d’apporter une contribution qui enrichira le contenu de l’exposition, sera visible par les autres visiteurs et valorisée par le musée.
Selon cette acception, le participatif ne peut être réduit à une notion avec laquelle il est parfois confondu : l’interaction. Proposer au visiteur d’appuyer sur un bouton pour voter suscite son engagement en le rendant actif. Cependant, selon le sens que l’on donne à ce geste, le dispositif peut être participatif ou seulement interactif. S’il s’agit de répondre à un quizz pour vérifier sa compréhension du sujet à l’issue de la visite, on préfère parler d’interaction, car le visiteur ne donne pas une contribution qui enrichit le contenu de l’exposition. Par contre, si, comme dans l’ancien dispositif Free2Choose à la Maison Anne Franck, il s’agit de se positionner dans un débat éthique grâce à un vote dont les résultats apparaissent dans l’espace d’exposition comme un sondage en temps réel, on peut dire que le dispositif est participatif. La contribution de chaque visiteur apporte réellement sa voix au débat.
Une fois cernée la notion de dispositif participatif, il s’agit de s’intéresser à une proposition considérée comme inspirante et susceptible de faire naître des pistes de réflexion.
Une exposition dans laquelle mettre son grain de sel !

Vue de l’exposition ©RV
L’exposition Cuisines et Descendances a ouvert en octobre 2022 à l’écomusée du Grand-Orly-Seine-Bièvre, une petite structure à la grande ambition, celle d’être « un musée qui change votre regard sur la banlieue ». C’est pour présenter et rendre hommage au patrimoine culinaire de la banlieue que l’écomusée propose cette nouvelle exposition temporaire. Elle présente, au cours d’une déambulation dans les pièces d’une maison, les différents aspects de la transmission culinaire. Pendant sa vie, chacun.e reçoit, s’approprie et transmet de nombreux éléments qui constituent ce patrimoine culinaire : des tours de mains, le goût des produits, des valeurs, des souvenirs, une passion pour la cuisine, parfois la charge qu’elle représente… et bien sûr, des recettes !
A la fin de l’exposition, le visiteur est invité à s’assoir pour partager sa recette fétiche. Il l’écrit sur un papier qu’il peut ensuite accrocher au mur, afin de la faire découvrir à d’autres visiteur.euse.s. Il peut aussi déposer sa contribution dans une « bonbonnière aux recettes », et, en échange, tirer une recette déposée par un autre visiteur pour la ramener chez lui. Il est invité à passer aux fourneaux, prolongeant donc la visite et la relation avec l’écomusée même une fois son portail passé.
La bonbonnière des recettes est présentée lors des évènements organisés par l’écomusée, afin de faire vivre la collecte, comme lors des Journées Européennes du Patrimoine. En faisant circuler les recettes entre les visiteurs, le musée laisse volontairement lui échapper certaines des recettes collectées. Cela pourrait paraître paradoxal dans un milieu habitué à la thésaurisation. C’est en fait un moyen de valoriser le caractère vivant de ce patrimoine, de partager ce qu’est la cuisine. Pour garder une trace de ces échanges de recette, le musée a créé le hashtag #jecuisineaveclecomusee, grâce auquel des photographies des recettes peuvent être partagées sur les réseaux sociaux.
Ce dispositif évite le piège fréquent du participatif gadget, ajouté à l’exposition « parce que ça fait bien ». Au contraire, la proposition est d’une grande cohérence par rapport à l’exposition. Avec son thème, d’abord, puisque l’on propose aux visiteur.euse.s de faire vivre cette transmission culinaire qui est au cœur de l’exposition. Dans la démarche, ensuite, puisque l’exposition a été conçue grâce à une collecte participative auprès des habitants du territoire. Les dix-huit personnes interrogées ont partagé leur expérience de la cuisine et ont désigné un objet et une recette par lesquels ils ont été présentés dans l’exposition. Le dispositif participatif permet donc de poursuivre tout au long de la vie de l’exposition cette collecte initiée lors de sa conception en recueillant les contributions des visiteurs et visiteuses, eux aussi majoritairement habitant.e.s du territoire.
Le graphisme de la feuille sur laquelle le visiteur écrit sa recette reprend d’ailleurs celui des recettes exposées. Nina Simon l’a prouvé, la qualité matérielle du dispositif proposé a un impact fort sur la qualité des contributions. Un visiteur prendra sûrement plus de soin à remplir une feuille cartonnée, de bonne qualité et bien présentée, que si on lui avait proposé un post-it – comme c’est souvent le cas dans les dispositifs participatifs ! -, support associé à des listes de courses, gribouillages ou notes sans importance et colorées. Ici, en plus de la qualité matérielle, la cohérence esthétique est extrêmement valorisante pour le visiteur, qui voit que sa contribution a le même statut que les recettes des personnes interrogées. L’exposition montre que les recettes constituent une partie de ce patrimoine culinaire de banlieue auquel s’intéresse le musée : il y a donc un intérêt sincère de la part du musée dans le fait de collecter les recettes des habitants. Il est d’ailleurs envisagé de publier, en guise de catalogue d’exposition, un carnet de recettes des habitants du territoire, qui regrouperait les recettes des 18 personnes interrogées et celles des visiteurs et visiteuses de l’exposition.
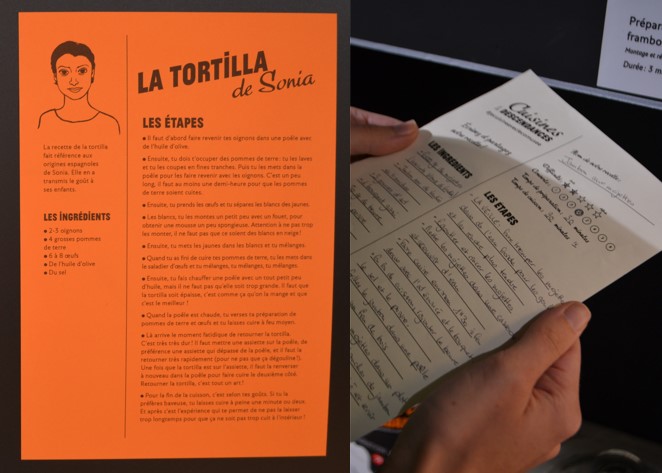
À gauche : La recette transmise par une habitante présentée dans l’exposition / À droite : Une visiteuse lisant la recette déposée par un autre visiteur ©RV
En guise de conclusion : quelques pistes
Alors, à partir de cet exemple, quelles pistes peuvent être mises en avant pour réfléchir des dispositifs plus enrichissants pour les visiteurs et le musée ?
Pour être le plus enrichissant possible, à la fois pour les visiteurs et le musée, un dispositif participatif gagne à :
- être lié à la thématique et au parti-pris de l’exposition, et donc à être pensé dès le début de la conception de l’exposition
- avoir un rendu esthétique qualitatif et cohérent avec le graphisme et la scénographie de l’exposition
- guider le visiteur dans sa contribution
- susciter des contributions intéressantes à la fois pour le visiteur qui participe et les autres visiteurs
- être pensé avec une valorisation des contributions par le musée (dans une exposition ou une publication, sur les réseaux sociaux…)
- prendre vie lors d’évènements ou grâce à la présence de médiateurs et médiatrices

Partage des recettes lors des Journées du Patrimoine 2022 : page Instagram de l’écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre
Raphaëlle Vernet
Si vous avez encore faim de découvertes :
- la page consacrée à l’exposition sur le site de l’écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre : https://ecomusee.grandorlyseinebievre.fr/programmation/expositions/grande-salle
- L’exposition Cuisines et Descendances a été conçue par l’équipe de l’écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre. Nicolas Franchot et Stéphane Rébillon en signent la scénographie et le graphisme. Rendez-vous à Fresnes pour la visiter d’ici mars 2024 !
- deux projets artistiques inspirants autour du partage des recettes de cuisine : le Grandmas Project, dont quelques vidéos sont présentées dans l’exposition (http://grandmasproject.org/fr/) et Kitchen, la cuisine transportable, un projet de Thorsten Baencsh et Christine Dupuis présenté dans une vidéo de Charlotte Grégoire (https://www.monoeil.org/kitchen)
#exposition #écomusée #participatif #cuisine #recettes

Ecrire³ au musée, sur le musée, pour le musée
Avec la promotion des Master 1, nous sommes parti.es en résidence d’écriture à Boulogne-sur-Mer. Accueilli.es pour l’occasion au musée de la ville, nous avons pu découvrir la collection Alaska en compagnie d’Elikya Kandot, directrice de l’institution, et de Justine Vambre, en pleine rédaction de sa thèse sur la transmission et le patrimoine partagé autour de cette même collection composée de 270 objets. Donnée en 1875 au musée, cette collection rassemblée lors du voyage d’Alphonse Pinart, un explorateur ethnologue du 19ème siècle, possède une histoire bien particulière. Tombée dans l’oubli de 1900 à 1980 et divisée entre la France et Berkeley aux Etats-Unis, elle se caractérise par un manque de connaissance et une perte de sens pour la ville de Boulogne-sur-Mer. Elle soulève ainsi la problématique de son interprétation et sa réappropriation qui pourrait être initiée à travers un échange et un partage entre les deux parties de la collection et le lieu d’origine de ces objets.
Durant trois jours, nous avons donc fait la connaissance de la collection et plus particulièrement des masques associés aux chants rituels, de leurs histoires et nous avons écrit à leur sujet, accompagné de Catherine Berthelard, animatrice de résidences d’écriture. Nous avons pu, à travers l’écriture, nous approprier cette collection, comprendre leur histoire, leur origine. La résidence d’écriture et tous ces exercices ont su tisser un lien au fur et à mesure entre les participant.es et la collection. Cet article est donc l’occasion de se pencher sur l’intérêt des résidences d’écriture, ou plus particulièrement de l’écriture comme médiation.
Image d'en-tête : Le château-musée de Boulogne-sur-Mer © M.D
Qu’est-ce que l’on entend par résidence d’écriture ?
Une résidence, de manière générale, est une forme de soutien à la création ou à l’action culturelle. Fournissant les conditions financières et techniques nécessaires, la résidence permet à tout écrivain ou artiste (chorégraphe, musicien, plasticien, …) de créer, écrire et produire une œuvre, en dirigeant éventuellement quelques actions de médiation. Institutionnalisées depuis les années 80, les résidences peuvent prendre des formes variées selon la structure et le projet que ce soit de l’ordre de la valorisation, de jeunes artistes, d’une pratique artistique, de l’expérimentation, de l’animation ou générateur de rencontre, sociale, intergénérationnelle, interprofessionnelle, ect.
La résidence peut ainsi s’apparenter à de la médiation culturelle dans la mesure où le projet et ses acteur.ices ou l’artiste en question décident de mener des actions avec les publics. Dans ce cas, la résidence ne se cantonne pas à la création de l’artiste mais vise à créer des liens entre l’œuvre réalisée et des publics. (Carole Biseniues-Penin, « Les résidences d’écrivains et d’artistes : des dispositifs de créations et de médiation »). En ce sens, la résidence incarnerait alors un médium pour mettre en relation les publics et leurs intersubjectivités avec l’objet culturel. Il s’agirait de mettre en dialogue les sujets et l’artefact, le regardeur et le regardé et d’ainsi offrir aux publics un moyen de s’approprier un objet culturel, une collection.

Une partie de la collection « Alaska » © M.D.
Des textes dans une exposition à la médiation littéraire, il n’y a qu’un pas
Cette médiation peut tout à fait se vivre avec l’écriture. L’écrit dans les expositions est, effectivement, omniprésent. Les visiteur.euses, en arpentant une exposition, découvrent des œuvres d’art, des objets et des textes. On les retrouve sur tout type de support, des cartels aux fiches de salles en passant par les panneaux et les murs. Sur un ton scientifique, humoristique, philosophique ou poétique, ils viennent partager des connaissances sur ce qui est exposé, sur la thématique de l’exposition. Ils fournissent du sens, un discours, un point de vue sur un sujet en particulier. Les clés de compréhension semblent donc, le plus souvent, passer par l’écrit. Néanmoins, ils restent lointains car écrits par une tierce personne, le(s) commissaire(s) de l’exposition ou le(s) muséographe(s) et pas toujours à la portée de tous.tes. Le vocabulaire utilisé, le ton semblent essentiels pour permettre de toucher et d’intéresser le plus grand nombre. La réception des textes d’expositions, des écrits dans les expositions reste tout de même différente en fonction de chacun.es.
Comment le public peut-il s’approprier ces écrits et se saisir du sens d’une exposition et de son discours ? En gardant à l’idée que cette médiation écrite contribue à produire du sens pour les visiteur.euses, ne serait-il pas judicieux que ces dernièr.es puissent le produire eux-mêmes ?
Venir écrire sur une exposition, une collection, un objet, une œuvre en particulier ne serait-il pas un moyen de venir s’approprier le sens, de créer sa propre interprétation et de devenir acteur de sa visite comme ce fut le cas pour la promotion des Master 1 lors de leur résidence d’écriture au Musée de Boulogne-sur-Mer ?
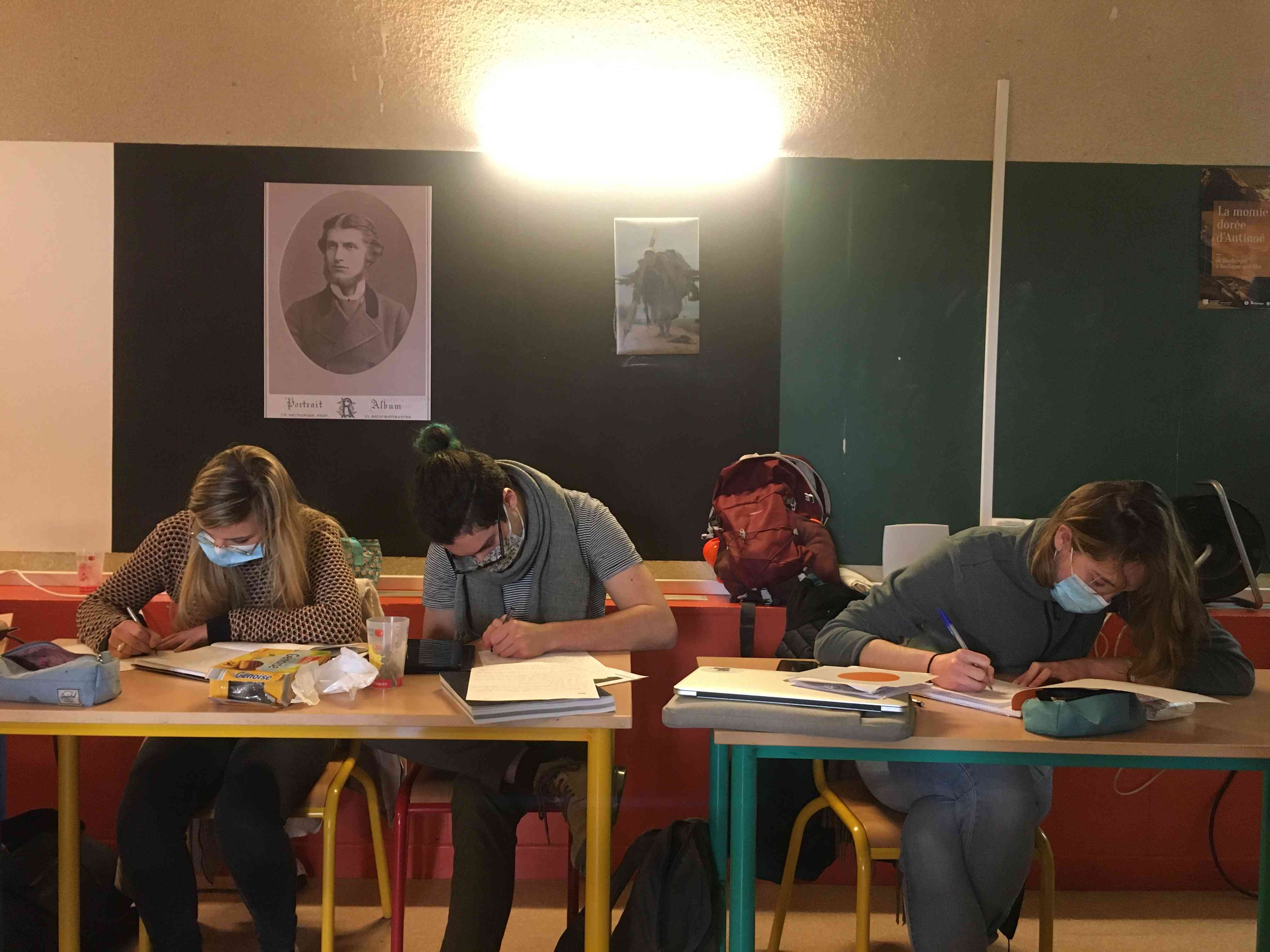
Tous.tes inspiré.es pour écrire sur la collection « Alaska » © M.R
Petit tour d’horizon des actions de médiation littéraire …
Dans le département du Nord, on pense à la Villa Marguerite Yourcenar, un centre de résidence d’écrivains européens. Il s’agit ici pour un.e écrivain.e ayant publié au moins un livre chez un éditeur professionnel de participer à une résidence d’écriture de un à deux mois sans devoir produire un ouvrage mais en devant participer à trois rencontres lors d’événements littéraires organisés par l’institution. Ici, cette résidence a pour objectif d’offrir aux écrivain.es sélectionné.es les moyens de rédiger un livre tout en participant à quelques rencontres. Il n’est cependant pas question d’une animation de production d’écrits avec un public autour d’une thématique, d’une collection.
Evidemment, beaucoup de musées littéraires proposent des résidences d’écriture à des écrivain.es. Parmi elles, la maison de l’écrivain Michel Butor à Lucinges dans la Haute-Savoie ou encore le Musée Rabelais, à Seuilly dans le Centre-Val de Loire, qui accueille depuis 2015 des écrivain.es en résidence. En Nouvelle Aquitaine, on retrouve le Chalet Mauriac, fréquenté par l’écrivain François Mauriac durant son enfance, qui possède un espace dédié à toutes les formes contemporaines d’écriture : de l’écriture numérique ou graphique en passant par l’écriture littéraire, cinématographique et aussi audiovisuelle ou musicale... Accueillant des auteur.es/réalisateur.trices d’une semaine à deux mois, la structure vient alors soutenir la création cinéma et audiovisuel par l’accompagnement dans l’écriture et le développement d’un long métrage.
Bon nombre d’autres musées et institutions se sont prêtés au jeu de cette action de médiation littéraire venant offrir un regard neuf et extérieur sur l’objet/le sujet en question, et bien au-delà de musées littéraires. Parmi eux, Le Muséum National d’Histoire naturelle de Paris, en 2017, qui a mis en place un atelier d’écriture pour des personnes à partir de 15 ans avec l’écrivain en résidence, Patrice Pluyette. Avec pour thème La nature exposée, l’écrivain et les participants ont écrit à la manière du roman initiatique. Ce genre littéraire, nourri par les expéditions passées et par le travail actuel de chercheurs, vient faire la jonction entre le public et cette histoire culturelle.
Autre exemple : une initiative plaçant les publics au cœur de la rédaction d’un recueil fut organisée en janvier 2017 par le Musée National de l’Histoire de l’immigration. Bernado Toro, auteur en résidence, a proposé pendant dix mois des ateliers d’écritures dans différents quartiers de la capitale. Avec des publics variés ayant un lien avec l’immigration, il a produit un recueil de dix nouvelles sur l’immigration à Paris et le regard que les migrants portent sur la société française.
Une action plus récente d’ateliers d’écriture durant l’automne 2020 dans ce même musée a eu pour thématique Ecrire sur soi ; Kidi Bebey, écrivaine, a, dans le cadre de sa résidence d’auteure au musée, animée six ateliers d’écriture à un groupe d’élèves d’une classe d’unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPEAA) d’un collège de Grigny en Essonne conduite par Bénédicte Vermogen. Ces ateliers, effectués à distance en raison du contexte sanitaire actuel, avait pour but de permettre à des élèves marqués par l’expérience migratoire d’écrire un récit sur soi et sa famille.
Vous l’aurez compris les résidences d’écriture et ateliers d’écriture ont de multiples objectifs. Elles viennent soutenir la création littéraire, elles invitent un.e auteur.e à porter un regard extérieur et singulier sur une institution, un territoire et ses habitants ou encore occasionnent pour les publics la rencontre avec un.e artiste, une œuvre, une collection et/ou une pratique artistique. Ainsi, la médiation littéraire semble être avantageuse pour les deux parties avec d’un côté, les participant.es qui deviennent acteur.ices d’un projet en étant inclus dans ce processus de production de sens, et de l’autre les institutions, à l’origine du projet, qui viennent enrichir les approches et les discours autour de l’objet culturel en question. Il semblerait que ces actions soient encore minimes et concentrées chez certains musées adeptes de ces formes de médiation. Les résidences d’écriture et plus particulièrement les médiations littéraires peuvent aider à l’inclusion des publics au cœur des expositions et actions que proposent les musées et institutions.
Manon DEBOES
Venez découvrir le carnet réalisé lors de la résidence d’écriture par la promotion des MEM1
http://formation-exposition-musee.fr/formation/projets-et-actions/37-workshops-museographie-expographie
Bibliographie
« Les résidences d’écrivain et d’artistes : des dispositifs de création et de médiation », sous la direction de Carole Bisenius-Penin, avril 2017
https://journals.openedition.org/culturemusees/1487
« La médiation écrite au musée : miroirs et jeux de miroirs », Pascal Ancel, décembre 2010
https://journals.openedition.org/ocim/378
Pour aller plus loin sur la question des résidences d’artistes
La résidence d’artiste : Enjeux et pratiques, Nicole Denoit, Catherine Douzou, Collectif, 2016.
#médiationlittéraire #résidencedecriture #lecritaumusée

Fabuleux Maintenon
Dans le froid, un poème
Quand vient l’hiver
Et que tente le château
De revêtir son pull-over
Par des foyers bien chauds,
Un évènement se prépare,
Dame Maintenon à l’honneur
L’attention elle accapare,
Pour Noël à ses heures.
Quelques mois durant,
Petites fées des coulisses
N’ont pas assez de leur temps
Pour rendre les lieux complices.
Au rythme de la cadence
Lundi, mardi, mercredi,
S’organise la danse
Des mouvements d’objets pardi !
Identification
Plan d’organisation,
Répartition
Opération.
Même jour autre musique
Pour les acteurs fabuleux,
Jouer pour rendre féérique
L’histoire des lieux.
Successeurs de logis
Du 13e à nos jours,
Ainsi conte le récit
Tour après tour.
Repérer les salles,
Définir les actes,
Quelles œuvres idéales
Ou quels artefacts ?
Identification
Puis scénarisation,
Organisation
Enfin démonstration.
Marquises costumées
Se pavanent sous les chants
Devant un public fasciné
Par les salons chatoyants.
L’amour se dévoile
A travers les portes secrètes,
Entre tissus et voiles
S’amusent les interprètes.
Et pour ainsi
Saisir les intéressé.es,
Il faut toutefois aussi
Déplacer les objets.
Pots, lampes et fauteuils,
Ne doivent pas perdre la tête
Et pour cet accueil
Tous aux cachettes !
Objets chamboulés
Pour spectacle annuel,
Tout est presque prêt
Pour le Fabuleux Noël.
Brumes dans les jardins,
Lueurs sur le chemin,
Le château embellit
Rend toute sa magie.

Cour avant du Château de Maintenon pendant le Fabuleux Noël ©CL
La frénésie de Noel
Chaque année au Château de Maintenon, un remue-ménage effréné fait vivre les lieux. Sur plusieurs week-ends de novembre et décembre, le spectacle du Fabuleux Noël conte l’histoire du château et celle de ses hôtes. Il est produit par la société de production événementielle Polaris. Pour accueillir acteurs et techniciens bénévoles ainsi que tous les visiteurs attendus, les espaces du château sont vidés puis décorés par du mobilier scénographique. Meubles, tableaux et objets décoratifs sont déplacés, que ce soit pour la sécurité des personnes et des œuvres, ou pour correspondre au scénario du spectacle. Gérées par le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, les collections sont minutieusement stockées en attendant Noël.
Une belle occasion de découvrir le château par son histoire sous un ciel duveteux puis le redécouvrir pour ses salles et leurs mobiliers au petit printemps…

Grande galerie du Château de Maintenon pendant le Fabuleux Noël ©CL
Pour en savoir plus :
www.chateaudemaintenon.fr
L.L
#Déménagementcollections
#ChâteaudeMaintenon
#FabuleuxNoël

Familles au musée : le Tote Bag du Louvre-Lens
Le 6 novembre 2019 s’est tenu au Louvre-Lens une présentation d’un dispositif famille mis en place grâce à un partenariat réunissant L'École de la deuxième Chance de Liévin (E2C), Le Louvre-Lens et le MuséoLab du Louvre-Lens-Vallée. Y a collaboré le Master Expographie Muséographie pour la phase test. Il s’est agi de créer des outils de médiation inclus dans un tote-bag mis à disposition des familles pour animer leur visite de la galerie du temps *.
Le MuséoLab : un espace de co-construction
Lancé en 2014 par Serge Chaumier, qui en est le responsable scientifique, le MuseoLab prend place dans le bâtiment de Louvre-Lens Vallée. Il a été inauguré fin août 2019. Ce fablab au service de la muséographie permet de travailler en partenariat avec des structures culturelles et de faire découvrir aux publics les outils numériques. Plusieurs projets sont en cours de développement, dont celui décrit ci-dessous.
Une collaboration enrichissante
Louvre-Lens, 10 heures. La présentation du dispositif famille commence. Gautier Verbeke, responsable de la médiation au musée, explique le projet en quelques mots. L’E2C propose à des jeunes de participer à un dispositif construit en partenariat avec le musée et le MuséoLab afin de créer des supports de médiation pour les familles visitant la galerie du temps. Il s’agit de former les jeunes à la maîtrise des machines, en leur faisant fabriquer des outils de médiation et ce faisant de les sensibiliser au contenu du musée. Le projet co-organisé entre l’E2C et les équipes de médiation du musée consiste en une série de six ateliers animés par le FabManager. Le Master Expographie-Muséographie de l’Université d’Artois (MEM) y est associé pour la phase d’évaluation des usages des outils réalisés. Le soutien de la Fondation Orange a permis de financer le projet. Le film relate en une dizaine de minutes le projet. « Le musée est un outil pour tous » conclut celui-ci.
Le film débute. Nathan Chateau, fabmanager du Louvre-Lens (auquel a succédé aujourd’hui Léo Marius), apprend aux jeunes de l’E2C les bases des outils informatiques. Grâce aux imprimantes 3D et autres découpeuses laser, le kit de médiation prend forme : on découvre un puzzle représentant la galerie du temps et de petits viseurs pour voir l’œuvre autrement. Ces viseurs, créés grâce à l’imprimante 3D, permettent de jouer sur les perspectives de l’œuvre, mais aussi sur la perception que le visiteur en a puisque, selon la forme utilisée - carré, rond ou rectangle - les perspectives changent et les tableaux prennent vie autrement. L’écran s’obscurcit, le film se termine : il est maintenant temps de découvrir le Tote Bag.
Les familles arrivent pour le test. Le dispositif est alors présenté par les jeunes de l’E2C. Julien, de l’école, nous raconte le projet. Le Tote Bag contient un puzzle, les viseurs, mais également des planches de dessin et des indications pour la visite de la galerie du temps. Les familles doivent trouver six œuvres dans la salle et répondre aux questions sur l’œuvre. Le Tote Bag est mis gratuitement à la disposition des familles à leur arrivée. Il est pensé pour la tranche d’âge 3-11 ans et a nécessité 2 mois pour concevoir et réaliser les objets qui le composent. Julien est ravi du résultat : grâce à ce projet, il a appris à utiliser une découpeuse laser et les logiciels numériques. Cette expérience lui a redonné confiance en lui.

Les jeunes de l’E2C présentent le Tote Bag aux étudiantes du MEM. © C.DC
Le but de ce projet, plus que de créer un dispositif famille, est de permettre à des jeunes de s’intégrer dans la vie active, mais aussi culturelle de la région. Ce programme s’inscrit pleinement dans la vision du musée. Le choix de la ville de Lens en 2004 pour délocaliser une partie des œuvres du Louvre s’inscrit dans une politique visant à rendre la culture plus accessible en région. Le bassin minier était donc un choix logique pour y implanter le Louvre-Lens. Le projet conçu avec le Muséolab est un vecteur de cette démocratisation culturelle. Beaucoup des élèves de l’E2C n’étaient jamais allés au Louvre Lens auparavant. Ce projet leur permet de découvrir de nouveaux outils - et autant de possibilités en termes de compétences - mais aussi de s’approprier l’espace muséal.
Il en est de même pour les familles. En effet, bien que les habitants de la région Hauts-de-France constitue le noyau des visiteurs du Louvre-Lens, les locaux ont encore du mal à s’approprier le musée. Le Tote-Bag peut devenir un véritable moteur pour les familles découvrent le musée, un enfant ne venant jamais sans être accompagné d’un adulte.
En avant pour le test !
Les enfants s’impatientent : il est temps d’essayer les Tote Bag ! Ceux-ci sont distribués et les enfants s’élancent vers la galerie du temps. Les étudiantes du master les observent. Après quelques minutes de jeux, elles s’approchent des familles et les questionnent sur la réception du dispositif. Hélène et ses deux garçons observent Une assemblée des mystiques. Le parcours plaît aux enfants, mais certains mots sont parfois compliqués : c’est le cas d’« architecte ». Une autre famille s’approche des œuvres. Timéo, 7 ans, a l’impression de faire une chasse aux trésors. Sa petite sœur de 3 ans, joue avec les viseurs. Son grand-père Gérard estime que le parcours n’est pas adapté à son âge, mais les « loupes », comme il les appelle, sont un formidable moyen de rendre la visite plus attractive. Les deux enfants ont beaucoup aimé le puzzle, coloré et ludique. Gérard apprécie lui aussi le dispositif. Peu attiré par les œuvres d’art, le parcours et les questions lui permettent de s’intéresser à certains aspects des œuvres auxquels il n’aurait pas prêté attention sans le Tote Bag. « Ce serait un bon concept à adapter aux adultes ! » lance-t-il. A bon entendeur…

Les familles testent et s’amusent. © C.DC / J.G
Petit à petit, les familles se dispersent. L’équipe du master se rassemble pour partager ses premières constatations. Le Tote Bag est un bon outil de médiation pour les familles. Le dispositif est varié, et le puzzle est très apprécié. Les fiches du parcours sont pour le moment des feuilles volantes mais, dans une version améliorée, celles-ci seront plastifiées et attachées entre elles. La forme même du sac est quant à elle à redéfinir. Le Tote Bag est tendance, mais pas forcément adapté à la petite taille des enfants. Pourquoi ne pas le remplacer par un sac triangle ou une petite valisette type “lunchbox” ? La place du sac est à redéfinir en fonction de la personne qui le porte : enfant ou accompagnant ?
Midi, la matinée se termine. Un beau travail de collaboration entre plusieurs entités vient de prendre un tournant : une fois le dispositif ajusté, les Tote Bag, au nombre de dix, seront proposés par le personnel d’accueil du musée aux familles visiteuses. Un nouveau cycle de formation commencera avec de nouveaux jeunes participants en janvier prochain
Clémence de Carvalho
*Pour garder l’anonymat des familles, certains noms ont été changés.
Pour aller plus loin :
Les Makers de l’Art, vidéo de présentation du projet conduit par les jeunes de l’E2C. https://www.youtube.com/watch?v=lJZ9lRErN2s
#famille
#louvrelens
#dispositif

Flânerie géopoétique
Les arbres nous inspirent et nous poussent à écrire. "La Traversée", atelier de géopoétique, nous plonge dans une flânerie où les mots s’entrelacent aux branches à la découverte de l'Arboretum Morgan.
Pour en savoir plus :
https://www.mcgill.ca/morganarboretum/
https://latraverseegeopoetique.com/
https://auretourduflaneurlesarbres.wordpress.com/
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.
Coralie Dunou

Halloween au musée : trick or treat ?
La Folie s'empare de Grévin : nocturnes spéciales Halloween

Médiatrice au musée, membre de l'USPPE © Elise Mathieu
Nous sommes à Paris à la fin du XIXe siècle. Les grandes expositions universelles ont levé le voile sur la beauté de la capitale. Cependant, ses rues sont infestées de vermine. Rat, cafards, déchets ? Non, bien pire que cela : malfrats, voleurs, prostituées, meurtriers, des gens dont il faut se débarrasser ! C'est en tout cas ce que pense le préfet de police de la ville. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, vous avez été « ramassé » par ses hommes et emmené de force au musée que l'USPPE a investi. Cette Unité de Soin Pour Personnes Extrêmes va s'occuper de vous et lorsque vous ressortirez, vous serez devenu un citoyen modèle. Enfin, si vous en ressortez...

Aperçu d'un lit de cet « hôpital » © Elise Mathieu
A peine entrés dans le musée, vous devez enfiler une blouse afin que les « médecins » vous décontaminent. Suivez les ordres à la lettre et pas de faux pas ! Toutes les équipes de l'USPPE sont là pour vous remettre sur le droit chemin. Au fil de votre avancée dans le musée, vous assistez à d'étranges scènes... Vous vous rendez vite compte que ces médecins sont sans scrupule et les professeurs avides d'expériences. Les statues de cire se mélangent aux médiateurs qui prennent un malin plaisir à se fondre dans le noir pour vous surveiller. Au détour des différentes salles, vous rencontrez de nombreuses personnes qui tentent de vous faire devenir de bons citoyens mais rien à faire ! Que vous agissiez comme ils le souhaitent ou non, vous avancez inexorablement vers la « chambre 6 », un endroit terrifiant d'après les dires des autres prisonniers, un endroit où l'on ira jusqu'à « effacer votre corps »...

Expérience pratiquée sur un prisonnier (médiateur) © Elise Mathieu
#Grévin
#Nocturne
#Halloween
Elise Mathieu

La Grande Guerre se rapproche de vous
Le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux propose des web-visites qui permettent à un public, notamment étranger, de bénéficier d’une visite au sein des collections permanentes sans avoir à se déplacer.
Il existe actuellement trois variantes de web-visites au sein de ce musée, toutes accessibles via un logiciel de visio-conférence et accompagnées d’un médiateur. Les web-visites sont différentes de par leur médium qui varie de la tablette au robot télécommandé, mais également par l’expérience de visite, à la fois pour le public mais également pour le médiateur.
Pour en savoir plus :
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube
Samantha Graas
31 juillet 2017
#histoire #mediation#robot

Le Chronographe : Transfert temporel
Le Chronographe, centre d'interprétation archéologique de Nantes Métropole, investit les lieux hybrides et pluridisciplinaires de Transfert&Co. Faisons ensemble un bon dans le temps, en 2250, pour se mettre dans la peau d'archéologues du futur.
Pour en savoir plus, c'est ici Transfert versus Le Chronographe : quand le musée s’invite dans un lieu hybride.
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.
Julia Parisel

Le jeu, un outil à réfléchir au service de la culture

La carte virtuelle du jeu et les Pokéstops. © Gaël Weiss / Frandroid
Pokémon GO, à l’aube d’une nouvelle ère de la ludification
« En plus d’offrir des occasions de coprésence, voire de rencontres, un jeu comme Pokémon Go met en avant, par les points d’intérêt où chaque joueur doit impérativement se rendre, le patrimoine culturel et bâti des villes, tels que certains monuments, des fresques d’art urbain, des sculptures ou des bâtiments dotés d’un intérêt historique particulier. Le jeu vidéo devient dès lors une médiation culturelle qui permet de se représenter différemment, de façon plus visible et consciente, les formes et les lieux qui composent la ville. »1
« Depuis longtemps, les jeux ont inspiré ceux qui souhaitent transférer leurs effets dans le non-jeu, qu’il s’agisse du jeu de Go, pour initier à la stratégie militaire, les badges des scouts pour récompenser et signifier un statut, ou les programmes de fidélité basés sur les points de vol aérien. »3
Promenades numériques
« Dans cette promenade en web immersif, on est en marche, et on se balade, on peut explorer – y’a une carte – y’a un côté un peu chasse au trésor, un peu safari urbain. »5
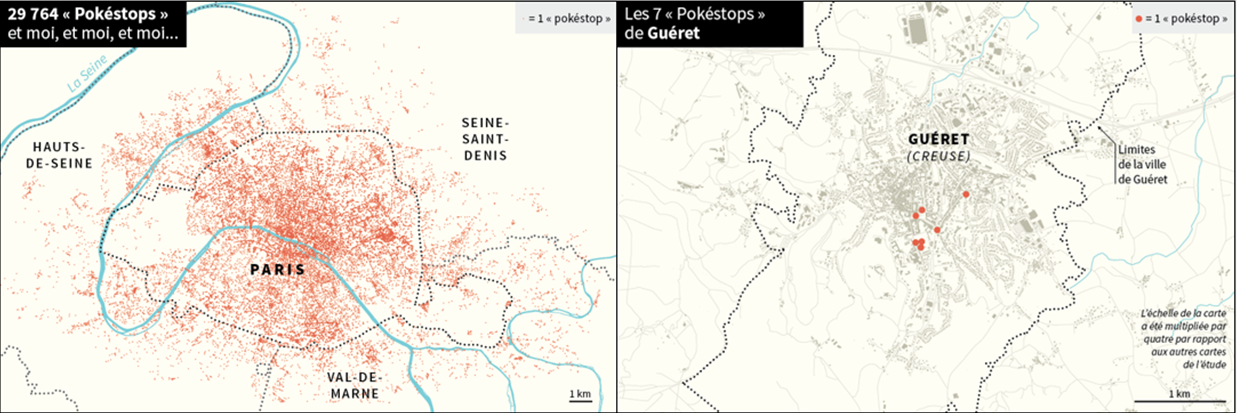
Laurie Crozet
#Pokémon
#Ludification
#Promenadenumérique
Liens utiles :
- https://plus.lesoir.be/53839/article/2016-08-08/pokemon-go-une-chance-pour-les-villes-plus-quun-probleme
- Witt, C. Scheiner & S. Robra-Bissantz (2011), “Gamification of Online Idea Competitions: Insights from an Explorative Case”, Ed. H.-U. Heis, P. Pepper, B.-H. Schlingloff, & J. Schneider, Informatik schafft Communities; Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Series of the Gesellschaft fuer Informatik p.1.
- Marache-Fransisco, E. Brangier (2015), “Gamification and human-machine interaction: a synthesis", Ed. P.U.F., Vol 78, Le travail humain, p.9.
- https://promenadenocturne.withgoogle.com/fr/panorama
- Lambert, J. Julia, J. Deramond (2015), « La ville en live. Itinéraires numériques et artistiques à travers le patrimoine urbain », Etudes de Communication, Vol 45, Pratiques d’espace. Les médiations des patrimoines vers la culture numérique ?, p.8.
- J. de Bideran (2016), « L’augmentation du patrimoine urbain, une exploration informationnelle », Ed. P.U.F., n°3, Sciences du design, p.3.
- Soja (2009), « La ville et la justice spatiale », Justice spatiale | spatial justice, n°1 http://www.jssj.org/article/la-ville-et-la-justice-spatiale/

Le mucem vous emmène… Au Mucem !
Depuis son inauguration en 2013 et Marseille Capitale européenne de la Culture, le MuCEM s’attache à innover avec des projets engagés : un accompagnement vers l’autonomie d’une venue au musée, accessible pour les personnes qui en sont éloignées en proposant des ateliers hors les murs, d’éveil culturel pour les plus jeunes et en programmant des activités en partenariat avec des structures du “champ social”.
C’est au courant de l’année 2019/2020 que le MuCEM dépose un dossier de candidature au concours du Prix Européen organisé par Art Explora. En décembre 2020, le musée a remporté le 1er prix pour son nouveau projet « Destination Mucem », qui s’adresse aux habitants des quartiers éloignés du centre de Marseille. Ils sont très mal desservis par les transports en commun. C’est connu : de nombreuses barrières économiques, matérielles et socio-culturelles brident et empêchent la venue dans un lieu culturel comme un théâtre ou un musée. C’est pour les riches, c’est trop loin, ce n’est pas pour nous…
Pour monter ce projet, le musée a collaboré avec l’association Les Amis du Rail et des Transports de Marseille (ARTM) qui a pour activité principale la restauration, conservation et valorisation des anciens véhicules de la Ville de Marseille, retirés du service, dont certains sont proposés à la location. Est-ce également une façon de sensibiliser les participants à la notion de patrimoine de leur ville et de sa conservation ?
Tout le monde à bord !
« Destination Mucem » est un dispositif inédit et engagé envers une mobilité des publics éloignés, peu ou pas familiers des musées. Tous les dimanches, un bus datant du début des années 70 sillonne les quartiers Nord, Nord-Est, Est et Sud selon des itinéraires décidés en collaboration avec la Préfète “Egalité des chances” de Marseille, ce qui a permis de créer 5 arrêts proches des centres sociaux de proximité. 28% des Marseillais vivent dans les quartiers prioritaires. Gratuit, le bus permet aux publics de créer un lien privilégié avec le musée. Malgré la volonté d’être un musée populaire et accessible, il n’est fréquenté en réalité que par 30% de la population de Marseille, et souvent des quartiers favorisés.
En route !

destination mucem / franceinfo
Dès la montée dans le bus du MuCEM, les passagers se voient remettre un billet d’entrée gratuit (au lieu de 11€ tarif plein par personne. Il n’y a pas de différence entre l’exposition permanente qui est souvent gratuite, et les expositions temporaires payantes. Ce système de tarification est appliqué dans certains musées de la ville comme au Musée d’Histoire de Marseille.)
Les voyageurs accueillis par un médiateur de l’AMS (Association de Médiation Sociale) préparent des circuits de visite variables et adaptés selon les expositions au musée. Équipé d’un micro et différents petits accessoires, le ou la médiatrice avec une boîte de sardines ou un petit bateau explique aux enfants la Méditerranée et la pêche… autant d’objets qui lui permettent d’animer le trajet. C’est un rappel mis en écho avec les collections permanentes à l'intérieur du bâtiment. « Aujourd’hui on part en voyage. On est un peu des explorateurs du passé et du présent. Au Mucem, on ne trouve pas que des sculptures, on trouve aussi des objets du quotidien. Car le Mucem parle de nous.»dit Anaïs Walh, médiatrice à bord du bus.
Ces médiations permettent d’échanger avec les passagers et sont déclinées pour des publics d’âges différents (jeunes publics, adolescents, familles, adultes, personnes âgées), cherchant à susciter la curiosité des passagers avant d’arriver au musée. Le trajet dure environ 1 heure, pour 30 places assises et 76 places debout : soient 106 personnes pouvant monter à bord. 2 trajets aller le matin et 2 trajets retour l’après-midi tous les dimanches. A noter que le bus ne circule pas pendant le mois d’Août.
Tout le monde descend, vous êtes arrivés !
Le bus du Mucem a pour vocation à être pérenne. Les équipes de développement du projet œuvre en parallèle à sa durabilité et longévité. Un diagnostic précis de l’impact carbone de la circulation d’un bus ancien est donc en cours afin de permettre la mise en place, dès le démarrage du projet, de mesures compensatoires adaptées. Est également en étude un autre bus à moteur électrique. Nous devrions avoir plus d’informations au courant de l’été 2022.
Une anecdote : en réalité, les quartiers sont tellement mal desservis par les transports en commun, que ce bus atypique est souvent rempli : les habitants l’utilisent pour se rendre en ville, et non au MuCEM. Pouvons-nous dire que le lien est créé ? Oui, dans une certaine mesure, car la médiation est bien un avant-goût du MuCEM pour ces habitants délaissés par les services publics.
Alexis

Bus Destination Mucem. © Julie Cohen/Mucem.
Pour en savoir plus :
- Mediation pour le MUCEM : http://www.cielairdedire.com/atelier-jeu-pour-le-mucem-marseille/
- Fadila raconte
- Reportage par Brut
#médiation #mucem #innovation

Le respect du spirituel dans l'espace muséal
La reconnaissance de la dimension spirituelle des objets dans les musées est une préoccupation partagée par diverses cultures. Cette considération influence la manière dont les objets sont exposés, conservés et interprétés, en respectant les croyances et les pratiques des communautés d'origine. Comment les musées intègrent-ils ces considérations spirituelles dans leurs pratiques muséales ?
Une approche collaborative avec les communautés autochtones
Dans de nombreuses cultures autochtones, les objets conservés dans les musées ne sont pas seulement des artefacts matériels, mais des entités investies d’une signification spirituelle. Leur gestion dans les institutions muséales prend donc en compte ces particularités immatérielles pour éviter toute décontextualisation ou appropriation irrespectueuse.
Le soin des objets sacrés ou culturellement sensibles repose sur un partenariat entre les musées et les communautés autochtones. Selon les recommandations du Gouvernement du Canada, ces consultations permettent de comprendre des aspects comme le pouvoir intrinsèque des objets et leurs implications pour ceux qui les manipulent ou les exposent.Le concept maori de Mana Taonga, qui considère les objets comme des ancêtres vivants, exige un traitement adapté. Cette philosophie, adoptée par des institutions comme le Musée Te Papa Tongarewa en Nouvelle-Zélande, place les communautés au cœur du processus décisionnel. Elles participent progressivement depuis les années 80 à la définition des soins nécessaires pour les objets, qu’il s’agisse de rituels spécifiques ou de la mise en place de protocoles restrictifs. Cela inclut la gestion de masques ou d’autres objets cérémoniels, qui peuvent avoir été séparés de leur communauté d’origine pendant longtemps sans perdre leur pouvoir ni leur importance.

Espace sacré maori Rongomaraeroa, Musée Te Papa Tongarewa, Nouvelle-Zélande, 2019. © Johnny Hendrikus. Te Papa.
Ainsi, de nombreux musées mettent en place des restrictions d’accès et d’exposition. Certains objets ne peuvent être vus ou manipulés que par des personnes initiées, des chamans, ou des personnes d’un sexe spécifique. Par exemple, des restrictions interdisent l’accès à des femmes enceintes ou en période de menstruation. Les objets particulièrement sensibles sont placés dans des vitrines opaques ou dans des espaces restreints pour limiter leur exposition au grand public.
Respect et sacralité de certains objets asiatiques
L’exposition de certains objets provenant des traditions shintô et bouddhistes en Asie nécessite une attention particulière pour respecter leur caractère sacré et préserver
les sensibilités des pratiquants.
Les statues de Bouddha, incarnant les enseignements spirituels, sont souvent exposées dans des espaces dédiés aux distractions minimisées. Ces environnements recréent
parfois l’ambiance d’un temple, avec bougies, encens et coussins de méditation. Ces salles peuvent être réservées aux pratiquants ou nécessiter la présence de guides
spirituels. De plus, par souci de respect, il est tenu d’exposer et d’entreposer les statues de Bouddha de sorte que la tête dépasse les objets qui l’entourent.
Les thangkas, peintures bouddhistes tibétaines, servent de supports visuels pour la méditation et sont utilisées dans des rituels spécifiques. Elles sont également présentes
lors de rituels d’initiation ou de purification. Leur manipulation est restreinte aux pratiquants qualifiés ou aux moines, pour préserver leur intégrité spirituelle.
Les masques rituels d’Asie de l’Est, quant à eux, sont perçus comme des incarnations d’esprits ou de divinités. Leur exposition peut être temporaire, limitée à des cérémonies
spéciales, pour éviter toute profanation ou perte de pouvoir spirituel. De même, les statues de Kannon, déesse de la miséricorde dans le bouddhisme Mahāyāna, sont souvent présentées dans des espaces propices au recueillement, accompagnées éventuellement de chants ou prières.
Comme pour les cultures autochtones, les musées asiatiques consultent régulièrement des moines, prêtres ou praticiens pour s’assurer du respect des traditions spirituelles. Le musée royal de Mariemont, à l’occasion de l’exposition Bouddha, l’expérience du Sensible (2024-2025), a notamment fait appel avant l’ouverture au public à des bouddhistes pour garantir une présentation respectueuse.

Vue de l’exposition Bouddha, l’expérience du Sensible. Musée royal de Mariemont, Belgique,2024. © Paulette Nandrin.
Défis communs, solutions spécifiques
Les objets spirituels liés aux traditions africaines, comme ceux du vodoun, posent également des défis particuliers aux musées. Ces objets, tels que les masques et les fétiches, sont investis de pouvoirs sacrés, d’un rôle actif lors de cérémonies. D’où des solutions spécifiques : l’exposition dans des espaces dédiés, la tenue de rituels de
purification ou encore la restriction de l’accès à certains publics.

Un fétiche bizango en tissu rembourré. Le scanner révèle la présence d’une croix de cimetière, un crâne, des bouteilles renfermant des âmes. Exposition Zombis, musée du Quai Branly, France, 2024. © Léo Delafontaine.
Les objets des religions monothéistes requièrent aussi des protocoles de traitement pour les reliquaires catholiques ou pour les rouleaux de parchemin de la Torah des Juifs,
que les restaurateurs ne doivent pas réparer, à moins d’avoir suivi une formation spéciale et obtenu la sanction de la communauté. De même, l’exposition des rouleaux de la Torah est soumise à des conditions particulières. Ne sont exposés que les rouleaux ne pouvant plus être utilisés pour la lecture publique en raison de dommages ou d’altérations. Il est essentiel de présenter les objets religieux en évitant toute banalisation ou profanation de leur usage en les accompagnant de supports éducatifs appropriés.
La problématique de la spiritualité des objets dans les musées reflète une prise de conscience croissante de la complexité et de la diversité des cultures représentées. Qu’il
s’agisse d’objets autochtones, asiatiques ou africains, ces artefacts incarnent des dimensions immatérielles qui nécessitent des approches adaptées. En collaborant avec les communautés d’origine, en limitant l’accès aux objets sensibles, et en créant des environnements qui respectent leur sacralité, les musées parviennent à concilier leur mission éducative avec le respect des croyances spirituelles. Ces pratiques encouragent une compréhension plus profonde et plus respectueuse des cultures, contribuant ainsi à la valorisation des diversités culturelles et à la préservation des héritages spirituels.
Nina Colpaert
Pour en savoir plus :
Note d'information générale sur les politiques relatives à l'autonomie gouvernementale et aux revendications territoriales globales du Canada et sur l'état actuel des négociations PARIS, Camille, « Visions chamaniques. Arts de l’Ayahuasca en Amazonie péruvienne », Le magazine du Master Expographie Muséographie, 2024. : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2519-visions-chamaniques-arts-de-l-ayahuasca-en-amazonie-peruvienne
PARIS Camille, « Musées et communautés autochtones, vers un partage des pouvoirs au musée ? », Le magazine du Master Expographie Muséographie, 2024.https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2514-musees-et-communautes-autochtones-vers-un-partage-des-pouvoirs-au-musee
Tchénando Patrick Noukpo, Les masques africains : des patrimoines identitaires dans la diversité culturelle entre espaces profane et sacré au Bénin, thèse de doctorat en
Sociologie. Université de Lorraine, 2020.https://theses.hal.science/tel-03208608/
#muséographie #PatrimoineSpirituel #collaboration

Le street art en mouvement : quelles actions culturelles ?
Né dans les rues de Philadelphie dans les années 1960, de mouvement marginal à phénomène mondial, le street art façonne désormais nos villes. Cet art de plus en plus reconnu trouve aujourd’hui sa place, porté par une multitude d’actions culturelles visant à le valoriser sous toutes ses formes.
Street Art Fest Grenoble-Alpes, crédits : Andrea Berlese
Vers une valorisation des toiles urbaines ?
C’est dans les années 1960, aux États-Unis et plus particulièrement à Philadelphie, que le street art, d’abord appelé graffiti writing, est apparu sous l’égide de deux artistes, Cornbread et Cool Earl. En France, il est porté par Ernest Pignon-Ernest dans les années 1970 et n’explosera qu’à partir des années 1980. Depuis ses origines modestes sur les murs des quartiers marginaux, le street art a évolué pour devenir un mouvement artistique d’envergure mondiale. Se distinguant par sa nature éphémère, il transforme les espaces urbains en expressions artistiques, allant de fresques murales monumentales aux petites interventions cachées, graffitis et pochoirs. Maintenant démocratisé par des artistes phares, il reste néanmoins un art qui ne fait pas l’unanimité. Mais une profusion d’actions culturelles initiées par divers acteurs tels que des artistes, amateurs, associations, institutions culturelles, collectivités sont autant d’actes de reconnaissance. Ces initiatives visent à sensibiliser et à valoriser le street art sous de multiples formes.
Participation et inclusion
Au-delà de son aspect contemplatif, esthétique ou engagé, le street art est aussi une œuvre sociale, élaborée dans les échanges et rencontres. Les festivals et événements autour du street art se multiplient, offrant une possibilité aux artistes de créer et d’interagir directement avec le public. Des festivals de street art aux ateliers artistiques en plein air renforcent les liens sociaux et favorisent l’échange. Cette année le Street Art Fest Grenoble-Alpes, festival sensibilisant aux formes d’expression artistique urbaine telles que le graffiti, les fresques murales, les installations, et les performances en direct, lance sa 10ème édition. Transcendant le cadre d’un évènement artistique, il est porteur d’actions culturelles autour du street art dans près de dix villes partenaires favorisant la participation active des habitants. Les ateliers artistiques, les visites guidées et les conférences organisés dans le cadre du festival visent à sensibiliser le public au street art. Des projets collaboratifs et participatifs encouragent les habitants à s’approprier l’espace public et à contribuer à la création d’œuvres collectives. Ces activités permettent de mieux comprendre les techniques, les styles et les enjeux sociaux et culturels du mouvement, contribuant ainsi à changer les regards sur cet art souvent mal compris.


Street Art Fest Grenoble-Alpes, crédits : Andrea Berlese
Un outil de sensibilisation, dialogue et contestation
Le street art est également devenu un outil important de sensibilisation sociale et environnementale. De nombreux artistes abordent des questions cruciales telles que les droits de l’homme, la justice sociale, ou encore la préservation de l’environnement. L’artiste et vidéaste italien Blu est connu pour ses multiples graffitis disséminés à travers le monde, notamment à Barcelone, New York, Varsovie, Londres et Rennes. Ses fresques abordent des sujets politiquement chargés, complexes et aux enjeux internationaux. Ici, une gigantesque bouche, dont les dents évoquent des immeubles, semble prête à dévorer un arbre aux feuilles verdoyantes. Cette représentation saisissante évoque le fléau de la déforestation.
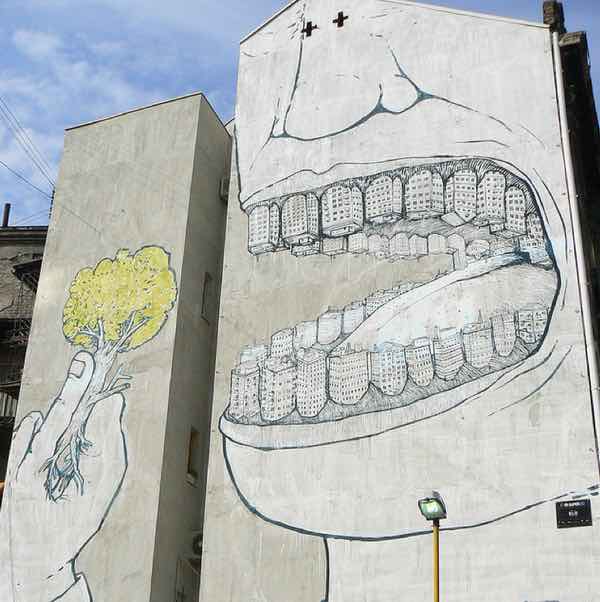
Peinture murale sur la déforestation réalisée par l’artiste Blu, en Serbie, crédits : La boite verte
Les artistes choisissent soigneusement leurs emplacements, tenant compte de l’architecture, de l’histoire locale et des dynamiques sociales. C’est le parti-pris que prend l’artiste JR en réalisant un projet artistique 28 Millimètres : Les Bosquets en 2004. Situé dans la banlieue parisienne, plus précisément à Montfermeil, Les Bosquets est un quartier marqué par les difficultés sociales et économiques. En 2006, en réaction à la stigmatisation médiatique de la jeunesse populaire, JR choisit de photographier les habitants des Bosquets, en leur demandant de se caricaturer et de se montrer sous un jour menaçant. Ce projet confronte les passants à des portraits caricaturaux des jeunes déployés vers divers quartiers de Paris, les invitant à réfléchir sur la représentation de la jeunesse des quartiers populaires. Né d'une volonté de donner une voix, JR engage ces habitants souvent marginalisés et stigmatisés dans un processus de création artistique qui démontre le potentiel du street art comme outil de collaboration et de dénonciation.
Une reconnaissance institutionnelle croissante
Face à l’engouement croissant pour le street art, de nombreuses institutions culturelles comme le Musée en Herbe avec l’exposition du graffeur Seth et le Grand Palais immersif présentant Loading. L’art urbain à l’ère numérique, reconnaissent désormais sa valeur artistique et sociale. Ce mouvement de reconnaissance témoigne de l’évolution de la perception de cette forme artistique autrefois marginalisée. En décembre 2023, le musée de l’Hospice Comtesse à Lille dédiait son exposition temporaire à l’artiste Jef Aérosol, un des pionniers du mouvement en France. Ses œuvres emblématiques furent exposées dans les salles historiques de cet ancien hospice, offrant ainsi un mélange surprenant entre l'art contemporain et le patrimoine historique. Cette exposition a attiré un large public, allant des passionnés d’art urbain aux visiteurs curieux. En présentant le travail de Jef Aérosol dans un cadre muséal, et en laissant les visiteurs investir une des cimaises de l’exposition, l’Hospice Comtesse contribue à son tour à la valorisation du street art en tant qu’expression artistique légitime. D’autres musées entièrement dédiés au street art émergent, comme le Art 42 à Paris ouvert en 2016 ou encore le Musée vivant d’Art Urbain et de Street Art à Neuf Brisach ouvert en 2018. En intégrant le street art en leur sein, les musées sensibilisent les publics plus sceptiques tout en valorisant ce mouvement soulevant généralement des questions sociales et politiques. Parallèlement, les villes collaborent de plus en plus avec les artistes pour intégrer le street art dans les projets de réhabilitation urbaine et de revitalisation des quartiers. C’est le cas de la ville de Charleville Mézières qui, en 2015, fait un appel à projet pour la création d’un parcours « art urbain » autour des poèmes d’Arthur Rimbaud. En réinvestissant les espaces vides, négligés ou abandonnés, le street art redonne vie à des murs amochés, invite les passants à redécouvrir leur ville et crée au fil des années un parcours de visite urbain, en lien avec Rimbaud, dans sa ville natale.


Vue aérienne de l’exposition Jeff Aérosol, Hospice Comtesse, Lille, crédits LS
Cimaise de l’exposition Jeff Aérosol, Hospice Comtesse, Lille, crédits LS
Des actions engagées
Les actions culturelles, événements et festivals autour du street art sont bien plus que de simples occasions de divertissement ou de contemplation artistique. Ils représentent des opérations dynamiques qui valorisent les différentes formes du street art. En favorisant la reconnaissance des artistes, ces initiatives enrichissent le paysage artistique contemporain et encouragent la diversité culturelle. De plus, en permettant aux artistes de créer directement avec le public, ces événements favorisent un échange culturel riche et stimulant, renforçant ainsi les liens sociaux et communautaires. Par leur capacité à sensibiliser aux enjeux sociaux, politiques et environnementaux, les actions culturelles deviennent également des outils de dialogue et de changement social. En encourageant l’inclusion, la créativité et l’expression individuelle, elles contribuent à façonner des sociétés plus ouvertes.
Léa Sauvage
#streetart #arturbain #actionsculturelles
Pour en savoir plus :

Les chefs au musée, Benoît Majorel du restaurant "Le Goût des Autres" à Caen, autour du beurre
Un chef qui cuisine des préparations à pour faire découvrir le beurre aux visiteurs gourmands ? C'était au Musée de Normandie, à Caen dans le cadre de l'exposition A table !en coproduction avec le Musée de Vire.
Pour revivre l'expérience en image, c'est par ici :
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.
En savoir plus : http://musee-de-normandie.caen
A. Le Belleguic-Chassagne
#Gourmandise
#Cuisine#Chef

Les dispositifs TSA dans les musées
De nombreux dispositifs ont pour objectif de favoriser l’accessibilité des publics en situation de handicap. Cependant, en France, 80% des handicaps sont invisibles, comme le Trouble du Spectre Autistique (TSA). Si les anglo-saxons ont été des exemples dans la prise en considération du TSA, plusieurs institutions françaises se démarquent aujourd’hui par les moyens qu’elles mettent en place.
image libre de droit, pexels.com.
Le TSA est provoqué par un développement cérébral atypique chez l’enfant. Si l’on parle de spectre, c’est pour prendre en compte toute la diversité de symptômes que présentent les personnes avec TSA. Ces troubles peuvent être une difficulté à communiquer, une difficulté à comprendre les émotions, les intérêts ou les comportements non-verbaux des autres individus ou encore des centres d’intérêt très spécifiques. Si certains ont une sensibilité accrue aux stimulations sensorielles (lumière, bruit, odeur, etc.), d'autres ont une sensibilité très faible. De la même manière, des personnes ayant un TSA peuvent présenter des capacités intellectuelles très diverses, de la déficience à l’intelligence spécialisée (le fait d’être très doué dans une discipline précise). Ainsi, cette variété de troubles s’exprime différemment chez chacun.
À cause de leur TSA, ces personnes peuvent ressentir des situations d’inconfort, de stress, de colère ou même des douleurs physiques qui entraînent des comportements qualifiés inappropriés dans des espaces publics. Pour favoriser leur confort et les encourager à participer à des activités culturelles, les projets se multiplient dans les musées. On peut distinguer trois grandes thématiques : les aides à la visite, le bien-être et la visée thérapeutique. Ces dispositifs sont également à destination d’un public plus large et d’autres troubles cérébraux comme des déficits de l’attention avec ou sans hyperactivité, le handicap intellectuel, etc., peuvent également les apprécier.
Les dispositifs d’aide à la visite
Pour préparer sa visite, certains musées publient sur leurs sites internet différents documents. Des plans sensoriels permettent aux personnes atteintes de TSA de planifier le parcours qu’ils vont suivre. Sur ce type de document sont indiqués les espaces bruyants et les espaces calmes des expositions afin de ne pas être surpris. Le Musée Camille Claudel, à Nogent-sur-Seine, met à disposition gratuitement en téléchargement un plan simple et ponctué d’icônes, permettant aux visiteurs atteints de TSA de visualiser leurs parcours (image ci-dessous). Le Louvre donne accès à deux plans, un premier pour le confort visuel illustrant quels endroits sont éclairés naturellement, et le second indiquant quels sont les espaces d’exposition où l’affluence est, en moyenne, plus faible. De la même manière, la Cité des Sciences et de l’Industrie, à Paris propose également ce genre de plans mais dispose de trois espaces calmes où la lumière est moins vive et l’ambiance sonore est modérée, ce qui permet de diminuer la surcharge sensorielle si la personne a besoin d’un moment de repos.
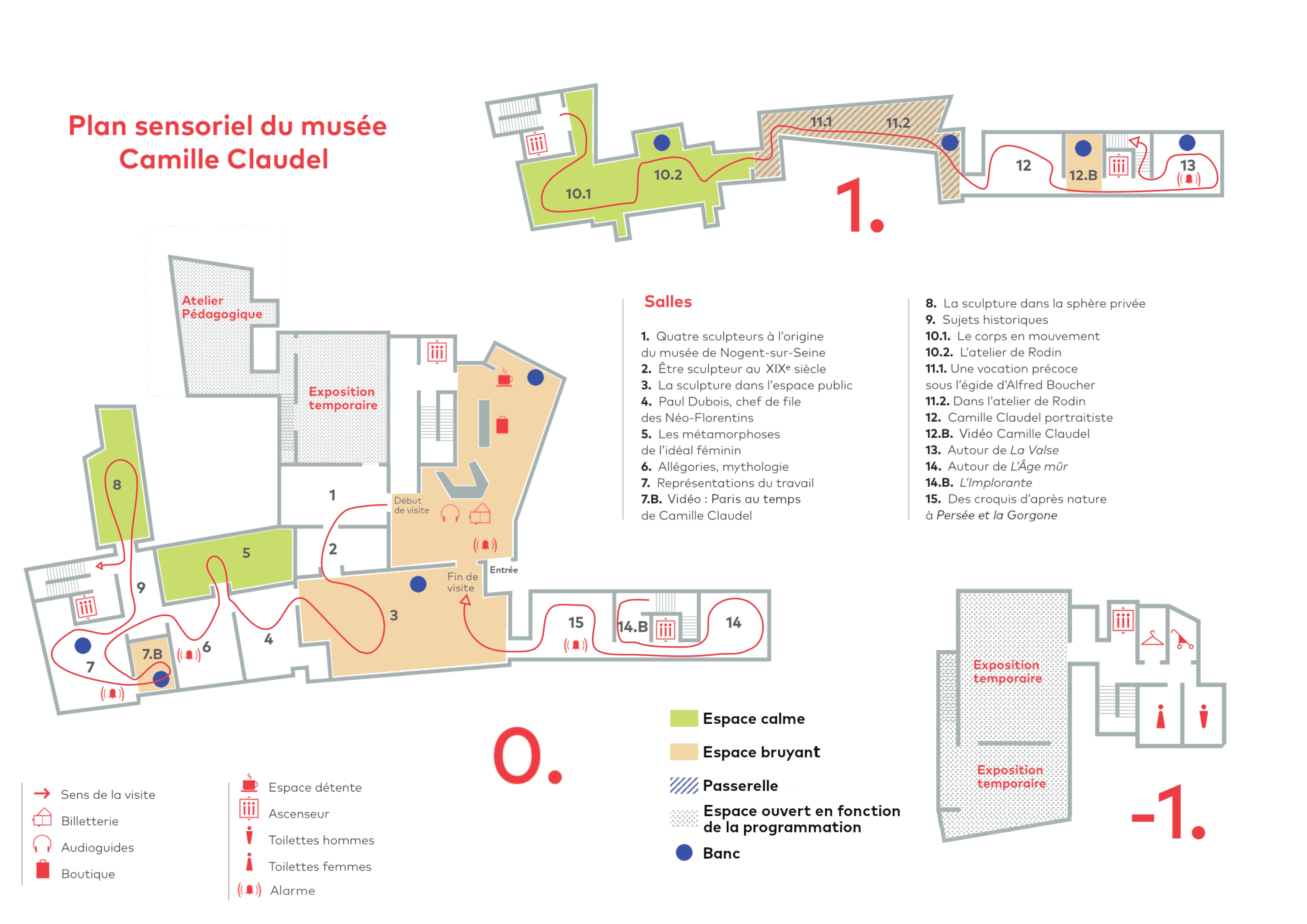
Plan sensoriel du musée Camille Claudel, mis à disposition sur le site du musée ©MuséeCamilleClaudel.
Ces musées mettent également à disposition des scénarios sociaux. Chacun de ces scénarios détaille les étapes à suivre pour visiter les lieux. Que ce soit pour le passage au contrôle de sécurité ou l’achat d’un billet, la Cité des Sciences et de l’Industrie a réalisé des documents, illustrés par de nombreuses photographies, où une personne en jaune montre les actions à réaliser. Des emplois du temps visuels vierges sont également téléchargeables, accompagnés d’une banque d’images, pour créer son parcours d’exposition et visualiser par anticipation les différents espaces. Le Musée Camille Claudel a publié une version pour adulte et une version pour enfant de ces scénarios sociaux en plus de pouvoir les visionner en vidéo. Le visiteur peut alors prévoir l’intégralité du parcours. La banque d’images proposée est également valorisée dans le cadre d’une Communication Alternative et Améliorée (CAA), de façon à favoriser la communication avec le ou les accompagnateurs ou avec le personnel du musée. Avec l’aide d’une éducatrice spécialisée, le Musée du Louvre a rédigé des parcours conseillés à destination des publics TSA ou de leurs accompagnateurs (Leriche, 2019). Ces parcours, relativement courts, se concentrent sur des espaces d’exposition précis et indiquent l’emplacement de certaines œuvres majeures de façon à trouver des repères dans les galeries.
Ces documents d’aide à la visite sont une première approche pour rendre le lieu d’exposition accessible. Ils témoignent du fait que l’institution s’intéresse à la question du handicap.
Le bien-être du visiteur
Malgré des dispositifs d’aide à la visite notables, nombre d’institutions ne proposent pas de dispositifs aidant le bien-être du visiteur. La Cité des Sciences et de l’Industrie invite les personnes atteintes de TSA à apporter leurs propres outils sensoriels, des objets permettant de canaliser l’attention ou d’aider lors de surcharge sensorielle (casque anti-bruit, lunettes de soleil, timer, fidgets, etc.). Toutefois, d'autres institutions vont plus loin en offrant aux publics spécifiques le prêt de ces objets. C’est notamment le cas des “sacs sensoriels” qui contiennent plusieurs outils d’autorégulation et permettent à la personne ayant un TSA de retrouver le calme en cas de surcharge sensorielle.
Lors de la Journée internationale du handicap, le 1ᵉʳ décembre 2023, le Muséum de Bordeaux a ainsi introduit un nouveau dispositif d'accessibilité : le sac sensoriel, baptisé sac FACIL (Facilité, Accompagne, Calme, Implique, Libère). Conçu spécifiquement pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique et de l'attention, ce sac contient une variété d'objets apaisants et réconfortants. Le sac FACIL, bien qu'initialement pensé pour les personnes ayant un TSA, est disponible pour tout visiteur. Le sac contient une sélection d'objets choisis par les visiteurs pour optimiser leur expérience. Que ce soit pour atténuer les stimulations sensorielles, se concentrer ou s'apaiser, le sac sensoriel s’adapte aux différents besoins spécifiques. Ces objets offrent un support sensoriel à la fois visuel et auditif, favorisant également la perception du corps dans l’espace. De plus, en complément de ce dispositif, l'institution a également aménagé un espace de repos équipé de fauteuils parapluies, conformément aux zones de repos déjà présentes dans d'autres musées français (Louvre-Lens, Centre Pompidou, Musée Toulouse-Lautrec, etc.). L’exemple du sac FACIL illustre bien la pertinence de la conception universelle : le dispositif est créé à partir d’un besoin spécifique mais sert l'intérêt de tous.

Sac sensoriel conçu par Lucie Nadrin (responsable du pôle médiation du muséum de Bordeaux) et son équipe ©MuseumBordeaux.
Le Musée national de la Marine, inauguré le 27 novembre 2023, porte également une attention particulière aux personnes atteintes de TSA et revendique une accessibilité universelle. Parmi ces dispositifs, un exemple novateur est la création d'un espace sensoriel inédit au sein du musée. Cette zone, appelée communément “La Bulle", tire son inspiration de la méthode Snoezelen. Conçue spécifiquement en collaboration avec des experts et des personnes en situation de handicap, notamment celles présentant un TSA, cette bulle vise à créer un environnement apaisant, où les visiteurs peuvent interagir avec les différentes stimulations sensorielles proposées. Cet espace est ouvert à tous les visiteurs, invitant ainsi chacun à découvrir cette expérience sensorielle unique. De même, le Musée de la Marine propose à ses visiteurs des créneaux de visite avec une “scénographie adoucie”, durant lesquels les variations sonores et lumineuses sont réduites. Cette initiative s’inspire des “heures silencieuses” proposées dans certains centres commerciaux. Il s’agit d’offrir une expérience de visite plus confortable aux personnes fatigables ou ayant une hypersensibilité.
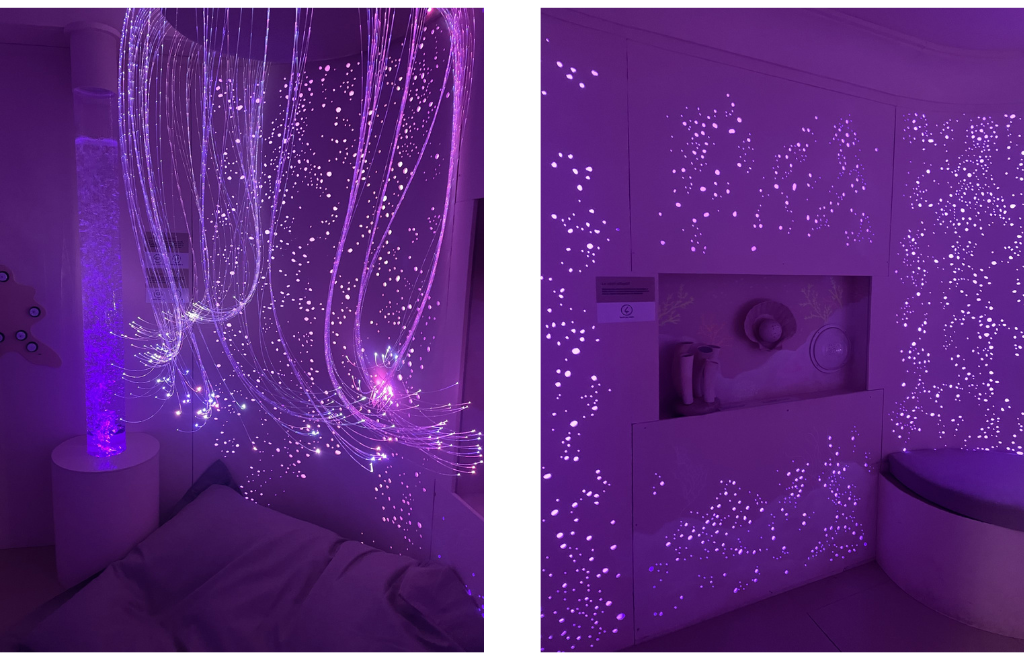
Espace “d’inspiration”, nommée La Bulle, présente au cœur du parcours permanent du Musée national de la Marine ©EmmaLaverdure.
Il est évident que tous les musées ne peuvent pas mettre en place un espace aussi onéreux que La Bulle, mais les outils sensoriels réutilisables sont une excellente alternative si les personnes atteintes d’un TSA ne disposent pas de leurs propres objets.
La visée thérapeutique
En 2014, au travers du FRAME (FRench American Museum Exchange), le Palais des Beaux-Arts de Lille se met en relation avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal et le Dallas Museum of Art. Forts de leurs différentes expériences, ils collaborent dans la rédaction d’un Guide muséal pour l’accueil des personnes autistes. Relayé par l’ICOM, ce document encourage la mise en place de différents dispositifs afin d’assurer l’inclusivité des musées et l’inclusion des personnes en situation de handicap invisible. Les musées étant des lieux informels d’apprentissage, ils « favorisent le développement d’habiletés comportementales, sociales et communicationnelles » (FRAMEwork, 2021, p. 29).
Le Palais des Beaux-Arts de Lille avait déjà mis au point fin 2013 une application pour tablette tactile, support prêté à l’accueil du musée. Conçue par l’association Signes de sens, développée en collaboration avec 2Visu production et financée par la Caisse d’Epargne Nord France Europe, Vivendi Create Joy et Pictanovo, cette application propose un parcours divertissant ponctué de jeux à destination des enfants et pensé pour être accessible aux personnes en situation de handicap. Toujours soucieux de la question du handicap et de l’accessibilité, le PBA décrit dans le FRAMEwork la mise en place d’ateliers de pratique artistique. Initialement accompagnés par un pédopsychiatre, puis par une art-thérapeute et différents personnels soignants dès 2012, ces ateliers ont pour but de développer les capacités sensorielles, intellectuelles et motrices. Introduit par une courte visite des espaces d’exposition, le participant expérimente, se concentre, s’affirme et prend conscience de sa place et de celle de l’autre dans un groupe social. Des artistes ou d’autres professionnels comme l’association Signe de Sens animent ces ateliers et définissent des thématiques, conjointement avec l’art-thérapeute, adaptés aux publics. En 2021, ce sont plus de 370 enfants, adolescents et jeunes adultes qui ont pu participer à près de 850 séances de pratique artistique.
La rédaction de ce guide permet aux professionnels des musées de prendre exemple sur ces dispositifs mis en place par les autres institutions sur la question du trouble du spectre autistique. À défaut d’avoir à disposition un atelier accessible, les professionnels de la santé s’accordent pour dire que les activités artistiques aident les personnes en situation de handicap. Toute institution peut imaginer mettre en place des visites adaptées ou peut essayer de valoriser des activités hors-les-murs avec des centres médicaux. Cependant, ce guide promeut une mixité des publics et non une véritable inclusion du handicap. La place des personnes avec TSA a été pensée, mais les personnes concernées n’ont pas été incluses dans ce travail et la mise en place de ces préconisations. Comme le conseil le FRAMEwork et l’association Signe de Sens, tous ces dispositifs sont à construire avec les publics concernés de façon à assurer leur efficacité. Les personnes en situation de handicap ne doivent pas être considérées comme des consommateurs passifs du musée, mais comme des acteurs de leurs démarches culturelles. Pour cela, la formation professionnelle est primordiale afin que chaque agent soit sensibilisé.
E. Laverdure & J. Crépin
#Accessibilité #Handicap #TSA
Pour en savoir plus :
- Cité des Sciences et de l’Industrie : Autisme, préparez votre visite : https://www.cite-sciences.fr/fr/ma-cite-accessible/autisme/preparez-votre-visite
- Musée Camille Claudel : Trouble du spectre de l’autisme : https://www.museecamilleclaudel.fr/fr/tsa
- Le Louvre : Un musée accessible à tous : https://www.louvre.fr/visiter/accessibilite/un-musee-accessible-a-tous
- Muséum de Bordeaux : L’accessibilité, une priorité au Muséum de Bordeaux : https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/accessibilite
- Musée National de la Marine : Visiter le Musée, publics avec besoins sensoriels : https://www.musee-marine.fr/fileadmin/user_upload/Paris/Visiter/brochures/MNM_Depliant-PublicsSensoriels-2023-FINAL-Bassedef.pdf
- Guide muséal pour l’accueil des personnes autistes, FRAMEwork, 2021, relayé par l’ICOM : https://www.icom-musees.fr/actualites/favoriser-linclusion-des-personnes-autistes-dans-les-musees
- Leriche, C. (2019). Musée et troubles du spectre autistique. Les Cahiers de l’École du Louvre. Recherches en histoire de l’art, histoire des civilisations, archéologie, anthropologie et muséologie, (14). : https://doi.org/10.4000/cel.4788.

Les tout-petits au musée d’art
Les tout-petits dérangent les visiteurs ? Mais que font-ils dans les musées ?
Entrée de l’exposition 1,2,3, Couleurs, Palais des Beaux-arts de Lille ©Gaëlle Magdelenne et Léa Sauvage
Ils pleurent, ils crient, ils courent puis ils rient aussi. Ce sont les tout-petits dans les musées. Nous, autres visiteurs, les entendons, tentons parfois de boucher nos oreilles en espérant que leurs parents les apaisent. Pour pouvoir profiter de notre visite. Mais pourquoi emmener son enfant au musée ? Les musées et les lieux culturels sont-ils des lieux appropriés à ces petits visiteurs ?
Qui sont les “tout-petits” ?
Les “tout-petits” sont originellement définis par la tranche d’âge de 12 à 36 mois. Dans les lieux culturels, les limites sont plus larges, elles englobent plus généralement les enfants de 0 à 6 ans. Cette tranche d'âge regroupe les petits ne sachant ni lire ni écrire, tout comme ceux qui ne savent pas encore marcher ou parler. Le parti-pris est ainsi de savoir délimiter les espaces, les activités et la médiation dédiées aux bébés et aux jeunes enfants. La médiation, bien différente pour ce public, devient un enjeu essentiel quant au fonctionnement et à la compréhension de ces espaces culturels.
Les liens entre le très jeune public et les lieux culturels ?
Le Musée en Herbe et La Cité des Sciences sont les lieux culturels précurseurs dans les propositions de programmation, de médiation et d’ateliers pour le jeune public et leurs accompagnants. A la suite de cette impulsion, les musées et lieux culturels français n’ont cessé de proposer différents dispositifs pour améliorer la visite libre des parents et des tout-petits. Le musée et sites archéologiques de Saint-Romain-en-Gal, par exemple, laisse à disposition des flâneuses, des fauteuils mobiles pour déambuler avec les enfants dans les collections. Mais ces dernières années, les lieux culturels vont plus loin : ils créent des ateliers d’éveil à l’art et à la création au sein d’espaces bébés bien délimités, ils créent des visites guidées en poussettes appelées « Cosy Visite ».
Une volonté politique
Si cette programmation très jeune public grandit et se diversifie aujourd’hui, c’est en partie dû à la signature d’un nouveau protocole interministériel en 2017, entre le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. Cette politique culturelle vise à développer, soutenir et accompagner l’éveil culturel et artistique de la petite enfance.
En 2019, Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste spécialisée dans les questions de l’enfance et de la famille, alerte sur la détérioration des liens parents-enfants. Dans son rapport sur la Stratégie en Santé culturelle, elle aborde la nécessité d’ouvrir les politiques culturelles sur le champ de la petite enfance. La mission Marinopoulos est lancée : la mise en place de dispositifs de médiation très jeune public et des espaces dédiés aux tout-petits dans les lieux culturels.
Pourquoi ?
Le but est de familiariser l'enfant avec le musée. Lui donner les codes pour comprendre ce lieu et ainsi le rendre accessible dès le plus jeune âge. Cela permet de s'approprier le lieu qui sort du cadre quotidien et rassurant de l'enfant.
Le défi pour les musées est donc de rendre accessible la culture aux plus jeunes. L'objectif est de jouer avec ce qu'ils connaissent déjà pour appréhender de nouveaux éléments. Certains musées ou lieux culturels vont adapter des activités en jouant avec les sens : l’ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût ou s’amuser avec des objets rappelant l'environnement quotidien des jeunes enfants, tel que des hochets, des tapis d’éveils ou des jeux de construction.
C'est également l'occasion pour les musées de créer des activités entre parents et enfants. Les parents sont à la recherche d'un éveil culturel pour leur enfant tout en recherchant des activités permettant de mettre à l'aise toute la famille. Être dans ces espaces jeune public au musée permet à l’enfant et son proche d’interagir ensemble avec les œuvres. Les médiations proposées favorisent les relations entre enfants et leurs accompagnants, avec d’autres enfants, parents et professionnels de la culture. Ainsi, ils intègrent ensemble les codes du lieu pour qu'il devienne familier et entre dans le cadre quotidien de l'enfant.

Espaces manipulables d’Eltono, Palais des Beaux-arts de Lille ©Gaëlle Magdelenne et Léa Sauvage
Des espaces et des lieux dédiés aux enfants de 0 à 6 ans : exemple du dispositif “1, 2, 3 couleurs”
Le Palais des Beaux-Arts de Lille a ouvert en octobre 2023 un tout nouvel espace temporaire de 200 m2, accueillant de la création contemporaine, dédié aux tout-petits. Cet espace, accessible sur réservation, est gratuit pour tous, néanmoins les adultes doivent s’acquitter d’un billet d’entrée au musée. En partenariat avec le centre d'initiation de l'art Mille Formes situé à Clermont-Ferrand et le centre Pompidou, cet espace situé dans l'atrium du musée, accueille les enfants de 0 à 6 ans. Pour le Palais des Beaux-Arts de Lille : « L'art est un facteur d'inclusion pour les tout-petits et leur famille ». Autour de dispositifs de créations contemporaines, les enfants et leurs parents pourront découvrir l'art ensemble, sur réservation et gratuitement, grâce à une expérience haute en couleur et en mobilisant les sens.
Durant ce temps de découverte, deux médiatrices répartissent les enfants en deux groupes, ceux de moins de 2 ans et demi et les plus grands (ainsi que leurs accompagnateurs) pour les guider vers les différents espaces. Jeu-Minots (de Claude Como) est un espace immersif recréé à partir de matériaux laineux qui renvoie au monde végétal. Dans cet espace, l’enfant de moins de 2 ans et demi est invité à toucher, manipuler et à se rouler dans les créations textiles. Espaces manipulables de l’artiste Eltono permet aux enfants de plus de 2 ans et demi d’utiliser leurs mains et leurs corps afin d’assembler, déplacer et manipuler différentes formes selon leurs envies en jouant. “1, 2, 3 couleurs” propose également deux autres espaces : un petit atelier qui familiarise à la création artistique ; et une cabane à histoires, qui invite les enfants à imaginer à l’infini.

Jeu-Minots de Claude Como, Palais des Beaux-arts de Lille ©Gaëlle Magdelenne et Léa Sauvage
Des dispositifs pensés pour itinérer dans des lieux publics et ruraux
Les dispositifs des artistes Eltono avec Espaces manipulables et Jeu-Minots de Claude Como, sont loués à Mille Formes, Centre d'initiation à l’art dédié aux enfants de 0 à 6 ans, pour une durée de cinq mois. Mille Formes accueille et propose de faire itinérer les œuvres et ateliers 0 - 6 ans dans d’autres lieux - des médiathèques ou des crèches. Ces lieux d’itinérances invitent à faire le lien entre des lieux culturels et des parents parfois réticents. Grâce à cette expérience la confiance s'accroît et incite les parents à revivre eux-mêmes cette expérience dans un lieu culturel comme le musée. Au début de l’année 2023, plusieurs Stations bébés mobiles présentées à Mille Formes et au Centre Pompidou au sein de l’espace 0.2 itinéraient dans plusieurs villes du Pas-de-Calais, afin de rendre accessible ces dispositifs au très jeune public plus éloigné des musées.
À l’issue de la dynamique lancée en 2019 par Sophie Marinopoulos et pour prendre soin de la relation parent-enfant, le tout-petit obtient une place centrale dans les lieux culturels. Renforcer la relation enfant - accompagnant, éveiller la créativité et l’imaginaire, et familiariser l’enfant avec le lieu culturel, deviennent des enjeux de fidélisation. La diversité des propositions est large : ateliers d’éveil et de motricité, visites adaptées dans les collections, ou simplement espaces de jeu et d'accueil.
Léa Sauvage et Gaëlle Magdelenne
Pour aller plus loin :
- Site du Palais des Beaux-Arts de Lille :https://pba.lille.fr/Agenda/1-2-3-COULEURS2
- Article sur le blog Bébé au musée, de Elise Mathieu : Bébé au musée (formation-exposition-musee.fr)
#Action culturelle #Médiations #trèsjeunepublic

Main dans la main
Benoît Jouan au LAM anime ici un atelier particulier qui fait se recontrer les enfants et leurs parents autour de la création.
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.
Amaury Vanet

Médiation détonante à la Piscine de Roubaix
Dans la série des médiations singulières, Caroline et Juliette vous proposent une rencontre détonante avec un guide-animateur peu commun à La Piscine de Roubaix, Julien Ravelomanantsoa.
Regards et non-regards, écoute, odeurs, ressenti, plaisir, jeu, gestes…, quelques ingrédients pour une médiation peu conventionnelle mais sensationnelle !
Pour aller plus loin :
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube"
Caroline Biondo et Juliette Gouesnard
#médiationsensorielle
#animation
#médiationsinguliere

Métier : restaurateur de mozaïque
Qu’est ce qu’un restaurateur de mosaïques ? Interview avec Marion Rapilliard et Hafed Rafai, respectivement restauratrice et restaurateur de mosaïques au Musée départemental Arles antique afin d’en savoir plus sur les enjeux et les différentes facettes du métier.
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.
Clotilde Villain

MuMaBoX
Au Musée André Malraux du Havre (76), le cinéma expérimental a trouvé une place de choix grâce à une programmation orchestrée par un passionné. L'occasion de découvrir des artistes, des techniques parfois déroutants.
A. Le Belleguic-Chassagne
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube
En savoir plus :
https://www.facebook.com/MuMaB
#Cinéma ArtVidéo
#CinémaExpérimental

Musée en miniature : la maquette dans l’institution muséale
Dans le cadre de deux expositions en 2021/2022 – respectivement Échelle et volume, la maquette d’aujourd’hui (Musée du Compagnonnage à Romanèche-Thorins (71), du 15 octobre 2021 au 31 mai 2022), et à l’occasion du festival de littérature jeunesse Des histoires pour l’histoire, une exposition sur « Les drôles de machines de Léonard de Vinci » (du 1er au 27 octobre 2021 au Temps des Cerises à Issy-les-Moulineaux (92)) – la maquette est à l’honneur. Si l’une présente le métier de maquettiste, aujourd’hui considéré comme artisanat d’art, l’autre évoque les différentes casquettes de Léonard de Vinci, et notamment celles de l’ingénieur et du concepteur de machines. À la fois objet de médiation mais également thème d’exposition, la maquette a une place de choix dans les musées et autres institutions muséales.
L’origine de la maquette
À l’origine, ce n’était pourtant pas tout à fait son dessein premier. Née durant l’Antiquité, notamment au travers de jouets sumériens, une maquette comme l’indique la définition du CNRTL, est un « Modèle réduit à trois dimensions, respectant les détails et les proportions d’un décor de théâtre, d’une construction en projet (le décor, la construction devant être réalisée suivant ces données) ». Il s’agit donc le plus souvent d’une reproduction d’un bâtiment en devenir, ou déjà existant. La maquette a donc, au départ, un aspect scientifique et technique, puisqu’elle sert à vérifier si une construction est solide, ou bien à mettre en lumière un projet autour d’une future construction. Elle sert aussi à démontrer un propos, à obtenir un nouveau point de vue sur un bâtiment ou un objet qui n’est observable que grâce à la réduction.
Avec la réalisation de figurines et de dioramas – d’autres formes d’objet entrant également dans le champ du modélisme et de la maquette – il semble approprié de reconnaître un aspect pédagogique à cette dernière. Celle-ci peut effectivement servir à enseigner ou illustrer un fait, un événement - notamment historique – à montrer l’évolution topographique d’un lieu, la situation géographique d’une ville à une date donnée ou bien encore donner vie à des batailles célèbres. Le diorama de la Bataille de Waterloo créé par Charles Laurent et exposé au Musée de la Figurine historique à Compiègne en est un parfait exemple. Le Musée des Plans-reliefs situé à l’Hôtel des Invalides à Paris ou la collection du Palais des beaux-arts de Lille constitue également un socle solide de représentations de plans militaires et techniques sur des villes ou des zones données.
Ainsi, le rôle de la maquette est – de prime abord – militaire, technique, industriel, scientifique et pédagogique. Elle a toujours fasciné, en témoigne l’existence de France Miniature à Elancourt, Italia in miniatura à Rimini ou bien encore Bekonscot à Beaconsfield au Royaume-Uni, des parcs à thèmes autour des monuments historiques mondiaux miniaturisés. Mais comme son descriptif l’indique, il n’est question ici que de parcs à thème, centré uniquement sur le divertissement et le spectaculaire. Mais il aide à voir l’intérêt vif porté à cet objet, et l’attrait qu’il peut représenter s’il est utilisé au sein d’un musée.
Comme indiqué précédemment, c’est un support pédagogique idéal pour représenter, expliquer, étudier ou promouvoir. La maquette permet de faire revivre ce qui n’existe plus (un château détruit), de rendre visible ce qui n’existe pas encore (un projet urbain) ou encore de donner à découvrir des éléments minuscules. Il semble dès lors convenir d’utiliser cet aspect pédagogique dans des lieux culturels. Ce passage sur la miniature dans l’ouvrage La miniature, dispositif artistique et modèle épistémologique dirigé par Evelyne Thoizel et Isabelle Roussel-Gillet tend à corroborer cette idée: «Le modèle réduit permet ainsi d’accéder à une autre forme d'intelligibilité en modifiant l’échelle de la représentation. Dans bien des musées d’archéologie ou d’histoire de la ville, une maquette, modèle réduit d’un bâtiment, est le passage obligé de la visite guidée. Elle offre un potentiel de rassemblement pour les médiations, afin que les visiteurs puissent se grouper autour d’elle et la voir ensemble. Le guide l’utilise pour leur donner des repères, des connaissances historiques sur l’architecture et les évolutions d’un bâtiment. La maquette comme dispositif interactif est alors au service de la compréhension scientifique » (Introduction).
Maquettes de l’exposition Les drôles de machines de Léonard de Vinci. Crédits: PT
Fac-similé de boucle de ceinture par Michel Campana. Crédits: PT
L’imaginaire au service du discours scientifique
Si la maquette a une fonction plutôt technique au départ, elle trouve également sa place dans les musées et autres institutions muséales. L’article de Daniel Jacobi intitulé «La maquette entre reconstitution savante et récit imaginaire dans les expositions archéologiques», qui est sous le prisme de l’exposition archéologique plus particulièrement, explique pourquoi un objet censé servir un but professionnel ou militaire est capable de servir une exposition, et pourquoi il y parvient aussi aisément. Si la maquette s’insère facilement dans un espace muséal, c’est qu’elle fait la part belle à l’imaginaire au sein d’un espace scientifique et historique. Support de médiation, elle permet d’expliciter un propos, de le démontrer tout en conservant un aspect ludique. La maquette ramène le visiteur à l’enfance, au jeu, à une part peut-être de spectaculaire, divertissant mais pour servir un propos scientifique. Cette recrudescence de l’usage de maquettes dans l’institution muséale provient, selon Daniel Jacobi, de l’arrivée de l’exposition temporaire lors de la refonte des musées durant les années 1980. Elle serait la première instigatrice de l’imaginaire au sein d’un discours muséographique. Dans son article, l’auteur explicite cette dimension scientifique de l’objet : « En tant qu’artefact muséographique, la maquette est sans aucun doute un dispositif pertinent pour donner à voir l’une des facettes majeures du discours scientifique archéologique : la reconstitution des édifices détruits et du mode de vie d’une civilisation disparue. Il permet, non seulement, de tester la validité d’une hypothèse scientifique […] mais aussi de la matérialiser concrètement ».
Il explique ensuite pourquoi il peut s’agir d’un dispositif muséographique attrayant et performant : « La maquette est une forme populaire. Plus encore, elle provoque une réaction presque jubilatoire en ce qu’elle évoque l’univers du jeu. Séduisante et attractive, elle suggère une posture de reconnaissance ludique et active. On l’observe, la commente, l’interprète comme une sorte d’énigme dans laquelle la solution est cachée. Et comme toute situation de jeu, la maquette incite à s’impliquer. Elle est en cela susceptible de devenir un support fantasmatique puisqu’elle est généralement associée, chez le visiteur adulte, aux souvenirs de l’enfance et à l’expérience d’une certaine liberté interprétative.». Dès lors, la faculté d’une maquette à communiquer et promouvoir, par exemple, un projet architectural en devenir se retrouve aussi dans une exposition muséale, où elle dévoile sous un nouveau jour ou tel qu’il a pu être un bâtiment ou une ville qui ne sont plus. Déchiffrable assez spontanément, elle est, pour reprendre les termes de Bourdieu, un art moyen. Il suffit de l’observer comme une saynète, d’en faire quasiment l’expérience empirique pour en comprendre, au moins une partie, l’interprétation scientifique dont on l’a imprégnée. Elle narre quelque chose visuellement. Elle donne également à voir l’objet original – sous sa forme réduite – comme un bâtiment sous un autre format, et on peut observer dès lors son organisation structurelle.
Elle se révèle ainsi comme un puissant dispositif cognitif : mettant en évidence ce qui est invisible, les détails qui semblent importants au maquettiste, les maquettes parviennent à illustrer de manière concrète le travail scientifique de l’exposition pour laquelle elle est utilisée. Par sa représentation de scènes, de monuments, de villes disparues ou appartenant au passé, la maquette matérialise et rend concret une hypothèse, un questionnement scientifique. L’exposition qui, pour Daniel Jacobi, est un nouveau média, permet aux chercheurs comme aux novices de s’approprier la maquette, s’approprier ce qu’elle retransmet. Ils se retrouvent conjointement autour du modèle réduit, qui est un plaisir partagé, un plaisir de l’enfance, plaisir qui se retrouve par ailleurs dans l’art de concevoir des modèles réduits – la confection de ces objets est devenu un loisir, un passe-temps pour nombre de personnes. Les maquettes ne sont après tout, selon l’auteur, « […] que de fragiles et éphémères constructions archéologiques imaginaires ».
La maquette, cœur d’expôt(sition), ou la maquette aujourd’hui
La maquette rentre donc aisément dans le champ muséal pour sa facilité à être comprise rapidement et à être un support de médiation. Tout d’abord, il convient de distinguer trois sortes de maquettes grâce aux éléments glanés précédemment. Il y a d’abord la maquette d’architecture, celle évoquée en première partie, qui est une œuvre d’art – et qui est exposée en tant que telle – et met à distance le visiteur, qui se contente de l’observer sans pouvoir la toucher. Ensuite, il existe la maquette conçue expressément pour la médiation comme la maquette de port fictif au musée portuaire de Dunkerque, qui permet aux visiteurs de découvrir comment fonctionne un port et son aménagement si particulier puis d’imaginer et construire à leur tour un port fictif et idéal. La Cité internationale de la dentelle et de la mode à Calais présente également une maquette du lieu qui montre la Cité telle qu’elle était auparavant et son évolution jusqu’à son apparence actuelle grâce à des éléments amovibles. Ce style de maquette s’explicite grâce à un médiateur qui en fait l’usage, la rend ludique tout en apprenant à son interlocuteur des données scientifiques, souvent à destination du jeune public. Enfin, il y a la maquette à actionner seule sans médiateur, et qui trouve sa place également dans le musée. Elle est alors considérée comme une manipe.
Dès lors, il apparaît évident que c’est un support modelable, malléable et qui rentre parfaitement dans le cadre muséal. Deux études de cas peuvent étayer ce propos : l’exposition « Les drôles de machines de Léonard de Vinci », qui fut exposée à la médiathèque Micro-Folie Le Temps des Cerises d’Issy-les-Moulineaux, et les maquettes du Musée portuaire de Dunkerque, où le nombre de modèles réduits conséquent, donnent à voir des méthodes de médiation variées.
L’exposition « Les drôles de machines de Léonard de Vinci » comprend trois axes de contenu. Tout d’abord, une présentation des « Machines de Léonard », conçue par les Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF-CVL), avec le concours de la Région Centre –Val de Loire grâce à des kakemonos. Puis, l’espace central d’exposition, situé sous une verrière, avec une série de maquettes et de fac-similés d’objets de travail et d’instruments qu’utilisait ou concevait l’artiste ingénieur toscan. Ces maquettes sont réalisées en bois par Claude Picoux, un ancien ingénieur devenu maquettiste à la retraite, ainsi que les instruments et mécanismes reconstitués de Michel Campana, réalisés en métal le plus souvent. Tous deux passionnés par Léonard de Vinci, leurs travaux respectifs sont mis au centre de l’exposition, où la muséographie présente et visualise réellement, et du mieux possible, les machines reproduites ou dessinées par l’artiste italien. Fondées sur les carnets de croquis de ce dernier, elles rendent vivantes les constructions de Léonard de Vinci. Lors des visites, les maquettes étaient utilisées (certaines sont amovibles et leurs mécanismes pouvaient réellement fonctionner) pour le plus grand plaisir des spectateurs de tous âges tout en expliquant comment elles ont été fabriquées et quelles machines elles représentaient. Ainsi, elles sont à la fois supports créés pour la médiation, objets pour illustrer une machine ayant ou n’ayant pas existé et expôt, puisqu’elles trônent au centre de la structure culturelle, et en deviennent dès lors des objets de collection.
L’autre étude de cas concerne le musée portuaire de Dunkerque, à la panoplie de maquettes de bateaux. Elles sont expôts, objets de collection au cœur de l’exposition mais aussi objets de médiation. Elles représentent des tranches de vie (il y a également des dioramas de moments de vie dans le port) avec des petits personnages dessus mais sont également des répliques de bateaux ayant navigué. Ces modèles réduits reproduisent fidèlement l’objet de départ – ou le faisant croire – et émerveillent le visiteur par son aspect ludique.
Toutefois, si ces maquettes rendent l’exposition ludique et bénéficient d’une médiation – en particulier celles de l’exposition sur les machines de Léonard de Vinci – elles restent tout de même des objets exposés sans réelle médiation pour les maquettes de Dunkerque. Par ailleurs, le trop plein de maquettes finit par desservir le propos ou surcharger le parcours visuel pour le visiteur.
Dès lors, s’il est vrai que la maquette peut offrir une médiation, son aspect ludique peut tout autant être moteur et frein à la compréhension. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’elle constitue la figure centrale d’une exposition. Le propos qu’elle sert ne peut être compris sous toutes ses coutures qu’à travers une explicitation de son fonctionnement. Mais étant souvent considéré comme un objet d’art, cet accès ne lui est, dans la majorité des cas, pas permis. Pour exploiter son potentiel à son maximum, la maquette doit peut-être se réinventer, et pousser ses capacités à être saisi à bras le corps par le visiteur en tant que manipe à son paroxysme. Elle ne serait plus seulement objet de médiation, ou objet de collection exposable mais partie intégrante de l’expérience de visite, sous toutes ses formes.

Maquette d’un navire au musée portuaire de Dunkerque. Crédits: PT
Pauline Tiadina
Pour aller plus loin :
- La maquette entre reconstitution savante et récit imaginaire dans les expositions archéologiques, Daniel JACOBI, mai-juin 2009
- « Introduction : La miniature, dispositif artistique et modèle épistémologique » par Evelyne THOIZEL et Isabelle ROUSSEL-GILLET, 26 avril 2018
- La vraie-fausse nature des dioramas, Clémence de Carvalho, L’art de Muser, 20 octobre 2021
#maquette #DispositifMuséographique #imaginaire

Museum Live #5 au Centre Pompidou
Au Centre Pompidou, le groupe Art Session, constitué de jeunes entre 18 et 25 ans propose régulièrement des soirées événementielles.
A l'occasion du Museum Live #5, L'Art de Muser est parti à la rencontre de ces bénévoles et de Florence Morat, chargée de programmation, qui les accompagne.
Aénora Le Belleguic-Chassagne
Pour en savoir plus :
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube
#CentrePompidou
#ArtSession
#Live
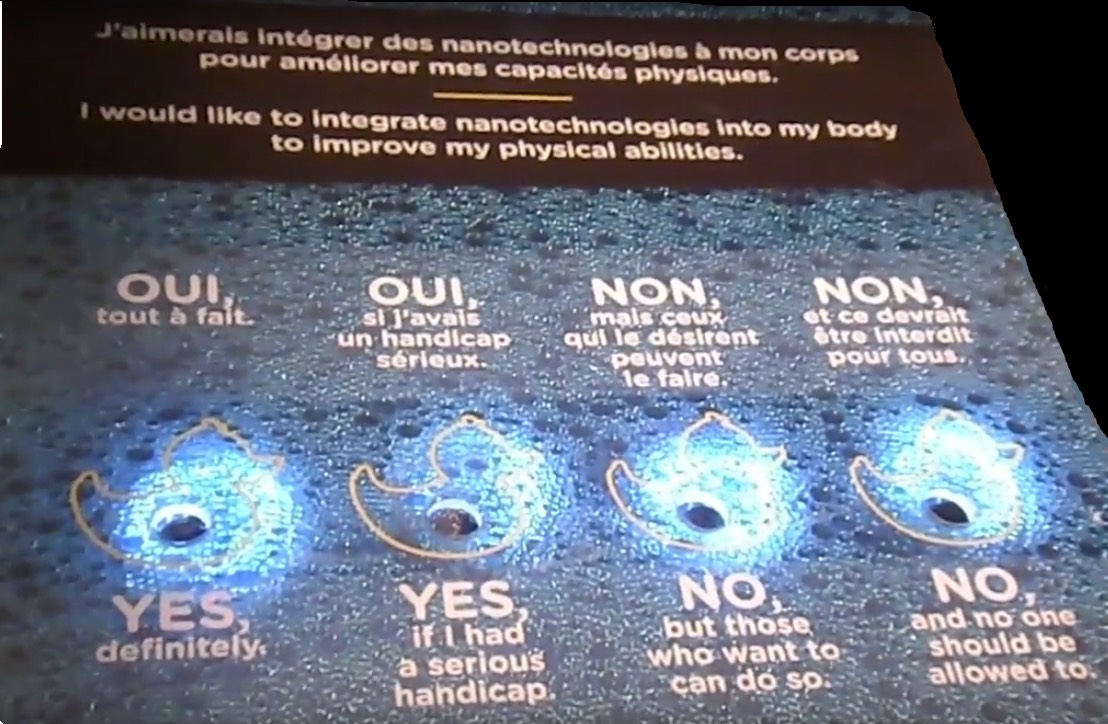
Nanotechnologie
Proposer au visiteur d'être actif dans la connaissance c'est ce que proposent, chacun à leur façon, le Museon Arlaten (Arles) et le Musée de la civilisation (Québec) :
Dans Nanotechnologie (Musée de la civilisation de Québec), le visiteur est invité à comprendre et se positionner sur le sujet des nanotechnologies, généralement réservé aux experts.
Avec les journées de la contribution, le Museon fait appel à ses publics pour l'aider à documenter ses collections. Rendez-vous à Arles aux journées du patrimoine pour voir la restitution de cette fructueuse collaboration l'année prochaine pour participer à la deuxième édition !
Océane De Souza
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube

Opération Wikimuseum au Palais des Beaux-Arts de Lille
Le rayonnement des collections des institutions muséales, se joue désormais dans le partage et dans les actions participatives en ligne. Le Palais des Beaux-Arts de Lille a lancé fin 2016, l'action Wikimuseum pour inciter les visiteurs à publier leurs documents personnels liés au musée (photos, dessins, écrits...). Sur la plateforme collaborative Wikimuseum, les documents sont mis en ligne par le grand public. Des "wikipermanences" organisées dans le musée aident les néophytes à se lancer dans le partage de documents parfois précieux ou insolites.
En savoir plus : • Lancement de la collecte de photos en ligne par le Palais des Beaux-Arts de Lille • Projet Wikimuseum sur le portail de Wikipedia •
Exemple de document numérisé : Charles Patelle-Bluttel, "L'Ecole hollandaise de Lille"
Hélène Prigent
16 mars 2017
#collecte
#numérique
#collaboratif

Performance théâtrale pour découvrir l'art brut
La première chose que je remarque, ce sont ses pantoufles. Sous un costume noir très élégant et professionnel, le médiateur qui nous accueille à la Collection de l’Art Brut de Lausanne avec un regard qui brille d'intelligence, porte des pantoufles. D’accord, je pense en réprimant un sourire, ça doit être un exemple de la fameuse philosophie “take it easy” à la Suisse.
La visite démarre, et j’ai une deuxième surprise. Pas de contextualisation historique ou de digression artistique, pas de diligente pérégrination d’une œuvre à l’autre. Dès les premiers mots, il est clair que cette visite ne va rien avoir d’ordinaire ou de banal.
Ce jeune homme nous emporte tous (la dizaine très hétérogène de personnes qui constitue notre groupe), avec sa voix et son enthousiasme. Comme un moderne jongleur, il bouge frénétiquement d’un tableau à une sculpture, nous obligeant parfois presque à lui courir après pour ne pas perdre le fil du récit. Il parle des auteurs comme s’ils étaient des amis (le terme artistes est très controversé dans le milieu de l’art brut). Il les appelle par leurs prénoms, souvent avec une expression rêveuse ou amusée, comme s’il était en train d’évoquer des souvenirs partagés.
C’est comme cela, avec une grande douceur, qu’il nous raconte par exemple l’histoire d'Aloïse, de sa naissance en 1886, de son métier de couturière et de ses rêves de devenir cantatrice. Nous apprenons et presque vivons avec elle une passion autant brûlante qu’imaginaire pour l’empereur allemand Guillaume II et nous frissonnons en découvrant son enfermement dans un asile en 1918, suite à la manifestation d’une exaltation religieuse jugée pathologique. Pourtant ses dessins ne reflètent ni tristesse ni colère, ils sont des instantanées pris dans un univers parallèle de contes et d’amour où le rouge et les fleurs dominent le paysage.
A ce point, notre guide fait une pause et nous fait un signe de conspirateur. En se levant sur la pointe des pieds il atteint une enveloppe qui était posée au-dessus d’un tableau et il nous chuchote : “Une lettre d’Aloïse !”. Il invite alors un des visiteurs, une dame très émue, à la lire à voix haute pour tous. Pendant quelques minutes, nous pourrions ressembler à un groupe de fidèles qui se réunissent en silence dans un lieu sacré, tant la lettre et la voix qui l’accompagnent sont touchantes.
Cette première étape n’est qu’un avant-goût de l’incroyable visite qui nous est proposée. Un voyage de 45 minutes farfelu et un peu fébrile, constellé des personnages fascinants et enrichi d’éléments purement théâtraux : notre surprenant médiateur qui converse aimablement avec une chaise vide pour reproduire l’interview originale avec un des auteurs, ou une canne à pêche abandonné au dernier étage du musée par un des personnages (fictifs) de la narration.
Une fois la visite terminée, les chanceux participants n’ont pas seulement été sensibilisés à l’art brut et beaucoup appris sur plusieurs de ses représentants, mais ils auront vécu une expérience rare et, c’est le cas de le dire, magique.
Les créateurs de cette médiation sont Nicolas (metteur en scène) et Romain (acteur), futurs diplômés de la Manufacture de Lausanne (prestigieuse école de théâtre et danse). Ils ont été sollicités par La Collection de l’Art brut en occasion de la Nuit des Musées et ils ont imaginé cette déambulation extravagante. Le musée souhaitait présenter une médiation originale et n’a pas été déçu : le succès que cette médiation a rencontré est tel qu’aujourd’hui elle est insérée dans la programmation du musée. Croiser le spectacle vivant et les visites guidées n’est pas une expérience inédite dans le monde muséale, mais il est rare qu’une telle liberté soit accordée aux artistes de la part de l’institution accueillante. Nicolas et Romain travaillent pour l’imaginaire et parfois ont demandé des dérogations à l’exactitude “scientifique” : comme tromper les visiteurs en décrivant un tableau devant un autre, le cauchemar de tous les conservateurs !
Les visites de Monsieur Jean capturent et séduisent, guident dans un royaume enchanté et solennel. Seul avertissement, même si Nicolas vous quittera sans que vous ayez le temps de prendre congé des fantômes qu’il aura évoqués sous vos yeux, ils risquent de vous suivre pendant quelques temps.
Par rapport à d’autres médiations de comédiens dans un espace muséal, pourquoi est-ce plus pertinent et réussi dans ce cas ?
Lara Zambonelli
#incroyablevisite
#artbrut
#lausanne
En savoir plus :
- Collection de l’art brut de Lausanne
http://www.artbrut.ch/fr/21070/collection-art-brut-lausanne
- Les visites de Monsieur Jean
http://www.manufacture.ch/fr/2109/Les-visites-de-Monsieur-Jean
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube

Peut-on jouer avec la mort ?
Au cinéma, dans la littérature, la musique, les arts plastiques, leur représentation nous fait trembler, pleurer, hurler de peur parfois. Les cimetières. Qui n’a jamais secrètement rêvé de se retrouver enfermé.e dans un cimetière en pleine nuit, seul.e ou accompagné.e pour une séance de spiritisme inoubliable ? Dans la vraie vie, cette séquence dramatique est généralement plus expérimentale, serré.e.s les uns contre les autres, dans le grenier de la maison familiale, avec des pots de yaourts vides en guise d’oracle.
L’univers inquiétant des cimetières, de la mort et la vie post-mortem fascine. Instinctivement, cet univers est associé à un environnement lugubre, des couleurs sombres et des sentiments douloureux. Cette association est pourtant très judéo-chrétienne et occidentale. Traversons l’Océan Atlantique en survolant Cuba pour atterrir au Mexique. El Dia de los muertos, le jour des morts, est une période de fête et de célébration ancrée dans la culture mexicaine contemporaine. Depuis 2003, ces célébrations sont d’ailleurs inscrites au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, reconnues comme « chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité ». Pendant ces jours de célébration des photos des personnes défuntes dont on célèbre la mémoire sont installées sur des autels, décorés de nappes, de fleurs, de nourritures colorées.

Photographie d’un autel El dia de los muertos © Eneas de Troya source https://www.flickr.com/photos/eneas/4072192627/
Pourtant en France, la mort est taboue et le chemin est encore long avant que l’on puisse désacraliser les cimetières et séparer de nos imaginaires le noir, le chagrin et le décès. Ce cheminement a peut-être été entamé en 2017 au couvent des Jacobins de Toulouse, avec l’événement "Ci-je Gis !". Par le biais d’expositions de photographies, et de performances théâtrales, les visiteur.se.s étaient invité.e.s à s’approprier l’idée de la mort sur un ton décalé, « avec humour et poésie ». C’est un couvent qui dispose d’un patrimoine funéraire par la présence de crypte et de tombes. Par ailleurs, il est plus commun aujourd’hui de pouvoir suivre une visite guidée au sein d’un cimetière. Cette initiative existe notamment au cimetière de Saint-Pierre à Saint-Pierre et Miquelon. La visite est l’occasion d’évoquer l’histoire de la population. C’est également le cas, dans la petite commune de Couture, au Nord d’Angoulême, où il est proposé aux visiteurs de découvrir le patrimoine funéraire du Ruffécois. L’objectif de cette visite est précisément de distancier cimetière et tristesse. Et plus connu, visiter le cimetière du Père-Lachaise seul.e ou accompagné.e d’un guide permet de découvrir les tombes d’illustres chanteurs, artistes, peintres etc.
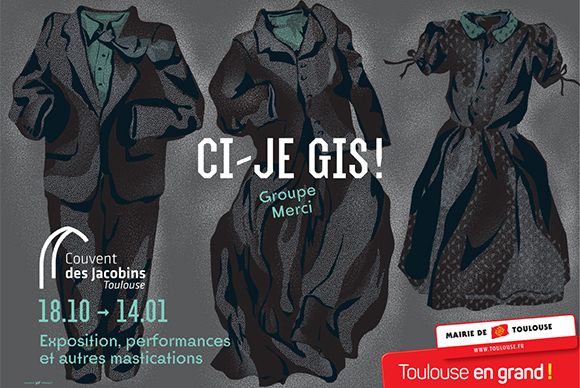
Affiche de l’événement Ci-je Gis ! au Couvent des Jacobins à Toulouse © Conception graphique VIF Design
Chez nos voisins belges, le rapport à la fin de la vie est déjà moins lourd. Depuis 2002, l’euthanasie active est dépénalisée. La Belgique est l’un des - très - rares pays au monde à l’autoriser. Prenons un autre exemple : Jacky Legge, conservateur au Musée du Folklore et des imaginaires de Tournai dispose déjà de son monument funéraire, réalisé par un artiste contemporain, au cimetière du Sud de Tournai.
Un cimetière vivant
Le cimetière du Sud de Tournai est un cimetière vivant. Il est créé en 1784 et s’étend sur plus de sept hectares. Une importante équipe de bénévoles travaille à la conservation de son patrimoine funéraire et de nombreuses initiatives sont mises en place pour le faire vivre. Et notamment pour valoriser la plus ancienne partie du cimetière, le périmètre historique. Dans ce périmètre, des artistes contemporains sont invités à créer, parfois directement sur les monuments funéraires. Ainsi, dans l’esprit de la méthode japonaise de restauration de porcelaines ou de céramiques, le Kintsugi, l’artiste français, Emmanuel Bayon a pu réparer une tombe en y ajoutant un morceau de bois peint en rouge mais tout en laissant apparentes les marques laissées par le temps. Un petit musée a également vu le jour dans le bâtiment qui n’est autre que l’ancienne morgue. Là où l’on exposait avant les corps des personnes décédées, sont désormais présentés aux visiteur.se.s différents éléments du patrimoine du cimetière.

Extrait du Carnet de jeu de piste, photographies de monuments funéraires créés par des artistes contemporains © Labelpages
L’initiative la plus récente est la participation du mouvement de jeunesse de Tournai, Patro NDA, à la 9ème édition du concours Musées(em)Portables organisé par Museumexperts. C’est un concours qui consiste à tourner un film, à l’aide d’un téléphone portable, d’une durée de 3 minutes maximum dans un lieu culturel ou patrimonial. Pour l’occasion, et toujours dans cette optique de valoriser le patrimoine funéraire, l’équipe des bénévoles du cimetière a accepté que le petit film du Patro y soit réalisé.
Auparavant, lors de l’ouverture des journées européennes du Patrimoine de 2018, le cimetière avait accueilli la compagnie de danse Danses & Cie de Tournai. La compagnie présente le spectacle Aux Portes du temps, un dialogue onirique à la tombée du jour entre les danseurs et l’architecture. Ce spectacle faisait partie d’une ambition plus large de revaloriser le patrimoine funéraire du lieu. Il a été mené en collaboration avec la Commission pour la Sauvegarde du Patrimoine Funéraire des cimetières de Tournai et l’école primaire Saint-Piat de la ville.
Photographie du spectacle de Danse Aux portes du temps, par la compagnie Danses & Cie de Tournai © Jacques Desablens
Des Os, des enquêteurs et une tombe mystère
En septembre 2018, est donc inauguré au cimetière un outil de médiation conçu spécialement pour lui. C’est un jeu de piste qui permet de découvrir le lieu en famille, muni d’une valisette et d’une énigme à résoudre. Il s’adresse aux enfants à partir de 8 ans et à « toutes celles et ceux qui ont gardé leur âme d’enfant ». Ils sont invités à jouer aux détectives pour retrouver une tombe mystère. Le lieu et ce qu’il représente sont désacralisés et pour le temps de l’enquête, Tournai prouve qu’il est possible de jouer et d’apprendre dans un environnement a priori lugubre.
La Commission pour la sauvegarde du patrimoine funéraire des cimetières de Tournai a eu l’opportunité de mener à bien ce projet grâce à Prométhéa, une référence en Belgique en matière de mécénat. Prométhéa se donne pour mission de développer le mécénat d’entreprise dans le domaine de la culture et du patrimoine. Tous les ans, un appel à projet a lieu et offre au lauréat une somme d’argent permettant au projet de voir le jour. En 2018, le Cimetière du Sud de Tournai devient lauréat et le jeu de piste "Des Os & Moi" est réalisé en quelques mois. C’est une initiative originale à plusieurs titres. En rédigeant cet article, j’ai recherché d’autres actions culturelles de ce type dans des cimetières, "Des Os & Moi" semble véritablement faire figure de proue en la matière. Son originalité ? Avoir été conçu par des enfants et proposer une approche ludique du cimetière. La Commission du lieu a fait appel à des élèves de 4ème, 5ème et 6ème primaire de l’école libre fondamentale Saint-Piat de Tournai. Ce qui correspond aux classes de CM1, CM2 et 6ème en France. Dans le carnet de jeu de piste, les élèves ayant participé à la création de cet outil de médiation, sont d’ailleurs nommément remerciés.

Eléments composant la valisette du jeu de piste © Commission pour la sauvegarde du patrimoine funéraire des cimetières de Tournai
Les enquêteurs partent donc carnet et carte du cimetière en main, à la recherche d’une tombe perdue. Cette tombe se situe au cœur du périmètre historique du cimetière, qui détient les monuments funéraires les plus anciens et le patrimoine que la Commission cherche en premier lieu à valoriser. Est également fourni aux Miss Marple et Hercule Poirot en herbe, une valisette qui complète l’outil de médiation. S’y trouve une loupe, des lunettes, les pièces d’un puzzle, un sablier et des impressions 3D permettant de reconstituer, en modèle réduit, une sépulture. Le jeu de piste est l’occasion d’arpenter les allées du cimetière, d’observer son patrimoine funéraire et ses caractéristiques. Les enfants, et les plus grands, peuvent appréhender les matériaux des monuments funéraires, la signification derrières des abréviations latines communément présentes sur les stèles, mais apprennent également à « lire » les sépultures. Et à savoir notamment quel était le métier de la personne défunte en regardant les éléments composant la tombe, comprendre les éléments de décoration comme les sabliers, les colonnes brisées, les flambeaux retournés etc. Mais également des informations plus pratiques comme apprendre à savoir à qui incombe la charge de l’entretien d’une tombe.
La mort n’est pas un sujet facile à aborder avec des enfants. Cet outil étant complet et pédagogique, il peut permettre d’amorcer un premier pas vers ce sujet en dédramatisant l’image de la mort et en se familiarisant avec les cimetières et leur patrimoine.
Ce type d’initiative est intéressante mais rendue possible grâce à l’existence d’une commission bénévole de conservation du patrimoine funéraire. Si ce type de commission est répandue au sein des cimetières belges, en France elles demeurent rares. La question de la conservation du patrimoine funéraire soulève de nombreuses questions, notamment quant au respect des droits des familles. En 2018, un sénateur pose une question ouverte au ministre de la Culture relative à la question de la conservation du patrimoine funéraire français, conscient de leur nature historique et leur intérêt artistique et mémoriel. Dans sa réponse, le ministre rappelle qu’à ce jour, « environ 450 cimetières ou parties de cimetières, tombes et tombeaux, caveaux, mausolées, stèles, dalles funéraires et pierre tombales sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques ». Mais cette protection n’a pas vocation à gérer les cimetières. Pour le reste le patrimoine relève du droit et du domaine privé et est géré par les familles. Ce qui entraîne de nombreuses pertes lorsque les familles ne sont plus à même d’entretenir les stèles, pierres tombales etc. Quand bien même ces monuments ont un intérêt patrimonial.
Cette question fait suite à une initiative prise par le Patrimoine Aurhalpin, une fédération régionale des acteurs du patrimoine d’Auvergne-Rhône-Alpes. En 2014, afin de trouver des réponses aux problématiques de sauvegarde de ce patrimoine particulier, la fédération met en place une commission Patrimoine funéraire. L’enjeu est alors d’organiser un événement culturel « permettant la découverte du patrimoine funéraire sur l’ensemble de la région ». Le Printemps des cimetières voit le jour en mai 2016 et depuis se tient tous les ans à cette période. Il permet de visiter les « jardins de pierres » lors d’animations dans et hors cimetières. L’objectif visé est de « raconter l’histoire locale, de mettre en lumière des personnalités, de présenter les savoir-faire liés à la pierre ou au métal, de découvrir l’art et la symbolique funéraire, de sensibiliser à la biodiversité… ». L’an dernier, l’événement a réuni plus de 2200 visiteurs. Et devant la réussite de l’initiative, elle s’est étendue au printemps, le 26 mai dernier à Paris dans plusieurs cimetières de la capitale.
Alors rendez-vous les 15, 16 et 17 mai 2020, en région Auvergne-Rhônes-Alpes, pour apprécier la richesse du patrimoine funéraire local, sous l’angle de « l’Histoire et les histoires de nos cimetières » !
Manon Lévignat
#jeudepiste
#patrimoine funéraire
#cimetièredusud

Prescriptions muséales, vers le soin ?
Quelles sont les preuves concernant le rôle de l’art et des musées dans l’amélioration de la santé et du bien-être ?
Prescription muséale © Musée des Beaux-Arts de Montréal.
Dans le Dictionnaire de Muséologie, la muséothérapie est définie par la chercheuse en neuroesthétique Dorota Folga Januszewska et le précurseur de cette discipline en Pologne Robert Kotowshi, comme :
“ L’utilisation des collections, de récits, d’espaces et de dispositifs expographiques comme solutions thérapeutiques pour traiter certaines maladies. La muséothérapie vise à contribuer à l’amélioration du bien-être, de la santé physique et mentale et de la stabilité émotionnelle des participants, et à concourir à la quête d'identité par le contact direct avec la culture, l’art et l’environnement naturel.[1] “
Le développement des neurosciences, dont la neuroesthétique à la fin du XXème siècle, a contribué à faire du musée un lieu d’éducation multisensorielle et de développement de la perception[2].
La muséothérapie est aussi intimement liée à la neuromuséologie, qui a d’abord été étudiée en Pologne. Cette discipline est rattachée aux recherches à propos de la neuroperception, autrement dit aux liens créés entre la visite du musée et la perception multisensorielle et la réception émotionnelle des visiteurs[3].
C’est dans ce sillage que des établissements tels que le Musée national de Kielce (Pologne) et le Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM) (Canada) ont été les premiers, dans les années 2010, à intégrer parmi leurs actions culturelles des séances de muséothérapie.
Le MBAM a inauguré en 2016 l’Atelier International d’éducation et d’art-thérapie Michel de la Chenelière[4]. Il s’agit du plus grand complexe éducatif dans un musée d'art en Amérique, et accueille chaque année plus de 300 000 participants grâce à la collaboration d’art thérapeutes, d’experts du milieu de la santé ou encore d’éducateurs[5].
La collaboration entre Nathalie Bondil, à ce moment-là directrice générale et conservatrice en chef du MBAM, et l’association Médecins francophones a permis d’initier dès 2018 la prescription de visites gratuites du MBAM à des patients souffrant physiquement ou mentalement[6].
La muséothérapie fait l'objet de multiples expérimentations depuis les années 2010, et se développe au sein de plus en plus d’institutions muséales françaises.
Le point de départ des actions santé du Palais des Beaux-Arts de Lille (PBA) prend place dès 2008 avec un projet visant à accueillir des enfants, adolescents et jeunes adultes souffrant de troubles de la sphère autistique. L’équipe projet était composée d’une chargée de médiation, d’une art thérapeute et de quatre artistes plasticiens qui ont mis en place des ateliers de pratiques artistiques et de découverte des œuvres suivant un rythme hebdomadaire de manière à assurer le bon suivi des séances[7].
Le 6 novembre 2023, le CHU de Lille et le PBA ont signé une convention de partenariat dans le but de développer à leur tour la prescription muséale. Sachant que dès 2012, deux art-thérapeutes avaient déjà intégré l’équipe et accueillaient des patients issus de services tels que l’oncologie, l’addictologie et la pédopsychiatrie. Ce partenariat avec le CHU de Lille permet de faire de la muséothérapie l’un des piliers de la politique d’accueil et d’implication des publics du PBA. Le musée propose depuis 140 ateliers d’art-thérapie par an, pour accueillir jusqu’à 1 400 patients issus des services du CHU de Lille[8]. Des séances sont aussi ouvertes aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer suivis au Centre Mémoire du CHU[9].
Inauguré en 2012, le Louvre-Lens a pour objectif d'ouvrir à tous l'accès aux collections nationales, et mène depuis son ouverture une politique d’actions singulières en matière de santé et de bien-être.
Des partenariats et des projets-pilotes sont co-élaborés depuis 2014 avec le Centre hospitalier de Lens, mais aussi avec des professionnels du monde médical, hospitalier, associatif, universitaire et muséal. C’est depuis 2023 que le Louvre-Lens a ouvert un nouveau programme de séances gratuites : le Louvre-Lens-Thérapie[10]. Les médecins du centre hospitalier peuvent aussi prescrire, sous la forme d’un bon, des visites au musée à leurs patients[11] avec l’accompagnement d’un art-thérapeute et une médiatrice culturelle.
L’exploration de la muséothérapie, notamment par le biais des prescriptions muséales, permet de faire du musée un laboratoire visant à stimuler des sensations de bonheur, d’introspection, la réduction du stress et s’attache à contrer l’isolement. Mais peut-on réellement aider les patients en leur proposant d’aller au musée ? Peut-on véritablement parler de soin, de cure ?
Nathalie Bondil considère la muséothérapie comme un outil de santé publique. Elle explique lors d’une interview pour le SITEM que les organisations internationales, telles que l’ICOM, l’OCDE et l’OMS ont validé cette approche, et soutiennent diverses recherches[12].
En effet, le rapport de 2019 de l’OMS intitulé « What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being ? » [Quelles sont les preuves concernant le rôle de l’art dans l’amélioration de la santé et du bien-être ?] recense plus de 3 000 études scientifiques qui ont permis de conclure que les arts jouent un rôle important dans la prévention des problèmes de santé, la promotion de la santé, ainsi que dans la prise en charge et le traitement des maladies[13] tout au long de la vie des patients[14].
La muséothérapie s’inscrit dans une dynamique plus large d’inclusion sociale au sein des musées. Bien que cette discipline soit encore en développement, avec des recherches relativement récentes, les spécialistes s’accordent pour dire qu'une influence positive sur les patients est observée. Il est alors essentiel d'encourager la collaboration entre le monde de la santé et l'univers muséal, afin d’évaluer rigoureusement les nouvelles études de terrain qui confirmeront sans doute, à terme, les effets thérapeutiques des musées[15].
Solène Bérus
[1] F. MAIRESSE (dir.), 2022, Dictionnaire de muséologie, Paris, Armand Colin, p. 446. ↩
[2] Sztuka i Filozofia, https://artandphilosophy.pl/wp-content/uploads/2020/11/SZiF_42_05_Folga.pdf, publié en 2013, Dorota Folga‑Januszewska, Museum vs. Neuroesthetics [consulté le 17/10/2024]. ↩
[3] F. MAIRESSE (dir.), 2022, Dictionnaire de muséologie, Paris, Armand Colin, p. 457. ↩
[4] La Lettre de l’OCIM, https://journals.openedition.org/ocim/1896, publié en ligne le 01/01/2019, Mélissa Nauleau, Musée + Art-thérapie = Muséothérapie ? [consulté le 14/10/2024]. ↩
[5] Musée des Beaux-Arts de Montréal, https://www.mbam.qc.ca/fr/actualites/inauguration-nouveau-pavillon-paix-michal-renata-hornstein/, publié le 05/11/2016, Semaine d'inauguration du nouveau Pavillon pour la Paix [consulté le 14/10/2024]. ↩
[6] Médecins francophones du Canada, https://www.medecinsfrancophones.ca/un-projet-pilote-novateur-pour-le-mieux-etre-des-patients-par-lart-prescriptions-museales-mbam-mdfc/, publié le 30/10/2018, Un projet-pilote novateur pour le mieux-être des patients par l’art : Prescriptions muséales MBAM-MdFC [consulté le 15/10/2024]. ↩
[7] Palais des Beaux-Arts de Lille, https://pba.lille.fr/Visiter/Groupe/Sante-et-Art-therapie/Lancement-du-Guide-museal-pour-l-accueil-des-personnes-autistes, date de publication inconnue, Lancement du Guide muséal pour l’accueil des personnes autistes [consulté le 17/10/2024]. ↩
[8] Club Innovation & Culture CLIC France,https://www.club-innovation-culture.fr/palais-beaux-arts-lille-chu-lille-prescription-museale-convention/#:~:text=La%20prescription%20mus%C3%A9ale%20est%20un,%2C%20th%C3%A9%C3%A2tre%2C%20chant%E2%80%A6 , publié le 09/10/2023, En signant une convention triennale, le Palais des Beaux-Arts de Lille et le CHU de Lille vont développer la prescription muséale [consulté le 17/10/2024]. ↩
[9] Club Innovation & Culture CLIC France,https://www.club-innovation-culture.fr/palais-beaux-arts-lille-chu-lille-prescription-museale-convention/#:~:text=La%20prescription%20mus%C3%A9ale%20est%20un,%2C%20th%C3%A9%C3%A2tre%2C%20chant%E2%80%A6 , publié le 09/10/2023, En signant une convention triennale, le Palais des Beaux-Arts de Lille et le CHU de Lille vont développer la prescription muséale [consulté le 17/10/2024]. ↩
[10] Le Mag, Le Louvre-Lens des entreprises, https://lemag.louvrelens.fr/evenements/initiation-a-la-museotherapie-au-louvre-lens/#:~:text=En%202023%2C%20le%20Louvre%2DLens,nous%20renvoie%2Dt%2Delle%20%3F, publié le 16/05/2024, Initiation à la muséothérapie au Louvre-Lens [consulté le 16/10/2024]. ↩
[11] France Bleu Nord, https://www.francebleu.fr/emissions/fier-de-ceux-qui-font-bouger-le-nord-et-le-pas-de-calais/la-museotherapie-avec-gunilla-lapointe-chargee-des-mediations-au-louvre-lens-2770086, diffusé le 16/10/2023, La muséothérapie avec Gunilla Lapointe chargée des médiations au Louvre Lens [consulté le 17/10/2024]. ↩
[12] SITEM, https://www.sitem.fr/conferences/le-musee-therapeute/#:~:text=La%20%C2%AB%20mus%C3%A9oth%C3%A9rapie%20%C2%BB%2C%20un%20outil%20en%20sant%C3%A9%20publique&text=Ce%20concept%20consid%C3%A8re%20le%20mus%C3%A9e,les%20neurosciences%20et%20la%20m%C3%A9decine, publié le 15/09/2021, Le musée thérapeute [consulté le 14/10/2024]. ↩
[13] Art For Science, https://www.artforscience.eu/plus-de-900-publications-scientifiques-traitent-des-effets-de-lart-culture-sur-la-sante-selon-le-rapport-du-11-novembre-2019-de-loms/, publié le 06/07/2020, Plus de 900 publications scientifiques traitent des effets de l’art & culture sur la santé, selon le rapport du 11 novembre 2019 de l’OMS [consulté le 15/10/2024]. ↩
[14] Organisation Mondiale de la Santé, https://who-sandbox.squiz.cloud/fr/publications/abstracts/what-is-the-evidence-on-the-role-of-the-arts-in-improving-health-and-well-being-a-scoping-review-2019, publié en 2019, Daisy Fancourt, Saoirse Finn, Quelles sont les preuves concernant le rôle de l’art dans l’amélioration de la santé et du bien-être ? [consulté le 17/10/2024]. ↩
[15] Les cahiers d’études de l’observatoire de l’Ocim, https://www.calameo.com/read/0057770602ca344bce4cf, publié en 2021, Leslie Labbé, La muséothérapie, analyse des potentiels thérapeutiques du musée [consulté le 22/10/2024]. ↩
Pour aller plus loin, plusieurs journées d’études sont prochainement organisées à ce sujet :
- Les 52 minutes d’ICOM France - Des musées en leur temps : « Le musée qui soigne, du care au cure : la muséothérapie. » Le jeudi 31 octobre 2024 à 12h30 // En ligne. https://www.icom-musees.fr/actualites/le-musee-qui-soigne-du-care-au-cure-la-museotherapie
- Rencontres professionnelles Occitanie Musées : « Musée et soin : du care au cure ? »
Le 21 novembre 2024 à 14h30 // présentiel Université Paul Valéry Montpellier III, et en ligne. - https://www.mbam.qc.ca/fr/education/mieux-etre/
- https://pba.lille.fr/Agenda/LES-ATELIERS-D-ART-THERAPIE
- https://www.louvrelens.fr/activity/louvre-lens-therapie/

Qu’est ce qui se cache sur le toit du forum des Sciences ?
Les visiteurs sont invités à faire de nombreuses découvertes au forum départemental des Sciences, mais le plus grand mystère reste ce quise cache sur le toit !
Indices
- Il faut porter un costume spécial
- Elles font « bzzz »
- Et produisent du miel
Et oui, dans le cadre de ses actions pour l’éco-responsabilité, le forum a installé des ruches sur le toit.
Lien : https://youtu.be/0JOMjXGtIf0
Eglantine Lelong
Pour en savoir plus :
http://www.forumdepartementaldessciences.fr/
https://www.rustica.fr/articles-jardin/installer-ruche-toute-securite,3094.html
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" suryoutube
#Sciences
#Ruche
#Environnement

Quand je suis devenu peintre
Une après-midi de libre, les beaux jours qui font leur retour timide, une envie de balade muséale agrémentée d’un thé et d’un macaron servis au café … Voilà un contexte bien approprié pour décider d’aller errer dans l’écrin XIXe du Petit Palais.
Malette de peintre et dispositifs de médiation divers © Emeline Larroudé
Sous la hauteur des plafonds peints dans un style fin de siècle, c’est moins l’écrasement d’une architecture monumentale que l’apaisement devant des figures lascives aux colorations douces qui s’opère. Moi, primo visiteur ? Que nenni. Devant cette magnificence, difficile de rester impassible, si bien que s’y rendre devient presque régulier. Et pourtant ! Voilà que cet établissement si souvent arpenté arrive encore à me surprendre. Dans une partie des galeries longeant les jardins fleuris se déploient des expositions temporaires. J’ai eu le loisir d’apprendre, une fois traversé le pont depuis les Invalides, que du 6 février au 13 mai 2018 se tient Les Hollandais à Paris, 1789-1914. Ma foi, un témoignage des échanges artistiques fréquents et souvent emblématiques des artistes peut être enrichissant. D’autant plus que l’affiche mentionne Van Gogh et Mondrian. Si l’un me laisse perplexe, l’autre m’éblouit par sa touche, et la mention de ces personnalités aux styles hétérogènes trahit déjà la richesse du contenu développé. De fait, j’ai rarement été déçu par une des expositions proposées par ce musée municipal Beaux-Arts. C’est alors le pas léger et l’estomac presque vide que je m’avance un peu nonchalant vers les espaces dédiés après avoir pris mon billet. Je salue l’agent de surveillance, je m’imprègne du sujet en parcourant l’introduction, je papillonne sous la verrière de chefs-d’œuvre et continue mon chemin de salle en salle, m’arrêtant ci et là lorsque mon regard se trouve inexplicablement attiré par une composition élancée ou des couleurs vives.
Copie en cours d’un chef-d’œuvre des collections du musée © E. L.
Là, après avoir traversé plusieurs salles présentant les travaux d’artistes qui, avouons-le, ne m’étaient pas familiers, je me plonge dans un Van Gogh qui se cherche, assez peu exploité. Je croise, amusé, des regards perplexes. C’est alors que, tandis que mes yeux longent les murs, j’aperçois une inscription blanche fléchée bien discrète sur ce fond bleu marin, « espace pédagogique ». Espace pédagogique ? Que peuvent-ils bien entendre par-là ? Ne puis-je y entrer sans petits-enfants pour prétexte ? Qu’ont-ils à leur proposer ? De la pratique ? Cela fait-il partie de l’exposition ou est-ce une annexe ? Je m’attarde à proximité, me retourne intrigué pour voir si je suis le seul à avoir remarqué cette signalétique, et constate qu’il y a du passage. La curiosité trop piquée, je ne peux m’empêcher de franchir précautionneusement le seuil d’entrée de cette salle qui, dans l’angle de la porte, semble déjà éblouir de sa lumière comme la source éclairée d’un tableau clair-obscur. Je m’arrête, saisi par la clarté qu’offrent ces grandes fenêtres donnant sur l’extérieur dans cette pièce qui retrouve une hauteur de plafond non-négligeable. Déjà, c’est l’agréable surprise, je me retrouve émerveillé dans un environnement auquel je ne m’attendais pas. Je guette et découvre, après avoir tenté de poser mon regard sur tout ce qui y est installé, que je me trouve en réalité dans L’Atelier du peintre. D’évidence, le public n’est pas plus bambin qu’ailleurs, et bien que quelque peu déstabilisé par la proposition, je me redonne toute légitimité à la parcourir.
Dispositif Dessiner par la fenêtre © E. L.
Réalisation en cours de la plasticienne © E. L.
En effet, se dressent cinq ou six chevalets et leurs tabourets associés au centre de la pièce. Que font-ils ? Faut-il réserver pour participer ? Guidés par une plasticienne, certains visiteurs s’attèlent à tenter de reproduire des chefs-d’œuvre mentionnés par le catalogue de l’exposition. Celle-ci en profite pour m’informer de la gratuité de la participation, des horaires des ateliers, et du reste des informations pratiques qui se trouvent sur le panneau de présentation à l’entrée. Pardonnez ma méprise, mais ce texte tout en longueur est bien la chose la moins attrayante ici. Quand bien même, nous sommes un vendredi après-midi, et le vendredi après-midi, c’est donc atelier Dessiner pour voir. Ma petite fringale tente de me rappeler à l’ordre, mais je suis bien trop obnubilé par les créations en train de prendre forme. Quel exercice laborieux se doit être, mais quel plaisir de contempler ces travaux s’exécuter dans une concentration pleine de sérénité. Regarder, c’est déjà se libérer, profiter d’un apaisement sans commune mesure. La tentation de prendre part est là, mais d’aucun pourrait se raviser devant la peur de mal faire, de n’avoir jamais fait ou de ne pas être à la hauteur (quelle hauteur ?). Si je n’ai jusqu’alors jamais dépassé le stade de novice, j’entends bien cependant que le dessin peut être considéré comme une activité très personnelle et intime, que l’on ne souhaite pas partager avec d’illustres inconnus nous observant avec insistance.
Dessin effectué par un visiteur durant l’atelier Dessiner pour voir © E. L.
Mais le dessin, pour moi, c’est avant tout les croquis esquissés dans le jardin de ma grand-mère, à retranscrire les paysages. C’est l’herbier crayonné en récoltant diverses feuilles. C’est aussi mon oncle qui, peintre amateur, s’est tenté à une carrière d’artiste. C’est un passe-temps trop longtemps délaissé, fruit dont j’ai encore le souvenir du goût, mais que j’ai cessé de croquer. Peut-être que le moment est venu pour moi d’y revenir, dans une émulation mutuelle, ici, dans les espaces aménagés du Petit Palais. Oui, je sens les craies et fusains qui m’attirent. Le café et les macarons vont attendre, la résignation aussi.
Emeline Larroudé
Liens internet :
http://www.petitpalais.paris.fr/sites/default/files/content/scholar-kits/latelier_du_peintre.pdf
http://www.petitpalais.paris.fr/expositions/les-hollandais-paris-1789-1914
https://www.facebook.com/Petit-Palais-mus%C3%A9e-des-Beaux-arts-de-la-Ville-de-Paris-273861966942/

Raconter l'Histoire de l'Art
Mais quel est donc ce livre présent dans toutes les boutiques de musée et dont la première de couverture semble nous fixer ? Les Yeux de Mona, un roman de fiction sorti en janvier 2024, écrit par Thomas Schlesser, est encensé par la critique et aurait « conquis le monde ». Il se révèle être un manuel d’Histoire de l’Art singulier.
Détail de La Jeune Fille à la Perle, Vermeer, 1665, Musée Mauritshuis (Domaine public).
Un récit intergénérationnel
Avant tout, c’est une œuvre de fiction. Mona, une petite fille de 10 ans, risque de perdre définitivement la vue. Son grand-père, Henry, soucieux de lui laisser comme souvenirs des « splendeurs visuelles », décide de l'emmener chaque semaine dans un musée pour y observer consciencieusement une œuvre d’art. Il pense que l’art est thérapeutique, et nous le savons aujourd’hui grâce aux différentes médiations qui sont organisées à destination de personnes malades ou hospitalisées (la muséothérapie).
Dans ce livre, dédié à « tous les grands-parents du monde », nous suivons ces sorties hebdomadaires, organisées en trois parties selon les trois grands musées parisiens visités : Louvre, Orsay et Beaubourg. Le grand-père sélectionne une œuvre et demande à sa petite-fille de la regarder en silence. S’ensuit une description, rapide et sensible. Puis vient le moment des questions, des interrogations enfantines mais légitimes, des réflexions aussi innocentes que sincères. Mona questionne ce grand-père qui ne la jugera pas pour son ignorance. Elle ose également critiquer des chefs-d’œuvre parfois mis sur un piédestal. Son jeune âge est le vecteur d’une liberté d’expression qui amène une vraie fraîcheur par rapport au discours sur les Beaux-Arts.
Si le livre est aussi bien reçu par le public, c’est en grande partie pour cet aspect poétique. On ne lit pas simplement des descriptions d’œuvres, nous partageons un moment intergénérationnel. C’est ce qui plaît, les réflexions d’une enfant faisant parfois rire. Mais le regard qu’elle pose sur ces peintures et ces sculptures est aussi touchant, faisant des liens et remarquant des choses que nous, adultes, ne prenons plus la peine d’observer. Beaux-Arts Magazine parle d’une « initiation à la vie par l’art ». L’auteur explique aussi sa manière de se délecter des œuvres, d’abord s’en emparer par une lente observation puis ensuite en chercher le sens et les symboliques. Henry est ici le médiateur qui répond directement aux questions de son jeune public. Il remplace un cartel trop impersonnel, partageant avec la fillette une complicité pétillante.

Premier tableau décrit dans le livre : Vénus et les trois Grâces offrant des présents à une jeune fille, Botticelli, fin du XVe siècle, Musée du Louvre (Domaine public).
Une histoire des chefs-d’œuvres parisiens
Les 52 œuvres qu’Henry présente à Mona sont des œuvres ayant une place dans l’Histoire de l’Art. De Vinci, Vermeer, Monet, Van Gogh, Duchamp, Kahlo, De Saint-Phalle, Abramovic ou encore Soulages sont chacun⋅e représenté⋅e⋅s par une seule œuvre soigneusement sélectionnée pour leur contribution au monde de l’Art. Les techniques sont explicitées de façon à être compréhensibles pour une enfant. Le vocabulaire reste cependant parfois compliqué, ce que Mona souligne sans gêne. Quinze œuvres illustrent le XVIe, le XVIIe et le XVIIIe siècle, puis quinze tableaux couvrent le XIXe siècle. Dans les 22 œuvres restantes, seulement neuf sont contemporaines (après 1945) dont deux ont été réalisées au XXIe siècle.
À la manière d’un manuel classique de l’Histoire de l’Art, chaque chapitre correspond à une œuvre. La description physique est objective, hors de la narration. Les explications qui suivent sont pertinentes et précisent à chaque fois un contexte socio-politique. La photographie de Mrs Herbert Duckworth, faite en 1872 par Julia Margaret Cameron, est l’occasion d’aborder l’évolution des techniques et l’invention de la camera obscura. La sculpture L’Oiseau dans l’espace de Brancusi (1941) est un moyen d’aborder l’abstraction, mais aussi le marché de l’art. Experts comme néophytes y trouveront leur compte dans un panorama soigneusement sélectionné par l’auteur. Paris a été choisi pour la narration, pour que les personnages puissent s’y déplacer simplement, mais évidemment les chefs-d’œuvre existent ailleurs et s’étendent sur une période beaucoup plus grande. De même, le beau et l’Histoire de l’Art peuvent être présents dans des Muséums d’histoire, de science ou de société.
Chaque chapitre porte le nom de l’artiste et une simple phrase, comme une maxime : « Laisse les sentiments s’exprimer » ; « Simplifie » ; « Lève le regard » ; « Il n’existe pas de sexe faible ». Elles essaient de résumer l’idée principale de l’œuvre ou la leçon de vie qui l’accompagne.
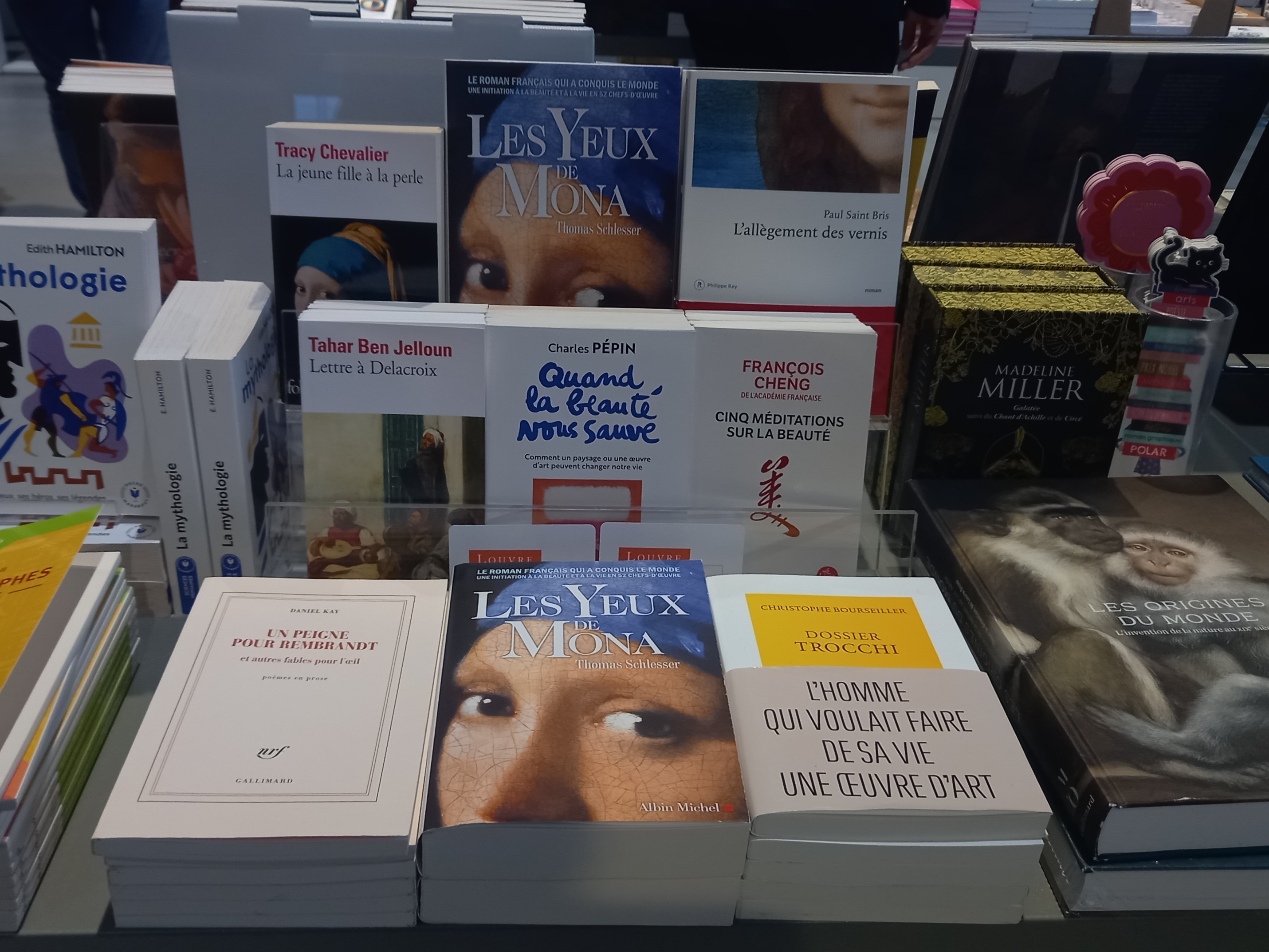
Les Yeux de Mona, mis en valeur dans les rayons de la boutique du Louvre-Lens © J.C. 2024.
Une médiation singulière
Les Yeux de Mona est un succès mondial, traduit dans presque 40 langues. Mais pourquoi ce phénomène littéraire ? Si la simple histoire d’un grand-père voulant faire découvrir à sa petite-fille sa définition du beau fonctionne parfaitement, c’est également l’approche pédagogique qui marche. Cette fiction reprend toutes les informations disponibles dans un bon manuel d’Histoire de l’Art, mais elle y ajoute une sensibilité. Il ne s’agit pas de lire des informations factuelles sur Esclave mourant de Michel-Ange ou Meule de foin III de Mondrian, mais de visiter aux côtés de Mona et Henry. Au travers des yeux d’une enfant de 10 ans, on ne regarde pas seulement une œuvre, on contemple également le bâtiment dans lequel elle est exposée et on observe malicieusement les autres visiteurs. Ce sont des scènes de vie, des situations que l’on retrouve typiquement au cours de nos visites qui ponctuent l’histoire. Entre des surveillants de salle qui tempêtent « No flash please ! » et les spectacles sur l’esplanade de Beaubourg, on se questionne sur l’existence du Père Noël et on s’imagine faire des attractions dans les grands tuyaux colorés du Centre Pompidou. On découvre ou on redécouvre ces classiques de l’Histoire de l’Art comme si nous étions aux côtés des personnages. L’œuvre n’est pas sacralisée, elle nous apprend des choses sur l’évolution du monde, sur l’expression, sur la politique, etc. Expliqués par un grand-père presque exemplaire, les Beaux-Arts sont alors accessibles à tous. Personne ne peut avoir de lacune, avec Mona, on repart de zéro et on découvre ces galeries parisiennes.
C’est là aussi tout l’intérêt de ce livre : remettre à sa juste place la variable sociale qui existe lors d’une visite au musée. L’expérience de visite est invariablement un facteur important. C’est une réflexion qui pourrait alimenter les médiations des musées de Beaux-Arts, qui décrivent des œuvres d’une façon parfois insensible et trop objective. Souvent, les références utilisées ne sont pas expliquées, comme si tout-un-chacun connaissait l’existence de L’Enfer de Dante ou le contexte géopolitique flamand du XVIIe siècle. Les questions des enfants sont aussi des questions que les adultes se posent. De telles réflexions pourraient permettre d’être plus inclusif envers des publics moins connaisseurs. Avec un tel exemple, l’explication des œuvres serait empreinte de plus d’émotion et pourquoi pas d’une co-construction avec son public. Cette écriture permet d’accéder aux œuvres différemment.
Les Yeux de Mona est une belle approche de l’Histoire de l’Art, accessible à tous et particulièrement poétique.
Jules Crépin
Pour aller plus loin :
- La muséothérapie : Musée + Art-thérapie = Muséothérapie, Mélissa Nauleau, Lettre de l’Ocim 2018. https://journals.openedition.org/ocim/1896
- Une interview de Thomas Schlesser par Florelle Guillaume pour Beaux-Arts Magazine (2024) : https://www.beauxarts.com/grand-format/thomas-schlesser-les-yeux-de-mona-nest-pas-une-histoire-de-lart-cest-une-initiation-a-la-vie-par-lart/
#Littérature #Histoire de l’Art #Médiation
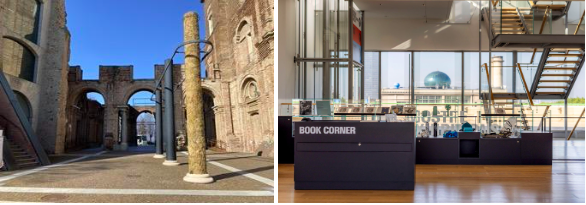
Réactiver un lieu historique par le biais de l’art contemporain? Le cas de la Pinacoteca Giovanni et Marella Agnelli à Turin et du Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea
Voyagez entre passé, présent et futur, en découvrant des collections d’art contemporain qui vous accueillent dans un contexte historique et architectural original !
Transformer ces lieux aux XXe et XXIe siècles
Quelle(s) Histoire(s) ?
Espace dédié à la production d’expositions de projets in situ commandés à des artistes italiens et internationaux, la Pinacothèque Agnelli, inaugurée en 2002, résulte d’une transformation du quartier Lingotto à Turin, qui fut l’un des principaux sites industriels de FIAT. Jusqu’en 2019, le bâtiment abritait le siège et les bureaux du constructeur italien. Aucune FIAT Torpedo, 508 Balilla, 500 Topolino ou Lancia Delta n’est présente aujourd’hui. Si ce sont les voitures qui vous intéressent, dirigez-vous plutôt vers le Museo nazionale dell’Automobile situé à une vingtaine de minutes de la Pinacothèque. Si vous souhaitez avoir une vue panoramique sur Turin et sur les Alpes tout en déambulant à travers des projets d’installations artistiques, vous êtes au bon endroit. La Pinacothèque présente un parcours d’exposition en plein air qui s’étend sur la piste historique du toit du Lingotto, la Pista 500, utilisée par l’usine FIAT pour les essais automobiles. Les interventions opérées entre réaménagement architectural et passé industriel invitent à découvrir un circuit fermé au public au XXe siècle devenu une piste désormais ouverte semée d’installations sonores et de sculptures. La collection permanente de la Pinacothèque comprend 25 œuvres acquises par Giovanni Agnelli et Marella Caracciolo. Si vous aimez l’art européen, vous tomberez sous le charme de l’art vénitien du XVIIIe siècle de Canaletto, les statues en plâtre d’Antonio Canova, l’impressionnisme de Auguste Renoir, ou le futurisme de Giacomo Balla. Quant aux expositions temporaires, elles sont conçues et produites spécifiquement pour les espaces de la Pinacothèque. Entre expositions monographiques consacrées à des artistes contemporains (Salvo. Arrivare in tempo, Thomas Bayrle. Form form Superform, Sylvie Fleury. Turn me on...), la Pinacothèque organise des séries d’expositions intitulées Behind the Collection qui mettent en regard des parcours transhistoriques et transgénérationnels entre des artistes contemporains et des œuvres de la Pinacothèque. En 2023-2024, l’exposition Vulcanizzato faisait dialoguer l’œuvre de Lucy McKenzie avec Antonio Canova, et en 2022-2023, un dialogue artistique s’est opéré entre Simon Starling et Giambattista.
Le passé du Château de Rivoli est plus rocambolesque que la Pinacothèque Agnelli, accrochez-vous bien...
Forteresse militaire au XIe siècle, propriété de la Maison de Savoie au XIIe siècle, résidence de cour au XVIIe siècle, caserne militaire au XIXe siècle et situé à 15km de Turin, le Château de Rivoli accueille désormais une collection permanente et des expositions temporaires d’art contemporain. Le château, dressé sur la colline de l’amphithéâtre de Rivoli-Avigliana, se compose de deux structures : le château dans son aspect du XVIIIe siècle et la Manica Lunga (Aile Longue) construite dans les années 1600 et longue de plus de 140 mètres. L’historique architectural et historique détaillé remonte au XVIIIe siècle lorsque le duc Emmanuel-Philibert transforme sa première résidence piémontaise en palais d’agrément. Le complexe s’enrichit de la Manica Lunga qui correspond à la pinacothèque ducale et qui accueille aujourd’hui les expositions temporaires. Au XVIIIe siècle, cœur battant de la vie de cour de Savoie, le château reçoit au sein de sa pinacothèque les artistes les plus renommés de l’époque comme Sebastiano Conca, Sebastiano Ricci, Gaspar van Wittel, ou encore Francesco Trevisani.
Victor-Amédée II de Savoie, roi de Sicile, confie à l’architecte Filippo Juvarra l’agrandissement du château, un projet jamais abouti pour cause d’emprisonnement de Victor-Amédée II et du nouveau roi, Charles-Emmanuel III, qui ne souhaita pas continuer les travaux, préférant d’autres résidences comme le Palazzina di Caccia di Stupinigi (le Palais de la Chasse de Stupinigi). De l’entrée du château, nous pouvons observer l’arrêt des travaux avec les bases qui attendent leurs colonnes, restées dans la vallée de Suse.
À gauche : Entrée du Château de Rivoli vers la collection permanente ©LS.
À droite : Rampe FIAT menant à la piste 500 sur le toit du Lingotto, Pinacothèque Agnelli ©LS.
Mutations architecturales et modernisation
Dès le XXe siècle, la Pinacothèque Agnelli et le Château de Rivoli voient leur architecture se métamorphoser dans le cadre de l’avènement des deux institutions culturelles.
Véritable symbole de l’architecture industrielle, le Lingotto fut construit de 1916 à 1923 par l’architecte Giacomo Mattè Trucco qui s’inspira de l’usine Ford de Highland Park. Mesurant plus de 150 000m2 et 500 mètres de longueur, le Lingotto est l’une des premières constructions entièrement conçues en béton armé à Turin. Ce centre industriel majeur en Italie ferme ses portes en 1982. Le site devient le reflet du déclassement des zones industrielles. Un an après, l’architecte Renzo Piano remporte le contrat de réaménagement de l’usine. Le projet architectural défend le recyclage industriel et la revalorisation du lieu comme un morceau de ville dans la ville. Ainsi dialoguent sur cinq étages, bureaux, logements, hôtels, commerces, restaurants, centre des congrès, héliport, auditorium Giovanni Agnelli, et la Pinacothèque Agnelli inaugurée en 2002. L’architecture intérieure originelle ne trahit pas la mémoire du lieu. Le centre commercial accueille ses visiteurs par la chaîne de montage en spirale qui dessert chaque étage jusqu’à la toiture du bâtiment : la Pista 500. Véritable emblème du site et prouesse architecturale, les 1,5 kilomètre de la Pista 500 deviendront iconiques, et figureront dans le film The Italian Job de Peter Collinson en 1969. Sous la demande de Giovanni Agnelli, Renzo Piano complète cet espace par la Bolla, un ovni entièrement constitué de verre qui a pour fonction d’être une salle de réunion panoramique pouvant accueillir une vingtaine de personnes. Le réaménagement du site fut également l’objet d’un questionnement environnemental.
Benedetto Camerana et Cristiana Ruspa du Giardino Segreto Studio conçoivent un jardin de 28 mètres de hauteur, inséré au cœur du Lingotto et composé de plus de 40 000 plantes et 300 espèces et variétés choisies selon un critère écologique : utiliser uniquement des plantes du Piémont et des zones limitrophes.
« La Pista 500 est le plus grand jardin sur toit d’Europe, et la décision de la
construire sur le toit d’une usine du début du XXe siècle a pour nous une valeur
hautement symbolique : un lieu qui, il y a cent ans, était une source de pollution par
excellence, et une piste qui était alors secrète et inaccessible, et qui devient
aujourd’hui un jardin ouvert à tous les habitants de Turin. Tout cela souligne le fait
que notre objectif n’est pas seulement de promouvoir les voitures : notre nouvelle
voie inclut également le respect du climat, de la communauté et de la culture. »
Olivier François, PDG de FIAT et CMO de Stellantis, Stellantis.
À gauche : La Bolla, Pinacothèque Agnelli, Lingotto, Turin ©SB.
À droite : Le Scrigno, Pinacothèque Agnelli, Lingotto, Turin ©LS.
Au XXe siècle, après que le Château de Rivoli ait été endommagé par l’armée et que le mobilier ait été vendu durant la période napoléonienne, la Région Piémont décide de prendre le château en prêt à usage pendant 29 ans et de le restaurer sous l’égide de l’architecte turinois Andrea Bruno à l’occasion du centenaire de l’Unité d’Italie en 1961. Le budget étant trop moindre pour l’ampleur des travaux, le bâtiment ne put se satisfaire que de réparations structurelles avant que les murs, les plafonds, les fresques et stucs ne soient de nouveau infiltrés par l’eau quelques années après, provoquant des effondrements. Face à cette urgence patrimoniale, la Région du Piémont s’engagea dans des campagnes de travaux en vue de créer un établissement recevant du public et d'accueillir un musée d’art contemporain, inauguré en 1984. À la structure du bâtiment, conservée pour les parties n’ayant pas souffert des dommages précédents, s’ajoutèrent des structures modernes en acier et en verre. L’escalier de métal à l’intérieur du bâtiment dédié aux expositions temporaires, l’ascenseur entièrement constitué de verre laissant le visiteur entouré du paysage environnant, et le plongeoir panoramique en verre au troisième étage du bâtiment abritant l’exposition permanente - donnant alors la possibilité au visiteur de se retrouver seul face à l’intensité de ce bâtiment et des paysages du Piémont qui l’entourent - sont désormais devenus des éléments incontournables de l’architecture du château. Néanmoins, d’autres problématiques se posent quant à la restructuration du site de Rivoli, rappelons-le, situé sur une colline dans les hauteurs de la ville de Rivoli. De 2007 à 2010, la refonte du flanc de la colline sud-est est confiée aux architectes autrichiens Hubmann Vass afin d’estomper cet effet de frontière et de créer un lien plus fort entre la ville et le Château de Rivoli. L’ascension, alors simplifiée par des escaliers et des escalators, prend la forme d’une route linéaire, où, à chaque pallier, le flâneur rencontre une nouvelle perspective de Rivoli et de son château.
À gauche : Escalier métallique, intérieur de la Manica Lunga, Château de Rivoli ©LS.
À droite : Extérieur de la Manica Lunga, Château de Rivoli ©LS.
Une nouvelle vie à travers l’art contemporain
Le marquis Panza di Biumo, important collectionneur d’art contemporain, vient en aide à Rivoli en quête d’un lieu où installer une partie de sa collection. C’est en 1984 que le musée d’art contemporain est inauguré dans le château qui devient un complexe à vocation publique et culturelle, ayant même l’honneur d’être le premier musée d’art contemporain d’Italie ! Le musée s’articule sur trois étages d’exposition dans le château : deux étages comprenant la collection permanente axée sur l’Arte Povera (Art Pauvre), la Trans-avant-garde, le Minimalisme, le Body Art (art corporel) et Land Art (utilisation des matériaux de la nature), et le troisième étage réservé aux expositions temporaires. Le troisième étage de la Manica Lunga est également un espace d’exposition temporaire.
Au Château de Rivoli, l’art contemporain est insufflé par des artistes venus spécialement à Rivoli pour produire des œuvres in situ au sein des pièces du château et de la Manica Lunga, mais s’inscrit également dans leurs thématiques et programmations d’expositions temporaires. Depuis son ouverture, le château a mis en avant de nombreux artistes italiens (Giovanni Anselmo, Lucio Fontana, Luciano Fabro, Mario Merz, Giuseppe Penone...), et des artistes internationaux comme Richard Long, Christian Boltanski, Karel Appel, ou encore Otobong Nkanga. Si nous nous concentrons sur les artistes italiens, nous remarquons que ces derniers appartiennent pour la plupart au mouvement de l’Arte Povera. Cette thématique se révèle être récurrente au sein du site depuis son ouverture dans les années 1980. La dernière en date est celle intitulée Mutual Aid – Art in collaboration with nature (31.10.24-23.03.25) portée par Marianna Vecellio et Francesco Manacorda et traitant de l’interdépendance entre les humains et la nature, des années 1960 à nos jours. Cette exposition présente des œuvres engagées portées par des artistes de l’Arte Povera et des artistes influencés par la réflexion critique et artistique de ce mouvement des années 1960 à Rome et Turin. Ce mouvement s’accorde au cadre naturel du Château de Rivoli, situé sur les hauteurs de la ville avec vue directe sur les Alpes. L’identité du musée se dessine alors grâce aux réflexions critiques artistiques actuelles (écologiques, numériques, technologiques, géopolitiques)défendues au sein de ses parcours temporaires et permanents.
La collection de la Pinacothèque Agnelli est également constituée par un collectionneur d’art : Giovanni Agnelli, une personnalité italienne importante, à la fois copropriétaire et dirigeant du groupe FIAT. Il a constitué au fil des décennies un ensemble prestigieux de peintures et de sculptures, avec son épouse Marella Caracciolo. À l’origine destinée à revêtir les murs de leurs résidences privées, la collection Agnelli porte l’empreinte d’une sélection personnelle et intime rassemblant des chefs d'œuvre de l’art européen, parmi celles de Canaletto ou Canova, reflétant son goût pour les grands maîtres de l’histoire de l’art, mais également Matisse, La Baigneuse blonde de Renoir, Picasso, etc. Giovanni Agnelli joue également un rôle central dans la promotion de l’art en occupant des postes dans les conseils d'administration d’institutions renommées parmi le Palazzo Grassi, le Louvre et le Moma. En 2002, Giovanni Agnelli lègue à la ville de Turin une collection de 25 tableaux en l’installant au cœur du Lingotto, dans les salles permanentes de la Pinacothèque Agnelli.
Entre conservation et innovation : une expérience muséale singulière avec de nouvelles formes de réactivation des lieux par les artistes
Ancien site industriel, la Pinacothèque Agnelli est réactivée grâce à des sculptures et des installations sonores présentes sur la Pista 500 qui sont le résultat de commandes de la Pinacothèque passées auprès d’artistes. A titre d’exemple, l’institution fait appel en 2023 à Alicja Kwade pour réaliser Against the Run, une sculpture s’intégrant à merveille entre les parterres de fleurs de la Pista 500 car gardant un lien entre passé et présent. L’horloge, d’apparence ordinaire à première vue, a ses aiguilles qui semblent se déplacer vers l’arrière alors qu’en vérité, c’est le cadran de l’horloge qui bouge, tandis que les aiguilles continuent de marquer l’heure exacte. Cette horloge en aluminium se connecte à l’histoire de l’usine Lingotto car le design s’inspire du modèle À gauche : Against the Run, Alicja Kwade, 2023, Pinacothèque Agnelli, Lingotto, Turin ©SB.
À droite : Horloge présentée dans l’exposition Casa FIAT ©Pinacothèque Agnelli.d’horloge utilisé historiquement dans les usines FIAT. Cette évocation du rôle central que jouait la mesure du temps dans l’usine en tant qu’indicateur principal de la productivité des travailleurs fait aussi référence au « coup des aiguilles de l’horloge ». En 1920, en opposition à la mise en œuvre de l’heure d’été, les ouvriers FIAT Brevetti de Turin décident de reculer d’une heure toutes les horloges de l’usine.
À gauche : Against the Run, Alicja Kwade, 2023, Pinacothèque Agnelli, Lingotto, Turin ©SB.
À droite : Horloge présentée dans l’exposition Casa FIAT ©Pinacothèque Agnelli.
Les installations sonores dans l’espace extérieur sont exploitées aussi bien à la Pinacothèque Agnelli qu’au Château de Rivoli. A la Pinacothèque, l’œuvre sonore Temps mort (Échauffement de Melody) (2022) de Cally Spooner est conçue avec et pour les espaces de l’ancienne usine FIAT. Cette partition pour violoncelle résonne dans les cinq étages de la rampe que les ouvriers utilisaient pour amener les voitures des chaînes de montage à la piste d’essai sur le toit du Lingotto. La mélodie, Suite pour violoncelle n°1 en sol de Bach (Prologue), est rythmée par un « bip » intermittent, un écho à un des bruits présents dans les usines. Ce travail sur les formes de contrôle et de répartition du temps entre en résonance, comme chez Alicja Kwade, avec le travail à la chaîne et la difficulté à distinguer son temps libre de son temps productif. Le travail de Cally Spooner sur l’exploration de temporalités différentes - de la musique classique dans un lieu industriel, une rampe en béton armé froide et vide - donne à ce site une dimension mystérieuse. Un médiateur invite les visiteurs à poursuivre leur visite de la Pista 500 vers cette rampe qu’on ne voit pas au premier abord. En arrivant devant cette dernière, cet important rappel visuel nous remémore la rampe que nous avons vue en entrant dans le centre commercial ; elle s’impose à nous comme élément principal. Si les visiteurs ne sont pas au courant de l’existence de la Pista 500 ou ne sont tout simplement pas venus visiter la Pinacothèque, cet élément imposant en béton surprend. C’est pourquoi, en arrivant par le haut de cette rampe par le biais de la Pista 500, tout s’éclaire : cette rampe étrange vue du centre commercial qu’on n’ose explorer est en fin de compte réinterprétée quelques étages plus haut, de façon sonore, en donnant du sens à cet espace, et de ce fait, le fait revivre.
Les installations sonores sont présentes au Château du Rivoli à l’entrée des escaliers extérieurs menant au parcours permanent. Néanmoins, les musiques, The Internationale (1999) de Susan Philipsz et Senza Titolo (Untitled) (1995) de Max Nehaus, sont beaucoup moins évocatrices qu’à la Pinacothèque Agnelli. Les visiteurs ne comprennent pas le lien créé entre les musiques proposées, ce qu’ils entendent, et le lieu. De plus, les cartels ne sont pas d’une grande aide car, si nous ne connaissons pas les musiques proposées, même en lisant les explications données sur les œuvres sonores, nous ne savons pas quelle musique citée correspond à ce qu’on entend. Toutefois, ce site historique est tout aussi bien investi au sein des espaces permanents qu’à la Pinacothèque, en axant le travail des artistes sur des installations ou créations in situ. La salle dédiée à SolLeWitt soulève la question de l’enlèvement ou du renouvellement de l’œuvre qui est plus complexe, car l’artiste a peint une multitude de couleurs sur les quatre murs et le plafond. Comment renouveler le parcours permanent avec des œuvres créées in situ à-même les murs ? Faut-il changer les œuvres ne nécessitant qu’un transport d’une réserve d’œuvres aux salles ? Repenser totalement les espaces et repeindre les murs en blanc pour exposer de nouvelles œuvres ou faire appel à un nouvel artiste pour une création in situ ?
A l’occasion d’expositions temporaires, les commissaires d’exposition réalisent des commandes auprès d’artistes qui investissent le lieu et dont les œuvres sont ensuite
laissées au sein du parcours permanent. Ce fut le cas pour Roberto Cuoghi qui, à l’occasion d’une exposition monographique lui étant dédiée en 2008, a créé SS(IZ)m
dalla serie / from the series Pazuzu (2010) qui s’inscrit remarquablement dans la salle 12 du parcours permanent. Au premier abord, nous pourrions penser que cette œuvre trônant au milieu de la pièce est réalisée en marbre noir, tandis que cette dernière est conçue à l’aide d’un système digital qui a reproduit à l’identique la Statuette du démon Pazuzu, conservée au musée du Louvre à Paris. Cette créature apotropaïque à deux visages, divinité secondaire de Mésopotamie, dialogue avec les bustes de sculptures classiques de femmes et d’hommes du château. Cette association d’ancien - bustes en marbre et peintures murales du XVIIIe - et de contemporain, permet au Château de Rivoli d’avoir une identité forte quant à l’implication de l’art actuel au sein d’un passé historique troublé par les changements de règnes, pillages, et adaptations du lieu. La dualité entre palais d’agrément et œuvres contemporaines passe aussi par l’installation d’œuvres audiovisuelles. Les vidéos, les images et les sons nous immergent dans des dispositifs dénonçant le consumérisme et les conséquences environnementales et technologiques. Ces ambiances ambivalentes sont l’exemple-même de l’évolution du lieu : des plafonds peints avec des scènes allégoriques, aux écrans projetant des images de robots.
À gauche : Statuette du démon Pazuzu en bronze, surmontée d’un anneau de suspension, Assyrie, vers le VIIe siècle avant JC, Musée du Louvre ©Musée du Louvre.
À droite : SS(IZ)m dalla serie Pazuzu, Roberto Cuoghi, 2010, Château de Rivoli ©LS.
Comment ces lieux s’adressent-ils aux publics ?
Le Château de Rivoli adopte une médiation écrite particulièrement accessible aux publics les moins avertis. Dans son exposition permanente comme dans l’exposition
temporaire Mutual Aid. Arte in collaborazione con la natura, les cartels bilingues (italien et anglais) s’éloignent du langage souvent hermétique des lieux d’art contemporain. Ils décrivent de manière simple la démarche de l’artiste et le processus de création de l'œuvre lorsqu’il a lieu. Ce mode d’adresse favorise une meilleure appropriation de l’art contemporain, souvent perçu comme élitiste ou abstrait. À l’inverse, la médiation écrite à la Pinacothèque Agnelli adopte une approche plus traditionnelle, notamment dans le cadre de son exposition temporaire, Salvo.Arrivare in tempo. Ici, les cartels sont délaissés au profit des textes de salles, qui fournissent des clés de lecture générales plutôt qu’une approche œuvre par œuvre. Ce parti-pris pousse le visiteur à observer, contempler, des toiles de l’artiste Salvo, à s'imprégner de leur atmosphère colorée sans nécessairement chercher à en comprendre immédiatement le sens ou l’origine. Est-ce un parti-pris délibéré ? Contempler l’art, le ressentir, n’est-ce pas également lâcher prise sur la volonté de le comprendre, de le cerner ? Cette approche peut certes générer une certaine frustration chez les visiteurs.
Dans l’offre de médiation orale, les deux institutions présentent des différences notables. A la Pinacothèque Agnelli, les salles et les visites guidées semblent davantage être fréquentées par un public averti, touristes ou scolaires d’âge mûr, qui déambulent aux côtés des médiateurs de la Pinacothèque. Tandis que sont majoritairement des groupes scolaires élémentaires et secondaires qu’on retrouve au sein des expositions du Château de Rivoli. Cette fréquentation peut s’expliquer par la situation géographique du lieu emblématique, alors seul musée situé dans la commune de Rivoli, mais également par le choix des œuvres exposées. Des installations comme Tube de Trichoptère #1 réalisé par Hubert Duprat ou Le lâcher d’escargots de Michel Blazy, incongrues, loufoques, captivent les jeunes visiteurs en facilitant une appréhension de l’art contemporain. Pourtant, le parcours permanent du Château de Rivoli ne se prive pas d’exposer des œuvres plus déroutantes encore. Novecento de Maurizio Cattelan, son cheval naturalisé pendu à une corde au centre d’une salle illustre parfaitement le goût de choquer, la volonté de susciter un malaise. Cette œuvre aujourd’hui emblématique de la collection interroge sur son mode de présentation, difficile d’accès pour un jeune public et dépourvu de trigger warning. Bien que les deux institutions semblent accueillir le jeune public, une limite demeure, celle d’un parcours spécifiquement conçu pour les enfants ou familles en visite libre. Si certaines œuvres du Château de Rivoli favorisent naturellement leur compréhension dans les cartels écrits, aucun fil rouge spécifique n’est proposé.
Novecento, Maurizio Cattelan, 1997 cheval empaillé, élingues en cuir, corde, Château de Rivoli ©LS.
Conserver la mémoire, conserver le patrimoine ?
Réaménager un site historique, c’est faire un choix, celui de conserver ou de transformer, celui de mettre en valeur le passé ou d’intégrer le contemporain, le château de Rivoli en est un exemple troublant. L’architecte Andrea Bruno, lui, adopte une approche qui interroge notre rapport au patrimoine : doit-on restaurer intégralement ou laisser visibles les marques du temps ? Comment réaménager un site sans altérer sa mémoire ? Dans la Manica Lunga, bâtiment abritant l’exposition temporaire, Andrea Bruno manie l’équilibre de la conservation du site et de sa restructuration en optant pour des structures en acier et en verre qui préservent la lisibilité extérieure du bâtiment et de ses formes archaïques. Certains espaces de l’exposition permanente sont restaurés, à l’image d’une salle située au premier étage, érigé par Filippo Juvarra, ou de l’appartement du duc d’Aoste. D’autres sont volontairement inachevés, les fresques alors presque effacées, les lacunes des stucs conservées en abandonnant l’idée d’une reconstitution fidèle de l’époque des Savoie. Ces choix font d’Andrea Bruno un pionnier de la réversibilité. Ces altérations fascinent, invitent à la nostalgie, à l’imagination d’une vie antérieure que le temps a tenté d’effacer de ces murs. Alors que ces vestiges semblent pourtant si évocateurs, le musée d’art contemporain les rend presque absents en renonçant à accompagner le visiteur dans un historique détaillé. Aucun cartel ni texte de salle n’évoque l’histoire du lieu à l’intérieur des parcours, là où la présence de l’art contemporain pourrait prendre le dessus sur l’identité plurielle du château.
The Salt Traders (I commercianti di sale), Anna Boghiguian, 2015, Château de Rivoli ©LS.
À l’inverse, la Pinacothèque Agnelli adopte un parti-pris distinct dans la valorisation de l’histoire du Lingotto. Si le bâtiment a été transformé, l’histoire industrielle du lieu
reste omniprésente. Au carrefour de la boutique, la bibliothèque, la cafétéria et des accès aux expositions temporaire et permanente, l’exposition Casa FIAT, imaginée en collaboration avec l’entreprise, retrace l’évolution de FIAT depuis sa création en 1899 jusqu'à aujourd’hui. Photographies d’archives, structures de modèles FIAT, affiches de réclame, maquettes et objets iconiques témoignent de la continuité entre l’histoire du site et son usage actuel du lien étroit entre l’architecture futuriste du lieu et le design automobile. Aujourd’hui, FIAT et le Lingotto continuent de nouer des liens avec d’autres institutions voisines comme le Musée de l’Automobile, le Centre historique FIAT et le Heritage Club dans laquelle objets de collection et archives sont présentés.
Séléna Bouvard & Léa Sauvage
En savoir plus :
Pinacothèque Agnelli : https://www.pinacoteca-agnelli.it/en/
Château de Rivoli : https://www.castellodirivoli.org/en/
#Artcontemporain #Architecture #Patrimoine

Six lycéens (em)portés dans les collections
Des idées ? Un smartphone ? L'envie de passer du temps dans un musée ? Ce concours national est peut-être fait pour vous... Musées(em)portables fédère de nombreux participants dans les Hauts-de-France chaque année. Une démarche activement soutenue par le Master Expographie-Muséographie à l'Université d'Artois.
Juliette Gouesnard et Camille Roussel-Bulteel, étudiantes de ce Master 2, ont accompagné plusieurs jeunes dans leur découverte d'un musée. Ces lycéens ont ainsi pu mener leur projet jusqu'à la réalisation de leur film et leur participation au concours.
La série vidéo "Médiation au musée" témoigne de cette expérience :
- Deux lycéens et leur professeur au musée d'histoire naturelle de Lille
- Quatre lycéennes et un portable au musée de la Chartreuse de Douai
La prochaine édition de Musées (em)portables sera lancée le 1er juillet 2017 pour une remise des prix en janvier 2018 : infos et formulaire d'inscription.
Juliette Gouesnard (réalisation vidéo) Camille Roussel-Bulteel (réalisation vidéo)
Hélène Prigent (article)
En savoir plus :
- Prix 2017 Musées(em)portables : le 2ème prix ICOM remporté par les centres socio-culturels d'Avesnes-sur-Helpe et de Fourmies et le Master Expographie-Muséographie (MEM),
- Expériences et films réalisés par le MEM pour Musées(em)portables,
- Musée d'histoire naturelle de Lille,
- Musée de la Chartreuse de Douai.
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube
10 mai 2017
#concours
#smarphone
#création

Souvenirs du musée de la Ruhr
A quelques kilomètres d'Essen en Allemagne, le Ruhr Museum conserve l'histoire de cette région très marquée par l'industrie du charbon. Quelle expérience de visite de cet ancien site minier, au cœur du plus grand bassin minier d'Europe ?
Panorama depuis le toit du bâtiment. ©OH
Au loin, nous distinguons les bâtiments d’un rouge brique. La célèbre forme des mines de charbon se détache du paysage. Nous lisons sur la brique « Ruhr Museum ».
Arrivées au pied du bâtiment, la hauteur des murs nous surpassent. Pour entrer au musée, quelques dizaines de mètres plus haut, nous montons dans l’escalator. Au fil de la montée, le panorama se dévoile avec ses étendues de forêts.
Nous arrivons à un vaste étage. Le comptoir de l’accueil est au centre. Des panneaux en allemand sont suspendus pour indiquer des directions. Une fois le billet de visite en main, un plan du site nous permet de constater l'ampleur du site. Ancien centre minier, l'espace d'exposition permanente fait 4 500 mètres carrés. A cela, s'ajoute 1 000 mètres carrés d'espaces d'expositions temporaires. Un détour au vestiaire pour déposer nos effets personnels, le regard rieur de la surveillante des casiers à entendre notre accent français dans les « Hallo » qui retentissent gaiement.
La scénographie a été faite par HG Merz, un studio de Stuttgart. La visite commence par une cage d’escalier, indiquant que nous sommes à vingt-quatre mètres du sol. Nous lisons « Panorama », un mot facile à comprendre, transparent. La curiosité nous pousse à suivre ce panneau qui tapisse plusieurs espaces du lieu. Nous montons. 45 mètres. 54 mètres. 65 mètres. Nous voici en haut du bâtiment : le paysage reste marqué par l’industrie. En effet, la région de la Ruhr contient le plus grand bassin industriel d’Europe. Ce dernier commence au sud de l'Angleterre, descend jusqu'au nord de la France, celui de la Belgique et se termine en Allemagne. La présence de charbon a multiplié le nombre de sites industriels. De ce fait, la région regorge de sites classés au patrimoine de l’UNESCO, de musées retraçant l’histoire de la mine, transformations de sites industriels en « coulée verte », pôle de recherche et haute technologie. Le devenir de ces structures monumentales recèle bien des enjeux politiques.
Puis vient le moment de comprendre l’histoire de cette région, en redescendant étage par étage dans un voyage pensé comme la descente du charbon. Des escaliers aux teintes jaunes orangées nous rappellent le feu des mines. La collection est riche de 25 000 pièces géologiques, archéologiques et historiques. Certains objets ont plus de 120 ans. La collection de sciences naturelles et d'archéologie vient du monde entier, mais la grande majorité provient de la région de la Ruhr. Ces dix dernières années, la valorisation s’est concentrée sur l'histoire naturelle de la région, en particulier les environnements de travail et de vie à l'ère industrielle.
Escaliers du musée de la Ruhr. ©OH
Dix-huit mètres. Première salle. Le mot « Présent » se détache du reste de l'espace. Accueillies par des cimaises en forme de rubans Leds blancs, des photographies, des visages, des instants capturés sont maintenant exposés comme témoins d’une époque. Nous traversons cet espace qui met en scène l’histoire du lieu, non sans une once d'attachement à ces images, témoins de leur temps. Un contraste intéressant joue avec notre perception de la salle : le blanc éclatant des cimaises irradie dans la pénombre de la pièce dont la structure est restée intacte.
Des colonnes blanches ponctuent la salle au fond de l’étage. Leur blanc perce la pénombre pour mettre en lumière un objet dans chaque colonne. À la fois mémoire collective et signe du temps, les éléments racontent, chacun à leur façon, un usage, un savoir-faire. Nous déambulons entre les colonnes sans en voir la fin. Des objets du quotidien, des éléments plus atypiques, des matières... Tous utilisés dans le passé. A la sortie de cette salle, le fil coupé d'un ascenseur rappelle la fin de l'industrie du charbon. Nous prenons conscience de l'importance d'illustrer les mémoires, les souvenirs encore présents.

Espace d'exposition du premier étage. ©OH
La visite continue. Nous descendons. Douze mètres. Étage sur la mémoire. Un sens large est donné à ce mot. Cela nous surprend : la mémoire est si souvent rattachée aux rapports sociaux et non aux éléments biologiques. L'espace d'exposition comprend des fossiles, des statues, des strates de la couche terrestre, des animaux empaillés, des paysages d'une autre époque... Nous voyageons des premiers vestiges de vie aux espèces contemporaines. L'exposition prend vie dans le bâtiment très peu modifié après la fermeture de l'industrie. La scénographie garde les pleins et les vides de l'espace : des fossiles au fond d'un silo, des statues dans le recoin d'une voûte... L'éclairage est tamisé, l'ambiance intimiste. Nous nous sentons liés à ces objets, curieux de comprendre leur présence ici. Les cartels sont épurés, les textes de salles sont disponibles sur une application développée par le musée. Nous permettant de comprendre la visite en français, ce logiciel décompose le musée en différents secteurs, en dehors des pôles pré-définis. Un texte, lu par une voix numérique ou par soi-même, donne les clés de compréhension de chaque espace.
Nous poursuivons. Un étage plus bas. Six mètres. Nous lisons « Histoire ». Un mot valise qui nous questionne. Toute cette visite n'était-elle pas là pour faire vivre l'histoire du site ? Située dans une ancienne pièce de triage du charbon, cette partie de l'exposition est traitée tout en longitude pour représenter une perspective temporelle. L'espace est décomposé comme le récit d'un roman, nous en ressentons des chapitres. 5 chapitres pour présenter l'histoire de la Ruhr. Le prologue débute à la formation du charbon il y a plus de 300 millions d'années. Puis, l'histoire continue avec une allée au centre de la pièce. Incitant le visiteur à s'allonger, des images projetées au plafond évoquent les débuts de l'industrialisation, l'essor de l'industrie du charbon et de l'acier puis vient l'industrialisation de masse. Sur un autre dispositif, sont illustrés les ravages de la guerre, la reconstruction et l'évolution structurelle, encore questionnée aujourd'hui. Le reste de l'exposition est en dehors de notre champ de vision, pour un voyage hors les murs. Parallèlement, nous découvrons sur la lignée voisine les aspects politiques, économiques, sociaux de l'industrie de la mine aux différentes époques : le monde du travail, le mouvement ouvrier, l'immigration, l'évolution de la population et leur mode de vie. Enfin, nous observons les conditions naturelles et conséquences de cette industrie : les matières premières, la destruction de l'environnement et les programmes de renaturation. Une ouverture laissant place aux questionnements qui découlent de la place de l'industrie de nos jours. Le musée semble très conscient des enjeux environnementaux, sociaux, durables... Entre souvenirs et avenirs.
Olympe HOELTZEL
Pour en savoir plus :
#expositions #Allemagne #histoire

Sporfoto, visite sportive
Visiter une expo en petites foulées et observer des photos en pas chassés c'est le principe des visites sportives de « Sporfoto ». À vos marques... Prêts ? Partez !
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube
Coralie Dunou
#sport
#photos
#Tripostal

Sziget Festival
Le Musée National de l'Histoire de l'Immigration participe depuis quatre ans au Sziget Festival en Hongrie. Plus gros festival de musique européen il rassemble pas moins de 500 000 personnes pour 103 pays représentés. Mais quel est le rôle du musée sur ce festival ? En quoi être présent sur un festival peut répondre aux missions muséales ?
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.
Mathilde Pavaut
#médiationsinguilière
#horslesmurs
#festival

Terre d'Estuaire : une rencontre avec la Loire
Partons à la découverte de l'estuaire de la Loire. Idéalement situé entre Nantes et Saint-Nazaire, le centre de découverte Terre d'Estuaire nous fait embarquer pour un voyage le long du fleuve, entre Terre et Mer.
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.
Julia Parisel

The museum of everyday life
Ce qui est un déchet pour quelqu'un, est peut- être un trésor pour un autre. C'est avec cette philosophie en tête que Clare Dolan a créé le "Museum of Everyday day", le musée de la vie quotidienne dans la région du Vermont, à Glover aux Etats-Unis en 2011.
Infirmière, marionnettiste et philosophe, c'est avec ses idées et son activisme au sein de la compagnie de théâtre "Bread and Puppet" que Clare a développé au fur et à mesure des années la volonté de créer ce musée qui rend gloire aux objets de l'ombre, ceux que l'on oublie...
Image d'introduction : "Mirror, Mirror" 2016 © clare dolan
A quoi peut ressembler un musée non rempli d'objets rares, mais avec des objets de tous les jours ? A quoi peut ressembler un parcours de visite non traditionnel qui défie l'exposition des objets et leurs cartels ? Et comment peut -il être possible de créer une exposition avec des objets banals, étranges, de curiosités, amateurs, hors du cadre... Avec en esprit la participation de bénévoles, une collecte d'objets via des donateurs et chinés.

"Draw the Line and Make Your Point: the Pencil and the 21st Century" 2013 © Clare Dolan
Les visiteurs réguliers du musée sont plutôt des artistes, des habitants de Glover, des passants un peu curieux, des étudiants, des collectionneurs d'objets atypiques, qui donnent également de leur temps pour construire les expositions, le bâtiment et sa rénovation. Engagé, les bénévoles peuvent également devenir médiateurs de visite guidée et animateurs de performance artistique au musée, qui a pour objectif d'illuminer l'avant et l'arrière, l'essentiel, la relation entre les objets et les Hommes ?
A force de toujours rester au même endroit, dans notre train-train quotidien, on en oublie l'environnement qui nous entoure. A Glover, on reçoit et examine les objets à travers leurs vies, leur histoire singulière, et toutes leurs utilisations dans l'histoire Humaine. A chaque exposition, un objet est mis en avant. La première exposition, en 2011 avait pour thématique l'allumette. A partir d’une collection de boîtes d'allumettes était retracée l’histoire de cet objet : son invention, et son utilisation à travers les décennies. On pouvait également y découvrir des instruments de musique (violon et banjo) en allumettes, des théâtres miniatures en boîte d'allumettes, un bestiaire extérieur et géant d'allumettes à travers le monde, ainsi que d'autres curiosités traitant de la friction, de la cendre, du bois qui brûle, de l'étincelle, de la chaleur entre des personnes qui s'aiment...
En 2012, le thème était "L'incroyable histoire de l'épingle", collection provenant du monde entier en relation avec un essai philosophique de Christopher Morley en 1920, qui rend hommage à l'épingle à nourrice comme cadeau de l'humanité : elle a permis d'attacher deux bouts de tissus ensemble, et ainsi de tenir chaud, rassembler les individus autour du feu, créer des liens sentimentaux, de haine, de convivialité, construire des civilisations jusqu'à devenir le symbole de cultures alternatives, ou à contre-courant comme le mouvement Punk dans les 60/70.
Se sont enchainées une exposition sur le stylo en 2013, la brosse à dent en 2014, la poussière en 2015, le miroir en 2016, la cloche et le sifflet en 2017, la clef et les serrures en 2018, les ciseaux en 2019, et enfin le nœud et la corde depuis 2020,toujours présentée.
Une logique low-tech est également mise en avant : il y a très peu de numérique (seulement pour des éclairages, mises en ambiance). L'objet peut aussi servir à provoquer l'éveil, la réflexion et faire travailler son imaginaire. Chaque objet est un prétexte à évoquer une idée sous-jacente : l'exposition "Bells & Whistles", la cloche et le sifflet en 2017, avait en double lecture l'engagement de mettre les objets avec une seule utilisation en opposition au téléphone portable avec quoi tout est possible : prendre des photos, aller sur internet, téléphoner, jouer, lire, se repérer, écouter de la musique, se connecter aux réseaux sociaux, calculer, trouver un restaurant... Le minimalisme de la fonction d'un sifflet met en avant l'importance des origines, de la recherche de la source, du tangible, de l'accessible, de l'essentiel et de l'honnêteté qui ne va jamais trahir. Cela permet aussi d'aborder le son, le bruit, la révolte, cet objet permet de se faire entendre pour donner son opinion, en débattre, protester contre l'Injustice !
Malgré la longue histoire de la clef et les serrures, le pas de côté de l'exposition "Locks & Keys" en 2018 met en avant (en plus d'un historique de la création de la serrure : de 3 blocs de pierre aux portes blindées des banques) un sentiment essentiel dans l'histoire de l'Humanité : l'inévitable satisfaction de pouvoir se cacher et se protéger des autres. Cela est-il une preuve d'un échec à vivre tous en harmonie ? L'Humain n'est-t'il pas un animal social, avec un besoin maladif de partager, de serrer dans ses bras, et de s'ouvrir à l'autre ? Pouvons-nous encore faire autrement, ou est-il trop tard ?
Interrogée sur la difficulté d'exposer de tels objets, Clare réponde que justement, cela permet de mettre en lumière des sujets politiques aux Etats-Unis comme le rôle clef de la corde dans l'histoire du meurtre des Afro-Américains.
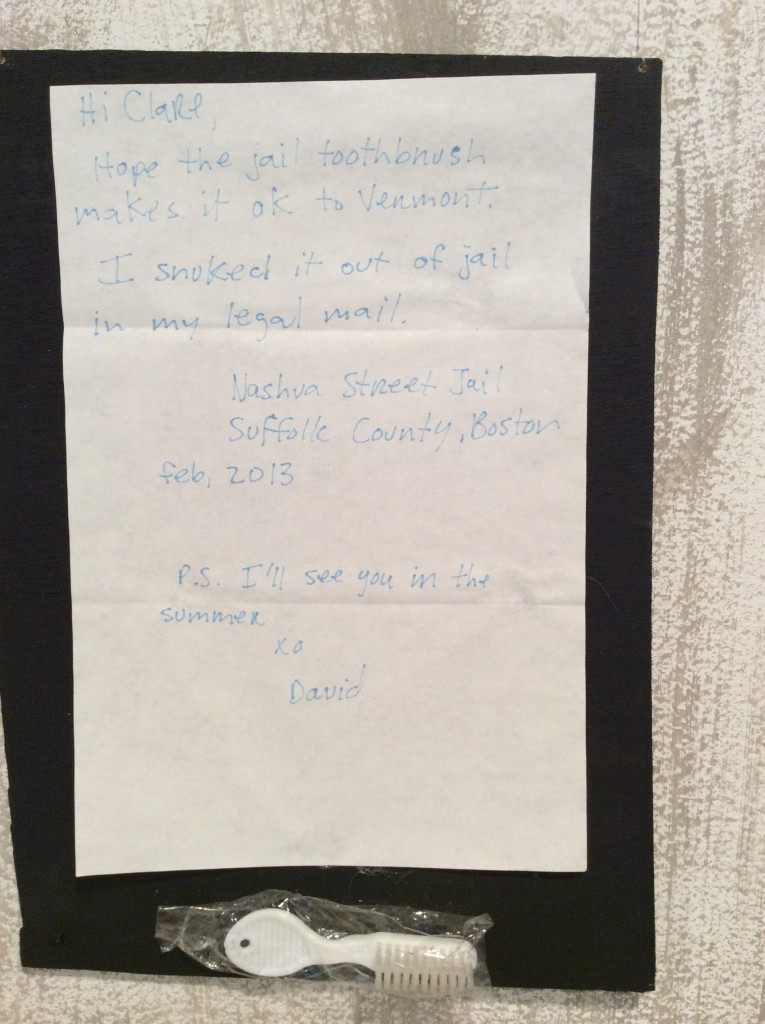
Lettre pour l'exposition "Toothbrush from Twig to Bristle In All Its Expedient Beauty" envoyé par un prisonnier avec sa brosse à dent à Clare, 2014 © Clare Dolan
Le parcours de visite :
"Allumer la lumière quand vous entrez, et n'oublier pas de l'éteindre à la sortie" ! Le musée se décompose en 3 séquences : la première, une salle d'écriture, de théorisation, et de publication philosophique à propos de la relation humain/objet, des méthodes de conservation et leur inventaire. La deuxième, une scène intérieure/extérieure pour accueillir les performances, spectacle de marionnettes, activités extérieures avec le public toujours en écho avec l'exposition en cours. La troisième (et la plus importante), le musée, qui rend tangible le travail théorique, la mise en place des pensées expérimentales de l'équipe muséographique du musée. "Fais ce que tu penses"... La visite peut être individuelle ou en groupe, seule ou guidée par ceux qui ont aidé à la conception l'exposition ou avec l'équipe présente au musée, tous prêts à vous transmettre leur passion pour l'inhabituel. L'équipe du musée met un point d'honneur sur une de ses missions principales, les workshops ! Elle souhaite, et le plus possible, intégrer ceux qui le souhaitent dans des ateliers et partager leur passion, leurs connaissances et laisser l'alchimie entre les participants prendre corps. Pour cela des résidences avec des artistes sont ponctuellement organisées, ainsi que des formations aux échasses, à la création de marionnettes en papier mâché, avec éventuellement des interventions de voisins de tous âges, et de collègues d'autres musées.
Nous sommes dans une société où on vénère l'exotique, l'autre, le rare et le précieux, autant que des célébrités... Cependant, n'est-il pas important de nous créer une place qui nous ressemble ? Nos histoires de vie sont toutes aussi singulières, et la connexion avec les objets qui nous accompagnent tout au long de notre existence mérite bien d'en faire un musée.
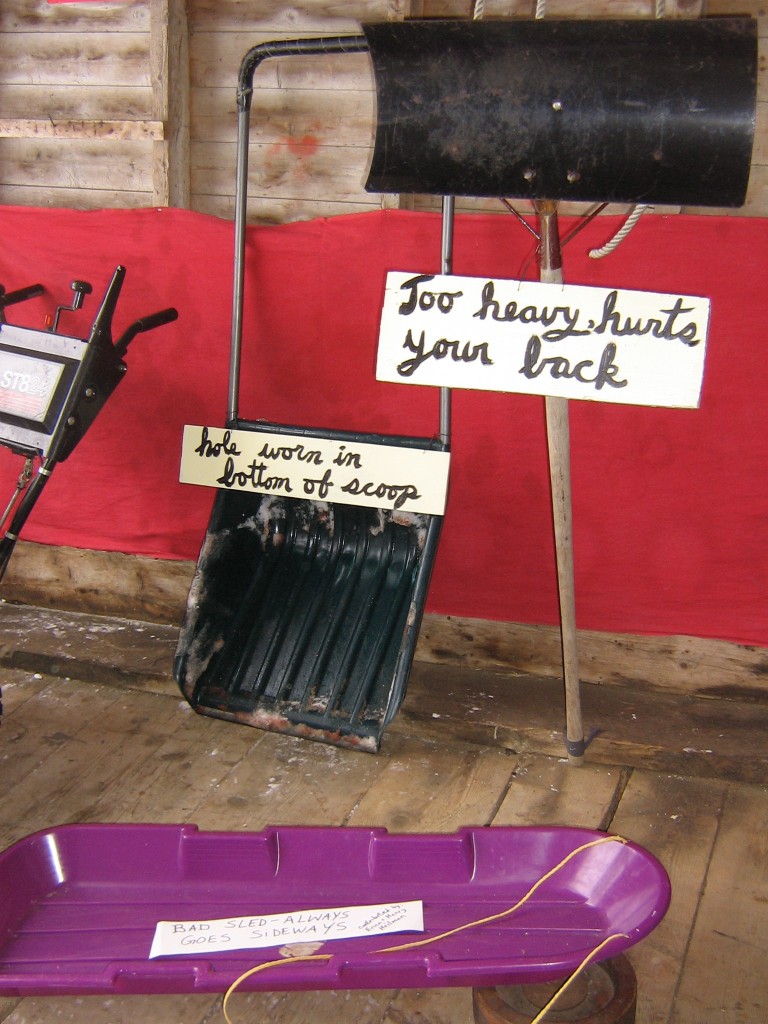
Cartel experimental © Clare Dolan
Pour aller plus loin :
- Site du musée : https://museumofeverydaylife.org/
- Constasoria/mediation "The Answers to Four Questions" https://www.youtube.com/watch?v=14xgE6AEQbk
- Hurricane Manifesto #1 : https://www.youtube.com/watch?v=bLfb0hi4Gk4&t=11s
- Constatoria/mediation "Hurricane Manifesto #1" à l'Ecosocialist Convergence de Northampton sur le changement climatique en 2012 : https://www.youtube.com/watch?v=bLfb0hi4Gk4&t=11s
#MediationSingulière #NosInclassables #PatrimoineSociété

To Go, l'exposition à emporter
Avez-vous déjà emporté toute une collection d’expositions avec vous ?
Afin de compléter votre expérience de séjour en Suède, le Musée Suédois du design, vous propose depuis mars 2020, de visiter le pays à l’aide de différents objets représentatifs du design suédois, tirés de l'exposition To Go, que l’on peut toucher, manipuler et surtout expérimenter. Impulsée par Visit Sweden, elle s’inscrit comme la première exposition mondiale à emporter.
Une expérience totale
Le musée veut casser les codes traditionnels des pratiques muséales en ne se satisfaisant pas seulement d’observer, mais également en permettant d’agir, afin d’offrir aux visiteurs une expérience complète vis à vis des objets exposés. Cette dernière permet ainsi de découvrir le travail de designers régionaux et la culture locale tout en voyageant dans le pays. Comme cela le musée démontre qu’une expérience muséale et immersive est aussi possible hors les murs.
Le principe est simple : après avoir réservé et récupéré votre sac à dos de marque Sandqvist dans un des quatre lieux d’intérêt disponibles, pouvant être un office de tourisme ou bien même un centre de design, vous pouvez partir à la découverte de la ville de votre choix à l’aide d’une collection d’objets représentatifs de l’industrie créative suédoise. Ces derniers ont été sélectionnés par différents commissaires du pays, tous spécialisés dans le design, à l’instar de Linnéa Therese Dimitriou, une artiste, créatrice freelance et directrice artistique de Sliperiet, le campus d’art d’Umeå.
Cette dimension expérimentale s’inscrit dans la nature du design suédois qui, d’après le musée, est fait pour être utilisé et ressenti, afin de percevoir tout son intérêt pratique et esthétique. Elle s’adresse davantage aux passionnés qui veulent s’approprier et mettre en pratique le design scandinave, tout en découvrant les richesses culturelles de la Suède sous différentes manières.
Une sélection d’objets en fonction de sa destination
Cette expérience est en réalité décomposée en une série de 4 expositions associées à de grandes villes, permettant de mettre en avant les quatre coins du pays suédois. On peut donc y retrouver l’est avec Stockholm, le nord avec Umeå, le sud avec Malmö et l’ouest avec Göteborg. Chaque exposition, imaginée par un ou plusieurs commissaires à la fois, détient son propre sac à dos avec ses propres objets permettant de découvrir les différentes facettes paysagères et architecturales, touristiques ou sociales de chacune des villes.

Collection d’objets à emporter de l’exposition To Go – est, source : © Johan Width, Swedish Design Museum
Sur le site internet, les expositions sont accompagnées de recommandations personnelles des commissaires, tel un itinéraire exhaustif à faire à pieds, en vélo ou en transports en commun, sur les endroits à visiter et choses à faire dans la région afin de profiter pleinement de l’expérience de design des objets proposés.
Par ailleurs, chaque histoire des collections et leur utilité est présentée sur le musée virtuel. Leur format et nature sont différents. Ainsi nous retrouvons l’art textile avec des serviettes ou bonnet, la céramique avec de la vaisselle, la bureautique avec des stylos et carnets mais aussi des appareils technologiques et innovants tel qu’un casque de vélo. Par conséquent vous pourrez écouter les meilleurs groupes de musique suédois avec le casque audio Jays, tout en vous baladant dans Göteborg.

Casque Jays qu’il est possible d’emporter avec soi pour la découverte de Göteborg dans le cadre de l’exposition To Go – ouest, source : © Johan Width, Swedish Design Museum
Une exposition innovante mais limitée
La médiation et l’essence de cette exposition et sa collection s’inscrit pleinement dans une dimension innovante et originale, permettant au visiteur de vivre une expérience peu commune par rapport aux expositions plus traditionnelles, et qui rappelle l’exposition “Take me (I’m yours)” située à la Monnaie de Paris en 2015. La participation et l’appropriation sont pleinement soulignées mais il peut être difficile de trouver le lien, autre que matériel, entre les objets et les destinations pour certaines personnes. En quoi l’objet conseillé, tel qu’une tasse, approfondit-il l’expérience de visite du pays ? Une connaissance et un appétit pour le domaine du design aide assurément à s’identifier et s’approprier les usages de ces objets. Par conséquent l’expérience de visite reste subjective et des bases en design sont nécessaires en amont pour profiter correctement de cette exposition.
De plus To Go retrouve aussi ses limites dans son accessibilité physique, car certes accessible pendant toute une semaine, la série de sac à dos est limitée et la demande très forte, ce qui amène vite à un épuisement de stock. De fait il est nécessaire de réserver au moins 3 mois en avance pour bénéficier de l’exposition. Toutefois la gratuité de prêt de la collection permet une accessibilité financièrement universelle.
Le parti-pris d’un musée purement virtuel
Le Swedish Design Museum est le premier musée virtuel sur le design suédois mais aussi le premier museum du design qui aborde à la fois les thèmes de l’architecture, du design et de la mode. C’est un musée uniquement virtuel ; il ne détient pas de collection physique, ni de lieu d’accueil dans le but de permettre au plus grand nombre d’accéder au design suédois.
L’innovation du Musée suédois du design se retrouve aussi dans ses expositions précédentes dans lesquelles il présentait des expériences de visites originales comme au travers de The home viewing exhibitions où le musée invitait les visiteurs à découvrir le design suédois, par le biais de véritables visites immobilières de propriétés privées, et qui sont aujourd’hui également accessibles depuis le site internet.
Tiffany Corrieri
#Design
#Suède
#Innovation
Image intro de l’article : Okra collection, exemple d’objets à emporter de l’exposition To Go – sud, source : © Johan Width, Swedish Design Museum

Un musée au plafond bleu
En pleine zone urbaine (ou non), au creux de nos campagnes ou proche de friches industrielles : les jardins éclosent et égrènent nos offres culturelles. Quels en sont les enjeux ?
image d'introduction : Museum Insel Hombroich ©Alexis
S’évader au grand air, fouler l’herbe de ses pieds nus, sortir de sa masure et se reconnecter à notre Nature : un rêve, une scène idéale pour beaucoup de citadins durant la succession de plusieurs confinements. Road trip, vagabondage, vivre l’ailleurs, reconnexion à la nature et expérience simple : la fréquentation des jardins ne fait qu’augmenter.
Rattachés à des musées, les jardins sont considérés comme un prolongement extérieur d’une exposition, comme une salle à part entière. Sont alors pensés la muséographie et la scénographie de ces lieux. Cependant, ce rayonnement ne s’arrête pas à la structure muséale : potager, jardin naturel, jardin artificiel, jardin botanique, jardin pédagogique, jardin de contemplation, de plaisir, de promenade, collaboratif, associatif, de repos… Éphémère ou permanent : des lieux de tous les possibles, où les fantasmes d’un monde plus lent et vertueux s’expriment. Découvrons les ensemble.
Un feu créativement destructeur
Le Jardin Éphémère, Place Stanislas ©Claire Delon - Exposition “Le Feu Effleure !” ©Mélanie Terrière
“Nous ne sommes plus sur une crise, mais un changement de modèle climatique [...] personne ne peut le nier” annonce Isabelle Lucas, adjointe au Maire de Nancy, à l’ouverture du Jardin Éphémère à Nancy, édition 2022.
Chaque année d’octobre à novembre, le Jardin Éphémère place Stanislas est le rendez-vous automnal attendu par les Nancéien.nes. Lieu de promenade, de délectation, d’engagement, de surprises et d’expérimentation : c’est un événement qui, depuis plusieurs années, aborde notre relation avec Dame Nature.
Depuis plusieurs éditions, une récurrence s’installe au choix de la thématique annuelle : la municipalité souhaite utiliser le Jardin tel une œuvre engagée et y aborder des thématiques brûlantes. “Terre ou désert ?", “Eau de vies”, “Place à l’arbre”... Cette année, “Le Feu effleure” est annoncé en lien avec le Congrès National des Sapeurs-Pompiers : un jardin hommage au travail effectué pendant les feux de cet été. Sont également proposés des visites guidées, des créations d'œuvre d’art contemporain, des ateliers et une exposition temporaire au milieu des buissons.
Tantôt engagé ou visuellement accrocheur, comment par le jardin et la nature, sensibiliser tous les publics, tout en valorisant un savoir faire local ? Un manifeste pour valoriser des connaissances nécessaires à une transition écologique évidente. 36 000 visiteurs y ont participé cette année.
Un Eden allemand

Museum Insel Hombroich ©Alexis - Museum Insel Hombroich ©Alexis
Une harmonie entre la nature et l’art, un parc idyllique de 20 hectares entre plénitude et zénitude : en tout cas, c’est comme ça qu’on nous le vend.
Autre exemple : le Museum Insel Hombroich est un lieu perdu au fond de la campagne allemande. Les visiteurs ne s’y bousculent pas même les jours de beau temps. Ils peuvent y savourer un temps de calme, de repos et de contemplation en pleine nature. Tantôt jardin, parfois musée : s’y chevauchent et s'entremêlent plusieurs bâtiments abritant des collections privées d’art contemporain et sentier en friche où poussent champignon et mousse. Cette œuvre humaine entre en résonance avec l'œuvre naturelle.
Passé l'accueil, un univers parallèle qui s’ouvre à nous : étangs, lacs, verdure luxuriante, sentier sinueux, fleurs, herbes folles et dansantes, plantes exotiques, prairies où le temps semble être arrêté. Dans ce jardin, c’est la nature qui prend ses droits, et l’humain qui l’accompagne et la contemple. Bien que tout soit aménagé artificiellement, ce n’est pas par la force et le contrôle qu’il est pensé : au contraire. Ce n’est pas un jardin à la française, mais plutôt du type anglais : on s’y pavane, s'arrête, s'étend dans l'herbe. Les visiteurs se laissent surprendre par des bâtiments entre deux bambous ou deux hortensias : on y vit son soi et sa curiosité. Il n’y a pas de parcours imposé. A chacun sa propre interprétation, place au lâcher prise.
Au détour d’un chemin, même si nous sommes dans un musée jardin, nous ne tombons pas nez à nez avec des cartels ou des textes de salles, mais directement avec des œuvres abritées ou en pleine nature. Ce n’est pas un lieu d’apprentissage pur : le public est amené à se demander comment l’objet est arrivé ici, d’où il vient, et comment s'intègre-t-il dans son nouvel environnement : il y mobilise son imaginaire, ses sens et se sent à l’aise. Au calme. Le bruit du vent est perceptible, le craquement des feuilles résonne, les buissons semblent se déplacer et les oiseaux s’époumonent. Une ode à la vie.
Le parc est construit sur un ancien site industriel aux allées géométriques et rangées. En 1994, le site est réaménagé : tout est pensé en courbe, asymétrique, le plus naturel possible où des œuvres en acier rouge corrodé rencontrent une nature au feuillage multicolore. Un pied de nez à cette époque industrielle dévastatrice. C’est radical.
Un simple carré de terre


Le jardin des simples et des saveurs oubliées ©La Ferme du Temps Jadis
La ferme du temps Jadis à Auby est un écrin de nature, une ferme et un musée d'anciens matériels agraires dans le Nord Pas-de-Calais. Sous l'appellation “écomusée”, ce lieu revendique son mode de fonctionnement bénévole, sous forme d’adhésion à leur association à but non lucratif, collectif, ludique et pédagogique. Une revendication assumée : la nécessité de transmettre un savoir-faire essentiel pour mieux appréhender les années à venir. Faire germer, faire une bouture, planter, transplanter, arroser, patienter… Y germent près de 150 variétés de plantes aromatiques, médicinales, tinctoriales dont l’origine ancienne intrigue et fascine.
“Ce jardin permettra de faire découvrir certaines plantes qu’on trouve à l’état naturel, qu’on peut considérer comme de la mauvaise herbe mais qu’on peut utiliser dans la cuisine, pour soigner des brûlures…” détaille le président de l’association et porteur du projet : Jean-Pierre Lesage. La transmission est le leitmotiv du projet : (ré)apprendre à utiliser ses mains, à produire sa propre alimentation et en comprendre le processus.
Ce n’est pas seulement la vue qui est mise à l’honneur : bien que les couleurs du site apaisent, le toucher et l’odorat sont également mobilisés. Un sentier à parcourir pieds nus afin de ressentir les différentes matières terrestres est proposé : terre, boue, écorce ou lin séché. Les bénévoles de l’association proposent d’y apprendre à créer son propre purin, de s’informer sur l’art du compostage et d’apprendre à cuisiner les légumes du potager de saison. Des chantiers participatifs gratuits sont annoncés, et mobilisent les habitants locaux à planter des arbres fruitiers et d’étendre les vergers déjà existants. Des nids d’oiseaux sont installés ainsi que des refuges pour les animaux. Ce maillage végétal et écologique est destiné à rétablir une faune et une flore qui étendent ses racines sur un paysage rongé par le travail minier.
Un avenir fait de plantes
C’est un constat général, la fréquentation des musées n’est pas similaire à ce qu’elle était avant la pandémie. Certains pourraient annoncer que les publics sont moins curieux : ne sont-ils pas juste ailleurs, en pleine nature, à la recherche d’un sens nouveau, plaisir et délectations ?
A l’heure où on pense chaque jour aux sales années à venir, où une transition écologique n’est peut-être plus suffisante, les Jardins (et ils sont nombreux!) offrent un havre de sérénité, d’espoir, de relaxation afin de mieux appréhender le futur à venir. Chérissons-les, et découvrons-en d'autres !
Museum Insel Hombroich ©Alexis
Alexis
Pour en savoir plus :
-
Japon, l’art du jardin zen - Arte
-
Série de documentaire (4 vidéos) - La vie sauvage d’un jardin - Arte
-
Série de documentaire (3 vidéos) - La nature, l’art et nous - Arte
-
Azur et Asmar - Le jardin de Jénane - Gabriel Yare
#jardin #transitionecologique #musée
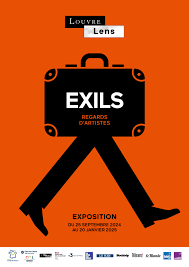
Un projet de conception partagée intégré à l’exposition EXILS-Regards d’artistes
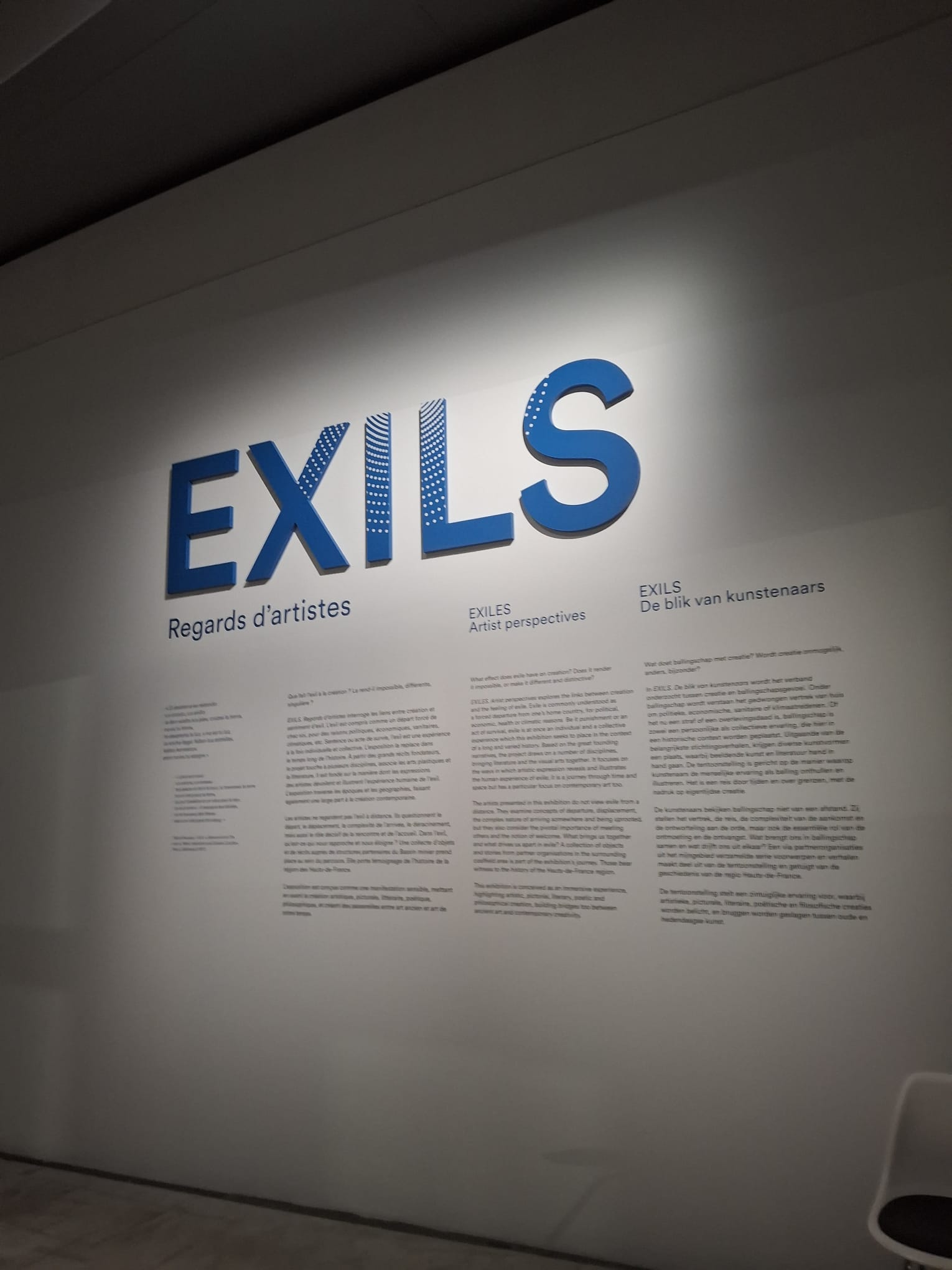
Musée du Louvre-Lens, ©Pauline Mabrut
En position centrale au musée du Louvre-Lens se trouve le public, présent dès la conception d’une exposition. Annabelle Ténèze, directrice du musée, et Dominique de Font-Réaulx, commissaire de l’exposition, ont pensé pour une section de l’exposition Exils, Regards d’artistes un projet participatif et inclusif, mené avec le concours de plusieurs structures partenaires.
Musée du Louvre-Lens, ©Pauline Mabrut
Six associations oeuvrant pour les populations du territoire ont travaillé sur le projet :
- l’APSA-CADA, Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (Liévin)
- l’association Femmes en avant (Liévin)
- le Centre socioculturel Alexandre Dumas (Lens)
- le Centre socioculturel François Vachala (Lens)
- l’association La Cimade (Lens)
- le SAVI, Service d’Accompagnement vers l’Intégration pour les mineurs immigrés (Béthune)
Avec eux, dix étudiants répartis en trois groupes de trois ou quatre, issus des divers parcours du Master 2 de l’École du Louvre.
Une exposition - porte d’entrée d’un dialogue entre art et territoire
L’exposition a trouvé terre d’asile à Lens, où elle a toute sa place. Le musée est ancré dans le bassin minier dont le développement a été rythmé par plusieurs vagues de migrations. De nombreux habitants du territoire, en quête d’un travail, ont vécu l’exil ou sont enfants ou petits-enfants d’immigrants. Aujourd’hui encore, le Pas-de-Calais vit au quotidien la présence et le passage de migrants qui tentent une traversée périlleuse vers le Royaume-Uni sur des canots de fortune.
Une partie de l’exposition a été construite en lien avec treize habitants du territoire lensois à qui fut proposé d’embarquer pour une aventure profondément humaine et à l’image de l’exposition. Port de départ : la présentation du projet par les associations aux potentiels témoins. Les structures partenaires ont retenu ceux dont le récit et les traces d’exils étaient les plus représentatifs et en phase avec l’exposition. Puis ont eu lieu les rencontres entre étudiants et habitants, suivies d’une longue traversée commune : une année riche d’écoute, d’échanges et de partages d’expériences.
Une collecte d’objets
Les habitants « témoins », présélectionnés par les associations, ont été invités à confier au musée le temps de l’exposition un ou des objets qui pour eux symbolise(nt) l’exil. Le Louvre Lens est Musée de France, mais sans collection permanente : pour l’exposition Exils, la notion de prêt, plutôt que de dons comme au Musée National de l’Histoire de l’Immigration, a tout de suite instauré la confiance et rassuré les témoins. Les habitants ont eu tendance à proposer de beaux objets (comme les assiettes de Marguerite de Hongrie) car l’espace du musée leur est d’emblée assimilé au prestige. Cette réaction questionne les codes du musée car elle s’oppose au principe d’Exils : ici ce sont des objets de sens et de mémoire familiale qui ont été prêtés. Ils sont des récepteurs et des traces de l'histoire d’exilés sur trois générations et sont traités au même titre que des œuvres d’art : leur état est étudié avant et après l’exposition et leur manipulation est délicate et professionnelle.
Précieux ou quotidiens, ces objets ont été emportés avec soi, rachetés en France ou encore offerts. Certains sont directement rattachés à Lens comme le collier de cheval (de la mine ou des maillots de football, ce qui permet aux habitants de la ville de s’y identifier. Ils rappellent aussi qu’au plus fort de son activité, le bassin minier rassemblait trente-deux nationalités.

Collier de Flageolet, cheval de fond de l’arrière-grand-père
Collier de cheval en bois, cuir et métal, Flandre-Occidentale, Belgique, 1850-1950
Musée du Louvre Lens © Pauline Mabrut
« Cet objet, je pense que je l’ai prêté pour que le regard des autres sur les personnes qui sont étrangères soit différent. Qu’ils se disent : “Après tout, cet objet, il est là, il a vécu presque toute sa vie dans nos mines, sur Lens, mais il représente autre chose.” […] Et les questions qu’ils vont se poser derrière : “Pourquoi est-il arrivé là ? Pourquoi il est comme ça ? Qu’est-ce qu’il peut nous raconter ? Et nous, dans notre propre histoire ?” Jocelyne D., Cimade, Lens
Un recueil de témoignages
Des paroles ont aussi été recueillies et Exils en mesure la charge émotionnelle. L’objet est pour certains prêteurs la cristallisation d’un récit qu’ils partagent.
L’escale suivante a été l’étude et l’analyse des échanges : les étudiants ont proposé les objets et les séquences audios collectés au commissariat de l’exposition. Ils ont décidé, ensemble, des objets qu’ils souhaitaient exposer (et qui pouvaient l’être). La sélection de 17 objets n’en a finalement laissé que peu de côté, il s’agissait surtout de choisir parmi plusieurs objets proposés par un même témoin.
La rédaction des commentaires, pour les cartels par exemple, a été faite par les étudiants et en lien avec les associations partenaires. Ils ont été validés après relecture par toutes les parties concernées.
« Le souvenir des calebasses, pour moi, c’est tous les jours en fait. Et encore ça me suit, parce que, malgré que je sois en France, elles sont avec moi. Pour moi, c’est un beau souvenir. C’est comme si j’étais toute avec ma famille ici et tout ce que j’avais fait toute petite. Mon souvenir, il me suit. C’est pas grand-chose, mais, pour nous, c’est grand-chose ». Mariam (Maya) D., Femmes en avant, Liévin
Assiettes de Marguerite
Hongrie, vers 1930-1940, céramique
© Musée du Louvre-Lens
« Le but, ce n’est pas de parler de l’assiette. L’assiette, c’est le moyen – c’est le médium, j’allais dire – d’arriver, d’accéder à la mémoire ». Famille Tillman-Farkas, Deboudt – Éric D., Lens-Salome
Une scénographie ouverte
La scénographie ouverte affiche une volonté de ne pas établir de différences entre chefs-d’œuvre historiques, œuvres d’artistes contemporains, et objets de la collecte. L’emplacement de cette dernière avait déjà été plus ou moins défini puisque la commissaire l’avait pensé dès le début du projet comme une partie intégrante de l’exposition. Le mobilier est bien intégré, c’est pourquoi les étudiants sont peu intervenus sur cet aspect même s’ils ont pu participer à plusieurs rendez-vous avec le scénographe Maciej Fiszer. Ils ont présenté la liste des objets retenus et des propositions scénographiques pour leur intégration dans le parcours de l’exposition. C’est un travail qui a permis d’opter pour des bornes d’écoute permettant de découvrir les témoignages audio, de décider des mises à distance, des mises sous vitrine, du choix de la couleur de la section, de la disposition des objets entre eux...
Deux étudiantes ont pris part à l’installation intégrale des œuvres au moment du montage de l’exposition. Pour l’installation plus précisément de la collecte, elles ont été rejointes par ceux qui avaient pu faire le déplacement. Tous ont travaillé ensemble aux côtés de la directrice du Louvre-Lens et de la commissaire de l’exposition.
Cette section de l’exposition montre, en se penchant sur les traces de l’exil, que c’est un vécu toujours actuel. Elle interroge la manière de vivre au quotidien une nouvelle vie, dans un autre territoire. Sa conception partagée rejoint le propos même de l’exposition. Exils, avec un « s », parle de tous les exils dans leur diversité et sous toutes leurs formes qu’ils soient contraints, volontaires ou imaginaires. Elle aborde les multiples motivations qui peuvent pousser à quitter une terre natale. Cette partie traite aussi de diversité, de rencontres, d’écoute et d’échanges. Les récits personnels, comme il en va de tous les exils, se rattachent à une histoire commune. Une dimension historique et universelle se dégage donc de cette section particulière pour rejoindre celle de l’ensemble de l’exposition.
Pauline Mabrut
Merci
Je remercie les étudiants qui ont pris part à ce projet d’avoir accepté de partager leur expérience.
Pour aller plus loin :
- Le Dossier de Presse de l’exposition
https://www.ecoledulouvre.fr/sites/default/files/media/document/Dossier%20de%20presse_Exils_FR_BD%20planche%20%281%29.pdf - Le Dossier Pédagogique
https://www.louvrelens.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dossier-pedagogique_Exils_2_page_BD.pdf - Une présentation vidéo,
par la commissaire de l'exposition, Dominique de Font-Réaulx
https://youtu.be/FLAN8vQ9Ex8?si=CptMQuaR00ZfETxc - Une présentation vidéo, par la directrice du Louvre-Lens, Annabelle Ténèze
https://www.bfmtv.com/grand-lille/replay-emissions/bonsoir-lille/exils-une-nouvelle-exposition-temporaire-au-louvre-lens_VN-202409240740.html
AUTRES EXPOSITIONS EN LIEN AVEC LA THÉMATIQUE
- Biennale de Lyon : Les voies des fleuves – Crossing the water
En cours, 21.09.2024 au 05.01.2025
La Biennale d'art contemporain de Lyon, manifestation créée en 1991, a un ancrage local, basé sur le dialogue et l'échange avec les populations.
« Avec La voix des fleuves - Crossing the water, les artistes sont invités à aller à la rencontre des populations et de savoirs-faire qui deviennent autant de sources d’inspiration, d’expérimentation que d’occasions de co-création » (Dossier de Presse)
https://fisheyeimmersive.com/evenement/biennale-de-lyon-les-voix-des-fleuves-crossing-the-water/ - Exposition installation Monte di Pietà
Terminée (du 29 juin au 21 juillet 2024)
Le Festival d'Avignon, fondé en 1947, est une manifestation du spectacle vivant contemporain.
"Fruit d’une collaboration entre Lorraine de Sagazan et Anouk Maugein,l'installation Monte di Pietà met à nu l’injustice, et la douleur qu’elle provoque. La metteuse en scène et la scénographe ont pour l’occasion collecté quelque deux-cents objets : ces objets sont liés au souvenir traumatique de violences ou de crimes, mais leurs propriétaires n’ont pourtant pu se résoudre à les jeter. Étiquetés et consignés, ces objets s’accumulent dans l’espace pour ériger un sanctuaire de chagrin." - Archives du Festival
https://festival-avignon.com/fr/edition-2024/programmation/monte-di-pieta-348720
#LouvreLens #Exils #Collecte
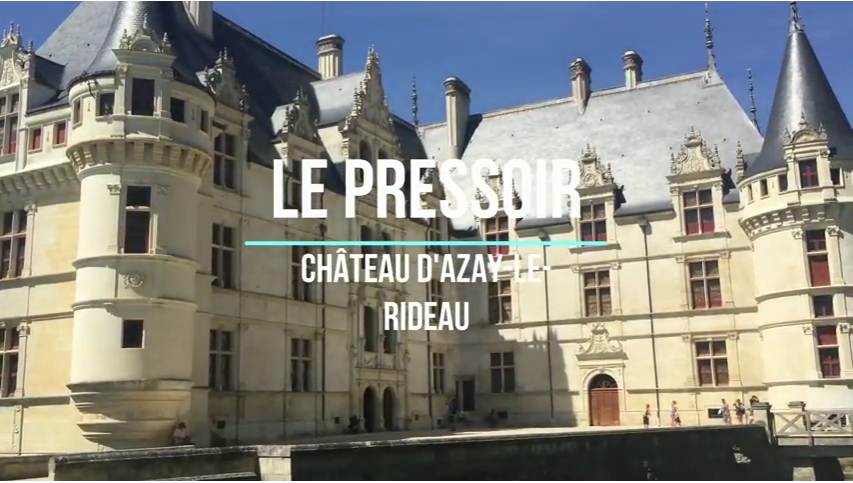
Une expérience de visite enrichie au château d'Azay-le-Rideau
Le château d’Azay-le-Rideau a bénéficié de janvier 2015 à juin 2017 d’un vaste programme de restauration entrepris par le Centre des monuments nationaux, et qui a notamment aboutit à une refonte totale du parcours de visite.
Installé dans l’ancien pressoir, l'espace d'interprétation offre une première immersion au cœur des collections du château d’Azay-le-Rideau. Animations numériques, matériauthèque, maquettes tactiles, table multimédia ou encore visuels monumentaux à la « caméra obscura » : tels sont les divers outils de médiation mis à disposition du visiteur et qui offrent une plongée immersive dans l’histoire de l’édifice.
Château d'Azay le Rideau : Le Pressoir
Pour aller plus loin :
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube"

Une heure au musée : les escape games muséaux
N’avez-vous jamais rêvé de découvrir les musées à la manière du film blockbuster « Une nuit au musée » ? De chercher des indices dans les collections des musées ? Ou encore de résoudre des énigmes pour éviter la destruction du site par un pharaon en colère ? C’est ce qui vous est proposé – l’évasion des collections en moins – dans plusieurs musées européens à travers les escape games au musée. Véritables outils de médiation ou gadgets détournant le public de la découverte des collections, c’est ce que nous allons découvrir ensemble.
C’est quoi un escape game ?
L’escape game est un nouveau concept de jeu qui fleurit partout en France et à l’étranger depuis environ 4 ans. Ces jeux d’évasion, issus des jeux vidéos « escape the room », se jouent en équipes réduites (entre 2 et 6 personnes en moyenne) et se déroulent sur une période d’une heure. Ils sont constitués d’une multitude d’énigmes à résoudre afin que les visiteurs puissent s’échapper de la pièce dans laquelle ils sont enfermés.
Quel lien entre les escape games et les musées ?
Face à l’ennui croissant de certains visiteurs au musée, les médiateurs culturels ont enclenché une ludification de leur programmation culturelle afin d’intéresser de nouveau les jeunes générations aux musées.
La ludification qu’est-ce que c’est ?
La ludification est une manière d’aborder la médiation culturelle en utilisant les éléments caractéristiques qui rendent le jeu attrayant, comme le challenge, la compétition, ou encore le dépassement de niveaux, le tout, dans un contexte autre que celui du jeu, dans la découverte d’un musée par exemple. La ludification permet (entre autres) de rendre le visiteur acteur de sa découverte.
Les médiateurs ne créent pas ces jeux parce qu’ils ont conservé leur âme d’enfant et que cela les amuse mais bien pour motiver les visiteurs et les impliquer. La ludification se distingue du jeu car elle utilise le jeu pour atteindre des objectifs pédagogiques autres que le fait de simplement jouer à un jeu, en théorie. Dans les faits cela est beaucoup plus complexe.
On s’amuse, mais qu’apprend-t-on vraiment ?
De nombreux musées et sites culturels mettent en place des escape games pour répondre à une mode des escape games, sans pour autant poursuivre des objectifs pédagogiques dans le jeu. C’est notamment le cas d’un site miner du sud de la France où l’escape game se déroule dans une galerie de mine. L’ambiance créée par les créateurs de l’escape game s’appuie sur des faits historiques réels de la mine. Mais à aucun moment le visiteur n’est invité à mobiliser des connaissances historiques afin de résoudre les énigmes. Bien sûr, toutes les structures culturelles organisant des escape games ne souhaitent pas en faire une introduction à la découverte de leurs collections. Certaines souhaitent simplement proposer un moment ludique à leurs visiteurs, il ne faut pas oublier ce cas de figure.
En dehors de ces cas particuliers, le souci principal de nombre d’escape games culturels est qu’ils ont tendance à agglomérer des jeux se voulant ludiques, sans véritable apport historique. Cela a pour effet de dissoudre l’ambition pédagogique de ces jeux, les transformant en simples jeux sans intérêt pédagogique particulier.
S’il est « bien » réalisé, alors les collections ou bien des éléments de leur histoire peuvent être directement incorporées à l’escape game. Elles deviennent alors des éléments clés à la résolution des énigmes. L’escape game « De faux airs de faussaire » du musée de Flandres à Cassel en est un bon exemple. Afin de résoudre les énigmes, les joueurs doivent consulter des dossiers d’œuvres du musée. Cette démarche permet de faire découvrir l’histoire du site et de ses collections aux jeunes générations et aide à dépoussiérer le musée qui est parfois vu comme un lieu ennuyeux pour le transformer en un lieu de jeu.

Escape game «De faux airs de faussaire » du Musée de Flandres (Cassel) © Par A. R.-M pour L’indicateur des Flandres
Parfois les escape games sont moins bien réalisés, le jeu accapare alors l’attention du visiteur et détourne son regard des œuvres. C’est le problème de beaucoup d’escape games muséaux où les visiteurs sont focalisés sur les énigmes et leurs réussites et non pas sur la découverte des œuvres. Les médiateurs qui créent des outils de médiation ludique doivent donc équilibrer cette ludification.
Ces escape games ne vont-ils pas transformer le musée en parc d’attraction ?
Plusieurs risques se font jour avec le développement de ces jeux. Le risque principal étant le fait de n’attirer finalement que des visiteurs uniques/des primo-visiteurs. Cela serait contraire au but premier de la création de ces outils, à savoir, élargir la typologie de public se rendant au musée. C’est pour cette raison que les musées ne doivent pas créer des escape games dans le but d’attirer un public pour une seule fois. La création de ce jeu ne doit pas être une fin en soi, mais une manière de véhiculer des informations sur l’histoire, afin d’éveiller un intérêt chez le visiteur. Nous ne sommes pas sûrs que les jeunes qui découvrent le musée pour la première fois à travers ce jeu y reviennent un jour.
Mais après tout, les visiteurs sont-ils obligés d’aller au musée pour apprendre quelque chose ? Ne peuvent-ils pas simplement se rendre au musée pour regarder des œuvres qu’ils trouvent belles sans vouloir nécessairement en apprendre plus ? Il existe beaucoup de raisons plus ou moins avouables de se rendre au musée, s’amuser en est une. Je ne l’évoque que peu, mais évidemment, nous pouvons simplement comprendre que les joueurs qui participent à ces escape games souhaitent juste s’amuser, et au fond, il n’y a aucun mal à cela.
L’escape game du Sisterna Museo de Fermo, un projet rondement mené
Certains musées en Europe parviennent à mettre au point des escape games qui mobilisent les visiteurs, sans les détourner de la découverte du lieu en question, tel le Sisterna Museo de Fermo en Italie (Musée des Citernes). Il tire profit de l’ambiance authentique dont il dispose déjà pour créer un escape game basé sur l’histoire et la culture. Pour ce faire, les solutions des énigmes mobilisaient des faits historiques ainsi que des légendes romaines, permettant ainsi aux visiteurs d’en apprendre plus sur l’époque romaine. L’objectif était atteint puisqu’il s’agissait du but principal de la création de cet escape game, c'est-à-dire amener les joueurs à mobiliser des connaissances historiques multiples pour résoudre les énigmes.

Escape game de Sisterna Museo (Fermo, Italie) © Musée Sisterna de Fermo
Les motivations qui ont conduit l’équipe du musée à créer cet escape game sont également bien définies, ce qui a probablement contribué à son succès. Ils souhaitaient accueillir des touristes sur leur site, et développer la fréquentation par un public plus jeune. Comme le dit Eliana Ameli (créatrice de l’escape game), « plus que jamais, les musées sont perçus par les jeunes générations comme étant ennuyeux », à travers cet escape game, l’équipe souhaitait démentir cette perception du musée.
Cet escape game est un modèle pédagogique autant que ludique, car il parvient à allier parfaitement le plaisir du jeu et l’apprentissage. D’autant que la plupart des personnes n’ayant jamais visité les citernes romaines leur ont fait un retour positif sur cet escape game, cette idée a également encouragé de nombreux visiteurs à venir découvrir le site.
Les escape games muséaux peuvent être une manière originale d’engager le public dans la découverte du site et de mettre un terme à une expérience de visite qui consiste à consommer passivement des expositions et des informations. Mais rien n’exclut la possibilité pour les visiteurs de simplement s’amuser en résolvant des énigmes dans un cadre exceptionnel. C’est pourquoi les escape games et « les jeux ne doivent pas être considérés comme des ennemis, mais comme des alliés pour transmettre de la culture ». Et voilà qu’est rafraîchie la façon que nous avons de découvrir les collections des musées, au croisement de l’apprentissage et de l’amusement.
Claire HAMMOUM—FAUCHEUX
#escapegame
#ludification
#mediationculturelle

Visite déguidée au Musée national de l'histoire de l'immigration
Vous en avez assez des visites guidées classiques durant lesquelles vous relâchez votre écoute au bout de la première demi-heure ? Préférez les visites déguidées de Bertrand Bossard : rire, découvertes et variation des postures des visites. C'est insolite et intelligent.
Aénora Le Belleguic
#visiteguidée
#théâtre
#médiation
Pour en savoir plus :
http://www.histoire-
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube
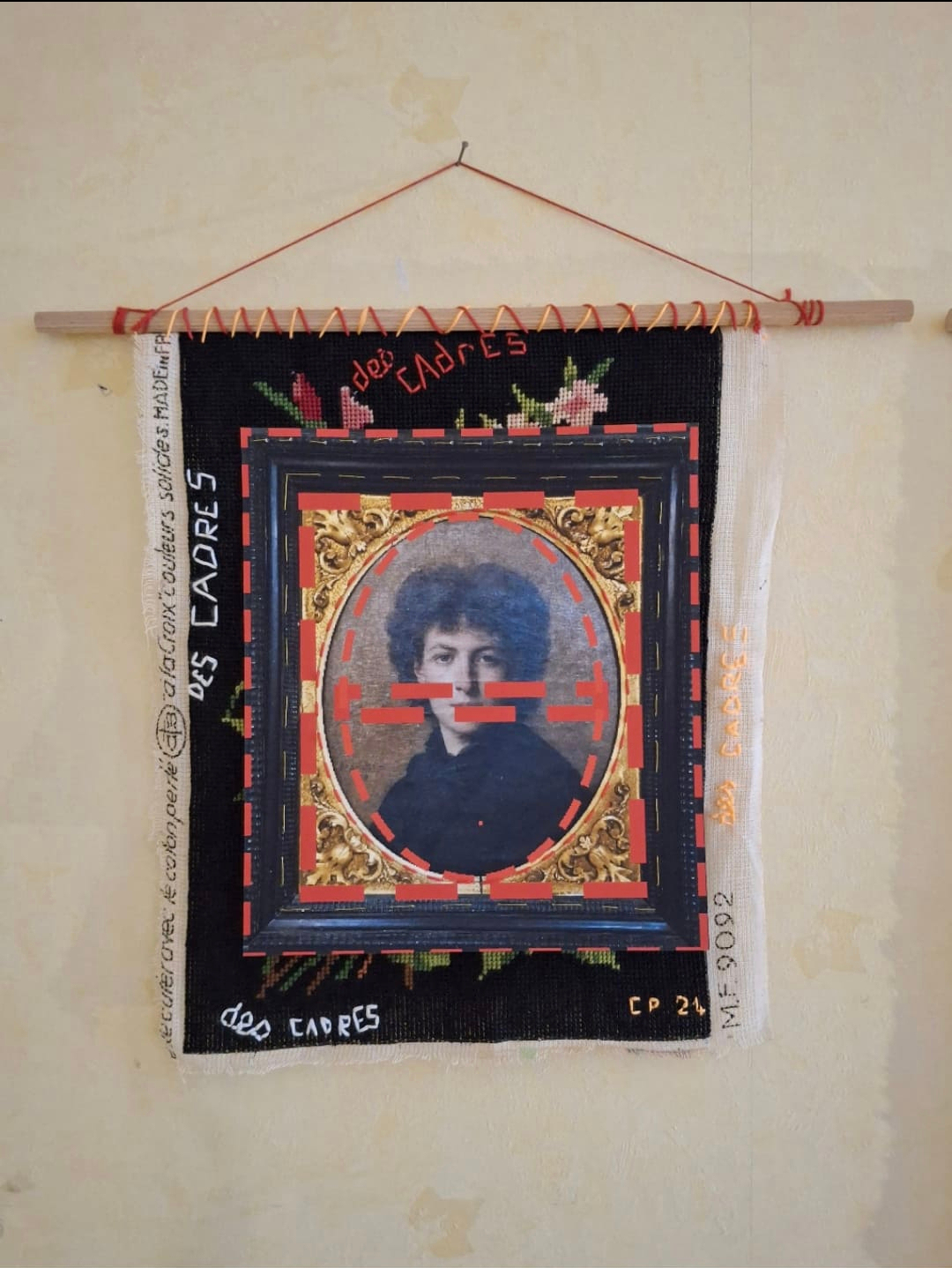
Visite et revisite : des expositions en écho, hommage à l'illustre enfant du pays
Bédarieux : une ville culturelle enracinée dans son histoire
Petite ville de 6 000 habitants nichée en Occitanie, Bédarieux intrigue par son calme et sa discrétion. Au loin, le viaduc reliait au XIXe siècle le bassin minier au réseau ferré vers la Méditerranée. La ville, en plein essor industriel, prospéra pourtant jusqu’au milieu du XXe grâce à l’industrie textile, les tanneries, les fours à chaux, la chimie et la construction mécanique.
«L’endroit n’a rien d’une destination touristique, encore moins d’un bassin d’emploi dynamique. Les rares passants rencontrés le reconnaissent volontiers : la vie a déserté la ville depuis bien longtemps » affirme le rédacteur en chef de Libération, le 21 avril 2021. Bédarieux apparaît même comme une ville de « taiseux » …
Loin des destinations touristiques ou des bassins d’emploi, elle n’en affiche pas moins une belle ambition. Comme rétorque son maire avec humour : « Il faudrait que vous vous penchiez sur les villes comme la nôtre... pour montrer celles et ceux qui se battent pour redresser ces coins de France trop longtemps délaissés, mais pleins d’avenir ! ».
A présent, Bédarieux s’épanouit à travers l’art : ce renouveau passe par une dynamique culturelle forte. Nouveau cinéma, salles de spectacles, médiathèque, festivals… la ville propose une diversité d’activités. La Maison des Arts, située dans l’ancien Hospice Royal Saint-Louis classé Monument Historique, regroupe depuis 2003 un Espace d’Art Contemporain reconnu pour ses expositions d’artistes locaux et internationaux.
Bédarieux est aussi marquée par l’émergence d’espaces de création privés comme « Le 31 ». L’artiste Nicolas Bexon, tombé amoureux de la ville, s’y est établi et s’investit pleinement. Avec une vie associative dynamique et des habitants engagés, Bédarieux prouve qu’elle sait allier discrétion et créativité pour se réinventer.
Le peintre du pays à l’honneur : exposition “Pierre Auguste Cot - La Collection”
Pierre Auguste Cot, né à Bédarieux, a toujours gardé un lien fort avec sa ville natale malgré son succès parisien. Propriétaire du Mas Tantajo, il y passait ses étés à peindre, entouré de sa famille, organisant des soirées conviviales avec ses amis comme Alphonse Daudet. Il offrait également des toiles et réalisait des portraits pour les habitants. Depuis 1947, un buste sur la place qui porte maintenant son nom rappelle l’attachement de la ville à cet artiste emblématique.
En 2024, l’exposition « Pierre Auguste Cot – La Collection » célèbre son œuvre et son héritage en exposant plusieurs de ses toiles. Le vernissage a réuni plus de 500 personnes, et de nombreux élèves et visiteurs ont ensuite découvert ses peintures, enrichies par des prêts d’institutions régionales comme le Musée Fabre de Montpellier. L’exposition est dynamisée par les élèves du Lycée des Métiers de Fernand Léger qui ont participé à la reconstitution d’un salon semblable à celui de Cot. La collecte de dons pour restaurer les œuvres de Cot a été organisée par la Fondation du Patrimoine, représentée par Jean Lavastre, délégué territorial de l’Hérault.
Pour le maire, cet événement permet aux habitants de redécouvrir un artiste qui incarne à la fois l’ouverture et l’ancrage de Bédarieux dans son patrimoine.
Les femmes à l’honneur
L’exposition met en lumière les représentations féminines dans l'œuvre de l'artiste.
La première salle présente six portraits de femmes, soulignant leur place importante dans son travail, qu’il s’agisse de proches ou de Bédariciennes. Le « Portrait de Madame Gervais » témoigne de la délicatesse avec laquelle Cot peignait ses modèles féminins, souvent issus de la bourgeoisie. Le buste de Madame Cot attire également l’attention dans la première salle.
Espace d’Art Contemporain (Bédarieux), © Pauline Mabrut
Ces œuvres témoignent de la formation rigoureuse que Cot a reçue auprès de ses maîtres, tels que Alexandre Cabanel.
Dans la seconde salle est exposée une peinture d’une prestance déroutante : “Mireille faisant l’aumône à la sortie de Saint-Trophime”, dans laquelle est représentée Mireille pleine de grâce et de grandeur, offrant quelques pièces à un mendiant dont le modèle était un jeune bédaricien.
Pierre-Auguste Cot revisité
L'exposition "Cot Revisité" se tient dans l’Atelier d’Art de Nicolas Bexon, où 25 artistes contemporains membres de l’association des 4CM (Créatrices et Créateurs du Caroux au canal du Midi) réinterprètent les œuvres de Pierre Auguste Cot.
Avec le soutien logistique de la mairie, cette exposition pose la question : que penserait Cot, l’artiste académique, des réinterprétations contemporaines de ses œuvres ? À l’époque, l’artiste répondait aux attentes ; aujourd’hui, il suscite réflexion et émotions.
L’exposition offre un parcours surprenant, où les artistes jouent avec humour et profondeur, toujours avec talent. Cette réinvention vivante de l’œuvre de Cot, après plus de 150 ans, réveille son héritage et invite les Bédariciens à découvrir ce grand artiste trop méconnu.
Parmi les œuvres, une jeune Ophélia, tablette tactile en main, observe silencieusement les visiteurs, tandis que sa robe (symbolisée par la robe de mariée de la mère de l’artiste) suspendue au mur ajoute un air mystérieux, nous faisant penser au travail de Sophie Calle.
Atelier d’Art Nicolas Bexon (Bédarieux), © Pauline Mabrut
Les artistes réinterprètent le célèbre "Printemps" avec des touches humoristiques ou provocatrices : des peintures retravaillées, des poupées Barbie mises en scène, une balançoire suspendue au-dessus d'un petit bassin…
Les femmes peintes par Cot sont au cœur de la question de l’émancipation féminine au fil des âges. L’artiste Catherine Philippe symbolise cette réappropriation par des éléments forts : un cintre portant un fœtus dénonçant les souffrances liées à l’avortement, et une autre œuvre, "La Prison Dorée", où une femme est prisonnière de barreaux d’or. “Mon travail créatif consiste à revisiter l’histoire de l’art avec un regard féministe, en utilisant des reproductions d’œuvres connues et reconnues sur lesquelles j’ajoute des éléments afin de rendre compte du vécu des femmes” explique l’artiste sur un cartel de l’exposition. Un hommage puissant à la lutte pour les droits et les libertés des femmes, brodé sur les œuvres.
Atelier d’Art Nicolas Bexon (Bédarieux), © Pauline Mabrut
L’« Orage » de Cot a été réinterprété, avec l’ajout de l'article 213 du Code civil de 1804 : « Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari ». Ainsi, la supposée Virginie devient l’otage de son compagnon, le toit du foyer se tissant peu à peu au-dessus de sa tête.
Atelier d’Art Nicolas Bexon (Bédarieux), © Pauline Mabrut
Revisiter une œuvre, c’est aussi revisiter l’Histoire de l’Art et réfléchir au rôle de l’artiste dans la société de son époque. De nombreux artistes participant à cette initiative ont évolué du figuratif vers l’abstraction ou le conceptuel, tout en abordant l’œuvre de Cot avec respect, et en l’ancrant dans les questions contemporaines mais déjà rencontrées dans le passé. Comme il l’est spécifié, l’art contemporain peut parfois déstabiliser, et certains visiteurs pourraient être surpris par ces interprétations modernes de l’artiste. Mais cette démarche est aussi une manière de s’approprier l’œuvre pour n’en retenir que l’essentiel, ce que chaque artiste a fait avec sa manière de percevoir les tableaux de Cot.
Un petit clin d'œil à David Beckham, qui, en arborant fièrement deux tableaux de Cot tatoués sur ses mollets, a permis à l’artiste bédaricien de conquérir des millions de fans de foot – et d’autres, probablement moins habitués des musées, mais tout aussi impressionnés par ses muscles !
Atelier d’Art Nicolas Bexon (Bédarieux), © Pauline Mabrut
La revitalisation des petites villes rurales est essentielle et à encourager. Bédarieux, avec Pierre Auguste Cot, dispose d’un héritage artistique précieux mais longtemps sous-exploité. Comme le souligne une commerçante qui a participé au jeu de piste “à la recherche des œuvres de Cot” en parallèle de l’exposition, pour beaucoup d’habitants, Cot n’était jusqu’à récemment que le nom de la place ou de l’arrêt de bus. Son œuvre restait largement méconnue car peu mise en avant par la ville. Pourtant, grâce à des expositions et des actions culturelles ambitieuses, Bédarieux exploite davantage ce patrimoine et l’affiche en tant que fierté. Ces initiatives permettent non seulement de reconnecter les habitants à leur histoire, mais aussi de dynamiser la ville, de s’ouvrir à la culture et d’attirer un nouveau public. Chaque commune, lorsqu’elle dispose d’un artiste local ou d’une richesse patrimoniale, peut saisir cette opportunité pour se dynamiser. L’art a ce pouvoir de transformer les territoires en leur redonnant vie et cohésion.
Pauline Mabrut
Pour aller plus loin :
Extrait du journal municipal de décembre 2024, Bédarieux :
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/Journal-Municipal/2024/12/Journal-municipal-Decembre-2024-Webpdf.pdf
Dossier de Presse de l’Exposition :
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/Presse/2024/11/Dossier-de-presse-Exposition-PA-COTpdf.pdf
A propos de Cot, Association Résurgences, Bédarieux :
https://resurgences.weebly.com/pierre-auguste-cot.html
Autres actions culturelles en lien avec la thématique :
Du 21 au 30 novembre : jeu de piste à la recherche des œuvres de Cot à travers les différents commerces de la ville, permettant de gagner des bons d’achat et des places de cinéma.
Le vendredi 27 décembre à 18h30 : Conférence "Pierre Auguste Cot, le bédaricien" par l'association Résurgences, à l'Espace d'Art Contemporain.
Le vendredi 3 janvier à 18h30 : Concert d'orgue par Marc Chiron, à l'église Saint-Louis (hommage et improvisations sur des tableaux de Cot, en écho à l’exposition Pierre Auguste-Cot - La Collection).
Le samedi 11 janvier à 18h30 : Conférence "La restauration du Prométhée Enchaîné" par Roos Campman, à l'Espace d'Art Contemporain.
Autres expositions en lien avec la thématique :
Barbara Chase-Riboud : Quand un nœud est dénoué, un dieu est libéré
“Jusqu'en janvier 2025, huit grands musées parisiens honorent l'artiste américaine Barbara Chase-Riboud. L'exposition présente une quarantaine d'œuvres de bronze et de soie, explorant des thèmes tels que l'histoire culturelle et la représentation des femmes.” - Ville de Paris
Louvre Couture, objets d’art, objets de mode
“Du 24 janvier au 21 juillet 2025, le Musée du Louvre à Paris propose une exposition explorant les liens entre les chefs-d’œuvre de ses collections et des pièces de mode créées par de grands noms du milieu. Cette mise en miroir souligne l'influence des arts sur la création textile, avec une attention particulière aux représentations féminines.” - Toute l’Europe
#PierreAugusteCot #CotRevisité #Bédarieux #Revisit

Wellcome Collection : La rencontre audacieuse entre la science et l’art, un musée qui éveille la curiosité
Imaginez un musée qui ambitionne d’explorer les liens entre la science, la médecine, la vie et l'art. Un musée qui vous invite à réfléchir sur les grandes questions qui touchent notre société, de la santé à l'humanité. Bienvenue à la Wellcome Collection, un musée unique en son genre situé à Londres.
Wellcome Collection, Londres
La curiosité est souvent l'élément moteur qui pousse les passionnés à découvrir de nouveaux horizons et à chercher des défis passionnants. C'est exactement ce qui a pu pousser une jeune muséographe, comme moi, à franchir les portes de ce musée lors d'un week-end dans la capitale anglaise. Sans attentes particulières ce musée à sur générer de la surprise et de l’inspiration. Au-delà de ses expositions sur des sujets variés, la Wellcome Collection est un espace de réflexion et de questionnement sur les grandes problématiques de notre époque.
L’histoire d’une collection aussi fascinante qu’éclectique
Le Wellcome Collection, fondé en 2007, est une institution culturelle gratuite qui se donne pour mission de défier la façon dont les gens pensent et ressentent la santé. Elle est inspirée par les collections assemblées par Henry Wellcome, un entrepreneur pharmaceutique et philanthrope du 19ème siècle. La collection comprend plus de 1,5 million d'objets qui témoignent de l'histoire de la médecine, de la santé et de la société, ainsi que de nombreux ouvrages rares et précieux en matière de médecine, de science et d'histoire.
Le musée propose des expositions temporaires sur des sujets variés, allant des pratiques de guérison traditionnelles aux dernières avancées scientifiques.
Une exposition permanente qui explore la notion d’humanité
La visite de la Wellcome Collection dirige dans un premier temps les visiteurs vers “Being Human", une exposition permanente qui cherche à explorer ce que signifie être humain au 21e siècle. Dans un espace peu vaste, des concepts complexes dialoguent à travers une variété de médias : vidéos, objets, créations artistiques, artefacts scientifiques, cartels et dispositifs ludiques, pour n'en nommer que quelques-uns.
Chaque section de l’exposition explore différentes facettes de notre pensée, de nos sentiments, de nos corps et de notre relation avec le monde en mettant toujours en avant l’importance de la diversité, qui porte le message que nous sommes tous uniques dans un monde commun. Ce qui rend cette exposition si captivante, c'est qu'elle ne se contente pas de montrer, elle interpelle. Les œuvres rassemblées sont comme des échantillons aux grandes questions que tout être humain peut se poser. L'exposition invite à prendre du recul, à remettre en question notre environnement, notre identité et les traces que nous laissons. Les éléments de collections exposés sont des œuvres engagées mélangeant art, design, science et bien d'autres.
Par exemple, une section est dédiée au changement climatique et à la crise écologique, mettant en question la capacité de l'humanité à passer à l'action. Les œuvres exposées dans cette section, comme la série de photo “Too” de Adam Chodzko, explorent la relation complexe entre l'être humain et le monde qui l'entoure, à une époque de profonds bouleversements. Certaines œuvres se concentrent sur les signes de ces changements, tandis que d'autres exposent des futurs potentiels, comme l'œuvre ‘Recipe for Potable Water” de Allie Wist qui présente un système de filtration d’eau fabriqué à partir d'objets du quotidien . Cette section suscite avant tout une question essentielle : sommes-nous prêts à nous adapter et à évoluer dans un monde en pleine transformation ?
Une installation remarquable, "Refugee Astronaut III" de Yinka Shonibare, met en scène un astronaute tenant précieusement quelques objets rassemblés à la hâte. Le titre suggère un exil forcé, un acte de désespoir plutôt qu'une exploration galactique confiante. Alors que la dégradation de l'environnement déplace de plus en plus de populations, cette œuvre interroge sur le nombre de personnes qui pourraient devenir des réfugiés.
"Refugee Astronaut III" de Yinka Shonibare, Wellcom Collection, Londres
Une autre section explore le corps et l'esprit, et cherche à offrir un regard différent sur le handicap et les différences. Une installation ludique intitulée "Oh my gosh, You're Wellcome... Kitten" réalisée par l'artiste The Vacuum Cleaner, est le fruit de six mois de collaboration avec quinze jeunes membres du personnel de l'unité Mildred Creak de l'hôpital Great Ormond Street. Ensemble, ils ont imaginé comment différentes expériences et environnements pourraient favoriser la santé mentale. Dans cette installation, les visiteurs sont invités à imaginer un lieu qui créerait une meilleure santé mentale pour tous. Les enfants participants ont proposé des réponses pleines d'imagination, telles que la présence d'un bébé rhinocéros dans chaque service de santé mentale pour enfants, des chambres avec des lacs, des montagnes et une bibliothèque de Poudlard, des infirmières aux grandes oreilles, et des seaux d'empathie.
Cette exposition offre un espace de réflexion où les préjugés sont remis en question, où l'on peut considérer les défis auxquels l'humanité est confrontée et envisager des solutions créatives. Elle illustre l'engagement du musée à explorer les multiples facettes de l'expérience humaine et à encourager des discussions approfondies dans un monde en constante évolution.
Exposition temporaire : Object in stereo
Cette exposition temporaire questionne le fonctionnement du musée, et ses collections, nous plongeant dans l’histoire des réserves du musée et de la conservation des collections pour mettre en évidence la façon dont ces espaces peuvent influencer la perception et la compréhension des trésors du passé.
L'exposition, intitulé “Objects in Stereo” se visite avec un habile dispositif permettant de voir les photographies stéréoscopiques de Jim Naughten en 3D. Elle se révèle être une véritable mise en abyme des collections du musée et de notre relation aux objets. Elle nous plonge au cœur des réserves et des problématiques de stockage, comme si en plein cœur d'une séance de psychanalyse, le musée partagerait lui aussi ses doutes et ses questions. Une grande table centrale présente une documentation accessible, recréant ainsi l'atmosphère d'un espace de recherche au sein d'une salle d'archives. Une véritable invitation à participer avec le musée, où chaque visiteur se sent convié à une expérience de découverte unique et immersive.



Exposition Object in stereo, 2023, Wellcome Collection, Londres
Un espace de lecture hybride
En plus des expositions, le musée abrite au premier étage une grande bibliothèque remarquable, riche d’ouvrages et de photos, meublée de canapés années 40 et réservée aux « incurables curieux ». Ici, les amoureux du savoir, qu'ils soient étudiants, chercheurs chevronnés, ou qui viennent d’ailleurs, trouvent refuge et inspiration. Cet espace est conçu comme un véritablement un lieu hybride, alliant les caractéristiques d'une bibliothèque et d'un musée et va bien au-delà d'un simple espace de recherche. En effet, elle est le reflet du musée dans son ensemble, offrant non seulement des ressources documentaires, mais également des médiations et des espaces d'exposition. L’espace n’est pas organisé par genre de livre ou par ordre alphabétique, mais il est organisé en grandes catégories. On retrouve par exemple des sections comme “Lives”, “vies” en français, qui regroupent des titres sur les thèmes de la biographie, de la maladie d’Alzheimer, du vieillissement ou des portraits. La section “Faith” qui se traduirait par “foi”, regroupe les ouvrages traitant d’amulettes, de religion et de médecine, de la mort et du processus de mort, ou d’autres sections, aux thématiques plus difficiles, comme la section “Breath”, “respiration” en français, qui aborde des sujets comme la cigarette, les guerres chimiques, les systèmes respiratoire, ou encore l'asphyxie.
A l’image des expositions, la bibliothèque encourage l'interaction et la contribution des visiteurs, des marque-pages sont mis à disposition pour laisser des traces, des avis et des critiques dans les différents livres. Des médiations sont judicieusement dispersées dans les espaces, pour offrir des expériences qui approfondissent les sujets, comme par exemple la création de journaux intimes, dresser son propre portrait ou encore s'adonner à des activités artistiques. L'espace est vaste, ouvert, et des coussins recouvrent les grands escaliers pour permettre aux lecteurs de s'y installer confortablement. La curiosité y est contagieuse. L'affluence est notable, loin d'un silence religieux, mais toujours dans le respect de tous les usagers.

Bibliothèque, Wellcome Collection, Londres
L'art de dialoguer avec son public
La Wellcome Collection résonne profondément avec la conviction que les musées sont des espaces de partage, de dialogues et d’interactions qui ont une mission primordiale de rendre accessible la culture auprès du public. Ce musée, un véritable bijou de curiosité, ne se contente pas simplement de présenter des objets de la collection de Henry Wellcome, il s’exprime de lui-même en créant un véritable dialogue avec le visiteur.
Le génie du musée réside dans sa manière accessible de présenter les choses et dans son intégration de la médiation. Il offre un espace ouvert et accueillant, où les publics se rencontrent et se retrouvent. La librairie et le café ajoutent à la convivialité à ce lieu de vie partagé, où la curiosité est valorisée. Les connexions entre les différents domaines créent du lien et montrent l'ancrage des sujets abordés dans un spectre plus large, celui du vivre ensemble, de l'innovation et de la réflexion collective pour un monde meilleur.
Pour en savoir plus :
- https://wellcomecollection.org/
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Wellcome_Collection
- //www.youtube.com/@WellcomeCollection
- https://wellcomecollection.cdn.prismic.io/wellcomecollection%2F4207b8c8-70d1-461e-bea6-f9da13f9a55a_wellcome+collection+who+we+are+and+what+we+do_2.pdf

Y'a d'la joie : FRAC Hauts de France
Pour la cinquième année consécutive le Frac Grand Large — Hauts-de-France et l'association d'aide sociale à l'enfance des Maisons des Enfants de la Côte d'Opale (MECOP) renouvellent leur partenariat et présentent l'exposition " Y'a d'la joie". Après avoir découvert les oeuvres lors d'ateliers de pratique artistique avec leur professeur, l'équipe du Frac a animé des ateliers au cours desquels c'est le rôle de commissaires d'exposition qui a été confié aux enfants. Fruit d'une expérience sensible et d'un travail collectif, la scénographie finale de l'exposition est directement inspirée des choix des enfants.
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.
Charlotte Cabon--Abily
#frac
#co-construction
#comissairesenherbe

Yoga au musée
Les Musées Royaux des Beaux- Arts de Belgique à Bruxelles ont mis en place depuis 3 ans une série de cours de Yoga au printemps. Chaque année, un professeur de yoga est invité à proposer une série de séance en mettant en lien sa pratique et les œuvres exposées dans une des salles du musée. Isabelle Vanhoocker, directrice des services aux publics, nous explique l'importance de s'ouvrir à de nouvelles pratiques et de s'adapter à la société actuelle en proposant le musée comme lieu de méditation et de spiritualité.
Justine Faure
#detenteaumusée
#yogameditatif

Zenon vous raconte
Au MusVerre, le médiateur Adrian Robert nous explique comment s'imagine et se déroule une animation de visite contée pour le très jeune public.
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.
Amaury Vanet