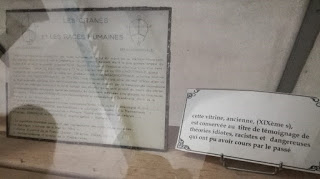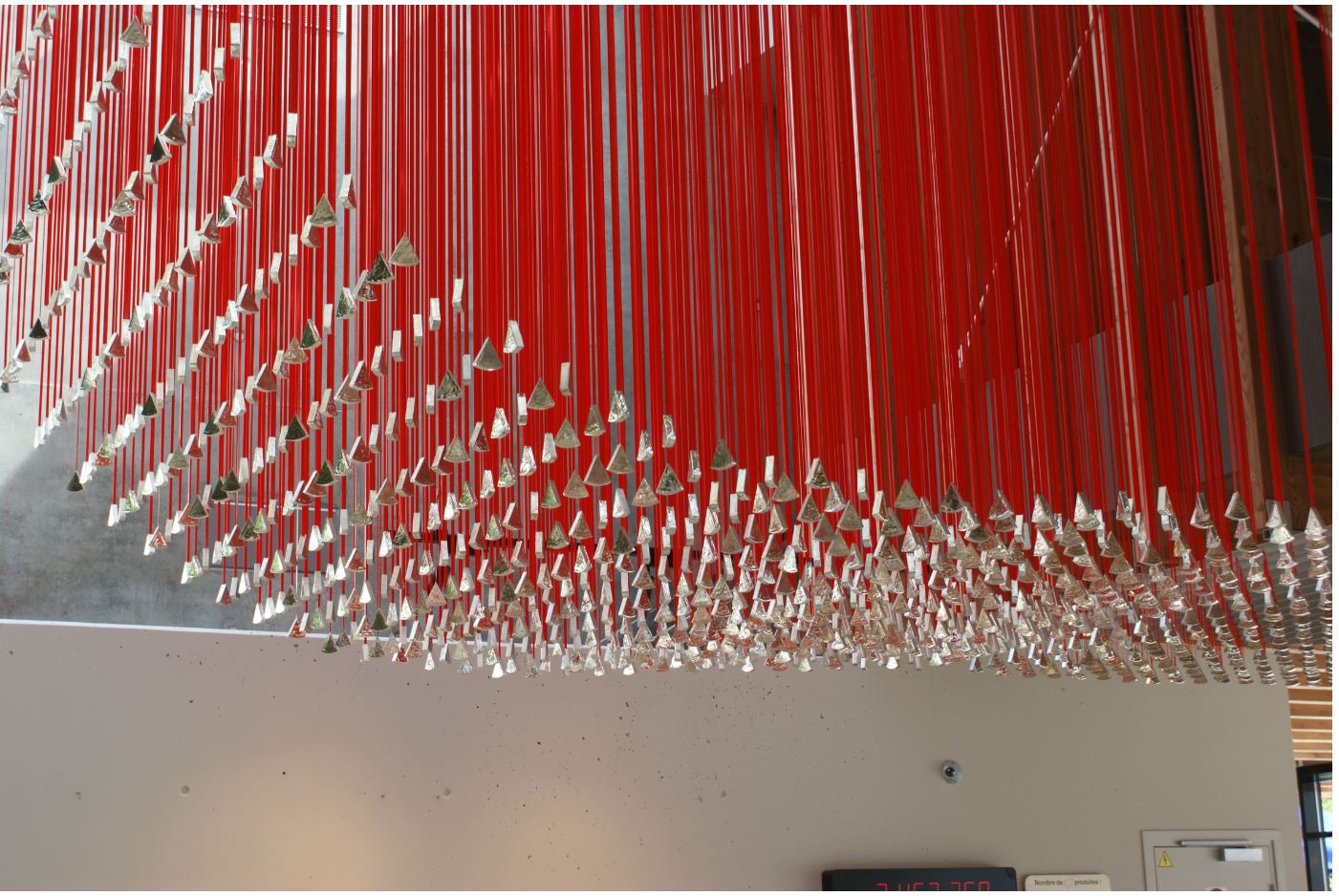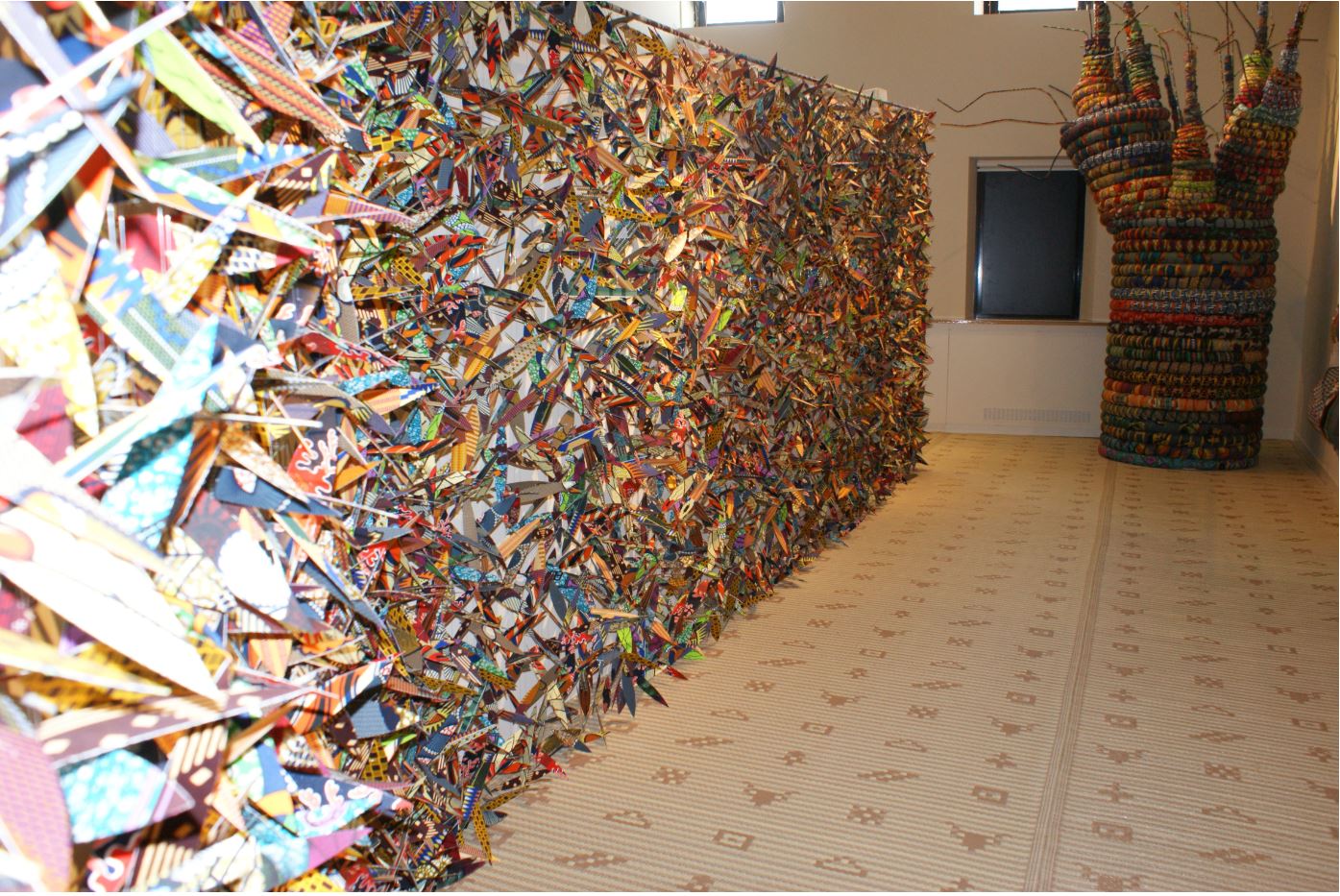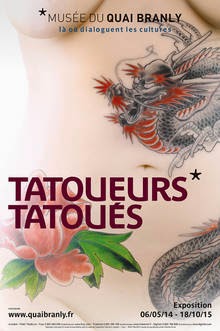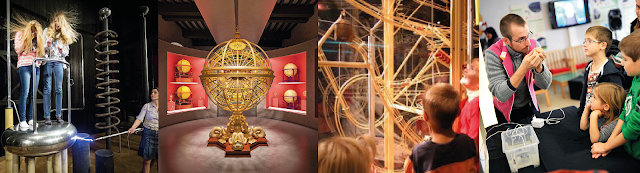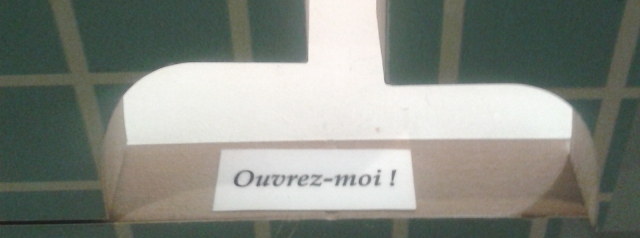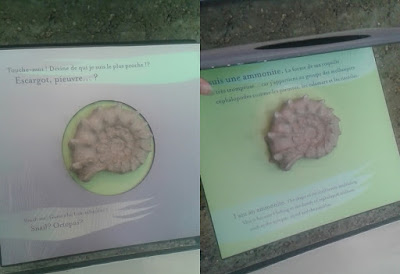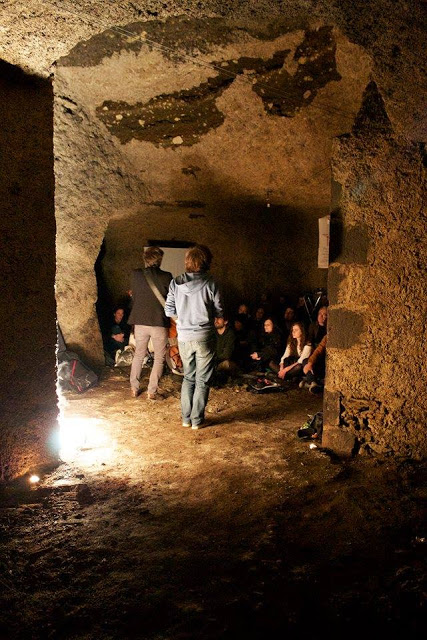Nos inclassables - objets non identifiés
« ART IS FREE. »
Rendre accessible l’art contemporain à toutes et tous, c’est le souhait d’Aurore Guez, une artiste parisienne de 22 ans qui a enflammée Internet. Pourquoi ? Elle expose et offre ses œuvres dans la rue.
Portrait d’Aurore Guez devant son œuvre représentant l’artiste Tyler, The Creator, 2023 ©Brice Cassagn

Aurore Guez et ses toiles ©BRK Studio
« Vous savez ce que j’adore par-dessus tout, je crois, c’est m’exposer à l’indifférence générale, » Citation tirée de l’interview réalisé par BRUT
Aurore Guez est une artiste parisienne de 22 ans. Tout en poursuivant des études d’économie, elle s’est lancée dans une aventure artistique hors du commun. Tout commence en 2021. En autodidacte, touchée par une profonde dépression lors du confinement lié au COVID-19, elle peint, ce qui devient son exutoire thérapeutique. Son œuvre s’inscrit dans une réelle pensée manifeste. Pourquoi l’art devrait-il être payant ? Pourquoi tout le monde n’a-t-il pas accès à l’art de la même manière ? Pourquoi les jeunes, étudiants ou non, ne pourraient-t-ils pas commencer une collection de tableaux ? Ce sont les questionnements de l’artiste qui décide dès 2022 d’exposer et d’offrir ses œuvres dans la rue. C’est ainsi que son slogan ART IS FREE voit le jour en 2021. Rendre accessible l’art contemporain à toutes et tous, c’est le souhait de cette jeune artiste déjantée. Cette proposition artistique éphémère enflamme rapidement Internet. Bien que juridiquement illégale car elle ne possède pas les autorisations adéquates, l’exposition trouve son public, un public disparate, pressé mais quelques curieux se voient offrir l’œuvre de leur choix.
Les expositions d’art contemporain peuvent être considérées comme un lieu d’entre-soi élitiste. Des œuvres abstraites hermétiques aux publics sont accrochées en galerie d’art sur des murs immaculés. Cette conception ne convient plus à la jeune génération qui se rend compte des problématiques d’accessibilité à la culture et qui ne se reconnaît pas dans ses propositions culturelles. La pratique d’Aurore Guez s’inscrit tout à fait dans cette prise de conscience.
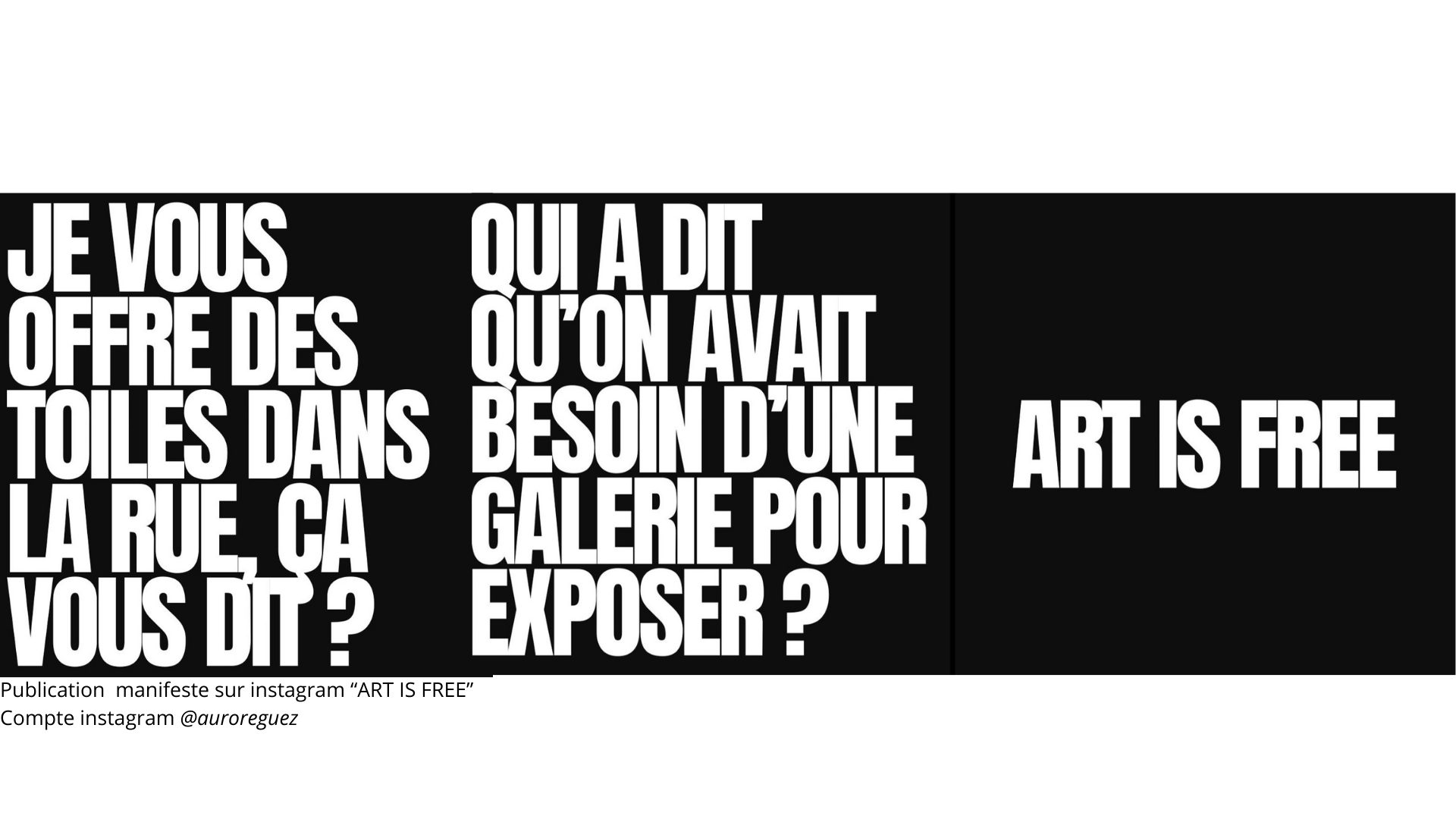
Des visages à travers un filtre grossissant
« Il ne s’agit pas de peindre la vie, mais de rendre vivante la peinture » Citation de Pierre Bonnard, citée dans un de ses posts Instagram
Son genre artistique est le portrait. Les visages sont grossiers et caricaturaux, arborant des yeux globuleux et de grosses bouches. Sa peinture est haute en couleurs, dans une inspiration héritée du fauvisme : teintes inédites, utilisation arbitraire et absurde. Les échelles sont faussées et démultipliées. Elle multiplie les représentations d’icônes issues de la culture populaire, allant des années 70 à nos jours. Ringo Starr, Snoop Dogg, Serge Gainsbourg, Salvador Dali, David Bowie etc... Tous sont passés au travers de ce qu’elle appelle son « filtre grossissant ». Elle déforme les visages pour les transposer dans un univers autre. L’artiste fait également le portrait à de nombreuses personnalités publiques actuelles telles que des DJs en vogue, des créateurs de contenus sur Youtube, des humoristes avec qui elle réalise des partenariats artistiques. De jeunes talents en photographie travaillent également avec elle.
Aurore Guez, une météorite dans le monde de l’art contemporain
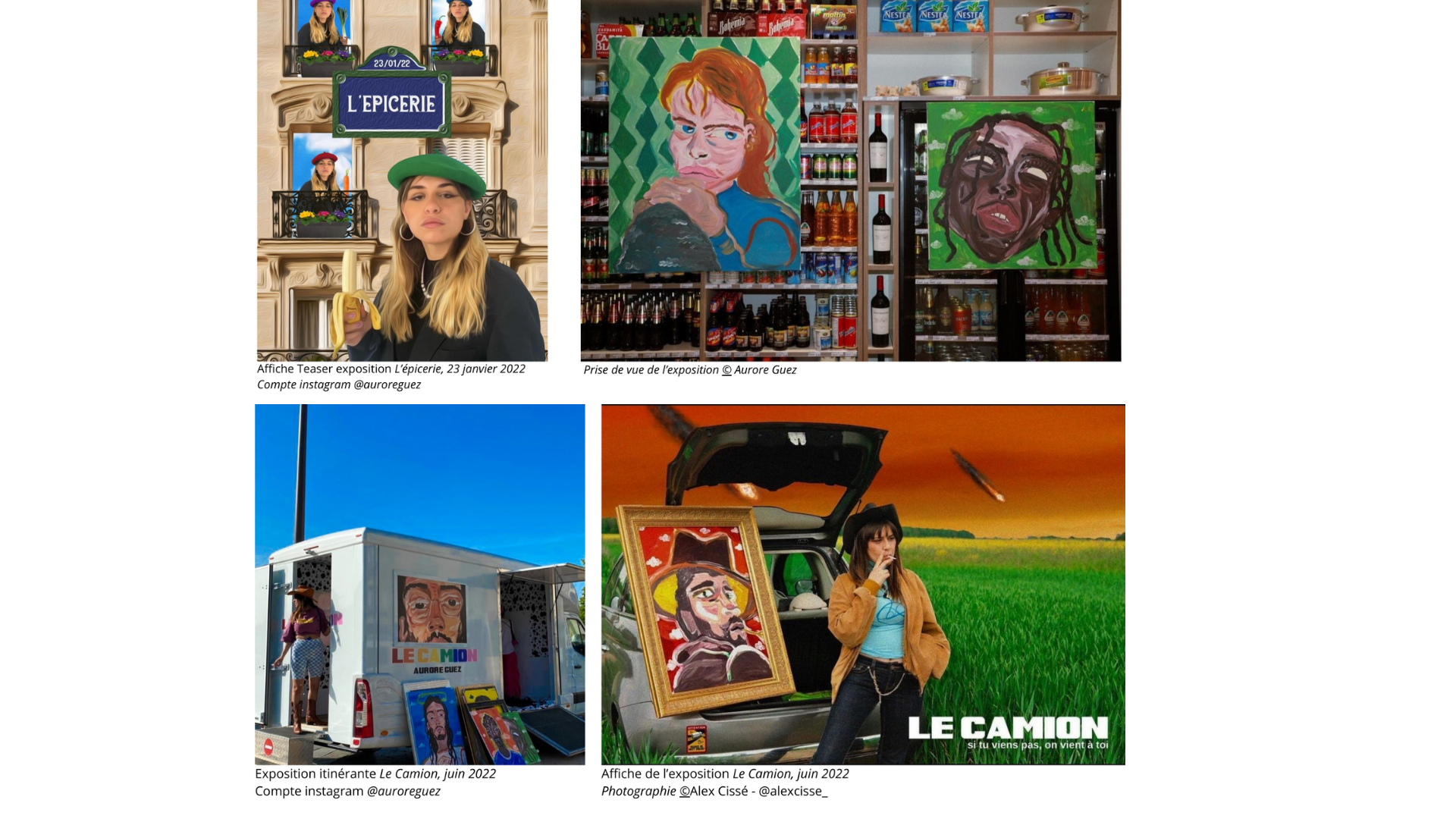
Panorama de ses expositions
Exposer ses œuvres dans la rue l’a propulsée sur le devant de la scène. Cependant, elle commence son périple artistique dès 2021 en créant des expositions immersives et farfelues qu’elle appelle des shows. Qu’est ce qu’une exposition immersive ? Proposer une réelle expérience sensorielle aux visiteurs en les faisant interagir avec l’œuvre, impliquant alors très souvent une forte scénographie. Les expositions d’Aurore Guez s'inscrivent dans des lieux plus atypiques les uns que les autres. L’aventure commence fin 2021 dans une épicerie latino, au sous-sol aménagé en forêt tropicale. L’artiste accueille les visiteurs et se charge de toutes les visites guidées. Quelques mois plus tard, Aurore Guez dégaine son chapeau et son blouson de cowboy et propose une nouvelle campagne « Le camion : si tu viens pas, on vient à toi ». A l’été 2022, l’artiste sillonne en camionnette les rues de Paris et propose ainsi une exposition itinérante permettant d’aller à la rencontre de potentiels publics. Le Paname Art Café, une salle de stand up parisienne, invite ensuite l’artiste à exposer pour quelques jours.
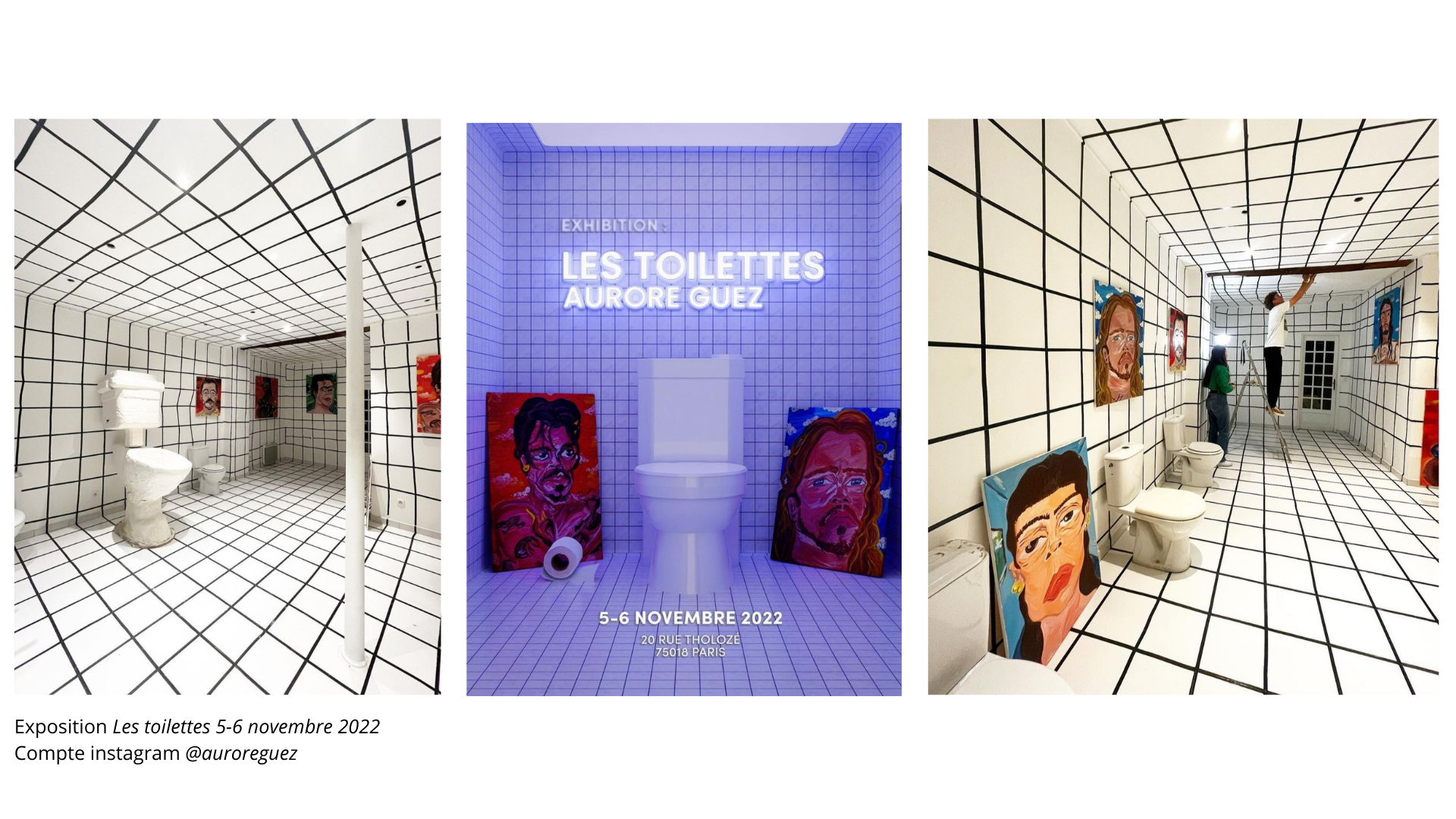
Autre geste : exposer dans des toilettes. Cette initiative rappelle l’exposition « Flush » (2021) où l’artiste Sacha a exposé ses œuvres dans ses propres toilettes.
L’artiste et son équipe ont pris leurs quartiers dans une galerie parisienne qu’ils ont aménagé en un gigantesque cabinet de toilettes aux échelles distendues. Cet événement a été l’occasion pour Aurore Guez d’inviter des artistes qu’elle affectionne comme la chanteuse Liv Del Estal qui a performé à côté des WC. Une idée farfelue mais qui casse les codes et joue avec les tabous. A la manière d’Andy Warhol, Aurore Guez côtoie le quotidien et le sublime en exposant l’art là où on ne l’attend pas. Même dynamique pour son exposition qui prend lieu dans un diner américain servant frites et Hot Dog. L’hôtel de ville de Vincennes s’est également vu investi, avec le Musée du Cactus et du Parapluie. L’artiste y expose quelques toiles en plein air dans un univers onirique et surréaliste. Chaque show est un véritable laboratoire créatif avec une direction artistique spécifique, une stratégie de communication efficiente, de réelles scénographies, des mises en scènes avec des acteurs mettant en valeur ses toiles.

La dernière en date : le magasin de lit
L’exposition la plus récente et qui a particulièrement retenu mon attention est le Magasin de lits qui s’est tenu le 25 avril. Cette exposition complétement loufoque prend place dans un magasin de literie en plein Paris (80 boulevard de Sébastopol). Les visiteurs sont invités à s’allonger sur de confortables lits pour découvrir les œuvres de l’artiste suspendues au plafond. Des pantoufles et bonnets de nuit sont à disposition pour approfondir l’expérience.
Cette scénographie insolite est inspirante pour renouveler l’accrochage des expositions de peintures. Imaginez-vous vous allonger pour admirer des œuvres. Plus de questionnement possible sur les assises dans les lieux muséaux… Cette démarche très intéressante pourrait aisément rentrer dans une démarche d’art thérapie dispensée de plus en plus dans les musées et lieux culturels. Cette atmosphère de magasin de lits à la « bonne nuit les petits » est singulière, extravagante et tellement rafraichissante dans le monde de l’art contemporain. L’exposition propose de forts partis pris muséographiques et scénographiques, en maniant humour et intimité.

The show must go on !
Aurore Guez est proactive, crée des histoires et des univers plus loufoques les uns que les autres. Les expositions qu’elle propose sont de véritables performances. Sa démarche bouleverse nos habitudes et prouve que le milieu de l’art peut ne pas se prendre trop au sérieux… Et ça fait du bien !
Cette jeune artiste pétillante et colorée nous transporte dans un style décalé et absurde, susceptible de toucher toutes les générations. Grâce à ses portraits aux couleurs acidulées, représentant des personnalités de tous horizonsissues de la pop-culture et de contrecultures comme le rap, Aurore Guez intrigue, touche et fédère. Ses expositions peuvent être considérées telles des manifestes qui s’inscrivent dans une pensée sociale de l’art et de la culture.

Prise de vue de l’exposition Le Diner © Aurore Guez 2023
Son compte Instagram est son carnet de bord artistique. C’est sur cette plateforme qu’elle s’exprime, partage son quotidien. Adoptant une véritable stratégie de communication spontanée et amusante, elle diffuse ses travaux et crée du lien avec sa communauté. Elle réalise souvent des petites capsules vidéos où elle vulgarise et démocratise le monde de l’art qui peut parfois rebuter. En s’entourant d’artistes, d’humoristes, de personnalités publiques créatives et hautes en couleurs, elle nous prouve que l’intelligence collective est essentielle dans la création de projets artistiques. Même avec des petits budgets, tout le monde peut créer, tout le monde a une histoire à raconter et des visions à offrir. Cette philosophie est celle d’une nouvelle génération d’artistes qui aime se réunir, s’amuser, et réunir ses forces pour créer ensemble et nous offrir des moments sans « prise de têtes » invitant à explorer notre imaginaire, ce dont nous avons bien besoin !
Vivement les autres performances de cette artiste prometteuse de la scène underground parisienne que l’on espère voir se familiariser avec le concept « d’happening » qui consiste à créer in situ devant un public.
Giulia Guarino
En savoir plus :
- Interview Konbini : https://www.konbini.com/videos/aurore-guez-la-peintre-qui-expose-ses-toiles-dans-la-rue/
- Interview BRUT. : https://www.brut.media/fr/entertainment/elle-expose-et-offre-ses-toiles-dans-la-rue-0697536a-8d95-45d5-a9b7-4940f2a7142b
- Médiation allongée du guide animateur Julien Ravelomanantsoa à la Musée de la piscine à Roubaix : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1330-mediation-detonante-la-piscine-de
Suivre son actualité : @auroreguez sur Instagram
#Artcontemporain #Expositioninsolite #Jeunetalent

Aujourd'hui j'ai rendez-vous pour un contrat pro. !

Aujourd'hui j'ai eu rendez-vous pour un contrat de professionnalisation. Dans le milieu culturel c'est assez exceptionnel pour me donnerle prétexte de rédiger un article.
Un contrat pro, cela signifie une vraie mission, le temps de la réaliser, un salaire décent (ça se prend!) et l'espoir d'être embauchée à la fin.
Du coup, depuis une semaine, je me prépare et je trépigne d'impatience. J'ai donc décidé de partager cette expérience avec vous. On ne sait jamais ça peut servir !
Mode d'emploi en trois leçons.
1. Qu'est-ce qu'un contrat de professionnalisation ?
Le destinataire :
Le contrat de professionnalisation est destiné à trois types de bénéficiaires :
✔ les étudiants de 16 à 25 ans révolus
✔ les demandeurs d'emploi âgés de 26 et plus
✔ les bénéficiaires de certaines allocations ou contrats
L'objectif :
Le contrat permet au bénéficiaire d'acquérir une qualification professionnelle ou de compléter sa formation initiale en vue d'accéder à un poste déterminé dans l'entreprise.
Cette définition inclut l'idée que le contrat débouche sur une embauche. Il représente donc une véritable opportunité pour un jeune diplômé entrant fraîchement sur le marché du travail.
La durée :
Le contrat peut être conclu pour une durée de 6 à 12 mois (voir 24 mois sous conditions particulières). Durant cette période, le bénéficiaire occupe un poste défini et mène à terme différentes missions.
Cette expérience est extrêmement valorisante sur un C.V. puisqu'aux yeux d'un futur employeur il signifie que son bénéficiaire a occupé un poste comme salarié.
Un accès à la formation :
Le contrat est accompagné obligatoirement d'un accès à la formation. Cette dernière peut être mise en place par un organisme public ou privé, ou par l'entreprise elle-même. Sa durée est comprise entre 15% et 25% de la durée totale du contrat, et ne peut être inférieure à 150 heures. Cette formation implique qu'un tuteur encadre le bénéficiaire dans les missions qui lui sont dévolues au sein de l'entreprise mais également pour le suivi de sa formation.
La rémunération :
Ici encore, le contrat est intéressant. Les 16/25 ans sont rémunérés en pourcentage du SMIC selon leur âge et leur niveau de formation, et ne peut être inférieur à 55% du SMIC. Les plus de 25 ans quant à eux, ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au SMIC et à 85% du salaire minimum conventionnel. Du côté de l'employeur, il permet d'accéder sous certaines conditions à une exonération de cotisations patronales ainsi qu'à de nombreux avantages tel que le remboursement des frais de formation.
2. La préparation : envisager toutes les possibilités
Si aucune solution toute faite ne permet de préparer au mieux son entretien, à mon sens quelques règles peuvent cependant être respectées.
Tout d'abord connaître sur le bout des doigts la législation concernant le contrat pro. (voir site dugouvernement). En effet, il n'est pas certain que l'entreprise que vous rencontriez sache réellement ce que signifie ce type de contrat, ou ne le confonde avec un contrat d'apprentissage. De plus malgré une législation longue et relativement barbante, certaines conditions du contrat ne sont pas précises. C'est le cas notamment de la rémunération. En effet aucune grille n'est disponible pour savoir à quel salaire vous pouvez prétendre en fonction de votre niveau d'études. Même s'il est bien entendu impossible d'établir une grille fixe, il aurait été intéressant que le gouvernement fixe un pourcentage fixe par rapport au salaire du poste occupé.
Ensuite comme pour un stage, il est indispensable de connaître : le secteur d'activité de l'entreprise, ses missions, son organigramme, mais également ce que réalise la concurrence. Si vous avez la possibilité de connaître l'intitulé exacte du poste, il est indispensable de se renseigner sur les missions qu'il entraine, la formation classique de ce poste, la rémunération standard, etc. Ces connaissances vous permettront d'être actif lors de l'entretien et de transformer vos particularités en forces si votre cursus est différent du cursus standard (ce qui est mon cas).
Personnellement je me suis préparée encore plus méticuleusement pour cet entretien que pour mes candidatures en stage, en master ou à des bourses d'état. En effet le contrat pro. ne peut être conclu que dans le secteur privé, ce qui exclut donc une grande majorité des structures embauchant dans le domaine culturel. Il est souvent méconnu, ce qui peut entrainer quelques craintes du côté de l'employeur. De ce fait j'ai vraiment considéré cet entretien comme une chance exceptionnelle et j'ai redouté la concurrence.
Après avoir travaillé le contenu de l'entretien, j'ai travaillé ma prestation. Aujourd'hui sur le web vous pouvez trouver des dizaines de vidéos réalisées par des coachs : « Parlez-moi de vous, que répondre à cette question ? », « Entretien d'embauche : jeune diplômé » ou encore « Langage corporel et non verbal, les gestes qui trahissent ». D'accord les titres sont racoleurs, le format fait très école de com' et l'on peut craindre que ce genre de conseils ne soit que peu adapté au secteur culturel. Cependant ces vidéos ont trois mérites : se préparer au cas où votre futur employeur est un sadique posant des questions complètement tordues et sans aucun intérêt pour le poste ; réfléchir à de véritables questions et vous apprendre à vous mettre en valeur ; vous détendre en ayant l'impression que vous avez tout fait pour vous préparer au mieux. Personnellement ayant eu sous la main quelqu'un d'assez sympa et tordu pour simuler avec moi un entretien, je l'ai répété plusieurs fois pour parer à toutes éventualités.
3. Nouveau look pour un nouveau job
La veille au soir j'ai entré l'adresse de l'entreprise dans mon GPS et j'ai préparé ce que j'allais mettre. Cela peut paraître trivial, mais pour moi c'est essentiel. Votre tenue est la première impression que vous allez donner à celui qui sera votre futur employeur. Lors de ma formation en droit, la question était beaucoup plus simple : tailleur ou costume de rigueur ! Lorsque j'étais en histoire de l'art, chacun s'habillait comme il le voulait et ça ne choquait jamais personne (hormis peut-être moi). Mais pour une entreprise dans le domaine culturel ? Certes on ne doit pas avoir un look de banquier, mais on ne doit pas non plus adopter celui d'un hippie. Du coup j'ai essayé de repenser à tous les interlocuteurs que j'ai rencontré dans ce secteur. Le plus souvent ils étaient habillés de manière assez classique, mais avec un élément original. Du coup j'ai opté pour un tailleur mais avec une veste décalée. Je me sens à l'aise dans cette tenue, et s'il ne faut retenir qu'un conseil en terme vestimentaire, c'est bien celui-là : se sentir bien, voire jolie, inconsciemment ça permet d'avoir confiance en soi. Personnellement je pousse le vice jusqu'à avoir des sous-vêtements fétiches et des chaussettes sans trous, même si personne ne les voit !
J'ai aussi préparé mon sac avec mon carnet de note (pour réviser dans la voiture parce que je savais que je serai très en avance), un crayon présentable : ni rose fluo, ni mâchouillé, ni publicitaire. J'en prend toujours un second au cas où on interlocuteur n'en aurait pas sous la main. Dans une chemise au nom de l'entreprise j'ai rangé mon C.V. et ma lettre de motivation, une fois encore au cas où mon interlocuteur ne les aurait pas imprimés. Je vous conseille également d'imprimer la documentation relative au contrat de professionnalisation, ainsi que la plaquette de votre formation. Si vous avez un book relatif à vos différents projets, pensez à le prendre, ça permettra de valoriser votre expérience.
Ensuite je me suis fait une petite séance de sophrologie pour m'endormir calmement, et éviter de répéter l'entretien toute la nuit. Bon je sais, dit comme ça, ça fait un peu bobo, mais ça marche pour moi. Après à chacun sa solution : sport, lecture, série TV, un petit verre de rhum …Enfin tout ce qui vous permettra de passer une bonne nuit.
Le matin, je me suis laissée plus de temps que d'habitude pour prendre un véritable petit déjeuner, afin d'éviter que mon ventre ne gargouille durant tout l'entretien. J'ai prévu une demi-heure de battement avec l'horaire prévu, résultat comme d'habitude j'ai attendu dans la voiture. Au final cela m'a permis de relire quelques notes. Deux minutes avant l'heure prévue j'ai respiré un grand coup, j'ai croisé les doigts et j'ai sonné à la porte.
Au final l'entretien a duré une heure, j'étais contente de l'avoir préparé autant même si mon interlocuteur ne m'a pas posé de questions pièges. J'ai mis en avant mes qualités, mais n'ai pas menti sur les sujets que je ne connaissais pas. Comme le conseillait la vidéo sur youtube j'ai fait attention de ne pas jouer avec mes mains ou avec mes cheveux.
Au sortir de là, j'étais plutôt contente de ma prestation et avais un bon pressentiment. J'espère donc que mon prochain article sera un guide de survie pour gérer un contrat pro, une formation prenante, un projet tuteuré, un mémoire, et une vie sociale !
Marion Boistel
Pour de plus amples informations sur les conditions d'accès au contrat pro :
Pour regarder des vidéos rigolotes mais tout de même instructives sur la manière de préparer un entretien :
https://www.youtube.com/watch?v=AYtAhi-YE9U
#contrat pro.
#préparation
#entretien
"Ils savent que c'est leur espace"
Le 26 mars 2015 s’est tenu à la Cité des Sciences un séminaire de muséologie : « Quoi de neuf du côté des enfants ? » L’intervention de Valérie Thieffry, responsable du service Politique des publics et actions éducatives au Museum d’histoire naturelle de Lille portait sur l’exposition imaginée à partir du livre « De la petite Taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête… ». Cette exposition permet aux enfants d’appréhender seuls le propos et met à leur disposition un espace de lecture. Durant son intervention ValérieThieffry a dit cette petite phrase qui a fait tilt : « C’est une exposition dans laquelle les enfants reviennent car ils savent que c’est leur espace. »
De la petite Taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête… © Lire au havre
Qu’est-ce qui fait qu’une exposition, qu’une muséographie, qu’une scénographie, nous font ressentir que c’est notre espace ? Qu’est-ce qui peut ainsi donner envie au visiteur de retourner dans un musée ou une exposition simplement parce qu’il s’y sent bien ? Sans doute que cela varie selon chacun, question de luminosité, d’agencement des salles, de présence de fenêtres ou d’assises, d’espace entre les différents éléments …
Il y a quelques mois, j’ai visité un musée et je me suis dit que je m’y sentais bien… Après avoir visité un grand nombre d’expositions, après avoir arpenté plusieurs musées, où j’aime me rendre pour le plaisir, c’est celui-ci qui m’a réellement frappée, où je me suis dit : « C’est mon espace ».
Ce musée se trouve en Bretagne, c’est le Musée des Beaux-arts de Quimper.
Façade du Musée des Beaux-arts de Quimper© Musée des Beaux-arts de Quimper
On reproche souvent aux musées des Beaux-arts de n’être pensés que pour les œuvres et en aucun cas pour le visiteur. Mais ici les deux ont leur place, ce n’est pas qu’un lieu de conservation, c’est un lieu de diffusion, d’éducation et de délectation.
C’est un musée à l’architecture multiple : de la pierre, des bois de teintes variées, des espaces modernes, d’autres anciens, du gris, du blanc, ocre… Contre toute attente, cette diversité n’empêche pas la création d’un espace unifié dans lequel œuvres et visiteurs se sentent à l’aise. Des vues sur les différents espaces du musée ont été créées, laissant ainsi de larges perspectives et une approche globalisante de cette variété. De larges ouvertures viennent ponctuer le parcours de visite, permettant au visiteur de respirer, de faire le plein de luminosité avant d’entrer dans une salle moins éclairée pour des raisons de conservation préventive.
Plus que le confort du visiteur, le Musée des Beaux-arts de Quimper cherche à stimuler l’amateur d’art, à le questionner, quel que soit son âge. Des espaces sont ainsi dédiés durant le parcours pour que chacun puisse prendre le temps, prendre son temps, dans le musée, auprès des œuvres.
Dans les expositions temporaires il est possible de trouver des espaces de lecture, comme si l’exposition s’était construite autour d’un salon. Une table avec quelques ouvrages, quatre fauteuils, deux petites étagères : un mobilier qui s’intègre parfaitement à la scénographie en place. Le visiteur est invité à prendre un livre et s’installer confortablement à la lumière du jour. Ce type d’espace n’est pas unique dans le musée. Dans la salle Lemordant, une table et quatre sièges permettent aux familles de se retrouver confortablement, un peu comme à la maison.
Salle Lemordant au Musée des Beaux-arts de Quimper © Bretagne Musées
Tout au long du parcours permanent, le visiteur enfant trouve des points de médiation qui lui sont destinés : des jeux pour l’aider à regarder certains tableaux. Ainsi, même si les parents n’achètent pas le livret d’aide à la visite, le jeune visiteur est accompagné. Une salle entière lui est même réservée. Les expositions temporaires y trouvent leurs déclinaisons en manips et autres activités pour que l’enfant – et les adultes qui sont ravis de se prêter au jeu – puisse jouer à partir des œuvres qu’il a vues. Cela lui permet de repartir avec un souvenir s’il ne l’expose pas avec ceux des autres artistes venus avant lui.
Ce sont ces espaces de convivialité qui m’ont plu. Ce sont ces lieux destinés au repos, à la discussion, à la contemplation qui m’ont permis de rythmer ma visite et d’en profiter au maximum, sans culpabiliser de faire des pauses. Et je crois que ce sont aussi ces invitations qui m’ont permis d’avoir avec les personnes m’accompagnant des discussions riches sur les œuvres qui nous entouraient ou que nous avions croisées.
Et vous, quel est le musée qui vous offre votre espace ?
Aénora Le Belleguic-Chassagne
A consulter :
- http://mhn.lille.fr/cms/home/activites/La-petite-taupe
(Exposition jusqu’au 31 mai 2015)
# Beaux-arts
# Confort
# Visite

« Art Cares Covid – Inside out », une exposition qui bouscule le modèle classique des musées
Bannière « actualités » du site des MRBA, novembre 2020, affiche de l’exposition « Art Cares Covid – Inside out », © MRBA, 2020.
Des projets culturels au temps de la Covid-19
L’exposition « Art cares Covid, Inside-out » s’est développée dans un cadre particulier, celui d’une crise sanitaire. En Belgique et partout ailleurs, la création artistique contemporaine a été fortement touchée : fermeture des galeries, annulation ou suspension des expositions, visites d’ateliers annulées, etc. Le monde muséal a également été particulièrement touché, notamment par la fermeture des institutions culturelles et ce pendant de longs mois. C’est à partir de cette observation que l’exposition temporaire « Art cares Covid » a été conçue.
D’abord prévue du 2 octobre 2020 au 24 janvier 2021, puis prolongée jusqu’au 14 février 2021, elle a été présentée au sein des Musées Royaux des Beaux-arts de Bruxelles (MRBA). Plusieurs acteurs ont participé à l’élaboration de cette exposition : Maëlle Delaplanche, commissaire de l’exposition et co-créatrice d’« Art cares Covid », Sandrine Morgante, artiste et co-créatrice d’« Art cares Covid » ainsi que Gaëlle Dieu, exhibition coordinator des MRBA.
Présentons d’abord le projet « Art cares Covid », une plateforme numérique élaborée par M. Delaplanche et S. Morgante. Celle-ci consiste à offrir une galerie numérique à différents artistes sélectionnés par les deux créatrices : des artistes belges ou résidants belges actuellement peu connus dans le domaine de la création artistique (Samuel Coine, Laure Forêt, Selçuk Multu ou encore Catherine Warmoes). La plateforme permet de leur donner de la visibilité et de vendre leurs œuvres en ligne. Elle a été pensée en association avec l’ASBL « A travers les Arts ! » qui se donne pour objectif d’aller contre l’isolement des séniors en leur donnant accès à la culture. « Art cares Covid » soutient donc cette association par un système de don lors de chaque achat d’une œuvre sur la plateforme (60% revient à l’artiste et 40% à l’association). Ces dons sont ensuite utilisés par l’ASBL pour des projets comme l’organisation d’animations artistiques près des maisons de repos. Le projet global souhaite fédérer des artistes émergeants à travers les arts, de vendre leurs œuvres tout en aidant les séniors isolés.
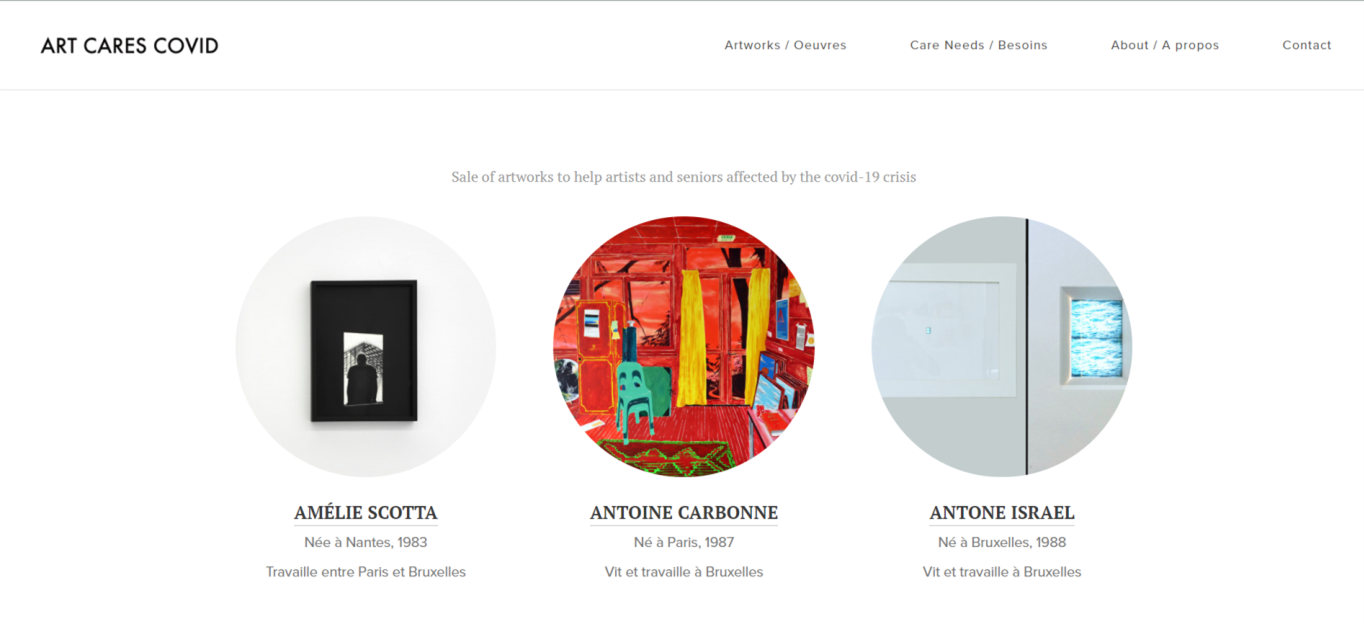
Site internet « Art cares Covid », exposition numérique présentant les artistes, novembre 2020 © M. DELAPLANCHE, 2020.
Art Cares Covid est alors, dans un premier temps, une galerie-« exposition » virtuelle d’artistes. A partir d’une œuvre phare de l’artiste, vous pouviez naviguer pour voir l’ensemble de ces œuvres, avoir accès à son site, comprendre sa démarche, etc. Le conservateur des œuvres contemporaines des MRBA, P-Y. Desaive, a été touché par ce projet et par la galerie virtuelle que proposait M. Delaplanche. Il lui a proposé de créer une exposition réelle à partir de cette galerie numérique. Une occasion pour le musée de s’ouvrir au contemporain, qui, depuis quelques années cherche à exposer ce type de collections, alors très peu présentes depuis la création du musée en 1801. Cette exposition permet également d’offrir une visibilité à une initiative sociale et artistique. Le conservateur a ainsi donné carte blanche à la commissaire M. Delaplanche pour l'exposition, en matière de scénographie et de muséographie pour l’exposition « Art cares Covid, Inside-out ».
Une exposition temporaire, du numérique au réel
« Art cares Covid, Inside-out » est une exposition dite « focus » mettant en avant 41 artistes belges à travers 72 œuvres. Le but premier est de « concrétiser » physiquement une exposition numérique. C’est un processus très intéressant puisque nous avons vu durant cette crise sanitaire comment les expositions et les musées se sont numérisés (visite d’exposition en vidéos, podcasts sur les œuvres, ateliers de médiation à faire à la maison, etc.) pour donner accès à la culture « à domicile » alors que cette exposition fait le chemin inverse : un projet numérique prend forme physiquement dans une institution muséale. L’exposition prend place dans le patio 0 des MRBAB, une pièce carrée avec en son centre une salle circulaire. Quatre îlots d’exposition ont été mis en place et présentent des œuvres choisies autour du thème que souhaitait aborder M. Delaplanche : la création artistique contemporaine au temps du Covid-19. Elle a demandé à chaque artiste participant de composer une œuvre de grandes dimensions et une œuvre de petites dimensions en accord avec la thématique : microcosme et macrocosme. Ainsi, dans un même espace les œuvres dialoguent ensemble par un jeu d’échelle : Stéphanie Roland propose une sculpture imposante en plexiglas nommée Méta-église (2016) alors que Joao Freitas élabore une petite sculpture de papier, Untitled réalisée pendant une résidence italienne. Les publics peuvent se déplacer d’expôt en expôt au sein de chaque îlot thématique, l’espace est très aéré et reprend les codes habituels du « white-cube ».
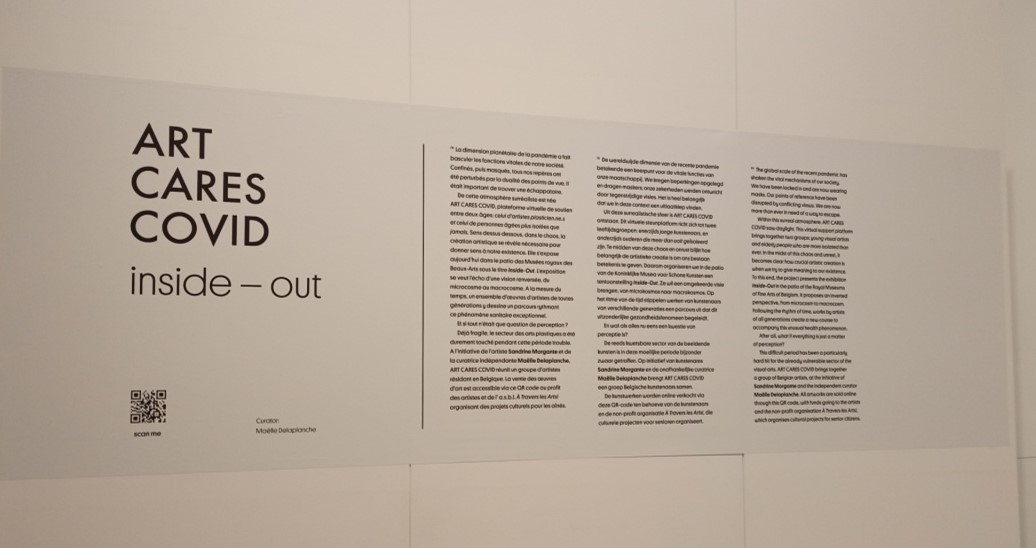
Texte mural, introduction de l’exposition, en trois langues, titre et nom de la commissaire © M. MAINE, 2020.
L’exposition présente une variété d’œuvres en rapport avec l’actualité sanitaire et aborde plus précisément les différentes phases ressenties par chacun durant le confinement, conséquence directe de cette pandémie. Le sujet choisi permet de parler des sentiments d’enfermement puis de délivrance, les tâches répétitives accomplies, le repli sur soi, etc. Dans un second temps, le but est de montrer comment la création artistique actuelle, dans sa diversité (supports, matériaux, aspects), peut donner une image de nos sentiments dans une situation complexe internationale de confinement. Sont donc mis en scène la création artistique d’artistes méconnus belges, le confinement et ses conséquences sur nos perceptions (temps, espace) et sur le monde artistique, les repères habituels de la vie quotidienne perturbée, l’art contemporain face à un sujet de société, le rapport microcosme/macrocosme, etc. Les objets exposés sont quant à eux, tous des œuvres dédiées à la vente, ils appartiennent aux artistes qui en détiennent les droits jusqu’à leur vente. Les MRBA ont fait le choix d’exposer des œuvres d’art ayant un but lucratif dans une institution où l’inaliénabilité des œuvres est de mise. Ce parti pris audacieux répond à la volonté du musée de s’ouvrir au contemporain mais pose de réelles questions sur le statut de ces œuvres. Assurance, régie, muséographie et accrochage, toutes ces actions en sont nécessairement touchées : l’artiste étant propriétaire de son œuvre, il a fallu de la pédagogie et de nombreux échanges pour que cette exposition ouvre aux publics.


Premier îlot de l’exposition © M. MAINE, 2020.
Salle circulaire, pièce dédiée aux projections, © M. MAINE, 2020.
De la galerie au musée, accrochage et muséographie
Cette exposition se démarque par son originalité : exposer des œuvres d’artistes originellement dédiées au marché de l’art dans une institution muséale publique peu axée sur le contemporain. Ce fait a d’ailleurs beaucoup d’influence sur la scénographie, sur les outils de médiation et notamment sur l’absence de cartels explicatifs ou de textes de murs thématiques. Par son type d’accrochage, l’exposition dans sa forme s’approche d’une galerie. Cela a une conséquence directe sur les publics visés : l’exposition s’adresse principalement à un public de galerie ou habitué à l’art contemporain. Le manque d’explications (textes, cartels) et l’absence d’outils de médiation rendent assez complexe la compréhension du propos de l’exposition durant la visite. Les différents sentiments ressentis durant le confinement n’étant pas indiqués, les publics non habitués ou les publics jeunes auront du mal à les déceler.
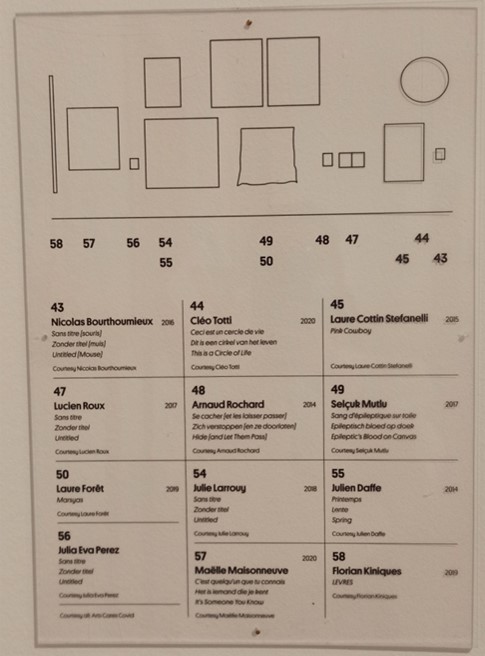
Cartel de l’exposition, quatrième îlot, © M. MAINE, 2020.
Pour autant, l’accrochage qui se fait à la fois sur une association chromatique et sur une diversité des supports offre aux publics un large aperçu de l’étendue de la création artistique contemporaine. Ce parcours de visite permet ainsi d’appréhender différents matériaux, médias, dimensions et sujets ; on comprend donc le caractère personnel de chaque œuvre. En sachant que le propos de l’exposition s’organise autour du vécu du confinement, on comprend mieux la relation entre l’individu et l’objet : émotions, contemplation, sensation, ressenti.

Quatrième îlot de l’exposition, © MRBAB, Bruxelles, Odile Keromnes, 2020.
Cette exposition donne de réelles pistes de recherche muséologiques comme la place de l’art contemporain dédié au marché de l’art dans un musée public, les compromis entre la volonté des artistes et les normes muséales ou encore l’implication d’une exposition dans des sujets d’actualité. Dans un contexte complexe pour les institutions culturelles comme pour les créateurs, de tels projets peuvent réellement faire la différence notamment en donnant une visibilité aux artistes et en proposant une nouvelle façon d’exposer les œuvres pour les publics. Cette exposition permet également aux MRBA de s’impliquer dans l’art contemporain, le tout dans un but associatif pour aider les séniors isolés. « Art cares Covid, Inside-out » bouscule quelque peu le modèle classique des musées en lui donnant de nouvelles fonctions et de nouvelles missions.
MAINE Marion.
Merci à Gaëlle Dieu et Maëlle Delaplanche d’avoir accompagné la rédaction de cet article.
Pour aller plus loin :
- ART BASEL, « The Impact of Covid-19 on the art market », vidéo YouTube, publiée le 21.05.2020.
- R. AZIMI, « Art contemporain : face au Covid-19, le virage numérique des galeries africaines », Le Monde, 19 janvier 2021.
- M. DELAPLANCHE, Site internet « Art cares Covid », lancé en 2020
.
#artcontemporain #bruxelles #galerie

Accro(c) au futur musée des collectionneurs d'Angers?
Vue panoramique du projet sur le Front de Maine, le quartier du musée des collectionneurs. compagnie Phalsbourg. source: ImagineAngers
« Rappelez-vous le Centre Pompidou »
Cette remarque faite à des visiteurs de la foire d’exposition sur le stand des lauréats du projet imagine Angers eut le don de me faire sortir les crocs. Et non, ce n’est pas seulement un mauvais jeu de mots sur l’apparence architecturale imaginée par Steven Holl et Franklin Azzi du musée des collectionneurs, que certains appellent déjà les dents. Car en mauvaise journaliste que je suis c’est bien évidemment un véritable dialogue de sourds avec les « médiatrices du projet » post scriptumque j’ai mené, tout en perdant mon calme. Il faut dire que citer Jean-Jacques Aillagon ancien ministre de la culture et de la communication sous le gouvernement Raffarin, aujourd’hui conseiller de la Compagnie Phalsbourg, était le faux pas que j’attendais. Pourquoi tant d’effusions?
Tout d’abord parce qu’entonner le couplet de la « réussite architecturale » d’un centre culturel pluridisciplinaire aujourd’hui éminent dans le paysage français (et parisien) ne permet en aucun cas de justifier les nouveaux projets architecturaux d’équipements culturels qui interpellent le public. En effet le cas de l’édifice qui comprend le musée national d’art moderne et contemporain est unique.
Bien qu’évidemment si l’on se fait l’avocat du diable des points communs peuvent être établis :
- Un concours architectural novateur.
- Un bâtiment pluriel
- Et surtout une volonté similaire à celle du président Pompidou qui avait l’ambition de « doter Paris d’un ensemble architectural et urbain qui marque notre époque ».
ci il s’agit davantage de marquer un territoire. Stephan Holl l’explique de cette manière dans une vidéo réalisée avant que le jury ne statue sur les différents projets :« Nous sommes convaincus que le site front de Maine pourra accueillir un équipement grandiose et iconique participant au rayonnement d’Angers tant en Europe qu’à l’international »[5].
Enfin bien sûr l’apparence du Centre George Pompidou fut qualifiée dès la présentation des architectes Renzo Piano Gianfranco Franchini et Richard Rogers (dont le projet a été retenu en 1971) par « tous les sobriquets. « Pompidoleum», «Hangar de l'art» ou «Raffinerie culturelle» sont quelques-uns des noms d'oiseaux dont le bâtiment est affublé. »[6]
Mais, tout d’abord, nous sommes loin de cette ampleur en termes de rejet[7] et de créativité pour qualifier le projet de la compagnie Phalsbourg. Ensuite, bien évidemment, la logique et la facilité nous poussent à rejeter l’aspect visuel du bâtiment. La nouveauté effraie certains autant qu’elle peut en fasciner d’autres. Toutefois, est-ce pour autant la peine d’évoquer le modèle du Centre George Pompidou pour stopper toute réaction un tantinet négative sur l’apparence prévue pour le front de Maine ?
N’oublions pas non plus le rôle de l'architecte des Bâtiments de France, Gabriel Turquet de Beauregard qui veille à la bonne insertion des constructions neuves aux abords des monuments protégés. Dans le cas présent « il se montre plus réservé. Il ne voulait pas de concurrence avec le château. Selon lui, les dessins de Steven Holl ne sont pas encore définitifs et restent « à préciser », les teintes et les formes notamment. »[8]
Pour ma part je n’ai rien contre ces incisives géantes !
Et pourtant pour me convaincre de l’intérêt du musée des collectionneurs, il me faudra bien au moins un texte de Jean d’Ormesson ! Je fais allusion à son éditorial du 31 janvier 1977 dans Le Figaro où il transcrit ce fameux état d’esprit collectif au sujet du Centre Pompidou : « C’est atroce. On dirait une usine, un paquebot, une raffinerie. Une espèce d'écorché monstrueux et multicolore, avec ses tripes à l’air » avant d’en faire son plaidoyer[9].
Si l’on se propose de faire l’inverse, nous débuterions par un « c’est étonnant ! On dirait une belle roche immaculée, un jeu d’osselet monumental, une famille d’icebergs. Une espèce de monolithe lisse et blanc, avec ses reflets miroitants. ». Puis nous saluerions le cheminement de pensée des créateurs basée sur le château d’Angers, et la tapisserie de l’Apocalypse qui se trouve en face, c’est donc une structure à la fois complètement différente de son environnement tout en étant complémentaire.
A la clef, 5 grands concepts que voici en image :
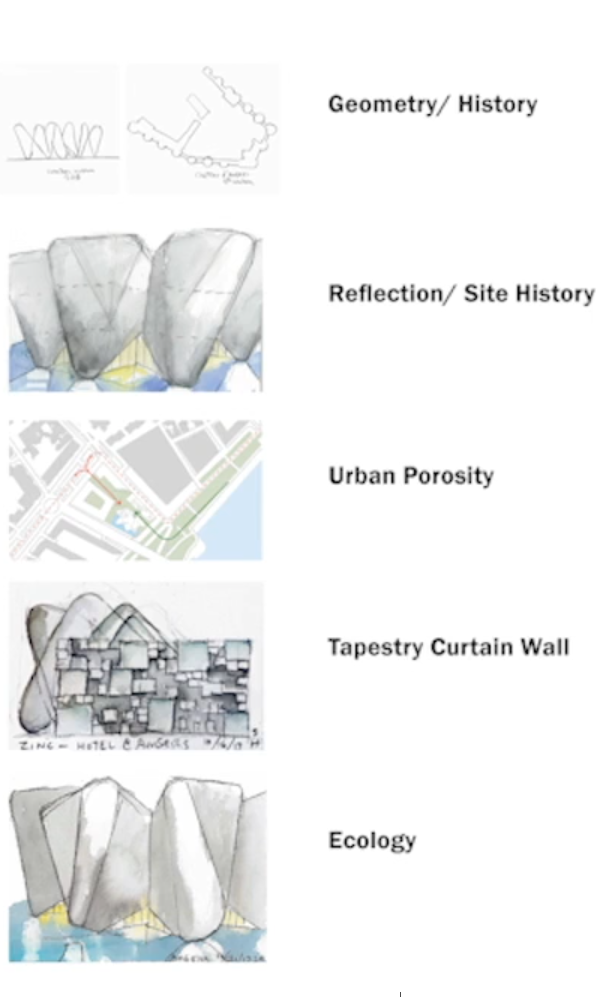
A mon sens on peut admirer le travail d’un architecte de la même manière qu’une œuvre d’art, sans parler de son utilité. Néanmoins, utilité il y a, à qui s’adresse cette offre du futur front de Maine ?
Des nouveaux logements et services pour la Doutre, ce quartier d’Angers qui était très populaire jusque dans les années 80, est aujourd’hui très prisé notamment pour le cachet des vieilles maisons et le calme qui y règne. Ces 145 logements participeront à la gentrification de cette zone urbaine en offrant des logements modernes avec un tout autre cachet.

Vue d'intérieur d'un logement, source site Imagine Angers
L’hôtel 4* étoiles à vocation touristique ajoute une couche supplémentaire de luxe au projet. Certes le complexe architectural propose ses espaces de co-working ce qui apporte l’aspect chaleureux et inclusif à ce projet urbain. En dépit d’un travail conduit pour dédier cet espace au domaine artistique via une recherche des besoins sur le site internet myprofileart qui regroupe 900 artistes angevins, les futurs habitants sont supposés être de jeunes actifs, start-uppers….
S’il faut développer une offre sur le territoire angevin pour cette catégorie de population, on peut néanmoins regretter que le projet n’intègre pas plus de mixité sociale. Certaines interventions de la conférence publiques font écho : une dame souleva, une phrase émise par Phillipe Journo[10] directeur et seul actionnaire de la Compagnie de Phalsbourg, sur le sentiment de réussite qu’auront les futurs habitants de cette résidence du quartier des collectionneurs. Qu’il réponde qu’il ne pensait pas à polémiquer avec cette formulation mais juste à présenter leur philosophie ne satisfait pas. S’il expliqua penser aux gens, sans être hors sol mais bien ancré dans la vraie vie, son interlocutrice répliqua que la vraie vie ce n’est pas que la consommation et habiter dans des appartements luxueux. A cela, il acquiesça, le modérateur en profita pour introduire : « d’où le musée ».
Cette inconnue de la conférence se dit sceptique : « Qu’est-ce qu’un musée des collectionneurs ? ». Effectivement, ce concept est à interroger. En voici sa description officielle[11] :« ce musée unique au monde sera dédié aux collectionneurs qui pourront exposer au grand public leurs œuvres inestimables accumulées pendant leur vie. ».
Tout est dit. Cet équipement servira davantage les collectionneurs et sans doute par la même occasion leurs égos. De cette manière, ils auront peut-être le sentiment d’avoir réussi ou d’être philanthropes en exposant aux publics démunis de « l’art » leurs patrimoines. Et puis quel grand public espère-t-on ? L’accessibilité n’est ici qu’un mirage. Il semble évident que les publics que l’on retrouvera dans cet espace « White cube » ne sera guère différents de ceux avides de l’offre culturelle, voir ceux qui collectionnent des œuvres d’arts. De plus si l’on se fie à la définition du musée de l’ICOM et à celle de la loi musée 2002[12], l’utilisation du terme musée est ici un abus de langage. Ce modèle se rapproche en effet plus du Centre d’art, puisqu’il n’y aura aucune collection propre à l’établissement. Le fonctionnement de ce système d’exposition reste d’ailleurs très obscur. Un comité scientifique semble avoir pris forme autour de la personne de Jean-Jacques Aillagon. D’après la presse, il aurait même l’idée d’appeler la 1ere exposition : « Apocalypse Now » en hommage à la tapisserie conservée au Chateau et au film de F. F. Coppola.
Ce projet, P. Journo souhaite qu’il comble le problème que très peu d’individus sont en mesure de se créer un musée pour montrer leur passion. Selon une élue angevine[13] un doute existe quant à la possibilité d’exposer en étant un collectionneur local. La stature de l’ancien ministre, féru d’art contemporain[14] n’engage pas dans cette direction.
Le projet de société Phalsbourg pour le musée des collectionneurs à Angers
Finalement ce système d’exposition qui promet des œuvres venant du monde « dentier »[15]servira plus à installer Angers comme destination d’un certain type de tourisme basé sur le star-system grâce à la renommée des architectes et des possibles œuvres que l’on y trouvera. Par ailleurs, l’idée que Angers soit la 1ère ville d’un possible « réseau mondial de musées des Collectionneurs. » n’a pu que séduire les personnes en charge de sélectionner les lauréats de Imagine Angers.
Sur ce point, M. Béchu maire de la ville, explique « on n’a pas signé un permis de construire, on a adhéré à une vision ». A cette même conférence, peu de temps avant, P. Journo expliquait que le rayonnement d’une ville relevait d’un collectif, qui commence par les élus qui doivent donner la vision, et continue par les opérateurs privés qui doivent la réaliser.
Or, ce projet d’innovation urbaine en ce qui concerne la partie musée n’est pas issue d’une réflexion municipale sur sa politique culturelle ou touristique mais bien un effet d’opportunité, profitant de l’expertise d’un promoteur immobilier. Je ne critique pas la société Phalsbourg qui se voit développer un projet singulier dans un environnement qui lui semble cher. Je réagis à cette privatisation de l’offre muséal, où aucun projet scientifique et culturel n’est établi, où l’on ne sait pas quelle politique des publics sera menée, ni même les orientations scientifiques du futur musée.
Tout cela alors qu’une offre existe et que des effets de concurrence peuvent être en jeu. Ainsi le musée des beaux-arts a clôturé en mars 2018 l’exposition « Collectionner, un désir inachevé » qui présentait au public 5 collections particulières[16]. Le musée d’histoire naturelle a lui, besoin d’une rénovation des espaces. A l’inverse le musée Pincé a été complétement restauré, le chantier des collections est toujours en cours et l’on ne sait guère ce qui va advenir ensuite. Ajoutons qu’un Centre d’art contemporain pensé pour reconvertir la maison d’arrêt après sa fermeture était une des propositions électorales de C. Béchu. Sachant que le déménagement de la maison d’arrêt est retardé, est-ce que le musée des collectionneurs va prendre le pas sur cette ancienne ambition ?
En tant qu’étudiante je me prépare à m’insérer dans le monde professionnel de la culture. J’aimerais évidemment participer dans un futur aussi proche que possible à la construction d’un musée. Pourtant ce projet de musée des collectionneurs dans ma ville natale que certains voient comme une chance est très loin de mon idéal.
Il correspond à ce « retour du collectionneur » évoqué par A.Gob et N.Drouguet[17] , évolution à rebours (une limite nette existe entre musée et collection privé depuis la fin du XVIIIème siècle) pratiqué par de nombreux musées européens dont le Museo Carmen Thyssen Malaga. Le projet muséologique de ce musée a été élaboré par la directrice scientifique après l’ouverture du musée. Espérons que le musée des collectionneurs lui ne se cassera pas les dents lorsqu’il s’agira de mettre en place un projet muséologique cohérent. Même si cela semble mal parti, qui-sait, rendez-vous dans 10 ans comme le dit Phillipe Journo. Il s’agira peut-être des dents du bonheur de la Ville...
Julie Davasse
Post scriptum
Nous pouvons nuancer notre propos, la municipalité a en effet la capacité de faire force de proposition en matière d’équipement culturel. suite à la publication le 15 mai 2018, d’un article Le Courrier de l’Ouest:
« L'ancien restaurant universitaire de l'école des Beaux-arts, installé dans le jardin du musée, va devenir un espace municipal culturel. [...] Les lieux, désertés depuis juin 2015, ont été rachetés par la Ville qui compte faire une opération blanche en y relogeant plusieurs services (archives municipales, service d'art et d'histoire...) et en revendant certains bâtiments ainsi libérés. En plus des services de la ville, ce bâtiment des années cinquante accueillera des expositions permanentes et temporaires sur le patrimoine, une salle pour l'art contemporain et un espace de résidence d'artistes. ».
http://m.courrierdelouest.fr/actualite/angers-lancien-resto-universitaire-transforme-en-espace-culturel-15-05-2018-359545?utm_source=rss_co&utm_medium=rss&utm_campaign=co_maine-et-loire [1]https://www.la-croix.com/Debats/Ce-jour-la/31-janvier-1977-Centre-Pompidou-tant-decrie-inaugure-2017-01-29-1200820789
[2] http://imagine.angers.fr/
[3] Oups vous ne connaissiez pas tous les méandres du bâtiment ! Pour me faire pardonner je vous incite à regarder un dessin animé sur le sujet ici!
[4] Idem à 2 http://imagine.angers.fr/[5] Extrait du doublage français de l’architecte qui s’exprime en anglais
[6] Centre Pompidou : les trois points qui fâchaient lors de la création, Par Camille Lestienne Mis à jour le 23/01/2017 à 12:20 Publié le 20/01/2017 à 18:14 sur le figaro.fr Histoire. Consulté le 31/04/18. http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/01/20/26010-20170120ARTFIG00271-centre-pompidou-les-3-points-qui-fachaient.php[7] Pour aller plus loin dans la controverse sur le Centre George Pompidou http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2017/01/23/tv-l-histoire-controversee-du-centre-beaubourg_5067792_1655027.html[8] « A Angers, l’architecte Steven Holl défie Blanche de Castille » LE MONDE | 29.03.2018 à 08h49 • Mis à jour le 29.03.2018 à 09h18 | Par Yves Tréca-Durand (Angers, correspondant)
[9] Cet éditorial a été republié par le Figaro Histoire, à l’occasion de l’ouverture du Centre Pompidou à Malaga (Espagne). Par Sophie Guerrier Mis à jour le 02/04/2015 à 17:19 Publié le 27/03/2015 à 18:29. http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2015/03/27/26010-20150327ARTFIG00315-inauguration-du-centre-pompidou-paris-1977-malaga-2015.php[10] Également 62ème fortune française selon le classement challenges de 2017. Ce n’est pas nouveau pour la Compagnie et lui-même de se lancer dans des projets artistiques et culturels. Il est effectivement propriétaire du théâtre Bobino, l’un des mécènes de l’Ecole Nationale des Beaux-arts de Paris (financement de la rénovation des façades de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, quai Malaquais à Paris et de leur mise en lumière), du Centre Pompidou Metz (soutien à diverses expositions) et de l’Opéra de Paris (co-financement de « 10 mois d’École et d’Opéra » et restauration de la Ceinture de Lumière). Source :http://www.club-innovation-culture.fr/angers-premier-musee-des-collectionneurs-monde/
[11] Issue du site Imagine Angers et présente dans les communications de l’entrepreneur et des architectes.
[12] Article 1er : « Est considérée comme musée, au sens de la présente loi, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l’éducation et du plaisir du public. »
[13] Rachel Capron élue de l’opposition interrogée par mes soins au téléphone sur le sujet.
[14] Il fut également à la tête du musée et domaine de Versailles, l’exposition Jeff Koons est par exemple de son initiative il collabore également avec d’autres musées et conseille F.Pinault pour la mise en place de sa fondation.
[15] Encore un jeu de mots pardonnez-moi
[16] Collections présentées : association PACA (Présence de l’art contemporain-Angers), collection Philippe Méaille, collection Fondation La Roche Jacquelin, collection Alain Le Provost, collection particulière.
[17] La Muséologie, histoire, développements, enjeux actuels. André Gob, Noémie Drouguet 4ème éditions Armand Colin, 2014
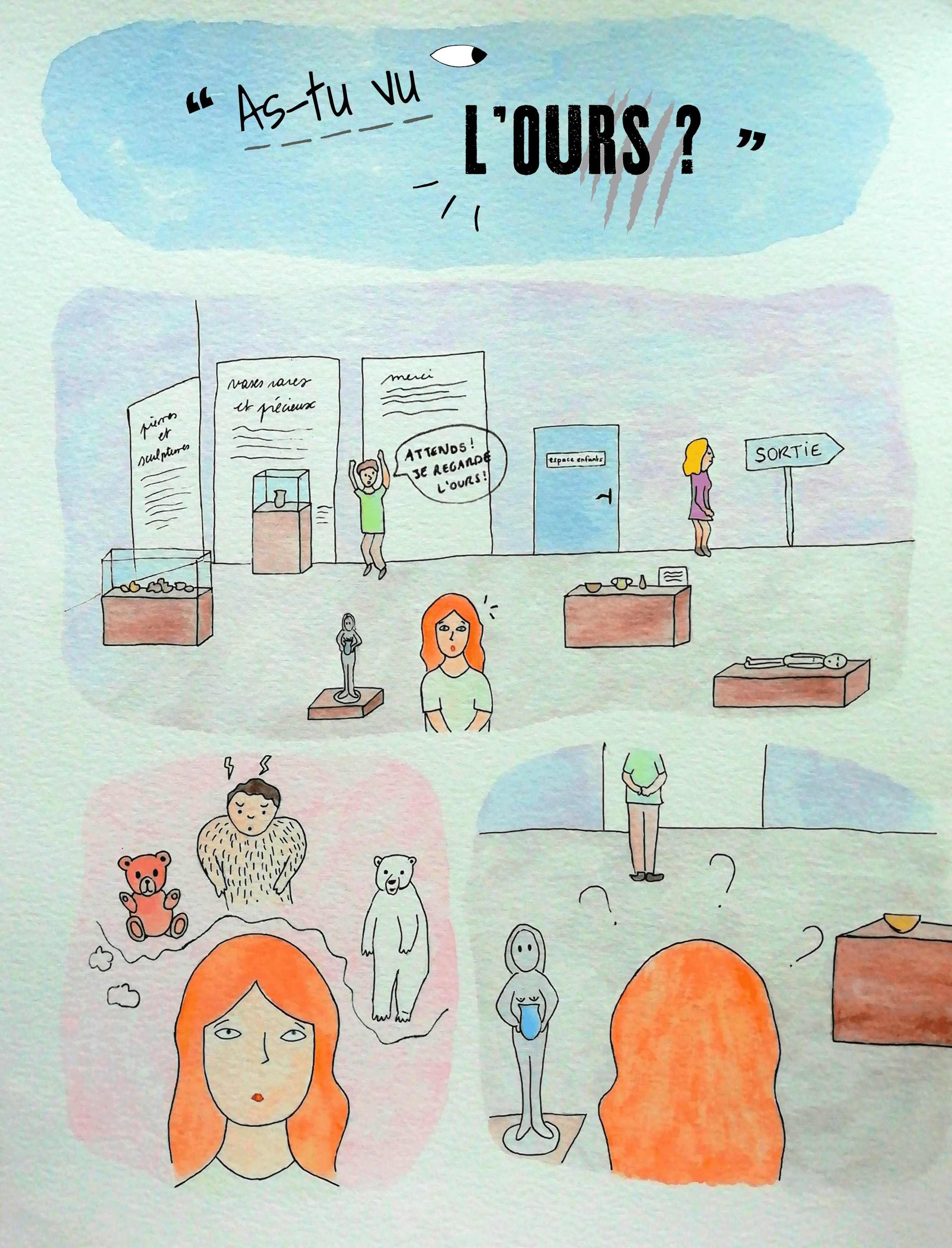
As-tu vu l'ours ?
- Grand mammifère plantigrade de la famille des Ursidés, à fourrure épaisse, le plus souvent carnivore.
- Fig. et fam. Homme solitaire, qui fuit la société. Un ours mal léché, un homme bourru, aux manières rudes.
- PRESSE. Fam. Liste des responsables d’un journal ou d’une revue, qui doit légalement figurer dans chaque numéro.
© Académie française, 2019
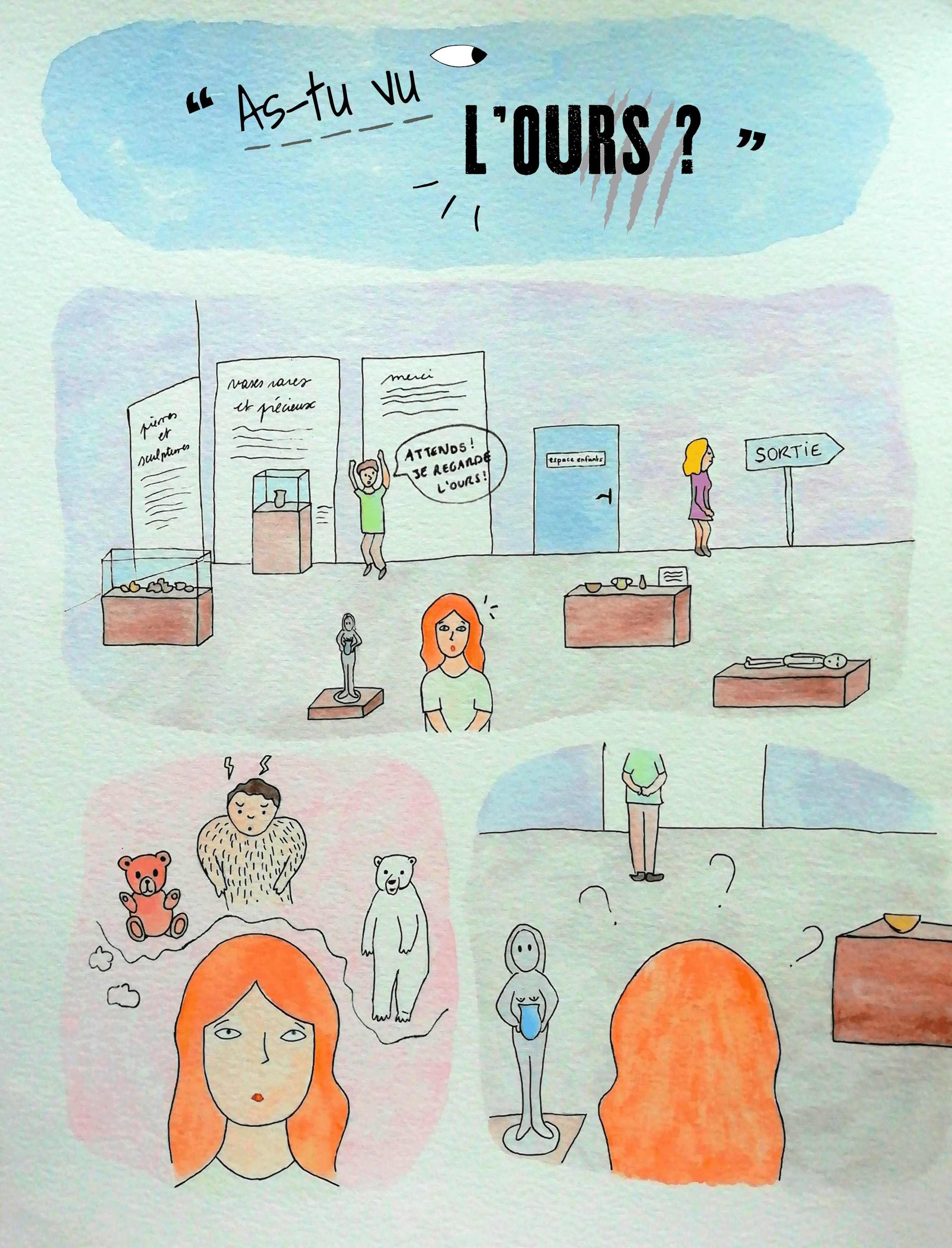
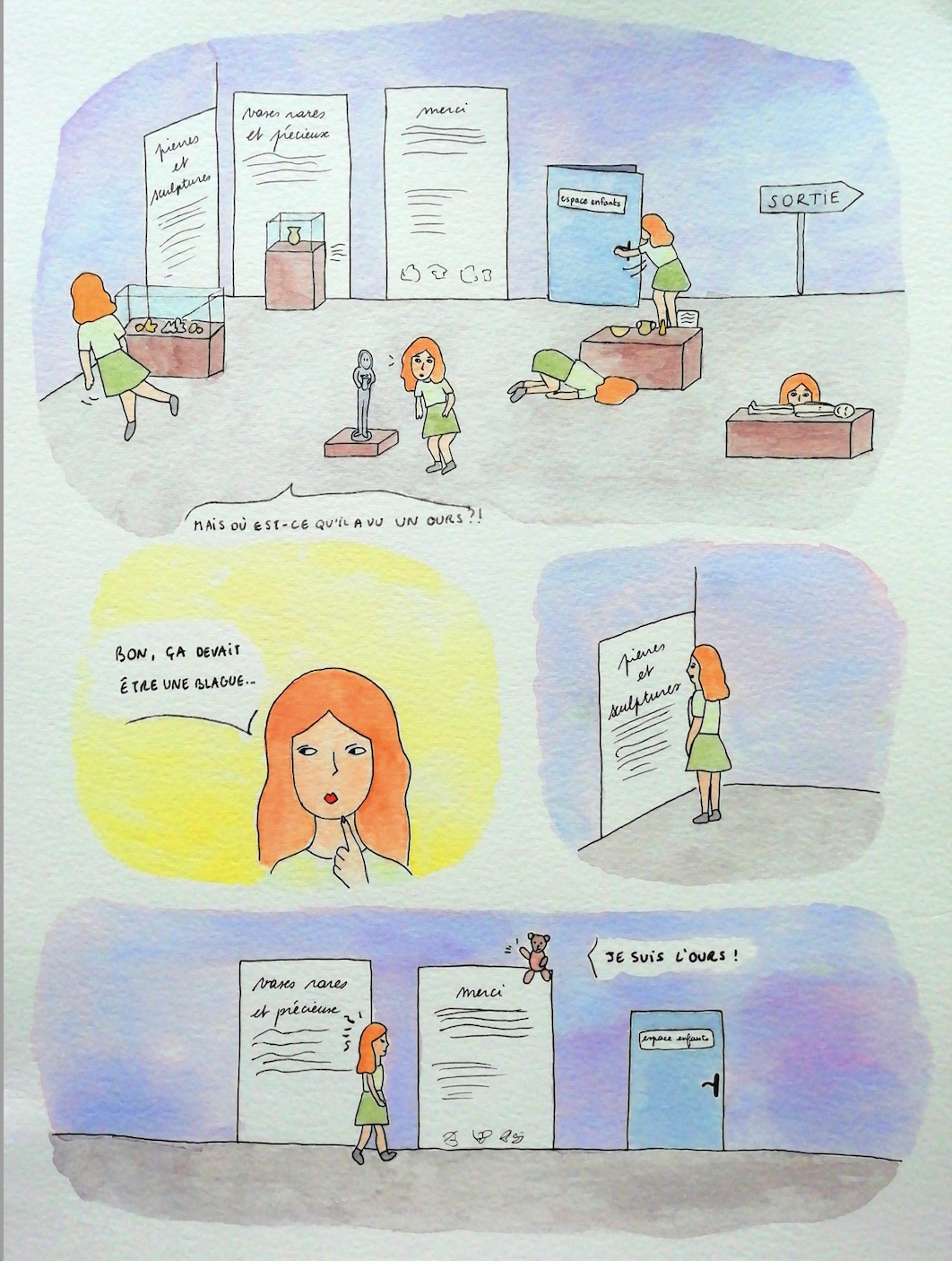

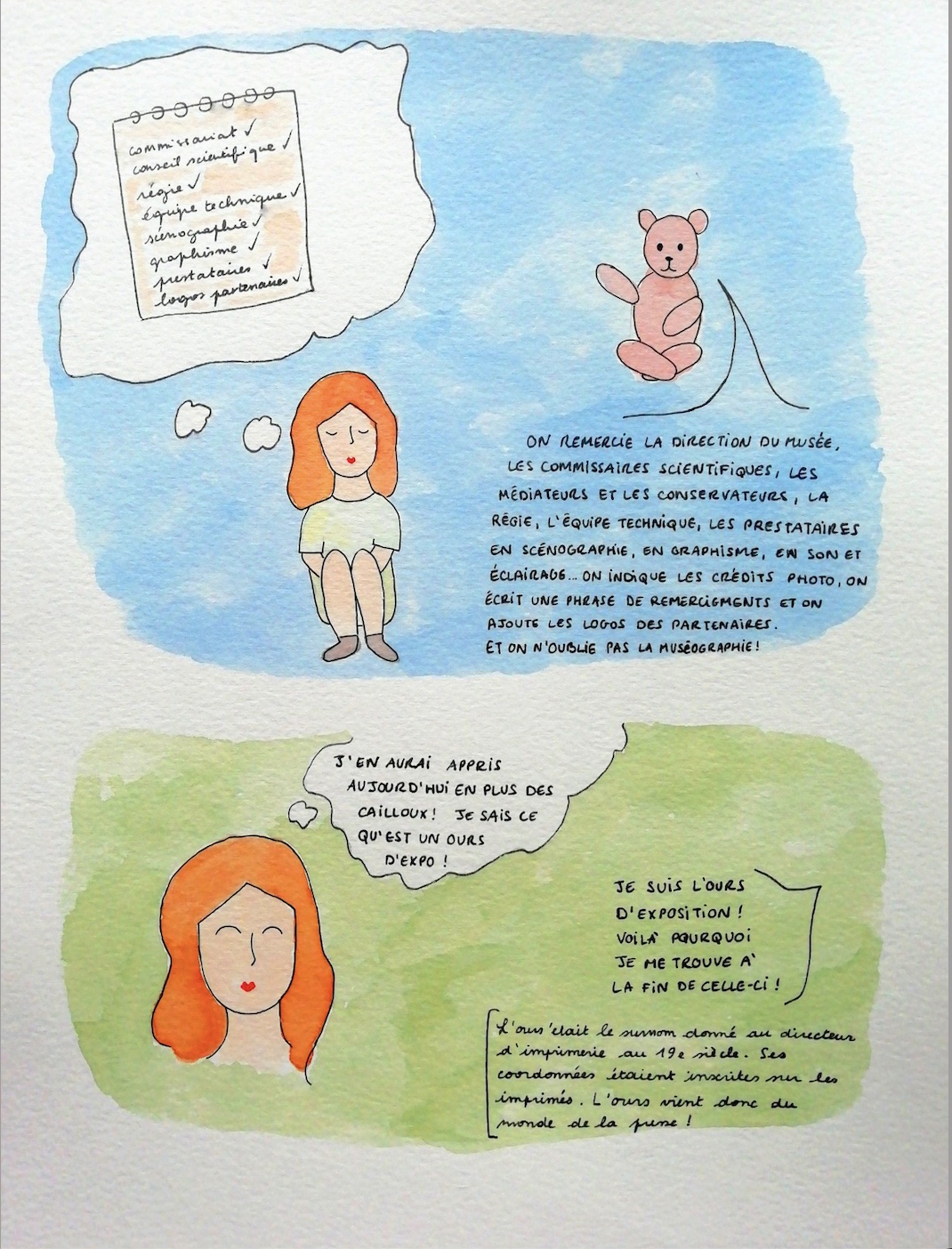
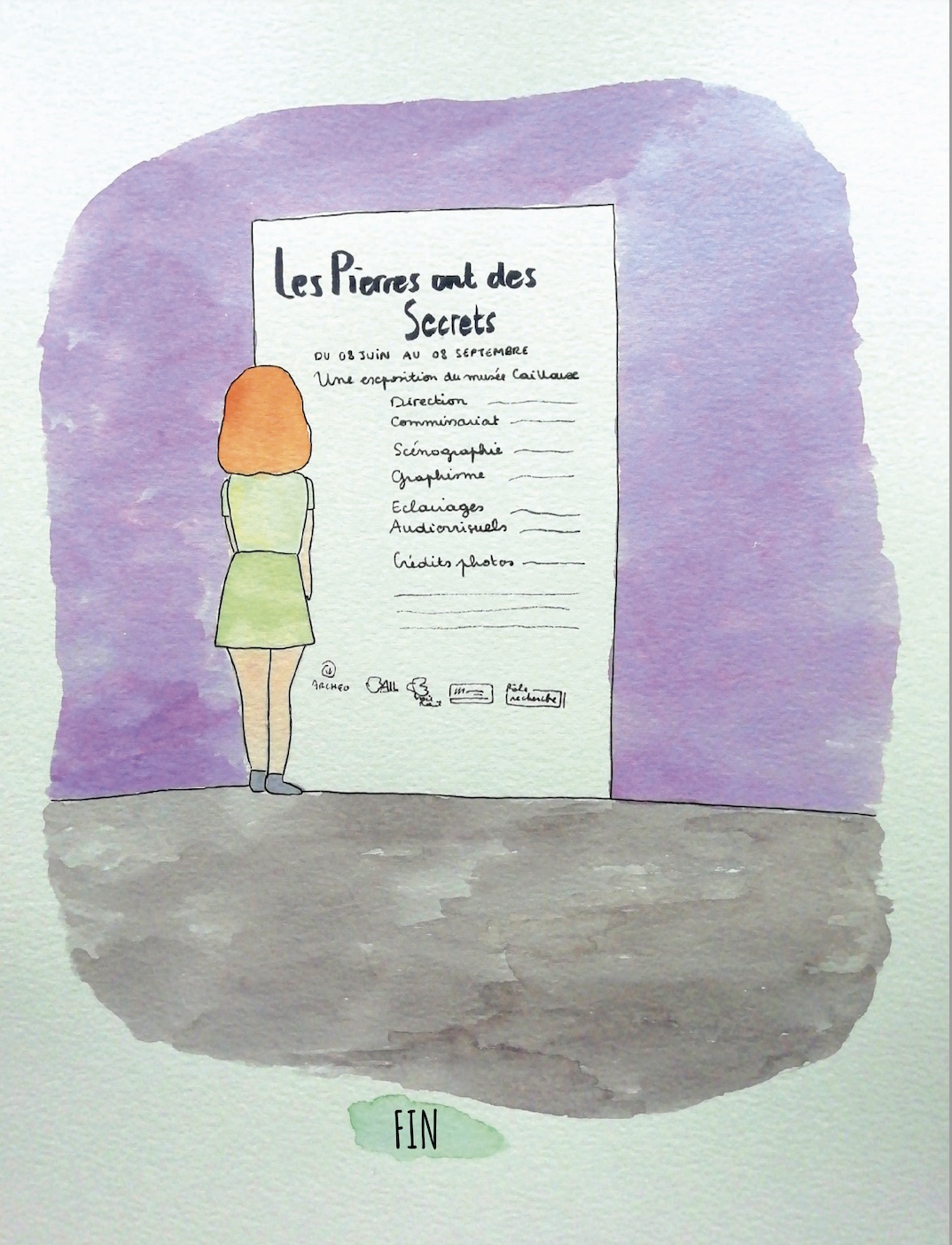
L.L
#oursdexposition
#remerciements
#museographie

Bienvenue au musée ?
Cela fait longtemps que les politiques publiques œuvrent à la « démocratisation culturelle », mais que signifie la notion d’élargissement de l’accès aux musées ? Comment est-on accueilli en ces lieux et quels sentiments éprouvent les visiteurs inaccoutumés ? Le musée pour tous ? Un rêve bien difficile à réaliser.
Image d'intro : © Doriane Blin
Délocaliser la culture et la rendre accessible à chacun, l’exemple du Louvre-Lens
Élargir l’accès des musées se traduit souvent par la notion de délocalisation. Si décentraliser les collections de la capitale sur un territoire provincial n’est pas nouveau, la création du Louvre-Lens en est un bon exemple contemporain. L’architecture, certes bien différente de celle du Louvre de Paris, lui emprunte pourtant l’idée d’ampleur (210 000 mètres carrés pour le Louvre-Paris contre 28 000 pour le Louvre-Lens, certes). Le bâtiment du Louvre-Paris est en U, celui du Louvre-Lens devient métaphore - vue du ciel - de la culture prenant son envol, déployant ses ailes et s’ouvrant aux publics. Par ailleurs, il est à noter que la Galerie du Temps, espace d’exposition permanent, ouvre ses portes gratuitement. Il importe de prendre en considération ce facteur : une mesure à saluer quand nous évoquons l’accès de chacun.
Cette structure décentralisée du Louvre-Paris pourrait offrir aux habitants du territoire un accès idéal à la culture, mais qu’en est-il vraiment ? Le lieu même d’implantation du site est sujet à controverses. En effet, son édification a engendré la destruction de l’ancienne salle des pendus, symbole fort de la culture minière. Il est donc légitime de s’interroger quant aux effets et à la réception d’un tel projet sur le territoire. Donner à lire, à voir, à contempler les grandes œuvres composant les collections de cette institution reste en soi une opportunité pour les Lensois mais ne doit, pour autant, abroger le patrimoine culturel local. Comment associer « culture pour tous » et « culture de tous » ? Accueillir cette antenne du Louvre à Lens a donc suscité diverses réactions : entre sentiment que l’on fait fi de la culture ouvrière et fierté d’héberger des collections emblématiques.
Enfin, le projet architectural avait pour vocation de permettre aux passants de traverser le bâtiment librement, ce dernier possédant trois entrées, toutes diamétralement opposées. Cette volonté de libre circulation semble utopique puisque l’instauration de dispositifs de contrôle à chaque porte du bâti dissuade le chaland. A tout le moins peut-il traverser le jardin, qui lui s’épanouit, après 10 cycles de saisons.
Faire ses premiers pas au musée
Si l’objectif initial est de permettre aux inaccoutumés de jouir des trésors artistiques des collections et les enjoindre à franchir les portes du musée, l’entrée même dans les lieux n’est pas une ode à l’ouverture ni synonyme d’accueil chaleureux. En arrivant, le visiteur peut ironiquement se demander s’il vient visiter un musée ou prendre un vol Paris-Tokyo. Après avoir déposé son sac sur le tapis, il faut passer sous les portiques de sécurité. Vert : le visiteur peut circuler. Rouge : il faut se soumettre à une fouille. Nous pénétrons enfin le lieu et allons acheter notre billet pour le présenter à l’entrée de l’exposition. Nous avons franchi toutes les étapes des contrôles de sécurité et avons le droit de déambuler à l’intérieur de l’espace de visite.
Photographie des portiques de sécurité à l’entrée « Loos-en-Gohelle » du Louvre-Lens © Mélanie Terrière
De tels dispositifs n’étaient pas présents il y a quelques années. Suite aux attentats de 2015 et 2016, des mesures préventives sont décidées par le gouvernement pour les administrations publiques. Ainsi, s’accentue le plan Vigipirate : les portiques de sécurité s’imposent à l'entrée de certains musées, sur décision préfectorale. La Voix du Nord évoque un renforcement des contrôles pour « les grands musées de la métropole » lilloise. Ce renforcement se traduit différemment selon les institutions : installations de portiques pour les uns, refus des bagages volumineux ou augmentation de la surveillance dans certaines zones du musée pour d’autres. Précisons cependant que la Piscine de Roubaix a fait appel à ces mesures peu avant l’ouverture de son exposition Camille Claudel, avant même les attentats.
L’article « Zoom métier : la sécurité dans les musées » (Emmanuel Decoupigny interrogé par Chloé M.) nous laisse entrevoir la complexité inhérente à la mise en place de ces dispositifs : « Cela a nécessité la réécriture du règlement de visite […]. Il a également été nécessaire de former [les agents] à ces procédures (comment accueillir un visiteur, comment lui demander d’ouvrir son sac, qu’a-t-on le droit de faire, de ne pas faire, où se limitent nos interventions…). Dès lors sont consultables, sur les sites internet de certains musées, les règles en vigueur telles que « tous les visiteurs feront l’objet d’un passage sous portique de sécurité, ou à défaut au magnétomètre. Le refus de se conformer à ces dispositions entraine l’interdiction d’accès et l’éviction immédiate du musée ».
Prenons en exemple quelques statistiques de fréquentation expliquant peut-être l’instauration de ces dispositifs dans certains musées des Hauts-de-France. En 2019, le Louvre-Lens comptabilisait plus de 500 000 visiteurs. Pour le Palais des Beaux-Arts de Lille et la Piscine de Roubaix, les chiffres avoisinaient les 300 000 entrées. Enfin, le nombre de visiteurs du LaM (musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut) s’élevait à 200 000. Ces institutions présentent toutes une fréquentation élevée.
Photographie des portiques de sécurité à l’entrée de la Piscine de Roubaix © Doriane Blin
Les interdits
Aller au musée peut être synonyme de plaisir, connaissances, détente, ennui, délectation... Chacun est libre de l’envisager différemment, mais l’expérience proposée répond à certaines règles de bienséance. Des ribambelles d’interdictions nous accueillent en ces lieux. L’article de Julien Baldacchino publié sur le site de France Inter en répertorie certaines assez loufoques, telles que « Ne pas porter ses affaires sur le bras », « Ne pas avoir de stylo », « Ne pas porter de chapeau », « Ne pas photographier l’extincteur » entre autres. Certaines semblent évidentes puisque répondent à des impératifs de conservation des œuvres et de respect des lieux publics. Pour d’autres, il est plus difficile de comprendre leur fondement. Seulement, les règles sont les règles.
Les lignes bougent, doucement mais sûrement. A titre d’exemple, la photographie au musée a longtemps été décriée mais est désormais tolérée. Ensuite, certaines institutions usent d’humour pour informer des comportements inadéquats, comme placer un petit chardon sur les sièges afin de dissuader le visiteur de s’y asseoir. Preuve que des alternatives émergent… La façon d’énoncer les interdictions a donc son importance pour le ressenti du visiteur. Aussi, il est possible de prendre les règles à revers : plutôt afficher ce qui est autorisé au détriment de ce qui est prohibé.
Là où les devoirs des visiteurs de musée sont bien connus, leurs droits sont souvent bien plus invisibilisés voire « inexistants » (voir à ce sujet l’ouvrage de Bernard Hennebert, Les musées aiment-ils le public ?).

Illustration extraite de la première de couverture du livre de François Hennebert, Les musées aiment-ils le public ? © Couleurs livres
Une visite de musée est donc régie par des codes sociaux. Ces façons-de-faire convenues peuvent rapidement se transformer en contraintes et décourager certains de passer les portes des dites institutions. « Le visiteur nouveau apprend de la simple présence du visiteur expérimenté, il adapte son comportement, baisse la voix […]. » (Claude Fourteau, « Faire vivre la gratuité », La Lettre de l’Ocim, septembre-octobre 2015). Visiter un musée est donc bel et bien un apprentissage de normes tacites. Ne pas se conformer aux attentes implicites voire injonctions de bonne conduite peut mettre mal à l’aise le visiteur.
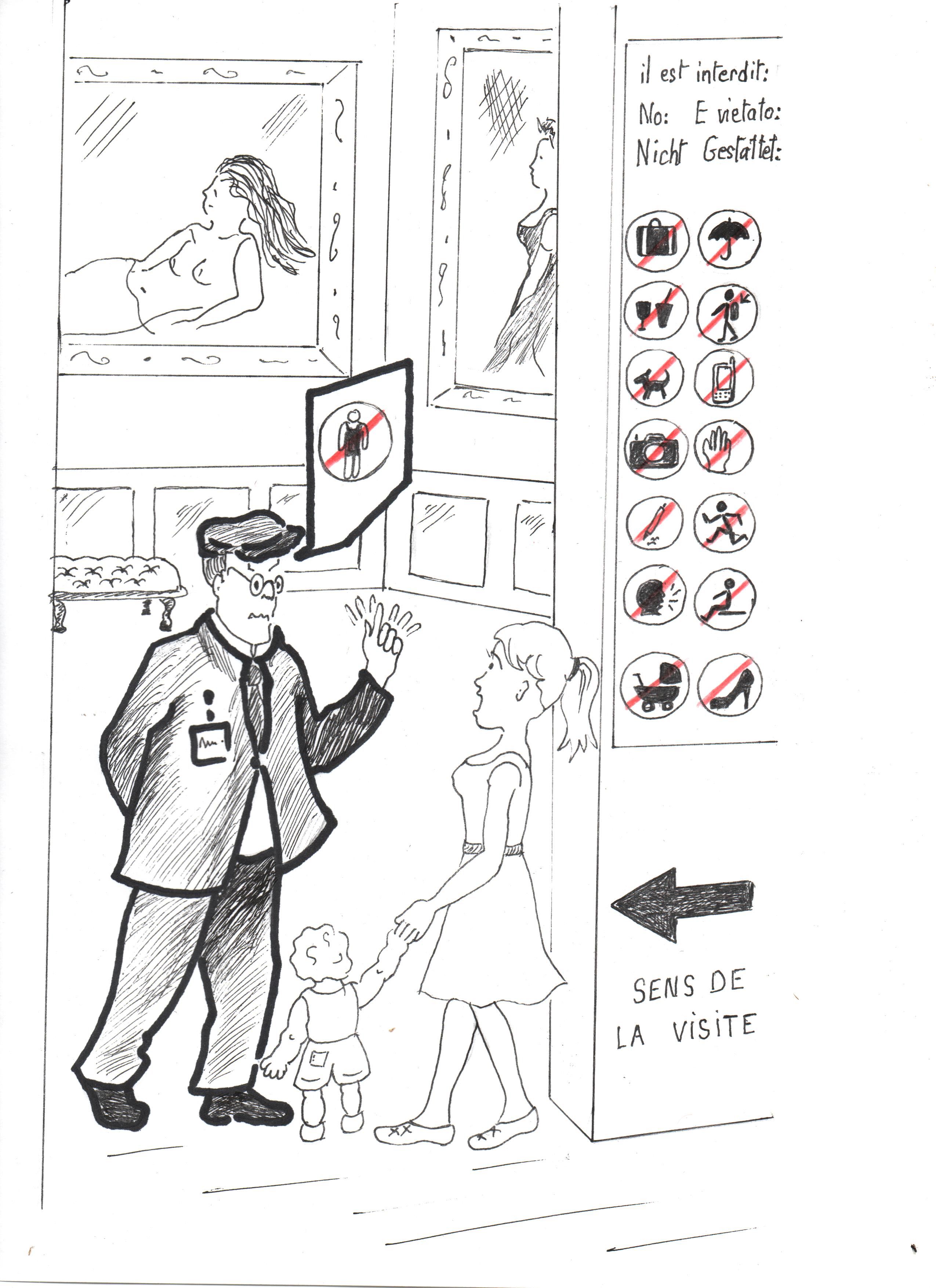
Dessin caricatural, Un musée, une découverte, une rencontre ! © Sandrine Porcher
« Nous apprenons à certains visiteurs à se comporter correctement dans un musée ; ce qui n'est effectivement pas forcément un acquis pour tout le monde, et c'est tout à fait normal. Le rapport d'une personne au musée ne se construit pas en quelques heures. » (Kristel Barriou interrogée par Olivier Soichot, « Nous régulons le rapport au musée », La Lettre de l’Ocim, janvier 2015).
Regard réprobateur du gardien ou des autres usagers du lieu, comment trouver sa place au musée si nous affichons un comportement trop peu normé ? Se départir de ces règles n’est pas chose aisée.
Entre accueil, médiation et surveillance
Sous le titre de « surveillant de musées » se cache souvent plusieurs réalités.
L’article « A l’ombre des musées : les agent.es vacataires », témoigne du vécu de deux agents. Leurs dires décrivent bien la figure complexe qu’ils incarnent au sein de ces institutions : « Du côté du public, très nombreux sur mon site, l’absence d’informations, la foule ou l’attente échauffaient les esprits. […] Pas facile d’expliquer à des personnes qu’elles ne peuvent rentrer […] : certaines sont juste déçues, d’autres s’emportent... ». Cet extrait montre combien il est difficile d’adopter l’attitude adéquate : entre règles, respect des jauges autorisées et accueil souriant, c’est un jeu d’équilibriste.
De même, les politiques tarifaires permettant un accueil élargi des publics n’est pas toujours la solution si l’on veut préserver l’expérience des visiteurs : « Dans le musée où j’ai travaillé, il pratiquait la gratuité les premiers dimanches du mois, cela attirait évidemment beaucoup de monde, engendrant, le plus souvent, quelques situations tendues. ». Dans leurs récits, sont aussi présents les missions de contrôle de sacs, de tickets et le regret concernant le manque de médiation : « De mon expérience, je pense que les gardien·nes de salle, les surveillant·es, … peuvent être une première ligne de médiation, souvent sous-estimée ».
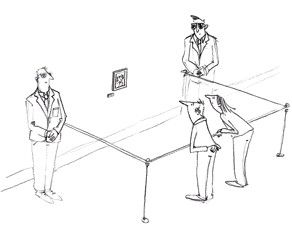
Illustration extraite de l’article « Gratuité des musées et valeur perçue par les publics », D. Bourgeon-Renault, A. Gombault, M. Le Gall-Ely, C. Petr et C. Urbain, La Lettre de l’Ocim, n°111, 2007 © Coline Desclide
Entre les lignes, se dessine la complexité des rôles de surveillant et de surveillé. En théorie, les musées sont ouverts à tous. En pratique, trouver sa place au musée et se sentir légitime d’y déambuler n’est pas si évident. De l’accueil à la sortie, en passant par l’espace d’exposition, nos comportements et déplacements sont régulés et minutieusement inspectés.
Enfin, l’entretien de Kristel Barriou publié dans La Lettre de l’OCIM, dont nous avons déjà cité les propos, montre bien ces enjeux. K. Barriou évoque tantôt la nécessité de faire des rappels aux règlements à certains visiteurs, qui parfois ont des réactions défensives (culpabilité, malaise…), tantôt l’indispensable esprit de confiance dans lequel doit se trouver le public pour apprécier sa visite. Accueillir et surveiller, les métiers du gardien de musée par François Mairesse et Anne Monjaret met en lumière les innombrables facettes et profils très divers de cette profession bien souvent méconnue et stéréotypée ou même méprisée.
Le musée pour TOUS ?
Les différentes pistes de réflexion évoquées ci-dessus invitent à penser la complexité inhérente au souhait d’accessibilité universelle des musées. De ce petit tour d’horizon, ressort une dissonance entre discours et terrain.
Nombreuses sont les initiatives et projets pour démocratiser la culture se confrontant à des contradictions empiriques telles qu’abordées en début d’article. Plus discrets et bien distincts, nous avons mentionné d’autres aspects se révélant parfois dissuasifs pour le visiteur de pénétrer les lieux. En effet, les enjeux propres à la sécurité présentent quelques antagonismes avec le terme « d’ouverture » souvent employé. Interdits et codes sociaux s’ajoutant, la possibilité d’appropriation des lieux par le public s’amenuise. Kritel Barriou, surveillante au Louvre, qualifie son rôle au sein de l’institution : « nous régulons le rapport au musée », citation éponyme du titre de l’article publiée dans La lettre de l’OCIM. Ainsi, il existe bel et bien des freins au rêve du « musée pour tous ». Si le tarif d’entrée est une donnée majeure d’accessibilité, il n’est donc pas la seule entrave à leurs abords.
Enfin, il semble difficile de conclure sans évoquer succinctement le nouveau dispositif de contrôle d’accès aux musées : la présentation d’un pass sanitaire. Si les politiques publiques souhaitent une culture accessible à tous et prônent une ouverture la plus large possible de ces dits lieux à chacun, elles restreignent désormais leur accès à une partie de la population. Le paradoxe interroge…
Pour aller plus loin :
- Kristel Barriou interrogée par Olivier Soichot, « Nous régulons le rapport au musée », La Lettre de l’Ocim, n°151, janvier 2015
- Manon Deboes et Marco Zanni, « A l’ombre des musées : les agents vacataires », L’art de muser
- Claude Fourteau, « Faire vivre la gratuité dans les musées », La Lettre de l’Ocim, n°161, septembre-octobre 2015
- Bernard Hennebert, Les musées aiment-ils le public ?, Couleurs livres, 2011
- François Mairesse et Anne Monjaret, Accueillir et surveiller, les métiers du gardien de musée, La documentation française, 2017
- Camille Mortelette. Reconversion d’anciens sites miniers en lieux culturels Enjeux territoriaux et appropriation dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Géographie. Université d’Artois, 2019
- Chloé M., « Zoom métier : la sécurité dans les musées », L’art de muser
#Sécurité #Suveillance #MuséesPourTous
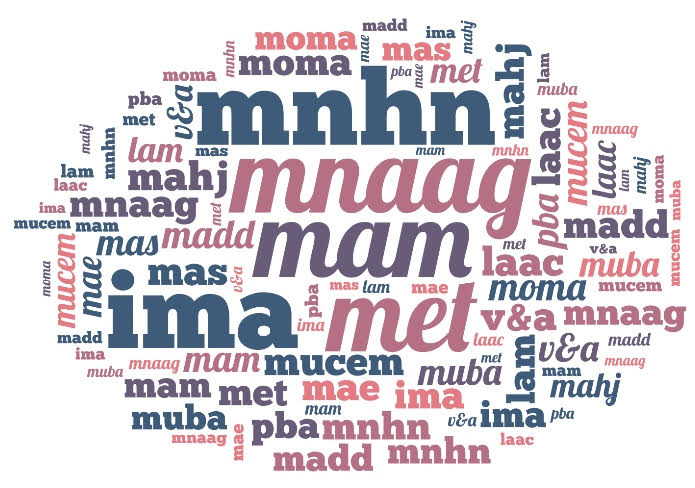
C’est quoi ton petit nom ?
Les musées des beaux-arts doivent-ils fuir l’appellation « musées des beaux-arts » ? De plus en plus de musées se détournent des noms traditionnels. En témoignent les musées de la métropole lilloise : PBA de Lille, MUba à Tourcoing, LaM à Villeneuve d’Ascq, Piscine à Roubaix…
Quid des muséums ? Le muséum d’histoire naturelle de Lille, en rénovation depuis 2020, réfléchit à changer son identité. Il devrait désormais se nommer Musée de l’Homme, de la nature et des civilisations, dans une démarche plus ouverte sur la société et notre planète.
Nommer une institution comme un musée demande une longue réflexion, que ce soit pour le sens, la sonorité, la symbolique… Petit focus sur quelques noms rencontrés fréquemment.
L’essor des acronymes
Depuis une vingtaine d’années, les noms de musée évoluent vers une simplification. MUba, acronyme de Musée des beaux-arts, est un des nombreux acronymes qui florissent dans le champ muséal. Mucem, MAS, MoMA, MET, MAD… Les musées se définissent plus par ces lettres que par une référence à un lieu… Fini les noms trop évocateurs, place aux acronymes ! Plus modernes, plus attractifs, les noms en acronymes sont des atouts de communication majeur pour les musées. Ils sont plus compréhensibles par les visiteurs non francophones et facilement mémorisables. Le nom est le premier moyen pour une institution pour se faire une place dans notre monde culturel dense. Il faut saisir l’occasion d’avoir un nom unique pour se démarquer des autres musées du même type. Le PBA de Lille (Palais des Beaux-Arts) a par exemple réussi à se distinguer des autres musées des beaux-arts existants, en choisissant une formule plus courte et moderne.
Un nom, c’est aussi une identité, qui s’inscrit dans notre imaginaire collectif. Pour marquer les esprits, rien de tel qu’un nom original, court, et c’est encore mieux s’il est accompagné d’un logo. Car l’avantage des noms en acronymes, c’est aussi leur facilité à en faire un logo logo (voir à ce sujet Les logos, ces grands bavards ! de Lisa Barris). Le Museum of Modern Art de New-York a été précurseur dans cette démarche. Dans les années 1960, le Museum of Modern Art dévoile son nouveau logo qui officialise son nouveau nom : il s’appellera désormais le MoMA, un nom qui se veut plus proche des visiteurs.

Logo du MoMA © Carlosdurso20 - Creative Commons
Les musées profitent généralement d’une rénovation pour changer d’identité visuelle et de nom. C’est le cas du LaM, diminutif de Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut depuis 2010 ; mais aussi du MET, pour le Metropolitan Museum of Art, adopté en 2016, et on pourrait en citer des dizaines. Le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, a lu aussi opté pour un acronyme, le Mucem, dès son ouverture en 2013, s’inscrivant immédiatement dans cette nouvelle vague de nom.
Le changement de nom peut aussi accompagner une redéfinition du ton de l’institution. Prenons l’exemple du MAD. Anciennement Union centrale des arts décoratifs rebaptisé Les Arts décoratifs, le musée a de nouveau changé d’identité en 2017. Le musée s’appelle désormais le MAD. C’est un double acronyme, signifiant à la fois « Musée des Arts Décoratifs » et « Mode, Art, Design ». La devise a elle aussi évolué, le « beau dans l’utile » devenant « un musée fou d’objets » (en anglais « mad » signifie « fou »). L’ancienne identité mettait en lumière les objets pour leur aspect esthétique, jouant sur la notion du Beau indispensable pour être dans un musée. Avec son nouveau nom, le musée change cette conception, supprime la notion de beauté pour se concentrer sur les objets. Quant à « mode, art, design », ce sont les domaines dans lesquels le musée met en valeur ses collections.
Créateur, donateur, mécène... Un retour sur investissement
Moins courts et accrocheurs, il existe au contraire des noms plus longs, en raison de l’ajout d’un nom de personnalité.
Un exemple récent : le musée d’Orsay, officiellement « établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie » depuis 2010. En 2021, à la mort de l’ancien président Giscard d’Estaing, le gouvernement a décidé d’accoler son nom à celui du musée d’Orsay, pour rendre hommage à celui qui avait impulsé la création du musée. Le nom s’est donc encore allongé, devenant l’établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie – Valéry Giscard d'Estaing.
Ce n’est pas le seul musée français à porter le nom de son créateur. En 2016, le musée des Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques est ainsi devenu le musée du quai Branly – Jacques Chirac, président qui avait œuvré pendant son mandat à l’ouverture d’un musée dédié à l’art extra-occidental. Le centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, inauguré en 1977, avait suivi le même schéma. Donner son nom à une institution culturelle n’est pas anodin. C’est une manière d’apparaitre dans l’espace public et de laisser en mémoire une action politique tournée vers la culture, avec les valeurs positives qui lui sont associées par ces hommes politiques.
Ces derniers ne sont pas les seuls à pouvoir donner leur nom à un musée. Les donateurs et mécènes sont parfois remerciés. C’est une pratique connue depuis longtemps dans le paysage muséal anglo-saxon : Ashmolean Museum de Oxford (datant du XVIIe siècle), les musées Guggenheim aux Etats-Unis, les musées Tate au Royaume-Uni, le Getty Museum, et bien d’autres ; et plus timide dans les musées français (musée national des Arts asiatiques – Guimet, inauguré en 1889 ou le MUba Eugène-Leroy, renommé ainsi en 2010).
Ces exemples concernent des donations historiques, relativement anciennes, qui ont contribué à fonder le musée. Qu’en est-il des donations actuelles ? Pour la première fois en France, une salle de musée est rebaptisée du nom d’un mécène. Il s’agit d’une salle du musée d’art moderne de la ville de Paris, qui se nomme depuis 2017 « salle Albert Amon », à la demande de son fils, en échange de la prise en charge de la rénovation de la salle.
Cette pratique appelée le naming consiste à donner son nom à une salle à son nom après avoir mécéné sa rénovation. Si la pratique est monnaie courante au Etats-Unis où les musées dépendent plus du mécénat qu’en France, c’est une problématique auquel les musées français vont devoir se confronter. Jusqu’où le mécénat pourra-t-il laisser son empreinte dans le musée ? Quelle importance vont prendre les noms de mécène ? Outre les noms de fondation ou de personnalités, les marques et grandes entreprises pourraient-elles associer durablement leur nom à ceux des musées ? Le Louvre pourrait-t-il renommer la salle des Etats « salle de Etats – AXA » qui a mécéné sa rénovation ? Le marketing n’a pas fini de se mêler au monde culturel.
Myrrha Bouly
Liens :
- https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/a-partir-du-1er-novembre-le-musee-d-histoire-naturelle-de-lille-ferme-ses-portes-plusieurs-mois_36686365.html
- https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/le-musee-les-arts-decoratifs-s-appellera-desormais-mad_3354863.html
- https://www.24matins.fr/fondation-maurice-amon-musee-dart-moderne-rebaptise-plus-grande-salle-628733
- Le point de vue d’un.e graphiste : https://luciole.com/moma-mad-mam-mucem/
- Lisa Barris, Les logos, ces grands bavards !
#Nom #musée #mécénat
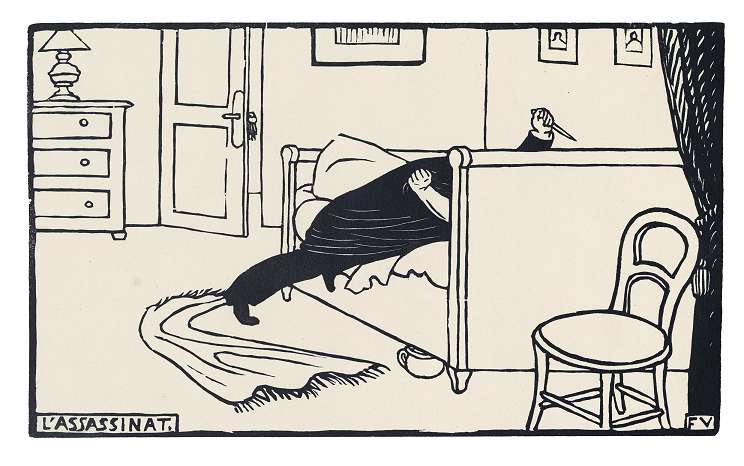
Cap sur le musée de la Préfecture de police
Nombreuses sont les personnes fascinées par le crime. Preuve en est les innombrables séries criminelles à succès tel Mindhunter de David Fincher, sortie en 2017 sur la plateforme Netflix. C’est une adaptation à l’écran de l’essai1 rédigé par le premier « profiler » de l’histoire. Le spectateur est invité à entrer dans la tête de célèbres tueurs en série à l’apparence étrangement ordinaire. Cet attrait du public se double d’une fascination grandissante pour les méthodes d’enquête utilisées dans les résolution des affaires criminelles. L’intérêt est réel, que ce soit pour le crime ou pour la chose policière.
Rien de neuf sous les tropiques me direz vous. En effet, les faits divers existent depuis toujours, même si c’est au 19ème siècle qu’ils prennent leur forme définitive. Ils seront moteur dans l’essor de la presse populaire autrement dite presse à grand tirage. Durant cet âge d’or du fait divers criminel, les journalistes se mettent à participer aux enquêtes, et à en dévoiler les coulisses dans les pages des journaux. Pour faire clair, « la télévision n’a pas attendu le fait divers pour devenir un média populaire » 2.
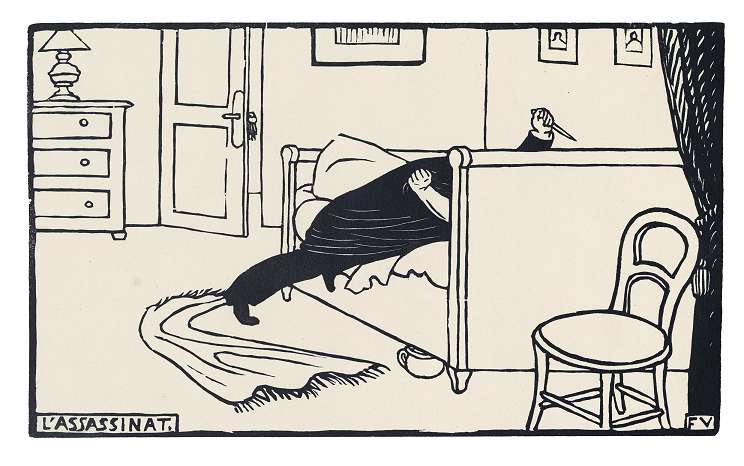
Félix Vallotton, L'Assassinat, Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la Photographie © BnF, Dist. Rmn-Grand Palais / image BnF
Mais pourquoi les faits-divers nous fascinent-ils autant?
Une première question se pose : mais pourquoi sommes-nous tant fascinés par le crime ? Comment expliquer cet attachement morbide ? Au-delà des anecdotes scabreuses, au-delà de la mise en fiction du crime, s’intéresser aux forfaits et à leurs auteurs, permet de saisir certains biais de la condition humaine. En effet, les faits divers fonctionnent comme des miroirs déformants permettant de déceler certaines anomalies des époques auxquelles ils se produisent. De plus, ils correspondent à une certaine production sociale dans la mesure où ils dévoilent et soulèvent des failles, des tabous et des crispations. L’une des raisons qui poussent les hommes à s’intéresser aux faits divers c’est que ce sont toujours leurs semblables qui sont au coeur de ces affaires, qu’ils soient à la place de la victime ou du bourreau. Ce fort potentiel d’identification (consciente ou non) contribue au succès du fait divers : « Si des gens ordinaires peuvent tomber dans la barbarie, la barbarie ne laisse jamais indifférents les citoyens ordinaires » (Daniel Zagury, La Barbarie des hommes ordinaires. Ces criminels qui pourraient être nous). Il y a bien évidemment un petit peu de curiosité malsaine mais rien d’anormal donc, tant que la fascination ne vire pas à l’admiration.
Maintenant que vous êtes rassurés quant à votre « normalité » toute subjective et que vous pouvez assumer votre passion en toute décomplexion, vous aimeriez bien en profiter. Pourquoi ne pas s’aventurer dans un musée du crime pour tenter d’approfondir le sujet ? Cette proposition tombe à pic car vous commenciez à vous ennuyer. Vous avez déjà visionné toutes les séries télévisées et documentaires, écoutés toutes les émissions Hondelatte raconte sur Europe1, même les Enquêtes impossibles de Pierre Bellemare y sont passées c’est pour dire. Pour votre plus grand bonheur, il existe des musées au charme suranné qui donnent à voir (et à comprendre ?) des activités criminelles, qu’elles soient célèbres ou ordinaires. Sacré programme !
Exposer le crime : le cas du musée de la Préfecture de Police de Paris
Il existe une multitude de musées exposant le crime à travers le globe. Certains sont simplement glauques à l’instar des musées de la torture qui pullulent un peu partout, toujours sur le même modèle ; d’autres sont instructifs, pédagogiques, virtuels comme le génial Criminocorpus ou même fictifs comme le « Black Museum » présenté dans la série à succès Black Mirror (S04E06).
Partons à la découverte du Musée de la Préfecture de Police de Paris. Il a été créé en 1909 par le Préfet Louis Jean-Baptise Lépine (1846 - 1933) également à l’origine de la brigade criminelle. Les premières collections du musée ont été constituées à partir de pièces réunies pour l’exposition universelle de 1900. Depuis, elles ont été enrichies et complétées grâce à des dons, des saisies et des acquisitions.
La police a autorité pour conserver ces éléments qui prennent des formes très diversifiés : photographies de scènes de crime, portraits anthropométriques de criminels, coupures de presse, armes, uniformes, faux et contrefaçons etc. Le parcours muséographique intègre de nombreux documents d’archives qui proviennent du fonds géré par la préfecture de Police. Il y a également des pièces accumulé par Gustave Macé, policier devenu chef de la Sûreté en 1877, tout au long de sa carrière. Il récupérait chez des brocanteurs des pièces ayant servi à des criminels afin de les retirer du marché et d’éviter qu’elles ne soient acheté par la pègre. Il est d’ailleurs à l’origine d’un « musée criminel » qui prend la forme d’un ouvrage (consultable gratuitement sur Gallica) présentant tantôt des objets utilisés par les malfrats, tantôt les instruments et équipements des policiers pour les attraper. Il est particulièrement intéressant de savoir comment la collection s’est constituée, mais avoir des informations supplémentaires sur le pourquoi du comment telle pièce a été patrimonialisée plutôt qu’une autre serait bienvenu.
Aujourd’hui, le musée bien qu’atypique par le sujet demeure classique dans la forme. Comme de nombreux musée de la police et / ou du crime, il se rapproche d’un cabinet de curiosité, impression renforcée par l’accumulation d’objets dans d’anciennes vitrines (qui sont par ailleurs très belles). Selon les chercheuses Gwénola Ricordeau et Fanny Bugnon, « Cela confère à nombre de ces musées une dimension globalement artisanale, ce qui les fait ressembler à une sorte de « brocante du crime ». » 3
Le but poursuivi par le musée de la Préfecture de Police est de raconter « l’histoire d’une institution qui, d’une police polycéphale à la Lieutenance de Police, a su s’adapter aux évolutions de la société et de l’espace urbain. »4. Ainsi, tous les objets servent à mettre en avant l’histoire de la police, ses réussites et son efficacité dans la résolution d’affaires et la gestion du crime. Le musée montre également l’histoire d’une profession à partir de 1667, date de l’institutionnalisation de la police. Le musée s’articule autour de cinq thématiques fonctionnant indépendamment les unes des autres mais formant un tout cohérent :
- Histoire de la police parisienne ;
- Crimes et châtiments ;
- Paris en guerre ;
- Métiers de la préfecture de Police ;
- Police technique et scientifique.
La partie sur l’histoire de la police parisienne m’a un peu ennuyée car elle est très factuelle et les expôts sont principalement des documents d’archives manuscrits ainsi que des uniformes montés sur des bonhommes en cire, rien de très sexy. Les autres sont intéressantes mais assez inégales dans leur traitement.
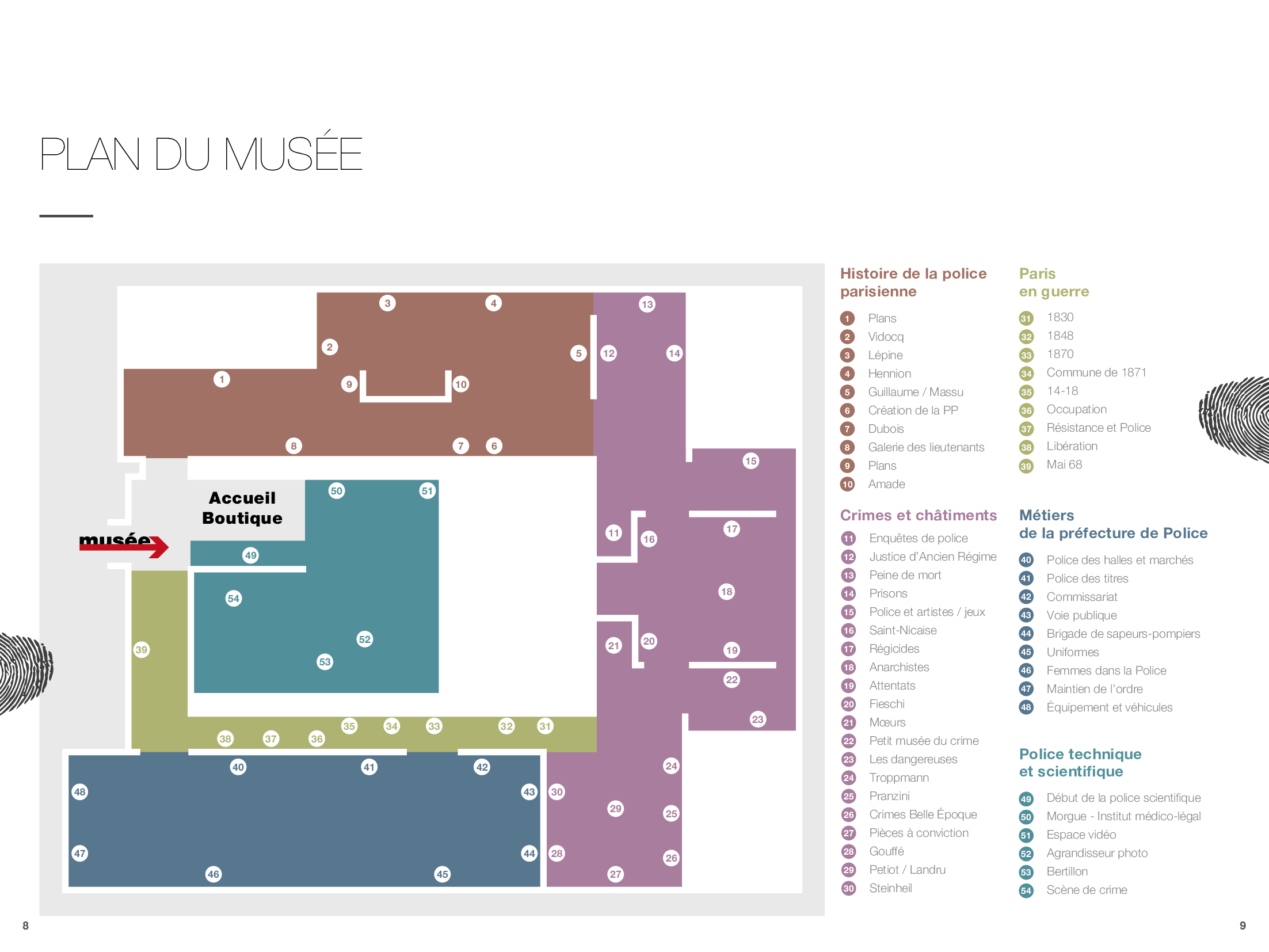
Plan de l'espace © Musée de la Préfecture de police
Une section conséquente de la muséographie est consacrée aux notions de Crimes et châtiments. L’accent est mis sur des assassins célèbres des 19ème et 20ème siècles. Ce choix semble pertinent lorsque l’on sait qu’à la fin du 19ème siècle, une conception particulière du crime et des criminels, majoritairement scientifique se développe. Par ailleurs, toutes les grandes thématiques sont abordées : la justice d’Ancien régime initiée par la royauté ; les régicides, événements traumatiques et fascinants toujours sévèrement punis ; les empoisonnements multiples et notamment la célèbre affaire des poisons (1666 - 1682 sous le règne de Louis XIV) ; les crimes dits « passionnels » ; les escroqueries en tout genre ; apachisme et délinquance dans les faubourgs.
Bien sûr, toutes ces histoires encore bien présentes dans l’imaginaire collectif possèdent leurs protagonistes. Ainsi, le musée de la Préfecture de Paris axe sa muséographie sur des grands noms du crime ou du banditisme.
Vous pourrez admirer deux faux d’un même Vlaminck - pourtant bien différents - saisis par la police judiciaire parisienne. Ils avaient été commandés par le célèbre vendeur d’art Fernand Legros.
Le parcours, en plus des textes de salle, est ponctué de petits encarts « Le saviez-vous ? » qui apprennent aux visiteurs des anecdotes aussi étranges que passionnantes dont voici un exemple :
« Les bandes de garçons bouchers qui travaillent à La Villette utilisent des os de moutons pour renforcer leurs coups. L’inspecteur Rongeat en fait péniblement l’expérience alors qu’il tente d’interpeller un certain Landrillon. À l’issue de leur affrontement, il semble être indemne, hormis des contusions. En fait, il meurt d’une péritonite deux semaines plus tard, due aux chocs infligés par la partie saillante de l’os. »
Des vitrines remplies d’objets insolites et bizarrement ingénieux viennent illustrer ces propos. Vous y trouverez toute sorte de poings américains, des bagues portés par les apaches servant à l’occasion des bagarres, un poignard en forme d’éventail replié et même un pistolet déguisé en radio.
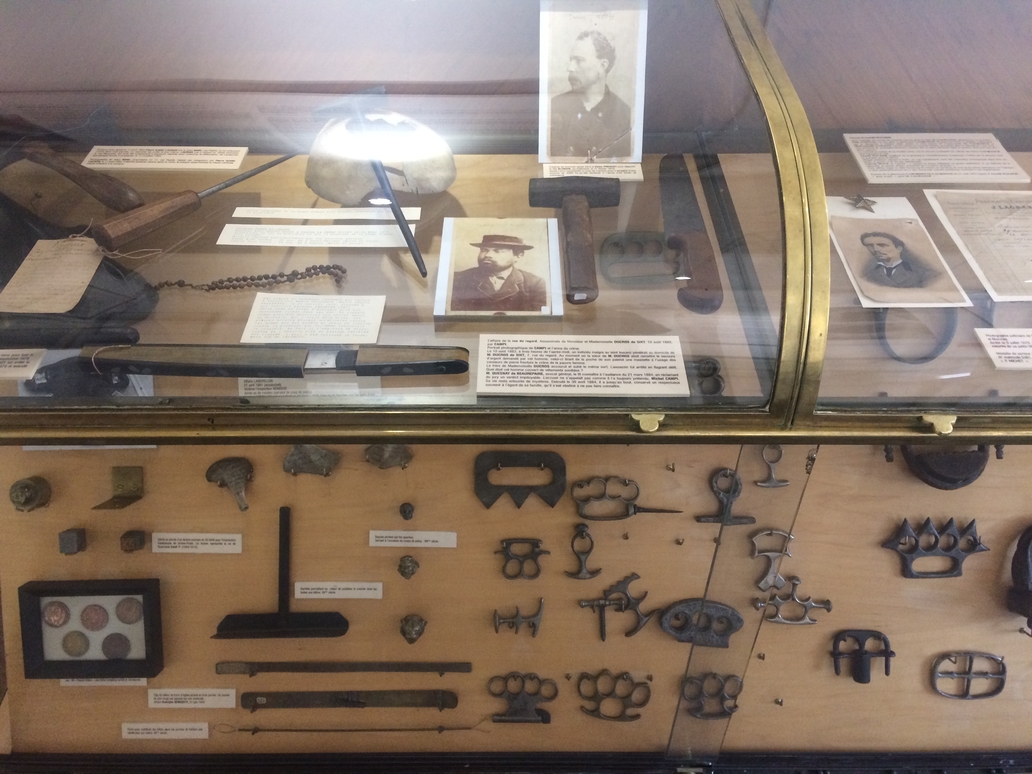

Vitrine et pistolet radio © A.G
Un panneau est consacré aux « Dangereuses ». Ah, les femmes et le crime, toute une histoire ! D’après le texte, il existe trois typologies de femmes dangereuses et chacune a sa figure de proue : « Les espionnes » avec Mata Hari en porte étendard ; « Les fatales [...] qui utilise(nt) (leurs) charmes pour faciliter le crime, voire le commettre » illustrées par Casque d’Or, la favorite des Apaches des faubourgs ; et enfin « Les vénéneuses » comme la marquise de Brinvilliers, actrice principale de l’affaire des poisons de 1666. Bien que ce séquençage soit quelque peu caricatural et reflète une vision fantasmée de la femme criminelle, les informations divulguées sont intéressantes.
En revanche, je regrette que nul part, la spécificité des crimes commis à l’encontre des femmes ne soit mentionnée. Les crimes à caractère sexuel, les violences conjugales, les féminicides sont passés sous silence. De manière générale, la place de la femme y est très marginale même lorsqu’il s’agit de parler des femmes policières dans la partie consacrée aux « Métiers de la préfecture de Police ».
Sans pour autant que le discours soit promotionnel, il n’y a pas de distanciation critique dans le propos. « Pour l’essentiel, les musées de la police font entendre le discours d’une institution sur sa propre histoire, regard déterminé par une approche positiviste. Construit au singulier et sans réelle distance, ce type de discours incorpore rarement les lectures critiques de l’histoire policière, notamment du point de vue de la répression des épisodes de contestation sociale qui, s’ils sont évoqués, rendent peu compte de l’usage de la force par la police. » (Gwénola Ricordeau et Fanny Bugnon). Cela est notamment flagrant dans le traitement des événements de Mai 68. Le musée n’est pas destiné à la remise en cause, mais contrairement à d’autres musées du crime, l’approche choisie n’est ni sensationnaliste ni spectaculaire.
En fin de parcours est présentée dans une petite section la police technique et scientifique. Alphonse Bertillon crée en 1882 un système de mensurations anthropométriques qui pose les bases de l’identification judiciaire, permettant de classer les criminels pour identifier les récidivistes. Les fiches étaient classées selon trois ordres de grandeur, en fonction de l’ossature de la personne : « Les mesures retenues furent la taille, la longueur de la tête, la largeur de la tête, l’envergure des bras, le buste (hauteur de l’homme assis), la longueur de l’oreille droite, la longueur du médius gauche, la longueur de la coudée gauche et la longueur du pied gauche » (source : cartel développé consacré à Bertillon). À la fin du 19ème siècle, Alphonse Bertillon est considéré comme un génie, son système est progressivement adopté dans le monde entier. Une seule chose m’interpelle dans cette section c’est l’absence du nom de Cesare Lombroso, considéré comme le père de l’anthropologie criminelle. Il a écrit en 1876 L’homme criminel. Même dans la brochure il est fait mention « d’une théorie alors populaire qui établissait un lien entre apparence physique et propension au crime » alors que Alphonse Bertillon et plus tard Alexandre Lacassagne se sont directement inspirés des travaux des criminologues italiens et particulièrement de Cesare Lombroso. Le traitement est donc volontairement et uniquement territorial. Selon les chercheuses Gwénola Ricordeau et Fanny Bugnon, la défense d’une identité nationale ou locale est une des caractéristiques des musées de la police à travers le monde5.
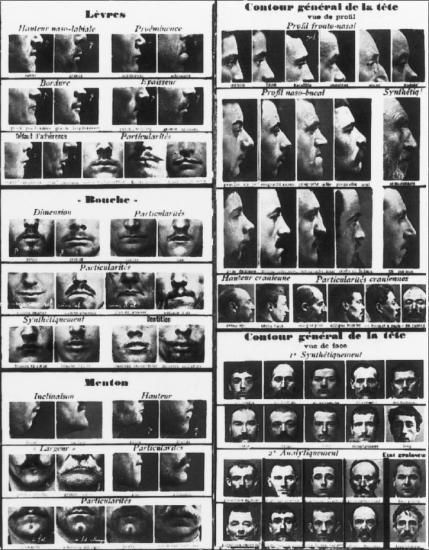
Portraits bertillonages © Pinterest
Les enjeux de la patrimonialisation du crime
Le musée de la police se revendique dans sa brochure comme « un musée du crime ». Or, ces deux types d’institutions, proches par les thèmes traités, ne répondent pas exactement aux mêmes problématiques, même si leur définition s’entrecoupent et qu’il est parfois difficile de les distinguer. Les musées du crime et de la police ont comme point commun d’être peu médiatique. Il y a très peu de musées de la police en France contrairement à d’autres pays comme les États-Unis. D’ailleurs funfact (ou non) mais l’État américain comptant le plus de musées de la police n’est autre que le Texas, avec notamment deux musées estampillés Texas Rangers.
Souvent, ces musées sont destinés à un public restreint à l’instar du fameux Crime Museum de Londres qui n’ouvre quasiment pas ses portes au public. Il a été créé dans un but pédagogique et accueille seulement des étudiants et des professionnels de la police. D’octobre 2015 à avril 2016, le musée qui se situe à Scotland Yard dévoilait sa sombre collection d’objets le temps d’une exposition temporaire au Museum of London, qui rencontra un franc succès. C’est bien la preuve que ces institutions rencontrent un public, des étudiants, des professionnels mais également des chercheurs, des visiteurs individuels. Certaines de ces structures accueillent même des enfants, c’est le cas du musée de la préfecture de Police de Paris où tout un pan de mur est consacré à l’exposition de dessins d’enfants représentant la police au travail. On peut tout de même se poser la question de comment sont abordées ces thématiques auprès du jeune public.

Dessins d'enfants © A.G
Les enjeux soulevés par la patrimonialisation du crime et des lieux policiers semblent peu émouvoir le grand public. Par ailleurs, peu de recherches sont réalisées sur la mise en exposition des objets liés à l’histoire du crime. Les musées de la police comme les musées du crime sont peu étudiés. Il existe une plateforme scientifique en ligne dédiée à l’histoire de la justice, des crimes et des peines. Le site internet Criminocorpus.org propose un Musée de la justice, une revue ainsi qu’un blog d’actualité. Marc Renneville son créateur milite pour l’ouverture d’un musée de la Justice et de la Sécurité qui centraliserait toutes les collections liées à ces thématiques au 36, quai des Orfèvres sur l’île Saint Louis.
Armelle Girard
Notes:
1. John Douglas et Mark Olshaker, Dans la tête d’un profileur, Michel Lafon, 461 pages.
2. Sécail, Claire. « L'essor du fait divers criminel à la télévision française (1950-2010) »,L'information psychiatrique, vol. volume 88, no. 1, 2012, pp. 51-59.
3. Gwénola Ricordeau et Fanny Bugnon. « La police au musée : une perspective comparative »,Déviance et Société, vol. vol. 42, no. 4, 2018, pp. 663-685.
4. Citation extraite de la brochure du musée.
5.Gwénola Ricordeau et Fanny Bugnon. « La police au musée : une perspective comparative », Déviance et Société, vol. vol. 42, no. 4, 2018, pp. 663-685.
Informations :
Musée de la Préfecture de Police
4, rue de la Montagne Sainte-Geneviève - 75 005 Paris
Métro : Maubert-Mutualité, ligne 10 Bus : 24, 47, 63, 86, 87
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h et le troisième samedi de chaque mois de 10h30 à 17h30.
L’accès au musée est gratuit.
Liste non exhaustive de structures semblables :
- Museo Lombroso di antropologia criminale (Turin)
- Museo Criminologico (Roma)
- Musée de la Gendarmerie Nationale (Melun)
- Black Museum, Metropolitan Police’s Crime Museum (Londres)
Liste non exhaustive d’expositions passées sur cette thématique :
- Crimes et Châtiments, 16 mars - 27 juin 2010, Musée d’Orsay
- Crim’expo : la science enquête, 10 février 2009 - 3 janvier 2010, Cité des sciences et de l'Industrie
- Fichés ? Photographie et identification du Second Empire aux années soixante, 28 septembre - 26 décembre 2011, Archives Nationales et version disponible en ligne sur Criminocorpus
#Crimes&Châtiments
#Police
#Frissons
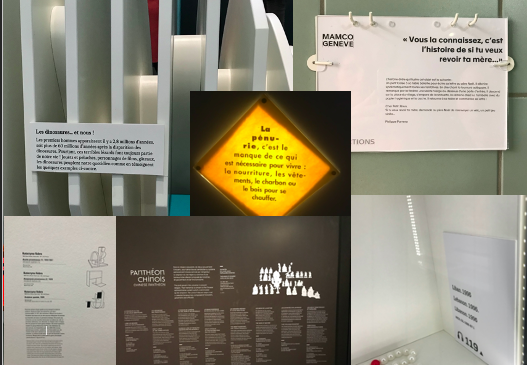
Cartel : un support en questionnement ?
Les cartels sont omniprésents, ils font l’objet d’une attention particulière dans une grande partie des musées. Pendant mon apprentissage aux musées du Mans, une discussion revenait très souvent lors des montages d’expositions : celui des cartels. Le texte est trop long ? Il gâche l’œuvre ? Ils sont trop visibles, trop bas, trop hauts ? Il existe de nombreux types de cartels, chaque institution à ces habitudes et énumérer des exemples n’est pas mon objectif, mais plutôt de prendre le temps de réfléchir à ce support.
Le cartel : avant tout un outil d’identification
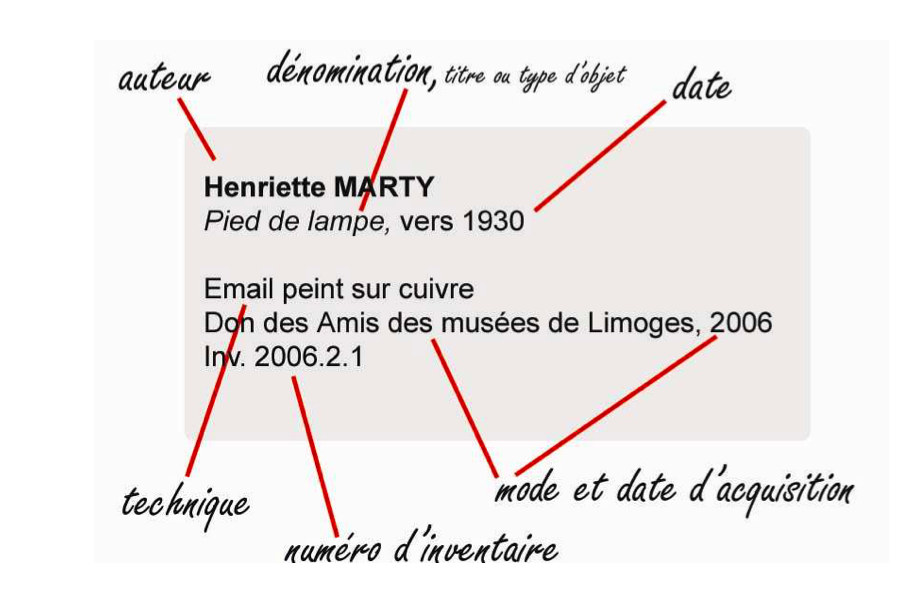
Documentation musée des Beaux-Arts de Limoges.
Avant toute chose, le cartel dans les espaces d’expositions permanents ou temporaires a une fonction bien précise.
Cartel : « ce sont les étiquettes qui accompagnent et documentent chaque œuvre ou objet. »
A cette définition, j’ajoute qu’il permet d’identifier l’œuvre, l’objet que les visiteurs observent. Très souvent, il se constitue pour une œuvre d’art du nom de l’artiste, de son titre, des dimensions, du numéro d’inventaire et si c’est un prêt ou un dépôt le nom de l’institution. C’est une sorte de carte d’identité pour œuvres et objets.
Cependant, il ne s’arrête que très rarement à ces informations. Ils peuvent être accompagnés d’un texte de présentation ou même d’une analyse développée de l’œuvre. Cela devient une zone de texte à part entière. Le ministère de la culture précise les objectifs de cet outil : « objectifs de communication, c’est-à-dire par le choix du niveau d’interprétation de l’étiquette (uniquement pour identifier, étiquette autonyme, ou décrire, expliquer, être une aide à l’interprétation, étiquette prédicative). »
Quel rôle pour ce format précieux ?
J’écris précieux sans demi-mesure. Proche des œuvres, il peut être un intermédiaire, une médiation entre les œuvres et les visiteurs. Il invite le visiteur à la découverte de ce qu’il ne pourrait pas voir/comprendre. Selon les scénographies, il s’intègre plus ou moins bien dans l’espace et il peut aussi faire l’objet d’un graphisme particulier.
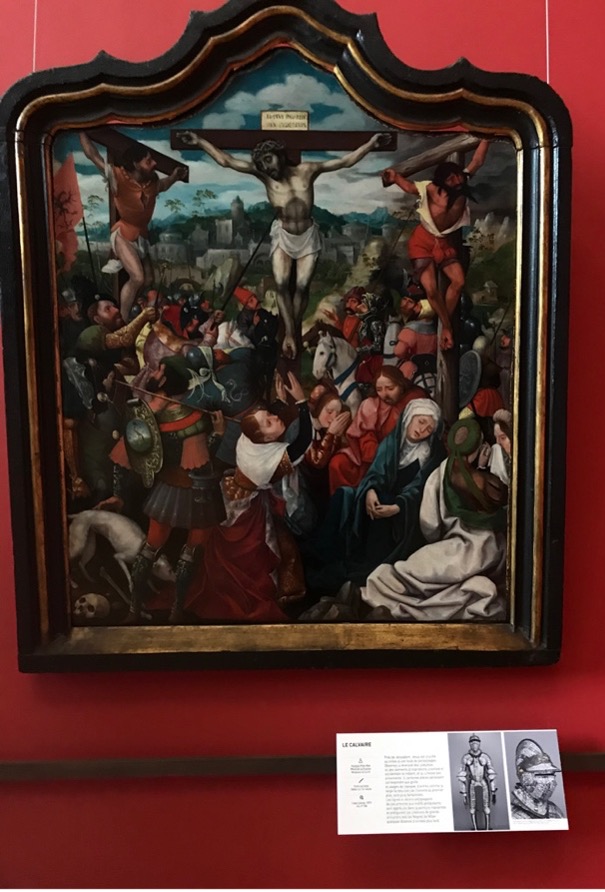
Exemple des cartels familles PBA, juin 2021 ©AV
Lors de ma dernière visite au Palais des Beaux-Arts de Lille (PBA), une première partie des « cartels famille » ont été installés auprès des collections médiévales. Ici, il est utilisé pour faire des liens avec le reste des collections. Ce n’est donc plus un cartel « traditionnel ». Des images y sont intégrées, ce qui peut interpeller les visiteurs et les amener à lire le cartel pour son contenu et non que pour connaître le titre de l’œuvre.
Écriture des cartels : quelles voix s’expriment ?
De nombreux avis s’affrontent. Qui doit finalement écrire ces cartels ? L’équipe scientifique, c’est-à-dire les responsables de collections, les conservateurs, ou des chercheurs, les médiateurs, les visiteurs etc.
Plusieurs essais sont réalisés par de nombreux musées. James Bredburne, directeur de la Pinacothèque de Brera, a laissé la place à des enfants pour écrire certains cartels du musée. En parallèle, des cartels scientifiques ont été posés. Sur l’étude menée, le directeur remarque que les visiteurs passent plus de temps auprès des œuvres lorsqu’ils lisent les cartels rédigés par les enfants. James Bredburne prend l’exemple du cartel consacré à Cézanne, il avait été écrit par une jeune fille de 13 ans. Plus court, plus interprétatif, le cartel attise la curiosité des différents visiteurs.
Là encore, il ne s’agit pas de supprimer définitivement les cartels scientifiques mais plutôt de rythmer les voix qui mettent en lumière les œuvres.
Autre aspect qui peut changer la lecture d’un cartel : le ton de l’écriture. Toujours dans les cartels familles du PBA, le tutoiement du visiteur est introduit, le cartel amène aussi des intrigues à résoudre en découvrant les œuvres. Le fait de questionner, de donner le temps au lecteur de s’interroger permet une visite plus riche et de devenir acteur de sa visite. Et pour ceux qui recherchent un discours plus soutenu, plus scientifique, le cartel de l’œuvre est encore présent. Le visiteur a donc le choix de découvrir l’œuvre par le contenu qu’il souhaite.
Cartels simples, développés, ont-ils encore un avenir ?
Je ne compte plus les cartels interminables, illisibles vus et lus dans certaines expositions. Il n’existe pas de règles propres pour écrire des cartels. Très souvent, son écriture est confiée aux équipes scientifiques. Cela peut produire des cartels développés aux références et explications complexes, voir incompréhensibles, soit par le vocabulaire employé, soit par sa longueur. Écrire des cartels courts ou avec plusieurs niveaux de lectures peut rendre la compréhension plus fluide.
Outre l’aspect technique, la forme du cartel me pose réellement question. À l’ère du tout numérique avant nous encore envie de lire des cartels collés aux murs ? Peut-être qu’il est temps de nous interroger sur notre rapport à cet outil afin qu’il ne disparaisse pas. Comment pourrions-nous découvrir ces informations par un autre biais que celui du cartel strict ?
Plusieurs institutions font le choix de supprimer les cartels de l’espace de visite. L’exposition « Memento Mons. Cabinet de Curiosités » au Musée des Beaux-Arts de Mons (BAM) en avait fait l’expérience tout en laissant le visiteur se procurer un livret de visite détaillé.
D’autres, tels que la Fondation Custodia, ont d’ailleurs aussi complétement enlevé ces outils des espaces d’exposition pour les écrire directement dans des livrets. Cela devient un réel gain pour le visiteur qui car s’il le souhaite il peut le ramener chez lui, s’il le souhaite.
Toutefois, tout le monde ne désire pas chercher dans son livret de salle en salle à quel numéro correspond l’œuvre pour lire son cartel. Intégrer dans les espaces d’expositions des cartels réduit cet intermédiaire. Mais d’autres formats ont pris la main pour diffuser du contenu. Le numérique peut jouer un rôle clé tant avec des formes matérielles qu’immatérielles avec l’apparition des QR codes, d’applications, des tablettes de visites etc. Il a apporté une nouvelle manière d’appréhender le contenu textuel dans les expositions.
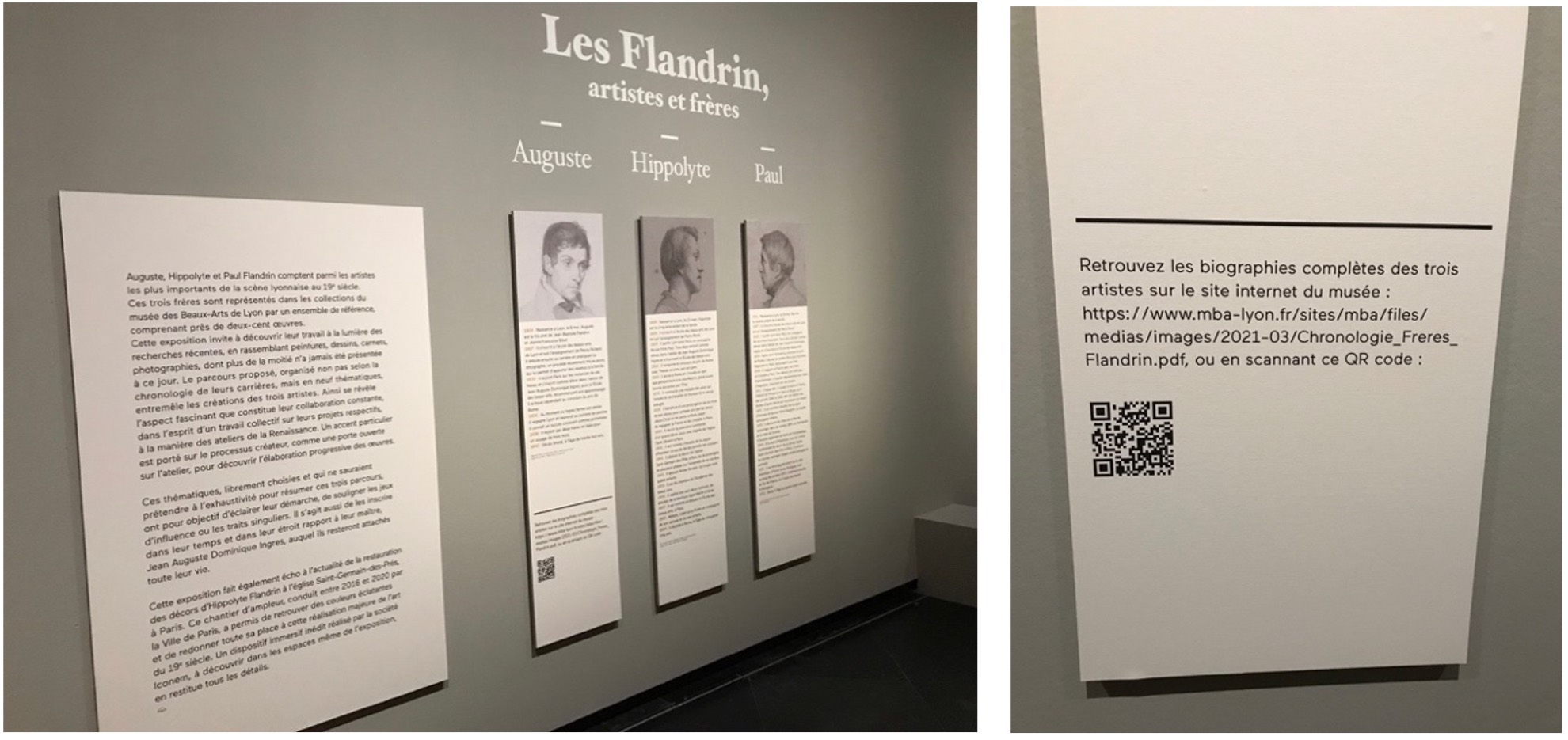
Exposition Les Flandrins, artistes et frères, entrée de l’exposition, Musée des Beaux-Arts de Lyon, juillet 2021, ©AV
L’apparition des QR codes n’est pas nouvelle dans les musées, ils sont mêmes récurrents. Au musée des beaux-arts de Lyon, pour l’exposition consacrée aux peintres et frères Flandrin, plusieurs QR codes étaient disposés. Tant pour certains cartels, qu’en compléments de textes, ou pour retrouver le livret de visite. Pour ne pas désavantager les visiteurs qui n’ont pas de smartphones ou pour ceux ne souhaitant pas les utiliser les textes étaient toujours présents dans l’exposition.
Autre forme, pouvant prendre le relais des cartels : l’audio. Pendant le confinement, la production des podcasts dans les institutions culturelles et particulièrement dans les musées s’est fortement accrue. (Voir Les musées dans nos oreilles : les podcasts au musée et sur les musées) Nombre d’entre eux se penchaient directement sur les collections exposées. Pourquoi ne pas les intégrer directement dans les parcours permanents ? Vous me direz que pour ceux qui le souhaitent, une grande partie des musées proposent des audioguides mais pourtant ce sont des formats bien différents. Les podcasts offrent l’opportunité d’apporter un ton différent, soit avec une touche d’humour, ou une touche de narration.
Dans tous les cas, les cartels ne doivent pas être négligés, ce sont des supports qui font parties des murs tellement nous pouvons y être habitués. Au point que nous pouvons leur accorder peu d’attention. Et des cartels trop longs, « mal intégrés », trop soutenus voire même quelquefois incompréhensible nuisent à mon expérience de visite. Partant de ce principe, le fait d’accorder un sens et un rôle à ces outils peut nous permettre de valoriser les œuvres et les expôts. Leur donner une nouvelle forme et nouveau rôle peut permettre de réellement les intégrer au parcours de visite. Comme le dit James Bradburne, il n’existe pas une vérité, ni un seul cartel.
Pour aller plus loin :
« 5 exemples de cartels », publié sur Exposcope : https://exposcope.wordpress.com/2021/04/06/cartel/
« Delacroix et Eugène. Des cartels sensibles », publié sur Exposcope : https://exposcope.wordpress.com/2019/04/29/delacroix-eugene-cartels-sensibles/
Conférence Les cartels au musée : La voix des œuvres, intervention de James Bradburne et Jean-Luc Martinez en 2017 : https://www.youtube.com/watch?v=g3OI4OSEMwI&t=1s
L'ouvrage de Daniel Jacobi : Textexpo : produire, éditer et afficher des textes d’exposition aux Editions OCIM. Voir https://ocim.fr/ouvrage/textexpo-produire-editer-afficher-textes-dexposition/
#cartels #musées #discours

Cela aussi passera
La question du temps qui passe et la question de sa trace turlupine d’autant plus lorsque l’on se destine à travailler dans un musée. Oh oui, de biens grands maux, sur lesquels on pose des grands mots souvent bien maladroits pour en extraire une maxime nébuleuse pseudo-hautement philosophique sur le Sens de la Vie.
« Diantre ! Cette scélérate a cru nous avoir avec sa cynique litanie ? La bougresse se terre derrière un style enlevé, digne d’un post aguicheur putaclic, et tergiverse avant de se lancer»
Mettons ces atermoiements sur un probable trop grand gavage de proverbes en papillotes. Loin de moi l’idée d’être une reine de la prose qui va résoudre la Grande Question muséale en quelques XXXX caractères mais tant pis, je me lance.
Les musées, ces temples du savoir, gardiens des reliques de l’Humanité, passeurs d’enseignements du passé, et à l’occasion de valeurs idéalistes.
Un musée, dans l’imaginaire collectif, c’est notamment la Conservation. Une accumulation de pièces de toutes sortes et de toutes valeurs, transformant le lieu en une caverne d’Ali Baba, un cabinet de curiosités emplis de mystères, d’objets rendus fabuleux. Mais au fond,
si Tout finit par se désagréger, puis par disparaître,
à quoi bon vouloir laisser une trace,
retranscrire, transmettre ?

Vue de l'Artothèque de Mons ©Bruynzeel.fr
La vie tient dans des boîtes
Tout est question de contenu dans des contenants.
Pourtant, il est étonnant de voir qu’un contenu
puisse être contenant
de tant de contenu.
Contenu qui, contient tant
de contenus détenu :
Récoltés, accumulés, collectés, collectionnés,
dépossédés de toutes fonctions ou identités,
Ces contenus, plus ou moins involontairement
sont oubliés.
Bien souvent aux dépens
d’une collection bien constituée,
d’une muséographie sélectionnée.
Caché, masqué, dissimulé,
ces contenus sont contenants de secrets sciemment gardés,
autant par leurs premiers possesseurs
que par leurs derniers acquéreurs.
Parfois trop difficiles à céder,
souvent trop difficiles à intégrer
à l’analyse gracile d’un programme bien ficelé.

Espace Bazars - Collection Bozzini ©Alain Germond / Musée d’ethnographie de Neuchâtel
Dans l’Histoire comme au musée
tout n’est qu’interprétation
de faits, d’objets éloignés.
Elle nous est simplement rédigée, présentée
Sans savoir si son orientation
est dirigée ou non.
En bon curieux, il faut toujours remettre en question
la valeur et la véracité d’une information.
Dans l’Histoire, comme au musée,
tout n’est que fragmentation
de ce qui fut un jour notre présent.
Un même sujet peut être traité à foison,
sans jamais l’épuiser,
tant il a de facettes encore non explorées.
Mais la sélection ne permet plus
le débordement du contenu.
Et l’inverse laisse totalement décontenancé
le curieux en quête d’une bribe du passé.

Vue de l’Artothèque de Mons ©L’art de Muser
À l’ère du numérique, où l’homme ne cesse plus
de créer en continu
des quantités de contenus,
traces, souvenirs et données
comme jamais il n’en avait eus ;
De tous ces maigres témoignages,
très bientôt hors d’usages,
d’un temps révolu,
Jamais, il n’en a autant perdu.
À l’ère du numérique, où tout est question
de bits, de place,
qu’en est-il de la conservation
de cette immatérielle trace ?
Que doit-on placer
dans les collections du musée ?
Le fichier originel ?
Une reproduction fidèle ?
Cette manie de la conservation,
de la pérennité, de l’immortalisation,
n’est-elle pas absurde, quand on sait que tout tend
- inévitablement -
vers la disparition ?
À quoi bon ?
Ozymandias
Le musée délivre aux objets une durée de vie plus longue que les personnes qui viennent les observer. La patrimonialisation confère une forme d’éternité ou du moins de pérennité.
Vouloir laisser une trace à travers les années qui passeront après nos morts revient à se battre contre le phénomène même qui est à l’origine du temps. Sans cette dispersion inéluctable de la matière, il n’y aurait aucun message à faire passer au futur, car il n’y aurait pas de nécessité à laisser un témoignage. Aucun objet, événement ou connaissance que l’on essaye de sauvegarder de la destruction n’existerait sans cette destruction. L’impermanence des choses est une propriété fondamentale de l’univers, que les musées auront toujours à apprivoiser.
Parce que tout passe, même le passé.
À quelques heures de la clôture de l’appel à la participation du projet Keo – satellite/time-capsule rassemblant des témoignages à destination du futur– peut-être qu’en transmettant une partie de ces questions, elles y trouveront un jour des réponses. Ou peut-être mieux : au contraire, elles paraîtront nébuleuses, fictionnelles, désuètes. Les musées auront-ils encore lieu d’être ? Seront-ils encore des lieux réels ou virtuels ? Chercherons nous à retourner au matériel, à un espace concret ? Nos écrits seront-ils les rares traces d’improbables reliques ?
JR
#impermanencedeschoses
Pour aller plus loin :
-L’impermanence des choses, la collection permanente du Musée Ethnographique de Neuchâtel : www.men.ch/fr/expositions/la-villa/
- Comment cette capitale s’est évaporée,par Léo Grasset sur DirtyBiology : www.youtube.com/watch?v=nEx2lQyfSlc&t=32s
- Quelle trace voulez-vous laisser ? Le projet Keo : www.keo.org

Changements climatiques et musées, quel(s) lien(s) ?
Le titre de cet article peut faire peur, tant le sujet est large. Mettons donc les choses au point. L’objectif n’est pas d’alerter sur le changement climatique en cours et ses conséquences, à l’échelle globale comme pour les institutions muséales. Il ne s’agit ni d’être moralisateur envers les pratiques des musées et de leurs professionnels, ni de lister des « bonnes pratiques ». Le but est de se demander en quoi les musées sont concernés par la crise climatique en cours, et surtout quels sont leurs moyens d’action, leurs compétences, pour participer aux évolutions nécessaires à faire dans notre société.
Qu’est-ce que cela implique pour tous les organismes membres de l’ICOM ? Les institutions muséales sont-elles vraiment concernées par les ODD ? Et comment participer aux efforts face à la crise climatique ?
Pourquoi et comment les musées sont-ils concernés ?
“In addition to their deep view of time, museums are eminently qualified to address climate change for a variety of reasons. They are grounded in their communities and are expressions of locality; they are a bridge between science and culture; they bear witness by assembling evidence and knowledge, and making things known; they are seed banks of sustainable living practices that have guided our species for millennia; they are skilled at making learning accessible, engaging and fun, and last, they are some of the most free and creative work environments in the world.”
De plus, les musées forment un réseau mondial très dense – plus de 55 000 institutions dans le monde, essentiellement dans les pays développés, il faut bien le noter – qui peut avoir un impact sur les engagements en faveur de l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, à condition bien sûr que toutes s’y mettent et que les engagements pris soient significatifs.
Agir en tant que réseau

L’entrée du Musée du changement climatique à la Chinese University de Hong Kong. © Hoising, CC BY-SA 3.0, via
Wikimedia Commons.
Exposer le changement climatique
Donner l’exemple, entre adaptation et atténuation
- Protéger le patrimoine culturel et naturel mondial, dans les musées et en général ;
- Participer à la diffusion et l’éducation aux ODD ;
- Rendre la culture accessible à tous ;
- Favoriser le tourisme durable ;
- Permettre la recherche pour soutenir les ODD ;
- Adopter une gestion interne en accord avec les ODD ;
- Adopter une gestion externe en accord avec les ODD.
1 Voir la page dédiée au développement durable sur le site de l’ONU.
2 Robert R. Janes, « Museums in perilous times », dans Museums Management and Curatorship, Volume 35, Issue 6: Museums and climate action, ICOM, 2020, pages 587-598.
3 Pour plus de détails sur ce concours : https://www.museumsforclimateaction.org/.
4 Une liste non exhaustive mais très fournie des expositions sur le thème du changement climatique est
disponible ici. D’autres articles sur le blog présentent aussi des expositions : « Le vent se lève » : récit d’une
déambulation écologique au MAC VAL et La biodiversité exposée.
5 Pour une présentation de ces musées, voir l’article de J. Newell, Climate museums : powering action, dans
Museums Management and Curatorship, Volume 35, Issue 6: Museums and climate action, ICOM, 2020, pages
599-617.
6 Deux articles du blog traitent déjà très bien ce sujet : Des expos recyclées et L’avenir écologique de la
scénographie d’exposition – post Covid.
Chim CHOLIN
A lire : Serge Chaumier et Aude Porcedda, sous la direction de, Musées et développement durable, La Documentation française, 2011.
#ChangementClimatique
#ObjectifsDéveloppementDurable
#TousConcernés
Pour aller plus loin : le dernier numéro de la revue de l’ICOM Museums Management and Curatorship, (Volume 35, Issue 6) : Museums and climate action, qui regroupe de nombreux articles intéressants.
Et ne pas hésiter à visiter les sites des institutions citées, et d’autres encore !
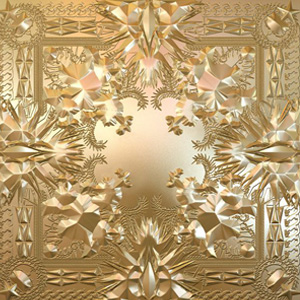
Chanter le musée
Rien de plus enivrant qu’un bon morceau de musique. Les mélomanes le savent : les yeux qui se ferment, le son qui se propage dans un corps rendu lâche ou prêt à bondir, l’anticipation d’un refrain qui va résonner dans le cœur, un éventuel solo qui se fait désirer et un dénouement qui fait l’effet du calme après la tempête. Que ce soit pour danser, se détendre, rester concentré, méditer, pogoter, avoir un bruit de fond ou faire le ménage, tout le monde y trouve son compte. Nombreux sont les genres, nombreuses sont les thématiques abordées.
Parmi ces chansons majoritairement anglophones (car il y a très peu de chansons françaises à ce sujet), en existent t-il qui évoquent les musées ? Peu, mais certainement. J’en ai choisis selon leurs paroles et non leur mélodie. Libre à vous d’attraper vos écouteurs ! Il y a des chansons qui mentionnent brièvement le musée (Chéri.e, des fois je ne te comprends pas, tu es l’art abstrait dans mon musée moderne - Moly Nilsson dans I hope You Die) et d’autres qui délivrent un message en utilisant le fameux établissement. Ce sont ces chansons qui m’intéressent : quelles images renvoient-elles du musée ?
Sans surprise, l’image du musée qui revient le plus souvent est celle de la caverne aux trésors. Ce stéréotype remonte à bien longtemps. Quand ont émergé les premiers musées ? “Officiellement”, lors de la Renaissance italienne où l’on a constitué des galeries d’art antique. Mais avant ? Il y avait les Mouseîon, ces temples grecs dédiés aux muses des arts contenant accessoirement des collections. Et encore avant ? Eh bien, il y avait les trésors de guerre, qui sont peut être les premières collections d’objets précieux. Synonymes de richesse, ces objets confèrent pouvoir et crédibilité. Dans le milieu très bling bling du hip hop, il n’est pas étonnant de voir des rappeurs comparer leur richesses à ce qu’on peut trouver dans les musées.
Illest Motherfucker Alive, Jay-Z et Kanye West (2011)
Basquiats, Warhols, serving as my muses
My house like a museum so I see 'em when I'm peeing
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Des Basquiat, Warhol me servant de muses,
Ma maison est un musée donc je les vois quand je suis en train de pisser
Good Morning, 2 Chainz (2013)
Inside of the car is like a damn computer
Inside of the crib is like a damn museum
-----------------------------------------------------------------------
L’intérieur de la voiture est comme un ordinateur
L’intérieur de la maison est comme un musée
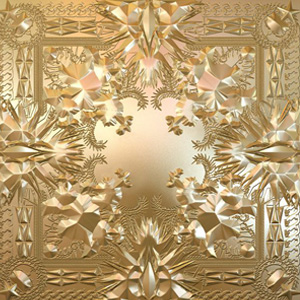


Des pochettes d’albums pour le moins luxueuses : Watch the Throne (Jay-Z), The Chronic (Dr. Dre), I Am (Nas)
Retour à l’histoire. Cette collectionnitesera capitalisée et aboutira aux cabinets de curiosités. Ce sont des intérieurs généralement privés où l’on pouvait trouver des choses rares et singulières : restes d’animaux, manuscrits, minéraux, végétaux, meubles, bijoux, armures... le tout provenant de contrées préférablement lointaines. Pour en mettre plein les yeux, on n’hésitait pas à fausser la réalité (la corne de narval présentée comme une corne de licorne, les compositions à partir de plusieurs squelettes pour créer une bête hybride….)
Museum song, Barnum (1992)
Everything about my museum was spectacular,
Quite a lotta
Roman terra cotta
Livin' lava from the flanks of Etna
[...]
A pickled prehistoric hand
A strand of Pocahontas' hair
Crow and Sioux
Who're going to
Be showing you
Some rowing through
A model of the rapids on the Delaware.
--------------------------------------------------------------------
Tout de mon musée était spectaculaire,
Un bon nombre de
Terres cuites romaines.
Lave vivante des flancs de l’Etna
[...]
Une main préhistorique en conserve
Une mèche de cheveux de Pocahontas
Crow et Sioux
Qui vont vous montrer
Un peu d’aviron à travers
Une maquette des rapides sur le Delaware
Cette image de providence est toujours bien ancrée dans la conscience contemporaine, même si certains commencent à s’interroger sur l’obligation inhérente du musée à montrer des objets authentiques...
Un autre cliché découle de ce foisonnement d’objets : celui du musée poussiéreux rempli des fantômes du passé. Au mieux, nous avons affaire à une douce mélancolie qui regrette un autrefois, au pire, au spectre de la mort qui rôde dans les couloirs.
Le gardien du musée, Les Blaireaux (2013)
Je m'appelle René
J’suis gardien d’musée,
Galerie d’la Renaissance italienne;
Depuis 30 ans qu’ça dure,
J’fais partie des murs,
J’ressemble à une momie égyptienne.
Edison Museum, They Might be Giants (1999)
The Edison Museum, not open to the public
Its haunted towers rise into the clouds above it
Folks drive in from out of town
To gaze in amazement when they see it
[...] So when your children quarrel and nothing seems to quell them
Just tell them that you'll take them to the Edison Museum
------------------------------------------------------------------------------------------
Le musée Edison, fermé au public
Ses tours hantées s’élèvent dans les nuages au-dessus
Les gens arrivent de la province
Pour regarder avec admiration quand ils la voient
[...] Alors si vos enfants se querellent et rien ne semble les calmer
Dites leur simplement que vous les emmènerez au musée Edison

Visuel tiré de la version deluxe de l’album « No ! » de They Might Be Giants
Dans cette vision lugubre du musée, nous ne sommes pas à l’abri de nos frayeurs. Ce qui est drôle, c’est que si l’on regarde les films proposés chaque année pour Musé(em)portables, la majorité ont pour sujet le meurtre au musée. Mais d’où vient cette tentation ? D’abord, exposer des objets dont on doit parfois encore percer le secret, c’est ouvrir la porte à tous les fantasmes. Le mythe de l’objet maudit a été traité maintes fois au cinéma, qui n’a pas voulu devenir archéologue après avoir vu Indiana Jones ! Ensuite, tout ce qui a attrait à la mort s’accompagne naturellement d’une série de superstitions (fantômes, spiritisme…)
Mais l’image la plus effrayante, c’est celle du musée qui a vendu son âme au capitalisme.
Big Yellow Taxi, Joni Mitchell (1970)
They took all the trees, put 'em in a tree museum
And they charged the people a dollar and a half just to see 'em
---------------------------------------------------------------------------------------
Ils ont pris tout les arbres, les ont mis dans un musée d’arbres
Et ont facturé les gens 1 dollar et demi pour les voir
Le musée est devenu grotesque, car il exhibe indécemment le triste spectacle de la vie pour faire du bénéfice. Entre les personnalités glorifiées à tort et les œuvres volées, on vient souligner la difficulté (le refus ?) du musée à se défaire d’un passé problématique.
Dear England, Lowkey (2011)
People are humans, not mindless animals
This violent tyrannical system is fallable
Hand in a looter the minute you see 'em
But the biggest looters are the British museum
---------------------------------------------------------------------
Les gens sont humains, pas des animaux dénués de sens
Ce système tyrannique violent est faillible
Qui dénonce un voleur dès qu’il le voit
Mais les plus grands voleurs sont le British Museum
Complètement “déconnectés” de la réalité, les murs du musée s’ouvrent à des expôts dont le public a du mal à s’emparer (oui je parle de l’art contemporain), renvoyant ainsi le reflet d’une vanité.
Museum of Stupidity, Graham Parker (1991)
One day there'll be a museum of stupidity
We'll fill it up with exhibits of idiocy
[...] Look at the walls of the museum of stupidity
You're bound to find there every advert on american tv
And every page of the british gutter press
-------------------------------------------------------------------------
Un jour il y aura un musée de la stupidité
On la remplira avec des expositions d’idiotie
[...]Regarde les murs du musée de la stupidité
Vous y trouverez toutes les publicités de la télé américaine
Et toutes les pages de la presse de caniveau britannique
Mais ce serait dommage de terminer sur une note si négative. Vous prendrez bien un peu de romantisme ? Interprétée par le grand Tony Bennett, je vous laisse avec cette jolie chanson évoquant quelques splendeurs terrestres dont le musée.
You're All the World To Me (1951)
You're all places that leave me breathless,
And no wonder: you're all the world to me.
You're Lake Como when dawn is aglow,
You're Sun Valley right after a snow.
A museum, a Persian palace
-----------------------------------------------------------
Tu es tous les endroits qui me coupent le souffle,
Ce n’est pas étonnant : tu es mon monde,
Tu es le Lac Como quand l’aube rayonne
Tu es Sun Valley juste après la neige
Un musée, un palais perse
B.O
#chanson
#musique
Co-habitation, co-création : les nouvelles formes des ateliers d'artistes
Dans l'imaginaire collectif l'atelier d'artistes est situé dans un paysage de campagne ou en bord de mer dans une petite maison entouré de verrières ou encore, plus contemporain dans des lofts londonien ou new yorkais. Mais l'atelier d'artiste a d’autres ancrages que ces types d'environnement. Les besoins de l'artiste se définissent aussi suivant sa spécialité et par les facteurs liés à son statut. La situation parfois précaire des artistes complique les possibilités de location de lieux spacieux. Par ailleurs il n'est pas rare pour l'artiste de faire face à des rapports compliqués avec les bailleurs. Les loyers vont de 0 à 515 euros selon que l'artiste s'installe dans un squat ou loue un lieu seul1. Une situation fréquente est celle où l'artiste se trouve face à un bailleur social et que celui-ci mise sur la venue d’un artiste comme tremplin pour une revalorisation du quartier, une participation à la vie collective, voire des créations installées dans le lieu de résidence.Sur la métropole lilloises plusieurs collectifs d'artistes installés rencontrent des difficultés dans leur lieu de création : problèmes de partage de l'espace, stigmatisation par les habitants comme lieu de « squat», bâtiment peu cher mais construit avec de l'amiante obligeant ces lieux à fermer pour travaux de désamiantage (la Ferblanterie à Villeneuve d'Asq).
Toutes ces problématiques poussent de plus en plus d'artistes à s'installer en collectifs de différentes manières pour permettre des économies de loyers, mais aussi de la co-création et du prêt d'outils. Ce type d'atelier d'artiste collectif n'est pas si récent. Le mouvement des squats artistiques qui a commencé dans les années 90 a lancé et posé les questions qui ont permis à l'art et aux structures culturelles d'avancer. Aujourd'hui encore les collectifs d'artistes et quelques grandes institutions (Palais de Tokyo, le 104) vivent sur ces idées. Les grandes interrogations des squats étaient nombreuses, quel est le rapport de l'art à un quartier? Le partage est-il un moyen de contrer la vie précaire de l'artiste? Comment proposer plus de transversalité dans les œuvres d'art? Ainsi les squats développent de nouvelles manières de créer avec des solutions collectives en se penchant sur des logiques de plateau technique, sur un espace en dehors des normes ouvrant des possibilités, plutôt qu’un espace définissant un usage unique. Les squats proposent donc un espace de dialogue, d'échanges de création, de source d'inspiration.
Madagasyart © M. P.
« (…) le but final de toute activité plastique est la construction ! (…) architectes, sculpteurs, peintres ; nous devons tous revenir au travail artisanal, parce qu’il n’y a pas d’art professionnel ; il n’existe aucune différence essentielle entre l’artiste et l’artisan (…) nous voulons, concevons et créons ensemble la nouvelle construction de l’avenir, qui embrassera tout en une seule forme : architecture, art plastique et peinture (…) »
Extrait du manifeste du Bauhaus (1919)
Le manifeste du Bauhaus défendait l’égalité entre l’artiste et l’artisan tous les deux visant à créer. C’est cette notion que les tiers lieux et les collectifs d’artistes ont bien intégrées. En plus de voir le lieu comme des ateliers partagés ils les ont pensé comme ateliers de « créatifs », « appellation » plus large permettant de pouvoir associer artistes et artisans. Ainsi de plus en plus d’artistes s’installent dans des ateliers collectifs appelés tantôt tiers lieu tantôt collectif d’artistes. Selon les dires de plusieurs artistes interrogés à la Co-fabrik de Lille cela leur permet surtout d’échanger sur les techniques de chacun et de faire évoluer leur création mais aussi de leur donner de nouvelles sources d’inspiration. Une artiste en sérigraphie vient ainsi en aide à une artiste verrier pour lui permettre de trouver de nouvelles techniques pour faire de la sérigraphie sur verre ou encore une doreuse à la feuille d’or devient source d’inspiration pour créer de nouveaux bijoux en verre incrustés d’or.
Volume Ouvert © M. P.
Mais pour que cette collaboration et ce travail puissent se faire ensemble dans les meilleures conditions il faut prendre en compte les besoins de chacun. Certains créatifs ont effectivement des processus de création qui ne peuvent pas s’associer. Par exemple un ébéniste ne peut pas travailler à côté d’une peintre au risque de retrouver de la poussière de bois dans la peinture etc…C’est sur ses problématiques que travaillent aujourd’hui les nouveaux collectifs d’artistes. Par exemple à Volume Ouvert (collectif de Lille), chaque créatif qui s’installe exprime ses besoins en termes d’espace et d’isolation et construit avec des systèmes de cloisons en palettes son propre atelier allant de 10 à 70 m2 selon ses besoins. Néanmoins cela n’empêche par la coopération et la création d’un volume commun permettant exposition, cours, travail collaboratif selon les demandes des créatifs. De plus le fait de travailler dans un espace commun est aussi une demande des artistes pour ne plus être isolés dans leur création, pour partager leurs réseaux. C’est un facteur de lien, d’ouverture sur les autres qui permet une structuration de la profession et l’émergence d’une conscience collective.
La Co-Fabrik © M. P.
Ces expériences nous montrent que comme dans beaucoup de domaines actuels les professionnels se tournent vers plus de partage, de mutualisations des moyens et des lieux de sociabilités, favorisant une création transversale et transdisciplinaire. Aujourd’hui émergent les co-commisariats d’exposition et un climat d’échange qui pousse aussi les institutions à imaginer le musée de demain comme un lieu transdisciplinaire.
M. P.
#atelierdartistes
#cohabitation
#cocréation
________________________________________________________________________
1 Tarif tiré d'une étude sur l'île de France et les ateliers d'artistes en 2009 par le Conseil Régional d’île de France

Comment choisir l'exposition à visiter ?
Lorsque je pars découvrir une nouvelle ville, une capitale ou un nouveau pays, j’en profite pour découvrir ses musées et ses expositions. Cela me permet d’en apprendre davantage sur le pays, sa culture et les opinions de ses habitants sur certains sujets.
Il est parfois difficile de choisir le musée ou l’exposition que l’on souhaite visiter durant son voyage, en particulier lorsque l’on se trouve dans une ville telle que Paris, Londres ou Rome qui en proposent des centaines. Mon prochain dilemme concerne Berlin.
Une première solution serait de tout simplement suivre ce que les sites et guides touristiques proposent, tel que le font Tripadvisor ou Lonely Planet. Concernant Berlin, les premières possibilités proposées sont le Musée de Pergame, le Musée Historique Allemand, et la Topographie de la Terreur. Ces trois musées, des plus connus sur Berlin, possèdent les meilleures notations par les touristes sur ces sites internet. Même si ces musées exposent des sujets intéressants, la possibilité qu’ils ne traitent pas des thématiques qui me touchent personnellement et le risque qu’ils soient remplis de touristes à cause de leur renommée internationale me contraint à élargir mes recherches.
Le Musée de Pergame© Raimond Spekking
Du coup, seconde étape : chercher une liste complètedes musées sur Berlin. Soit un abécédaire des 175 musées sur le site de la ville. Afin de faciliter l’identification des musées, il est possible de faire des recherches selon différentes thématiques. Celles-ci sont l’histoire, la nature et les sciences, l’art, l’archéologie, etc. L’une des thématiques intrigue plus que les autres : les musées inhabituels : tel que le Musée des Mondes Souterrains de Berlin, le Musée des Lettres de l’Alphabet, le Musée en Plein Air des Lanternes à Gaz, le Musée des Chats et le Musée des Salles de Brassage Historique.
Le Musée des Mondes Souterrains de Berlin©Berliner Unterwelten e.V.
Une autre solution serait d’identifier les expositions temporaires qui sont proposées par les différents musées lors de la durée du voyage et de consulter leur site. Les expositions proposées en ce moment sont sur les médias sociaux, la surveillance dans l’art, les instruments de musique électroniques, les objets de Berlin lors de la guerre froide, etc.
Une dernière solution, et probablement la plus simple, est de se laisser conseiller par des amis ayant déjà visité ces musées. Ils partageront leurs coups de cœurs ou leurs avis mitigés.
Mon séjour sera court et je ne peux qu’en choisir qu’un. Je regarde les commentaires d’autres visiteurs et les critiques professionnelles de l’exposition, la localisation géographique, le coût d’entrée, les horaires d’ouvertures, etc. Cela en élimine mais le plus juste est de choisir un sujet ou une thématique qui m’interpelle. Si cette recherche m’a permis d’identifier de nombreuses expositions que je ne connaissais pas, j’ai décidé d’aller visiter la Kinemathek,le musée sur le film et la télévision, dont j’ai déjà souvent entendu parler. Ce musée propose une exposition « Things to come »sur la science-fiction lors des dernières dix années jusqu’au 14 Mai 2017.
Affiches de l’exposition Things to come© DeutscheKinemathek
Si j’ai envie de visiter ce musée, c’est parce que j’en ai entendu dire du bien. Le bouche-à-oreille a très bien fonctionné pour moi. C’est pour cela, que beaucoup de musées compte là-dessus pour vendre leurs expositions. Mais l’exposition doit avant tout proposer une thématique qui intéresse un public. Dans le cas de cette exposition, tous les amateurs des sagas de sciences fiction sont interpellés, mais pas seulement. Le musée tente d’interpeller un plus large public grâce à sa problématique : à quoi va ressembler notre futur ? Les films ne sont qu’un moyen de reproduire certaines possibilités. En quelques mots, le titre doit donner envie de visiter l’exposition.
« Things tocome – Science-fiction film » : il reprend la problématique, et dans un second temps il interpelle les amateurs de science-fiction. C’est bien la communication, qui permet de faire connaître l’exposition en dehors des habitués du musée, que ce soit par le bouche-à-oreille, les affiches, les publications dans les journaux ou sur les sites internet. La Kinemathek a réalisé trois affiches différentes, selon les trois principaux sujets abordés : l’espace, la société du futur et l’étranger. L’exposition ayant été inaugurée le 30 juin 2016, il est simple de trouver de nombreux articles critiques. Ce qui a permis à l’exposition d’être remarquée ? La connexion avec les 50 ans de la série Star Trek.
Sarah Pfefferle
#Berlin
#Quel musée visiter
#Deutsche Kinemathek
#Voyager
Liste des plus grands musées à Berlin : http://www.berlin.de/fr/musees/
Liste détaillée des musées de Berlin (en allemand) : http://www.berlin.de/museum/a-bis-z/
Site de la Kinemathek (en allemand) : https://www.deutsche-kinemathek.de/

Comment faire entrer mon chien au musée ?
A chaque visite de musée, la même question se pose : qui restera dehors pour garder le chien ? Et s’il était possible de faire autrement ? Culture pour (tou)tous !
Olaf gambadant joyeusement au Musée Guimet (montage) S.N.
Chaque fois que je veux faire une sortie musée en famille, le même problème se pose : qui d’entre nous restera dehors, pour garder Olaf ? Notre terrier du Tibet a beau être propre, sage et (presque) obéissant, impossible de faire entendre au personnel qu’il se tiendra bien : nos amis à quatre pattes ne sont pas les bienvenus, même en laisse, au milieu des collections muséales.
Incapable de me résoudre à laisser ce pauvre toutou dehors, je m’attelle à une nouvelle mission : est-il possible de faire entrer un chien au musée ? Quelles stratégies pouvons-nous mettre en place pour qu’il y soit accepté ?
Stratégie n°1 : Le naturaliser

Photos et montage : S.N.
Cette première stratégie semble radicale, mais c’est pourtant sous cette forme que nous croisons le plus souvent les animaux dans les musées, en particulier dans les Museums d’histoire naturelle, où les spécimens biologiques peuplent les vitrines comme les réserves. Dans les cabinets de curiosités, ancêtres des musées, se trouvaient déjà des naturalia, trésors de sciences naturelles, dont des spécimens naturalisés, au milieu des herbiers, pierres et autres fossiles.
Si ces animaux sont acceptés vidés de leurs chairs ou baignant dans du formol, dans chacun des cas, morts, il est plus rare que les animaux se baladent librement dans les collections, bien que des collections vivantes soient parfois conservées par les institutions.
Mon chien n’est pas encore mort, bien heureusement. Mais s’il l’était, serait-il possible pour lui de rejoindre des collections muséales ? Il faudrait dans ce cas faire don de son enveloppe naturalisée au musée, et que ce don soit accepté, ce qui n’est pas chose aisée.
Le Muséum de Toulouse présente ainsi les acquisitions des musées : « Quel que soit le mode d’acquisition, tout objet entrant dans le domaine public doit répondre à certains critères avant d’intégrer les collections. Il doit être conforme au projet scientifique et culturel (PSC) qui définit, entre autres, la politique d’enrichissement de l’établissement […]. La politique d’acquisition tient compte des aspects scientifiques, pédagogiques, esthétiques, de la documentation qui accompagne l’objet et de sa cohérence avec les fonds existants du muséum. » (« Politique d’acquisition et mode d’enrichissement des collections », L’écho des réserves).
Plusieurs contraintes rentrent donc en ligne de compte, et à moins de justifier d’un intérêt pédagogique particulier, de démontrer la beauté légendaire de mon chien ou d’avoir documenté ses exploits, il semble difficile de le faire rentrer dans des collections de museum.
Stratégie n°2 : Devenir une star (ou soudoyer des agents)

Montage : SN ; photos : capture d’écran du compte instagram de Demi Moore (@demimoore) / AH.
En juillet 2022, l’actrice et réalisatrice Demi Moore se rendait au Louvre en compagnie de son chien Pilaf pour admirer successivement la Joconde, Psychée ranimée par le baiser de l’Amour de Canova ou la Vénus de Milo. Cette visite a été très critiquée : alors que le commun des visiteurs se voient refuser l’accès au musée s’ils sont accompagnés d’un animal, il reste possible pour des célébrités de passer outre les consignes de sécurité et les règles de conservations préventives généralement appliquées. Pour faire découvrir à Olaf l’œuvre de Léonard de Vinci ou les peintures animalières de Rosa Bonheur (je suis sûre qu’il apprécierait), serais-je obligée de changer mes plans de carrière, et bénéficier de traitement de faveur par mon statut ou mes « généreux » mécénats ?
Stratégie n°3 : lui trouver un emploi au musée
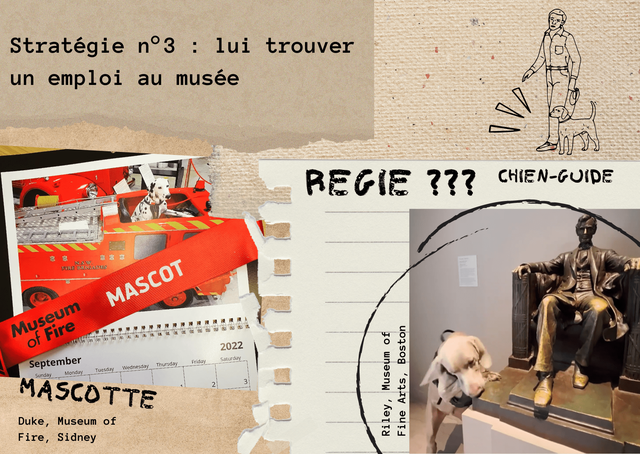
Montage : SN ; photos : capture d’écran des compte instagram du Museum of fire et du Museum of Fine Arts de Boston (@mof_sidney et @mfaboston)
Les chiens vivants sont bien souvent interdits d’accès dans les musées… mais ce n’est pas le cas de tous les chiens. Certains remplissent des rôles bien particuliers, qui leur donnent un statut et un accès privilégié aux salles d’expositions. Parmi ces chiens tolérés, les chiens-guides, qui permettent à leur maître aveugles ou malvoyants de se déplacer sans encombre dans les lieux publics. Interrogé dans le cadre de l’exposition Chiens et chats au Museum de Toulouse, Christian Lepinay, maître aveugle, précise : « un animal de compagnie on l’a chez nous, un chien-guide on l’a partout, on peut aller partout avec. […] La loi aujourd’hui nous permet d’accéder à tous les lieux publics avec nos chiens-guides », ce qui inclut donc les musées rentrant dans cette catégorie. Un long apprentissage est nécessaire aux chiens-guides, cela ne s’improvise pas, Olaf en est donc totalement exclu.
Il pourrait cependant remplir la fonction de mascotte qu’occupent certains chiens dans des musées : c’est le cas de Duke et Suki au Museum of Fire de Sidney, qui décorent les calendriers édités par le musée, sont pris en photos avec les visiteurs et sont même déclinés en peluches vendues dans la boutique.
D’autres chiens employés par les musées occupent des postes surprenants. Ils peuvent ainsi être chiens de berger pour les moutons d’un écomusée (Taff, au Food Museum de Suffolk), ou encore… régisseurs. Riley, un Weimanarer, travaille au Museum of Fine Arts de Boston, et assiste l’équipe de conservation en prévenant par son odorat entraîné les risques d’infestations de nuisibles (mites, insectes xylophages…) dans les collections.
Riley, the Museum Dog, Boston, Museum of Fine Arts (cliquer sur l'hyperlien pour voir la vidéo)
Montage : SN ; photos : capture d’écran du compte instagram du Museum of Fine Arts de Boston (@mfaboston)
Malheureusement, il est un peu tard pour commencer l’entraînement d’Olaf et faire de lui un régisseur du futur. A défaut, il reste possible d’explorer les espaces muséaux qui, par leurs contraintes de conservation moins strictes ou leurs espaces ouverts, permettent aux chiens de circuler librement.
Stratégie n°4 : Chercher des espaces de liberté

Montage et photos : SN
Les galeries, qui restent des espaces de vente et d’exposition davantage que des lieux de conservation, autorisent souvent les chiens à entrer dans leurs espaces. Olaf a ainsi pu découvrir récemment la peinture contemporaine au hasard d’une visite d’une galerie d’art. Fait encore rare, une récente exposition du Pavillon de l'Arsenal permettait également à ses visiteurs de venir accompagnés de leurs animaux de compagnie : dans "Paris Animal - Histoire et récits d'une ville vivante" (du 29 mars au 1er octobre 2023), les visiteurs à deux ou quatre pattes pouvaient découvrir l'histoire des cohabitations animales citadines.
Dans les parcs et sites ouverts au grand air, comme le Landschaftspark de Duisburg en Allemagne, les chiens en laisse sont les bienvenus et peuvent eux aussi découvrir ce lieu témoin du patrimoine industriel. L’accompagnement d’un chien révèle d’autres strates d’histoire des lieux. Regarder autour de soi est important, mais que nous racontent les odeurs ? Quelle perception du monde peut m’apporter l’animal ? Olaf peut-il sentir la trace des produits chimiques, l’odeur des machines et du charbon qui hante les lieux ? Dans le parc de sculpture du domaine de Kerguehennec en Bretagne, ou les parcs des châteaux de la Loire, il est plus intéressé par les animaux de passage que par l’art contemporain ou l’architecture, et il me force à m’y intéresser à mon tour. Faire des visites avec mon chien demande donc un peu plus de recherche et de souplesse dans les programmes, mais force à sortir de mes habitudes culturelles, et à lire les lieux non pas uniquement comme des lieux marquants du patrimoine humain, mais des lieux bien vivants fréquentés par des non-humains… Prêter attention à ces êtres traversant les lieux permet d’être, finalement, davantage attentifs à leur présence, leur confort, mais aussi à percevoir leurs performances. La musique animale, des chants d’oiseaux aux aboiements, à peut-être autant d’importance qu’un duo de pianistes. Les murmurations des oiseaux au crépuscule valent bien la chorégraphie d’un cercle celtique. La toile d’une araignée est-elle une construction architecturale moins aboutie qu’une cathédrale ?
Et, si la plupart des musées leur sont fermés, il nous reste la fiction pour imaginer ces promenades à quatre pattes :
Museum Trotter, par Julie Dumontel, Pauline Tiadina et Olympe Hoeltzel, 2nd prix du jury au concours Musé(em)portable 2023.
Sibylle Neveu
Pour aller plus loin :
- Clémence de Carvalho , Exposer le vivant : entre attraction et curiosité, L’Art de Muser , 01/03/2021
- Journée d’étude de l’association des élèves-conservateurs de l’INP : Plus vif que mort ! L’animal en patrimoine, le 16/04/2019
- « Politique d’acquisition et mode d’enrichissement des collections », L’écho des réserves, blog du Museum de Toulouse
- « Demi Moore et son chihuahua au Louvre, Jason Momoa à la Chapelle Sixtine, quand les passe-droits des stars font bondir les internautes », Connaissance des arts, 09/08/2022
- Mooc des musées de la ville de Strasbourg et de la Fondation Orange : « L’animal, les musées et moi »
- carte toutouristique du site Tourisme avec mon chien
- Dans le cadre de l'exposition Chiens & chats présentée au muséum de Toulouse du 5 Octobre 2016 au 17 juin 2017, un film retraçant la vie d'un chien guide a été produit par le Muséum en partenariat avec l'école des Chiens Guides du Grand Sud Ouest. Réalisation : Stéphane Dumont et Eddy Gomis (Anakena Productions).
- Exposition "Paris Animal - Histoire et récits d'une ville vivante", du 29 mars au 1er octobre 2023 au Pavillon de l'Arsenal
#chien #mascotte #animaux

Comment visiter du bout des doigts ?
Vous êtes un professionnel de la culture ? Vous travaillez dans une institution qui cherche à rendre accessible son parcours permanent aux visiteurs malvoyants ou non-voyants ? Vous souhaitez améliorer l’expérience de visite de tous ? Cet article est fait pour vous.
L’accessibilité universelle au musée ?
L’accessibilité universelle, concept auquel se réfèrent les professionnels, vise à offrir un accès au musée adapté à tous les publics, ce qui passe par la prise en compte des besoins spécifiques de chacun – dont les publics en situation de handicap font partie. Et ce, afin de proposer un parcours de visite unique, utilisable par tous les visiteurs, qui favorise une expérience de visite positive. S’il peut paraitre utopique d’imaginer pouvoir répondre aux besoins de chacun, des outils permettent de se rapprocher de cet idéal. De même, l’ensemble des outils ou dispositifs de médiation – hormis les vidéos en LSF*, qui sont ciblées pour les publics sourds signant et le braille – améliorent le confort de visite de chacun. Simplifier et clarifier les textes expographiques en FALC* profite autant aux visiteurs maîtrisant mal le français, aux enfants, qu’aux personnes en situation de handicap intellectuel. Les objets à toucher tels que les fac-similés ou les images visio-tactiles participent quant à eux à rendre le musée didactique et ludique, et se démarquent d’une vision élitiste. L’accessibilité globale est rendue possible dans l’enceinte de la structure muséale par une prise en compte non seulement du cadre bâti, mais également des contenus. Elle est établie comme un idéal vers lequel les établissements muséaux souhaitent et doivent tendre. Si ce postulat n’est pas admis de tous, l’accessibilité est – enfin – questionnée et mobilisée comme une prérogative essentielle des projets d’établissements culturels. Ainsi, elle s’est progressivement imposée comme une condition pour répondre à l’une des missions essentielles du musée : accueillir les publics.
L’émergence des parcours tactiles, un engouement récent
Depuis une dizaine d’années, de nombreux musées français engagés dans une démarche d’accessibilité se dotent de parcours tactiles. Jalonnant les espaces permanents, des stations permettent de découvrir un nombre restreint d’objets à toucher sous la forme de maquettes, de facsimilés en 3D ou d’images dites visio-tactiles – dont les lignes de contours mettent en relief un objet 2D.
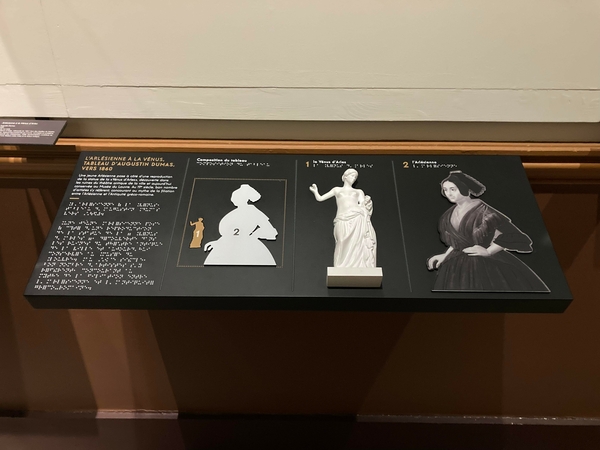
Station tactile du Muséon Arlaten « L’arlésienne à la Vénus » ©CL.
Pour les visiteurs privés de la vue, la découverte par le toucher est le principal mode d’appréhension et de compréhension des œuvres. Si ces dispositifs sont systématiquement conçus en ayant à l’esprit les besoins des publics en situation de handicap visuel, ils sont aussi le reflet d’une politique d’ouverture à tous les publics. En particulier les familles, et sont également conçus à cet effet. Récemment, divers établissements culturels se sont dotés de parcours tactiles. Musées nationaux, musées départementaux, musées de province, les tutelles et les statuts de ces institutions diffèrent. Les contextes de réalisation de ces parcours également : construction du musée, rénovation, refonte du parcours permanent ou encore ajout au parcours existant. Plusieurs musées nationaux ont vu le jour en France au 21e siècle, c’est notamment le cas du musée du Quai Branly – Jacques Chirac en 2006, ainsi que du Mucem, plus récemment en 2013. Ce premier est l’une des premières institutions à avoir intégré une démarche d’accessibilité de ses outils dans les parcours permanents, et ce, dès la construction du bâtiment. Aussi, dès l’origine, il existe dans ces deux sites une volonté d’être accessible. Cela se traduit notamment par l’intégration de parcours tactiles. Par ailleurs, au regard de la loi de 2005 et des nouvelles obligations d’accessibilité au sein des établissements culturels, plusieurs musées ont dans le cadre de lourds projets de rénovation, engagés d’importants travaux de mises aux normes et de réaménagements, impliquant la fermeture temporaire des établissements. L’occasion de réfléchir à l’accessibilité globale souhaitée dans ces futurs musées. Loin de se limiter à la conception d’un parcours tactile pour les publics déficients visuels, ces musées développent une offre plurielle et multisensorielle. Pour d’autres institutions culturelles, cette réflexion s’inscrit dans l’ADN du musée. À cet effet, les projets de refonte du parcours permanent apparaissent comme une véritable aubaine pour poursuivre la démarche engagée. Enfin, il existe un autre type de cas, plus rare cependant, où le parcours tactile n’est pas pensé en même temps que le parcours permanent, venant ainsi s’ajouter à postériori. C’est ce qui a été fait au Lugdunum Musée et Théâtres romains, à Lyon. Ce qui pose un certain nombre de difficultés, notamment en termes de cohérence.
1ère étape : sensibiliser les équipes
Porter un projet d’accessibilité suppose de travailler avec une équipe sensibilisée. Certains établissements optent pour la nomination d’un chargé de mission handicap et accessibilité, plus communément appelé « référent accessibilité ». Véritable personne-ressource, il est de son ressort d’avoir une vision transversale des besoins et de proposer des actions et outils concrets afin d’améliorer l’accessibilité du site. Le référent travaille en collaboration avec l’ensemble de l’équipe du musée, mais également avec les partenaires extérieurs tels que les architectes, graphistes, scénographes, afin de les rendre attentifs à tous les niveaux. Cependant, le reste de l’équipe se doit de garder à l’esprit la diversité des publics à besoins spécifiques auxquels s’adressent les expositions produites. C’est pourquoi certains établissements privilégient les postes de chargés des publics. D’autres, comme le MuséoParc Alésia, créent un pôle accessibilité, dont fait partie un représentant de tous les services du musée. Si la sensibilisation en interne repose sur la bonne volonté de chacun, elle est également le fruit d’un long travail rythmé par des journées de formations annuelles permettant à chacun de se sentir concerné. L’obtention de la labellisation Tourisme & Handicap apparait par ailleurs comme un véritable moteur d’engagement.
« Parce que d'une part, si l’on obtient le label, cela permet de communiquer dessus, d'être référencé sur le site qui est assez consulté par les personnes en situation de handicap. Mais c’est aussi l'occasion de faire un audit, donc ça donne des outils précieux pour avancer en interne et c’est une bonne manière afin d’établir une feuille de route et définir des priorités pour se rendre accessible » (Chargée de mission RSO du musée du Quai Branly Jacques Chirac, entretien réalisé le 15/06/2022)
Enfin, l’accompagnement d’un professionnel de l’accessibilité est particulièrement conseillé. L’équipe du musée peut s’entourer d’un consultant spécialiste, notamment pour réaliser un diagnostic, établir des préconisations en vue d’une labellisation et définir les besoins spécifiques à prendre en compte. Par ailleurs, nombre d’institutions travaillent de concert avec une assistance à maîtrise d’ouvrage – AMO*. Ses compétences de conseil permettent d’alerter sur les points de vigilances, de rédiger les cahiers des charges, de sélectionner les entreprises compétentes, de suivre la fabrication des dispositifs sélectionnés, mais aussi d’établir des liens et des partenariats avec des représentants institutionnels ou associatifs du champ du handicap. A titre d’exemple, l’agence Polymorphe design a accompagné le MuséoParc Alésia, l’entreprise Accèsmétrie a assisté le Muséon Arlaten et l’agence Handigo guide actuellement le Musée national de la Marine. Ainsi, en étant entouré par des professionnels qualifiés, très au clair avec les normes et préconisations en vigueur et en contact avec les représentants associatifs, les projets sont plus à même d’être menés à bien et de répondre véritablement aux attentes des publics à besoins spécifiques.
2sdétape : concevoir les dispositifs de médiation
Chaque projet est singulier : par la temporalité qui lui est propre, les enjeux internes à l’institution, les changements de mandatures, les coûts financiers attribués, les thématiques soulevées dans l’exposition, l’espace disponible, les différents acteurs impliqués et les relations créées. L’écosystème du projet est profondément lié à la méthodologie choisie et malgré un guide très détaillé édité par le ministère de la Culture et de la Communication, tout n’est pas applicable et relève du cas par cas. C’est souvent au service médiation que revient la mission de concevoir les dispositifs de médiation. Celui-ci doit donc penser la réflexion sur les contenus accessibles comme une réflexion sur les publics. Prenons l’exemple du Musée national de la Marine, dont le projet de conception du parcours tactile est en cours. La méthodologie employée est la suivante : l’équipe commence par définir les informations qu’elle souhaite transmettre (le contenu), puis les objectifs et les rôles de chaque dispositif, avant de définir les besoins spécifiques des différents publics à prendre en compte et enfin, la forme qui leur sera donnée. Il est question de diversifier les approches. Les dispositifs sont conçus et pensés d’abord pour leur rôle de transmission d’un discours manquant, qu’ils viennent compléter. Par ailleurs, le parti-pris muséographique de l’institution, en ce qui concerne les dispositifs tactiles, est de rendre compte des émotions procurées par les œuvres.
« On est parti espace par espace. Au tout départ : de quel sujet je parle ? Comment est-ce que je peux répéter l'information ou la compléter pour que ce soit clair ? Quelles activités peuvent être intéressantes ? Quel registre j'ai envie de mobiliser ? Est-ce que j'ai envie de faire rire les gens, de leur faire peur, de leur susciter de l'émotion, de leur rappeler quelque chose qui est familier pour eux ? […] Je pense que la réflexion pour nous, elle a été différente que pour d'autres musées. C'est de se dire « qu'est ce qui est important pour moi quand je vois une œuvre, moi, voyante ? ». Et en fait, c'est l'émotion qu'elle me procure. Donc j'ai besoin de comprendre à minima à quoi ressemble l'œuvre si c'est une sculpture, si c'est un tableau, si c'est un modèle. Quel format ? Qu'est-ce qu'elle présente ? Et surtout, quelle émotion elle dégage ? On a ensuite travaillé sur les besoins, comment transmettre ce contenu. Et une fois que vous avez un peu tout listé, comment on fait pour rentrer ça dans un seul et même dispositif. » (Chargée de médiation et référente accessibilité au Musée national de la Marine, entretien réalisé le 15/06/2022).
Pour l’équipe du MuséoParc Alésia, il était primordial d’avoir un outil de médiation adapté à chaque moment du parcours. Pour ce faire, un lutrin jalonné de dispositifs de médiation guide les visiteurs et répond à cette demande. La réflexion sur les contenus s’est ensuite centrée sur les grandes typologies de handicap, afin de définir les outils à mettre en place. Ici, le parti pris muséographique est de multiplier les supports, afin que chaque visiteur puisse au gré de son envie et de ses compétences, interagir ou non avec les dispositifs à sa disposition.

Visiteur s’apprêtant à toucher une reproduction de pièce de monnaie au MuséoParc Alésia ©Sonia Blanc.
3ème étape : identifier les besoins spécifiques
« Il faut se dire une chose, c'est que toutes les personnes mal ou non voyantes n'ont pas ce qui est mon cas justement, de représentation à plat dans l'espace. Moi, si vous me faites toucher une carte ou un dessin, j'ai du mal. Je sais qu'il y a des personnes qui y arrivent très bien, surtout les aveugles tardifs, mais nous les aveugles de naissance, on a une très mauvaise représentation à plat dans l'espace. » (Visiteuse de musée en situation de handicap visuel, bénévole de l’Association Valentin Haüy, entretien réalisé le 13/07/2022)
Un aveugle de naissance n’a pas les mêmes besoins qu’un aveugle tardif, tout comme il existe une diversité de degrés de malvoyance. C’est pourquoi il est important de varier les approches et les dispositifs, et de ne pas seulement proposer des images visio-tactiles, afin de ne pas exclure de visiteurs. Proposer une reproduction de l’œuvre en trois dimensions, avec des textures se rapprochant de la matière originelle de l’œuvre ou de l’objet en question, et privilégier une charte unique pour tous les dispositifs aux couleurs contrastées est ainsi recommandé. Par exemple, augmenter les contrastes sur les différentes parties d’un facsimilé permet à un visiteur malvoyant de mieux identifier la composition d’une œuvre.

Station tactile du Muséon Arlaten « Tarasque de procession », les couleurs choisies sont le blanc et le jaune ©CL.
« Malheureusement il y a peut-être 4 ou 5 œuvres qui sont mises en avant et qui sont représentées sur toute une exposition, donc ce n’est pas énorme. On est un peu frustré, on a juste accès à ce dont on a bien voulu nous mettre en reproduction. » (Visiteuse de musée en situation de handicap visuel, bénévole de l’Association Valentin Haüy, entretien réalisé le 15/07/2022)
Le nombre de stations tactiles a son importance, puisque les œuvres ou les objets présentés sont les seuls auxquels les visiteurs non-voyants auront accès. Il en est de même pour le braille – un système d’écriture tactile –, qui semble intrinsèquement lié à l’accessibilité des contenus. Or, seulement 10% des déficients visuels lisent le braille. En outre, cela signifie que très peu de visiteurs sont en mesure de lire et comprendre ces documents. Imprimer des cartels en braille ne suffit donc pas à rendre les parcours d’expositions accessibles. Cependant, bien que son utilisation soit très spécifique, les associations du champ du handicap visuel préconisent d’y avoir recours, en doublant toutefois l’information d’un contenu textuel (en gros caractère) et/ou sonore. Et ce, afin d’éviter toute stigmatisation des publics non-brailistes. Il faut par ailleurs noter qu’un texte en braille est beaucoup plus long qu’un texte dit en noir. Le choix du contenu répond donc des contraintes techniques et spatiales de chacun. Si pour certaines institutions l’écriture en braille est une traduction exacte des cartels, pour d’autres il s’agit d’un nouveau texte résumé sous la forme de courtes phrases, ou encore d’une synthèse comprenant les informations de base. Synthétiser le texte en braille est également recommandé au regard de la concentration que cela requiert. Enfin, pour un confort d’usage optimal, les cartels en braille doivent être inclinés et fabriqués avec des matériaux résistants à l’écrasement.
« J’ai visité une exposition avec un audioguide et en fait on se perdait parce qu’il y avait plein de tables avec des choses à toucher, l’audioguide parlait, mais bon malheureusement il ne vous disait pas « tournez à gauche, tournez à droite », ce qui fait que vous n’aviez rien sous les pieds. Et en fait, on y allait au petit bonheur la chance. » (Visiteuse de musée en situation de handicap visuel, bénévole de l’Association Valentin Haüy, entretien réalisé le 13/07/2022)
Par ailleurs, si les éléments tactiles sont indispensables pour avoir accès au message global de l’exposition, ils ne sont pas suffisants s’ils sont appréhendés seuls. Un audioguide ou une audiodescription – une description orale des éléments visuels – est nécessaire à la bonne compréhension des expôts, et facilite la découverte tactile. Dans un souci d’autonomie et pour repérer l’emplacement des dispositifs accessibles, il est particulièrement recommandé que l’audioguide apporte des indications de déplacements. Toutefois, la mise en place de bandes podotactiles et d’un guidage au sol à l’utilisation d’une canne blanche reste la seule solution qui permet une autonomie complète des visiteurs non-voyants. A titre d’exemple, le LWL Industrial Museum à Dortmund, en Allemagne, présente une exposition permanente inclusive. Installée dans un ancien bâtiment administratif, le parcours est équipé d’un système de guidage au sol depuis l’entrée du bâtiment jusqu’à sa sortie. Il guide les visiteurs mal ou non-voyants vers un plan de chaque salle présentant les objets à toucher, les points d’écoutes et les images visio-tactiles ainsi que la disposition des cimaises. Les visiteurs peuvent appréhender l’espace en toute sécurité et profiter pleinement de l’expérience de visite.

Bandes podotactiles, image visio-tactile et buste à toucher au LWL Industrial Museum, Dortmund ©CL.
4ème étape : tester les dispositifs avec les publics concernés
« Solliciter les associations ou les usagers eux-mêmes pour avoir leur avis, c'est vraiment l'essentiel, je pense. Ça rallonge les processus de création, de validation, etc, mais si on ne convie pas les personnes elles-mêmes, on va systématiquement tomber à côté de la plaque. Même avec toute la bonne volonté du monde, même en étant formé. » (Chargée de mission RSO du musée du Quai Branly Jacques Chirac)
Afin que les dispositifs conçus soient réellement utilisables et appropriables, il faut travailler avec les publics concernés. Ici, la co-construction est entendue comme le fait d’associer à la conception des dispositifs à destination des publics à besoins spécifiques, les usagers eux-mêmes. Et ce, par le biais de réunions ou de groupes de travail dans lesquels sont préconisés les mesures à mettre en place, les besoins à prendre en compte, les améliorations à effectuer. L’acte de co-construction le plus aboutie étant la validation en cours de réalisation des dispositifs – ou des prototypes –, testés plusieurs fois par un petit groupe de personnes en situation de handicap. Dans le cadre des parcours tactiles, il est recommandé de demander à des personnes aux degrés de malvoyance différents. Cette co-construction garantit une expérience de visite adaptée. Toutefois, ces phases de test et de validation allongent les délais, notamment quand les dispositifs doivent être revus, il est donc important de prendre en considération ces derniers lors de l’établissement du rétroplanning. A défaut de ne pas pouvoir réaliser de tests utilisateurs, des compromis peuvent être trouvés comme la consultation d’un comité composé de relais associatifs.
5ème étape : ne pas négliger la médiation humaine
« Je pense que de toute façon, il faut qu'il y ait quand même un guide qui soit présent. Parce que le tactile ne vous donnera jamais des explications détaillées sur une œuvre. Il faut que ce soit une combinaison des explications orales et du toucher. » (Visiteuse de musée en situation de handicap visuel, bénévole de l’Association Valentin Haüy)
Le guide est largement privilégié à l’utilisation de l’audioguide, notamment pour le rôle communicationnel et participatif de l’expérience proposée, et la possibilité d’interaction qui en découle. La présence d’un guide est également préférée en ce qu’elle diminue la fatigabilité des visiteurs. En effet, la navigation tactile requiert une grande concentration, et accéder au contenu n’est pas aisé. Ne pas avoir à lire les cartels en braille ou à chercher l’information peut permettre de maintenir son attention sur un temps plus long. En cela, l’appropriation des parcours tactiles, la compréhension des œuvres et la satisfaction retenue de la visite sont profondément liées à l’accueil et l’accompagnement humain proposés au sein du musée. Les médiateurs culturels sont les premiers représentants de l’institution muséale, et les garants d’une expérience de visite agréable.
6ème étape : communiquer sur l’offre
Concevoir un parcours tactile est une première étape pour rendre accessible le musée aux publics mal et non-voyants. Bien que ces dispositifs profitent à tous, il est important que le musée soit perçu comme un lieu adapté dans lequel le visiteur, quelles que soient ses envies, puisse profiter pleinement de la visite. De ce fait, il ne suffit pas d’avoir les outils à disposition pour que ces derniers soient utilisés. Les musées dans leur mission d’accroissement, de fidélisation et de diversification des publics ne doivent pas se contenter d’attendre que les visiteurs viennent à eux, ils doivent aller chercher les publics en transmettant l’information. En effet, les institutions culturelles ayant récemment conçu une offre accessible peinent à attirer ces publics, notamment dans le cadre des visites spécifiques. Le défi pour ces musées dont l’accessibilité est récente, est de communiquer auprès des publics sur l’existence d’une offre qui leur est adaptée. Ils peuvent prendre contact avec les organismes et des associations locales et nationales – Association Valentin Haüy, CFPSAA, Les auxiliaires des aveugles, apiDV, Voir ensemble... Les supports d’information créés leur sont envoyés et l’information est diffusée aux adhérents par le biais de l’emailing et des magazines spécialisés, édités par les associations nationales. En guise d’exemple, le Lugdunum Musées et Théâtres romains, a créé une brochure envoyée à près de 500 structures médico-sociales réparties sur le territoire Lyonnais. Mais tout cela prend du temps et il ne faut pas s’attendre à ce que les effets positifs soient visibles immédiatement. De fait, le rôle du « bouche à oreille » n’est pas à négliger. Les publics étant plus enclins à visiter un site recommandé par un proche digne de confiance.
Les parcours tactiles, des dispositifs nécessaires mais insuffisants
Pour conclure, concevoir un parcours tactile à destination première du public déficient visuel ne suffit pas à rendre le musée accessible. Dans la réalité des faits, l’expérience de visite est régie par un grand nombre de facteurs, et la visite ne débute pas dans l’espace d’exposition. Afin de proposer une expérience de visite accessible à tous, il faut nécessairement penser l’accessibilité dans sa globalité. La conception d’un dispositif de médiation ne doit pas être pensée ex-nihilo, mais en lien avec son environnement, immédiat ou non. Et si les parcours tactiles sont à destination de tous les publics, ils ne s’inscrivent pas dans une démarche d’accessibilité universelle. A la différence des parcours multisensoriels. En effet, la multiplication des canaux sensoriels permet d’appréhender les œuvres, les expôts ou encore le discours général de l’exposition, et ainsi la découverte et l’apprentissage selon les envies et compétences / capacités de chacun. Lorsqu’une personne est privée d’un sens, varier les modes d’approches sensorielles permet de proposer une expérience adaptée. Concrètement, ces parcours multisensoriels se présentent comme des stations sur lesquels la mobilisation de tous les sens est rendue possible, et ce pour tous les visiteurs. A titre d’exemple, le Musée d’Aquitaine à Bordeaux a récemment inauguré un parcours sensoriel composé d’une trentaine de stations. Certaines mobilisent simplement le toucher, d’autres présentent des dispositifs olfactifs, etc. Au Musée des Augustins à Toulouse, un parcours multisensoriel qui n'est pas encore ouvert au public proposera également une série de stations qui mobilisent les sens et font vivre aux visiteurs une véritable expérience.

Module « L’orgue » du parcours Touchez la musique au musée de la Musique ©CL.
Camille Leblanc
*LSF = La Langue des Signes Française est une langue visuelle et gestuelle qui permet de communiquer par des signes.
*FALC = Le Facile A Lire et à Comprendre est une méthode d’écriture simple développée en France par l’Unapei.
*AMO = Pour assumer pleinement son rôle, le maître d’ouvrage peut s’adjoindre les compétences d’un assistant au maitre d’ouvrage.
Pour aller plus loin :
- CASEDAS Claire, « Les publics en situation d’handicap visuel », podcast J’ai l’œil du tigre, n°46, 26 octobre 2021, 20 min.
- LEBAT Cindy, « Une muséologie du sensible : enjeux et conséquences pour les visiteurs déficients visuels », Les cahiers de muséologie, n°2, 2022, 15 p.
- LEBAT Cindy, « Les personnes en situation de handicap sensoriel dans les musées : réalités d’accueil, expériences de visite et trajectoires identitaires », Héritage culturel et muséologie, Thèse, Université Sorbonne Paris Cité, 2018, 512 p.
- SALMET Ariane, « Expositions et parcours de visite accessibles », Ministère de la Culture et de la Communication, collection Culture et handicap, 2017, 148 p.
#Expositions #Accessibilité #Handicap
Cultures souterraines
Qui n'a jamais rêvé de s'enfoncer sous terre, d'explorer grottes et lacs souterrains, équipé d'une lampe frontale, d'une carte, d'une combinaison et d'un harnais ? Il en est sûrement parmi vous qui ont réalisé ce rêve, amateurs ou professionnels. Mais n'importe qui ne peut pas s'improviser spéléologue, et encore moins dans un cadre urbain. Dans les milieux cataphiles¹, vous êtes un « touriste » si c'est votre première descente. La cataphilie contemporaine est proche de l'urbex, l'exploration urbaine. L'urbex consiste à explorer des lieux construits par l'homme, abandonnés ou non, interdits ou difficiles d'accès. Être cataphile ou explorateur urbain ce n'est pas la même chose, les seconds qui aiment les souterrains ne sont pas des cataphiles.
Quid du culturel dans tout cela ? Et bien, certains de ces amateurs de souterrains ont choisi de rendre accessibles ces endroits à un public, certes peu nombreux. Différentes initiatives peuvent être recensées, mais la plupart d'entre elles restent inconnues, introuvables. Festivals, expositions, lieux culturels, on trouve de tout sous terre !
Sous terre, tout est possible
La Mexicaine de perforation est probablement le plus connu de ces groupes, responsable des Arènes de Chaillot, salle de projection clandestine sous le palais de Chaillot. Branche « événements artistiques » de l'UX, agrégation de groupes clandestins, la Mexicaine de perforation a pour but de créer des zones libres d'expression artistique. À l'origine de plusieurs festivals de cinéma mais aussi de représentations théâtrales, LMDP n'investit pas uniquement des lieux souterrains (le Panthéon, les grands magasins,...). Urbex Movies et Sesión Cómod sont les deux festivals qui ont été organisés par LMDP. Le premier projetait des classiques sur le thème de la ville comme Eraser Headde David Lynch, Fight Clubde David Fincher ou encore Ghostin the Shellde Mamoru Oshii. Le second projetait des films en lien direct avec le souterrain, comme La Jetéede Chris Marker ou Le Dernier Combatde Luc Besson. En 2004 la salle de projection fut découverte par la police, et EDF porta plainte pour vol d'électricité (il fallait bien faire fonctionner ce cinéma...).
La salle de projection clandestine à Chaillot ©Urban Resources
Directement issue de l'héritage de la Mexicaine de Perforation, la Clermontoise de Projection Underground, basée à Clermont-Ferrand, organise lors du Festival Underfestprojections, concerts et expositions. A lire dans « Urbexet culture avec la Clermontoise de Projection Underground » à paraître bientôt !
Bien sûr, tout cela est clandestin, et donc interdit. Même sans laisser de trace, pénétrer dans un lieu privé est interdit par la loi. Celui qui se fait prendre s'expose à des poursuites. C'est pour cela que tous ces événements ne concernent que quelques personnes, en général entre trente et cinquante. De plus, la communication est très limitée, il n'est pas toujours facile de savoir comment procéder pour assister à un de ces événements ! C'est le cas des vernissages de Madame Lupin, des expositions d'art contemporain dans des lieux insolites, interdits au public. Il faut réserver sa place, les instructions sont envoyées très peu de temps avant la tenue de l'exposition. Avec quatre expositions à son actif, cette association propose des lieux aussi éclectiques qu'une piscine désaffectée, le fort d'Aubervilliers, un lieu souterrain ou encore le musée des Arts et Traditions Populaires². En plus de ces expositions, l'association organise régulièrement des dîners des lieux insolites. L'exposition Hiddenunder the sand se déroulait dans un lieu souterrain inconnu, partiellement ensablé.
« Hiddenunder the sand » ©G.V.
Des événement culturels clandestins ?
Toutefois, l'occupation culturelle d'un lieu souterrain ne se fait pas forcément de manière illégale, des initiatives légales ont aussi vu le jour. En Croatie, la ville de Pula a pris l'initiative d'ouvrir ses souterrains datant de la Première guerre mondiale au public, tout en proposant régulièrementdes expositions et des manifestations culturelles.
Les souterrains de Pula ©S.B.
Le festival Art souterrain de Montréal
Encore plus développé, le festival Art souterrain se tient à Montréal tous les ans, à l'occasion de la Nuit Blanche. Le but de ce festival est d'exposer les œuvres d'environ quatre-vingt artistes dans la ville souterraine. En effet, la ville possède un réseau souterrain ultra développé (33 km sous terre) qui permet de relier les différents quartiers de la ville. De nombreux commerces et services sont implantés dans ce réseau. En 2016, pour la 8ème édition, le festival Art souterrain a proposé quatre circuits qui emmenaient le public dans treize édifices souterrains.
Doté d'un commissariat d'exposition, le festival propose aussi un parcours « satellite », dans des galeries et lieux culturels de la ville, ainsi qu'un grand nombre d'activités. Visites guidées, visites d'ateliers d'artistes ou médiations pour les scolaires sont proposées tout au long du festival, qui dure presque un mois entier. La prochaine édition se déroulera du 4 au 26 mars 2017, et aura pour thème « Jeu et diversion ».
Et même sur Google !
Sur un terrain plus institutionnel et dématérialisé, Google Arts & Culture regroupe sous le projet Curio-cité des expositions en ligne et des explorations urbaines dans des lieux normalement interdits au public, inaccessibles ou même détruits. Ainsi il est possible de « visiter » les sous-sols du palais de Tokyo, la verrière du Grand Palais, ou encore la fameuse tour 13, investie par de nombreux artistes puis démolie.
L'occupation culturelle des lieux souterrains par des collectifs est due à une convergence entre le fait de braver l'interdit, de redonner un but à des lieux désaffectés, de contrer un système « élitiste » de l'exposition, et tout simplement aussi, de partager des moments chaleureux. La plupart de initiatives sont probablement inconnues, tenues secrètes. Faut-il qu'elles restent telles quelles, ou qu'au contraire, il y ait de la communication et donc une ouverture au public ? Une normalisation, une légalisation, une institutionnalisation ? Cela ne risquerait-il pas de les faire disparaître, de déformer ces pratiques si uniques ?
Juliette Lagny
#artsouterrain
#urbex
1 Un cataphile est une personne qui aime visiter les anciennes carrières souterraines de Paris, de manière interdite.
2 Article sur l'exposition au musée des Arts et Traditions Populaires http://www.linstantparisien.com/paris-underground/
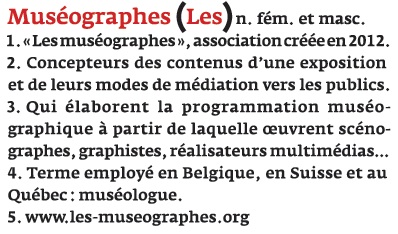
Demain serons-nous tous muséographes ?
Il faudrait déjà expliquer ce qu’est un muséographe. Vaste question traitée par des experts du sujet1. Pour simplifier l’on pourrait dire que le muséographe conçoit l’exposition en accord avec le commanditaire (contenus, publics, conservation, …) et coordonne bien souvent les différentes équipes en charge de la production. Muséographe ou expographe ? Le débat est aujourd’hui encore ouvert.
1-Couverture de la plaquette de communication Voyagez avec Matisse © C.R.
Cet article n’a pas la prétention de donner une définition claire de ce que devrait être mon métier, mais plutôt de montrer que les compétences acquises à travers ma formation et mes expériences peuvent m’amener sur d’autres chemins que celui de l’exposition. Actuellement je travaille majoritairement sur deux projets, la création d’un outil de médiation numérique pour le Musée Matisse du Cateau-Cambrésis - en collaboration avec deux entreprises régionales - et la création d’un coffret de trois ouvrages augmentés sur Amedeo Modigliani pour les éditions invenit2. Ces deux missions, ne consistent pas à concevoir et produire une exposition mais de manière plus large des projets culturels. Peut-on alors penser que je suis une jeune muséographe ?
Être muséographe, c’est d’abord être curieux. Il est essentiel de s’intéresser à tous les sujets : sciences, ethnographies, société, … et parfois même Histoire de l’Art lorsque le poste de muséographe ne se confond pas avec celui de conservateur. A cette curiosité s’allie une grande rigueur scientifique, et une capacité à vulgariser3 le contenu. Il vaut mieux apprécier les journées de lectures, le travail avec des spécialistes et la longue recherche du mot le plus approprié. Ce sont exactement ces compétences qu’il m’a fallu mettre en place pour ces deux projets. Je passe de longues heures en bibliothèque, j’échange avec des conservatrices spécialistes du sujet et tente de décrire en quelques lignes des concepts qui pourraient être un sujet de thèse ! Dans le cadre de Voyagez avec Matisse, nous avons avec l’équipe muséographique4, créé un concept innovant à partir de nos connaissances du sujet. N’est-ce pas la base du travail de muséographe ?
2 - ColetteNys-Mazure, Valloton, le Soleil ni la mort, collection ekphrasis © éditionsinvenit
Être muséographe c’est également être extrêmement rigoureux et organisé. La gestion de projet est une part essentielle de notre travail. Organigramme, rétroplanning, budget, protocole de validation, convention, contrat de cession, … sont autant d’outils indispensables. Il vaut mieux maitriser Excell, Indesign et MindMap. Ces outils étant utilisés par l’ensemble des acteurs du projet il est essentiel qu’ils soient compris et utilisables par tous. La coordination commanditaire, conseils cientifiques, scénographe et direction de production mis en place pour une exposition, offre bien des similitudes avec la gestion de tout projet culturel.
Pour chaque expérience et quelle que soit la structure (associative, municipale ou entreprise) mes « intitulés de poste » n’ont jamais été muséographe, mais plutôt chargée de missions, chargée de projet, ou encore assistante chef de projet. Cependant à aucun instant je n’ai eu l’impression de pas exercer le travail de muséographe, et de ne pas mettre en application les compétences acquises dans le cadre de mon master. Ma polyvalence semble s’être élargie et à un an de la fin de mes études, cela me rassure de pouvoir postuler à des postes de types différents dans le milieu culturel.
Aujourd’hui il me semble déjà savoir que je n’exercerai pas le même poste toute ma vie, je serai peut-être expographe un jour, ou alors je mettrai mes compétences en gestion de projet au service d’un autre domaine que la culture, qui sait ?
Marion Boistel
# muséographe
#futur
#vie professionnelle
1 -
- François Mairesse et André Desvallées, sous la direction de, Dictionnaire Encyclopédique de Muséologie, Armand Colin, 2011.
- André Gob et Noémie Drouguet, La Muséologie, Armand Colin, 3ème édition, 2008.
- Serge Chaumier et Agnès Levillain, Qu'est-ce qu'un muséographe ?, La Lettre de l'OCIM : http://hal.inria.fr/docs/00/47/22/81/PDF/m_levillain_chaumierlo.107pp.13-18.pdf
2 - Les éditions invenit ont développé une collection nommée ekphrasis, autour d’une œuvre d’art une carte blanche est offerte à un écrivain. La collection Récits d’Objets possède quant à elle dans le rabat du livre, un lien vers une application permettant d’accéder à différents contenus : modélisation 3D, comparaisons avec d’autres œuvres et brèves explications, entretiens avec les auteurs et/ou les commissaires d’exposition. Le projet de coffret, développé dans la collection Ekphrasis mêle ces deux concepts.
3 - Terme au final peu approprié, qu’on pourrait remplacer par « rendre accessible à tous », mais il s’agit ici d’un autre débat …
4 - Remarquez qu’on parle bien d’équipe muséographique !

Des musées comme des aéroports ?
Comment un musée peut-il mieux servir son public ? Comme je passe beaucoup de temps dans les aéroports, l’autre jour, après une escale de quatre heures à Chicago O’Hare, j’ai commencé à réfléchir sur les similarités entre les deux types d’établissements.
Crédit : JC
Les iPads à l'aéroport Toronto Pearson (YYZ). Crédit : JC
Il est clair que les musées et les aéroports n’ont pas le même but : les aéroports, comme des gares de trains, sont des grosses salles d’attente pour faciliter le transport des personnes et des biens. Les musées sont censés être des lieux de recherche et de sauvegarde, des endroits presque sacrés ! Mais restez avec moi ; prenez l’exemple de votre ami qui n’aime pas les musées. Avant de s’interroger sur les raisons qui font qu’il est votre ami, voyons pourquoi cette personne abhorre les musées.
Car enfin, tandis que les aéroports sont des lieux de transition, les musées sont les lieux de transmission. Mais pour votre ami « muséophobe », un aéroport est aussi un lieu public parfois :
- 1. Frustrant, pour comprendre le sens d’orientation, à la signalétique indispensable
- 2. Usé, délaboré
- 3. Ennuyeux
- 4. Claustrophobe
- 5. ou bien trop vide
Cette description vous rappelle de quelque chose ?
Pour l’aéroport, comme pour le musée, vous vous munissez d’un billet d’entrée rempli d’informations. Dans le cas d’un voyageur fréquent (avec numéro de fidélité), l’aéroport vous connaît mieux que vous le supposez. Avec ce numéro de voyageur fréquent, la compagnie aérienne sait que, par exemple, le mois dernier vous avez passé dix jours au Canada, que vous faites souvent l’aller-retour à Marseille en semaine qui indique un voyage d’affaires, et que parfois vous voyagez à deux, souvent vers les destinations ensoleillées. Ce numéro vous permet d’accéder aux endroits spécialisés —la Sky Lounge Air France, ou votre commande habituelle, un gin tonic vous attend. Vous êtes salué par votre nom dès votre entrée dans le bâtiment, avec un accueil chaleureux et personnalisé. Quel plaisir vous trouvez lors de vos voyages. Vous auriez même envie de simplement rester à l’aéroport !
Et si nous élargissons ce plaisir aux autres lieux qui accueillent le public ? Nina Simon, auteur du livre The Participatory Museum, compare les musées avec un autre établissement inédit : les casinos. Tandis que le résultat n’est pas le même, nous pouvons apprendre pas mal de choses sur la customisation de l’expérience muséale. Avec la carte d’adhèrent d’un casino (Simon emploi l’exemple de Harrah’s) qui est inséré dans chaque machine et à chaque table de jeux, et pour retirer les jetons à la caisse et retirer son argent gagné (sous réserve !). La carte permet à l’établissement de savoir à quelle fréquence l’usager vient au casino, combien il dépense, et son « point de douleur » (après avoir perdu 87 euros, il s’arrête). Quand l’usager vient au guichet pour collecter ses gains, l’insertion simple de sa carte permet à la caissière de voir le nom du client (Bonjour, M. Martin), sa fréquentation (tous les mardis de 17h à 19h), et ses habitudes pendant son séjour (il adore le poker). La caissière peut voir, par exemple que comme M. Martin aime le poker, peut-être il sera éventuellement intéressé par une nouvelle table de poker qui peut apparaître prochainement, ou le tournoi de poker qui aura lieu dans deux semaines. Quel bonheur de pouvoir répondre et s’adapter aux besoins de son public avec un telle exactitude et efficacité ?!
Grâce à votre Carte d’Abonnement toutes vos visites deviennent qualifiantes*
Votre Carte d’Abonnement du Club Muséo vous fait bénéficier du statut de «visite qualifiante» pour toutes vos visites sur le réseau de sites* du Club Muséo.
Cette carte vous tente? Crédit : JC
Les musées rêvent de faire pareil.
Cette idée de customisation n’est pas hors la portée des musées ; au contraire, ce type d’adaptation aux publics est même préférable pour les musées et les lieux culturels. Plusieurs établissements ont déjà un système d’abonnement mais qui n’exploitent pas les informations recueillies. Imaginons si à chaque glissement de la carte, l’agent d’accueil a la capacité de saluer notre cher visiteur, de voir sa fidélité au musée, et de pouvoir recommander un évènement ou une exposition qui rentre dans ses intérêts. Quelle satisfaction de venir au musée et se sentir chez soi grâce à l’expérience customisée !
Donc, pendant cette saison hivernale, pour que les musées ne deviennent pas des grosses salles d’attente qu’on visite uniquement en cas d’intempéries, réfléchissons sur les opportunités que les musées peuvent nous offrir. Plus nous pouvons tisser de liens avec nos publics, plus ils auront envie de revenir nous voir. Le gin tonic est facultatif !
Jill CARLSON
#personnalisation
#fidelisationdespublics
#participation
Lisez The Participatory Museum de Nina Simon en anglais, ici : http://www.participatorymuseum.org

Des musées du futur au futur des musées : les musées de science-fiction
Avant-propos : cet article dévoile l’intrigue de plusieurs récits, listés à la fin, afin de pas les divulgâcher.
Image d’intro : Le commandant Cooper du film Interstellarvisite sa maison muséifiée (Interstellar, 2014, Christopher Nolan). Dessin : Marco Zanni.
Super-musée planétaire, mémorial aux victimes de l’Anthropocène ou musée-forum utopique … Cinq ans après la mission Musées du XXIème siècle, il est tentant de porter un regard plus spéculatif sur l’avenir.
Le musée, relique de notre civilisation
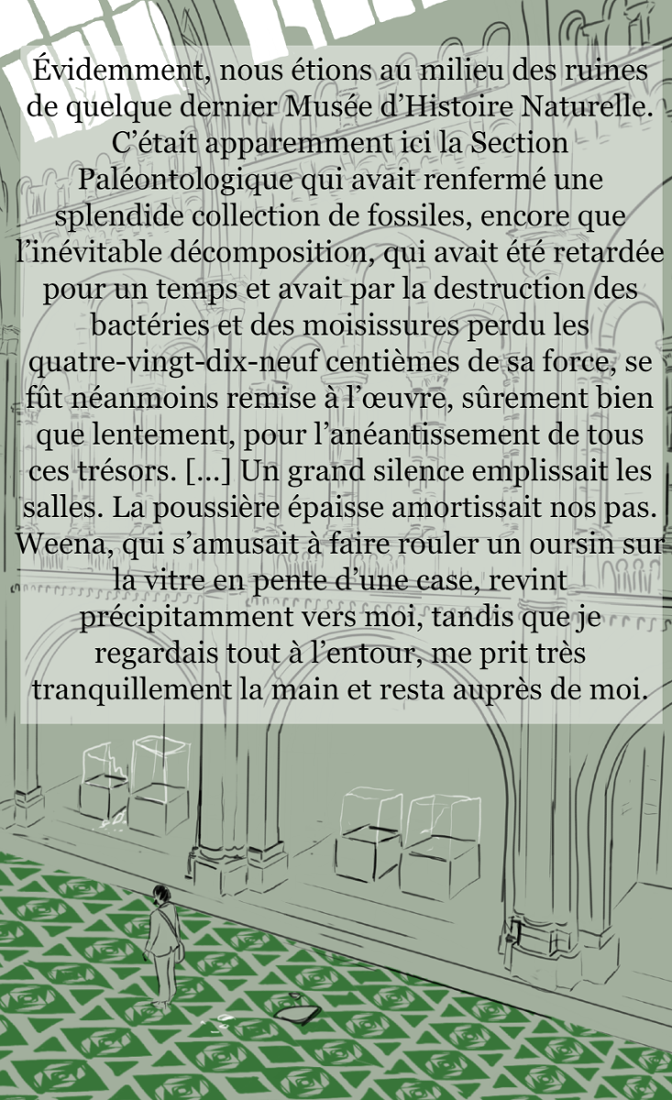
Le héros découvre le Palais de Porcelaine, basé sur les musées du début du XXème siècle comme le South Kensington Muséum, actuel Muséum d’Histoire Naturelle de Londres. (Extrait de La Machine à explorer le temps, H. G. Wells, 1895, chap. XI). Dessin : Marco Zanni.
Le musée dystopique : lieu de pouvoir et de contre-pouvoir

Le capitaine George Taylor découvre son lieutenant naturalisé, poursuivi par un singe (La Planète des Singes,Franklin Schaffner, 1968, 20th Century Fox). Dessin : Marco.
La science-fiction, un outil de réflexion muséologique ?
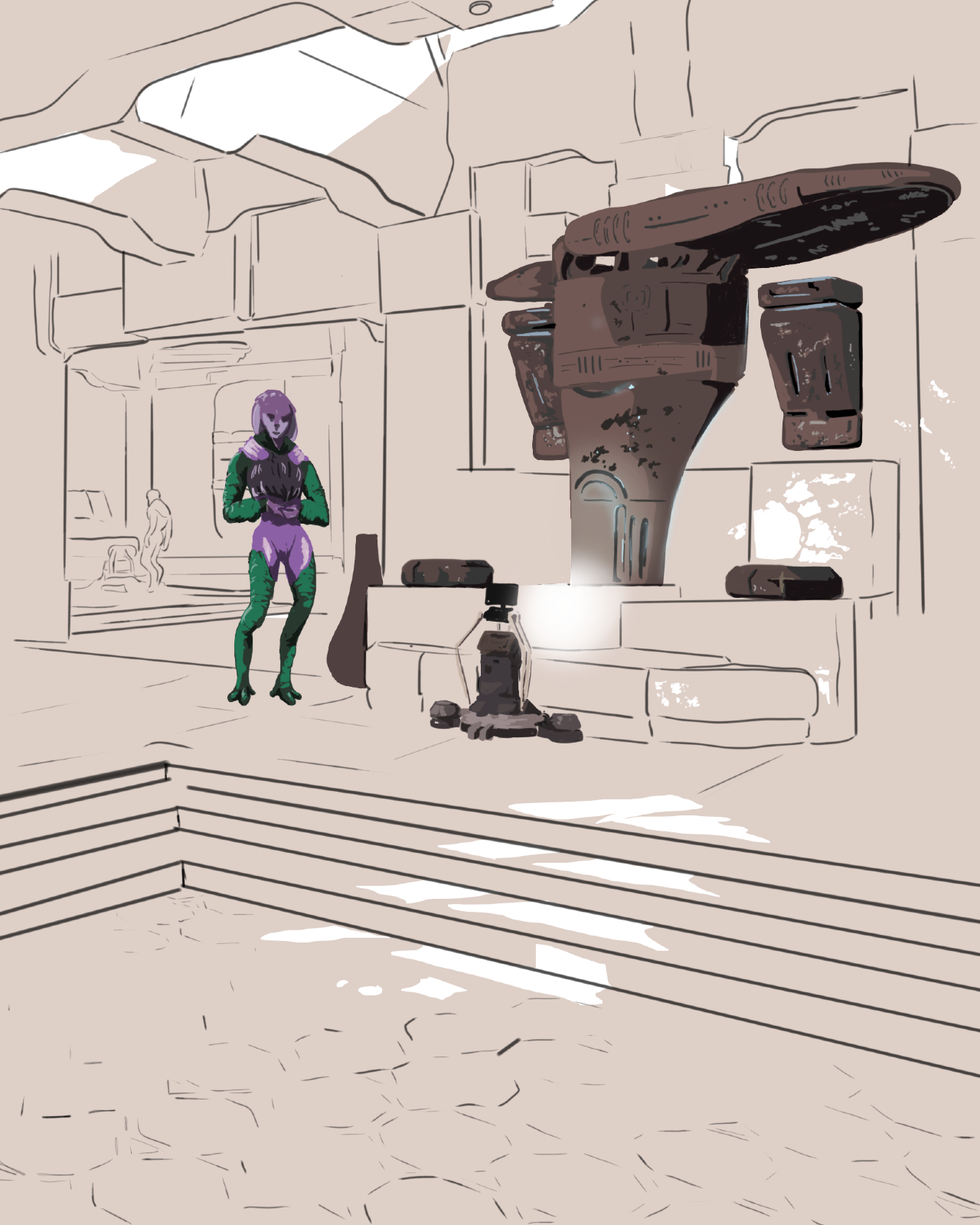
Le musée de la population Angara et sa conservatrice, du jeu Mass Effect Andromeda (Electronic Arts, 2017). Dessin : Marco.
Sources :
- Amy Butt, 2021. “The Present as Past : Science Fiction and the Museum”,Open Library of Humanities,vol. 7/1.
- Annie Van-Praët, 2011. “L’Image du musée dans le cinéma de fiction”,Hermès, la Revue, vol. 61/3
- Pierre-Antoine Pellerin, 2020. “ Le Joker au musée dans Batman de Tim Burton, ou le vandalisme artistique entre avant-garde et culture populaire”, Interfaces, n°43.
- Alain Musset, 2014. “Ciudad, apocalipsis y ciencia-ficción”,Bifurcaciones, revista de estudios culturales urbanos, n°17.
- Bruno Brulon Soares (trad. Marion Bertin), 2020. “Rupture et continuité : le futur de la tradition muséologique”,ICOFOM Studies Series, vol. 48/1.
- “Why Museum Professionals Need to Talk About Black Panther”, The Hopkins Exhibitionist,22/02.18.
Liste des œuvres citées :
-
La Machine à Explorer le Temps (The Time Machine: An Invention), H.G. Wells, 1895 ;
-
Interstellar, Christopher Nolan, 2014 ;
-
Nous Autres (Мы), Yevgeny Zamyatin, 1920 ;
-
La Planète des Singes (Planet of the Apes) , Franklin Schaffner, 1968 ;
-
Batman, Tim Burton, 1989 ;
-
Equilibrium, Kurt Wimmer, 2002 ;
-
Mass Effect Andromeda, Electronic Arts, 2017 ;
- Black Panther, Ryan Coogler, 2018."
Pour aller plus loin :
#musée #science-fiction #fiction

Des musées font leur festival!
Cette année j’ai passé mes vacances à Budapest, pour découvrir son impressionnant parlement, la douce chaleur des bains thermaux, le quartier juif très animé, le musée de la Terreur à l’histoire douloureuse, mais surtout le Sziget Festival !
Une île sur le Danube est presque entièrement consacrée à ce festival pour accueillir un demi-million de « Szitoyens » tels qu’on les appelle ici.
À peine arrivée, la tente installée pour 3 jours, je consulte le programme et me rends très vite compte que je n’arriverai pas à profiter de toute cette mini ville reconstituée : une dizaine de scènes, un cirque, un théâtre, un cinéma, une fête foraine, un parc aventure, des terrains de sport, un quartier d’artisanat, un espace artistique, des Food trucks à n’en plus finir et surtout un quartier de musées.

Programmation du quartier des musées, Sziget Festival 2017. © C.D.
Après une bonne nuit de concerts et quelques heures de sommeil je cours voir de quoi il s’agit. En effet, c’est bien un véritable quartier avec une rue principale et des musées éphémères à découvrir de chaque côté. Pas moins de 10 musées de Budapest (excepté un musée parisien) se partagent la vedette :
- Le musée d’Aquincum
- Le musée d’Histoire militaire
- Le musée des Arts décoratifs
- Le musée de la bande dessinée et de la caricature
- La maison hongroise de la photographie
- Le musée hongrois de science, technologie et de transport
- Le musée national de Hongrie
- Le musée d’histoire naturelle
- Le musée d’Ethnographie
- Le musée de l’Immigration de Paris

Entrée du quartier des musées, Sziget Festival 2017. © C.D.
Chaque institution propose une découverte de son musée à sa façon.
Le musée d’Aquincum présente une reconstitution au style « bricolé » de l’intérieur d’une villa antique hongroise. Plusieurs activités sont proposées pour les visiteurs : les ateliers de parure pour les plus manuels, les jeux antiques pour les plus stratèges, sans oublier des soldats romains qui combattent à l’épée plusieurs fois par jour. Une occasion d’impressionner le public et d’inviter à l’échange.
Pour ceux qui ont rêvé de se mettre dans la peau de « Bones », le musée d’Histoire naturelle est fait pour vous ! En touchant trois véritables crânes humains du XVIIIe siècle, vous devez deviner quel était le sexe du défunt. Pour poursuivre la découverte des collections du musée, une exposition de panneaux et de vitrines racontait le parcours de divers explorateurs hongrois.
Le musée National Hongrois proposait des tests de personnalité pour se mettre dans la peau de personnages historiques locaux, et des goodies à réaliser soi-même ; badges et éventails estampillés avec les œuvres d’art du musée.
On ne pouvait non plus rater le bus « Ikarus », au milieu de toutes ces tentes, déplacé par le musée hongrois de science, technologie et de transport.Le musée ne pouvait se passer de l’un de ces bus typiques de Budapest des années 1970. On plongait alors dans le temps pour composter son propre ticket, entrer dans le bus et en apprendre plus sur son histoire.
La maison de la photographie rencontre aussi un franc succès ! Et pour cause le musée propose aux visiteurs de se prendre en photo dans deux mini-studios avec deux fonds différents et des costumes ; l’un était un fond vert, l’autre un fond de style 19e siècle. Les festivaliers se sont prêtés au jeu avec plaisir et repartent avec une photo inédite en souvenir.
Outre des ateliers de dessins, le musée de la bande dessinée et de la caricature, a invité les concepteurs du court métrage « Dirty Fred » à se prêter au jeu de la médiation. Le réalisateur et d’autres membres de l’équipe sont donc présents pour nous faire découvrir le projet par le biais d’un questionnaire et de nombreux goodies à la clef.
Le musée d’Histoire militaire a ravit les amateurs de batailles du 20e siècle avec une exposition sur les hussards hongrois pendant la première guerre mondiale et la présentation de costumes et d’armes d’époque.
Trônait également l’impressionnant dôme en céramique du sommet du musée des arts appliqués.Un atelier permettait de réaliser des rosaces en sable coloré afin de reproduire le motif de la verrière du musée. J’ai particulièrement apprécié jouer avec les collections du musée qu’il s’agissait de replacer selon différents critères, esthétiques ou financiers, montrant alors que l’appréciation d’une œuvre est relative.
La « tente sans frontière » accueillait le musée d’Ethnographie de Budapest et le musée de l’Immigration de Paris. Un partenariat a été mis en place entre les deux musées il y a 2 ans et c’est que qui a permis de les réunir cette année sous la même tente autour des thématiques de l’immigration et de l’intégration. Des expositions panneaux étaient à découvrir sur les côtés de la tente et au centre un grand écran avec un espace de dialogue et de documentation. Cet espace de 100m2 a accueilli de nombreuses animations tout au long de la semaine de festival : conférences, débats, présentations d’artistes, projections de films, etcetera.






Pendant ce voyage à travers les musées de Budapest, les différentes propositions de médiation se mélangeaient afin de recevoir au mieux ces publics si variés. On retrouvait des présentations plutôt classiques d’expositions panneaux et d’objets (en vitrines ou non), mais aussi des ateliers plus décontractés toujours en lien avec le musée et ses collections, des moments d’échanges et de co-création, et surtout des rencontres avec le personnel du musée dans un contexte totalement inédit. De nombreux médiateurs étaient là pour nous accueillir que ce soit pour un moment de détente ou quelques minutes d’apprentissage.
Le Sziget Festival fête cette année son 25ème anniversaire, et cela fait plus de 10 ans que le quartier du musée a vu le jour. Il faut dire que le festival ne ménage pas ses efforts pour booster le tourisme de la ville. Le pass du festival permettait d’avoir une réduction de 50% sur plusieurs musées dans Budapest et d’autres villes jusqu’à fin août 2017. Il existait aussi des « city pass » permettant de prendre les transports gratuitement et d’obtenir des réductions pour les thermes et diverses boutiques en ville. Un vrai plus pour rendre plus confortable le voyage de tous les festivaliers de passage dans la capitale.
Une belle découverte donc que ce surprenant quartier de musées, où se mêlent les institutions culturelles, le public et les artéfacts et où l’on rebondit de découvertes en découvertes suivant ses envies. L’idée de prime abord étonnante, que des musées soient représentés dans un festival, prend finalement tout son sens. Toutes ces personnes sont venues pour partager une passion commune : la musique. N’est-elle pas le médium par excellence qui à la fois transcende et différencie chaque population ? Tout comme les musées qui rassemblent les créations de l’Homme et de la nature, elle permet) à la fois de s’identifier et de découvrir l’autre. Les festivals, comme les musées, sont des lieux d’ouverture vers le monde qu’il ne faut pas hésiter à expérimenter.
DIY : Comment momifier son ancêtre préféré
D’après l’exposition « Les momies ne mentent jamais », Cap Sciences
Cher lecteur, chère lectrice,
Tu viens de perdre un ancêtre que tu aurais bien aimé garder un peu plus longtemps ? J'ai la solution pour toi ! Elle est un peu sanglante, mais très efficace ! Vois-tu, aujourd'hui je vais te donner la recette pour la garder à tes côtés encore très (très) longtemps ! Et oui, nous allons suivre le processus de momification de la civilisation sud-amérindienne Chinchorro qui a vécu au Chili entre 10 000 et 3 400 ans avant JC (il y a donc fort, fort longtemps).
Corps de Sirène, Musée Maritime, Helsingor, Danemark
Pour momifier ton ancêtre tu auras besoin de :
- Un ancêtre
- De l’eau (une grande carafe, on ne sait jamais dans quel état est le/la mort.e)
- Un grand récipient d'eau salée (5 litres, selon la taille du/de la mort.e)
- Un désert (ou des charognards, tout dépend du paysage autour de ton lieu d'habitation)
- Un couteau (qui coupe vraiment bien)
- Une paire de gants (sauf si vraiment, le sang ou les maladies ne te posent pas de problèmes)
- Un sèche cheveux
- 5 morceaux de bambou (de la taille des membres du mort de préférence)
- De la ficelle
- Du fil et une aiguille
- De la pâte végétale (un gros pot)
- De l'argile
- Un bâtonnet type potier
- Des pigments (de la couleur que tu préfères, pour les Chinchorros c'était noir à partir de 6000 avant JC, deux millénaire plus tard c’était rouge et 500 ans plus tard ils choisissaient d’utiliser de la boue)
- Une brosse
© Margot Coïc, image d'une momie Chinchorro
Une fois que tu as réuni tout ce matériel, assez hétéroclite certes, nous pouvons passer à la recette :
La première étape est de nettoyer le corps, si tu l'as gardé c'est qu'il n'est pas passé entre les mains d'un croque-mort et on ne sait pas trop dans quel état il est, personnellement je te conseillerai de demander à quelqu'un qui ne connait pas le défunt.e de s'en occuper mais bon (à moins que tu aies quelques contacts et dans ce cas là : bien joué !).
Ensuite (tiens toi bien), incise (avec délicatesse) la peau au niveau du cou des poignets et des pieds. Passe tes mains sous la peau des chevilles et tire la peau d'un coup sec, mais délicat, afin de la retirer, comme un pyjama. La peau humaine est très fragile, il ne s'agirait pas de la déchirer. Retire ensuite la peau du visage, des pieds et des mains et dépose le tout dans ton grand récipient plein d'eau salé, après avoir retiré les cheveux. Range le pour plus tard.
Découpe le bas du ventre, glisse tes mains sous la chaire et les muscles et retire les organes. Selon ton envie, ou ton humeur du moment, tu peux soit les abandonner dans ton désert, soit les déposer tout autour de ta table d'opération pour décorer (chacun son style, n'est-ce-pas ?). Il te reste tout de même le cerveau, les Chinchorros laissaient le crâne intact car ils passaient par la jonction entre les vertèbres et le crâne, c'est à cet endroit précis que tu vas inciser la chaire pour récurer le crâne et retirer le cerveau (il ne faudrait pas que ça pourrisse !). On utilise donc le même procédé que pour la citrouille d'Halloween !
La quatrième étape porte le très sympathique nom suivant : le démembrement (à toutes les personnes qui ont eu le plaisir de démembrer des barbies, amusez-vous !) un petit coup de sèche-cheveux au niveau des articulations, une petite incision pour les nerfs et c'est parti : on tire d'un coup sec ! CRAC ! Pour la tête, les bras et les jambes. On abandonne le tout dans un désert (ou si vous avez un petit élevage de loups, de tigres ou de lions - je ne le dirais pas à Brigitte Bardot promis !), pour que les charognards mangent la chaire et retrouver dans quelques semaines des os bien propres et bien blancs !
Entre temps, amuse toi à tisser avec les cheveux une jolie perruque.
Quelques semaines plus tard, récupère ces membres. Il risque de manquer quelques phalanges, quelques petits os mais ce n'est pas très grave, ne t'inquiète pas. Assemble-les à nouveau dans l'ordre anatomique (sauf si tu as toujours rêvé de voir ta grand-mère avec des pieds à la place des bras). Attache chaque membre à un morceau de bambou grâce à la ficelle et plante le dernier dans le thorax avec la tête posée dessus. Une fois ton squelette tout assemblé recouvre le de pâte végétale afin de redonner du volume au corps.
Comme la pâte végétale c'est super glissant tu peux sortir la peau de son récipient et la glisser sur le corps à nouveau, avec délicatesse bien-sûr ! Ces deux dernières étapes permettent de redonner un aspect humain à ton ancêtre parce que jusque-là, avouons-le il n’était pas très sexy-chocolat.
Tu es prêt.e ? On passe au moment marrant. Avec de l'argile crée un masque et utilise ton bâtonnet pour dessiner les traits du visage (c'est l'occasion de donner à mémé un sourire ravageur !) saupoudre ensuite la peau de pigment noir, rouge ou bien de boue, selon la technique Chinchorro que tu préfères et frotte à l'aide d'une brosse.
Positionne ta perruque sur la tête et recoud les morceaux de peau qui se sont déchirés.
Voilà ton ancêtre est magnifique, prêt.e à prendre place sur ton fauteuil préféré pour l'éternité ! Tu peux aussi la sortir lors de pique-niques ou soirées familiales en tous genres en évitant les remarques pas toujours très politiquement correctes ! En tous cas les Chinchorros n'hésitaient pas à leur demander conseils quelle que soit la situation (genre, si tu devais épouser la voisine ou le voisin).
Après quelques temps ton ancêtre risque d'être un peu défraîchi, tu peux lui redonner un joli minois grâce à quelques produits cosmétiques spéciaux !
Je n'ai pas encore eu le plaisir de l'essayer sur mes ancêtres mais j'espère que ce petit DIY te sera utile le moment venu !
Margot Coïc
Cet article a été écrit à la suite de l’animation « À la table des Momies ». Merci à la médiatrice qui m’a tout appris sur la momification Chinchorro et qui a réponduà toutes mes questions pendant l’exposition.
Lien : http://www.cap-sciences.net/au-programme/exposition/les-momies.html
#Momies
#Chinchorro
#Absurde

Dons, quelle politique d'acquisition ?
Légende photo de couverture-vignette : Centre de conservation et de ressources © Yves Inchierman, Mucem
Légende photo d’intro de l’article : Les réserves visibles du Louvre Lens © Louvre Lens
Qui dit musée dit collections, sauf rares exceptions, à mettre en valeur et qui dit collections dit acquisitions et enrichissement de celles-ci. La valorisation du musée et de ses collections passe en partie par une politique d’acquisition définie. Les musées sont généralement fiers de présenter à leur public les nouvelles acquisitions, qui peuvent être le résultat d’achats ou de dons prestigieux. Au contraire, ils ne parlent jamais des dons refusés, de ces objets que des particuliers souhaitent offrir à titre gratuit aux musées de leur choix pour les voir valoriser. Il n’y a en effet pas de raison pour que les musées mettent en avant à travers leur communication les dons refusés, qui n’entrent pas dans les collections, puisque par définition ils ne font pas partie du musée. Pourtant, l’acte même de refus est particulièrement intéressant à questionner. Il offre une réflexion sur la démarche des musées, sur leur Projet Culturel et Scientifique (PSC) et la politique d’acquisition qu’ils suivent. Aussi analysons les politiques d’acquisition des musées pour comprendre ce qui définit l’entrée ou non des dons en collection, et la gestion qui s’en suit.
Le caractère inaliénable des collections de musée

Page Internet du Musée des Tissus (Lyon) : faire un don d’œuvre
Préconisation sur les politiques d’acquisition
Élaboration des politiques d’acquisition
Il est donc primordial pour tout musée de bien définir sa politique d’acquisition afin d’être en mesure de savoir si les dons peuvent intégrer les collections ou bien s’ils doivent en être écartés. Elles sont mentionnées et explicitées dans le PSC des musées, lui-même élaboré tous les cinq à dix ans. La durée de vie d’un PSC met déjà en avant une difficulté : celle d’élaborer une politique qui dure dans le temps. Les recherches et objectifs d’un musée à un moment donné, établis dans le PSC, ne sont plus forcément les mêmes à la fin de sa validité. La mise à jour de ce dernier est donc indispensable pour poursuivre la bonne cohésion de la collection et continuer à acquérir ou non les œuvres de la façon la plus pertinent possible. De plus, elle détermine si la politique d’acquisition est une priorité pour le musée ou non, et dans le cas des dons cela peut grandement aider de fixer les axes à suivre dans l’intégration ou le refus de dons par l’équipe de conservation.

Vitrine de la Galerie des dons du Musée national de l’histoire de l’immigration © Anne Volery, Palais de la Porte Dorée, 2019
- Ainsi, il faut privilégier des objets dont la valeur scientifique est importante et qui justifie d’un intérêt public dans les domaines d’histoire, art, ethnologie, science etc. Mais comment comprendre l’expression valeur scientifique ? Pour appréhender la valeur d’un tel objet, il faut dans un premier temps avoir une très bonne connaissance de sa provenance et de ses propriétaires. Au-delà de cet aspect, la valeur scientifique se comprend à partir de l’intérêt apporté par l’objet dans l’enrichissement des collections. Tous les dons ne se valent pas et n’apportent pas le même savoir pour le musée qui le possède.
- À partir de là, se développe l’idée de la continuité des collections qui fait partie intégrante de la politique d’acquisition. Il est difficile en effet pour un musée de justifier l’acquisition d’un don qui n’a rien à voir avec les collections. Il s’agit alors d’accepter des dons qui sont en rapport avec les collections, mais surtout qui viennent les compléter et combler des lacunes sur une période historique ou un courant artistique, un·e artiste, un fonds ou une collection précise.
- Les refontes d’espace ou chantiers des collections peuvent également amener à des précisions de la politique d’acquisition. L’évolution d’une approche dans un musée, nouveau discours scientifique, changement muséographique amènent en effet le besoin d’enrichir les collections et de compléter l’existant selon les nouvelles intentions scientifiques et muséographiques.
Traitement des dons
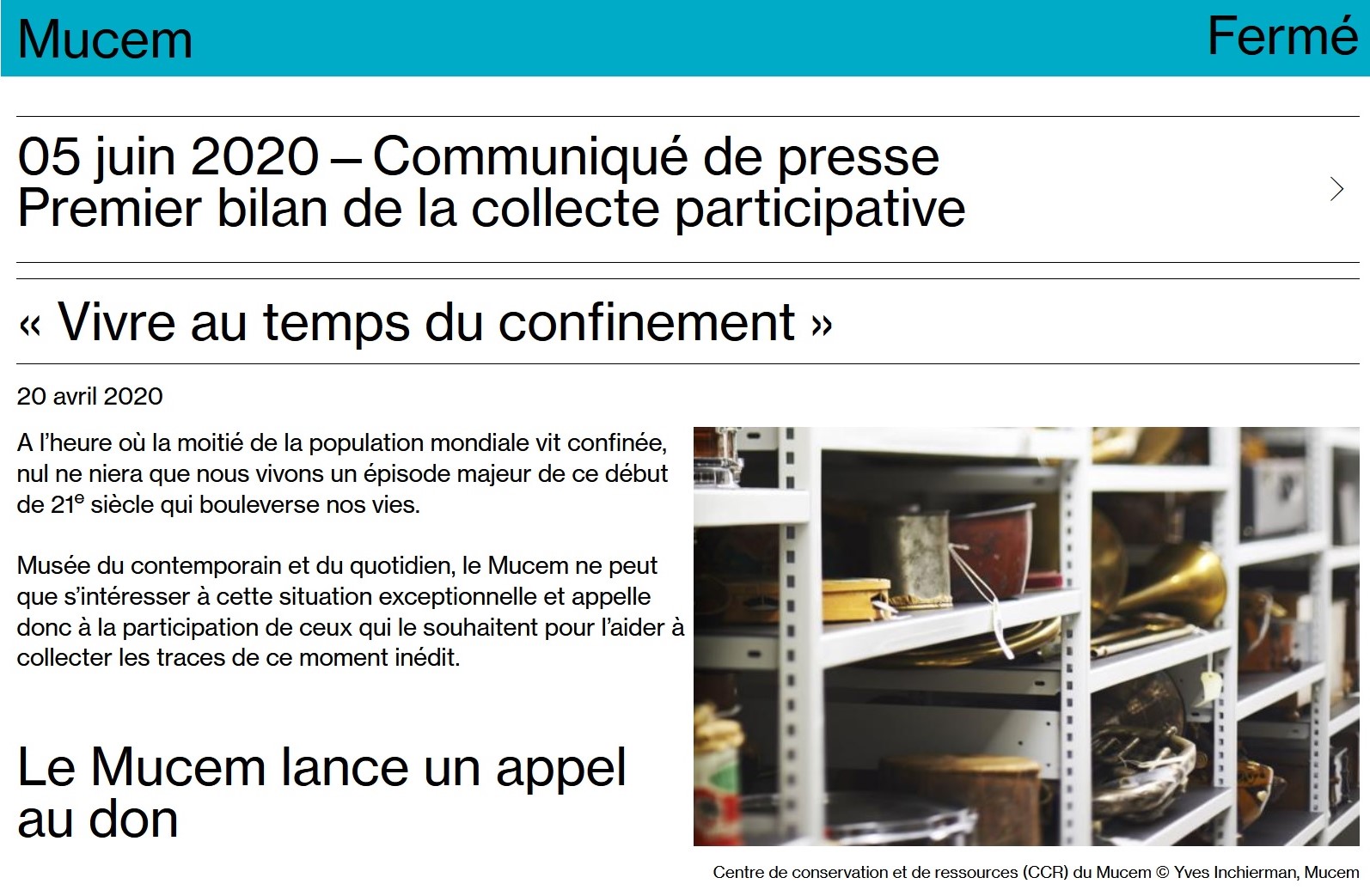 Page Internet du Mucem : collecte participative « vivre au temps du confinement » en 2020
Page Internet du Mucem : collecte participative « vivre au temps du confinement » en 2020
Les dons viennent bien souvent de particuliers, attachés à un musée et souhaitant donner de la valeur à un objet, enrichir les collections ou bien transmettre un patrimoine. Leur démarche est soit subjective et personnelle, motivée par un lien affectif avec le musée et ne va pas toujours dans le sens de la politique scientifique établie par l’équipe de conservation, soit elle s’inscrit dans le cadre d’une collecte définie par le musée lui-même. Dans ce cas-là, la démarche est encadrée et les dons doivent être en lien avec la thématique annoncée, il arrive cependant que des dons ne soient pas toujours en accord avec celle-ci. De ce fait, la conservation est en droit de refuser des dons qui ne lui semblent ni cohérent avec le reste du musée, ni pertinent au regard de la valeur scientifique de l’objet. En effet, la valeur scientifique vient déterminer l’entrée ou non de l’objet au registre d’inventaire. Une autre raison justifiant le refus d’un don peut être son passé juridique. Il peut être difficile selon les objets de déterminer l’origine et les différents propriétaires du don, rendant selon l’objet et la période concernée le propos difficile à justifier pour le musée acquéreur. Pour cette raison et pour éviter d’éventuels soucis juridiques, les musées peuvent refuser l’entrée de dons malgré leur intérêt scientifique. En ce sens la valeur juridique peut prévaloir sur la valeur scientifique.
Alors que nous avons vu que le cas des objets qui ne sont ni conservés ni exposés doit être défini, les PSC précisent peu ce qu’il advient des dons écartés. Différentes pistes sont envisageables. L’objet peut tout de même intégrer le musée, pour le service pédagogique, qui l’utilise lors d’ateliers avec du jeune public ou du public en situation de handicap. Une autre possibilité est de tout simplement laisser l’objet à son propriétaire, lui expliquant que malgré l’intérêt qu’il porte à l’institution son objet n’a pas sa place dans les collections. Enfin, si l’équipe de conservation estime que l’objet a sa place dans un autre musée ou dans une autre collection, il peut proposer un transfert vers cette institution.
Politiques d’acquisition et PSC sont des documents indispensables pour la bonne gestion des collections d’un musée. Ils donnent les axes de réflexion à suivre, les clés pour une gestion cohérente d’une institution muséale. Le musée étant par nature un lien qui collecte des objets ou des œuvres d’art, dons sont soumis à une politique bien précise justifiant ou non de leur entrée en collections. Celle-ci doit donc à la fois définir ce qui peut entrer en au registre d’inventaire, mais aussi les façons de traiter les dons qui n’y ont pas leur place.
Clémence Lucotte
Pour aller plus loin :
Le manuel « Comment gérer un musée » de l’ICOM
La vie des collections des musées de France
Le Vademecum des acquisitions à l’usage des musées de France
Exemples de pages Internet de musée dédiées aux modalités pratiques des dons : Musée des Tissus à Lyon et Musée de l’Armée à Paris
#don #acquisition #ICOM

Du carnet de bord d'une apprentie muséographe
Tous ceux qui ont déjà écrit un mémoire de master dans leur vie savent bien que le stress peut vite prendre le dessus… On considère souvent qu’on aurait pu mieux s’organiser, on scrute ses camarades en essayant de leur soutirer des stratégies organisationnelles, qui en réalité, n’existent pas sur la planète Terre… On redoute les délais encore plus que le mauvais œil.
Des extraits du carnet de bord de mon mémoire éclairent des moments de ce parcours commun aux étudiants en master et démystifient – s’il eut été besoin –l’existence d’un parcours de mémoire standard à suivre, sans obstacles et au résultat certain.
Arras, juin 2014. Je suis arrivée à la fin de ma première année du Master Expographie-Muséographie et je dois choisir un sujet de mémoire. Je suis italienne, j’ai dans ma poche un diplôme en ethnologie et je collabore avec un collectif photo. J’ai donc tout naturellement orienté mes recherches vers une analyse comparative de l'utilisation et du rôle joué par la photographie dans les expositions qui traitent des migrations entre la France et l'Italie.
NB : les recherches dédiées à l’écriture d’un mémoire en muséographie ne sont pas uniquement faites de consultations de livres à la bibliothèque, mais autant de visites et de rencontres, des interviews et de retranscriptions. Un agenda et un magnétophone constituent le kit de base du muséographe en visite.
L'entrée au Musée National de l’émigration italienne au Vittoriano
Rome, Décembre 2014. Je rentre en Italie et je vais à Rome pour visiter le Musée national de l'émigration italienne. Carnet de bord à la main et appareil photo autour du cou je descends à l’arrêt du métro Colisée et, après un quart d'heure de marche, me voici devant le Vittoriano.[1] En son sein, dans une aile du rez-de-chaussée, a été ouvert en 2009 le musée en question. Promu par le Ministère des Affaires étrangères en collaboration avec celui des Biens et Activités culturels, ce musée fait le point sur l'émigration italienne dans le monde, à travers un parcours chronologique qui va du Moyen-Âge à nos jours.
AVERTISSEMENT : la pause de Noël se rapproche, pour moi c’est synonyme d’Italie, de retour chez moi. Dans le Master on « bosse » dur et le mot « vacances » ne fait pas partie du lexique de l’apprenti muséographe qui, au contraire, profite de ce que les autres appellent « vacances » pour avancer sur les différents projets, et pour ranger le tas de post-it qui envahissent son bureau.
Vittoriano, 10h30. J’avais préparé ma visite, je savais ce que je cherchais et avec quoi je voulais revenir. Tout d'abord, le catalogue de l'exposition[2]. J’en avais déjà consulté des extraits en ligne, et j’avais remarqué des articles susceptibles de m’être utiles dans l’écriture de mon mémoire. J’entre dans le musée, je le vois, m’en approche pour le feuilleter et demande s’il est possible de l’acheter. Giuseppe, le gentil gardien-médiateur à qui je m’adresse, m’informe que le catalogue n’est plus en vente, qu’il est épuisé, et qu’à son avis l'éditeur n’envisage pas de le réimprimer. Bien qu’un peu frustrée, je ne me suis pas découragée ! J’ai noté sur mon carnet de bord de me rappeler de le chercher d’occasion sur internet. Après cela je lui ai demandé si, parmi toutes les autres publications bien placées dans la bibliothèque derrière lui, il y en avait qui traitaient des sujets qui m’intéressaient. La réponse fut un « non » catégorique. Rien n’était à vendre, par contre j’aurais pu consulter les publications du centre de documentation, accessible via un escalier en colimaçon au milieu de l'exposition, vers lequel m’a guidé Giuseppe. J’étais tellement préoccupée par mes recherches théoriques que j’ai négligé l'exposition, y jetant un simple un coup d’œil en passant.
La consultation des publications dans le centre de documentation du musée
A NE PAS OUBLIER : c’est très utile de préparer les visites aussi bien que de programmer un calendrier pour rencontrer les personnes-ressource des institutions. Ceci dit, cela ne doit pas empêcher de suivre les principes de l’ethnologue sur le terrain : il observe silencieux, il note discrètement, il photographie sans se faire voir, il se présente en faisant la connaissance d’autres figures professionnelles potentiellement intéressantes pour sa recherche et probablement intéressées par son sujet de mémoire.
Giuseppe me rassure : il est sûr que parmi toutes les publications il y a ce qui m’intéresse mais me demande combien de temps je dispose pour les trouver car il n’y a pas de répertoire pour procéder rapidement aux recherches des publications. Enfin, il m’informe que les livres sont uniquement consultables sur place et qu’il n’y a aucune photocopieuse à disposition des chercheurs. C’est alors que je perds tout espoir ! Giuseppe l’a bien remarqué, sur mon visage s’affiche une expression d'impuissance. Compréhensif et complice il s’approche de moi en me demandant si j’avais un portable qui prenait des bonnes photos… À bon entendeur...
Ah, il allait oublier, il revient vers moi pour m’informer que depuis deux jours il n’y a pas de connexion internet au musée. Par conséquent, les dispositifs généralement utilisés pour l’accès aux dossiers informatisés des Italiens émigrés sont hors d’usage. Visiblement désolé il m’avoue qu'il a prévenu les techniciens mais que personne n’est jamais arrivé.
Je m’assieds face à une bibliothèque qui me défie de toute sa hauteur. Penseuse je me demande pourquoi tout est si compliqué et pourquoi, après une demi-heure dans le musée, le seul aspect positif a été ma rencontre avec Giuseppe, à l'écoute du visiteur et grand connaisseur du sujet.
Vue d'ensemble de la dernière partie du parcours d'exposition. Sur la gauche, l'escalier qui monte à la bibliothèque
© Comunicare Organizzando – Rome
RAPPELEZ-VOUS : nous pouvons adopter différentes stratégies pour essayer d’être efficaces, mais le terrain est semé de surprises et d’inattendus à gérer avant de se trouver sur le terrain. Les rencontres professionnelles sont à alimenter au fil du temps, elles pourront nous être bénéfiques encore, une fois diplômés.
Vittoriano, 15h30. Je descends l'escalier en colimaçon et je me rends compte très vite que le défi posé par la bibliothèque n’avait rien à voir avec ce qui m’attendait en bas : un parcours chrono-thématique en cinq sections et vingt-trois sous-parties pas du tout interactif et à la scénographie datée. Je me sens submergée par une proposition muséographique trop riche : les textes, les documents d’archive et iconographiques, les chants des migrants qui accompagnent une grande partie du parcours de visite, tout cela proposé sans différencier plusieurs niveaux de lecture. Il en résulte donc un parcours trop dense qui démotive la plupart des visiteurs préférant ne pas le terminer.
Gare de Roma Ostiense, 00h15. J’attends mon train de nuit pour remonter jusqu’à Gênes et j’en profite pour faire un bilan de ma journée. Pendant que je vois Rome disparaître par la fenêtre de ma voiture je pense que mes attentes n’ont pas toutes été satisfaites. Mise à part la rencontre avec Giuseppe et mon avancée dans les recherches bibliographiques, le parcours d’exposition du seul musée national dédié à l’émigration italienne m’a déçu. Je m’attendais à une proposition moins standard, à une scénographie plus récente dans ses choix, aussi bien des matériaux que des supports d’exposition et à un parcours immersif dont je n’ai pas trouvé trace.
ETRE REALISTES : je prévoyais de mettre au propre mes notes et de commencer à lire des articles dans le train du retour mais, après une journée sur le terrain, je me suis endormie juste après avoir allumé mon ordinateur. Qu’est ce que voulez que je vous dise, j’assume, je suis encore une apprentie muséographe.
La Berta Viola
[1] IlVittoriano est un ensemble monumental érigé il y a un siècle dans le centre de Rome, à l'honneur du premier roi italien, Victor-Emmanuel II de Savoie.
[2] Le musée se compose d’une seule exposition permanente et ne prévoit pas la possibilité d’en présenter des temporaires. C’est pour cette raison que dans le texte d’ouverture de l’exposition le commissaire d’exposition en parle comme d’un « musée-exposition ».

Graffiti et trains : liaison dangereuse ?
“Dans le graffiti, tu as deux écoles : les murs ou les trains. Pour les murs, l’intérêt c’est de faire des peintures travaillées, pépères. Quand tu peins sur des trains, tu retrouves à la fois cet aspect graphique, la recherche de lettrage et de couleur, mais aussi le côté mission : trouver les dépôts, éviter la surveillance, connaitre les horaires des gardiens. Ça devient un sport artistique. Moi je me suis plus tourné vers le train. Quand tu as goûté à ça, tu ne peux plus t’arrêter.” Rap 2122 1
Subway Art © Photos par Henry Chalfant & Martha Cooper, 1984
Ils se tournent aussi très vite comme à New-York vers le support mythique du graffiti : les métros ou les trains. Des tags exécutés à la va-vite dans les couloirs ou les stations jusqu’aux grosses pièces sur des métros ou RER, les writers français reprennent les codes et les styles du mouvement new-yorkais. Mais à Paris à la fin des années 80, comme à New York à partir de 1972, les artistes cartonnent la ville : les tags incompréhensibles pour la majorité des Parisiens, saturent les murs, les rames et les couloirs du métro donnant aux usagers une impression d’insécurité, de lieux délaissés et d’incivilités impunies :
“Le graffiti est pour la majorité de la population une perturbation qu’il faut faire disparaître, un bruit urbain sans signification et de même nocivité que les klaxons et les gaz d’échappement dans les embouteillages”2
La répression commence alors pour la RATP et la SNCF : on recouvre les rames d’une fine couche de plastique empêchant la peinture de complètement sécher, on crée des solvants pour l’effacer plus rapidement, on augmente la surveillance des couloirs, des dépôts et on essaie de nettoyer systématiquement les trains fraîchement taggués sans les mettre en circulation afin de décourager les graffeurs. Des brigades anti-graffitis sont créées, en lien avec les services ferroviaires afin de constituer des dossiers documentés sur chaque writer pour identifier les auteurs, les perquisitionner et les arrêter en vue d’une condamnation. Ces mesures se diffusent rapidement dans l’Europe entière car les passionnés vont se lancer dans un “tourisme” du graffiti dont le but est d’aller peindre les métros, les trains dans d’autres pays avec son crew afin de diffuser à l’internationale son nom et de gagner la reconnaissance de ses pairs. D’une pièce au chrome, peinture argentée qui réfléchit bien la lumière, un classique à un discret sticker portant son blaze sur un poteau de signalisation, le but est de recouvrir la ville. En France en 2014, la SNCF annonce dépenser 30 millions et la RATP 20 millions d’euros chaque année pour lutter contre les graffitis. La préfecture de police annonce elle, une dépense autour de 3 millions d’euros chacun.3
“Destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui » est punie de 1500 à 30 000 euros d’amende et de 2 ans d'emprisonnement maximum (Article 322-1 du Code Pénal). L'article 322-1 du Code pénal prévoit aussi que « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger ». Le graffiti vandale ne se limite d’ailleurs pas seulement à la peinture aérosol mais aussi à des tags à l’acide, en mélangeant l’acide avec l’encre d’un marqueur pour attaquer le verre de la vitre et avoir des coulures, très esthétiques ou encore des gravures pour marquer durablement le train. Le graffiti vandale conduit à des procès spectaculaires avec notamment l’affaire des 56 graffeurs jugés 10 ans après les faits4 ou celle du graffeur parisien Azyle à qui la RATP réclame 200 000 euros de dégâts pour vingt ans de peintures mais dont celui-ci conteste le montant de manière scientifique et méthodique.
Interview du graffeur Azyle par Mouloud Achour dans l'émission "Clique" le 25 septembre 2015
Aujourd’hui malgré la prédominance du street art et de la généralisation du graffiti en galerie, les irréductibles writers continuent de peindre. Les femmes sont aussi présentes et revendiquent leur droit à taguer et graffer des trains, il y a même des crews spécialement féminins ou encore des couples de tagueurs comme Utah et Ether qui parcourent le monde pour peindre ensemble !5 Peindre sur un train reste un but pour la jeune génération qui veut obtenir la reconnaissance des anciens et montrer qu’elle est prête à transgresser les lois et affronter les difficultés grandissantes par passion. Mais paradoxalement, la SNCF depuis quelques années invite des artistes graffeurs pour décorer des gares ou créer le décor de l’extérieur de train comme le TGV l'Océane en 2016. La même année, le graffeur américain mythique Futura 2000 peint entièrement en live durant le Festival Rose Béton un train qui a été exposé toute la durée du festival devant les Abattoirs, le musée d’art contemporain de Toulouse comme une véritable oeuvre d’art. Des artistes s'intéressent aussi aux trains abandonnés, à la casse : Maxime Drouet alias Manks, après avoir été arrêté en 2011, s’est reconverti en photographe pour témoigner de la beauté des trains abandonnés. Les peintures photographiées depuis l’intérieur du train semblent être de véritables vitraux. Il prélève parfois même des vitres, des portes de trains peintes et les expose comme des témoins d’une époque révolue. La photographie a toujours fait partie de l’histoire du graffiti : à l’époque où internet existait à peine, il fallait prendre une photo de sa peinture la nuit ou attendre le lendemain en espérant que le train sorte du dépôt pour partager sa photo entre amis ou dans des fanzines. Aujourd’hui c’est plus simple, on se filme et on poste des vidéos ou photos des exploits sur les réseaux sociaux.


Vitraux et vitre © Photos par Maxime Drouet
Le train est intimement lié au graffiti, vandale, illégal mais libre. La prochaine fois que vous verrez un tag, un graff que vous trouverez moche, pensez alors qu’il représente sûrement des années de recherches calligraphiques pour son auteur. Qu’il a reproduit son nom des centaines de fois sur des trains, des métros, des murs. Que c’est peut-être un graffeur débutant comme un artiste reconnu, représenté en galerie ou répondant à des commandes publiques mais qui a probablement commencé dans la rue et sur les rails. Malgré le marché de l’art, et la possibilité de monnayer cet art de la rue qui est à la base un art gratuit et accessible à tous, un writer peut garder une part de sa passion première : un besoin de se replonger dans la nuit, l’illégalité comme un besoin d’équilibre pour ne jamais oublier l’essence même de la culture graffiti : la passion des lettres et de la transgression.
Cloé Alriquet
Bibliographie sélective
- Chalfant, H., et Cooper, M., Subway Art, New York, Thames & Hudson, 1984
- ESCORNE Marie, L’art à même la ville, Presses Universitaires Bordeaux, Artes, 2015.
- Lemoine, S., L’art urbain, Du graffiti au street-art, Paris, Gallimard, 2012
- Terral, J. et Lemoine, S.,, In Situ, un panorama de l’art urbain de 1975 à nos jours, Paris, Editions Alternatives, 2005
1 https://www.streetpress.com/sujet/1476366932-uv-collectif-graffiti
2 Seno, E. (ed.), Trespass : une histoire de l’art urbain illicite, Taschen, 2010, p.84
5 Documentaire Girl Power https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=fFiU2NBlfSQ

Guide des bonnes pratiques de l’appel d’offres
Dans le secteur culturel (et de la fonction publique) les appels d’offres sont monnaie courante, aussi je vous propose un guide des bonnes pratiques à destination des personnes qui sont ou qui seront en charge de la rédaction de ces appels et/ou de leur suivi pour des expositions, principalement dans des institutions.
Poser les bases: définition de l’appel d’offres
Appel d'offres (AO)
L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. Dans notre cas ; l’appel d’offre peut concerner un travail muséographique, graphique ou scénographique, ou une prestation multimédia.
Article L. 2124-2 du code de la commande publique
Lexique utile pour ne pas se perdre dans la jungle du marché public:
Avant toute chose, voici un lexique des mots utilisés dans cet article et les acronymes que l’on rencontre dans un appel d’offres :
→ Le commanditaire (couramment nommé le profil acheteur): c’est la partie qui écrit l’appel d’offres, dans ce cas précis des musées et institutions culturelles
→ Le candidat: c’est la partie qui répond à l’appel d’offres, dans ce cas précis, des muséographes, des scénographes, des graphistes, des architectes, des éclairagistes, des transporteurs, des concepteurs multimédia etc
→ DCE: Dossier de Consultation des Entreprises, c’est le dossier qui est mis à disposition des candidats par le commanditaire, généralement sur les plateformes de marchés publics. Il contient entre autre les pièces suivantes :
- RC: Règlement de la consultation,il fixe les règles de l’appel d’offre que les candidats doivent respecter
- AE: Acte d’engagement, c’est le formulaire par lequel le candidat adhère aux clauses du marché public décrites dans le CCTP et le CCAP
Ces deux documents font partis de ce qu’on appelle communément le cahier des charges
- CCTP: Cahier des Clauses Techniques et Particulières, fixe les clauses techniques d’un marché particulier déterminé. Ce sont les stipulations qui donnent une description précise des prestations à réaliser et permettent à la personne responsable de suivre le déroulement du marché et la bonne exécution de ces prestations. Ils détaillent ainsi l'objet du marché.
- CCAP: Cahier des Clauses Administratives Particulières, il fixe les dispositions administratives propres à chaque marché.
Bonnes pratiques

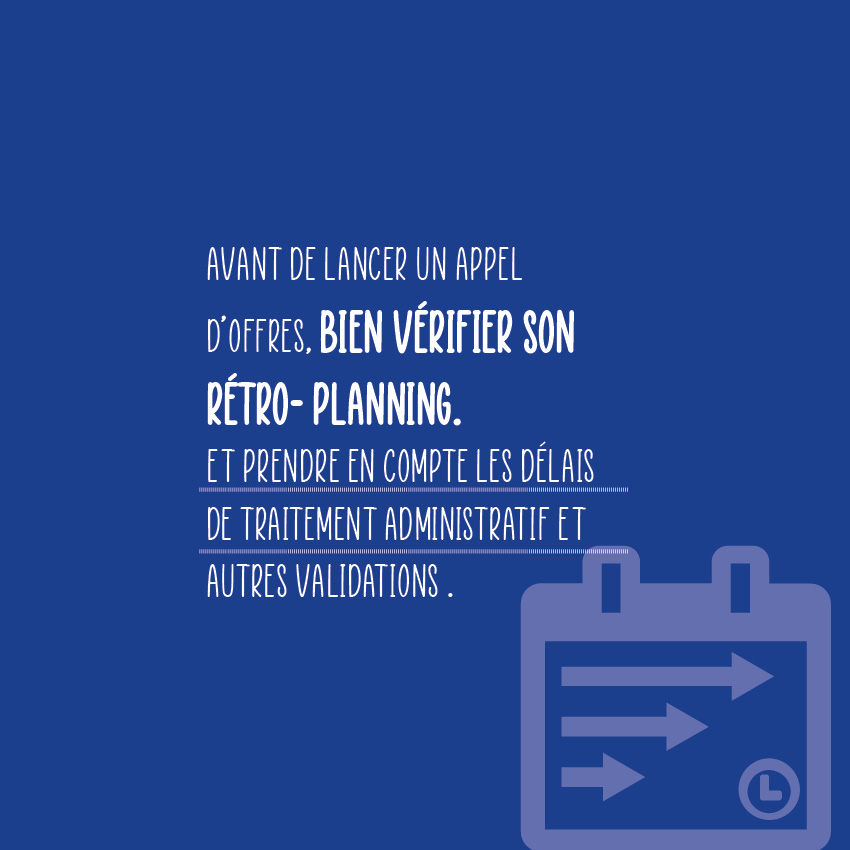

→ Avant de lancer un appel d’offres, bien vérifier son rétro-planning et prendre en compte les délais de traitement administratif et autres validations : Si le commanditaire souhaite un travail de qualité, il faut laisser le temps aux personnes sollicitées pour que la réponse soit bien faite, mais aussi prendre en compte les délais de traitement administratif et les étapes qui viendront après l’appel d’offre (par exemple : avant projet sommaire, avant projet détaillé…). Faire son appel d’offres à 2 mois du début de l’exposition, c’est prendre le risque que tout soit bancal, que peu de personnes y répondent par peur des délais et obtenir un résultat médiocre.
→ Utiliser le bon vocabulaire, décrire ses souhaits et être le plus précis sur sa demande dans le cahier des charges : pour faciliter la recherche aux candidats mais aussi obtenir des réponses qui satisferont vos attentes, il est important d’utiliser le bon vocabulaire, et d’être le plus précis sur sa demande mais aussi ses interrogations, ses envies, ses doutes…, plus la réponse sera satisfaisante et moins il y aura de mauvaise surprise et d'incompréhension entre le commanditaire et le candidat sélectionné.
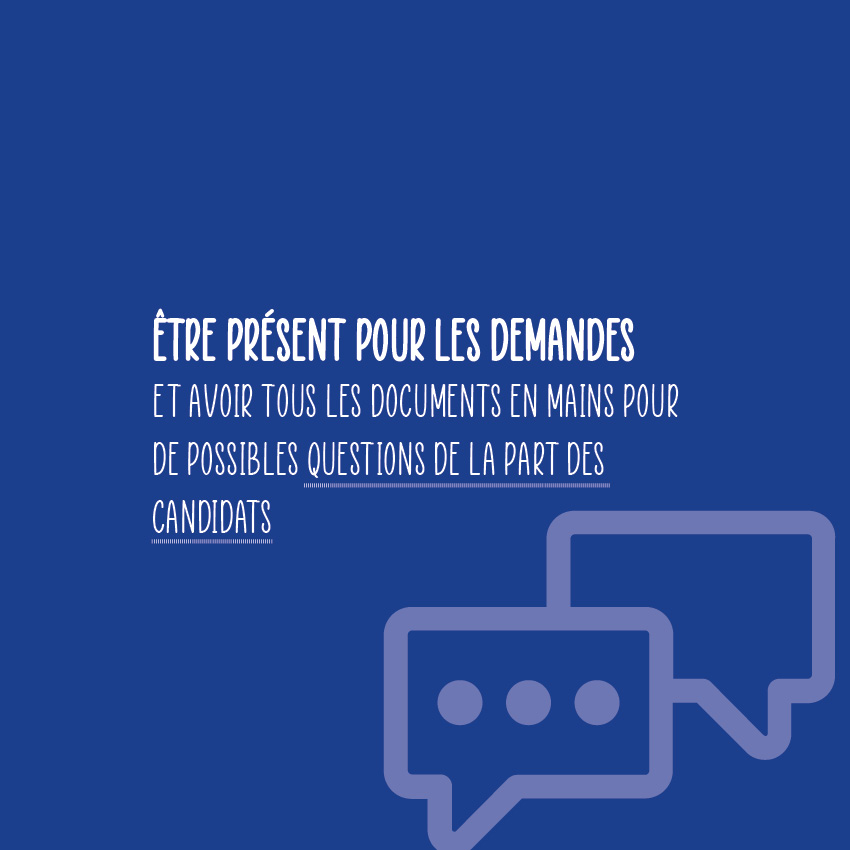

→ Être présent pour les demandes et avoir tous les documents en mains pour de possibles questions de la part des candidats : Il arrive que des pièces du cahier des charges soient manquantes lors de la mise en place de l’appel d’offres sur des plateformes, et que pris par le temps, ces documents soient déposés quelques semaines avant l’échéance. Tout document manquant et toute question sans réponse pénalise le bon déroulement de l’appel d’offres et la qualité des réponses des candidats, parfois jusqu’à devoir relancer un marché public. Il est donc important que la personne en charge de l’appel d’offres soit présente pour répondre aux interrogations des candidats et, dans un soucis d’équité, que tous les participants aient accès à la réponse.
→ Bien doser son DCE : Un dossier de consultation constitué de deux documents, c’est trop peu pour indiquer au candidat ce que l’on souhaite et en même temps le noyer sous une tonne d’informations qui ne le concerne pas rend la lecture du dossier plus compliqué et la réponse trop floue ou déjà trop précise pour la phase de consultation.
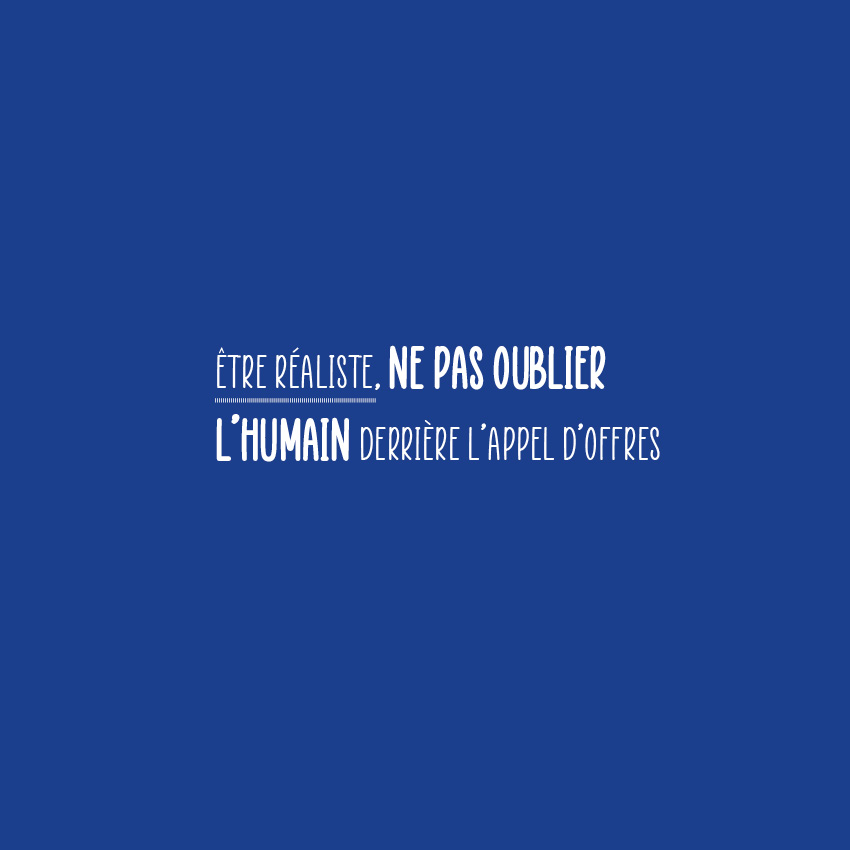

→ Être réaliste : Il faut savoir que répondre à un appel d’offres non rémunéré*, qui consiste généralement à constituer un dossier de références et une note d’intention, demande tout de même un travail de rédaction et/ou de mise en page. Cela représente un temps de travail et d’investissement personnel non rémunéré pour le candidat. Il faut une moyenne de 4-5 appels d’offres pour obtenir un marché, le temps que le candidat trouve les appels d’offres, fasse le tri, remplisse les documents et pose sa candidature, cela peut prendre jusqu’à 2 semaines voir 2 mois selon la demande. Dans ce cas, on ne demande pas une réponse dans un délai de 2-3 semaines, puisque le candidat n’aura pas le temps de s’y consacrer, qu’il lui en coûtera du stress, du travail (et des stagiaires sous pressions !).
- * Tout appel d’offres consistant à la production d’une esquisse (un dossier constitué d’images /de représentations 3D / de prestations graphiques) doit être rémunéré. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas et dans ce cadre, l’association des scénographes bataille afin que ce travail soit reconnu à sa juste valeur.
→ A la fin du processus, rester présent : Une fois l’appel d’offres terminé et le choix fait, il est plus cordial de donner des raisons de ce choix aux perdants et de rester à la disposition des candidats pour toute demande concernant le travail fourni. Les candidats font souvent partie de réseaux de professionnels et en cas de mauvaise intelligence, cela peut desservir le demandeur dans ses prochains marchés publics. Donc pour rester cordial, courtois et en bonne intelligence avec des candidats mieux vaut donner de son temps !
J’espère avoir donné quelques clefs pour ne pas s’arracher les cheveux lors d’un processus d’appel d’offres et permettre aux commanditaires comme aux candidats de survivre dans la jungle des marchés publics.
J.D
Pour en savoir plus, voici une super chaîne Youtube qui décrit toutes les étapes des marchés publics et appels d’offres : : décodeur public
https://www.youtube.com/channel/UCwqqg8LO698Se56r_12y0dg
Pour aller plus loin sur les bonnes pratiques à adopter dans la construction d’un projet d’exposition : Projet d’exposition, guide des bonnes pratiques http://scenographes.fr/scenographes.fr/documents/guideexpo_nogloss.pdf
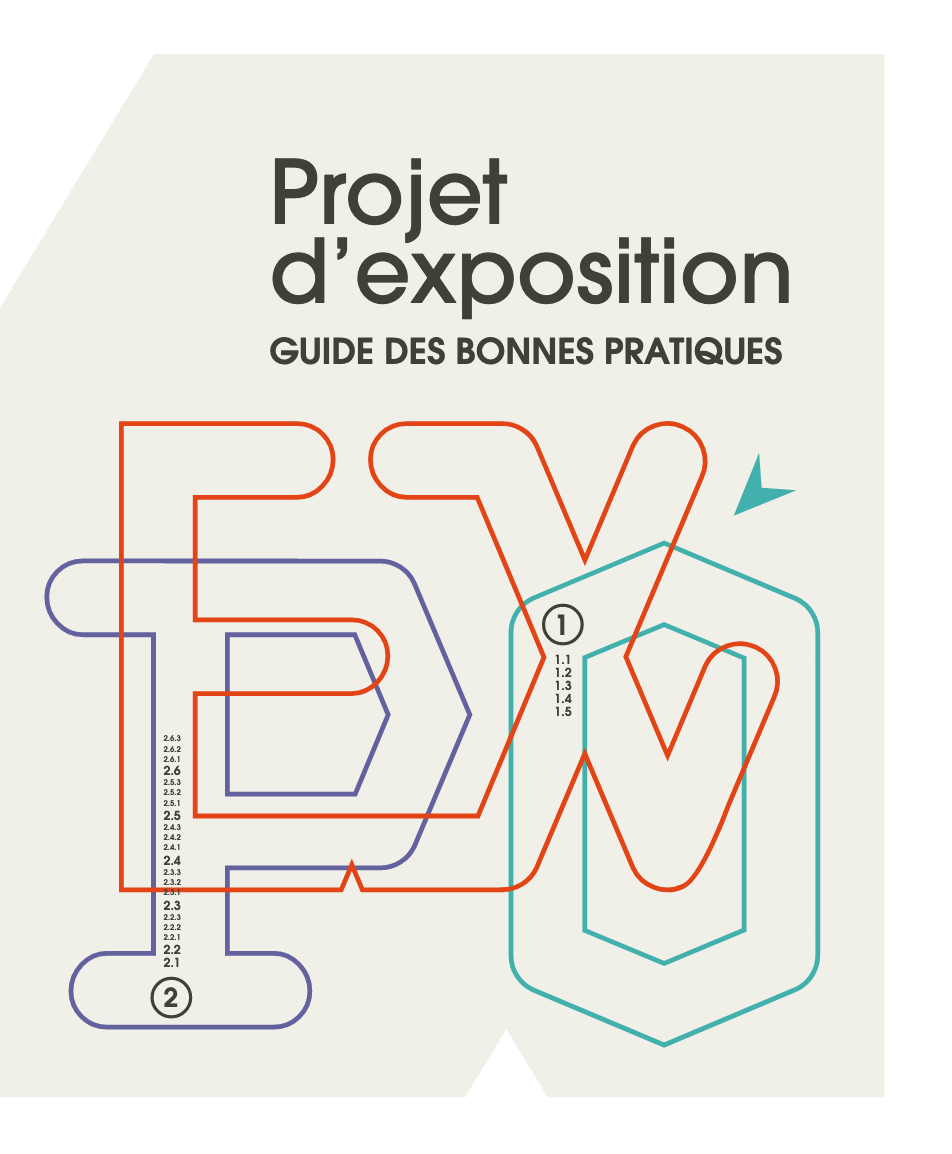
Pour les curieux, voici une liste réduite de plateformes pour trouver des appels d’offres :
- PLACE : La plateforme des achats de l’Etat
- La centrale des marchés
- Les plateformes de marchés publics des Départements (exemple)
- Marchés Online
- Bulletin officiel des annonces des marchés publics
#guidedesbonnespratiques
#appelsdoffres
#marchépublic

Halloween au musée : trick or treat ?
La Folie s'empare de Grévin : nocturnes spéciales Halloween

Médiatrice au musée, membre de l'USPPE © Elise Mathieu
Nous sommes à Paris à la fin du XIXe siècle. Les grandes expositions universelles ont levé le voile sur la beauté de la capitale. Cependant, ses rues sont infestées de vermine. Rat, cafards, déchets ? Non, bien pire que cela : malfrats, voleurs, prostituées, meurtriers, des gens dont il faut se débarrasser ! C'est en tout cas ce que pense le préfet de police de la ville. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, vous avez été « ramassé » par ses hommes et emmené de force au musée que l'USPPE a investi. Cette Unité de Soin Pour Personnes Extrêmes va s'occuper de vous et lorsque vous ressortirez, vous serez devenu un citoyen modèle. Enfin, si vous en ressortez...

Aperçu d'un lit de cet « hôpital » © Elise Mathieu
A peine entrés dans le musée, vous devez enfiler une blouse afin que les « médecins » vous décontaminent. Suivez les ordres à la lettre et pas de faux pas ! Toutes les équipes de l'USPPE sont là pour vous remettre sur le droit chemin. Au fil de votre avancée dans le musée, vous assistez à d'étranges scènes... Vous vous rendez vite compte que ces médecins sont sans scrupule et les professeurs avides d'expériences. Les statues de cire se mélangent aux médiateurs qui prennent un malin plaisir à se fondre dans le noir pour vous surveiller. Au détour des différentes salles, vous rencontrez de nombreuses personnes qui tentent de vous faire devenir de bons citoyens mais rien à faire ! Que vous agissiez comme ils le souhaitent ou non, vous avancez inexorablement vers la « chambre 6 », un endroit terrifiant d'après les dires des autres prisonniers, un endroit où l'on ira jusqu'à « effacer votre corps »...

Expérience pratiquée sur un prisonnier (médiateur) © Elise Mathieu
#Grévin
#Nocturne
#Halloween
Elise Mathieu

Hip-Hop 360 : une expo qui fait du bruit
À travers un parcours composé de 8 séquences, l’exposition retrace la naissance du hip-hop français depuis ses origines : les États-Unis. Comment le hip-hop est-il devenu un tel phénomène culturel ? De la musique à la danse, en passant par la mode, le rap et les premières radios, zoom sur l’histoire du hip-hop.
image d'introduction : Vue de la séquence 2 : Conçu pour durer. © Marie Thérasse
Un parcours à 360° : sous quel prisme ?
Eh oui ! La Philharmonie a fait le choix de présenter uniquement la branche française du hip-hop. Cette particularité surprend, car le titre promet une rétrospective à 360 degrés. On pourrait s’attendre à ce que l’exposition retrace l’histoire du hip-hop d’un point de vue international. Or, il n’en est rien. Le titre Hip-hop 360 : Gloire à l’art de rue fait, en réalité, référence à tout ce qui caractérise la culture hip-hop : la musique, le style vestimentaire, la danse… Il s’agit d’un mouvement artistique pluridisciplinaire et c’est précisément cela que l’exposition a voulu montrer. Un point de vue pour le moins original et qui fonctionne bien.

Plan de l’exposition. ©Marie Thérasse
Dès l’entrée de l’exposition, une salle d’introduction présente deux frises murales : l’une est chronologique et reprend les dates clés de l’histoire du hip-hop. Cette même frise est répétée sur le mur adjacent, au format numérique cette fois. Des dates et des photos défilent et des extraits musicaux sont diffusés en fond sonore. La seconde frise se présente sous forme d’arborescence des différents styles : rap, graff, beatbox, DJ, danse. Ce schéma est accompagné de quelques objets. Ainsi, le visiteur comprend bien comment le hip-hop est structuré. Cette introduction donne le ton et le visiteur comprend tout de suite dans quoi il s’embarque.

Séquence d’introduction, frise murale. ©Marie Thérasse
Le visiteur arrive ensuite dans la première salle consacrée à la naissance du hip-hop. Cette séquence revient sur l’origine de cette nouvelle culture : les États-Unis. Le visiteur est plongé dans le quartier du Bronx à travers une série de photographies mettant en lumière le climat social qui règne dans les années 1970. Les grands noms de cette histoire sont également mis à l’honneur, tels qu’Afrika Bambaataa et la Zulu Nation ou encore Dee Nasty. Ce sera la seule et unique salle consacrée au hip-hop américain. Ensuite, cap sur la France. De l’autre côté de l’Atlantique, le hip-hop débarque au début des années 80 et ce sera le début d’une longue histoire que l’exposition retrace sous tous ses angles. La deuxième séquence concerne le développement du hip-hop en France et comment il s’y est établi de façon durable. La troisième séquence se concentre sur les émissions radio qui ont diffusé du hip-hop. Ensuite, c’est au tour du graffiti, de la mode et du beatmaking de faire leur entrée dans cette rétrospective. Les paroles ne sont pas en reste et font également l’objet d’une séquence dédiée qui met en avant la grammaire du rap, ses rimes et son freestyle. Le désir d’affronter d’autres rappeurs autour de battles prend le dessus et les mots doivent être bien choisis pour avoir de l’impact sur son adversaire.
Immersif ou pas immersif ?
L’immersion : c’est par ce terme que la Philharmonie a choisi de définir cette exposition. Mais qu’est-ce qui pousse à utiliser un tel qualificatif ? Si le terme est de plus en à la mode ces dernières années, la plupart des expositions immersives se caractérisent souvent par une utilisation importante du numérique et de projections en vidéomapping. Ce n’est pourtant pas le cas pour Hip-Hop 360. Dans ce cas, qu’est-ce qui peut bien motiver la Philharmonie à utiliser ce vocable ?
Et bien, c’est la scénographie ! Réalisée par Clémence Farrell, elle plonge le visiteur dans un univers urbain en reprenant les codes des lieux où la culture hip-hop est née : le Bronx, les studios radio ou encore le métro parisien. D’abord, de par les photographies du Bronx dans la première séquence et ensuite par la seconde séquence. Cette dernière contient un décor reconstitué d’un salon des années 80 où le visiteur peut s’assoir et regarder des extraits de l’émission h.i.p.h.o.pde 1984, diffusés sur une télévision cathodique. Visuellement, ce décor détonne un peu par rapport au reste de la scénographie, mais son contenu a du sens et il fonctionne plutôt bien. Il suffit de s’y assoir pour basculer 40 ans en arrière. Nostalgie garantie !

Vue de la salle 1 : Retour aux sources. © Marie Thérasse

Séquence 2, reconstitution d’un salon des années 80. © M. Thérasse
La part immersive de l’exposition est aussi amenée par l’espace 360, un cercle panoramique de 120m² qui rappelle les cyphers (espace de freestyle). Cet espace est dédié à la diffusion de vidéos et présentant les diverses ramifications qui composent le hip-hop. Après avoir pénétré cet espace, le visiteur est directement plongé au milieu d’un concert de Diam’s ou d’une prestation du beatboxer Faya Braz.

Vue panoramique de l’espace 360. ©Marie Thérasse
De façon générale, la scénographie est très réussie et fonctionne assez bien. Tantôt brute, tantôt recouverte de graffitis, la tôle froissée revient à plusieurs reprises comme élément de décor. L’intérieur d’une rame de métro a aussi été reproduit pour illustrer le développement du graffiti parisien. Les visiteurs prennent place sur le banc pour regarder une vidéo explicative sur cette pratique.

Scénographie séquence 5 : rame de métro. ©Marie Thérasse
La séquence sur la mode décompose chaque style vestimentaire au moyen de mannequins habillés avec les tenues typiques de la culture hip-hop, tandis que des téléviseurs font office de têtes et diffusent des vidéos explicatives. Cependant, ces éléments suffisent-ils à qualifier cette exposition d’immersive ? Le terme est peut-être mal choisi, car il ne correspond pas à la définition qu’on en donne récemment. Toujours est-il que le caractère immersif au sens propre est bien présent.

Mannequins utilisés pour la scénographie de la séquence 6. ©Marie Thérasse
En avant la musique
Qui dit exposition sur le hip-hop dit forcément musique ! Indispensable à une telle exposition, l’écoute de pistes audios occupe une place importante et les visiteurs reçoivent un casque dès leur entrée. Grâce à cela, ils peuvent à tout moment le brancher à un boitier pour écouter un morceau ou visionner une vidéo. Cependant, les casques sont assez imposants et le nombre d’entrées audio n’est pas toujours bien pensé. D’une part, les boitiers sont parfois trop peu nombreux et les visiteurs doivent patienter pour pouvoir brancher leur casque. D’autre part, les vidéos proposent parfois jusqu’à 4 branchements, ce qui engendre la présence d’un regroupement important devant un petit écran. Quant aux extraits audios, ils disposent de 8 entrées. Les casques étant filaires, cela contraint le visiteur à ne pas s’éloigner au-delà de ce que la longueur du fil lui permet. Ces conditions ne sont pas toujours favorables à une visite confortable. Il aurait peut-être été préférable d’utiliser des audioguides individuels pour plus de confort, au détriment de l’interactivité entre visiteurs.
Néanmoins, l’utilisation d’un casque est nécessaire pour ce type d’exposition, vu le nombre d’audios à écouter. De plus, cela permet une bonne gestion du son dans l’espace. La majorité des écoutes se fait par casque, le visiteur n’est donc pas dérangé par les sons environnants. Dans certaines salles, le son est directement diffusé à travers des haut-parleurs. Dans chacune d’entre elles, la diffusion du son est toujours bien maitrisée. Une fois sorti d’une salle, le visiteur n’entend plus le son qui était diffusé précédemment. À l’exception de l’espace 360 où le son est spatialisé. Le cercle est ouvert et donne directement sur le reste de la pièce. Cela n’est néanmoins pas gênant et cela crée une ambiance sonore qui n’empêche pas de profiter des 3 dernières séquences.
Interactivité ne rime pas toujours avec efficacité
Des dispositifs de médiation sont disposés tout au long du parcours. Dans la troisième séquence, la salle est plongée dans l’obscurité et l’un des murs est paré de radiocassettes, type « boombox » tandis qu’une ligne du temps numérique est projetée sur l’autre. Une réplique de boombox permet aux visiteurs de parcourir les stations radio de chaque période et d’écouter des émissions ou des morceaux qui étaient diffusés cette année-là. La ligne du temps propose chaque fois un petit texte explicatif pour accompagner chaque partie.
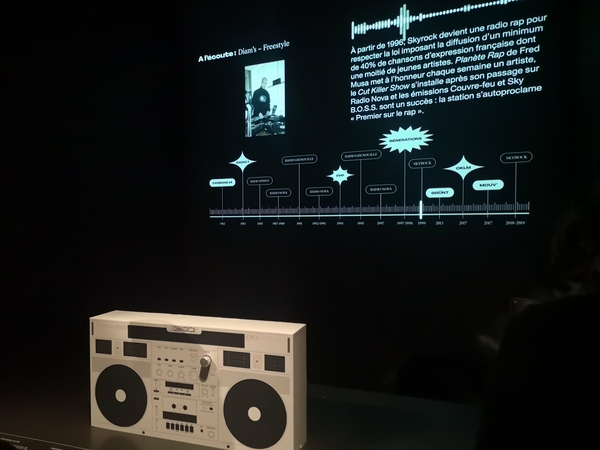
Dispositif de médiation sur la radio. ©Marie Thérasse
Un second dispositif se focalise sur la reconnaissance du style grâce aux paroles. À la fois interactive et pédagogique, la médiation proposée permet de bien comprend les caractéristiques grammaticales du rap. Dans un autre registre, les visiteurs peuvent également s’essayer à la pratique du graffiti en taguant virtuellement sur un écran. L’objectif ? Graffer un maximum de lieux de la carte sans se faire attraper par la police.
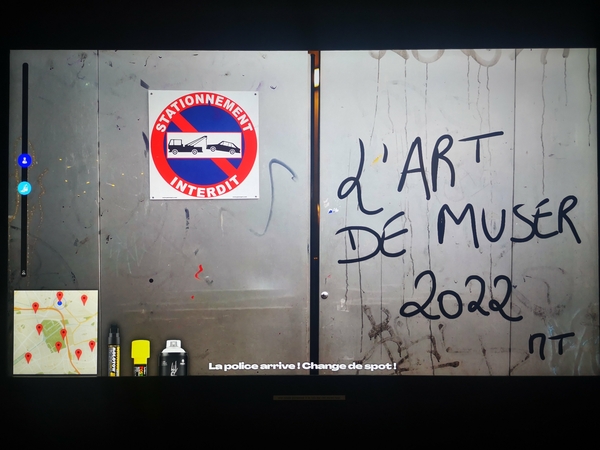
Écran avec médiation sur le graffiti. ©Marie Thérasse
Enfin, trois dispositifs sont placés dans la dernière salle et permettent aux visiteurs de se familiariser avec la production musicale et de mieux en comprendre les caractéristiques. Les visiteurs peuvent manipuler une table de mixage ou encore un tourne-disque mais les consignes sont assez confuses : « Sélectionnez un titre et comparez les samples utilisés ». Nul ne sait sur quoi la comparaison doit se baser. Sur ces dispositifs, il faut admettre que la médiation ne fonctionne pas. Pourtant l’idée était plutôt bonne mais le concept est à revoir. Une chose est sûre, ce n’est pas à travers la médiation que l’exposition marque le plus les esprits. Elle a toutefois, le mérite d’exister et dispose d’un beau potentiel qu’il aurait été intéressant d’exploiter plus en profondeur en s’attardant davantage sur les instructions.

Dispositif de médiation sur les samples. ©Marie Thérasse

Dispositif de médiation sur le mixage. ©Marie Thérasse
Marie Thérasse
Pour aller plus loin :
- LEVY, Emma (2022), L’immersif, un appât des publics, L’art de Muser
- La Philharmonie de Paris, interview des commissaires
- Visite virtuelle de l’exposition en live avec interviews :
#hiphop #philharmonie #immersif
Jardins, une expo qui vous veut du bien
Une exposition peut-elle être une œuvre d’art ?
Nous voici au vendredi de l’Ascension, au printemps déjà chaud, les marguerites, les iris, les soucis et les roses sont en fleurs. Il fait beau comme jamais, c’est un temps contre-nature, comme le ciel des peintures. La binette à la main, en plantant des géraniums dans des plates-bandes, je me suis posé cette question. Très inspirant le jardinage, me direz-vous. Certes. Surtout lorsque le Grand Palais propose l’exposition Jardins à ne manquer sous aucun prétexte.
Affiche de l'exposition
Ça aurait pu être une serre géante sous la grande verrière – mais non ! ; Laurent Le Bon, conservateur au Musée Picasso, aurait pu réaliser une exposition sur le jardin dans l’art. Mais non, contrairement à ce que laisse entendre la description sur le site du Grand Palais qui commence par citer six peintres mondialement connus et nous vend « certains des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art ». Il s’agit bien en réalité de l’Art du Jardin du XVIème à nos jours qui est traité ici, à travers sa représentation. Du Jardin au sens large. L’Ars Horti dans tous ses aspects. Car si on y trouve en effet des œuvres prestigieuses, des noms d’artistes célèbres – ces noms racoleurs sur l’affiche avec lesquels la RMN nous propose un événement blockbuster, bien que sur 450 objets exposés on ne trouve qu’une ou deux œuvres de ceux-ci – le véritable intérêt de cette exposition réside ailleurs : la promenade.
Dans une recherche proustienne de l’expérience du Jardin, on explore, on découvre, on visite un vaste domaine, fleuri, ombragé, semé de bosquets et ponctué de fontaines, on aperçoit ici un frêle papillon de mai, et là-bas le coin d’un château. On s’assoit sur un banc circulaire (gracieusement mis à disposition par une marque de mobilier d’extérieur) et l’on croise un jardinier surpris. Comme dans le nymphée de la Maison de Livie au Palazzo Massimo delle terme, les couloirs du Grand Palais sont devenus pour quelques mois une promenade en plein air.
Sitôt franchies la porte de l’exposition, le regard est d’ailleurs plongé dans une fresque pompéienne habitée d’oiseaux. (Fresque de la maison du bracelet d'or, (30-35 aprèsJ.-C , Pompéi)
Chaque nouvelle salle explore un nouveau point de vue, incite à observer les détails : la terre, l’humus, les essences d’arbres, les insectes, le rôle de l’eau ou le passage des saisons, la présence du jardinier à l’ouvrage. Comme dans Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway– dont un extrait est savoureusement projeté avec sa musique entêtante (pensée pour le gardien qui l’entend en boucle) – le visiteur devient observateur attentif de ce grand parc savamment dessiné.
Grâce à la scénographie presque immersive de Laurence Fontaine, on se promène, on regarde par les fenêtres des cimaises les paysages bucoliques qui s’étendent au loin, on tourne, on descend des escaliers, on se perd même un peu dans ce parcours labyrinthique tout en allées et en alcôves (un gardien est là pour nous guider lorsque la signalétique, malgré ses larges flèches blanches, n’arrive pas à surmonter les difficultés du bâtiment).
L’expérience du Jardin, lieu multisensoriel par excellence où les parfums, les couleurs et les sons se répondent est pratiquement reconstituée. Le texte d’entrée précise que l’exhaustivité n’est pas visée : on s’étonne presque de ne pas entendre le chant des merles et des hirondelles, de ne pas sentir la fraîcheur de la pluie et le vent qui emporte au loin le parfum des roses, de ne pas caresser l’écorce rugueuse d’un vieux chêne. Un dispositif olfactif (à ne pas rater dans un coin de bosquet) prolonge d’ailleurs l’expérience de l’immersion pour les visiteurs qui osent approcher leur nez comme au cœur d’une fleur.
Ernest Quost, Fleurs de Pâques, 1890, Roubaix - La Piscine
Cette exposition se veut pluridisciplinaire et ne se cloisonne pas à « l’Art », et c’est là sa grande force. Plus, elle requestionne le statut « d’œuvre » : l’Archéologie, les sciences naturelles, les objets du quotidien, peuvent-ils être des « œuvres » ? Un arrosoir, le plan des canalisations des jardins de Versailles, des échantillons de bois provenant de la xylothèque du Muséum, des reproductions de plantes en cire, n’ont pas été réalisés pour être des œuvres d’art mais comme outils de travail ou d’étude scientifique : ils sont pourtant « muséifiés » dès lors qu’ils sont mis sous vitrine. Des objets témoins des pratiques horticultrices – toute une ethnographie –, des multiples techniques de conservation et de reproductions pérennes de ces fleurs périssables (des herbiers aux films en time-lapse, des aquarelles aux cires anatomiques en passant par les impressionnantes répliques en verre des frères Blaschka), ou encore des travaux de multiples Le Nôtre avec plans, maquettes et vues cavalières, jusqu’aux prélèvements de sédiments et aux pollens. Œuvres d’art de facto, par l’amour du détail et de la minutie qu’ils expriment, lorsqu’ils côtoient Dürer, Matisse et Kubrick.
Car le cinéma n’est pas en reste avec les jardins de L’année dernière à Marienbad et le labyrinthe de Shining, en écho au parc de Saint-Cloud de Fragonard [1] et à une tapisserie représentant la fontaine d’un palais palermitain. La littérature aussi est bien présente avec des citations collant aux différents thèmes, de Huysmans ou de Verlaine où, comme sur d’autres murs, poussent quelques feuilles, ou encore avec – petite madeleine – une planche de Béatrix Potter.
L’art contemporain (les iris de Patrick Neu, la Grotta Azzurra de Jean-Michel Othoniel…) apporte quant à lui un nouveau souffle aux peintures plus classiques – qui évitent agréablement les poncifs attendus, type jardins de Giverny – grâce à des regards poétiques et des clins d’yeux pas piqués des hannetons.
Les expositions pluridisciplinaires surprennent toujours, ouvrent des portes imprévues, incluent le visiteur dans leurs questionnements. Qu’est ce qu’une exposition ? Qu’est ce que l’art ? Qu’est ce qu’un jardin ? Rien n’est tranché, mais à chaque thème développé une pièce de puzzle se met en place. On ne cherche pas à répondre à ces questions, à expliquer ce qu’est un jardin, ce qu’est l’art, ce qu’est une exposition. Laurent Le Bon explore, libre, invente et expérimente, il attire l’attention sur de petites choses. Un jardin c’est ceci, mais également cela, une œuvre c’est ça, mais ça aussi, et encore ça.
Gilles Clément, Mettre les pieds au jardin, 2007, Collection particulière
De surprises en découvertes, même sans les textes souvent jargonneux et assommants annonçant le nouveau chapitre –peut-être même ici grâce à leur avantageuse absence (seules quelques lignes viennent fort à propos contextualiser certains expôts) – le visiteur apprend sans s’en rendre compte un pan d’histoire qu’il raccroche à ses connaissances, à son vécu, à ses mille souvenirs réactivés par un objet ordinaire ou insolite, par un mot, un son ou une image. De lointains cours de science ou de littérature ressurgissent du labyrinthe cervical, des associations rappellent une expérience, un voyage, un roman…
Multiplier les médias, les styles, les références, construit un discours plus exhaustif par des regards croisés, et autant de moyens d’accroche (ou de bouées de sauvetage) : l’attention est maintenue, la curiosité exacerbée. La scénographie sans cesse renouvelée comme dans les jardins de Chaumont-sur-Loire nous transporte d’un laboratoire de botaniste à la cabane d’un jardinier, puis d’un jardin à la française à une serre lumineuse où s’affrontent sans rivalité les couleurs vives d’innombrables fleurs.
Emile Claus, Le vieux jardinier, 1885, Liège – Musée des Beaux-Arts / La Boverie
Puisque l’on sort du Grand Palais comme d’un feel good movie, la tête pleine de chlorophylle, réjoui comme en revenant d’une longue balade, alors peut-être cette exposition est-elle une œuvre complète, composée de multiples branches, dans laquelle on entre pour flâner, comme dans un jardin aux centaines de fleurs, d’arbres, de bosquets, de mares, d’oiseaux et de cigales. Après cette randonnée champêtre, deux envies s’imposent à mon esprit : aller cheminer dans un grand parc pour y guetter toutes ses composantes, ses couleurs, ses odeurs, ses perspectives… et retourner planter mes géraniums, pour devenir, l’espace d’une après midi, un jardinier en herbe… Désormais une chose reste sûre : il faut cultiver notre jardin.
Jérôme Politi
27 mai 2017
#Grandpalais
#jardins
#coupdecoeur
Pour en savoir plus :
L’exposition jusqu’au 24 juillet, c’est par ici : http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/jardins
[1]Ce tableau habituellement accroché dans un chic salon d’apparat au siège de la Banque de France a été prêté pour l’exposition contre Le Buffet de Vauvenargues de Picasso : échange de bons procédés entre une institution prêteuse et le conservateur d’un grand musée national.

Kunsthalle Marcel Duchamp, le plus petit musée du monde est en Suisse
En 1946, Marcel Duchamp passe cinq semaines en Suisse et notamment cinq jours à Cully, sur les bords du Léman. Fasciné par la chute d’eau proche de son hôtel, il la photographie et l’utilise pour sa dernière œuvre, l’installation Étant donnés : 1° la chute d'eau, 2° le gaz d'éclairage (1946-1966), conservée aujourd’hui au Philadelphia Museum of Art.
The thought game (le jeu mental), Tom Hackney, 2016 ©KMD
A l’occasion d’un symposium autour de Marcel Duchamp et la cascade du Forestay en 2009, Stefan Banz et Caroline Bachmann créent aussi un lieu d’exposition, baptisé Kunsthalle Marcel Duchamp. La taille de ce lieu ? Une capsule de 45 cm sur 75 cm, perchée à 1m50 de hauteur. Deux étages, ouverts 24h sur 24 et 7 jours sur 7, cinq à sept expositions par an, ce musée n’a rien à envier aux plus grands, ni en termes de fréquentation, ni en termes de programmation. Les artistes exposés à la KMD sont internationaux et pas toujours méconnus : Ai Weiwei, Cildo Meireles… Catalogues et livres d’artistes sont publiés¹ à l’occasion des expositions.

Sunflower seeds, Ai Weiwei, 2011 ©KMD
En moins de 10 ans d’ouverture, le musée a déjà connu une rénovation. Le bâtiment d’inspiration brutaliste (un cube de 35 x 35 cm) a été remplacé en 2016 par une capsule-dôme (45 x 75 cm), en cuivre recouvert d’émail.

Marcel Duchamp - A game in a game, Ernst Strouhal, 2012 et Dialogue with imaginary viewers,
rétrospective, 2016 ©KMD

With a one woman show, Karin Sander, 2016 ©KMD
L’étage supérieur est offert à la vue du visiteur par de grandes baies vitrées, et il peut être aménagé comme on veut à l’aide de cimaises. L’étage inférieur est visible depuis une toute petite fenêtre. Les murs sont en émail blanc, l’espace est totalement modulable selon l’exposition.

Différentes scénographies ©KMD
Ce lieu d’exposition inconventionnel questionne les rapports entre l’art contemporain et l’espace, que ce soit le lieu géographique (Cully, petite ville au bord du Léman) ou la taille des expositions présentées. Il prend le contre-pied des biennales et foires internationales, figures de la mondialisation et de la globalisation de l’art contemporain où le commissaire fait figure de promoteur, où l’artiste exposé est là pour vendre son œuvre (à un acheteur ou pour une exposition), pour lui assurer une visibilité internationale. Cette forme de démesure se retrouve dans la Kunsthalle Marcel Duchamp mais de manière inversée : sa petite taille (3 375 cm² !) ne lui assure pas une visibilité maximale mais une visibilité suffisante, les artistes y sont exposés dans un but purement artistique et sélectionnés pour des projets précis autour de la figure et de l’œuvre de Duchamp.
La KMD renverse aussi le concept de musée, ou du moins elle lui donne une nouvelle dynamique. Le visiteur est un acteur plus important que “l’institution”, qui n’est vraiment que le réceptacle du propos. En outre, cette forme subtile de musée² permet de déclencher plus facilement et plus volontairement la rencontre avec les œuvres, ce que d’autres musées bien plus connus peinent à faire. Faudrait-il réduire tous nos musées immenses au 1 000ème pour leur donner cette dynamique ?
J. Lagny
#duchamp
#miniature
#artcontemporain
Pour en savoir plus :
Le site de la Kunsthalle Marcel Duchamp : https://www.akmd.ch/
Exposition en cours : Foin, Alain Huck, du 22 avril au 18 juin 2017
Prochaine exposition : One hundred years of Marcel Duchamp’s fountain, du 24 juin au 27 août 2017
¹ https://www.akmd.ch/publications/
² Malgré cela, la KMD a les mêmes charges qu’un musée : transport des oeuvres, entretien du bâtiment, publications...

L'art du cocktail ... ou les cocktails dans le monde de l'art
L’art de la cocktailerie est bien connu, il s’agit de bien savoir mélanger aux bonnes doses des liqueurs, sirops, etc. le tout soigné d’une belle décoration.
Crédits : potion de vie.fr - 2014
Et bah, dans le monde de l’art c’est pareil ! Surtout quand il s’agit de colloques, rencontres, séminaires, symposiums, journées d’études ; dans tous les cas on est face à des moments ou les professionnels de la culture sont en contact entre eux. Ainsi que dans un cocktail chacun des composants peut exprimer son individualité et sa créativité, également au sein des conversations et échanges entre ces acteurs au cours desquels on reconnaît bien les idéaux et théories que chacun postule. Chacun apporte sa saveur !
Et comme dans tout bon cocktail c’est le mélange qui fait la magie, c’est d’ailleurs à ces occasions que nous, jeunes étudiants, pouvons nous mêler aux spécialistes de diverses disciplines, conservation, médiation, régie, théoriciens, directeurs des musées, etc. et les approcher plus facilement en participant aux pauses déjeuners, soirées d’événementiels, qui sont de belles occasions de rencontres. On rencontre des personnes passionnées par leur métier dans une ambiance conviviale, il faut avouer qu’autour d’un verre les personnes sont plus détendues et à l’écoute, et que le design culinaire autant que les plaisirs de la conversation font pleinement partie des vernissages, tant préparés.
Crédits : L'Art de Muser - 2012
Une fois qu’on a réussi à les approcher (ce qui est tout un art aussi : savoir reconnaitre quelqu’un que l’on n’a jamais vu, qui bien sûr porte un badge… mais retourné et pas visible…) à nous de savoir jongler avec grâce entre propositions et idées comme un bon barman qui fait du « flair bartending », pour étonner et surprendre notre interlocuteur. C’est à ces moments là que peuvent se dévoiler devant nous des opportunités : pour un travail de recherche, ou pour un stage, ou bien une opportunité de travailler ensemble sur un projet ; à nous d’être comme un mistral,étonnant et fraichement servi. Et comme dans le monde du cocktail « l’art n’est pas affaire de quantité, mais de temps et d’imagination », faire des propositions innovantes.
Dans la vie, il faut savoir rencontrer pour trouver des opportunités. Si on ne les trouve pas, comme un bon maitre du cocktail, il faut savoir agiter ! Créons nous-mêmes ces moments ! Allons à la rencontre ! Mais surtout chers amis, prenez ceci comme un conseil, il ne faut JAMAIS, JAMAIS rater l’occasion, en toute modération, de prendre un bon cocktail !!
Andrea Vázquez
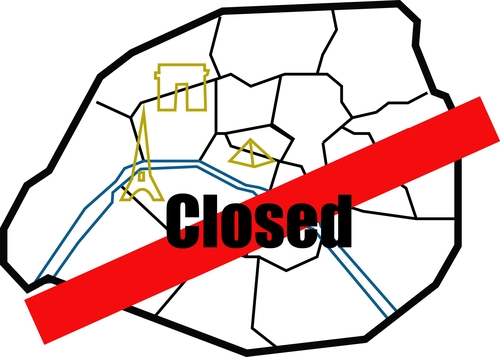
L'exposition que je n'ai pas vue
Quelles conséquences pour les musées ?

Tweet du musée du Louvre
Le total de cette grève pour le moment a entraîné une baisse de fréquentation entre 40 et 50% en moyenne, la plus haute baisse estimée serait de 70%. Les causes principales sont donc le manque de transport, qui rend l’accessibilité aux musées digne d’un parcours du combattant, principalement pour le personnel, ce qui entraîne une baisse des effectifs et donc une réduction des heures d’ouvertures. Et bien sûr une difficulté pour les visiteurs de se rendre sur place.

© Pavillon de Bercy - Musée des Arts Forains
Musées et grève en 2009
Le Centre Pompidou avait été le plus impacté en fermant ses portes pendant 17 jours. Le mouvement avait débuté le 23 novembre 2009, depuis le Centre Pompidou. Sa revendication était liée au non remplacement d’un départ à la retraite sur deux. En 17 jours de conflit, le musée avait perdu plus de 660 000 € de recettes, sur les billets d’entrée et au moins 100 000 € de recettes sur la boutique, en comparaison avec notre grève de 2019 où les pertes sont estimées à 400 000 €, alors que le musée n’a fermé ses portes une seule fois : on peut en déduire que le public a été refroidi par la grève des transports en commun et a préféré ne pas se déplacer. Peut être a-t-il été aussi moins séduit par la programmation et l’exposition Bacon qui n’a pas sû trouver son public.
Une exposition en gare

Exposition Beb Deum, Gare d'Austerlitz © Les Impressions Nouvelles
Juliette Dorn
#grève
#muséesparis
#expositiongare
Pour aller plus loin : https://www.lequotidiendelart.com/articles/16783-quel-impact-sur-les-musées-parisiens.html
Festival du Merveilleux au musée des Arts Forains : http://arts-forains.com/actualites/festival-merveilleux-fete-10-ans
Article grève de 2009 : https://www.lefigaro.fr/culture/2009/12/06/03004-20091206ARTFIG00051-apres-la-greve-les-musees-rouvrent-leurs-portes-.php

L'exposition qui se déguste avec les sens, Cookbook'19
L’exposition que je vais vous conter allie subtilement les travaux des chefs cuisiniers et ceux des artistes. Que pensez-vous de l’esthétique d’un plat raffiné ? Plaisir des yeux, plaisir en bouche ? La cuisine est un domaine qui fait appel à la créativité et où l’esthétique a finalement son importance. Quiconque peut jouer s’il le souhaite avec les couleurs, les textures et les formes, créer des visuels tel un dessinateur et un sculpteur. C’est ce que l’exposition Cookbook’19 de 2019 aux Musée des Beaux-arts de Paris a voulu transmettre, explorant les traits communs entre cuisine et art. Des cuisiniers ont été invités à produire des œuvres et des artistes à utiliser la gastronomie pour s’exprimer, créer et s’amuser.
Pour rendre la lecture plus poétique, j’ai décidé de m’initier mentalement au sein de l’exposition passée, en tant que commissaire d’exposition fictif. Vous verrez que je me suis fondue dans le décor que j’ai conçu, observant finement et tournant autour des œuvres. Je me suis fortement inspirée du livre de Lydie Salvaye Marcher jusqu’au soir, qui devant la fragilité des œuvres de Giacometti, ces êtres vivants, s’est perdu dans ses pensées, son passé torturé.
C’est parti, me voici toute une nuit, perdue entre ces créations et mes pensées les plus intimes. Le but n’est pas de vous faire un écrit détaillé sur l’exposition, vous trouverez de nombreux articles déjà présents sur le sujet, mais de vous emmener dans l’univers de mes ressentis, entre émotion et poésie.
Sur les vers de mon intérieur
Toujours la volonté d’en voir plus, d’en boire plus, plus et encore,
Me voici devant une infinie ivresse livrée avec délicatesse.
Qui vient donc réveiller le loup qui sommeille en moi ?
La bête qui boit verre après hiver et verre d’hier comme un délice sans fin.
L’œuvre que je viens de lire, me tient éveiller de la pire facette que j’essaie de camoufler.
Il s’agit de la peinture tridimensionnelle de l’artiste Mélanie Villemot, composée de 36 cocktails Sunset, placés de manière régulière et systématique, formant un motif et une répétition de forme. Un piquant mélange de jus d’orange, de jus de mangue, de tequila, de liqueur de fraise, de sirop de cassis et de grenadine. Les visiteurs sont invités à les déguster lors du vernissage provoquant une implication physique des spectateurs, initiant le ton de l’exposition. Lorsque j’ai rencontré cette jeune femme, je l’ai trouvée étonnante, pleine d’envies, d’idées et de désirs et j’ai eu envie de lui faire confiance, de la laisser me présenter son projet. Et aujourd’hui, je ne suis pas déçue, quand je vois l’engouement et le plaisir des visiteurs savourer une des premières œuvres comestibles.
Osez, osez, venir déguster des goûts empruntés à des éléments inexplorés !
J’ai l’audace de dénouer les goûts consommés, clichés et gourmands.
Venez, venez découvrir des goûts inquiétants, mais tout autant excitants.
Davide Balule, a lui aussi proposé pendant le vernissage des glaces aux goûts surprenants : poussière, peinture et bois brûlé étaient à la carte, ce jours là. Ni une, ni deux, j’ai à nouveau goûté ces parfums empruntés à notre quotidien. Des créations qui se mangent pour une exposition sur le thème de la nourriture étaient primordiales. C’est un sacré coup de pub ! Cependant il a fallu être vigilant quant aux normes sanitaires liées aux allergies diverses des visiteurs. De ce fait, David et moi avons décrit sur une feuille les ingrédients présents dans ses créations. De même pour l’œuvre de Mélanie. Et pour la petite anecdote, il était programmé que Fanny Maugey, à la fois de formation pâtisserie-chocolaterie et aux Beaux-arts, puisse-t-elle aussi participer en réalisant un parquet en chocolat, tel Charlie visitant la chocolaterie. Malheureusement, le chauffage à même le sol a rendu ce projet impossible. Mais des œuvres en chocolat ont été placées en avril, peut-être en faisant écho au lièvre ou aux cloches de Pâques.
Telle une marelle, j’y saute les deux pieds joins,
Curieuse sensation du pied retrouvant les dures sensations d’un sol imaginé.
Avivez tous vos sens ;
Le chef cuisinier s’est amusé à retrouver,
Les saveurs liées au palais.
Cette fois, le chef brésilien a voulu nous emmener dans son univers en proposant d’entrer physiquement dans l’esprit de ses plats. Il a disposé au sol cinq modules, destinés à marcher dedans et à procurer les mêmes impressions que celles d’un de ses fameux plats. Qui n’a jamais voulu remarcher pied nu, et surtout dans des espaces d’exposition ? Retrouvant des sensations liées à l’enfance. Sa proposition m’a séduite car moi-même une grand enfant, je me suis dit que les adultes, parents ou non, seraient ravis de jouer.
Inspire, respire les couleurs,
Couleurs endiablées d’une odeur de fruits. C’est exquis !
N’oublions pas les légumes, une place d’honneur dans nos cœurs.
Le chef Esben Holmboe Bang s’est amusé à créer des sérigraphies parfumées à partir de légumes et de fruits. Les visiteurs sont alors invités à s’approcher de l’œuvre et de la humer. Encore un sens invité dans cette exposition.
J’ai toujours eu l’habitude de créer
Même avec des petits riens
Des restes, des bouts et tout ce que j’avais sous la main.
Malgré le temps qui marche à petits pas,
J’ai découvert la joie d’être un chef,
Enfermé, mais libre de mes ingéniosités,
De manger et d’assoir mes recettes sur du nouveau papier.
Grâce à ces photographies, Nicolas Daubanes dévoile les méthodes et les processus des détenus afin de créer de nouvelles recettes au sein de leurs quatre murs. La nourriture est récupérée et le matériel qu’ils disposent, est réinventé. Parmi, ces créations, le radiateur sert désormais de grille-pain et des FigoluTM deviennent des makrouts. Le travail de Nicolas était judicieux, mettant en parallèle un univers auquel peu de gens ont accès. Cette idée d’être ingénieux malgré l’enfermement, de choisir la lumière malgré l’obscurité est une forme de résistance à mon goût !
#artculinaire #oeuvresdégustées #sensrévélés
http://www.artnet.fr/artistes/daniel-spoerri/
https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2012-2-page-71.htm
Image de couverture : © Zoe Williams, Ceremony of the Void, 2017

L‘exposition « Biolumina, Planète bioluminescence » : une expérience immersive poétique et pédagogique.
Exclusivement du 3 au 11 juin en plein cœur du Marais à Paris, plongez au cœur de la bioluminescence. Une exposition inédite sur une technologie innovante.
Cette expérience immersive proposée par une entreprise présente un fait scientifique de manière poétique et ludique aux visiteurs, adultes et enfants. L’exposition invite le visiteur de partir à la découverte d’un phénomène naturel de production de lumière nommé bioluminescence. Une exposition immersive au croisement de la science et de l’art pour s’émerveiller et interagir avec une lumière vivante et écologique. Divisé sur deux niveaux, cet espace de 180m2 se découpe en deux séquences. Le parcours de visite propose dans un premier temps de contempler, et de vivre un moment de bien-être grâce à la lumière bioluminescente et dans un deuxième temps de comprendre par une démarche scientifique et technique ce phénomène.
Un voyage immersif poétique
Le visiteur est accueilli par la fondatrice Sandra Rey de Glowee : cette startup française produit de la lumière grâce à des bactéries inoffensives et non toxiques. Cette lumière s’obtient grâce à l’activation de molécules particulières et certaines conditions environnementales qui sont présentées dans les différents dispositifs présents dans la seconde partie de l’exposition. Dès que les portes s’ouvrent, le visiteur est plongé directement dans l’univers magique de la bioluminescence, il entre dans l’espace appelé « contemplation room ». Portée par une musique relaxante, une voix off annonce le déroulé de la visite. Le visiteur est appelé à la contemplation pour s’immerger au cœur de la nature bioluminescente. La première pièce uniquement éclairée par cette lumière vivante nous invite à déambuler dans un décor unique, l’expérience est poétique, visuelle et auditive. Un émerveillement rendu possible grâce à un décor unique éco responsable en réemploi de matériaux, conçu et réalisé par la scénographe Candice Dupré et son équipe. D’élégantes sculptures de papier créées par l’artiste Junior Fritz Jacquet rappellent un environnement à la fois naturel et imaginaire. Ces sculptures de papier reflètent, diffusent et mettent en valeur la lumière bioluminescente.
Un espace méditatif sous un arbre fait de papier et de lumière bioluminescente avec des poufs permet au visiteur de s’allonger et d’écouter à l’aide d’un casque des histoires sur les phénomènes de la bioluminescence dans la nature. Immergé dans cet univers féerique le visiteur suit une rivière lumineuse et déambule dans l’espace par un chemin illuminé de bioluminescence.


Photo 1 et 2: espace immersif bioluminescent « contemplation room » ©S.A
Une expérience interactive et pédagogique
Dans la deuxième partie, des dispositifs de médiation et manipulation sont à la disposition du visiteur pour comprendre pourquoi et comment ce phénomène se produit, par quelles espèces et de quelle manière. Cet espace dit « interaction room » permet de manipuler le liquide bioluminescent afin de comprendre qu’il lui faut de l’oxygène pour s’illuminer.
Pour finir, un atelier permet de créer son dessin bioluminescent dans une boîte de pétri et de repartir avec cet échantillon.

espace pour comprendre qu’est-ce qu’une bactérie ©S.A
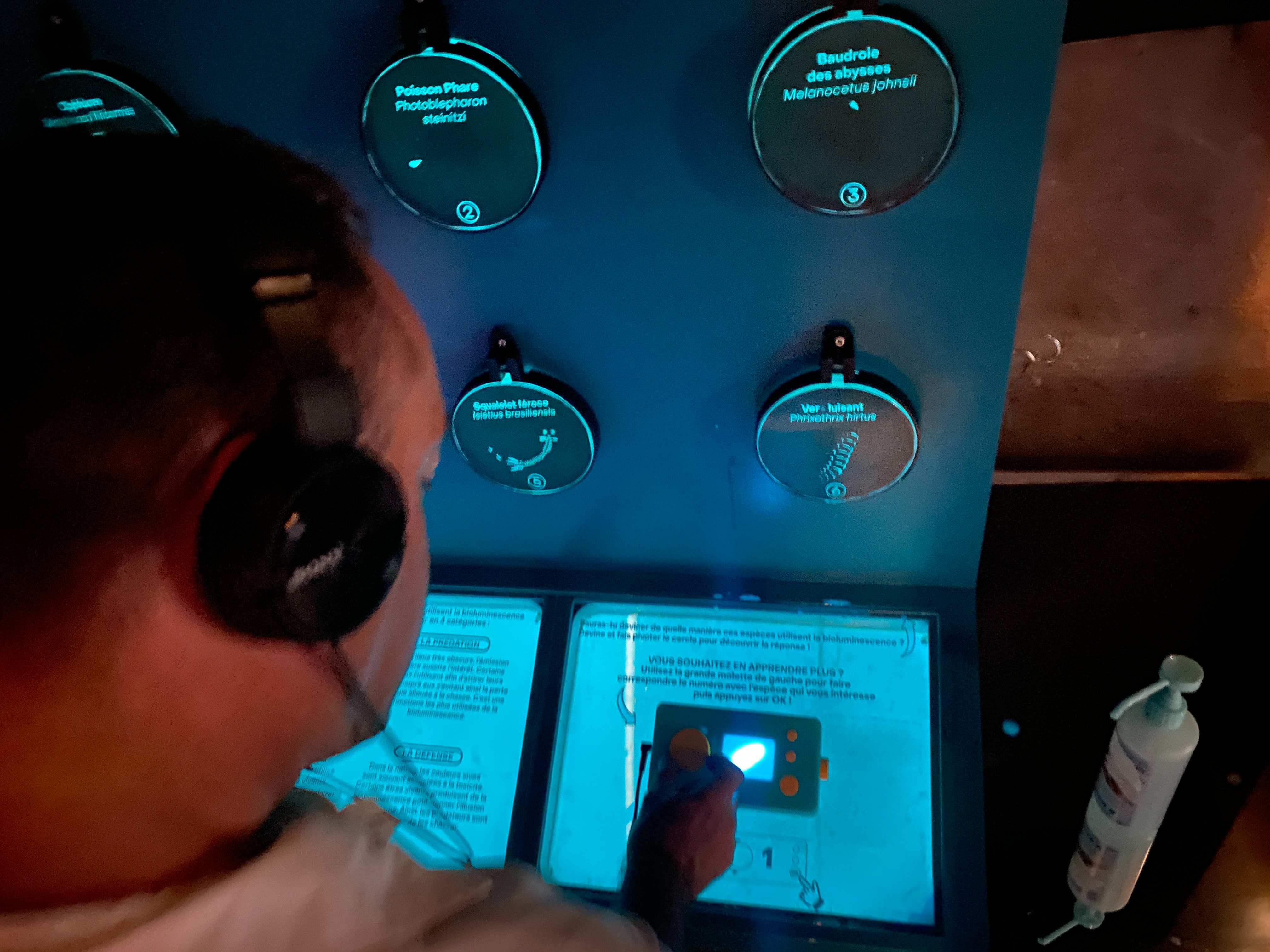
dispositif pour comprendre de quelle manière les espèces utilisent la bioluminescence ©S.A
S’émerveiller, comprendre et manipuler, avec cette première exposition sur la bioluminescence, Glowee propose au visiteur une expérience complète qui permet au visiteur d’imaginer d’autres applications possibles pour cette lumière écologique. Il est important aujourd’hui de s’intéresser à ce type d’innovation et de prendre conscience qu’il existe des solutions alternatives aux énergie actuelles. En utilisant la bioluminescence Glowee a pour objectif de changer la manière dont la lumière est produite et consommée. Cette exposition propose donc par le biais de l’émerveillement, un retour à la nature permettant d’ouvrir l’imaginaire et de se projeter dans l’avenir afin d’envisager et de concevoir des technologies durables. L’horizon de la bioluminescence reste encore à écrire.
Suzon Auber
#exposition #immersif #bioluminescence # écologie
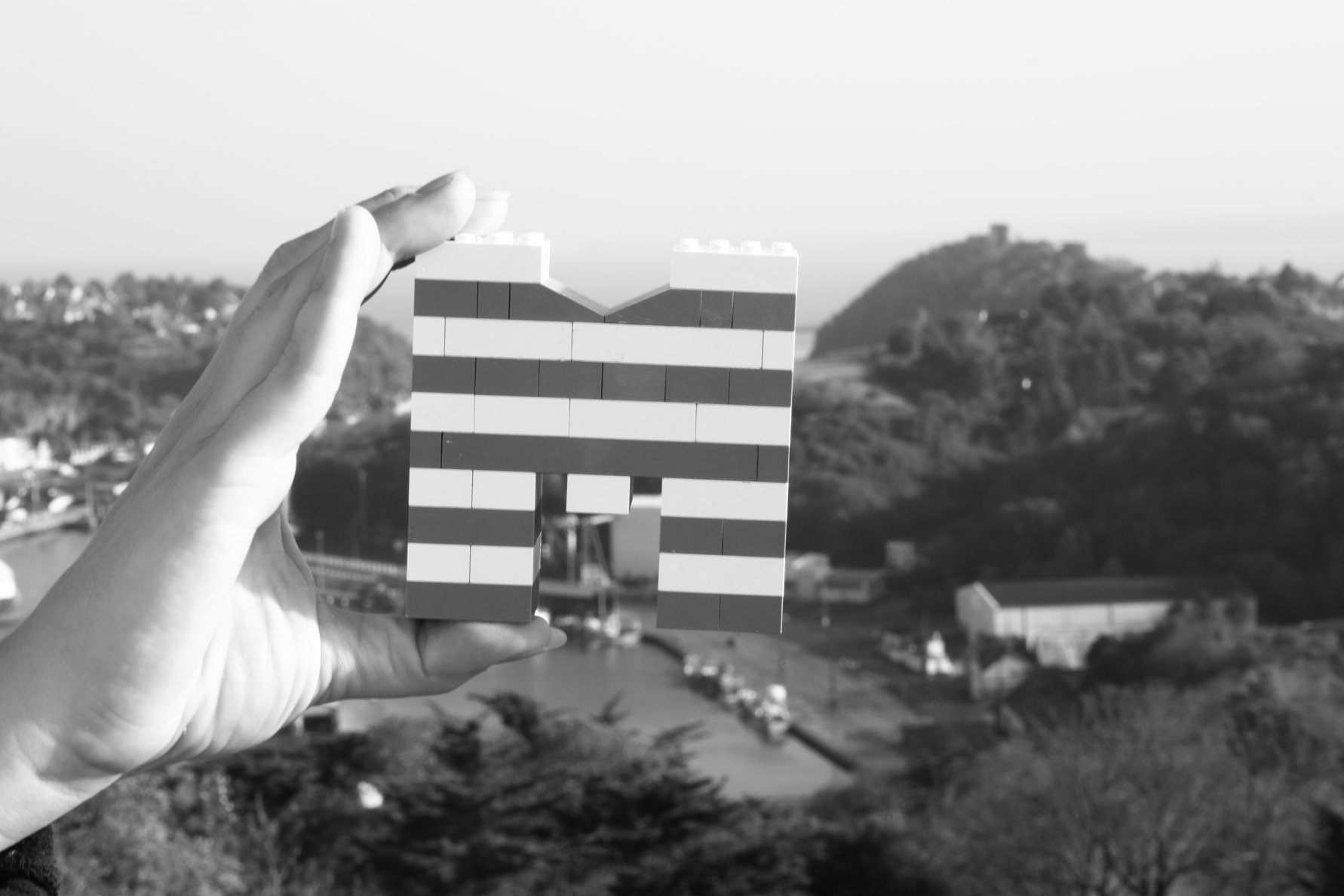
L’EXPERIENCE MUSEOMIX - Dans les coulisses de Saint-Brieuc 2018
Museomix quézaco ?
© NatAnitaCarmen – Museomix ouest – Le M de Museomix au dessus de la vue depuis le toit de la villa Rohannec’h.
Museomix à Saint Brieuc
Museomix, la Villa et moi
© Justine Faure - Intérieur de la villa Rohannec’h, le calme avant la tempête Museomix.
© Museomix ouest – Espace contenu rez-de-chaussée de la villa Rohannec’h (archives de la villa, collection numérisées du musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc, mémoires orales Les Bistrots de l’Histoire, bibliothèque municipale, et Archives départementales)
© NatAnitaCarmen - Photo de la plénière du vendredi soir sur le palier du premier étage de la villa Rohannec’h.
© Museomix ouest – Travail en équipe dans une pièce au premier étage de la villa Rohannec’h.
© Museomix Ouest – Et du partage en cuisine également ! - toutes les générations étaient présentes pendant Museomix.
Et Après Museomix ?
© Museomix ouest – L’équipe de Museomix Saint-Brieuc 2018 : participant.e.s et organisateur.rices
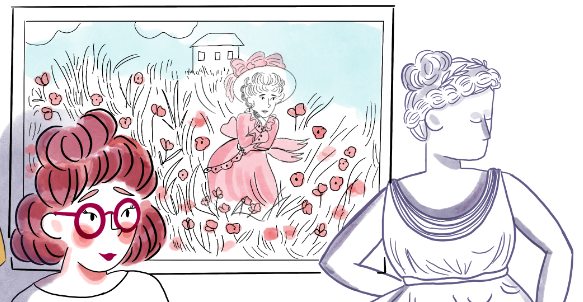
La belle au musée dormant
Mon esprit semble me projeter vers un endroit familier. Pourtant, il m’est difficile de le reconnaître : le lieu est sombre, comme si toute la lumière était absorbée par un trou noir. Peut-être qu’à force de ne plus pouvoir m’y rendre, ma mémoire l’a supprimé. Tout en me forçant à discerner l’endroit où je suis, je commence à marcher. Et au premier pas, je reconnais un son. Mon corps lourd et ankylosé avance avec difficulté sur ce que je crois être un vieux parquet, comme celui des vieilles bâtisses. Le bois craque et les fibres de la matière se déchirent au fur et à mesure que je me déplace dans cette pièce. J’éprouve ce déchirement dans mes chairs, et à chaque pas, les poils de mon corps se dressent. Je me courbe afin que mes mains puissent sentir le parquet. J’ai l’impression que les cellules de ma peau s’arrachent et se coincent dans la matière quand mes doigts caressent le sol. Il est assez vieux, lisse, et je sens mes mains : cela sent le miel et le pin. Après quelques instants, je réussis à la décrypter précisément en faisant appel à de vieux souvenirs. Je creuse dans ma mémoire, les muscles de mon visage se contractent si forts que des douleurs apparaissent autour de mes yeux. Mon cerveau brûle, forant encore plus profond dans mes souvenirs. Et puis soudain, plus rien et les muscles de mon visage se détendent. De la cire.
Il fait chaud, alors je m’étends sur le sol et cette odeur, qu’il avait été si difficile à identifier, m’enveloppe dans un cocon. Je ne vois toujours rien. Et au bout que quelque temps un point lumineux apparait dans le ciel noir. Seul. Puis un deuxième, et un troisième jusqu’à former un amas de points lumineux. Chaque point me rappelle une perle qui brille quand le soleil vient taper de ses rayons sur une de ses facettes. De ces petites perles, il y en a des centaines suspendues au-dessus de ma tête, retenues par des fils imperceptibles. Même si je me sens soulagée avec l’apparition de cette source de lumière, elle est encore si faible que je peux à peine apercevoir le parquet et encore moins l’endroit où je me trouve. Ces petites étoiles immobiles forment plusieurs cercles imbriqués les uns dans les autres. Mon corps se détend et le parquet, si froid, devient plus chaud. Apaisée par cette chaleur, mes muscles s’allègent et à chaque fibre musculaire détendue, des amas lumineux apparaissent. La lumière est de plus en plus présente dans la pièce. Je me relève sur mes coudes et en me concentrant un peu, j’arrive presque à deviner des formes. Se dresse devant moi une ombre assez volumineuse qui ondule dans l’espace. Le bruit du parquet craque de plus bel sous mon corps. Je me dirige droit devant en faisant le moins de bruit possible, car j’ai l’impression que l’on m’observe depuis le début et qu’autour de moi se trouve une multitude de personne. Je tends mes mains, je tressaille. Il ne s’agit pas d’une ombre, mais d’un objet froid. J’attends quelques instants, tétanisée, incapable de bouger. Sous mes mains, la matière est rugueuse et semble poreuse. Cette sensation me rappelle immédiatement les maisons en tuffeau de la Loire. Très vite, mon esprit fait le lien entre ces maisons et la matière de ce bloc. Il s’agit de la pierre. Rassurée par la nature de l’objet, ma pression artérielle revient à la normale. Je commence à parcourir ce bloc de pierre du bout de mes doigts. Mes mains sont à présent au sommet du bloc et je peux sentir des bosses et des creux qui ondulent comme des vagues et qui se rassemblent tous en un même point. Je ramène mes mains vers l’avant et sous ma peau se creuse une forme qui ne m’est pas inconnue. Du bout du doigt, j’effleure le haut du devant du bloc de pierre et au fur et à mesure que je descends, je ressens une légère courbe. Arrivée au sommet, mon doigt glisse vers quelques centimètres plus bas sur deux petites bosses pulpeuses et allongées, et qui esquissent une douce cambrure en leurs extrémités. Je parcours le reste. De chaque côté du bloc de pierre, un morceau se détache et se projette devant moi. De la paume de ma main, je parcours ce bloc, pendant que mon autre main reste immobile sur l’autre morceau qui me semble symétrique. Le morceau se divise maintenant en cinq petites ramifications que je peux sentir effilés et délicats. Je réussis à glisser mes doigts entre les creux, ils s’y logent parfaitement. La sensation ressentie ne m’est pas indifférente. J’ai l’intime conviction que ce bloc de pierre est animé par une âme d’un autre temps. Je regarde autour de moi, j'ai toujours l'impression d'être observée. J’abandonne ce bloc de pierre pour aller observer les alentours.
Dans l’obscurité, et en contractant les muscles de mes yeux, j’arrive à distinguer des sortes de fenêtres de différentes tailles qui s’accumulent, recouvrant ce que je pense être des murs. Derrière ces fenêtres, se trouvent une multitude de choses qui n’ont aucun lien entre elles. Je passe d’une fenêtre où l’on peut voir un paysage de la Grèce Antique, à une autre où se profile un très beau château anglais. Je ne comprends pas. Et puis les personnes elles-mêmes ne sont pas revêtues de la même façon. Dans une des fenêtres, deux femmes, assises sur une chaise. Leur poitrine est littéralement ouverte de façon à ce que l’on puisse voir leur cœur. À la vue de cette fenêtre, une forte émotion empoigne mon propre cœur et comme par magie les petites perles suspendues dans le ciel scintillent un peu plus. Je comprends. Alors, je me mets à courir allant de fenêtres en fenêtre. Dans l’une, deux femmes arborant de ravissantes toilettes se baladent dans un champ de coquelicot avec leur enfant. Et dans une autre, un couple qui s’embrasse, le visage caché par un voile blanc. À chaque fenêtre, la lumière se fait de plus en plus forte. À force de courir, je ne remarque pas que je suis revenue devant ce fameux bloc de pierre. Instinctivement, je glisse doucement ma main à l’intérieur de la sienne. Comme si j’avais appuyé sur un bouton, la lumière apparait.
Je sursaute à cause d’un flash qui me tire brusquement de ma rêverie.
Je m’étais assoupie sur un banc d’un musée.
Je tiens dans la main un crayon de papier et dans l’autre un carnet de croquis. Une statue est dessinée, exactement la même que dans mon songe. Je me redresse devant la statue, triomphante au milieu de la salle. Elle me regarde. Je ne suis pas encore totalement réveillée, j’ai l’impression qu’elle me fait un clin d’œil. Autour d’elle, le public déambule.
Après de longs mois d’absence, le public revient admirer ces œuvres d’un temps révolu. Nous n’observons pas seulement les œuvres d’art. Nous admirons, ancrons dans nos mémoires ces sociétés passées. Plusieurs jeunes femmes sont attroupées autour des Deux Fridas de Frida Kahlo, tandis qu’un vieux couple se remémore leur amour de jeunesse devant Les Amants de René Magritte. Des enfants courent autour de leurs mères essayant de les distraire pendant qu’elles discutent devant Les Coquelicots de Claude Monet. Ces sociétés ont sculpté pendant des siècles celle dans laquelle nous vivons. A notre tour, nous sculptons un avenir pour les générations futures. Les musées seront toujours là, intemporels et résistants au temps, même confiné. Dans quelques siècles, ces gardiens des civilisations perdues abriteront sans doute des œuvres, des témoignages et des objets, recenseront des pratiques que nous, citoyens du XXIe, ne connaitrons jamais.

© Salomé Turpin / Instagram @sallymoony
Edith Grillas
#Musée
#Imaginaire
#Petite histoire
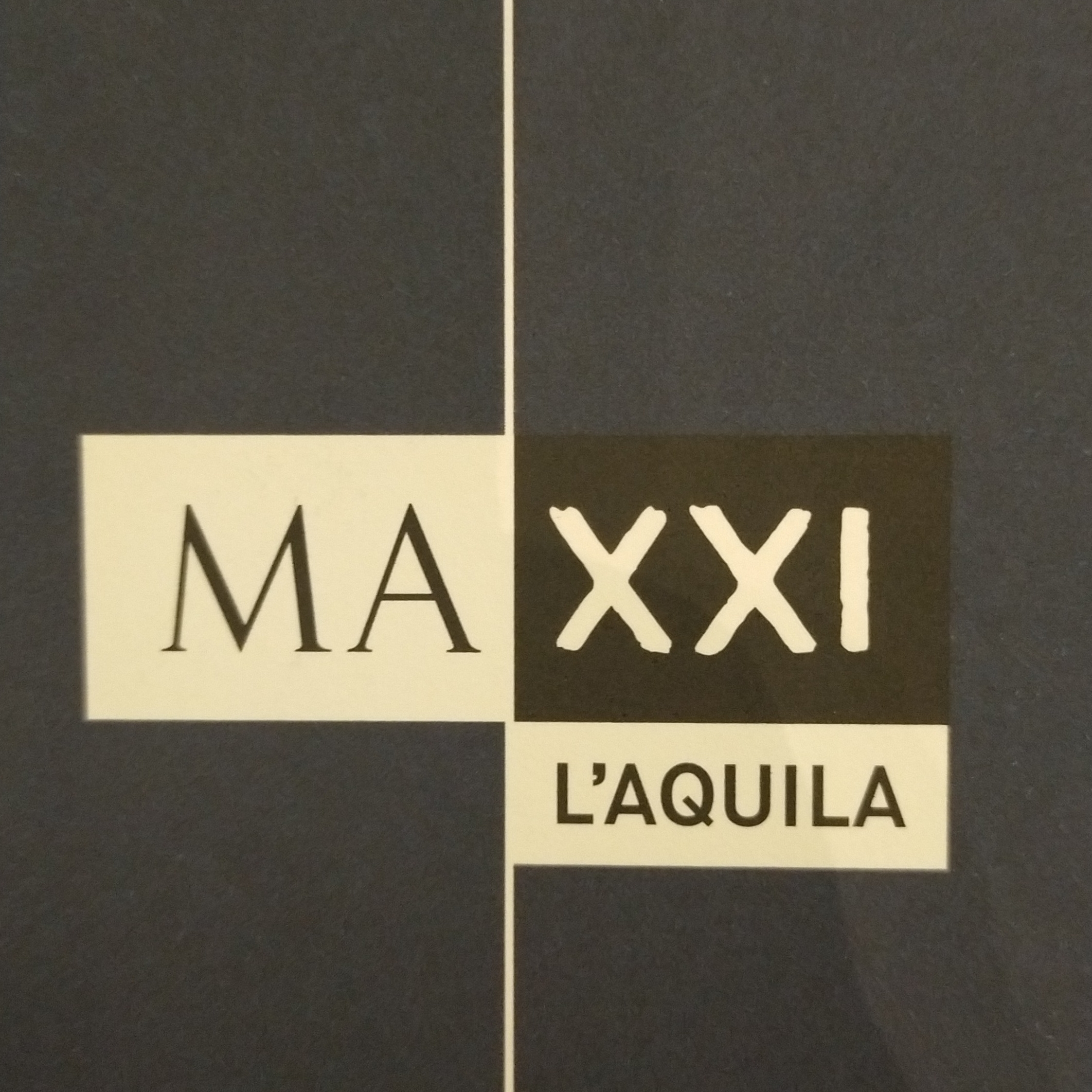
La culture peut-elle nous sauver la vi(ll)e ?
Lorsque l’on pose la question de l’impact d’un musée sur un territoire, un tortueux débat s’ouvre, avec son cortège de théories complexes, de chiffres et d’arguments contradictoires. Il ne sera pas question de cela aujourd’hui, mais plutôt d’une discussion imaginaire. Celle qui se tiendrait si l’on réunissait autour d’une table quatre villes qui, par-delà leurs différences, partagent un point commun : avoir misé sur la culture pour remédier aux difficultés de leur territoire.
A cet échange fictif sont invitées
- Bilbao, Pays-Basque espagnol. Cette ville portuaire dont le dynamisme était basé sur la métallurgie et la sidérurgie a subi la crise industrielle des années 1980. Un vaste projet de rénovation urbaine a été initié pour faire renaître la ville et changer son image, avec comme symbole la grandiose architecture de Frank Gehry qui accueille l’antenne du musée Guggenheim. Avec un million de visiteurs par an, l’impact de ce musée sur son territoire est tel que les spécialistes parlent d’un “effet Bilbao”.
- Détroit, Michigan, États-Unis. Capitale mondiale de l’automobile au début du XXe siècle, la ville a connu un déclin tel qu’elle s’est déclarée officiellement en faillite en 2013. Pour éponger ses 18 milliards de dollars de dettes, la mairie a envisagé un temps de vendre une partie des collections du Detroit Institute of Arts, parmi les plus importantes des Etats-Unis.
- Lens, Pas-de-Calais, France. Le musée du Louvre, souhaitant ouvrir une antenne en France, a choisi le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, frappé par la désindustrialisation. Le Louvre Lens a été inauguré en 2012 dans un bâtiment dessiné par l’agence d’architecture japonaise SANAA. Il entend participer à la reconversion de ce territoire, une dynamique forte déjà illustrée par l’ouverture en 2002 de La Piscine, musée d’art et d’industrie de Roubaix.
- L’Aquila, Abruzzes, Italie. De l’autre côté des Alpes, c’est le MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo - de Rome qui décide d’ouvrir une antenne dans une ville sinistrée. Il s’agit de L’Aquila, capitale des Abruzzes, frappée par un dramatique tremblement de terre en 2009. Alors qu’une grande partie de la ville reste à rebâtir, le Palazzo Ardinghelli, datant du XVIIIe siècle, a été restauré pour accueillir le musée d’art contemporain, qui a ouvert ses portes en 2021.
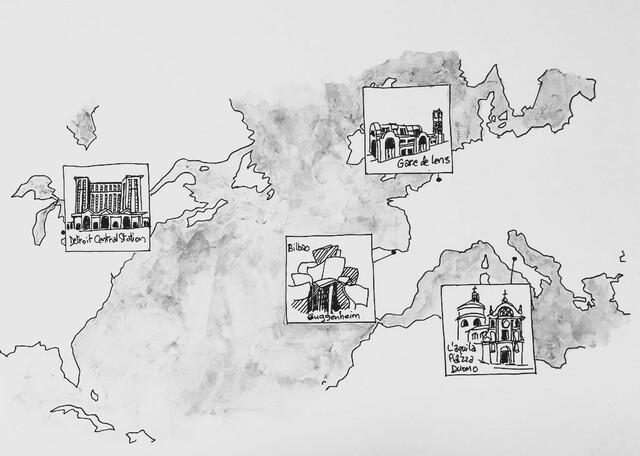
Les villes qui dialoguent ici © Vincent Audin
Bilbao
C’est l’effet « Bilbao »
Lit-on dans les journaux :
Quand l’industrie finie
Me laissant appauvrie,
Voilà qu’un grand musée
On décide d’installer.
Oui ! Prenons Guggenheim
Et misons sur Gehry !
L’architecte et la marque
Feront qu’on le remarque,
Pensaient les spécialistes
Reluquant les touristes.
Cela n’a pas manqué :
De lointains visiteurs
Sont venus par milliers,
Pour me combler d’honneur
Adieu la torpeur !
Détroit
Quelle chance vous avez !
De mon côté de l’océan
Les choses se passèrent autrement.
Une fois la faillite arrivée
Avec ses dettes à solder
Ce sont les œuvres du musée
Qu’on a voulu céder.
Nous aurions pu perdre Van Gogh, Rembrandt et puis Matisse
Si nous n’avions compris que la valeur de l’art
Dépasse celle des dollars.
Lens
Bilbao, Detroit, Lens : c’est une même histoire industrielle
Entre métallurgie, automobile et mines
Avec toujours cette même question :
Aux affres de la désindustrialisation,
Le musée est-il une solution ?
A Lens, c’est donc le Louvre qui s’installe
Dans un genre moins royal
Avec un bâtiment,
Bien moins exubérant. [en se tournant vers Bilbao]
Les œuvres de la galerie du temps
L’ancien puits de mine croisé en se baladant
Toutes traces, plus ou moins lointaines, d’un passé
Que l’on veut repenser.
En s’en tenant aux chiffres, certains – peut-être – diront
Qu’on peut être déçus par la fréquentation.
Mais ici, l’objectif est tout autre
L’ambition non moins haute :
Sur son territoire rester ancré,
Et à tous la culture partager.
L’Aquila
Ciao, io sono L’Aquila.
Je ne suis pas surprise :
Vous ne me connaissez pas
Je ne suis ni Florence, ni Rome ni Venise
Mais la capitale d’une région méconnue
Que l’on nomme Abruzzo.
Au centre de la botte,
Du haut des Apennins jusqu’à l’Adriatique
Je suis la terre des ours et du safran doré
Je suis une terre sauvage aux sommets enneigés
Je suis une terre qui tremble froissée par les séismes
6 avril 2009, 3h32, 308 morts
Une décennie plus tard,
On vante la résilience
D’un peuple qui en silence
Rêve un nouveau départ.
Il reste tant à faire
Et il faut de l’argent
Pour réparer les pierres
Sans oublier les gens.
A l’Aquila c’est l’art contemporain
Qui se fait pèlerin
Quand de Rome le MAXXI
Vient prendre ses quartiers
Au Palazzo Ardinghelli
Tout juste restauré.
De l’art contemporain ? me direz-vous
C’est élitiste, c’est pas pour nous
Mais pour qui d’autre, alors ?
L’antenne d’un grand musée venu de la capitale ?
Comme chez toi [en se tournant vers Lens]
S’ouvre un débat
Quand certains parlent de colonialisme culturel.
Mais quand j’ai vu le palais restauré
Les habitants s’y rencontrer
Quand j’ai vu les œuvres exposées
Mon territoire représenté
Je me suis reconnu.
Je me suis reconnu dans les photos de Paolo Pellegrin
Celles qui montrent les fissures et les ruines
Mais aussi dans celles de Stefano Cerio
Qui peuple de structures gonflables
Les plaines inhabitées
Du Campo Imperatore
Je me suis reconnu dans la douleur
Me suis retrouvé dans la couleur
Est-ce que l’art peut nous soigner ?
Vous vous ferez votre idée.
Peut-être pourra-t-il m’aider
Pour ne pas oublier
Mais sans se limiter
Aux souvenirs sombres
Emprisonnés sous les décombres.
Pour penser à demain
Est-ce si lointain ?
Car comme dit la chanson
Demain est déjà là
Domani è già qui

Photographie prise dans les Abruzzes en 2021 © Raphaëlle Vernet
Raphaëlle Vernet
Pour en savoir plus :
- Brochure de l’exposition d’inauguration (Punto di equilibrio) du MAXXI L’Aquila, avec visuels des oeuvres
- Article relatant l’ouverture du MAXXI à L’Aquila en 2021 et présentant son projet en lien avec le territoire
- La chanson (en italien) Domani, écrite en soutien aux Abruzzes et à ses habitants suite au séisme de 2009
- L’Aquila Fenice, un podcast (en italien) co-produit par le MAXXI pour raconter la renaissance de L’Aquila
#culture #développementlocal #antennes #L’Aquila

La Fondation GoodPlanet, de la « bulle verte » à la vitrine écologique
Le 14 octobre dernier, les amis de Yann Arthus-Bertrand se « vend[ai]ent aux enchères »1, au profit de la Fondation GoodPlanet installée depuis mai 2017 au Domaine de Longchamp. Comme en témoigne cette manifestation hors-du-commun, le lieu destiné à « placer l’écologie et la solidarité au cœur des consciences »2 ne lésine pas sur le spectaculaire. Au risque de verser dans une écologie hors-sol et dans une solidarité verbeuse.

Château de Longchamp, bâtiment de la fondation GoodPlanet (bois de Boulogne, Paris, 16e), le 26 juin 2018 © Celette
Le domaine de Longchamp, un lieu grand public ?

Des enfants participant à un atelier créatif proposé par créative l’association Créative handicap, sous l’œil attentif de Yann Arthus-Bertrand, le dimanche 14 octobre 2018 © C.R.
Les scolaires sont particulièrement ciblés par l’offre de médiation de la Fondation : 5 000 enfants auraient été accueillis entre mars et août 20186. Le catalogue 2018/2019 propose 19 ateliers abordant sous des formes variées (jardinage, ateliers photos, jeux de rôle, etc.) des thématiques liées au développement durable et à la solidarité. Or, dans la documentation disponible en ligne, les données chiffrées prennent largement le pas sur ces indicateurs qualitatifs - pourtant essentiels pour une fondation qui se donne pour objectif d’éveiller les consciences.
Une écologie plus contemplative qu’active
La Fondation GoodPlanet se veut également un lieu « d’expérimentation » de l’écologie. Dans le parc, la sensibilisation aux enjeux environnementaux se fait au travers d’un potager en permaculture, d’un rucher pédagogique, d’une roseraie et d’un hôtel à insectes. Le 14 octobre, aucune médiation n’était organisée autour de ces espaces.

Le compost et son panneau explicatif © C.R.
Si des panneaux expliquent de manière concise et efficace le fonctionnement et l’intérêt de ces dispositifs, des bénévoles auraient été bienvenu.es pour initier le public au désherbage manuel du potager ou à l’entretien du compost. Des ateliers payants intitulés « comprendre et s’initier à l’agroécologie » permettent tout de même aux plus motivé.es – ou aux plus fortuné.es - de participer aux travaux du potager. Pour le reste, l’entretien des espaces verts est confié à un jardinier indépendant7. On imaginerait pourtant bien, dans ce lieu solidaire, des salarié.es en chantier d’insertion.

La roseraie en friche © C.R.
Autre argument phare du parc, l’exposition Genesis de l’artiste Sebastião Salgado. Les photographies de Sebastião Salgado, comme celles de Yann Arthus-Bertrand, appellent à « s’abreuver à la splendeur des régions polaires, des savanes, des déserts torrides, des montagnes dominées par les glaciers et des îles solitaires »8. Cette nature vierge et spectaculaire figée dans les photos de Salgado n’est ni d’aucun lieu, ni d’aucun temps et sa préservation incombe à tous – donc à personne en particulier. Creusant la distance entre des lieux photographiés, devenus paysages à sanctuariser, et nos lieux de vie quotidiens, ce genre d’exposition motive difficilement l’action. Pourtant, les espaces à préserver sont d’abord ceux dans lesquels nous évoluons au quotidien et dans lesquels nos capacités d’action sont les plus grandes.
Rencontrer des humains mais pas ses voisin.es
Cette difficile articulation du global et du local se fait encore sentir dans les espaces d’exposition intérieurs. Sans surprise, les deux tiers des espaces sont occupés par l’exposition du travail de Yann Arthus-Bertrand9, le dernier tiers étant réservé à la Fondation Rocher.
Dans les deux cas, le/la visiteur.euse est assomé.e de chiffres dénonçant des inégalités de tous ordres. L’exposition Celles qui changent le monde de la fondation Rocher place en contrepoint de ces indicateurs pessimistes la présentation de projets écologiques et solidaires menés par des femmes aux quatre coins du monde. Ces présentations sont sommaires mais ont le mérite d’être contextualisées.
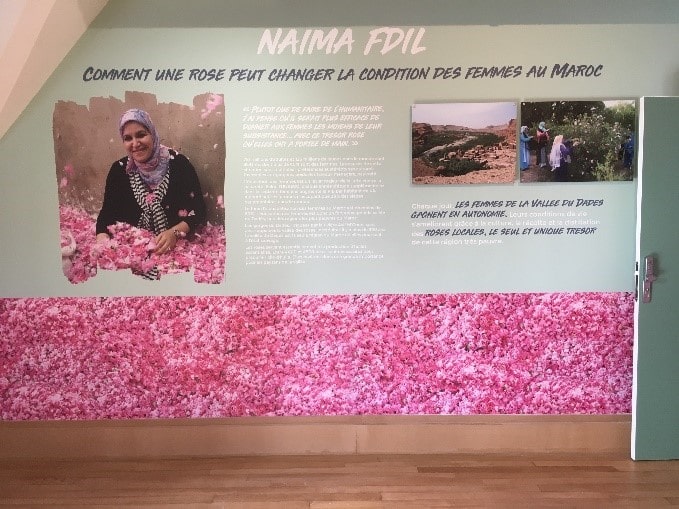
Celles qui changent le monde © C.R.

Exposition HUMAN, espace « dialogues » © C.R.
Aux étages supérieurs, le projet vidéo HUMAN, présenté dans plusieurs salles thématiques, propose de découvrir 2 000 portraits, défilant en très gros plans. Le dispositif fonctionne à la perfection : les brefs récits de vie des personnes filmées, projetés sur grand-écran, sont poignant.es. Pour autant, le témoignage suffit-il pour vivre une réelle expérience de l’altérité ? A-t-on vraiment « rencontré » une personne lorsqu’on l’a regardée sur un écran pendant quelques minutes ? Plus largement, que retire-t-on de cette « expérience émotionnelle » ? Une fondation reconnue d’utilité publique10 n’a-t-elle pas vocation à créer un lien social plus complet et durable ? Il faudrait, pour cela, laisser un peu de place à l’exposition d’initiatives de proximité. On pourrait par exemple imaginer de mettre en dialogue l’exposition HUMAN avec de petits films réalisés sur le même modèle par des visiteur.euses11. Des projets de ce type pourraient en outre être portés par des associations de proximité qui faciliteraient ce passage de l’échelle monde à celle du territoire.
Faut-il vendre ses amis pour sauver la (good)planète ?
Vous l’aurez compris : dans tous les domaines, GoodPlanet voit grand. Il faut dire que la fondation a des partenaires prestigieux. Elle est notamment soutenue par la « volonté philanthropique de la Fondation Bettencourt-Shueller » et par pléthore de grands mécènes12, au premier rang desquels BNP Paribas et Suez. En 2017 les mécènes (entreprises et particuliers confondus) assuraient 65% des ressources de la Fondation ; d’où, sans doute, le message assez consensuel tenu au Domaine de Longchamp.
Malgré ces généreux donateurs, le bilan 2017 de la Fondation est déficitaire. Heureusement, Yann Arthus-Bertrand peut compter sur ces ami.es célèbres qui acceptent de vendre aux enchère un moment passé avec eux. Dimanche 14 octobre le commissaire-priseur d’un jour Nikos Aliagas a ainsi pu mettre à prix une journée privilégiée aux côtés de Zazie – partie à 6 500€ - ou encore un déjeuner avec Blaise Matuidi, adjugé-vendu à 7 200€13. Au total, la vente aura rapporté 176 140€. Les acheteurs ? Des particuliers et… encore des amis14 !. Les copains pouvaient bien rendre un service, c’était le week-end de la Fraternité à la Fondation GoodPlanet.
C.R.
#GoodPlanet
#écologie
#solidarité
1Selon le flyer de l’évènement.
2 Plaquette de présentation de la Fondation GoodPlanet.
3 Rapport d’activité 2017 de la Fondation GoodPlanet, p. 7. Le rapport est consultable en ligne : https://www.goodplanet.org/fr/la-fondation-goodplanet/.
4 https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/Yann-Arthus-Bertrand-s-installe-a-Longchamp-pour-l-ecologie-727522
5 Rapport d’activité 2017 de la Fondation GoodPlanet. L’ensemble des citations de ce paragraphe sont issues du même document.
6 Catalogue des ateliers jeunesse, septembre 2018-juin 2019, p.3. Le catalogue est consultable en ligne : https://www.goodplanet.org/wp-content/uploads/2018/10/Ateliers-Jeunesse-Fondation-GoodPlanet.pdf
7 https://www.goodplanet.org/fr/la-fondation-goodplanet/equipe/
8 Texte de présentation de l’exposition, signé de Lélia Wanick Salgado, commissaire de l’exposition.
9 Ce que Télérama qualifiait malicieusement de débordement « égologique ». https://www.telerama.fr/sortir/goodplanet-yann-arthus-bertrand-replace-l-ecologie-au-coeur-de-la-capitale,158050.php
10 La Fondation GoodPlanet a été reconnue d’utilité publique en 2009, quatre ans après sa création.
11 Un atelier de ce type a pris place au Musée de l’Homme en 2017. http://www.benoitlabourdette.com/actions-culturelles/ateliers-creatifs-ouverts/musee-de-l-homme-atelier-cinema-anime?lang=fr
12 Rapport d’activité 2017 de la Fondation GoodPlanet, p.62 à 68.
13 Chiffres relevés par Kombini, footballstories.konbini.com/news/bonne-cause-dejeuner-blaise-matuidi-a-ete-vendu-7-200e-aux-encheres/
14 « Des amis de la fondation », Selon Le Parisien, http://www.leparisien.fr/paris-75/176-740eur-recoltes-pour-la-vente-de-yann-arthus-bertrand-14-10-2018-7918914.php#xtor=AD-1481423553%23xtor=AD-1481423554

La haute couture s'invite aux musées
La mode est à la mode, et ce ne sont pas les musées qui diront le contraire. De Dior aux Arts Décoratifs, de Balenciaga au musée Bourdelle à Jean Paul Gaultier au Grand Palais, les expositions de mode n’ont jamais autant déplacé les foules. Rien qu’en 2018, l’exposition Dior, organisée pour les 70 ans de la marque comptait 70 000 visiteurs.
Même si dès le XIXe siècle on exposait la mode lors des grandes expositions universelles, dans des pavillons d’élégance, c’est au Metromopitan Museum of Art (MET) que l’on doit les expositions d’envergure qui se développent aujourd’hui. Une des prochaines en date Louboutin aura lieu au Palais de la Porte Dorée à partir de février 2020.

Exposition Dior aux Arts Décoratifs @juliette dorn

Armani Silos @juliette dorn
Ces expositions imaginées par le conservateur ou suggérées par les maisons elles-mêmes ont bien sûr un intérêt marketing pour la marque. Exposé, le vêtement, n’est plus seulement un objet, il atteint le statut d’œuvre selon les propos de Sonia Rykiel. Il est doté de sa propre histoire, hors des défilés et des collections. En exposant leurs collections privées, les maisons de luxe donnent à voir leur savoir-faire, elles créent leur propre mythe. Ce sont les concernés qui financent ces expositions. Lorsque Dior expose aux Arts Déco, à Londres ou à Moscou, ce n’est pas anodin : dans ces grandes villes sont implantées ses boutiques de prêt à porter, c’est un moyen pour la marque de fidéliser sa clientèle tout en essayant de toucher au plus large. C’est aussi un moyen de se rapprocher d’une future clientèle, puisque ces expositions s’adressent à des visiteurs mais aussi à des clients potentiels. Nous parlons jusqu’ici d’expositions temporaires. Le lien de leur monstration n’est pas anodin non plus, entre une exposition au sein même du magasin newyorkais Prada et une autre organisée dans une institution muséale, qui de l’exposition en magasin, du défilé, ou encore de l’exposition muséale s’inspire de l’autre ?
Mais un autre fait marquant retient notre attention : de plus en plus de maisons de couture ouvrent leur propre musée. En 2017 Yves saint Laurent ouvre non pas un mais deux musées, alors que jusqu’alors, ses collections privées faisaient l’objet d’expositions événements à travers le monde. Armani à Milan a quant à lui réinvesti tout un quartier mêlant collection de mode et expositions temporaires. Citons aussi Gucci qui depuis 2018 a intégré son propre musée au Palazzo della Mercanzia à Florence. Dans ces deux cas, le directeur artistique de la marque est le créateur de l’espace et de la muséographie.
Enfin, la maison Chanel: Le Palais Galliera, premier musée de la mode à Paris va rouvrir en cette fin d’année. La maison Chanel a mécéné les travaux pour l’ouverture de leur tout nouvel espace d’exposition permanente, avec des salles consacrées spécialement à Gabrielle Chanel. La maison Chanel ne possède pas son propre musée, mais en subventionnant le palais Galliera et en faisant prêt de pièces de sa collection privée, elle s’offre une visibilité et un public autre que ses habituels acheteurs, met sa la marque en avant.
Les maisons de couture offrent ainsi une autre vision que ce que l’on peut voir lors des défilés, réservés à des initiés. Le musée offre un espace plus intimiste, le vêtement est visible de plus près, il est rarement sous cloche, pour donner l’illusion d’être accessible. Le lieu, la scénographie et le parcours concourent à cette dimension émotionnelle. D’un point de vue scénographique, la mode a une culture du grandiloquent, elle réadapte ici l’événement créé pour les défilés et principalement la fashion week.
Si la mode est un sujet proche du public, qui porte des vêtements tous les jours, les voit dans la rue et les magazines, c’est une culture qui s'acquièrt spontanément, la haute couture a ses codes.
En exposant la mode, on peut se permettre des scénographies extraverties. Pour Dior, Nathalie Crinière crée une scénographie événement, au point que le vêtement perd de son attrait tellement l’œil du spectateur est attiré par le décor qui l’entoure La salle remplie de fleurs en papier rappelle les créations de Christian Dior, avec ses défilés aux milliers de fleurs. Au contraire, le musée Armani présente ses collections dans un univers épuré, sublimé simplement par la lumière, là aussi un écho à ses créations et aux défilés.

Défilé Automne Hiver 2014-2015 au musée Rodin @ Dior
Lorsqu’une exposition de mode se concentre sur une marque ou un couturier en particulier, c’est l’univers décidé par le directeur artistique qui transparaît. Cela devient plus compliqué lorsqu’une exposition mélange les styles et les maisons de couture : la Cité de la dentelle et de la mode présente en parallèle des pièces du XIXème comme des vêtements plus contemporains, le créateur n’est plus l’attrait principal du vêtement, c’est sa technique qui est mise en avant. L’ambiance choisie est donc plus neutre pour s’adapter aux différents vêtements exposés, qu’ils soient l’œuvre d’un couturier ou du prêt-à-porter.
Alors alliance de marketing et de parcours sur le stylisme singulier de chacun, ces expositions mécénées sont-elles glorification de la marque ou ultime reconnaissance d’un couturier ?
Un élément de réponse réside dans l’exposition “Sonia Rykiel Exhibition” dédiée à la créatrice en 2008 aux Arts Déco, pour l’anniversaire de la maison. Cette exposition retrace le parcours créateur, en présentant notamment des dessins, les premières créations et les différentes collections. C’est avant tout un hommage envers le caractère charismatique et iconique de Sonia Rykiel.
Balenciaga exposé au musée Bourdelle, c’est un hommage post mortem au couturier et à son œuvre, un moyen de montrer le génie créateur en faisant dialoguer les robes de haute couture avec les sculptures de l’artiste du XXeme.
Dans ces exemples, le couturier est au premier plan, on glorifie non pas la marque qui découle de ces illustres noms mais son œuvre. L’accent est mis sur la personnalité du couturier, sur son talent. Exposer Coco chanel, ce n’est pas exposer Karl Lagerfeld, son successeur à la tête de la maison, mais l’aspect innovant des pièces de la créatrice pour son époque.

Exposition Cristobal Balenciaga, l’oeuvre au noir @musée bourdelle
Bien sûr lorsque le nom du créateur présenté est lui-même le patronyme de la marque, même si son œuvre est avant tout mise en avant, la marque en retire une certaine gloire. Pour une marque, posséder sa propre exposition ou mieux encore son propre musée est un moyen d’affirmer son influence dans le monde de la mode mais aussi dans la société.
L’exposition Dior est un parfait exemple de réalisation à la gloire de la maison. Le parcours d’exposition n’est pas chronologique ni divisé selon les différents directeurs artistiques de la marque, mais est présenté par grands thèmes, le Style Dior, ce qui fait l’essence même de la marque et sa reconnaissance mondiale.
Ainsi, entre grandiloquence et minimalisme, l’exposition de mode a autant un aspect marketing lorsqu’elle est centrée sur un créateur et sa marque en particulier, qu’une reconnaissance artistique pour le couturier. En adoptant les codes de la haute couture pour créer l’événement, ce type d’exposition est à présent ancré dans l’univers muséal et place le vêtement et son couturier au même titre qu’une œuvre d’art et son artiste: iconique.
Juliette Dorn
# Mode
#Hautecouture
#Couturier
Pour aller plus loin :
Christian Dior, couturier du rêve : https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/expositions/expositions-terminees/christian-dior-couturier-du-reve/
Back side : dos à la mode au musée Bourdelle, jusqu’au 17 novembre 2019
http://www.bourdelle.paris.fr/fr/exposition/back-side/dos-la-mode
Christian Louboutin, l’exposition : du 25 février au 26 juillet 2020
https://www.palais-portedoree.fr/fr/christian-louboutin-l-exposition

La rencontre du design et de la culture (scientifique)
Mettant les publics au cœur de ses préoccupations, les institutions culturelles cherchent sans cesse de nouvelles façons d’améliorer leur expérience de visite. Pour ce faire, le recrutement de professionnel.le.s aux parcours et compétences diverses est souvent envisagés. Ces politiques d’embauche témoignent d’une volonté d’apport de polyvalence et de transversalité dans les équipes.
Dans cet esprit, Le Vaisseau, un centre culturel et scientifique dédié aux enfants de 3 à 12 ans, à Strasbourg, a accueilli depuis mars dernier, Clara Speiser, une designeuse produit. A travers un entretien, je vous invite à découvrir son regard neuf et transversal.
Peux-tu te présenter ?
« Je m'appelle Clara Speiser, j'ai 26 ans, je suis designeuse d'objet, et actuellement, j'exerce cette fonction au Vaisseau ! »
Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours ?
« Mon DUT en science des matériaux m’a appris les différentes familles de matériaux, le verre, la céramique, les métaux, les polymères naturels et les polymères synthétiques et les composites. C'était fascinant ! J'y ai découvert pour chacun les propriétés microscopiques, macroscopiques. C’est, pour résumer, tout ce qui les caractérise et les procédés de fabrication qui leurs sont affiliés.
A ce stade de mon parcours, j'ai voulu apprendre à mettre en forme ces matériaux qui occupent notre quotidien. J'ai souhaité, moi aussi, leur donner corps et les faire vivre en tant qu'objet. Je suis donc partie en licence professionnelle à l'école de design de Nantes Atlantique pour me former au design d'objets.
Dans cette année charnière pour mon orientation, j'ai rencontré des enseignant.es/designers qui m'ont appris à créer des objets en accord avec un brief client. A travers une série de questions, ils m’ont appris à insuffler des valeurs à un objet, à effectuer un travail de recherche créatif pour donner un sens à l'objet. L'utilisateur est-il un enfant ? Un.e sportif.ve? Un.e retraité.e ? Dans quel lieu va être utilisé l'objet ? Sous l'eau ? En pleine nature ? À l'hôpital ? Dans une cuisine ?
Quelle valeur veut-on que l'objet dégage ? Veut-on qu'il soit robuste, ludique, minimaliste, honnête, futuriste, biomimétique, délicat, durable, élégant, dynamique, ....?
J’ai ainsi appris à m’interroger et définir les nombreuses caractéristiques que possèdera l’objet que je réalise : ses lignes, les matériaux utilisés, leurs aspects de surface, les couleurs choisies et sur quels éléments de l'objet, les mécanismes apparents ou non, les vis visibles et même exagérées, les formes arrondies ou anguleuses, des formes bombées ou très fines, des contours amplifiés, etc.
Je pense qu'à l'issue de cette licence, j'en étais là en termes de design d'objet. J'étais capable de mettre en place une démarche créative pour dessiner un objet pertinent pour un utilisateur et un contexte d'utilisation.
J'ai eu besoin d'aller plus loin, et d'approfondir le design. C’est pourquoi j’ai intégré une Ecole d’Ingénieur à l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard et leur formation « Ergonomie design et ingénierie mécanique ».
Cela m’a permis d’obtenir la double casquette ingénieur/designer.
J'ai appris à me servir de plusieurs logiciels de conception 3d, tels que Solidworks, Rhinocéros et Catia V5. J'ai pu me perfectionner sur ce dernier pendant ces 3 années d'études à un niveau avancé.
Durant cette formation, je me suis également formée aux méthodes et outils pour l'ergonomie et l'éco-conception qui sont des domaines transversaux du design d'objet.
Enfin, j’ai pu découvrir de nouvelles méthodes de créativité, de design thinking tout en m’exerçant au dessin, au maquettage et au prototypage.
Je terminerai là-dessus en précisant que lorsque je conçois un objet, mon objectif est toujours l'utilisateur et l'expérience qu'il va pouvoir vivre à travers l'objet. »
Que fais-tu au Vaisseau ?
« Au Vaisseau, je conçois les éléments d'exposition interactifs pour les enfants autrement appelé les manipes. Pour moi, le demandeur, c'est le muséographe. Il veut une exposition qui va raconter une histoire avec les objets interactifs pour véhiculer telle notion.
Suite à sa demande, je réalise des objets fonctionnels, et en adéquation avec la durée de vie de l'exposition qu’elle soit temporaire ou permanente. Pour cela, je dessine, croque, maquette, prototype avec des imprimantes 3d, une découpeuse laser.
Puis je passe par la phase de modélisation en 3D sur le logiciel Solidworks que j'implémente dans l'espace avec le logiciel SketchUp.
D’un projet à l’autre, je n'ai pas toujours les mêmes contraintes. Parfois, les manipes seront réalisées dans l'atelier de fabrication du Vaisseau, parfois, leur fabrication sera externalisée. L'une ou l'autre option dépendent toujours d'un unique facteur : le budget !
Ces contraintes de départ sont importantes car elles vont énormément impacter la direction artistique que vont prendre les objets.
Pour une exposition à 100% réalisée en interne, les formes des objets dépendront :
- des machines que l'on possède en interne et des matériaux qui leurs sont affiliés (principalement des plaques de bois)
- des compétences et des techniques des techniciens
- du délai du projet, donc du temps imparti pour la réalisation

Des prototypes de manipes pour l’exposition La Caverne © M.D
Je cherche le plus souvent à trouver des procédés de fabrication réalisables en interne. Et parfois, je suis amenée à aider à la fabrication finale. Je peins, visse, ponce, fabrique des moules en impression 3d et des contre moules en silicone entre-autre.
Dans cette configuration de création de manipe, je suis limitée en termes de moyens, de machines et de matériaux. Mais aussi contradictoire que cela puisse paraître, j'ai aussi plus de liberté dans mon expression artistique.
Je m'explique : Dans le cadre d'une exposition à plus gros budget, on peut faire des marchés de scénographie. À partir de là, la direction artistique sera entre les mains de la scénographie. J'aurai alors une posture beaucoup plus conciliante où je serai entre les choix de la scénographie et les faisabilités techniques des fabricants/manipeurs (donc les personnes qui branchent, programment, soudent, fabriquent le produit fini).
Je me trouve alors à la direction de conception des éléments de l'exposition.
Ainsi, j'intègre dans mon dessin 3D les codes formels et graphiques de la scénographie pour être en accord avec l'univers à naître. Et de l'autre côté, j'intègre dans mes volumes les contraintes du manipeur, c’est-à-dire les passages de câbles, les zones d'accès technique.
Malgré toutes ces contraintes auquel je dois concéder, je suis aussi garante de mes propres choix, que je défends : l'usage et ce que vont faire les enfants avec les objets. Un choix d'usages et des scénarii d'utilisation que j'ai d'ailleurs co-construits avec le(s) muséographe(s) du projet. »
Que penses-tu que le design produit peut apporter comme valeur ajoutée à un centre de sciences comme le Vaisseau ou aux institutions culturelles en général ?
« L'utilisateur est au cœur de la conception. En cela, le design s'assure que le parcours utilisateur sera positif.
En tant que designeuse, je pense aux postures, aux tranches d'âges et leurs tailles associées, aux sens mis en jeux pendant l'utilisation, sons, vue, toucher, l'odorat (ce qui me pousse à fuir les matières qui sentent le chimique, le "neuf" !).
Je pense aussi à l'approche : un jeu de résolution un peu complexe devra être détaillé et rassurant pour guider l'enfant vers la solution. Un jeu qui laisse une grande place à l'imagination de l'enfant devra être très suggestif, presque effacé (ex : il suffit d'un canapé et de quelques oreillers pour qu'un enfant créé une île au milieu d'une étendue de lave).
Le design c'est l'usage, c'est se mettre à la place de l'utilisateur pour lui faire vivre une expérience positive. »
Venue renforcée l’équipe du service de Conception et Développement de Projets, Clara vient répondre à l’un des objectifs : la conception des manipes en interne. Soucieuse de proposer un usage adapté aux enfants, elle assure une conception viable des manipes améliorant ainsi l’expérience de visite des publics.
Focus sur une manipe : De la demande au processus de conception à la phase de réalisation
Dans le cadre de la toute nouvelle exposition permanente Caverne, portant sur les couleurs dans la lumière et les illusions d’optique, Clara a eu l’occasion de mettre en pratique tout son processus de création. En effet, toutes les manipes de cet espace ont été entièrement réalisées en interne. Nous allons ici nous intéresser à l’espace « Coin du feu » dans lequel Clara a conçu et réalisé le « feu ». Ce dispositif lumineux vient dessiner l’ambiance de cet espace autour duquel on peut se rassembler en tribu (une famille, un groupe de visiteur.euses en « langage Vaisseau »). Il devient ponctuellement un espace de médiation que les animateur.rices peuvent s’approprier en profitant du dispositif de Clara, qui cache un rétroprojecteur, pour réaliser un théâtre d’ombres.
La réalisation de ce dispositif peut se diviser en plusieurs étapes
1. La demande
Cette « étape 0 » permet de comprendre les besoins, ici en l’occurrence des muséographes en charge du projet qui vont co-rédiger le cahier des charges qui est la base de travail de la designeuse.
2. La phase de recherche
Elle comprend une phase exploratoire à travers des planches d’inspiration et du sketching. Elles vont concerner l'usage et les scénarii, les postures qui sont envisageables, et aussi les matières.
L’idée, à ce moment du projet, est de ne pas se restreindre, et de se laisser aller à la créativité, aucune idée n'est encore à écarter.
Planche d’inspiration pour le dispositif © C.S
3. La phase convergente (cf le design thinking)
Le manque de temps à cette étape du projet ne permet plus d’explorer les différentes pistes pour des questions évidentes de plannings. Il est donc temps de passer en phase convergente et de resserrer ses idées. Pour cela, il faut formuler des concepts, 4 maximum.
Ils sont matérialisés par une architecture produit, donc une forme non définitive, qui suggère l'intention, mais dont le scénario est plus détaillé qu’en phase recherche.
À ce stade, le détail formel et graphique des concepts peut en réalité être plus ou moins avancé. Plus avancé si par exemple le demandeur est très précis sur ce qu'iel désire, ou si la designeuse est libre dans la direction artistique que doit prendre le projet. Moins avancé si la forme se construit en ping-pong avec les scénographes, qui est à la direction artistique, ou bien encore si le produit va subir beaucoup d'évolutions techniques en fonction des prototypes réalisés.
Les trois propositions pour le feu de l’exposition Caverne © C.S
4. Le choix
Vient finalement l’heure de présenter ses concepts au demandeur.euse.s qui choisiront le plus pertinents selon le projet. Il est parfois possible que ce soit un concept « bis » issu de deux propositions combinées ensemble.
5. La vérification de la viabilité
Il faut ensuite réaliser des maquettes et/ou des prototypes.
A coup de cartons récupérés, de cutter et de colle, la designeuse conçoit des maquettes. Ce sont des objets statiques dont on se sert pour valider des dimensions et des postures. Il est parfois possible d’utiliser la découpe laser pour des formes difficiles à découper au cutter. Le but, à cette phase du projet, est de limiter au maximum les matières coûteuses et plus « précieuses » que le carton usagé (bois et plastique entre autres).
Quant aux prototypes, ils sont là pour valider des fonctions, qu'elles soient mécaniques ou électroniques. L’utilisation de matières plus coûteuses et de procédés plus précis permet ainsi de rester fidèle aux jeux de mécaniques.

Test des rendus lumière du prototype. © M.D
6. Définition de l’architecture produit détaillé
Les conclusions des maquettes et des prototypes vont permettre de définir l'architecture produit détaillée, puis de modéliser l'objet en 3D dans sa version finale.
Architecture produit du dispositif du « feu » © C.S
7. Les plans techniques
On termine par la réalisation de plans techniques pour la fabrication. Dans le cas de Clara, certains plans iront pour l'atelier du Vaisseau et d'autres pour des éléments sous-traités ne pouvant être réalisés en interne.
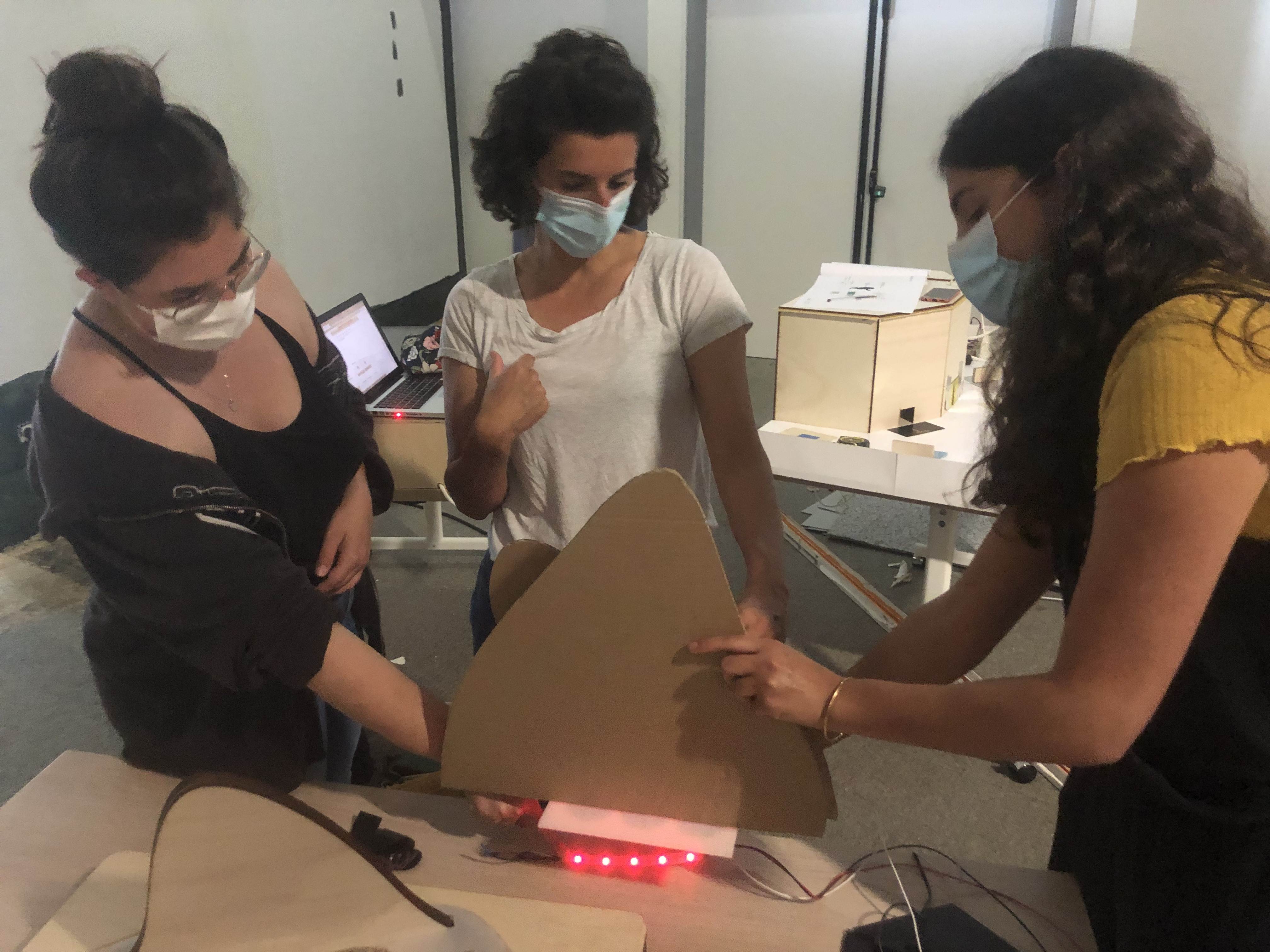
Tests et échanges sur le rendu avec la scénographe et la muséographe. © M.D
De gauche à droite : Margot Coïc, muséograhe, Céline Daub, scénographe et Clara Speiser, designeuse produit.

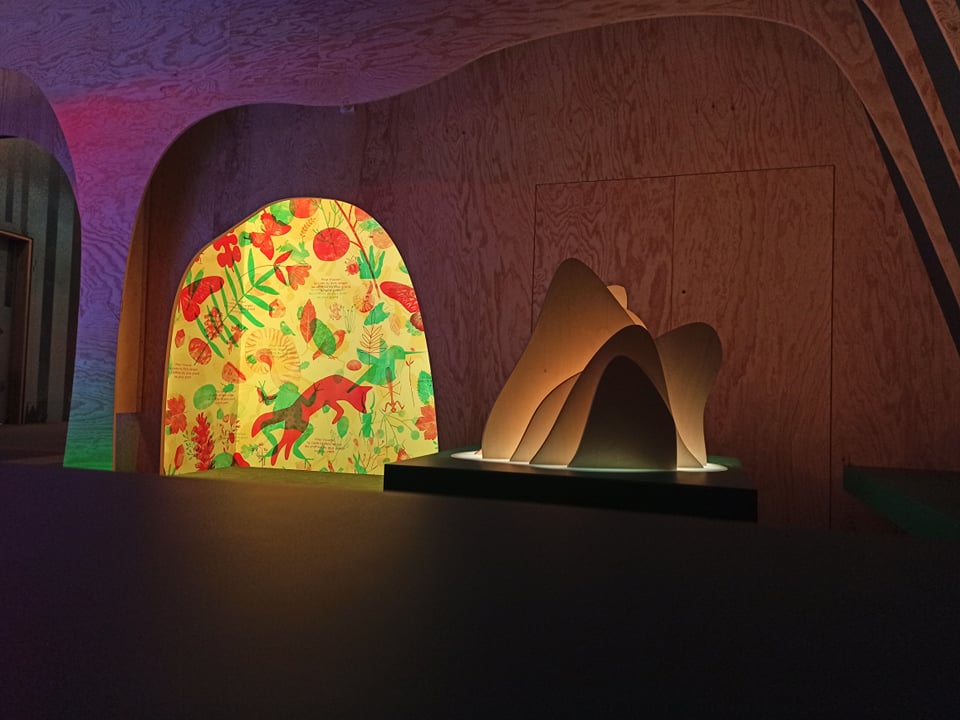
Le coin du feu dans le nouvel espace d’exposition La Caverne © M.D
#Design
#CentredeSciences
#Manipes
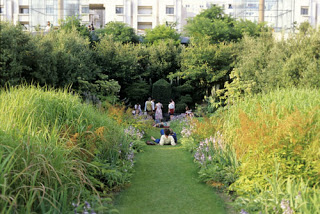
La scénographie du jardin
Les jardins séduisent un public de plus en plus large, qu’il soit professionnel, amoureux de la nature, ou juste de passage. De plus en plus de jardins sont ouverts au public, la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins [1] a énormément de succès, on crée des labels spécifiques. Deux grandes institutions culturelles française, le Centre Pompidou-Metz et le Grand Palais, y consacrent chacune une exposition. Cela a peut-être à voir avec la prise de conscience d’une nature de plus en plus menacée par la main de l’homme. Plébiscité, le jardin devient donc un lieu exposé aux regards, foulé, parcouru par des publics, comme dans une exposition. Alors que le soleil commence à pointer le bout de son nez et fait s’éclore, fleurir, s’épanouir, croître le jardin, nous proposons d’interroger la relation entre jardiniers et scénographie.
Le « jardin » perçu comme espace serait mis en scène pour ses visiteurs. A quelle fin ? Déjà sous la dynastie des Ptolémées en Egypte, les jardins participaient à la gloire de la dynastie. Au XVIIe siècle, André Le Nôtre travaille au Château de Vaux-le-Vicomte et bien sûr à Versailles, jardins à la française par excellence. Ces jardins mettent en scène le pouvoir de leur commanditaire. Au XVIIIe siècle se développe la notion de parc pittoresque, en Angleterre avec William Kent et en France avec René-Louis de Girardin (parc Jean-Jacques Rousseau d’Ermenonville). Les parcs pittoresques reprennent les idées clés des Lumières. Au XXe siècle on observe l’influence de l’art dans les jardins, par exemple à la villa Noailles à Hyères. Progressivement, une idée de nature sauvage est évoquée, une nature qui pousserait librement, comme en témoigne le Parc André Citroën créé par Allain Provost et Gilles Clément.
Parc André Citroën © Y. Monel
Ainsi la mise en scène des jardins ne date pas d’aujourd’hui. Si l’on s’attache à la définition de la scénographie comme « l’art de concevoir et de mettre en forme l’espace propice à la représentation ou présentation publique d’une œuvre, d’un objet, d’un événement » [2], le jardinier est ce type de créateur, il est celui qui imagine, dessine, conçoit, le jardin. Comme un architecte, il utilise des plans ; comme un scénographe il crée des ambiances grâce à des palettes, un parcours grâce à des volumes ; comme un technicien il « construit » et entretient son jardin avec des outils spécifiques. Il est tout cela à la fois, concepteur et réalisateur : « On ne peut pas apprendre l’art des jardins de façon théorique. Il est nécessaire d’apprendre la vraie nature des plantes et des pierres, de l’eau et du sol, autant par les mains que par la tête » [3].
« Rendre l’espace actif et même acteur, définir un point de vue signifiant sur le monde, élaborer des dispositifs et des lieux scéniques qui en assurent la mise en œuvre, assurer un travail réfléchi de découpage de l’espace, du temps de l’action, conférer une valeur poétique à un cadre scénique approprié au drame représenté, telles sont les caractéristiques du travail scénographique » [4] dit Marcel Freydefont à propos de la scénographie. L’art du jardin aujourd’hui est-il si différent ? Si un espace peut être actif et acteur, c’est bien celui du jardin, qui est en perpétuelle évolution. Que ce soit d’un point de vue écologique, artistique ou intime, le jardin a du sens, c’est une déclaration, un geste. Se développant petit à petit au fil des saisons, le jardin est ancré dans le temps et aussi dans l’espace par sa taille ainsi que la déambulation le long des allées, des bordures. Quant à sa valeur poétique, elle est indéniable.C’est ce travail de scénographe du jardin que font les lauréats du Festival International des Jardins à Chaumont-sur-Loire [5]. Chaque année, des équipes composées de paysagistes, d’architectes mais aussi d’artistes ou de designers répondent à une problématique en proposant une création originale. Une vingtaine de jardins sont présentés au public dans un parcours semi-directif.
Frankenstein’s Nature, Anca Panait et Greg Meikle, édition 2016 © E. Sander
Visité, le jardin devient une scène, où le visiteur est acteur et spectateur, regardeur et auditeur… Ce qui est mis en scène c’est la force vitale de la nature, c’est son essence même, sa capacité à croître pour ensuite faner et renaître. Peut-être que le jardin parle à l’homme car il est comme une métaphore de celui-ci, vivant mais éphémère, naturel et artificiel. Artificiel car de la main de l’homme, même quand le jardin se veut au plus près de la vérité : « Le concept de jardin sauvage est, proprement, un oxymore puisque tout jardin est une création artificielle » [6]. Un jardin est toujours une collaboration entre l’homme et la nature, avec la nature et non contre la nature.
Dans cet esprit de lien avec la nature, le Tiers-Paysage, concept inventé par Gilles Clément, désigne des endroits où l’homme laisse la nature se développer, des réserves de la biodiversité, jardins ou parcs aménagés comme espaces naturels intouchés. Le parc Matisse à Lille présente une de ses réalisations pouvant correspondre au concept de Tiers-Paysage, l’île Derborence. Cet îlot s’élève au milieu du parc et l’homme n’y a aucune prise. Le Tiers-Paysage est mis en scène par le « piédestal » sur lequel se tient l’île. Ainsi, même si l’homme n’intervient pas, il y a scénographie. Pourquoi ? Parce que, comme le dit Jean-Pierre Le Dantec, architecte-urbaniste ancien directeur de l’école d’architecture de Paris-La Villette, « dans notre monde urbanisé, seule la présentation d’une nature sauvage est susceptible d’attirer l’attention » [7]. C’est sans doute pour cette raison que Gilles Clément a choisi de mettre en scène l’île Derborence, pour attirer la conscience du visiteur sur l’écologie, sur une manière d’exploiter la diversité et les possibilités de la planète sans rien détruire.
Île Derborence, Parc Matisse, Lille © Grow
Gilles Clément a élaboré d’autres concepts qui sont liés à celui du Tiers-Paysage, comme le Jardin Planétaire ou le Jardin en Mouvement. Le Jardin Planétaire c’est l’idée que la planète est, comme le jardin, un espace clos que l’homme doit respecter pour lui-même continuer à vivre. En 2000 à la Grande Halle de la Villette une exposition est consacrée au Jardin Planétaire. Gilles Clément en est le commissaire, Raymond Sarti [8] le scénographe. Le but de l’exposition était d’attirer le regard du visiteur sur l’écologie et de faire prendre conscience de l’état de la nature aujourd’hui. Pour cela, la création de Gilles Clément était soutenue par une scénographie tentant de se fondre parmi les plantes. On peut trouver cela paradoxal, qu’il y ait besoin de dispositifs pour expliquer la pensée écologique contemporaine alors que le visiteur est entouré de plantes, de fleurs. Toutefois, ces dispositifs scénographiques n’étaient là qu’en renfort de l’œuvre végétale de Gilles Clément, mise en scène.
Le Jardin Planétaire © R. Sarti
Le Jardin Planétaire, croquis de la scénographie © R. Sarti
Malgré ces exemples, il n’est pas encore possible de parler d’une véritable discipline scénographique du jardin.Trop peu de personnes s’en réclameraient. Gilles Clément n’apprécierait sans doute pas qu’on dise que son île Derborence est une création scénographique ! Néanmoins, si l’on reprend la définition de la scénographie de Marcel Freydefont citée plus haut, les liens entre scénographie et jardin sont indéniables.
J. Lagny
#jardin
#scénographie
[1] http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
[2]Association SCENOGRAPHES, Projet d’exposition, Guide des bonnes pratiques, 2013
[3] Russell Page, L’éducationd’un jardinier, Paris, La Maison rustique, 1999
[4] Marcel Freydefont, Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Editions Bordas, Paris, 1995
[5] http://www.domaine-chaumont.fr/fr/festival-international-des-jardins
[6] Jean-Pierre Le Dantec, « Régulier, naturel ou sauvage, mais toujours artificiel » in Grand Palais, Jardins, Paris, RMN Grand Palais, 2017, p. 237
[7] Jean-Pierre Le Dantec, « Régulier, naturel ou sauvage, mais toujours artificiel » in Grand Palais, Jardins, Paris, RMN Grand Palais, 2017, p. 243
[8] http://www.raymondsarti.com/

Le débat oublié
Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau débat politique inédit et sans précédent. Merci d’être avec nous en ce jeudi 20 avril 2017, exactement trois jours avant le premier tour des élections présidentielles. Les onze candidats à la présidence ayant peu débattu lors des deux débats télévisés du sujet, pourtant si essentiel, de la culture, l’heure est venue aujourd’hui de développer les idées de chacun !
ATTENTION : Nous vous informons que ce débat est un débat fictif, qui n’a donc pas réellement eu lieu entre ces candidats (ou alors loin des yeux attentifs des caméras). Il repose néanmoins sur une analyse précise des programmes de chacun.
Commençons sans plus attendre, les candidats ont tous pris place et notre première question est la suivante : en matière d’éducation culturelle, quelles sont vos propositions ?
Marine LE PEN : Étant la candidate la plus haute dans les sondages jusqu’à présent, je me permets de commencer… Avant tout, la culture que je souhaite soutenir et valoriser dans mes actions est bien entendu la culture française. Avec ses valeurs et traditions, la France possède un patrimoine culturel qu’il ne faut pas négliger. Et qu’est ce qui reflète plus la France si ce n’est sa langue. C’est pourquoi, je m’engage fermement à défendre notre belle langue à travers plusieurs mesures essentielles : les cours de français devront représenter la moitié du programme scolaire de primaire. Il faut tout bonnement supprimer “l’enseignement des langues et culture d’origine” (ELCO) qui n’a pas sa place dans les programmes scolaires et nous allons abroger la loi Fioraso qui vise à restreindre l’enseignement en français dans nos universités !
Jean LASSALLE : Voyons Madame Le Pen, je ne suis pas du tout d’accord ! Mes chers concitoyens, je pense justement qu’il faut coopérer avec les écoles étrangères, surtout en terme d’éducation culturelle voyons !
François FILLON : Alors permettez-moi de vous dire que je pense qu’une meilleure articulation des enseignements est nécessaire. C’est-à-dire que des cours tels que l’enseignement culturel et autres cours d’histoire de l’art doivent d’abord être en lien avec l’histoire en générale. Non ?
Jean-Luc MÉLENCHON : Mais c’est pas du tout ça le fond du problème, vous n’y êtes pas du tout. Ce qu’il faut avant tout c’est un renouveau de l’éducation artistique à l’école ! Les amis, qu’elle devienne une priorité de la maternelle à la faculté !
Benoît HAMON : Je partage l’avis de Monsieur Mélenchon et c’est pourquoi je propose un “Grand plan pour la culture à l’école” !
Jean-Luc MÉLENCHON : Oui enfin c’est la même idée que moi sauf que vous y avez ajouté un titre plus pompeux…
Nicolas DUPONT-AIGNAN : Pour une fois, je suis bien d’accord avec la gauche tiens. Il faut permettre à tous ces élèves de faire au moins une œuvre artistique de leur scolarité ! Après s’ils en ont assez de l’art, ils passeront à autre chose.
Marine LE PEN :Messieurs, s’ils veulent continuer, moi je propose : un grand plan national de création de filières des métiers d’art, aussi bien au lycée qu’en université et ainsi nous implantons un réseau national d’artistes dont nous pourrons être fiers.
Jean-Luc MÉLENCHON :Peut-être Madame Le Pen, mais il faut surtout que l’enseignement supérieur artistique soit un service public national ! Et je pense également qu’il faut créer des jumelages entre les établissements scolaires et les établissement culturels, voila !
Jacques CHEMINADE: En parlant de jumelages, il faut aussi une coopération des centres de loisirs et des écoles avec les conservatoires et orchestres… On n’a pas encore dit un mot sur la musique, le plus bel art de tous…
Marine LE PEN :Dans mon programme je propose qu’il y ait une véritable éducation musicale à l’école, contrairement à ce qu’on peut avoir aujourd’hui… Oui la musique est aussi importante pour le Front National.
Jean-Luc MÉLENCHON :Mais il faut réussir à intéresser les jeunes voyons ! Ce que je propose est le développement d’une filière numérique, j’adore les jeux vidéos c’est un “magique instrument de formation et de culture”, et puis vous devez tous sûrement avoir entendu parler de mon hologramme…[Jean-Luc Mélenchon fait un clin d’œil à la caméra]
Jacques CHEMINADE : Faites attention à vos propositions Monsieur Mélenchon, les jeux vidéos sont responsables d’un bon nombre de violences ! Et je souhaite voir interdits tous les jeux vidéos jugés trop violents pour nos adolescents…
Nous: Monsieur Macron, nous ne vous avons pas encore entendu, quelles sont vos propositions concernant l’éducation et la culture ?
Emmanuel MACRON :Moi, lorsque je serai président j’assurerai un accès aux éducations culturelles et artistiques à tous les enfants. De plus, je dédierai une dotation spéciale pour des projets éducatifs, culturels et touristiques pour valoriser le patrimoine. Et toc, d’une pierre deux coups. En marche vers un président jeune et swag !
Nous remarquons donc que François Asselineau, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud restent sur la touche pour cette première question et c’est bien dommage… Peut-être se rattraperont-ils par la suite! Nous les attendons au tournant. Passons donc à notre deuxième question sur la démocratisation culturelle : quelle est la première mesure que vous souhaiteriez mettre en place afin de rendre la culture accessible au plus grand nombre ?
Philippe POUTOU : Il faut abroger la loi Hadopi !
Nicolas DUPONT-AIGNAN :Alors ça je suis bien d’accord !
Marine LE PEN: Et bien moi aussi tiens ! Au nom de la liberté publique, bien entendu ! Il faudrait même ouvrir le chantier de la licence globale !
François FILLON: Mais n’importe quoi : cette loi, mise en place sous Sarkozy et plus exactement sous le gouvernement François Fillon 2, donc moi, ne peut être supprimée, c’est ridicule ! Par contre, je propose que les horaires des établissements culturels soient élargis. La culture ne passe pas par le téléchargement illégal, mais en allant dans les lieux de culture mesdames et messieurs !
Emmanuel MACRON : Alors oui, je suis d’accord, Monsieur Fillion, le téléchargement c’est mal. C’est pourquoi l'émergence d’un “Netflix européen” sera une aubaine pour notre culture européenne, nos films et nos séries ! Mais néanmoins, je pense aussi que les établissements comme les bibliothèques devraient bel et bien être ouverts le soir et le dimanche !
Jean-Luc MÉLENCHON :C’est bien beau tout ça mais une médiathèque en ligne permettrait également une nette démocratisation de la culture…
Jacques CHEMINADE : Non, non, non, je suis absolument contre ce monde des images et des écrans ! Vivons dans le monde réel !
Jean-Luc MÉLENCHON :Il n’y a rien de mal contre les écrans Monsieur Cheminade ! Bon mis à part quand il s’agit de publicité car je suis contre cette invasion de la publicité dans notre société c’est pourquoi je vais faire interdire les écrans de publicités numériques. Voilà.
Emmanuel MACRON : Bon, revenons à des choses concrètes. Si je suis élu, je mettrais en place un pass culturel de 500 euros pour les jeunes de 18 ans. Ce pass sera européen !
François ASSELINEAU : Dans ma version, je voyais plus cela sous forme de chèque culture amélioré qui serait en fait plus accessible….
Nicolas DUPONT-AIGNAN :Alors qu’avec moi ce serait plus sous forme de “ticket découverte culturelle” pour tout le monde à partir de 16 ans…
Benoît HAMON : Tout le monde propose la même chose, j’aimerais quant à moi instaurer la journée “rue libre pour la culture” pendant laquelle les acteurs de la culture devront construire avec les habitant des projets hors-les-murs.
Jean LASSALLE :Citoyens, citoyennes, moi, je préfère une grande fête de la philosophie, des sports et de l’engagement !
Jacques CHEMINADE: Ça serait d’ailleurs bien de rétablir le sport de proximité. Je dis ça comme ça… Bon qu’est-ce qu’on fait pour renforcer la francophonie hein ? Je vous le demande !
Benoît HAMON : Alors ça, ça va être vite réglé puisque je propose la création du Palais de la langue française ! D’autres questions monsieur Cheminade ?
Jacques CHEMINADE: Bon alors je reviens sur la musique mais c’est important ! Il faut généraliser les mercredis musicaux. Pourquoi mercredi ? C’est mon jour préféré de la semaine. Il faut aussi renforcer les conservatoires, cela va de soi.
Emmanuel MACRON: Et bien, il me semble que nous devrions parler d’un sujet en particulier : le statut des intermittents du spectacle ! Je propose d’adapter ce statut et de le pérenniser pour que cela devienne un outil au service de la politique culturelle.
Marine LE PEN: Oui, enfin, il faut surtout contrôler les structures qui en abusent, pourquoi pas en créant une carte professionnelle ? Ce statut doit absolument être remis en ordre.
Jean-Luc MÉLENCHON : Cela me fait mal de l’admettre, mais je suis d’accord avec Madame Le Pen, il faut pérenniser ce statut mais aussi le valoriser, tout comme les artistes précaires.
Nicolas DUPONT-AIGNAN: Je vous suis aussi !
Jacques CHEMINADE : Vous allez me dire que ce n’est pas très original mais je suis d’accord avec vous tous…
Jean-Luc MÉLENCHON : Enfin les amis, les intermittents du spectacle ne sont pas les seules personnes qui travaillent dans la culture : n’oublions pas les médiateurs culturels ! Qu’est-ce que vous leur proposez vous ? Pas grand chose, il faut absolument les favoriser et répandre ce métier dans toutes les structures culturelles.
Benoît HAMON: Et je ne vous entends pas parler des artistes ! Grâce à mon revenu universel, les artistes pourront bénéficier du statut de l’artiste aidé.
Jean-Luc MÉLENCHON : Et favoriser la création !
Emmanuel MACRON: Justement, puisque vous en parlez… Moi je propose de lancer un Erasmus des professionnels de la culture. Pas mal non ? Cela faciliterait la circulation des commissaires d’expo, des conservateurs mais des artistes aussi !
Marine LE PEN : Enfin, la culture c’est aussi l’audiovisuel, et si nous parlions un peu du CSA ! Il faut le réformer en créant trois collèges, un représentant l’Etat, un autre les professionnels et un dernier représentant la société civile.
Philippe POUTOU : Il faut surtout que le CSA soit remplacé par un organisme de supervision des médias ! Tout comme il faut créer un statut juridique pour les rédactions avec un droit de regard ou de véto sur les décisions économiques et éditoriales !
Emmanuel MACRON: Alors là, pas du tout ! Il faut que les sociétés audiovisuelles publiques soient plus indépendantes et ouvertes, plus efficaces. Tout comme pour les entreprises de presse ! Prenons le modèle anglo-saxon : il faut garantir l’indépendance éditoriale et journalistique !
Très bien, quatre candidats sont restés muets. Il est temps de passer à notre quatrième question : quelles sont vos propositions concernant les lieux culturels ?
Nathalie ARTHAUD: Puisque je me sens visée, je vais prendre la parole. Il est nécessaire de développer les bibliothèques et en règle générale de soutenir toutes les initiatives culturelles.
Jacques CHEMINADE: Les bibliothèques ne suffisent pas ! Moi je propose d’ouvrir un musée de l’imaginaire. 1 pour 500 000 habitants, à moins de 45 minutes de chez eux. Deuxième proposition : la création d’un palais de la découverte par région. Ça c’est efficace !
François FILLON : Je suis aussi pour la création de nouveaux lieux mais lorsque je serai président j’ouvrirai un lieu d’art européen à Strasbourg. De plus, il me paraît essentiel que la culture et ses lieux entrent dans l’ère numérique.
Marine LE PEN : Oui enfin avant de penser à ouvrir des nouveaux établissements, vous ne croyez pasqu’il faudrait qu’on arrête de vendre à l’étranger et au privé nos bâtiments nationaux?
Nicolas DUPONT-AIGNAN : Je pense surtout qu’il faudrait s’intéresser à nos lieux culturels maintenant et s’occuper d’eux ! D’abord, il faut rendre les musées gratuits tous les dimanches. Ensuite, il faut créer un nouveau ministère : un grand ministère qui engloberait le patrimoine, le tourisme, le spectacle vivant, les arts, les lettres, le cinéma et la communication !
Benoît HAMON : Je valide la création d’un nouveau ministère, je suis pour la création d’un ministère de la Culture, des Médias et du Temps libre.
Jean-Luc MÉLENCHON : C’est bon, vous avez fini ? Qui a parlé des archives nationales ? Il faut y investir. Qui a parlé du 1% ? Il faut l’appliquer. Qui a parlé de la prévention archéologique ? Il faut la re-nationaliser.
Monsieur Asselineau, nous ne vous avons toujours pas entendu, j’espère que vous pourrez saisir la chance de notre dernière question… Messieurs, Mesdames les candidats, le débat touche à sa fin et terminons sur une note indispensable et tabou : la culture et l’argent. Quelles sont vos propositions ?
François ASSELINEAU: Là, je peux intervenir ! Selon moi, il faut absolument augmenter les budgets dédiés à la sauvegarde des monuments historiques classés et des œuvres d’art françaises. C’est tout pour moi, bonne soirée !
Jean LASSALLE: Hé, il me semble que vous m’avez oublié… Quelle était la question ? ah oui. Moi aussi je propose des choses sur le budget. D’ailleurs, les financements doivent absolument tendre vers la création indépendante.
Jean-Luc MÉLENCHON :Oui, je suis pour favoriser la création et la production indépendante ! La culture ne doit pas être un moyen d’échange marchand ! Il faut mettre fin à l’avantage des mécènes et le sponsoring, finis les avantages fiscaux, finie la défiscalisation des œuvres d’art ! Finie aussi l’intrusion de la finance dans les conseils d’administration des établissements culturels. Aidons plutôt les collectivités territoriales !
Benoît HAMON : Mais oui Jean-Luc ! Il faut mettre fin à cette baisse des dotations et investir 4 milliards d’euros dans la culture !
Nicolas DUPONT-AIGNAN : Seulement ? Moi je pousse le budget à 1% et en plus j’organise des tirages du loto le jour des Journées du Patrimoine pour accompagner les actions en faveur de celui-ci !
Jacques CHEMINADE : Bande de petits joueurs… C’est à 2% que le budget de la culture doit être ! Nous sommes en guerre dans le domaine culturel.
François FILLON : Bon, même si je risque de passer pour le méchant, encore… J’assume, même si les médias vont encore bien en profiter... Moi, je donne 2 milliards pendant mon mandat.
Marine LE PEN : Allez, Monsieur Fillon, arrêtez de vous faire passer pour la victime et laissez parler les vrais. Je suis sûre que vous n’aviez pas pensé à créer le mécénat citoyen grâce à une plateforme numérique dédiée. Au passage, j’augmente le budget de la culture de 25%.
Emmanuel MACRON : Madame Arthaud et Monsieur Poutou n’ont apparemment rien à ajouter… Alors certes, il faut que l’effort continue d’investir dans la culture mais je crois qu’il doit en échange, exiger des contreparties, des contreparties d’efficacité ! De plus, il est essentiel de rétablir une concurrence équitable entre les différents acteurs numériques. Enfin, il faut investir oui, mais surtout dans les industries créatives et culturelles, je leur donne 200 milliards d’euros.
Bien, merci à tous d’avoir participé à ce débat dédié à la culture, un sujet dont on parle trop peu. Nous rappelons que la culture contribue à hauteur de 3,2% du PIB, au même niveau que le secteur de l’agriculture. Le secteur créatif n’est pas jugé aussi important que la sécurité ou l’emploi dans les programmes mais n’oublions pas que la culture pourvoit aussi des emplois et peut être une solution contre la crise identitaire dont la France semble souffrir. Dans ce débat, nous pouvons remarquer que l’accent a été mis sur le patrimoine et la préservation de la langue française et un intérêt est visible concernant l’audiovisuel et la presse mais finalement il y a assez peu de propositions sur la culture scientifique ou encore l’éducation populaire… Quoi qu’il en soit nous espérons que tout ceux qui nous liront pourront se faire une idée et choisir leur candidat si ce n’est pas déjà fait ! Merci de nous avoir suivi et surtout, n’oubliez pas d’aller voter le 22 avril !
Méline Sannicolo et Lucie Taverne
#présidentielles
#débat
#culture
Le drag et la scène ballroom : entre divertissement, politisation et art
La performance drag s’introduit et tente de se faire une place parmi les pratiques artistiques reconnues. Récemment, les drags queens gagnent les galeries et les musées. Elles affirment ainsi leur place non seulement en tant qu’artistes, mais aussi en tant qu’icônes fondamentales de la diversité et de la créativité au XXIe siècle. Toutefois, si leur présence s’accroît, rares sont les institutions qui leur consacrent une exposition entière.
© Din, Pexels
Le 6 avril dernier, la Piscine de Roubaix organisait un concours de drag queens en partenariat avec l’école Esmod de Roubaix. Dans le cadre d’une exposition rétrospective de Jeremy Deller, le musée des Beaux-Arts de Rennes a accueilli une performance de drag queens. Le Palais des Beaux-Arts de Lille avait également présenté une soirée spéciale “Drag Palace” en juin 2024. Les performances et artistes drag sont surtout citées de manière succincte ou prennent part à la programmation autour d'une exposition dans le cadre de médiation, d’atelier ou de hors les murs, comme si elles ne pouvaient franchir ce plafond de verre de la reconnaissance institutionnelle muséale.
Naissance d’un divertissement artistique
Le drag, tel que nous le connaissons aujourd’hui, s'épanouit dans les années 1960 aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi en France, à Paris, en particulier dans le quartier de Pigalle. Il se développe autour de la performance scénique dans les bars et cabarets, lors de compétitions pendant lesquelles plusieurs concurrentes s’affrontent dans des épreuves de roast and shade, de lip sync, de danse ou encore de catégories. Ces compétitions prennent un nouveau tournant avec la création de la scène ballroom. En effet, à la fin des années 60, les compétitions qui ont lieu principalement à Harlem à New York, sont constamment gagnées par des drag queens blanches. Les compétitrices noires et latinas décident alors de quitter cette scène et de créer la leur. En raison de leurs conditions de vie précaires, elles ne peuvent louer que des salles municipales de bal. Par métonymie, ces nouveaux lieux de rencontre et de développement d’une culture propre, prennent le nom de ballroom. Initialement, la ballroom est composée principalement de femmes trans africaines-américaines ou latinas, mais s’élargit rapidement.
Se développe également la communauté drag king. De la même façon qu’une drag queen s’approche d’une esthétique dite « féminine » en performant les stéréotypes du genre féminin, un drag king se tourne vers une esthétique dite « masculine », en performant les stéréotypes du genre masculin. Toutefois, le drag king n’est pas le pendant masculin absolu de la drag queen. Plusieurs chercheureuses situent la naissance des pratiques king au début des années 1990, dans les bars underground de New York, de San Francisco et de Londres. Si les drag kings s’inspirent des mouvements queer nés aux États-Unis à la fin des années 80, ils s’inscrivent également au sein d’une culture de la performance et du travestissement bien plus ancienne, qui remonte aux années 1860.
Vers la reconnaissance d’un art vital
Dans un premier temps, la scène ballroom est un espace-temps non-mixte, sorte de parenthèse safe loin d’un monde discriminant et dangereux comme scène clandestine, car illégale. Il s’agissait de lieux de rencontre, de création, de divertissement, de fête, de libération et de spectacle où étaient célébrés des corps et identités discriminées. Le drag est aussi un exercice de libération identitaire, un affranchissement des codes. Pour beaucoup, le fait de pouvoir s’exprimer et d’être soi sans peur est libérateur. Le fait de s’habiller de tenues extravagantes, colorées et pailletées a un effet performatif de la joie. Il s’agit pour les drag queens et kings de faire une performance pour répandre cette joie et cette fête. Ainsi, ielles sont de véritables performeureuses multidisciplinaires. En plus de se maquiller, confectionner leur tenue et perruque, ielles mettent au point de véritables spectacles, alliant différents arts de la scène. Progressivement ielles sont reconnues comme telles, même si cela reste lent et minime. Cette reconnaissance intervient surtout dans les années 2000, notamment grâce à l’émission américaine RuPaul Drag Race, lancée par la célèbre drag queen RuPaul. Cela participe largement à l'intégration de la culture drag à la culture populaire américaine. Ces dernières années, la communauté ballroom connaît également un regain de visibilité notamment grâce au succès de la série Pose. Ce n’est pas la première fois que le drag et la culture de la scène ballroom connaissent une résurgence dans la culture populaire. Dans les années 90, les films Paris is Burning et Priscilla, folle du désert, avaient provoqué l’intérêt et le dépassement des frontières américaines, notamment en France grâce à Mother Niki Gucci et Mother Lassandra Ninja. En 1990, Madonna « strikes a pose », dans sa chanson Vogue, reprenant les mouvements du voguing, danse née au cœur de la scène ballroom dans les années 70. Toutefois, il faut mettre en avant la longévité inédite de ce récent engouement. RuPaul est une figure de la pop culture depuis plus de 10 ans. Avec la génération YouTube et les réseaux sociaux, de plus en plus de drag queens émergent. Certaines vont même au-delà du drag comme performance, comme la drag queen américaine Violette Chachki, ou la française La Grande Dame défilant comme mannequin pour des marques de luxe comme Prada, Moschino ou encore Jean-Paul Gaultier. Si l’émission et les différentes franchises donnent accès au grand public à l’envers du décor, cela se fait dans le cadre du divertissement. De plus, le caractère léger voire frivole des performances, rend pénible sa reconnaissance comme art à part entière. Esthétique révolutionnaire et nouvelle manière de faire performance, le drag s’inscrit pourtant dans la lignée des arts du spectacle.

© Kamaji Ogino
Le dérangement des codes et identités genrés.
En tant qu'élément important de la culture queer, le drag dérange non seulement parce qu'il introduit de nouvelles valeurs esthétiques, mais aussi et surtout parce qu'il prône les différences et s'attaque aux idées préconçues sur le genre et les identités différentes qui existent dans la société. Le drag dérange les codes et met en avant une pluralité des genres, mais surtout la fluidité d’expression de genre puisqu’il s’agit de créer son personnage. De même pour la scène ballroom de manière générale, qui promeut l’inclusivité en opposition à la société discriminante. Les compétitions célèbrent toutes les identités, alliant mode, esthétisme, performance. Le drag et la scène ballroom cherchent à effacer toutes les distinctions d’origine, de genre et de sexualité.
A la fin des années 80, la pensée queer se théorise et accompagne la diffusion de la culture de la scène ballroom. Cette pensée pose ce principe fondamental : le genre est une construction sociale et non une définition biologique. La binarité homme/femme est remise en question. L’avènement de cette pensée prend place en 1990 lorsque Judith Butler publie l’essai fondamental Trouble dans le genre. Instaurant la théorie queer comme discipline universitaire, cet ouvrage est la rampe de lancement des études du genre. De même, lorsque Monique Wittig publie The Straight Mind (1992), exposant le contrat hétérosexuel comme régime politique au fondement de la société binaire et patriarcale.
Ce sont des questions encore très actuelles et le drag, comme pratique du divertissement, est idéal pour une génération critique du genre. Une réelle corrélation existe entre la théorie des études du genre et la pratique du drag. Non seulement transgression du féminin et du masculin, le drag invente des créatures queer surréalistes avec le mouvement des clubskids qui interprètent non pas un personnage genré, mais une sculpture vivante.
De manière générale, cette nouvelle scène artistique tente de faire comprendre et accepter l’abandon d’une société binaire. De multiples ateliers tels que les ateliers de Louise De Ville, qui a importé le drag king en France à partir des années 2000, sont créés et ouverts à toustes pour apprendre les bases de cette pensée minorisée. Thomas Occhio, drag king français, explique l’aspect politique fulgurant de la scène drag à la lumière de sa déconstruction du patriarcat et de toutes les injonctions féminines sur l’appropriation de l’espace et des corps. Le fait d’être dans une société patriarcale donne une dimension politique au drag king. Là où la drag queen présente une ode à la féminité, le drag king prend exemple sur une masculinité dominante, néfaste.
L’art du drag et la culture de la scène ballroom questionnent des grands concepts comme la féminité, la masculinité, mais également l’hétérosexualité, la blanchéité et les classes sociales. Il met l'accent sur l'intersectionnalité et la multidisciplinarité.

© Rosemary Ketchum
Le corps : un étendard politique
L’art du drag et plus généralement la culture de la scène ballroom sont par essence politiques. Toutefois, il faut exercer une distinction entre la conscientisation et la politisation. L’art du drag est politique en soi, car il vient questionner de grands concepts, et apparaît même comme symbole de résistance et de résilience. Mais cela est-il fait en conscience d’être politique ?
La scène ballroom apparaît comme cas d’école de l’incarnation de l’intersectionnalité, de la pratique artistique comme pratique politique parce que c’est une culture, un mouvement. Elle est une scène intrinsèquement politique mais pas nécessairement politisée : politique parce qu’elle a été créée pour des raisons politiques dans un système raciste, patriarcal et classiste, mais elle n’est pas constamment dans le pro-activisme, dans un militantisme de terrain.
Souvent, un but politique est projeté sur la scène ballroom, voire militant, ce qui implique une conscientisation. La scène ballroom est une scène queer racisée noire-latina donc elle est politique en soi parce qu’elle est l’avènement de la revendication, la volonté d’existence, de représentation de cette communauté par elle-même et pour elle-même. De plus, elle est le lieu de la mise en mouvement de corps minorisés. La mise en mouvement d’un corps est politique ; mais concernant les corps minorisés, exister dans la rue est un acte politique, même involontaire, car ces corps sont discriminés et à l’encontre des codes imposés par les groupes dominants. Toutefois, cette politisation n’est pas forcément conscientisée, ou revendicative.
Il convient de distinguer les artistes dépolitisé.e.s et celleux apolitiques pour des raisons stratégiques. Une branche tend vers le mainstream, au profit d’une plus grande visibilité quand une autre plus radicale crée des espaces militants pour porter les messages. Prenons l’exemple de la drag queen Symone, gagnante de la saison 13 de RuPaul Drag Race. Après avoir défilé avec un durag, elle affirme : « Durag is a part of black culture and I wanted to celebrate that on the stage ». Pour l’épisode 9, elle défile également les mains en l’air, vêtue d’une longue robe blanche sur laquelle on peut voir à l'arrière deux trous de balles, ainsi qu’une coiffe blanche sur laquelle est écrit « Say their names », tout en énumérant les noms de Breonna Taylor, George Floyd, Brayla Stone, Trayvon Martin, Tony McDade, Nina Pop, Monika Diamond en voix off. D’autres comme Courtney Act ou Nina West de la saison 11 s’affirment également activistes et leurs performances sont militantes.
La mainstreamisation : entre visibilisation, reconnaissance et appropriation
En raison du succès rencontré, l’art du drag et la culture de la scène ballroom sont sortis de leur sphère initiale pour le mainstream et la pop culture, pris dans des logiques de capitalisation et de mainstreamisation. Les codes d’émancipation de la scène ballroom sont davantage célébrés, mais principalement lorsqu’ils sont dépolitisés.
Deux visions apparaissent alors : l’une positive, car cette mainstreamisation apporte de la visibilité sur des groupes minorisés et permet à davantage de personnes de s’identifier et de ne pas se sentir isolées. La mainstreamisation est intéressante en ce sens qu’elle permet d’exister hors de la ballroom. Elle permet la représentation culturelle. Une autre vision, plus négative apparaît lorsqu’un public non concerné intègre la scène ballroom et les performances drag et capitalise. D’autant plus que dans cette capitalisation, les personnes employées pour représenter la scène ballroom ne sont pas nécessairement les principales concernées.
La marchandisation du drag, l'introduction d'une recherche pécuniaire, semble nier son aspect politique. Mais cette critique essentialise les identités. La rémunération et la professionnalisation sont une manière pour les drag queens et drag kings de se faire reconnaître et d’être pris.es au sérieux. Il faut nuancer la condamnation du profit puisqu’il concerne des personnes évoluant dans les marges, voulant parfois en sortir. La fidélité aux marges est une posture théorique, car toute personne a besoin de revenus dans un système capitaliste. Cela reflète l’injonction à la pureté militante contre la monétisation d’une identité ainsi que le refus de la sociologie d’allier expérience et expertise perpétuant le mythe du faux activiste intéressé.
Le problème de cette mainstreamisation est donc l’appropriation non-respectueuse de cette culture par la classe dominante.
Dans sa conférence « Décolonisons ledancefloor » (2017), l’activiste queer et féministe Habibitch dénonce l’appropriation culturelle qui découle de cette mainstreamisation. Iel explique que « toutes pratiques artistiques créées et fédérées par les communautés marginalisées sont au centre du processus d’appropriation culturelle ». Il y a appropriation culturelle quand il y a capitalisation donc profit, qu’il soit matériel ou immatériel, d’éléments de cultures d’un groupe dominé, par le groupe dominant. Habibitch inscrit cela dans un continuum colonial : parce qu’aujourd’hui la colonisation géographique et territoriale est moindre, c’est la culture qui est colonisée. Iel reprend ainsi les mots d’Aimé Césaire dans son Discours sur le colonialisme (1950) dans lequel il explique l’effet retour du colonialisme par l’appropriation culturelle. Ce continuum colonial passe d’une colonisation matérielle à une colonisation immatérielle, qui s’exprime dans le domaine de la culture et du symbolique.
Régulièrement, les groupes dominants se saisissent de pans culturels de l’Autre, font du profit, ne prennent pas en considération la charge mentale et la charge raciale des personnes ayant créé ces cultures dans un souci de survie. L’écrivain afro-américain Greg Tate résume cette friction en quelques mots : « Everything but the Burden », titre de son livre publié en 2003. En ces termes, il dénonce l’appropriation d’une culture de communautés minorisées pour en tirer profit et sans penser à la raison d’être de l’élément de culture en question, de son origine et de son aspect politique. Par exemple, le succès est davantage tourné vers le voguing – pratique de danse et performance - et moins vers la ballroom comme réunion d’individus. Il y a de la part de la classe dominante, une instrumentalisation des communautés minorisées par l’adoption de leurs codes.
La mainstreamisation est donc indissociable des notions de domination et d’asymétrie. Le risque ne réside pas dans l’impératif économique des communautés concernées faisant perdre la visée politique ; mais dans l’appropriation des dominants, invisibilisant les histoires passées comme présentes. De plus, la mainstreamisation entraîne l’arrivée d’un nouveau public au sein des clubs. Ces personnes, qui ne sont pas forcément de la communauté, peuvent par leur curiosité, fétichiser et exotiser les participant.e.s de la culture en question. Les menaces de rendre la scène moins safe et d’outer des personnes augmentent puisque de plus en plus de personnes filment et postent sur les réseaux sociaux. Il y a donc une responsabilité individuelle à respecter l’histoire de cette scène artistique quelle que soit notre identification.
L’art du drag rejoint la scène ballroom dans des impératifs intrinsèquement politiques. Les deux ont offert une incarnation possible de toutes ces personnes marginalisées et minorisées, dans un espace flamboyant et au croisement de toutes les identités. Cette nouvelle manière de s’exprimer par la performance, la danse, le maquillage et l’esthétique s’éprend du dancefloor qui devient le lieu parfait d’expression et de résilience en troublant les codes et identités genrées. Entre défauts de reconnaissance et appropriation culturelle poussée par la capitalisation et la mainstreamisation, l’art du drag et la ballroom ont des défis à surmonter.
Adèle-Rose Daniel
#Drag #Ballroomscene #Arts

Le droit d'exposition

Vue de l’exposition Voyage au centre de la terre, 2018. © AGR
A quel besoin répond-t-il ?
Les artistes-plasticiens dénoncent le fait que des institutions culturelles exposent leurs œuvres et en retirent des bénéfices en excluant de les rémunérer. Parfois, le droit d’exposition est cédé par l’artiste à l’institution au moment de l’acquisition de l’œuvre. Dans ce cas, le prix compense la perte des droits d’exposition pour l’œuvre acquise. Ce cas de figure étant assez rare, les artistes-plasticiens se retrouvent souvent lésés. Or, cette rémunération est essentielle pour l’économie des artistes en leur permettant un revenu minimum pour chacune de leur exposition. De plus, cela permet de soutenir la création et la production de futures œuvres.
Que dit la recommandation du Ministère de la Culture ?
- Pour une exposition monographique, l’artiste-plasticien touche 1 000€, quelle que soit la durée de l’exposition et le nombre d’œuvres exposées.
- Si l’exposition bénéficie d’une billetterie payante, l’artiste-plasticien touche 3% des recettes de la billetterie si elles excèdent 1 000€.
- Pour une exposition collective qui présente plus de 10 artistes, une rémunération minimum de 100€ est allouée pour chaque artiste-plasticien.
- Si l’exposition collective présente moins de 10 artistes, la somme de 1 000€ sera partagé par le nombre d’artistes exposé.
En avril 2020, l’association D.C.A (Association Française de développement des centres d’art contemporain) a été la première à proposer un code des bonnes pratiques concernant la rémunération pour les droits d’exposition et à garantir son application par ses membres. Les FRAC jouent aussi le jeu « La part de la rémunération relevant du droit d’auteur de l’artiste, dénommée “droit d’exposition”, sera désormais mentionnée et identifiée dans le cadre de la rémunération des artistes par les FRAC », comme le précise Julie Binet la secrétaire générale de Platform.

Vue de l’exposition Gigantisme – Art et Industrie, 2019. ©AGR
Quels freins au respect de son application ?
L’idée en utilisant le terme de « recommandation » était de responsabiliser les organisateurs d’exposition et non pas de leur imposer la rémunération du droit d’exposition. Pourtant, tant que cette rémunération ne sera qu’une « recommandation » les institutions les plus imposantes ne se saisiront pas de l’urgence de la situation. Sur ce sujet Nicolas Vulser ironise « Ces établissements publics ou même privés, prompts à s’auto-féliciter de drainer des millions de spectateurs, paient leur électricité, mais ne trouvent pas un centime pour les créateurs ».
D’autres critiquent l’idée que les institutions culturelles doivent payer un droit pour exposer leur propre collection.
Le Journal des Arts rapporte une évaluation des coûts pour l’application de la rémunération des droits d’exposition pour les établissements sans billetterie qui montre que « Sur la base d’une rémunération de 1 000 euros, le coût pour les Frac et centres d’art s’élèverait chaque année respectivement à 153 000 euros et 173 000 euros pour les expositions monographiques. Pour les musées de France, le coût annuel total des expositions monographiques et collectives a été chiffré à 182 000 euros. »
Et les artistes ?
Axelle Gallego-Ryckaert
#droitdexposition
#artisteplastcien
#artcontemporain
Voici une vidéo pour en savoir plus sur le débat autour du droit d’exposition : https://www.arte.tv/fr/videos/094932-000-A/le-droit-d-exposition-des-artistes-enfin-reconnu/

Le mucem vous emmène… Au Mucem !
Depuis son inauguration en 2013 et Marseille Capitale européenne de la Culture, le MuCEM s’attache à innover avec des projets engagés : un accompagnement vers l’autonomie d’une venue au musée, accessible pour les personnes qui en sont éloignées en proposant des ateliers hors les murs, d’éveil culturel pour les plus jeunes et en programmant des activités en partenariat avec des structures du “champ social”.
C’est au courant de l’année 2019/2020 que le MuCEM dépose un dossier de candidature au concours du Prix Européen organisé par Art Explora. En décembre 2020, le musée a remporté le 1er prix pour son nouveau projet « Destination Mucem », qui s’adresse aux habitants des quartiers éloignés du centre de Marseille. Ils sont très mal desservis par les transports en commun. C’est connu : de nombreuses barrières économiques, matérielles et socio-culturelles brident et empêchent la venue dans un lieu culturel comme un théâtre ou un musée. C’est pour les riches, c’est trop loin, ce n’est pas pour nous…
Pour monter ce projet, le musée a collaboré avec l’association Les Amis du Rail et des Transports de Marseille (ARTM) qui a pour activité principale la restauration, conservation et valorisation des anciens véhicules de la Ville de Marseille, retirés du service, dont certains sont proposés à la location. Est-ce également une façon de sensibiliser les participants à la notion de patrimoine de leur ville et de sa conservation ?
Tout le monde à bord !
« Destination Mucem » est un dispositif inédit et engagé envers une mobilité des publics éloignés, peu ou pas familiers des musées. Tous les dimanches, un bus datant du début des années 70 sillonne les quartiers Nord, Nord-Est, Est et Sud selon des itinéraires décidés en collaboration avec la Préfète “Egalité des chances” de Marseille, ce qui a permis de créer 5 arrêts proches des centres sociaux de proximité. 28% des Marseillais vivent dans les quartiers prioritaires. Gratuit, le bus permet aux publics de créer un lien privilégié avec le musée. Malgré la volonté d’être un musée populaire et accessible, il n’est fréquenté en réalité que par 30% de la population de Marseille, et souvent des quartiers favorisés.
En route !

destination mucem / franceinfo
Dès la montée dans le bus du MuCEM, les passagers se voient remettre un billet d’entrée gratuit (au lieu de 11€ tarif plein par personne. Il n’y a pas de différence entre l’exposition permanente qui est souvent gratuite, et les expositions temporaires payantes. Ce système de tarification est appliqué dans certains musées de la ville comme au Musée d’Histoire de Marseille.)
Les voyageurs accueillis par un médiateur de l’AMS (Association de Médiation Sociale) préparent des circuits de visite variables et adaptés selon les expositions au musée. Équipé d’un micro et différents petits accessoires, le ou la médiatrice avec une boîte de sardines ou un petit bateau explique aux enfants la Méditerranée et la pêche… autant d’objets qui lui permettent d’animer le trajet. C’est un rappel mis en écho avec les collections permanentes à l'intérieur du bâtiment. « Aujourd’hui on part en voyage. On est un peu des explorateurs du passé et du présent. Au Mucem, on ne trouve pas que des sculptures, on trouve aussi des objets du quotidien. Car le Mucem parle de nous.»dit Anaïs Walh, médiatrice à bord du bus.
Ces médiations permettent d’échanger avec les passagers et sont déclinées pour des publics d’âges différents (jeunes publics, adolescents, familles, adultes, personnes âgées), cherchant à susciter la curiosité des passagers avant d’arriver au musée. Le trajet dure environ 1 heure, pour 30 places assises et 76 places debout : soient 106 personnes pouvant monter à bord. 2 trajets aller le matin et 2 trajets retour l’après-midi tous les dimanches. A noter que le bus ne circule pas pendant le mois d’Août.
Tout le monde descend, vous êtes arrivés !
Le bus du Mucem a pour vocation à être pérenne. Les équipes de développement du projet œuvre en parallèle à sa durabilité et longévité. Un diagnostic précis de l’impact carbone de la circulation d’un bus ancien est donc en cours afin de permettre la mise en place, dès le démarrage du projet, de mesures compensatoires adaptées. Est également en étude un autre bus à moteur électrique. Nous devrions avoir plus d’informations au courant de l’été 2022.
Une anecdote : en réalité, les quartiers sont tellement mal desservis par les transports en commun, que ce bus atypique est souvent rempli : les habitants l’utilisent pour se rendre en ville, et non au MuCEM. Pouvons-nous dire que le lien est créé ? Oui, dans une certaine mesure, car la médiation est bien un avant-goût du MuCEM pour ces habitants délaissés par les services publics.
Alexis

Bus Destination Mucem. © Julie Cohen/Mucem.
Pour en savoir plus :
- Mediation pour le MUCEM : http://www.cielairdedire.com/atelier-jeu-pour-le-mucem-marseille/
- Fadila raconte
- Reportage par Brut
#médiation #mucem #innovation
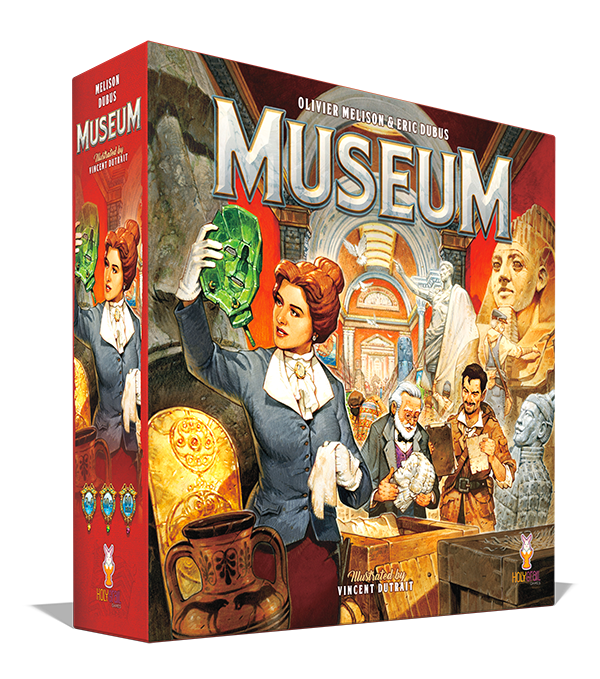
Le musée a enfin son jeu de société
Si vous rêvez de devenir conservateur d’un musée mais que vous n’arrivez pas à obtenir le concours, cet article peut résoudre votre problème… au moins virtuellement.
Il est vrai que les musées n’ont jamais été au centre d’une licence ludique ou vidéoludique. Alors que d’autres structures culturelles et/ou de loisirs ont été traités par des développeurs et ont connu le succès : notamment les parcs d’attractions avec les jeux de gestion de la licence vidéoludique Roller Coaster Tycoon ou encore les zoos avec le jeu vidéo Zoo Tycoon.
Aura-t-il fallu attendre 2018 pour que le musée connaisse son jeu culte ? Museum, créé par Olivier Melison et Eric Dubus et illustré par Vincent Dutrait, détient toutes les cartes en main pour le devenir ! Ce jeu nous invite à deux, trois ou quatre joueurs, à endosser le rôle d’un conservateur et à explorer les quatre continents pour trouver des artefacts et les exposer dans nos galeries. Mais notre quête sera parsemée d’obstacles grâce à différents mécanismes de jeu.
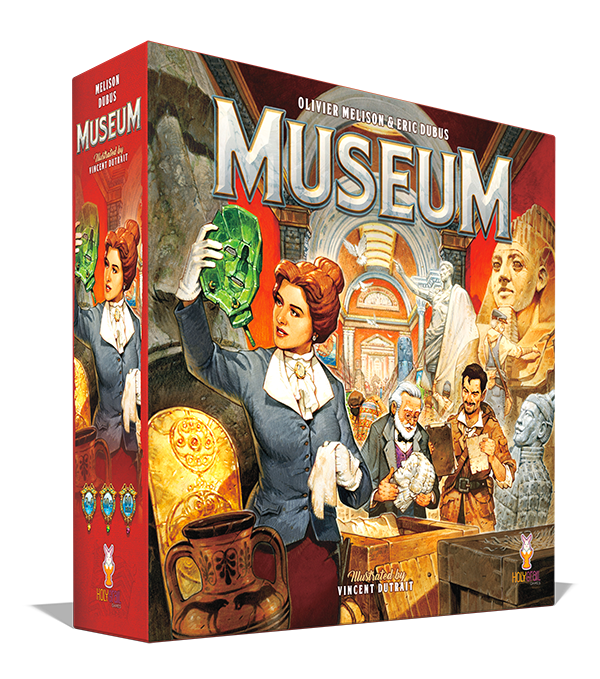
La boîte du jeu de base Museum
Revivre « l’âge d’or » des musées
Les créateurs ne sont pas d’anciens ou d’actuels professionnel des musées. L’un travaille dans la publication internationale et l’autre est professeur d’histoire. Ils ont apporté un contenu historique véridique. Les cartes « artefacts » regroupent des objets qui ont effectivement été trouvés lors d’expéditions européennes. Parmi elles, des jarres en céramiques japonaises, des artefacts de Stonehenge ou encore des sculptures préhistoriques des Cyclades. Quatre continents, douze civilisations et six domaines archéologiques sont représentés. De plus, les concepteurs font un peu de médiation en ajoutant au bas de chaque carte artefact un petit cartel explicatif. Les conservateurs virtuels peuvent de ce fait savoir précisément ce qu’ils exposent dans leur musée !

Exemple d’un carte artefact
Les concepteurs nous présentent Museum comme un jeu se déroulant durant « l’âge d’or » des musées. Cette périphrase indique la période s’étalant de la fin du XIXe siècle aux premières décennies du XXe. Cette période a vu gonfler le nombre d’objets au sein des collections des grands musées occidentaux comme le Louvre ou le British Museum pour ne citer que les plus emblématiques. Parmi les œuvres collectées à cette période figurent des artefacts de grande valeur culturelle qui sont ancrées dans nos représentations collectives et notre imaginaire. Le jeu montre à nouveau à quel point cette époque révolue a cristallisé une certaine relation au musée ainsi que des représentations. On remarque également que le musée est tout d’abord associé à ses collections.
Nous avons une relation ambigüe avec cette période car nous pouvons éprouver une certaine nostalgie envers elle. En effet, à cette époque, la planète et les anciennes civilisations étaient encore des sources de mystère. La stupéfaction et le vertige des années nous séparant de celles-ci se manifestaient à chaque grande découverte archéologique. On prête aussi aux archéologues de cette époque une fibre d’explorateurs et d’aventuriers hors pair. Indiana Jones est aussi venu participer à cette tendance. Ce frisson de la découverte de l’inconnu est bel et bien un des facteurs d’appétence pour ce jeu qui retransmet au joueur cette sensation. Cet appétit de la découverte mêlé à l’envie de mystère explique peut-être le choix des concepteurs de développer l’extension « Les Reliques de Cthulhu » qui intègrent l’univers fictif de H.P. Lovecraft ainsi que ses artefacts maudits au sein de vos collections qui faisaient jusqu’ici référence à des objets réels.
Cependant, cet âge d’or est aussi la période de toutes les expéditions des grandes puissances occidentales à l’origine des pillages des trésors des colonies et des pays pauvres où les expéditions avaient lieu. Ce sont ces pillages qui suscitent tous les débats autour des restitutions des collections dans le milieu muséal et culturel dans son ensemble. Nous sommes loin de tous ces questionnements dans Museum, même si les concepteurs n’ont pas été totalement naïfs. Le jeu propose en effet des cartes « Opinion Publique ». Elles signifient que la presse commence à remarquer que certains continents sont pillés, et que trop peu d'objets sont exposés par les musées. Ces cartes peuvent donner un malus conséquent aux joueurs conservateurs qui collectent des artefacts mais ne les exposent pas ! Autre indicateur de la conscience des concepteurs : l’extension « Marché Noir » du jeu. Cette extension encourage la fourberie et l’immoralité dans leur fonction temporaire de conservateur de musée. En effet, ces derniers peuvent tout simplement acquérir des artefacts sur le marché noir ! Ce genre de pratiques a pu être constatées lors de cet « âge d’or » des musées. Cependant, cette pratique peut s’avérer préjudiciable au joueur s’il ne joue pas habilement.
Pourquoi Museum s’ancre-t-il dans cet « âge d’or ». Et pourquoi cette période détient-elle une appellation aussi positive ? Nous pouvons peut-être interpréter cette représentation comme une idéalisation des créateurs et des joueurs pour cette période. Cette appellation traduit en réalité l’envie de découverte et le mystère qui entouraient les expéditions de cette époque plutôt que l’aspect purement historique. Ce regard a posteriori se ressent également dans la représentation archéologique conservateurs de musée.

Le plateau du jeu de base Museum
Dans la peau d’un conservateur ?
Tout au long de sa partie, le joueur est conduit à différentes actions différentes actions que le conservateur est censé mener. Parmi elles, placer les collections dans son musée. En d’autres termes qui ne sont pas explicites dans la règle du jeu ; faire de la muséographie. Attention, ici la réflexion et la conceptualisation ne va pas bien loin. Il s’agit avant tout de remplir toutes les salles du musée. Si aucun « trou » n’est laissé, un bonus conséquent est octroyé au joueur. Il s’agit également d’exposer les œuvres par civilisation ou par domaine dans les galeries de son musée pour gagner encore plus de points.
Dans Museum, on ne parle pas des réserves. Un lieu pourtant habituellement au centre des curiosités et des idéalisations du musée ! Cependant, le jeu parle vaguement d’un lieu où l’on peut entreposer ses artefacts non exposés : en termes purement ludiques, il s’agit de la défausse des cartes. On rappelle que le joueur se défausse d’artefacts valant un certain nombre de points pour en exposer d’autres. Mais ces cartes défaussées peuvent être récupérées par les autres joueurs.
Lors de son tour, le joueur peut également décider de faire un inventaire. C’est-à-dire qu’il vide sa défausse. Cette action permet au joueur de protéger des artefacts de « vols » des autres joueurs et de gagner des points supplémentaires à dépenser au tour suivant. On peut sourire en constatant la fragilité du statut des artefacts dans ces musées de papiers. L’inaliénabilité des collections est un concept bien absent de cet univers ludique. On ne leur en voudra pas de prendre des libertés afin de rendre le jeu un peu plus dynamique et amusant…
Enfin, les cartes « faveurs » font parfois référence à d’autres actions au sein d’un musée. Par exemple, il est possible d’organiser une conférence de presse au musée afin de gagner des « points de prestige » ou bien de recruter un expert pour valoriser ses collections. Ne sont donc représentées que des fonctions admirables dans ce musée virtuel…
Parmi les actions diverses et variées que le joueur dans la peau d’un conservateur peut mener, nous pouvons remarquer que le conservateur virtuel proposé par Museum rassemble dans sa seule entité plusieurs fonctions professionnelles au musée. Le joueur conservateur est à la fois muséographe, directeur de la communication et régisseur. Il n’est pas fait mention d’aucune autre fonction au musée à part les « experts » Ces derniers sont définis comme des spécialistes d’un domaine ou d’une civilisation qui « mettra en valeur les collections.» On se demande bien comment ils le font. Le plus important est qu’ils vous rapportent des points supplémentaires à la fin de la partie ! Pour en revenir au conservateur, on peut admettre également que l’image que l’on a souvent de lui, seul (ou presque) dans son musée, prend racine dans la réalité de l’époque. En effet, les conservateurs étaient souvent les seuls maîtres à bord au musée. Le jeu nous prouve une fois de plus que la représentation du conservateur du musée est, elle aussi, la source de beaucoup d’idées reçues.
Museum est sans grande surprise un jeu qui donne une image fantasmée et naïve du musée. Il met en scène un « âge d’or » qui met en valeur les conservateurs collectionneurs et les archéologues aventuriers. Un monde muséal virtuel où l’inaliénabilité des œuvres est un concept absent et où le marché noir est un lieu incertain mais excitant pour le joueur. Le système de jeu de Museum et de ses cinq extensions le rendent à la fois accessible à une clientèle familiale et attirant pour les joueurs chevronnés. Les concepteurs recommandent le jeu aux plus de 10 ans. Vous pouvez vous procurer le jeu de base pour 45 € et 18€ pour chaque extension (seule quatre sont vendues parmi les six existantes. En effet, les deux dernières sont des exclusivités Kickstarter réservées aux personnes ayant soutenu ce projet sur la plateforme de financement participatif) Pour vous le procurer, privilégiez le vendeur de jeux de société plutôt que les boutiques des musées où vous ne le trouverez pas, a priori. Cependant, malgré les libertés prises avec la réalité ainsi que le manque d’apports scientifiques étayés (malgré quelques efforts honorables mentionnés précédemment) peut-être que certaines boutiques le proposeront. Qui sait ? L’avenir nous dira aussi si Museum deviendra le jeu de société de référence se déroulant dans des musées. En tous cas, il possède tous les ingrédients pour le devenir !
Amaury Vanet
#jeu
#représentations
#réflexion
Pour plus d’informations sur le jeu rendez-vous sur : https://holygrail.games/museum-page-ks-francais/
Source des images : Holy Grail Games (https://holygrail.games/museum-page-ks-francais/)

Le Musée de l'Etrange : les mannequins au musée
Plantons le décor : un musée d’histoire locale visité au hasard d’un dimanche après-midi pluvieux. Le parquet grince, les cartels sont écrits à la main, les vitrines poussiéreuses débordent d’objets hétéroclites … Et là, au détour d’un couloir, il vous surprend : un mannequin se tient derrière un petit cordon de sécurité, figé dans son costume traditionnel.
Les mannequins, objets anthropomorphes inanimés, répondent à des besoins précis dans les musées. Ce sont d’abord des supports de collections, souvent des costumes. Ils incarnent aussi un contenu, comme un personnage, une scène ou une époque. Ils servent alors une représentation théâtralisée du discours muséographique. Leur apparence humaine favorise enfin l’immersion et ils permettent d’habiller l’espace comme élément de scénographie.
image d'introduction : Mannequin de Mineur du Muséum d’Histoire naturelle de Lille, Marco Zanni

Le mannequin anthropomorphe est présent dans l'imaginaire des musées, plutôt les musées d’histoire, de sciences naturelles ou d’ethnologie : par exemple, Ben Stiller accompagné de Franklin Roosevelt ramené à la vie dans le film La Nuit au Musée, 2006. Image : Marco Zanni.
Malgré leur utilité, ils paraissent souvent vieillots, voire gênants ou risibles. Ainsi, les anglophones profitent d’une coïncidence linguistique pour utiliser le mot dummy (“mannequin”) comme équivalent de dumb, “idiot”. Mais pourquoi étiqueter les mannequins d’un tel ridicule ? Petit essai non-exhaustif sur les raisons du désamour d’un emblème du kitsch muséographique.
Le mannequin, une relique du musée ?
L’histoire du mannequin de musée est peu sourcée et complexe. Il se développe principalement à la fin XIXème siècle. Dans les musées d’anthropologie, il perpétue la sculpture ethnographique, qui met en évidence les caractéristiques réelles ou supposées de différents peuples. Le mannequin sert donc d’exemple d’un type ethnique, avec ses attributs physiques, son costume, une attitude jugée représentative. La volonté de classification raciale croise la fascination pour le pittoresque exotique. Les musées de folklore européens l’utilisent également pour mettre en avant des usages, des costumes, des fêtes ou des coutumes. Ceux-ci sont souvent représentés en action, voire inclus au sein de dioramas, habitant un espace constitué d’objets collectés sur le terrain.

Diorama du Musée d’Ethnographie du Trocadéro : scène de Bretagne, 1884-1928, d’après une photographie du MuCEM, Marco Zanni
Les dioramas sont des dispositifs de représentation théâtralisée et figée dans un espace clos. Considérés comme modernes et accessibles, ils permettent d’incarner un patrimoine de façon vivante et didactique. Les dioramas sont très en vogue au début du XXème siècle, pour tomber progressivement en désuétude.
Le mannequin, associé à ce mode de présentation, se fait difficilement une place dans les tendances expographiques successives. Dans les années 1950 et 1960 s‘amorce un mouvement vers la sobriété et une désincarnation des mannequins. Aujourd’hui, ils sont considérés par certaines institutions comme des reliques muséographiques à remplacer ou à revaloriser. Ils restent cependant utilisés, par choix ou par contrainte, avec des variantes selon les types de musée. Leur usage est ainsi fréquent dans les musées de sciences et d’histoire naturelles, peut-être par effet de proximité avec les spécimens taxidermisés.
Le mannequin, un humain raté ?
Outre son poids historique, le mannequin trouble la perception. Notre cerveau est équipé pour reconnaître les signes d’humanité dans son environnement. Cela donne parfois lieu à de mauvaises interprétations, comme la perception de visages humains dans des objets inanimés (paréidolie faciale). Des objets avec des représentations plus ou moins réalistes de traits humains ont donc tendance à brouiller ce décodage, souvent de façon inconsciente.
La Vallée de l'Étrange (Uncanny Valley) est une théorie proposée dans les années 1970 par le roboticien Mashiro Mori. Il conceptualise la gêne croissante en fonction de la ressemblance anthropomorphique d’un objet (robot, prothèse, poupée, etc.). Plus un objet s’approche de l’apparence humaine, plus nous percevons les petits défauts qui l'éloignent. Cette gêne apparaît à partir d’un certain degré de proximité, et peut régresser au-delà d’un seuil de ressemblance proche de la perfection.
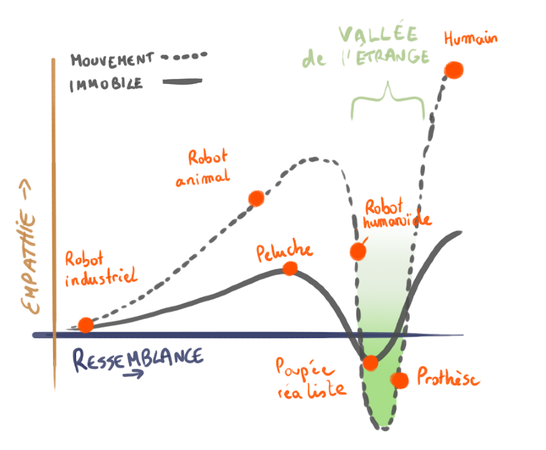
Schéma explicatif de l’Uncanny Valley,Marco Zanni
La Vallée de l'Étrange n’est pas véritablement quantifiable : si ses effets ont été observés par quelques expériences, ses mécanismes restent incertains. Pour la philosophe des sciences cognitives Frédérique de Vignemont, ce réflexe de rejet instinctif est une réponse du cerveau à son incapacité à catégoriser l’humain du non-humain.
Les entreprises prennent en compte ce malaise : le design des prothèses tend désormais à conserver un aspect artificiel, suite au constat que les usager.es apprécient globalement moins les prothèses réalistes. La Vallée de l'Étrange est également appliquée en dehors de la robotique. Elle explique par exemple la peur des objets anthropomorphes inanimés (poupées, mannequins, figurines, etc) sur laquelle se fondent beaucoup de fictions.
Nos mannequins de musée ne sont pas dignes de films d’horreur. Mais quand ils se veulent (trop) réalistes, ils peuvent susciter une émotion vive : de la gêne, mais aussi le rire. Le phénomène est amplifié par l’utilisation du numérique, puisque le mouvement renforce l’illusion de la ressemblance. Le ressenti est évidemment très personnel, et aucune étude ne semble avoir été portée sur la réception des mannequins de musée.

Mannequin avec projection vidéo faciale, Musée Fournaise (Chatou), Marco Zanni
Le mannequin n’est pourtant pas condamné à susciter des émotions non désirées auprès des publics. Nous n’avons parlé que des mannequins très anthropomorphes mais plusieurs musées choisissent des mannequins plus neutres, aux formes plus abstraites, suivant l’évolution des mannequins de vitrines.

Espace Vivant de la Bonneterie (Romilly-sur-Seine), mannequin sur machine, Marco Zanni
Certains mannequins sont purement fonctionnels, afin de donner corps à un costume en évoquant au minimum une silhouette humaine. Le mannequinage est parfois nécessaire à la bonne compréhension de l’objet ou pour des raisons de conservation, et non d’exposition.
Concernant les mannequins anthropomorphes anciens, plusieurs musées ont choisi de les assumer. Déjà car ils plaisent à certains publics qui leur attribue un charme suranné. Mais ce sont aussi des témoins de l’histoire de la muséographie, valorisés en tant qu’objets eux-mêmes. C’est le cas des mannequins du Museon Arlaten : suite à sa rénovation, son parcours traite à la fois de la société provençale et de l’histoire du musée. Un travail d’identification, de recherche et de valorisation des mannequins des dioramas du musée du début du XXème siècle a été réalisé.
Le mannequin peut aussi se rapprocher du travail artistique pour apporter un aspect sensible à un support d’exposition. Les sculptures d’Elisabeth Daynès, paléo-plasticiennes, jouent le rôle des mannequins tout en étant des œuvres uniques. Ses reconstitutions de personnages préhistoriques ont un intérêt didactique et une valeur plastique intrinsèque.

Kinga, adolescente Néandertalienne tenant un numéro de la revue Causette,sculpture d’Elisabeth Daynès pour l’exposition Néandertaldu Musée de l’Homme, Marco Zanni.
Enfin, si les mannequins font rire, on peut y voir une porte d’entrée pour des actions de médiations ou des visites particulières. Même les professionnel.les s‘y mettent : un argument de taille (mannequin) pour porter un regard différent sur eux !
Marco Zanni
Pour aller plus loin :
- Sur la Vallée de l’Etrange : https://lejournal.cnrs.fr/articles/petit-detour-par-la-vallee-de-letrange
- Sur la valorisation des mannequins : J’ai l’Oeil du Tigre, podcast de Claire Casedas (Fun In Museum), épisode 22 “Au secours … mannequins moches. 10 solutions créatives” http://www.funinmuseum.com/pages/podcast-j-ai-l-oeil-du-tigre.html
Aucun mannequin n’a été maltraité dans la réalisation de cet article.
|
#Mannequin #Valléedel'Etrange #Muséographie |
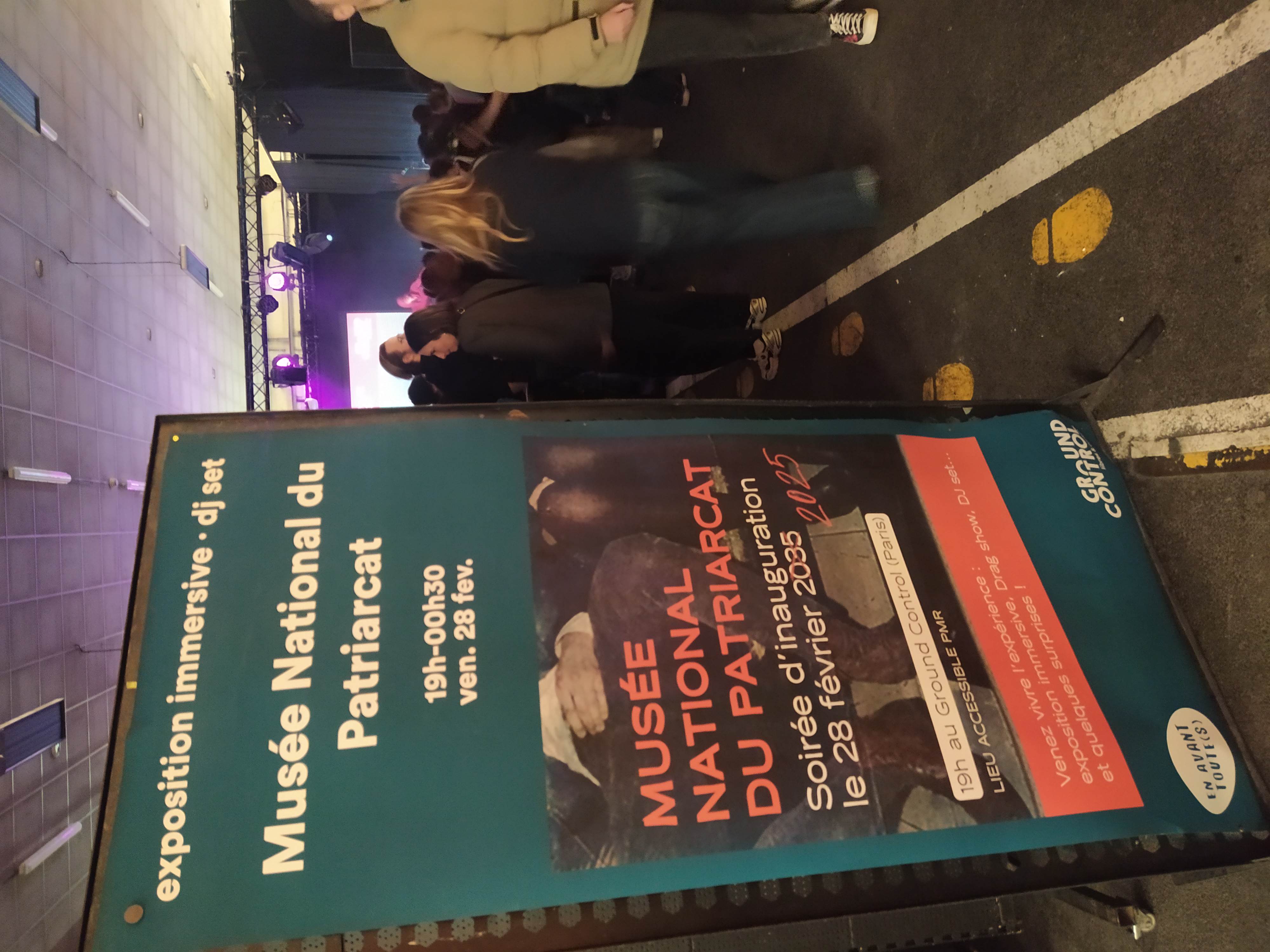
Le musée national du patriarcat
Et si le patriarcat appartenait à une époque si lointaine qu’il serait exposé dans un musée ?
© T. Schriver
“*Imaginez, nous sommes en 2035 et le patriarcat est mort. Fermez les yeux 5 minutes et imaginez un monde où les violences sexistes et sexuelles n’existent plus, où l’injustice et les inégalités liées au patriarcat sont enfin reléguées au passé*.” Ce monde si lointain devrait avoir un musée. C’est ainsi que le Musée National du Patriarcat a ouvert, le temps d’une soirée au Ground Control à Paris, le 28 février 2025.
L’association “En avant toute(s)” a consacré investi un espace de 176m2, pouvant accueillir 270 personnes debout. Sur les murs, les visiteurs et visiteuses découvrent de nombreuses affiches qui ont permis de faire la promotion de l’ouverture du musée “Venez découvrir un monde où la contraception était exclusivement féminine”, “Il y a un temps où la place des femmes dans la société se comptait en centimètre”.
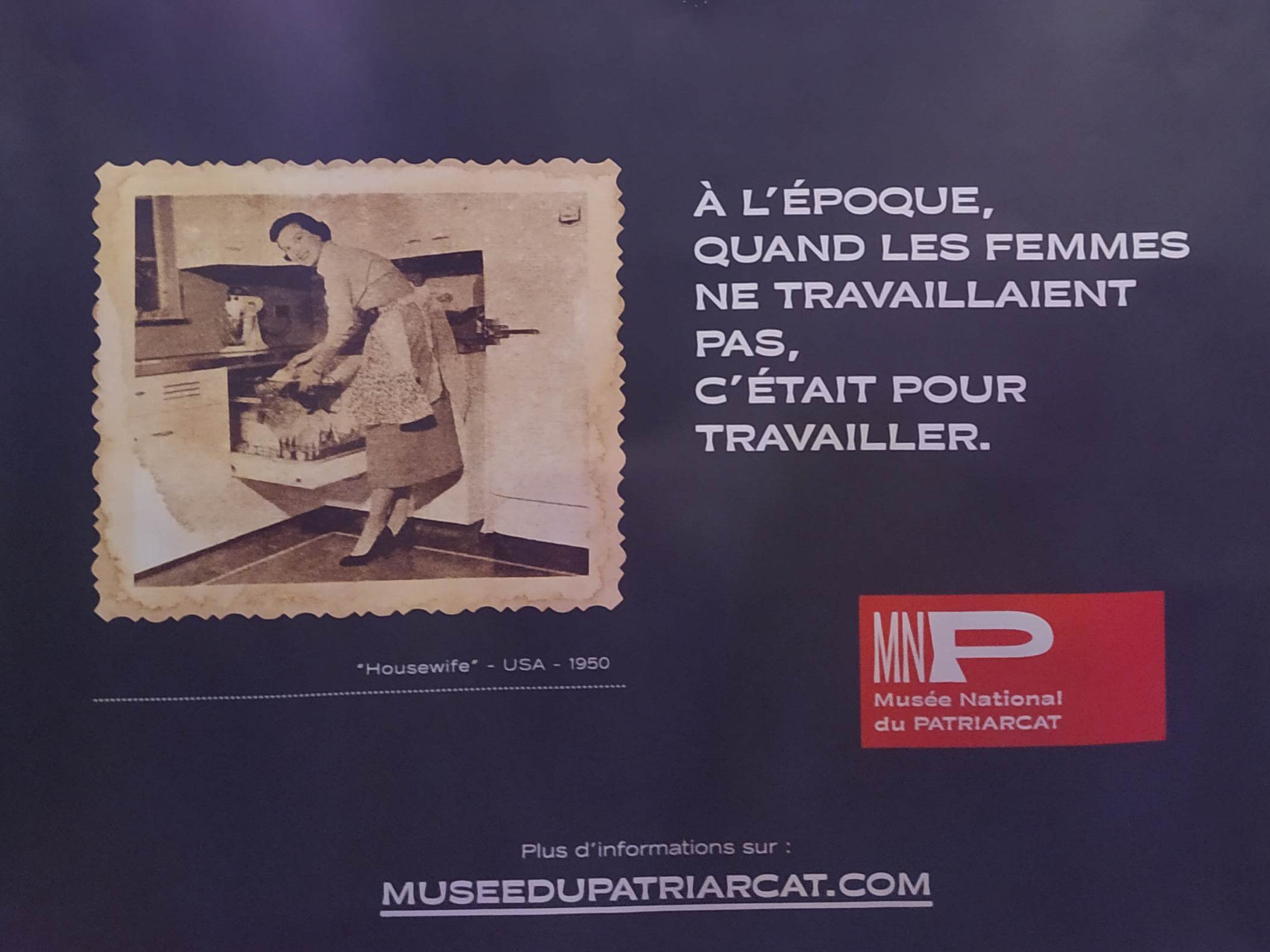
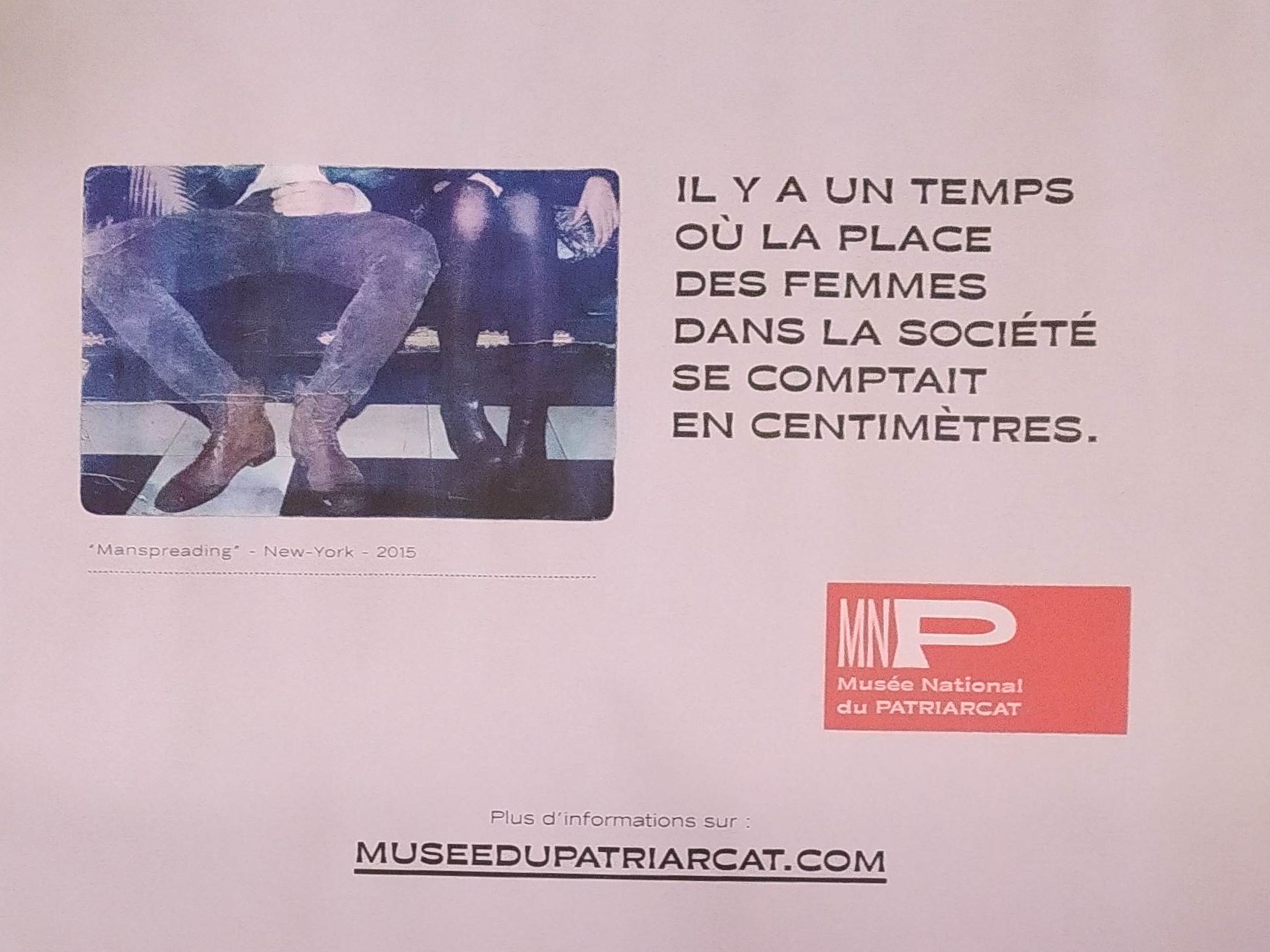
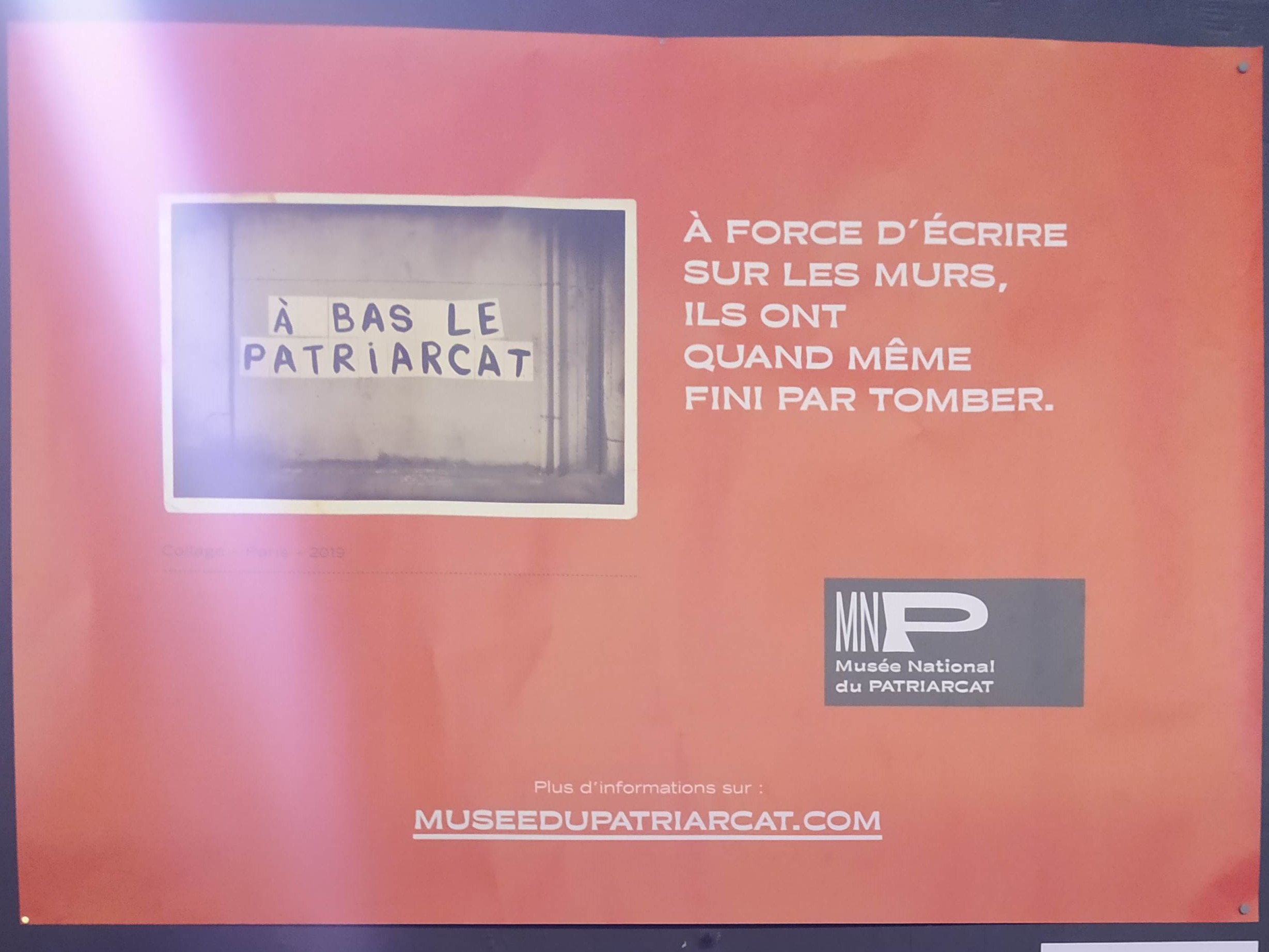
© T. Schriver
Parmi les “archives” exposées :
● des pancartes de manifestations,
● le violentomètre, outil de détection développé fin 2018 notamment par En avant toute(s) suite à une commande de l’état français,
● des jouets genrés (bébé rose, ordinateur bleu)
● des captures d’écrans où seul “Madame” ou “Monsieur” peuvent être cochés
● des rasoirs bleus et roses pour aborder la taxe rose etc.
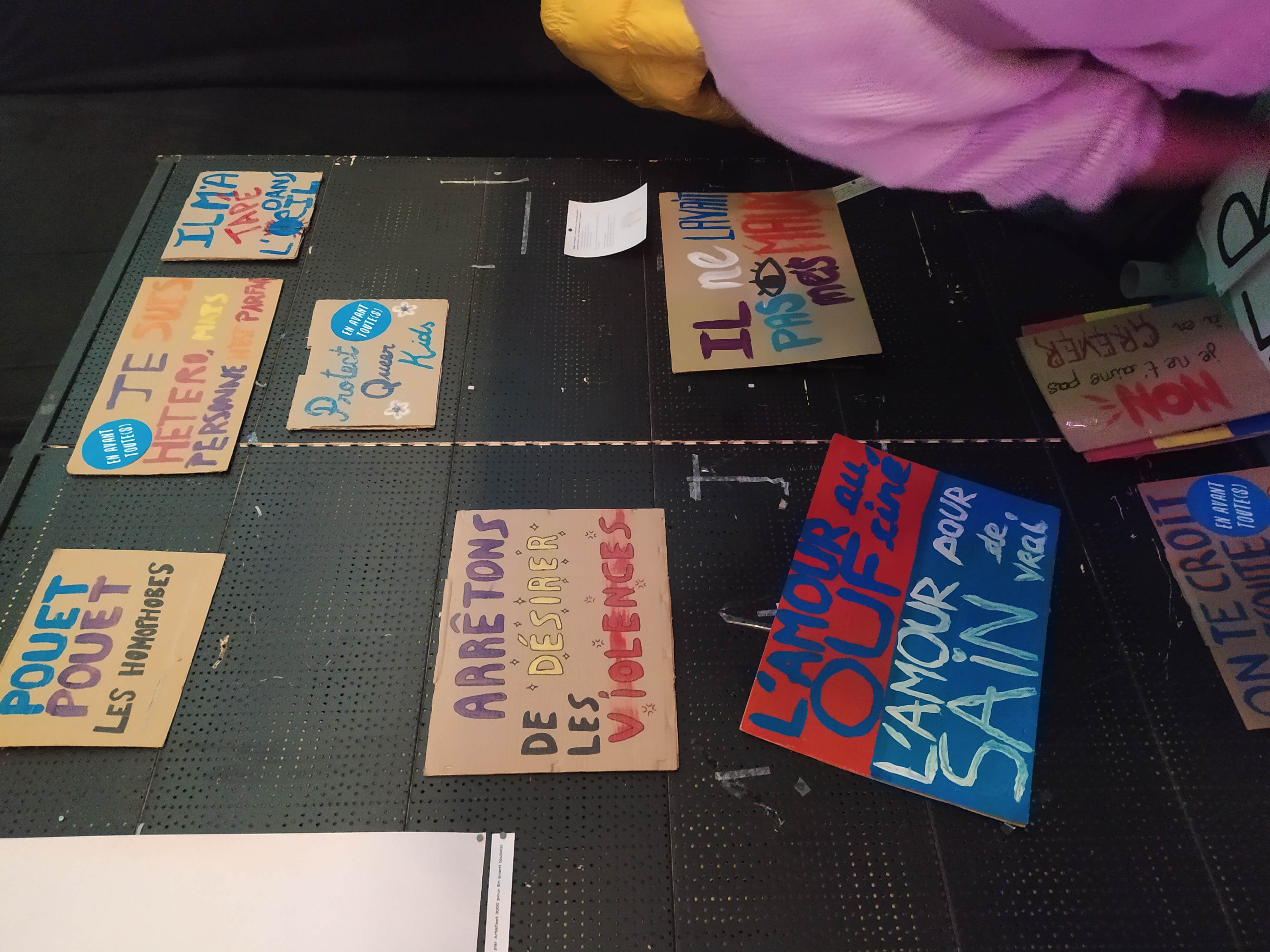
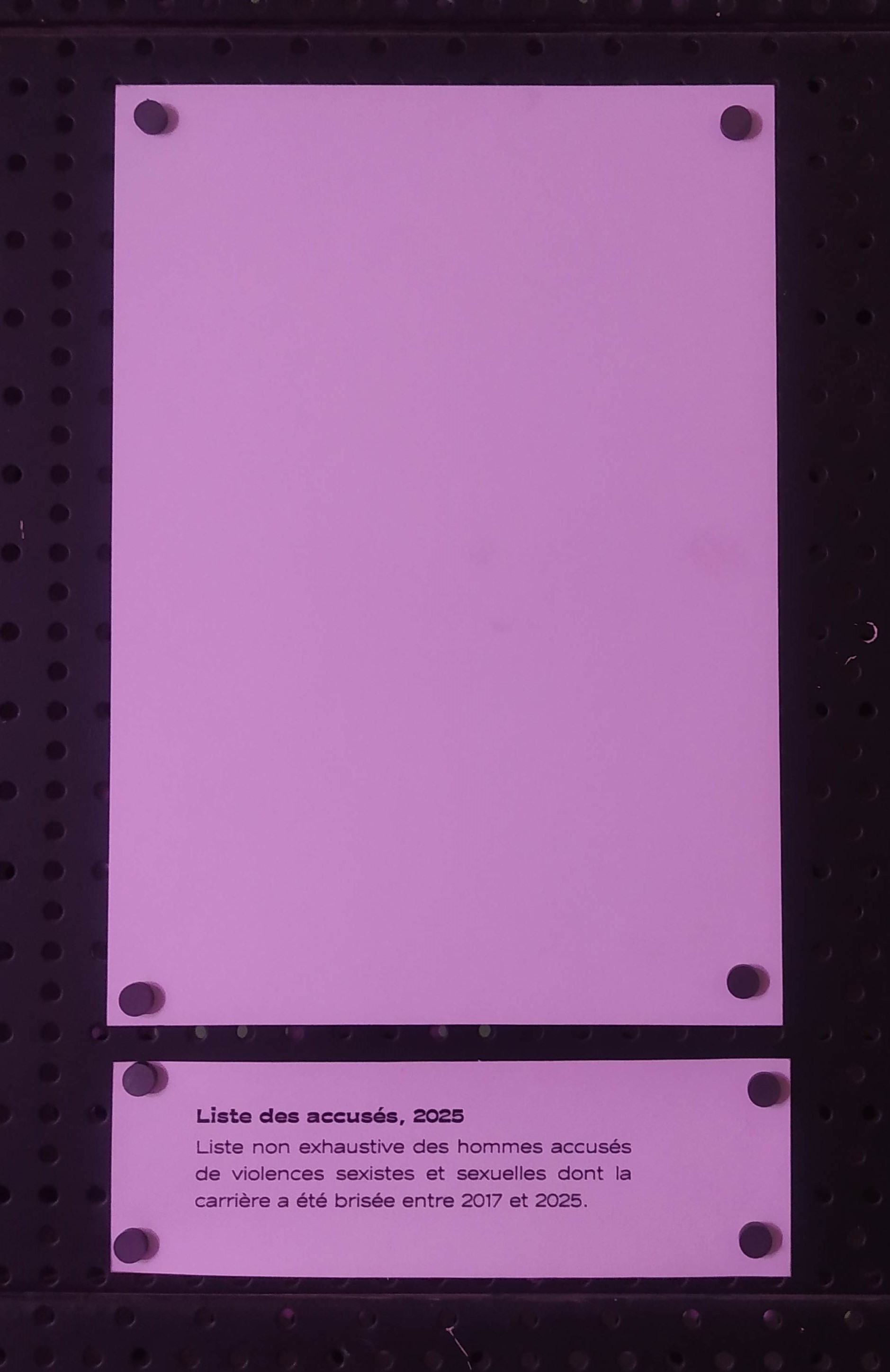
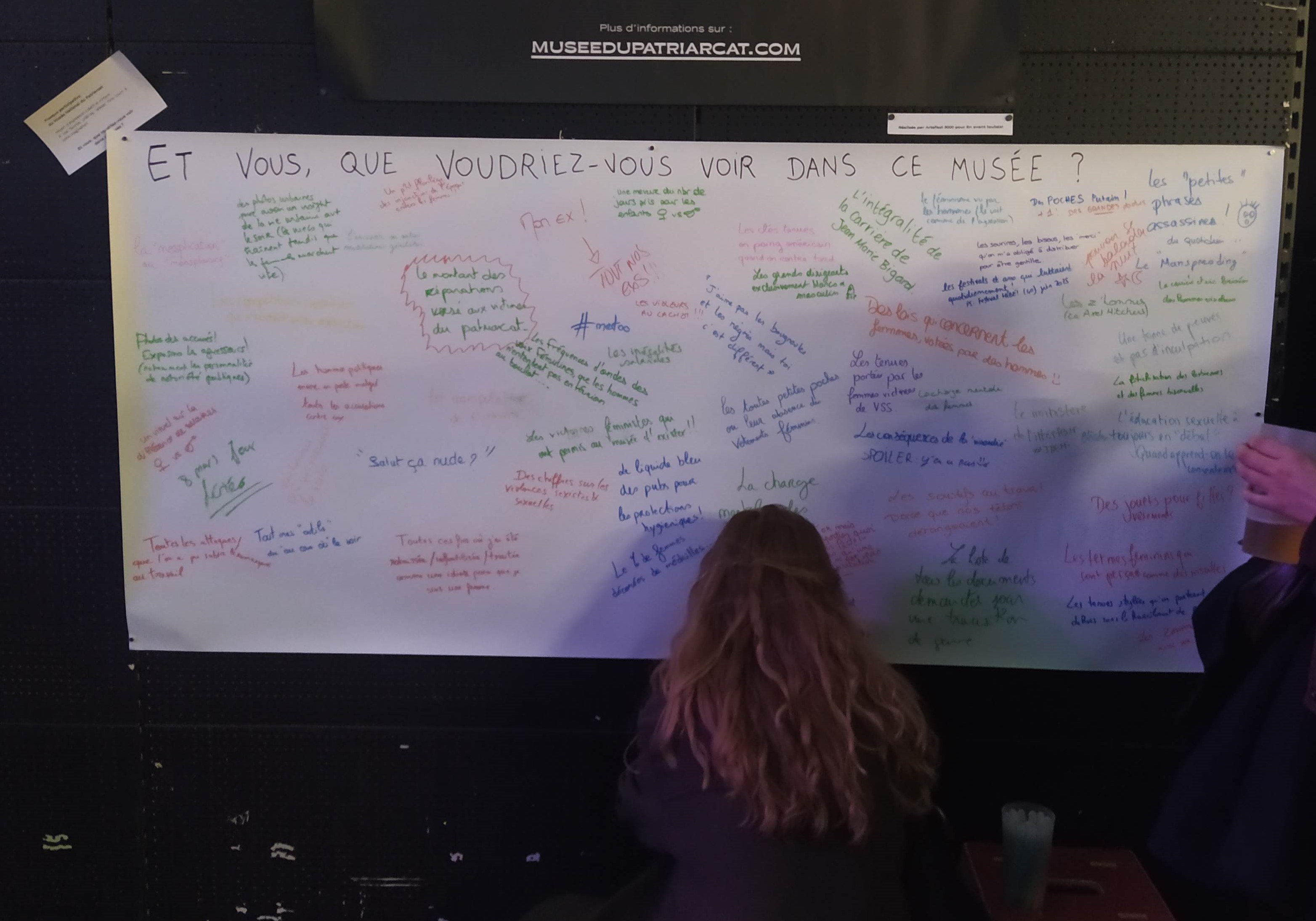
© T. Schriver
Ne manquant pas d’ironie pour pimenter le parcours, un vase rempli d’eau représente les “larmes ouin ouin des hommes” et une feuille blanche liste les “hommes accusés de violences sexistes et sexuelles dont la carrière a été brisée entre 2017 et 2025”.
L’association n’a pas travaillé avec des professionnels du monde muséal, néanmoins, elle a eu le réflexe de varier les moyens de médiations : une vidéo interactive sur le harcèlement de rue, et, à la fin du parcours, un mur sur lequel les participant.es répondent à “Et vous, que voulez-vous voir dans ce musée ?”.
Cette exposition éphémère, accessible après avoir fait un don à l’association, a aussi été le lieu de divers événements au cours de la soirée : discours des fondatrices de l’association, DJ sets, stand up et drag show.
Succès
L’événement relayé sur différentes plateformes (site web, instagram, journaux, magazines), a fait l’objet d’affichages publics avec MediaTransports. Et la collaboration entre l’association et l’agence de pub Artefact 3000 a été lauréate du Concours Futurs Désirables, organisée par le Club des Directeurs Artistiques.
De nombreux badauds, attirés par le mystère de cette salle feutrée de rideaux et de ses événements, ont bien tenté de se faufiler. C’était sans compter l’équipe de bénévoles qui leur demandait leurs bracelets ou bien expliquait le projet et le don de 10€ afin de rentrer. Une majeure partie était intriguée, intéressée par le projet et a fait ce don. Entre questions et réponses, la plupart d’entre eux terminaient par “Vous avez de l’espoir !”. Néanmoins, le succès fut tel que les rideaux qui marquaient la taille de la pièce, s’ouvraient de plus en plus, et que leurs ourlets ne touchaient plus le sol. Il était temps d’ouvrir l’exposition à toute.s.
Suite à ce succès temporaire, il est important de noter :
● que le sujet du patriarcat et de sa place dans un passé révolu intéresse l’opinion publique, les médias, les publicitaires
● que l’imaginaire du musée peut être saisi par tous et l’est saisi notamment par les associations à des fins de sensibilisation et d’opérations coup de poing (cf. les militants écologistes et leurs jets de soupe ou peinture)
● que le musée à l’image de lieu poussiéreux, bon à exposer des archives, lorsqu’il est repris par des sphères amatrices, est un lieu vivant, d’échanges, d’humour !
Tiphaine Schriver
#patriarcat #association #éphémère #féminisme
Pour en savoir plus sur “En avant toute(s)” :
“En avant toute(s) a été créée en 2013 par Ynaée Benaben et Thomas Humbert, très vite rejoint par Louise Delavier et Céleste Danos. Une vaste étude de terrain a permis de montrer que les structures destinées aux femmes victimes de violences étaient trop peu nombreuses ou surchargées et de constater la prévalence des violences chez les plus jeunes femmes.
Nous avons alors décidé d’œuvrer dans notre environnement proche en nous adressant aux personnes de notre âge en cherchant des modes de communication plus adaptés aux usages actuels et à l’imaginaire de notre génération.
Depuis 10 ans, nous développons notre expertise et menons toutes nos actions dans l’optique de : promouvoir l’égalité des genres, prévenir les violences de genre, s’adresser aux jeunes.”

Le musée ne vous tend plus la perche
Enfin, il ne vous tend plus la perche à photo, autrement dit, un "selfiestick". Les perches à photo sont essentiellement une canne télescopique avec une accroche pour mettre son smartphone ou son appareil photo afin de mieux se prendre en photo tout seul. Petits bras ? Pas de soucis ! Le selfie stick permet à l'usager de prendre un recul jusqu'à un mètre.
Et, au moins si vous n'habitez pas sur la planète Mars depuis quelque temps, vous l'avez déjà vu à plusieurs occasions utilisés par les touristes. (Et vous avez peut-être déjà consulté les prix ). Devant la Tour Eiffel, aux Champs-Elysées, à la mer ou sous la pluie, le selfie stick va où vous voulez. Sauf, depuis peu de temps, dans les musées.
© J.C.
Il y a des nombreux endroits interdits aux selfie sticks : le Carnaval à Rio, le Palais de Versailles, les stades O2 et Wembley, la Mecque, et la plage ultra exclusive Garoupe à Antibes. Et les musées : les Smithsonians, le Met, le British National Gallery, l'Albertina à Vienne, entre d'autres. Les musées en France hésitent à interdire totalement, mais croyez-moi quand vous sortez votre canne au milieu de l'exposition Jeff Koons au Centre Pompidou, un agent d'accueil va vous dire quelques mots. Il vous explique que c'est pour la sécurité des œuvres, en raison des risques de faux pas et oops ! 25 Marilyns d'Andy Warhol devient 24 Marilyns et une pauvre dame avec la griffe sur la joue. Une vraie tragédie. Alors, interdiction totale est la préférence du jour !
© J.C.
Mais pourquoi est-ce que le selfie stick est si à la mode ? Sommes-nous juste plus narcissique que jamais ?
Je postule que ce n'est pas uniquement un narcissisme né d'une culture de l'immédiat, mais plutôt un moyen de tisser des liens avec l'un à l'autre et d’ancrer sa présence dans le fil du temps. On va regarder dans le passé pour déchiffrer le futur. Pour chaque chercheur de l'Histoire, qui a passé des heures dans les archives, la correspondance écrite nous permet une vue intime de la personne. Il y a des codes à déchiffrer (surtout dans les lettres d'espion !), il y a des dessins ou des photos, il y a des questions et des réponses. Mais qui prend le temps d'écrire une lettre maintenant (à part de nos amis à l'EDF) ? Comment nous documentons-nous ? Vous, les malins me répondez : Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tous les réseaux sociaux. Il y a des codes spécifiques (t1kiet, a2m1), des photos postées, des questions et une plateforme de réponses (un RT sur Twitter). Ces réseaux sont les journaux intimes de l'époque contemporaine (même si on croit qu’ils disparaissent, les tweets et les snaps existent pour l’éternité).
Nous avons besoin de documentation. Il fautdocumenter la vie pour les enfants de nos petits-enfants. Il faut documenter les phénomènes culturels (#icebucketchallenge),voir ce qu'on mange (#faitmaison), partager les divertissements (#PSG), etfaire le deuil des tragédies (#jesuischarlie). D'ici 500 ans, des études sociologiques serontmenées pour comprendre la question de savoir si la robe est bleu et noir oubien blanche et dorée.
Ilreste possible de se prendre en photo sans selfie stick ; ce dernier facilite la prise de selfie en donnant une vue plus large depuis l'appareil photo ou le smartphone. Il est toujours possible de demander aux inconnus de prendre une photo devant une œuvre ou devant un monument. Bien que nous voudrions rendre plus accessibles nos vies quotidiennes avec nos proches, sommes-nous prêts à nous rendre plus proches d’inconnus. Cette performance artistique de nos vies ne s'élargit pas plus loin que notre cercle intime.
La vie quotidienne est le sujet de l'intention artistique depuis toujours. Les fresques qui se trouvent dans la grotte de Lascaux (#dansmonquartier), les portraits de nobles (#fashionvictim), les paysages bucoliques (#nofilter). Ils auront assez de recul pour constater notre existence et trouver l'impact sur la leur. C'est un peu ce qu'on fait actuellement quand on voit les tableaux de Pieter Brueghel l'ancien, qui sont les commentaires sur les mœurs de l'époque, ou on peut lire le Canard Enchaîné pour savourer une critique contemporaine.
Et alors, que devient notre précieux selfie stick dans cette histoire ?
Ce qu'on ne dit pas, c'est que les selfies sont un moyen non seulement de documenter nos vies, mais aussi de s'impliquer dans l'œuvre. Nous nous voyons dans les reflets de Jeff Koons, nous aimons repousser la Tour Penchante de Pise pour la "remettre" dans sa place. Nous nous voyons dans l'art, dans l'histoire. Nous nous sommes non seulement intégrés, mais impliqués. Le voyeur devient l'objet vu ; un petit selfie innocent devient une pratique de documentation qui existe depuis la naissance de l'homme.
Donc la prochaine fois que vous voyez un touriste portant un selfie stick, pensez aux raisons derrière un tel usage. Est-ce que c'est narcissique pour se vanter devant des amis, ou une pratique culturelle documentaire qui date depuis la naissance de l'humanité? Comme le selfiestick nous l’apprend, avec un peu de recul, vous trouverez peut-être un point de vue plus large.
Jill CARLSON
#selfie
#actualités
#règlement intérieur
Le sort des expositions temporaires
Qu’advient-il du mobilier d’une exposition temporaire quand elle se termine ? Ce n’est pas la question que l’on se pose lorsqu’on visite une exposition, sauf si, comme moi, vous voulez tout remporter chez vous). Par contre, c’est une question que se posent les concepteurs d’exposition, qu’ils soient exécutants ou commanditaires. Petit tour d’horizon des différents cas de figure.
Le musée de Bibracte, distingué au niveau européen pour ses actions en la matière
Direct à la poubelle...
Le cas le plus triste est l’aller simple à la case poubelle. Faute de moyens de stockage ou manutention, les lieux d’exposition doivent se résoudre à jeter les mobiliers utilisés. Mais comme l’éco-conception rentre de plus en plus dans les mœurs, les déchets occasionnés ne sont pas forcément importants. Si quelque chose doit vraiment être jeté, un suivi est mis en place pour que les déchets soient acheminés vers les centres de tri appropriés. Au musée portuaire de Dunkerque, l’exposition Tous pirates ? finira sa course à la poubelle, excepté pour certains éléments qui peuvent servir à la médiation. C’est aussi le sort qui a été réservé à l’exposition Zizi Sexuelréalisée par la Cité des Sciences et de l’Industrie.
Mobilier de Zizi sexuelà la Cité des Sciences et de l’Industrie © Sortir à Paris
Vive le réemploi !
Consciente des enjeux, la Cité des Sciences a élaboré un guide d’éco-conception des expositions pour ne pas reproduire cette destruction. Ainsi l’exposition Ma terre première pour construire demain a été conçue de manière à ce que les supports soient réutilisables pour d’autres expositions : avec une nouvelle esthétique, les supports embrassent une nouvelle identité.
Les structures de Ma terre première pour construire demain © Musées et développement durable
La conception de mobilier durable et réutilisable dès le départ d’une exposition n’est pas encore de mise partout. C’est toutefois le cas à la BnF, sur le site de Richelieu, où des cimaises mobiles conçues en 2007 ont été réutilisées quatre fois par la suite.
Quand le mobilier ne peut resservir tel quel comme dans le cas précédemment abordé, il est stocké dans l’attente d’une possible réutilisation ou d’une itinérance. Au Musée National de l’Education à Rouen, le mobilier est stocké là où on peut, sans lieu dédié, jusqu’à sa réutilisation. Le Musée essaye de prévoir celle-ci en amont, en demandant aux scénographes lors de la conception des nouvelles expositions d’essayer de réutiliser l’existant. C’est le même principe à la BnF, qui inclut dans les cahiers des charges de nombreux critères de développement durable, dont l’obligation d’utiliser au maximum les vitrines existantes. Au Musée de l’île d’Oléron, ce sont des matériaux de récupération qui servent à faire les expositions et qui, une fois celles-ci terminées, sont “remis en jeu”. Pour l’exposition À la côte, des palettes furent utilisées pour créer des cloisons puis servirent à la manutention au sein du musée.

Les palettes de À la côte © photos du musée de l’île d’Oléron
De son côté, le musée de Bretagne dispose de peu d’espace de stockage dédié aux matériaux bruts, c’est pourquoi on n’y garde que des grandes surfaces de bois ou de plexiglas, qui peuvent être réutilisées pour d’autres usages. Des cloisons de la dernière exposition de l'Écomusée du pays de Rennes ont été utilisées pour l’exposition-écrin Louise de Quengo - Dame des Jacobins qui a eu lieu cet hiver.

L’exposition Louise de Quengo - Dame des Jacobins© Musée de Bretagne
A l’inventaire !
A l’inverse, Rennes Métropole a mis à disposition du musée un espace où sont gardés tous les mobiliers moins ordinaires. Ceux-ci sont répertoriés dans une base de données indépendante, qui est communiquée aux scénographes pour privilégier la réutilisation en amont même de la conception.
D’autres lieux d’exposition possèdent des espaces de stockage conséquents pour leur mobilier d’exposition. C’est le cas du Centre Pompidou-Metz qui, dans une ancienne base aérienne, conserve les mobiliers intéressants. Un inventaire de ce mobilier est tenu à jour pour faciliter la réutilisation. La Cité des Sciences et de l’Industrie dispose elle aussi d’un tel lieu, où le mobilier est entreposé en attente d’itinérance ou de réutilisation.


L’entrepôt de la Cité des Sciences et de l’Industrie © M. C.
L’essor des ressourceries
Si la réutilisation des mobiliers n’est pas possible pour le lieu d’exposition lui-même, cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas envisageable pour quelqu’un d’autre. Au musée de Bretagne, c’est La Belle Déchette, une ressourcerie qui donne une seconde chance à des objets et matériaux réutilisables, qui récupère une bonne partie du mobilier que le musée ne peut pas garder. Sinon, les chutes de matériaux font le bonheur des petites associations et des maisons de quartier de Rennes.
Upcycling, késako ?
La BnF, lorsqu’elle ne fait pas des expositions en carton, donne ses bâches d’exposition à la société bilum, qui les “upcycle” en articles de bagagerie. L’upcycling est l'action de récupérer des matériaux dont on n'a plus l'usage afin de les transformer en produits de qualité ou d'utilité supérieure : c’est du recyclage « par le haut ». En plus de l’intérêt écologique, l’upcycling crée des objets uniques, comme cette gamme de bagagerie à partir des expositions Astérix à la BNF et Astérix s'affiche à Bercy Village. La RMN-Grand Palais et le Louvre font aussi confiance à bilum.

Modèles issus des expositions Astérix à la BnF, Monetet Hokusai© bilum
Plus tournés vers le grand public et sans partenaire régulier, les Ateliers Chutes Libresinvestissent des lieux d’exposition le temps d’un atelier, pour réutiliser les chutes de matériaux d’exposition et fabriquer des objets divers à destination du grand public.
Et les coopératives ?
La règle des 3R (réduire, réutiliser, recycler) est de plus en plus respectée par les musées et lieux d’exposition. Toutefois, les exemples abordés ici ne sauraient être représentatifs du paysage français, qui est bien plus varié. La vie du mobilier d’exposition temporaire devrait être une question centrale pour toutes les institutions : certaines ont du mobilier qui ne va plus servir mais qui pourrait servir à d’autres, des manipes et des maquettes, du matériel audiovisuel,... Il faudrait, comme Michaël Liborio le suggère dans l’ouvrage Musées et développement durable, créer une coopérative de mobilier d’exposition à l’échelle d’une région, d’un département ou tout simplement d’un réseau d’institutions. Une coopérative de ce type permettrait à bien des lieux de faire des expositions qu’ils ne pourraient faire autrement, et aux autres de s’engager plus fortement dans une démarche durable et solidaire.
Si l’on se penche sur l’éco-conception des expositions, il y a beaucoup à dire, à réfléchir et bien sûr à faire. De nombreuses structures se sont déjà engagées dans cette voie (la BnF, Universciences pour ne citer qu’elles), et il y a fort à parier que d’autres vont suivre d’ici quelques années.
Juliette Lagny
#recycler
#expositiontemporaire
#développementdurable
_________________________________________________________________________
Pour en savoir plus :
CHAUMIER Serge et PORCEDDA Aude (sous la direction de), Musées et développement durable, Paris, La Documentation Française, 2011
DEROUAULT Serge et RIGOGNE Anne-Hélène, « Une gestion responsable des expositions temporaires à la Bibliothèque nationale de France », La Lettre de l’OCIM [En ligne], 140 | 2012, mis en ligne le 01 mars 2014, consulté le 06 janvier 2018

Le street-art s'installe à Clichy !
Entre le 19 mai et le 14 août 2021, une exposition présentait le travail du street-artist Sunset au Pavillon Vendôme, centre d’art et office du tourisme de la ville de Clichy. Le week-end du 3 et 4 juillet, l’association Co42 s’installait sur un terrain de sport municipal pour la première édition du C.A.P.S Festival, le Clichy Arty Playground Street Festival.
Regardons de plus près ces deux manifestations culturelles.
Image d'en-tête : Terrain de sport municipal, rue du 19 mars 1962 © rentingART
Post-graffiti, de la rue au musée
L’exposition Post-graffiti, de la rue au musée, s'est installée dans les salles du Pavillon Vendôme avec les toiles de l’artiste Sunset (sun7). Organisée par RentingART (société proposant la location d’expositions clé en main et l’organisation d'événements d’art contemporain) l'exposition se présente comme une rétrospective du travail de l’artiste.
Mais commençons par situer ce qu’est le post-graffiti.
Si le graffiti, c’est l’art de graffer dans la rue, le post-graffiti serait plutôt l’art de graffer pour exposer dans une institution (galerie ou musée). Une exposition de street art dans un centre d’art c’est donc exactement du post-graffiti, même si l’artiste vient d’abord du graffiti. Pour en savoir plus sur l’histoire du graffiti et son arrivée en institution .
Jonas Bournat, ou Sunset, graffe depuis les années 2000, en utilisant toujours les mots comme base de son travail. Le Pavillon Vendôme présente les trois périodes de l’artiste, à rebours. Le rez-de-chaussée expose les toiles de sa dernière série, Planosfear : des sphères formées de mots calligraphiés, la plupart dans différents tons de rouge.
A l’étage sont accrochées les portraits de personnages célèbres réalisés par Sunset depuis 2009 sous la forme de calligrammes graffés (Obama, Lady Di, Pierre Soulages...).
Ces portraits ne présentent aucun contour ou dessin, ils sont entièrement constitués de mots calligraphiés. La série est d’ailleurs appelée Calligrammes urbains, et elle est suivie des premiers travaux de l’artiste, les Abstractions urbaines. Cette dernière (ou première) série est notamment présentée à travers deux installations vidéos, dans les deux dernières salles. Une vitrine présente le matériel utilisé par Sunset, pour rappeler que s’il expose aujourd’hui dans un centre d’art, l’artiste vient avant tout du street art.

Steve, Sunset, 2015. © Maud Person
Malgré le parcours street-art de l’artiste, l’exposition est épurée, toute de blanc vêtue, ce qui rappelle les origines de RentingART, issu de l’art contemporain et des whites cubes. L’exposition est accompagnée de visites guidées et d’initiations au street art (quatre dates proposées sur la durée de l’exposition) et de rencontres avec l’artiste (deux dates proposées).
Cette ouverture vers le public est dans le même esprit que le C.A.P.S Festival, dont rentingART est partenaire.
C.A.P.S Festival, terrain de sport et hommage à l’art procédural
Si l’acronyme C.A.P.S a bien sûr un sens (Clichy Arty Playground Street Festival), c’est surtout une référence aux “caps”, le nom donné aux bouchons des bombes de peinture, auxquels on peut trouver mille usages ! La diversité des tailles de capuchons permet de varier la taille du trait, et un vieux bouchon peut par exemple servir de pochoir inversé pour créer de petits ronds.
Alors au C.A.P.S, que s’est-il passé ce week-end de juillet ?
Six artistes ont investi ce terrain de sport municipal durant la semaine précédant le festival : CharlElie Couture, Jo Di Bona, Poter, Tim Zdey et Sunset. CharlElie Couture a réalisé un long poème sur les murs et le sol du stade, alors que Jo Di Bona installait sa fresque colorée, agrémentée d’affiches à motifs noirs et blancs, sur le mur au fond du terrain. Poter et Tim Zdey décoraient le hangar accolé au terrain d’immenses motifs géométriques (colorés pour Poter, en hommage à l’artiste Sol LeWitt, et noirs et blancs pour Tim Zdey). Enfin, Sunset s’emparait du dernier mur, tout en longueur, pour réaliser sa propre fresque, mêlant les couleurs de Sol LeWitt et ses propres motifs en cercle, les Planosfear.
Si on parle autant de Sol LeWitt ici, c’est parce que le C.A.P.S Festival souhaitait lui rendre hommage par cet événement. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette figure de l’art procédural des années 70, c’est par ici !
L’idée du C.A.P.S était de rapprocher le street-art des habitants, et on peut dire que cela a plutôt bien marché. Près de 1000 visiteurs sur le week-end, et la participation active des enfants et des jeunes lors de l’installation en semaine, et pendant les animations du week-end. En semaine, les enfants, curieux, venaient donner un coup de main aux artistes pour repeindre le terrain, et ils étaient présents tout le week-end pour s'entraîner au street-art sur des “murs” faits de film plastique tendu : pas la technique la plus écolo, mais particulièrement pratique et efficace.
Pendant le festival, on a vu une batucada, des dj-sets, et les animations à destination des plus jeunes illustrées juste ci-dessous (et des bières artisanales au nom du festival !).

© @caps.festival
Image vignette : Œuvres de la série Planosfear - Sunset © Maud Person
#streetart #capsfestival #expo

Le télétravail s'invite chez soi
On apprend à aimer et à comprendre la nécessité et l’infini des possibles du travail en groupe dans ce Master, mais personne n’avait prévu que cela doive se faire à distance.
J’écris en pensant aux étudiantes ayant appris la muséographie sur les bancs de la faculté d’Arras, dans notre salle bleu canard. Ma promotion s’accorderait pour dire que ce Master d’Expographie et de Muséographie nous apprend beaucoup. Réfléchir au contenu d’une exposition. Apprendre à rédiger un synopsis, un programme muséographique, un cahier des charges pour nos collègues et néanmoins ami.e.s scénographes. Apprendre, par le biais de workshops intensifs, à conditionner des œuvres pour les réserves d’un musée. Apprendre à concevoir une médiation, parfois même en anglais. Ré-apprendre à aimer écrire. Et bien d’autre choses encore. Mais ce que ce Master nous apprend avant tout, c’est à travailler en équipe, à réfléchir ensemble, à penser à plusieurs. En tout cas, moi, c’est ce que j’ai appris à aimer cette année. Ou pendant les sept mois pré-bouleversement de nos vies. Un soir, la nouvelle est tombée, les facs fermaient leurs portes à compter du lundi suivant. Puis le frère d’une amie d’enfance qui travaille dans une librairie et dont l’oncle a des connaissances dans différents ministères a eu l’info par sa voisine que le confinement total allait être prononcé prochainement. Entre fake news, réelle angoisse et insouciance, j’ai attrapé les affaires qui m’étaient chères, des livres pour travailler et des livres pour m’évader, prévu une liste de séries à binge-watcher puis j’ai sauté dans un train et quitté pour une durée indéterminé le soleil des Hauts-de-France. Une boule immense de stress dans le ventre. Et le cœur moins léger d’avoir laissé derrière moi des amies et cette précieuse cohésion de groupe.

Dessin autoportrait de Lorette en pleine ébullition ⓒ Lorette
Le marché de la visioconférence/apéro a explosé. Mais moi, voir des têtes familières sur un écran sans pouvoir réellement communiquer, sans pouvoir réellement échanger, ça ne m’amuse pas beaucoup. Les rires sont tristes, les silences pesants et les non-dits lourds de sens. Parce que même sur le plus sophistiqué des logiciels, ces rendez-vous ont un goût amer.
La vie des musées est elle aussi bien plus compliquée
Un public vous manque et tout est dépeuplé. Les couloirs et les salles sont vides. Les montages d’exposition sont à l’arrêt. Les vernissages n’ont pas eu lieu. Les conventions de prêts pour les expositions à venir sont plus complexes à établir. Nous autres étudiant.e.s débutons nos stages dans d’étranges conditions. Télétravailler avec des ami.e.s n’est pas simple. Mais avec des inconnu.e.s ! C’est particulier. On essaie tant bien que mal de se familiariser avec des visages pixélisés. On essaie de composer avec les aléas de la visioconférence.

Visuel du Podcast du département de l'Isère ⓒ Département de l’Isère
Les musées auront tout de même su rebondir dans ces temps un peu tristes et un peu gris. Les espaces d’expositions n’accueillent plus de visiteurs mais les réseaux sociaux prennent la relève. Le Musée Dauphinois de Grenoble propose à ses publics de laisser la culture s’inviter chez eux. Les publics confinés ont la possibilité de partager leur dessin d’animaux imaginaires de la montagne, de découvrir des objets phares de leur collection et d’écouter le podcast des musées confinés, premier podcast des musées du département de l’Isère. Trois épisodes vous proposent d’en apprendre plus sur Rose Valland, à qui le musée dédie en ce moment l’exposition Rose Valland, En quête de l’art spolié.
« La vie continue » donc et le travail avec. Mais travailler en équipe, réfléchir ensemble et penser à plusieurs, par écrans interposés, c’est beaucoup moins amusant. Entre les « tu peux répéter ? », « ma connexion a coupé », « mon micro ne fonctionne pas », la vivacité des échanges est freinée et les litres de café et les mégots de cigarette n’en finissent plus de s’accumuler sur le bord de la fenêtre. La vie continue, certes, mais dans quelles circonstances.
Guide de survie en télétravail
J’écris ce texte à la veille du déconfinement et je crois maintenant m’être suffisamment apitoyée sur mon sort. Je n’ai pas la prétention d’apporter LA solution pour réussir à travailler au mieux à distance. Je n’ai pas non plus la prétention de me lancer dans un plaidoyer enflammé sur les bienfaits du contact humain, du travail en groupe et de la liberté. D’autres l’ont fait et je n’ai pas de pierre à apporter à l’édifice. Si ce n’est : c’est vraiment super !
Alors pour éviter de rester sur une touche amère, pour affronter le déconfinement, qui n’est pas un retour à la liberté (#restezchezvous) et si d’aventures, cette situation venait à se renouveler, voilà ci-après, un guide qui permet de rester positif.ve. Je crois.
1. Dors. Réveille-toi. Fixe le plafond. Attends que la vie passe. Introspecte-toi. Fixe le plafond encore. Oui il y a une drôle de tâche sur le coin du mur. Oui c’est sans doute une araignée. Ne panique pas. Dors.
2. Lis. Beaucoup. Une chambre à soi, des livres sur les musées ou l’abécédaire des Alpes qu’importe, occupe ton esprit par des mots. Ils nourrissent aussi bien que le pain.
3. N’écoute pas les contenus de développement personnel qui te diront de réfléchir à tes addictions. Tu tenteras d’y mettre un terme plus tard. Pas maintenant. Là ce n’est pas le moment.
4. Installe Instagram sur ton GSM. Va suivre le contenu de BarbaraButch. En réalité va suivre tous les comptes militants féministes et queer pro-sexe qui prône la convergence des luttes. (Je profite de ce guide pour militer moi-même, parce que la lutte n’attend pas).
5. Binge-watch ou savoure tes séries. De toute façon tu sais que tu t’arrêteras à l’avant-dernière saison. Fais-le simplement sans culpabiliser.
6. Relis les cinq premiers points. Souffle. Tout va bien. Dis-toi que tout ce que tu as lu, regardé, compris, aimé ou détesté sont les sujets des nombreuses discussions enflammées que tu auras une fois le déconfinement terminé.
7. Ne désinstalle pas Instagram de ton GSM ! Va suivre le contenu de Décolonisons-nous. En réalité, va suivre tous les comptes militants qui t’aideront à engager le long chemin de la déconstruction. Pour une société plus juste, sans hiérarchie, sans rapport d’oppression. (Cf point 4 : La lutte n’attend pas).
8. Désinstalle BFMTV en revanche. Et ne regarde pas trop les informations. De manière générale, ne t’aventure pas trop dans les chaînes de télévision. Tu pourrais tomber sur une chaîne qui diffuse des messes en direct. (La chaîne KTO, si, si, ça existe).
9. Ecoute, ré-écoute, ré-écoute encore les musiques sur lesquelles tu as des souvenirs impérissables. Quitte à danser seul(e) dans ta salle de bain. Non il n'y a pas de honte à avoir. Personne ne te regarde. Tout le monde est chez soi.
10. Rappelle-toi que non, le confinement ne nous aide pas à « prendre le temps de prendre le temps » et à « renouer avec les choses simples de la vie ». Qu’est-ce qu’on avait dit sur les contenus de développement personnel ? Relis le troisième point.
11. Relis le tout. Je sèche, je n’ai plus de conseils avisés. Parce qu’on brode tous avec ce qu’on a, qui on est, ce qu’on aime et ce qu’on aime moins.
Manon Lévignat
#télétravail
#muséesconfinés
#restezchezvous
Liens vers le podcast des musées confinés : https://musees.isere.fr/actu/musee-dauphinois-ecoutez-ya-rien-voir-le-podcast-des-musees-confines
Les Hortillonnages : impression sauvage, expression humaine
De passage à Amiens, en attendant le prochain train, le temps de vagabonder dans le centre-ville, l'idée évidente est de visiter la cathédrale Notre-Dame.
Entailles, Wilson Trouvé, Amiens © Yann Monel
Une fois le pèlerinage terminé, nous descendons la rue de la Barette, remontons les berges de la Somme, le soleil d'automne nous pousse à traverser le fleuve pour rejoindre le parc qui le longe. Notre marche hasardeuse se complique : des cours d'eau de plus plus nombreux nous barrent la route, la nature se densifie et nous impose l'assistance d'un plan. Sous nos yeux, une étendue immense, un archipel d’îlots entrecoupés de minuscules cours d'eau. Nous imaginons une formation naturelle: ruisseaux, îles et mangroves découlant des eaux du fleuve qui abreuvent et inondent ces terres. Au loin, des barques accostent, déchargent et chargent ce qui semble être badauds et touristes. Nous en sommes.
La Maison des Hortillonnages
Le lieu appartient à l'Association pour la protection et la sauvegarde du site de l'environnement des hortillonnages. Notre sentiment se précise: l'endroit n'est pas un quelconque espace vert mais une particularité amiénoise. Impatients d'embarquer, nous sommes munis de tickets et d'un plan détaillant chaque nom des canaux qui découpent les lieux. Mais du cheminement naturel qui nous a conduit en ce port, s'est éveillé en nous une curiosité inattendue : la signification de ce mot bien étrange: Hortillonnage. Une salle est prévue pour répondre à nos questions. Le décor rustique tient d'une cabane de chasse. Films d'archives et photos anciennes nous permettent de nous fondre et comprendre l'histoire du site, son utilité, sa faune, sa flore et le plus intriguant : ses habitants.

Vue du ciel, Amiens © Licence Creative Commons
Les Hortillonages, Amiens © C.V
Une nature façonnée par l'homme
Le sentiment d'être au centre-ville de la capitale picarde s'est évanoui, mais la brève exposition d'introduction vient nous le rappeler. C'est l'homme qui a comblé, creusé, défriché, détourné et enfin cultivé ce qui étaient d'anciens marais et tourbières. Non par plaisir mais par nécessité. Les hortillonnages, ces terres fertiles au cœur d'Amiens, ont permis de nourrir sa population durant des siècles. Les maraîchers transportaient leurs récoltes via des barques et approvisionnaient les étals des marchés des quais de la Somme. On estime la naissance des hortillonnages à l'ère Gallo-romaine mais le premier document qui en atteste date de 1492. 1500 hectares au XVème siècle et un millier de maraîchers pour les exploiter.
L'avènement du chemin de fer entame le ralentissement de ce mode d'agriculture. En 1900, 500 hectares de terre. 300 hectares aujourd'hui, 7 exploitants pour les cultiver, 99% des îlots sont devenus des jardins d'agrément.Nous sommes appelés à embarquer, accompagnés de 10 autres personnes. Le Gouverneur, nom de notre navire, s'approche silencieusement. Une barque à cornet, bateau à fond plat aux allures de gondole, dont la rame est remplacée par un moteur électrique qui n'émet aucun bruit si ce n'est les clapotis de l'eau. Le moyen de propulsion permettra d'apprécier le calme qui habite le site et possède un atout écologique évident.
A la barre Jean-Claude, enfant du pays est trahit par son léger accent bien picard. Il aura la double casquette de capitaine et médiateur. Une fois les amarres larguées, le chef à bord nous décrit les 3 km de croisière à venir, demandant aux passagers d'étudier leurs cartes et de cerner le parcours. 45 minutes soit 3 km de croisière sur les 65 km de rieux. La visite ne couvre pas l'ensemble des hortillonnages et n'est pas improvisé. Depuis le port nous nous rendons au rieu d'Orange, le numéro 13 sur la carte. La vocation du circuit est de présenter la diversité des parcelles. Il est établi en communion avec les propriétaires des îlots, ces derniers ayants émis de nombreuses plaintes à l'encontre des visiteurs qui naviguent sans encadrements et qui n'hésitent pas à emprunter des canaux privés, peu scrupuleux de l'environnement et de la quiétude des hortillonnages.

Les Hortillonages © C.V
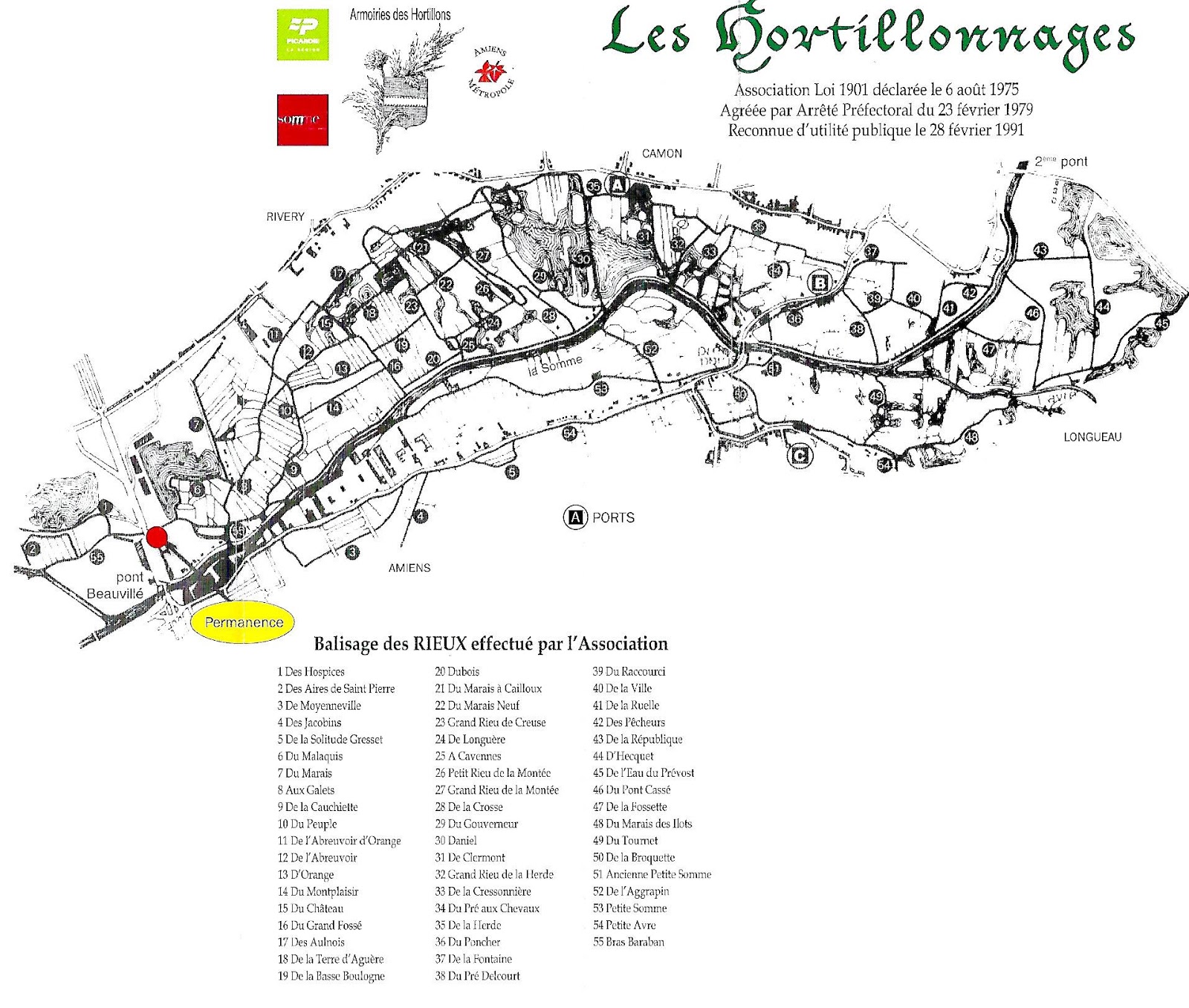
Balisage des rieux © La Maison des Hortillonages
Un musée à ciel ouvert
Au fil de l'eau nous avons la preuve que les hortillonnages ont perdu leur vocation initiale de nourrir les Amiénois. Jadis ventre de la ville, ils sont désormais le poumon vert. Les nouveaux habitants, surnommés par notre capitaine "les Robinsons" y viennent pour camper, pêcher, cultiver leur potager, se baigner l'été tant l'eau y est propre... Nombreux se plaisent à mettre en scène leur parcelle tels de véritables scénographes. Nous attendions un endroit exclusivement dédié à la nature, l'expression de l'homme y est finalement foisonnante.
Le visiteur est autant intrigué par l'ouvrage titanesque réalisé depuis des siècles, les hortillonnages, que l'inventivité des gens qui le font vivre. Les parcelles se succèdent mais ne se ressemblent pas: ruches, houblonnière et cabane encerclée de sculptures représentants un orchestre de jazz qui évoquent les quartiers de la Nouvelle-Orléans... L'architecture parfois audacieuse des cabanes incite à la rêverie. Les Robinsons se plaisent à afficher leurs talents d'horticulteurs, jardiniers, bricoleurs. En témoigne ce vélo posé à proximité du canal, qui pompe l'eau une fois le pédalier mis en route. Aux ambiances poétiques et colorées se succèdent des œuvres artistiques. Le 15 octobre se terminait le 8ième festival Arts, villes et paysages, organisé par la Maison de la culture d'Amiens.
De jeunes paysagistes, plasticiens, architectes et designers étaient invités dans les hortillonnages pour produire des œuvres qui tiennent compte des contraintes naturelles et des spécificités du lieu. Plusieurs installations n'ont toujours pas été démontées comme l’œuvre Arcane de la plasticienne chinoise Yuhsin U Chang. Ce fragile entrelacs de branches qui semble léviter surprend sans détonner des mangroves qui l'entourent si ce n'est grâce à sa blancheur immaculée. Ici l'artiste, en évoquant la fragilité des écosystèmes, se joue une fois de plus de la nature et s'en inspire pour la mettre en scène. Des mécènes financent la préservation du site, et s'affichent en bienfaiteur sur des pancartes installées sur des îlots. Mécénat, médiateur, mise en scène, expositions et œuvres d'art, les hortillonnages sont devenus un véritable musée à ciel ouvert.

Arcane, Yuhsin U Chang , Amiens © C.V.


Les Hortillonages, Amiens © C.V.
Des hortillonnages nous mesurons l'abnégation du genre humain, son évolution au fil de l'histoire. Prêt à détourner des fleuves pour subvenir à des besoins élémentaires, également capable d'un raffinement, d'une créativité sans limite pour conserver un lieu qui avait perdu sa vocation d'exister. Si les Amiénois n'avaient pas investi ces terres maraîchères en déclin, l'endroit ne serait plus que tourbière, marais ou béton. Au-delà du caractère unique des hortillonnages, d'avoir ramené puis conservé une nature si diverse au cœur de la ville, nous trouvons en ces lieux un formidable terrain d'expression. Mesurons également les capacités de destruction de l'homme. Aux 130 000 visiteurs annuels qui embarquent chaque année grâce à la Maison des Hortillonnages dans un cadre strict, s'ajoutent 50 000 visiteurs indépendants. Les Robinsons, pour préserver leur terre ont de nouvelles questions à se poser.
#Amiens
#Hortillonages
#LaMaisondesHortillonnages
Pour en savoir plus :

Les muséums d’histoire naturelle, une prise de conscience écologique ?
Alors que les enjeux écologiques sont connus de tous depuis de nombreuses années, comment les institutions culturelles prennent part à cette « prise de conscience » ? Les muséums d’histoire naturelle sont, du fait de leur histoire, intimement liés à cette question. En effet, comme le démontrent très bien Florian Charvolin et Christophe Bonneuil dans leur article « Entre écologie et écologisme : la protection de la nature au Muséum dans les années 1950 », les muséums, et principalement celui de Paris, s’investissent d’un nouveau rôle à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale : celui de la protection de la nature. Même si aujourd’hui, leurs missions se sont éloignées de cet objectif et correspondent dorénavant à celles d'une institution culturelle, il n'en est pas moins intéressant de comprendre comment se placent les muséums face à ces questions d’environnement, de biodiversité et d’écologie.
Présenter la nature comme un bijou de biodiversité
Le musée d’histoire naturelle de Paris propose depuis le 23 octobre 2021, l’Odyssée sensorielle une exposition coproduite par le muséum et par la société Sensory Odyssey. Dans cette exposition, un parti pris fort est tenu : montrer la richesse de la nature et faire découvrir aux publics le monde animal. Durant tout le parcours, les visiteurs.euses passent d’espace en espace, de monde à monde : marais, forêt, savane, océan, souterrains, banquise, etc. Dans chacun de ces mondes, ils sont invités à regarder la nature vivre sur de grands écrans accompagnés d’un dispositif olfactif ainsi que des jeux de lumière et de température.

Odyssée sensorielle, © M.Maine.
Cette exposition « spectacle » souhaite montrer une nature qui émerveille. La protection de l’environnement n'est pas le fond du propos. Néanmoins, comme ce projet est basé sur des campagnes de vidéo-reportages, certains moments captés rappellent aux publics les problèmes écologiques actuels de fonte des glaces comme de pollution des mers, avec des exemples comme celui d’une chute de glacier ou encore d’une baleine essayant de manger un sac plastique. Pour autant, le discours proposé par le muséum en fin de parcours, dans le « point chaud », ne traite pas réellement de ces moments captés.
Il est vrai que les muséums d’histoire naturelle ont longtemps été un moyen de montrer aux publics la richesse et la beauté de l’environnement. Certaines scénographies sont très représentatives de ce discours comme la première partie du parcours du Naturalis de Leiden (Pays-Bas), Life. Une gradation scénographique et muséographique prépare petit à petit, depuis les profondeurs, les publics à s’émerveiller devant le foisonnement de spécimens à la surface. Un grand nombre de mammifères y sont exposés dans une mise en scène spectaculaire.

Life, Naturalis de Leiden © M.Maine.
Une histoire des collections à connaître
Cette idée d'accumulation fait partie intégrante de l’histoire des muséums et de leurs collections. En effet, les premières collections de sciences naturelles ont été rassemblées dans des contextes particuliers, principalement au XIXe siècle. Il s’agissait alors d’une collecte systématique dont témoigne aujourd’hui le nombre de spécimens présentés dans les institutions (200 000 au muséum de Paris par exemple). Certains muséums prennent même le parti de l’illustrer dans leur muséographie comme le Muséum d’histoire naturelle de Lille et la présentation d’oiseaux dans les anciennes vitrines.
Cette masse de spécimens se retrouve également dans le Naturalis de Leiden et notamment dans la partie dédiée à la séduction et à la reproduction. En effet, au centre d’un espace très scénographié, sont exposés œufs, nids, petits, adultes, fruits d’arbre, etc. La mise en scène à destination du jeune public rend le tout très ludique et amusant. Néanmoins, il s’agit de collectes massives de spécimens, allant toujours plus loin dans la « collection » : le mâle, la femelle, les petits, l’espèce avec son pelage d’hiver, les œufs, les nids, etc.
Comment parler de l’impact humain sur l'environnement dans un muséum ?
Le Natuurhistorisch de Rotterdam rappelle aux publics les enjeux écologiques actuels tout au long de son parcours. Une salle dédiée aux expositions temporaires accueille un.e artiste contemporain.e qui compose des peintures de paysages naturels « habités » par les déchets humains (masques, canettes ou autres). Dans le reste du parcours, un dispositif expographique pousse les publics à se remettre en question : l’animal est obligé de s’adapter à son environnement, imposé par l’humain. Ainsi, sur un socle, un cygne naturalisée est installée dans son nid entièrement constitué de déchets humains. Cette mise en scène peu habituelle et rare dans les muséums marque un réel tournant muséographique : ne plus présenter l’animal dans son environnement fantasmé et idéalisé mais bien dans un contexte bouleversé par l’humain.

Natuurhistorisch de Rotterdam© M.Maine.
La séduction, la reproduction, la naissance sont autant de thèmes particulièrement plébiscités par ces institutions mais la mort des espèces ne l’est pas tant que cela. Deux structures évoquent toutefois la mort des êtres vivants dans un discours engagé : le Naturalis et le Natuurhistorisch. Le premier accorde à la mort un espace d’exposition complet, Death mettant en scène le décès de l’animal causé par l’homme. Dans cet espace, la muséographie présente notamment les méthodes d’éradication des espèces qualifiées de nuisibles, la quantité d’insectes tués lors de nos déplacements en voiture, nos habitudes alimentaires omnivores ou encore l'utilisation du cuir ou des peaux animales pour certaines confections de vêtements. Même s’il n’y a pas de remise en cause de ces pratiques, aborder cette thématique reste un geste fort (et nécessaire) pour le muséum. Du côté du Natuurhistorisch, le propos autour de ce sujet est plus pointu : pour parler des espèces tuées sur la route, une vitrine expose directement un hérisson écrasé. Le muséum appose également la mention des circonstances dans lesquelles les animaux naturalisés, nouvellement acquis, sont décédés sur un cartel (impact avec un hélicoptère, marée noire, etc.). Les enjeux écologiques ne sont pas tant abordés dans les muséums par la démonstration des extinctions de masses mais bien par l’impact « direct » de l’humain sur la faune : transport, élevage, chasse, etc.
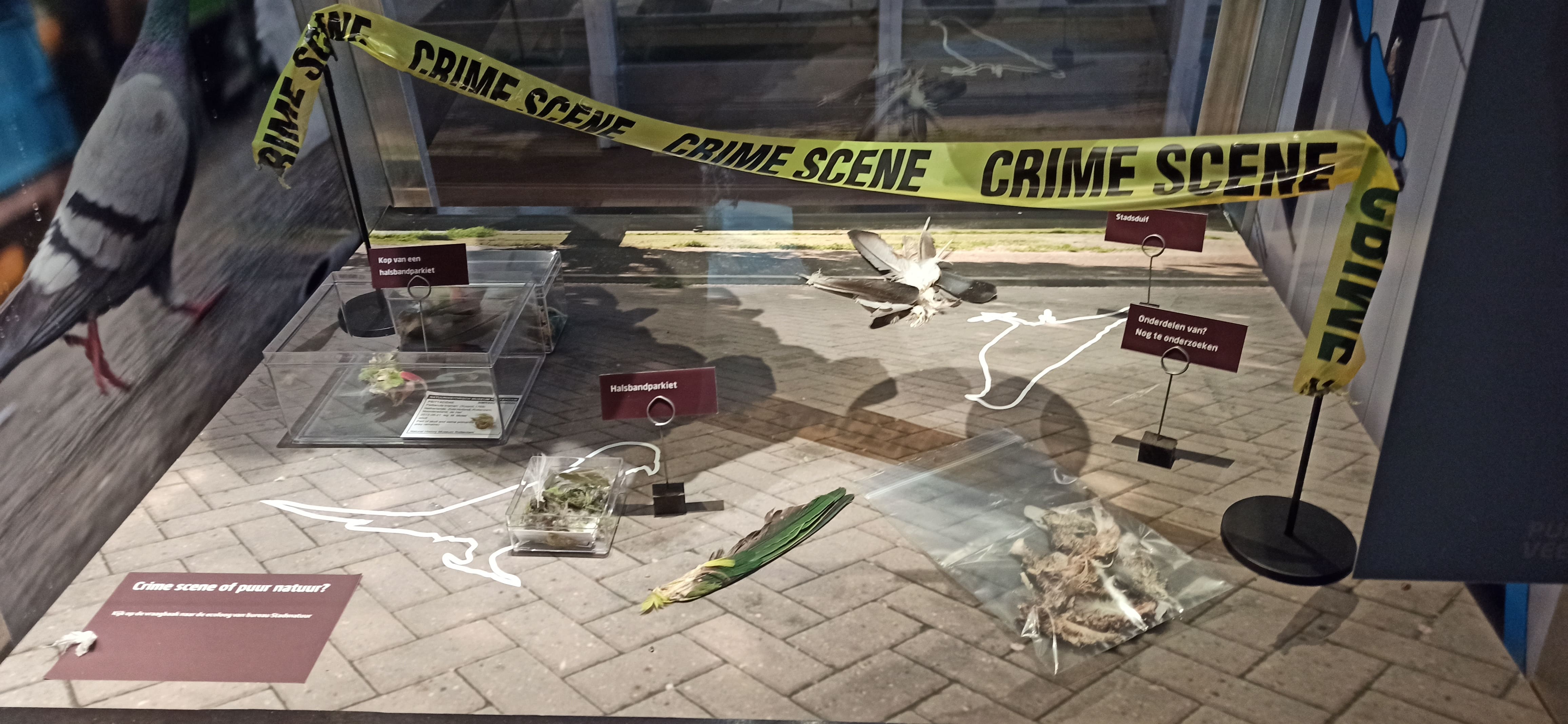
Natuurhistorisch de Rotterdam© M.Maine.
Les muséums peuvent aborder de différentes manières les questions d’écologie, d’environnement et de bien-être animal, que ce soit dans leurs discours, dans leurs sujets d’exposition ou même dans leurs expôts.
Et si ces institutions ne se limitaient pas à traiter ces questions comme un sujet d’exposition mais s’interrogeaient elles-mêmes sur leur propre consommation et leur impact écologique ? Énergie, matières premières, recyclage… De plus en plus d’expositions sont développées avec une volonté d’« écoconception » ; c’est-à-dire une conception respectant au mieux les principes du développement durable ainsi que l’environnement.
MAINE Marion
Références bibliographiques / pour aller plus loin
- C. BONNEUIL et F. CHARVOLIN, « Entre écologie et écologisme : la protection de la nature au Muséum dans les années 1950 », Responsabilité et environnement, n°46, avril 2007, p. 46 à 52. https://www.annales.org/re/2007/re46/charvolin-bonneuil.pdf
- C. CASEDAS, « Musées et écoconception : théorie et bonnes pratiques», J’ai l'œil du tigre,n°61. https://podcast.ausha.co/j-ai-l-oeil-du-tigre/61-musees-et-ecoconception-theorie-et-bonnes-pratiques
- A. SONVEAU, « Odyssée Sensorielle : expérience sensorielle, sensationnelle ou sensible », L’Art de Muser, 28 mars 2022. http://www.formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2331-odyssee-sensorielle-experience-sensorielle-sensationnelle-ou-sensible
#Muséum #Environnement #ImpactsHumains

Les nocturnes lèvent les interdits

Cartographie de l'imaginaire de la nuit © E.F
FÊTE + SOIRÉE + MYSTÈRE = FUSE à la Vancouver Art Gallery
INTIME + RÊVE + MYSTÈRE = Dream Over au Rubin Museum
TRANSGRESSION
Une expérience de visite inédite, oui ! Mais à quel prix ?
-
GERMAIN Floriane, « Une expérience singulière : visiter de nuit un musée », La Lettre de l’OCIM [En ligne], 156 | 2014, mis en ligne le 01 novembre 2016, consulté le 19 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/ocim/1460 ; DOI : 10.4000/ocim.1460
-
HALL Edward T. La Dimension cachée, 1966
-
Page Internet du FUSE: https://www.vanartgallery.bc.ca/events/fuse-resonances
-
Page Internet Dream Over: https://rubinmuseum.org/mediacenter/dream-over-2019
-
Reportage FUSE 2014 réalisé par NovusTV: https://youtu.be/CTrrNXrAOS8

Les nouveaux musées français en 2019 - 2020 : vraies nouveautés ou fausse modernité ?
En 2018, une fois encore, ils ont été nombreux à ouvrir, comme le musée Camille Claudel à Nogent-sur-Marne ou dernièrement, l’Envol des Pionniers le 22 décembre à Toulouse. Chaque année de nouveaux musées apparaissent sur notre territoire. Souvent ce sont des merveilles, pensés pour magnifier une collection, parfois de véritables vaisseaux futuristes sortis du sol et un peu vides. J’ai voulu savoir ce que les futurs musées nous réservent. En ce début d’année 2019, voici un tour d’horizon des musées ouvrant en 2019, en 2020 et au-delà.
L’attractivité de l’art moderne et contemporain par ses collectionneurs
Une des ouvertures les plus attendues de 2019 est la Collection Pinault - Paris, situé dans l'ancienne Bourse de Commerce à Chatelet, aménagée par l’architecte japonais Tadao Ando et accueillant la collection personnelle de l’homme d’affaires, François Pinault. Selon le site internet, ce nouveau lieu d’exposition de la collection après l’ouverture en 2006 et 2009 de deux espaces à Venise, “présentera des accrochages thématiques et des expositions monographiques, mais aussi des productions nouvelles, des commandes, des cartes blanches et des projets in situ. Ouverte à tous les publics et à toutes les disciplines artistiques, la Bourse de Commerce propose des programmes pédagogiques, des conférences et rencontres, des projections et concerts, des performances”. Propriété de la ville de Paris depuis 2016, le bâtiment a été concédé à la famille Pinault pour 50 ans et le futur musée, dont le coût de chantier et de gestion de l’établissement avoisine les 108 millions d'euros est financé entièrement par une société créée par la famille Pinault et ne sera donc pas soumis au statut de fondation.
Toujours à Paris, au printemps 2019 et dans le cadre de l’appel à Projet « Réinventer La Seine » de la Mairie de Paris, Fluctuart verra le jour du côté du Pont des Invalides. Ce centre d’art urbain flottant de 1000 m² sera gratuit, ouvert à tous et toute l’année et réunira de jeunes artistes émergents du street-art, des pionniers historiques comme Futura 2000, ou des artistes mondialement reconnus. Il réunira une collection permanente des grands noms du street-art, trois expositions temporaires par an, une librairie spécialisée, des évènements et des résidences d’artistes.

Projet de Fluctuart, Paris © Seine Design
Autre grande amatrice de street-art, Agnès B ouvrira dans le courant de l’année 2019, La Fab, fondation Agnès b. d'art contemporain. Situé au rez de chaussée de logements sociaux conçus par l’architecte Augustin Rosenstiehl, ce lieu du 12e arrondissement de Paris se trouve au n°1 de la place Jean-Michel Basquiat, inauguré le 29 septembre 2018. Ici, point d’exposition permanente mais des présentations temporaires pour accueillir les 5000 oeuvres de sa collection comme dans sa célèbre “Galerie du Jour” fermée depuis janvier 2018. Le lieu se veut être un espace culturel ouvert à tous, la collectionneuse souhaite que "les gens ne se soient pas intimidés à la Fab", que les jeunes s'y sentent chez eux". Elle compte organiser en collaboration avec le centre d'art Le Point Éphémère des concerts, des lectures, des moments de danse et de poésie.
Du côté de l’art moderne, c’est en 2020 que sera inauguré le musée d’art moderne de l’Abbaye de Fontevraud en Maine-et-Loire créé suite à un don à l’automne 2017 des époux Cligman d’une partie de leur collection d’œuvres d’art. En plus de cinquante ans, l’ancien industriel du textile Léon Cligman et son épouse, la peintre et sculpteure Martine Martine ont acquis une collection composée d’oeuvres de grands noms de la peinture des XIXe et XXe siècles : Delacroix, Toulouse-Lautrec, Derain, Van Dongen, Degas, César… mais aussi dessins, des verreries, des tapisseries de Jean Lurçat, des objets antiques. Le nouveau musée de 1 200 m2 accueillera quelque 1000 oeuvres données à la Région et l’Etat et seront installés dans le bâtiment de la Fannerie de l’Abbaye dont l’extérieur a déjà été rénové. Le coût des travaux d’aménagement du lieu, estimé à 8,6 millions d’euros, est financé par la Région et l’Etat et par une donation de 5 millions d’euros de Léon et Martine Cligman.
En 2022, exposer ses oeuvres quand on est collectionneur mais qu’on n’a pas la place de tout admirer et pas l’argent pour se faire construire un musée, ne sera plus un problème avec l’ouverture prévue d’un étonnant Musée des collectionneurs à Angers. Cet immense espace est conçu par l’architecte Steven Holl pour accueillir les expositions de collectionneur d’art privé du monde entier. Ce lieu, sans collection propre, fonctionnera en réseau avec d’autres musées de collectionneurs à travers le monde. A suivre...

Projet du Musée des Collectionneurs, Angers © COMPAGNIE DE PHALSBOURG / Architectes : Steven HOLL / Franklin AZZI.
La gastronomie et l’art de vivre à la française ont le vent en poupe
Depuis l’inscription du repas gastronomique français au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco en 2010, l’Etat doit mettre en oeuvre la création de la cité de la Gastronomie. En 2013, c’est donc non pas une, mais quatre villes qui ont été choisies sur tout le territoire français pour obtenir le label “gastronomie”.
La première à ouvrir en 2019, sera la Cité de la gastronomie de Lyon dans l’enceinte de l’Hôtel-Dieu, profitant de la réhabilitation de cet ancien hôpital monumental. La cité occupera 3 700 m2 des 50 000 m2 des bâtiments classés qui s’étirent le long du Rhône. Lyon a choisi, dans cet ancien hôpital, de s’intéresser aux relations entre gastronomie et santé. Au programme, deux expositions permanentes, deux expositions temporaires par an, des ateliers de cuisine, des démonstrations, des conférences…. En 2020, ce sera la Cité de la gastronomie et du vin de Dijon, puis en 2024 la Cité de la Gastronomie de Paris-Rungis près du célèbre marché et enfin la Cité de la gastronomie de Tours dont on ne connaît pas encore la date d’ouverture. Parallèlement, on pourra découvrir en 2020, l'Hôtel de la Marine, bâtiment du XVIIIe siècle sur la place de la Concorde, ancien Garde-meuble de la Couronne qui a comme volonté de valoriser la gastronomie et l’art de vivre à la française selon Philippe Beleval, président du CMN. À travers un parcours historique on découvrira les appartements des Intendants et les salons d'apparat. Sur les 12 700 mètres carrés du bâtiment, la moitié sera ouverte au public. Les intérieurs, rénovés avec soin, seront meublés et une expérience immersive est promise avec une mise en place de la médiation numérique, des effets sonores et même olfactifs. Une salle d’exposition de 400 mètres carrés accueillera également l’exposition de la collection privée de l’émir du Qatar, la collection Al Thani pendant 20 ans. La première exposition temporaire sera dédiée aux arts de la table au XVIIIe siècle. Un restaurant, un café et un salon de thé occuperont le rez-de-chaussée de l’hôtel. Une école de cuisine pourrait également y être implantée.
Les métiers d’art et les savoir-faire du luxe à l’honneur
L’ancien musée des arts et traditions populaires, situé dans le bois de Boulogne, fermé au public depuis 2005 a été choisi par LVMH pour installer la Maison LVMH/Arts-Talents-Patrimoine, un centre culturel dédié au métiers d’art et de l'artisanat dont l’ouverture est prévue en 2020. Le bâtiment, concédé par la mairie de Paris pour 50 ans sera modernisé par l’architecte Frank Gehry déjà concepteur de la Fondation Louis Vuitton située à deux pas. Les métiers d’art auront alors un lieu permanent où montrer l’excellence des savoir-faire et les liens qu’ils entretiennent avec les industries du luxe. S’y retrouveront une salle de concert, une salle de 680 m² consacrée à des manifestations ou des expositions, des ateliers d’artistes en collaboration avec la Fondation Louis Vuitton et une académie des métiers d’art et des savoir-faire composés d’un centre de documentation sur les métiers d’art et des ateliers recevant des artisans d’art. Du côté de Chanel, l’entreprise renforce aussi son engagement envers ses métiers d’art avec la création en 2020 d’un site dédié à accueillir ses créateurs, la Manufacture de la mode. Le bâtiment servira avant tout à accueillir près de 600 artisans d’art travaillant pour la marque de luxe mais selon le président de Chanel Bruno Pavlovsky, “un espace de 1000 mètres carrés sera ouvert sur la ville avec des expositions et des ateliers participatifs”.

Projet pour la Manufacture de la Mode, Paris © Chanel
Ça baigne pour les musées maritimes
Bordeaux s’empare de son patrimoine maritime, en le rénovant avec la création en 2022 des Bassins des Lumières par Culturespaces dans l’ancienne base sous-marine ou en le créant avec l’ouverture du Musée de la Mer et de la Marine dont la salle d’exposition temporaire accueille déjà des expositions depuis cet été et qui ouvrira définitivement avec son parcours permanent à l’été 2019. L’édifice dessiné par l’architecte Olivier Brochet (Musée de l’Homme) s’étend sur 13.000 m2 dont 6.500 m2 de salles d’exposition et 3.000 m2 de jardins suspendus. Il a souhaité un lieu ouvert et moderne autour d’une approche chronologique de la navigation, faisant la part belle aux grandes explorations et traversées mais aussi à l’histoire et au devenir du milieu naturel maritime. Il y aura une partie hors les murs avec des bateaux renavigables, restaurés grâce à des partenariats, notamment avec la fondation Hermione à Rochefort et une antenne du musée à la citadelle de Blaye qui participera à la connaissance du milieu naturel de l’estuaire de la Gironde. De plus, d’ici 2021 un aquarium mêlant espèces protégées destinées à la reproduction et installations numériques ouvrira également ses portes non loin du musée.
Projet pour le Musée de la Mer et de la Marine, Bordeaux © Brochet Lajus Pueyo
Monaco accueillera de son côté en 2020, le Centre de l’Homme et de la Mer. Sur près de 5000 m2, les visiteurs profiteront de l’exposition permanente sur la collection de l’archéologue sous-marins Franck Goddio et un espace d’exposition temporaire dans un bâtiment en forme de raie manta dessiné par Rudy Ricciotti (MUCEM). La tendance est loin de s'essouffler avec l’ouverture prévue du Musée Maritime de Saint-Malo en 2022 designé par l’architecte japonais Kengo Kuma qui a pour but d’accueillir les visiteurs "au coeur de la ville et représenter toute l'histoire maritime de la ville. Celle d'hier, d'aujourd'hui et de demain", selon Claude Renoult, le maire de la ville.

Projet pour le Musée Maritime, Saint-Malo © Kengo Kuma
Les musées de figures majeures
En plus du centre de l’Homme et de la Mer, Monaco ouvrira en 2020 le musée Grimaldi dans le même bâtiment, qui parlera de l’histoire de la famille royale. Suite à une exposition itinérante sur la défunte princesse Grace Kelly, l'exposition sera pérennisée dans ce lieu. À Vif et à Poissy, les lieux sont déjà existants, c’est la création d’un musée qui est nouvelle. La Maison Champollion, propriété du frère de l’égyptologue à Vif en Isère, accueillera un musée départemental qui sera dédié à l’égyptologie à travers les figures des deux frères Champollion. Ce lieu a été ouvert seulement quelques mois en 2004 lors de la IXème conférence internationale d’égyptologue à Grenoble et sera donc à présent pérennisé en 2020. À Poissy, ce ne sera pas avant 2022 que l’on pourra visiter le Musée Le Corbusier construit près de la Villa Savoye une des maisons les plus connues de l’architecte. L’idée est d’en faire un centre majeur sur l’architecte où seraient réunies les archives, les esquisses, les peintures et l’expertise de l’architecte et où s’installerait la Fondation Le Corbusier.
Et de la diversité !
En 2019 et 2020 de nombreux autres musées et lieux d’expositions vont ouvrir sur des thématiques étonnantes. Le premier d’entre eux à ouvrir avant l’été 2019 sera sûrement Citéco, la cité de l’économie de la Banque de France située dans l’ancien hôtel Gaillard, bâtiment classé de 1882 dans le 17e arrondissement de Paris et succursale de la Banque de France de 1923 à 2006. Lieu de découverte et d’approfondissement des mécanismes de l’économie, Citéco a une vocation pédagogique et ludique avec des expositions interactives et numériques mais qui mettra également en avant des collections en lien avec la monnaie et la salle des coffres sera préservée et ouverte à la visite. Selon Marc-Olivier Strauss-Kahn, en charge du projet, ce serait "un musée de troisième génération, comme il n’en existe aujourd’hui qu’à Mexico" (le MIDE, Museo interactivo de economia): "le maître mot, c’est l’interactivité. Le visiteur va vivre une expérience unique. Il pourra gérer un budget sur une machine à sous, poser un objet sur un scanner d’aéroport pour découvrir la provenance de tous ses composants, assister à un conseil des gouverneurs de banques centrales… Nous reprendrons certains des outils qui ont fait le succès de notre exposition "Krach, boom, mue", organisée en 2013 à la Cité des sciences et de l'industrie".

Projet de scénographie à Citéco, Paris © Citéco
Toujours en 2019, ouvrira le Centre européen du livre et l’illustration de Colmar dans l’enceinte de la bibliothèque patrimoniale des Dominicains remis aux normes et modernisé. Colmar conserve une riche collection avec le deuxième fond d’incunable de France jusqu’à des illustrations contemporaines. Ce sont plus de 400 000 documents qui sont conservés dans l’ancien cloître des Frères Prêcheurs avec notamment un livre plus rare encore que la première édition imprimée de Gutenberg, un des trois derniers exemplaires de la « Bible à 49 lignes » de Johann Mentelin, éditée en 1 460 et conservée dans un état remarquable. Le lieu se destine à mettre en valeur ses collections, proposer des expositions temporaires et devenir un lieu de ressources pour les chercheurs.
Puis en 2020 c’est la Maison des Mathématiques qui ouvrira ses portes dans le 5ème arrondissement de Paris, projet lancé par le mathématicien et député Cédric Villani et adossé à l'Institut Henri-Poincaré (IHP) dirigé depuis 2018 par Sylvie Benzoni. Chercheurs et grand public cohabiteront dans ce lieu avec un espace muséographique, des salles de recherches et d’échange avec des conférences, des rencontres dont le but est de montrer les liens des mathématiques avec la société d’aujourd’hui. NarboVia, le musée de la Narbonne antique ouvrira aussi ses portes en 2020 et retracera l’histoire de l’une des premières colonies antiques de la Méditerranée. Le bâtiment de 800m2 conçu par l’architecte Norman Foster accueillera des espaces d’exposition, des salles de travail et des réserves pour ces collections, dispersés dans différents musées de la ville qui n’ont jamais bénéficié d’un lieu de conservation et de présentation mutualisé.
En résumé, en 2019-2020, au moins une quinzaine de nouveaux lieux culturels vont ouvrir en France. Que ce soit des établissements publics ou des institutions privés, les thèmes abordés sont nombreux et si certains semblent novateurs et avoir une réelle envie de transmission et d’éducation, d’autres témoignent d’une volonté de développement touristique. D’énormes structures apparaissent avec des ”gestes architecturaux” forts avant même de savoir exactement ce que l’on va mettre à l'intérieur et cache les nombreux musées qui doivent fermer chaque année faut de moyens et de visibilité (Musée d’art africain de Lyon, musée des Tissus de la même ville tout juste sauvé). De nombreux lieux arrivent aussi à perdurer grâce à des rénovations, nombreuses ces dernières années : Musée Carnavalet, Musée Ingres, Museum de Bordeaux ou par de grands travaux pour les monuments pour accueillir toujours plus de visiteurs comme avec la fermeture et rénovation du Grand Palais entre 2020 et 2024 ou le chantier de reconstruction de la flèche de la basilique Saint Denis, commençants en 2020, ouvert au public pendant onze ans. Aujourd’hui, la culture se monnaie, se privatise mais jusqu’à quand ? Ne perd-on pas le côté “sans but lucratif, au service de la société et de son développement” de la définition du musée par l’ICOM, pourtant si essentielle ? Alors en attendant, meilleurs voeux culturels à tous et profitons de nos musées ouverts !
Cloé ALRIQUET
#nouveauxmusées
#ouvertures
#musées

Lettre ouverte à la Culture (Et à celles et ceux qui l'aiment)
Bonjour Culture adorée,
Je t’écris pour tellement de raisons que je ne suis pas sûre d’avoir la place pour tout dire... Quand je pense Culture je pense à toutes les cultures, toutes les formes : le cinéma, le théâtre, la musique, la littérature, l’opéra, la bande dessinée et bien sûr les musées. Tous les musées, le musée d’art et le musée de culture scientifique, le musée associatif et la machine institutionnelle parisienne.
Soyons honnête, en ce moment, c’est pas la fête. A une semaine des élections que te propose-t-on ? Pas grand-chose… Les candidats ont l’air d’avoir oublié que toi et tout ton personnel êtes essentiels au fonctionnement de notre société. Ils oublient que tu touches des milliers d’enfants, collégiens et lycéens, que tu fabriques des citoyens. Que sans toi, la France n’est rien. (Enfin, si ça reste un pays, mais c’est plus la France).
Il est loin le temps où les présidents se démarquaient par leurs politiques culturelles. Le temps où ils entraient dans l’Histoire en créant de grands musées, pour prendre soin de notre patrimoine. C’est comme ça que le Centre Pompidou est né pour accueillir nos collections modernes et contemporaines, suivit par la BnF, caserne d’Ali Baba des livres et des archives, puis le Quai Branly qui voulait honorer les Arts et Civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Grâce à toi, Pompidou, Mitterrand et Chirac ont laissé leur trace. Grâce à eux, on reconnaissait ton importance, Culture, et tu te retrouvais avec de nouveaux écrins pour présenter notre patrimoine.
Au delà de ces quelques temples monument aux érigés par les chefs d’Etat, on aaussi vu les médiathèques se multiplier, les cinémas se développer, le nombre de festivals augmenter : c’est tout un réseau culturel qui s’est développé pour nourrir notre société. Tu ne témoignais plus uniquement d’un patrimoine matériel réservé aux musées, mais tu devenais actrice du quotidien de chacun(e) et de notre patrimoine futur. Oui, le nôtre, celui qui t’appartient Culture, celui qui appartient à tous les citoyen(nes) et surtout, celui qu’on écrit tous les jours.
Ce témoignage précieux de notre histoire humaine, celui qui nous apprend à ressentir, à nous émouvoir, qui nous invite à questionner l’univers qui nous entoure, qui nous apprend aussi à l’accepter et à mieux le connaître. Celui qui nous rappelle que nous sommes un ensemble, et que c’est ensemble qu’on avancera. Grâce à toi aussi !
Et oui Culture, ne les laisse pas te sous-estimer ! Tu as bien ce pouvoir là. Malgré nos différences tu nous invites à échanger, tu nous réunis autour de ce patrimoine essentiel, de notre histoire humaine, européenne et internationale. Témoignage précieux sur lequel ton personnel veille tel un gardien de nuit. Beaucoup l’oublient ce personnel, alors qu’ils devraient lui dire merci : merci de prendre soin de ce témoignage de nos histoires pour que des générations en profitent, merci de participer à réinventer la culture d’aujourd’hui pourqu’elle devienne celle de demain !
Ces petites fourmis (celles qui se tiennent derrière la billetterie, qui rôdent dans les salles, et qui sont en coulisse, les régisseurs, les médiateurs, les conservateurs, les muséographes etc.) qui travaillent tout le jour et dorment peu la nuit, pour nous raconter des histoires extraordinaires, qui nous incitent à redécouvrir nos histoires, notre patrimoine et toutes ces choses qui sont partie intégrante de notre culture personnelle et font de nous ce que nous sommes.
Ces petites fourmis qui ont aujourd’hui besoin d’aide.
L’Etat te coupe les vivres, Culture, tel un parent fâché. Et la nouvelle génération, qui ne demande qu’à t’aider, perd petit à petit l’espoir et sa citoyenneté. En plus de se demander pour qui voter, elle se demande pourquoi ? Tu disparais des programmes ! Ça n’augure rien de bon… Toi qui jadis était si importante, te voilà reléguée au rang des oubliés ! On veut te faire taire, on t’oublie, mais quelques irréductibles continuent à lutter !
Alors Culture, embauche nous ! Ensemble on est plus fort(es) !
On se serrera les coudes, on rappellera aux gens que nous travaillons pour eux et que c’est en ça que tu es importante !
Ne me ferme pas la porte au nez, laisse moi entrer, prenons un café, j’ai plein d’idées pour t’aider !
Restons ami(es), brainstormons, trouvons des solutions ! Rappelons à tout un chacun notre importance et lançons la nouvelle fabrique du citoyen ! Inventons le Théâtre, le Cinéma, l’Opéra, la Littérature, la BD, la Danse, le Musée du XXIème siècle ! Faisons de la Culture un Tiers-Lieu pour tous, ensemble à deux et à tous !
Je t’attends Culture,
Laisse-moi entrer,
Ne me claque pas la porte au nez,
Et prenons un café,
J’ai plein d’idées…
© Margot Coïc
Margot Coïc
#cultures
#avenir
#politique

Lettre ouverte aux accueils des musées
Lorsque des visiteurs viennent au musée l’un des premiers espaces qu’ils côtoient est l’accueil. Lieux essentiels dans une institution culturelle, ils sont relégués au second plan sans grands aménagements particuliers. L’accueil se limite à une billetterie, une boutique qui sert à la fois de boutique-souvenir et de librairie pour mettre en valeur les dernières expositions ou une sélection d’ouvrages. Et parfois s’y trouve un café/salon de thé. Mais ces lieux restent de fait peu exploités au niveau muséographique par les institutions culturelles.
Pourtant, lors de mes dernières visites tant personnelles que lors de nos déplacements avec le master j’ai découvert des lieux qui ont donné une nouvelle dynamique à ces espaces quelques fois délaissés.
L’accueil : lieu d’ouverture sur l’extérieur
Si le musée est considéré comme une « zone de contact » – idée notamment développée par James Clifford – alors l’espace d’accueil devient l’intermédiaire entre l’extérieur et les espaces du musée. L’accueil est donc déterminant pour que les visiteurs s’immergent dès leur entrée dans la thématique ou les collections du musée.

Hall d’accueil du Centre Pompidou ©Keewego Paris
Outre le Centre Pompidou qui dans les années 70 offre une première proposition d’espace d’accueil par le biais de ce plateau forum. Une nouvelle aire d’accueil est pensée et plusieurs options sont présentées aux visiteurs dont de nombreux lieux de repos qui avaient été mis en place. Les visiteurs peuvent appréhender l’architecture moderne de Renzo Piano, Richard Rogers et Gianfranco Franchini avant de continuer leurs libres circulations. Peu de musées ou institutions culturelles changent les codes architecturaux pour que l’expérience de visite commence réellement dès son entrée.
Et si un accueil vous faisiez venir au musée ?
C’est à travers la visite de quatre musées d’arts – le Palais des Beaux-Arts de Lille, le BAM de Mons, le FRAC de Dunkerque, et le CAPC de Bordeaux – que je m’intéresse à cette notion d’accueil du public en tant que structure et intégration dans le musée. Non exhaustive, mon approche n’évoque pas l’accueil comme centre de ressources, caractéristique qui se retrouve au Louvre-Lens par exemple.

Espaces d’accueil, Besoin d’air de Mathias Kiss, Palais des Beaux-Arts de Lille, Novembre 2019 ©AV et Espaces d’accueils, PBA, ©Sinapsesconseils
Direction le Palais des Beaux-Arts de Lille. De véritables espaces ont été pensés afin que le visiteur se sente plus à même de préparer sa visite. Au-delà de l’espace boutique et café, le musée a mis en place des « espaces relax » avec le wifi gratuit, une zone de travail, et différents canapés. Une zone numérique est également dédiée à la découverte des collections et des dispositifs de médiations où les visiteurs peuvent organiser leurs visites en fonction du parcours qu’ils choisissent ou les œuvres qu’ils préfèrent. Ces lieux deviennent de véritables espaces de vies.
Le PBA montre sa volonté d’intégrer les espaces d’accueils au sein du parcours muséographique, l’accueil s’inscrit comme la première étape de la visite où découvrir le musée devient une expérience ludique et agréable.

Espace d’accueil BAM, Mons, Décembre 2019, ©AV
Seconde visite : le BAM – Musée des Beaux-Arts de Mons. Si cette fois nous entrons sur un grand accueil-boutique aux lignes architecturales modernes et épurées, un espace se démarque dès l’extérieur du musée. « La bulle du BAM, meet, share, relax » accueille les publics. Cet espace à la fois recherché pour que les visiteurs s’y détendent est également un lieu où certaines personnes peuvent travailler sur le modèle d’un mini open space. Lors de notre visite plusieurs étudiants y préparaient des projets artistiques. Cet espace peut inviter de nouveaux publics à franchir les portes du musée.

Accueil du FRAC de Dunkerque, ©jepi-dunkerque
Ainsi découvrir ces espaces d’accueil devient une véritable expérience muséale dans laquelle les visiteurs peuvent se détendre et deviner les différentes collections du musée. De ce fait, mettre en valeur ces zones permet à la fois de donner des informations concernant les activités de l’institution ou encore de présenter une œuvre participative pour introduire la visite. Le FRAC de Dunkerque a également mis en valeur l’espace d’accueil par un seul et même bloc qui relie l’accueil du public en lui-même, la boutique et un espace dédié à l’échange autour d’un café. Cette nef centrale introduit et donne sur les espaces d’expositions.

Espaces d’accueils du CAPC, Bordeaux, Janvier 2020, © AV
Quant au CAPC de Bordeaux, son entrée se divise en trois espaces distincts. Le premier au centre, reste un espace libre de déambulation où un espace vidéo est consacré à l’histoire du lieu et de l’association Arc-en-Rêve (centre qui met en valeur l’architecture contemporaine). Le deuxième expose une œuvre participative dans laquelle le visiteur peut laisser s’il le souhaite des avis sur une thématique ou sur le CAPC. Et enfin l’espace de billetterie/librairie fait la liaison entre l’entrée et les espaces d’expositions.
La mise en valeur d’une réflexion et d’une organisation de ces espaces d’accueils offre un véritable intérêt muséographique pour les institutions culturelles. Leur aménagement témoigne de l’attention que donne le musée en question à l’accueil des publics. De plus, proposer des espaces tels que des salons de réflexions, lieux d’échanges ou d’appréhension des collections dès l’entrée introduit de manière significative l’expérience de visite.
Anaïs
#accueils
#musées
#publics

Lire sur les murs
Souvent, durant mes visites de musées, je ressens une certaine frustration devant un élément particulier des expositions. Je vous laisse deviner : je regarde les vitrines, et finis souvent par éprouver une gêne dans le cou que l’on peut sentir à force de trop tourner la tête… Vous ne voyez pas ?
Rappelez-vous, vous êtes devant ce magnifique objet en cuivre taillé (ou cette intrigante photographie argentique dans un cadre, chacun ses goûts) et vous aimeriez en connaître les détails, alors vous cherchez autour de vous des informations. Vous trouvez le cartel : avec un peu de chance, il se situe à moins d’un mètre de vous. Avec moins de chance, vous faites quelques pas pour aller le lire. Manque de chance, arrivé devant celui-ci, vous avez déjà oublié le numéro que portait votre Graal. Vous avez beau regarder les descriptions, espérant en trouver une qui corresponde à l’objet, vous ne savez pas faire la différence entre une fibule et une broche. Alors vous revenez vers votre objet. Ah oui, numéro 35. Vous retournez vers le cartel. C’est donc une fibule, en cuivre, du IIe siècle avant Jésus Christ. Vous retournez contempler l’objet. Attendez, c’était avant ou après Jésus Christ ?
On a tous connu un moment comme celui-ci. Voire plusieurs. Des moments où les cartels étaient à plusieurs mètres de l’objet (vous avez probablement vos propres exemples). Voire des moments où les objets en vitrine ne portaient pas de numéros, et où, après avoir parcouru la vingtaine de cartels délicatement apposés en bas de celle-ci, vous avez abandonné. Et encore, je ne vous parle pas du cartel placé trop haut, ou trop bas.
Celui-ci n'est pas assez informatif, celui-ci trop détaillé. Celui-ci trop haut, celui-ci trop bas. Celui-ci écrit trop petit, celui-ci est… où est-il enfin ? Sûrement plus loin, là où il ne gênera pas le regard du visiteur. Pourtant le visiteur attend souvent des ressources qu’il ne trouve pas toujours. Et à part directement à côté de l’expôt, peu d’emplacements ont grâce à mes yeux.
Récemment, j’ai visité un musée d’ethnographie, j’ai pu relever trois dispositifs pour se repérer parmi les expôts. Il ne s’agit pas ici de dispenser des conseils techniques, d’autant plus que les contraintes qui pèsent sur la disposition des cartels sont différentes selon les lieux et les types d’expôts. Il s’agit plutôt de pointer ce que j’ai trouvé de positif dans ma visite.
- Celui qui mentionne où regarder
Pas renversant, mais c’est plus simple quand on sait si l’on doit regarder en haut ou en bas, à gauche ou à droite.
- Celui qui trône fièrement au milieu de la vitrine
 Musée de Normandie @NP
Musée de Normandie @NP
Ou qui « veille » sur les expôts, à vous de voir.
- Celui qui est un peu plus que du texte
Il est aussi un schéma explicatif qui reconstitue ce que vous avez sous les yeux. Plusieurs expôts composent la vitrine, et ils sont difficilement séparables : j’ai retrouvé ce procédé plusieurs fois pour des collections archéologiques, il permet de saisir entièrement la vitrine ou l’assemblage d’expôts en regardant le cartel. Très pédagogique, c’est celui que je trouve le plus ingénieux, et le plus pensé pour le public.
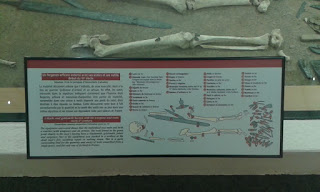 Musée de Normandie@NP
Musée de Normandie@NP
Mais il y a bien sûr plein d’autres solutions intéressantes et qui aident le confort de visite, quelles sont les vôtres ?
NP
#Cartel
#visite
#texte

Luminopolis, au cœur de la lumière
Bienvenue à toi voyageuse ! Te voici à Luminopolis !
Heureusement tu n'es pas seule, avec ton équipe, il te faudra répondre à un certain nombre d'énigmes pour pouvoir sortir de la Cité des lumières, car une fois que tu as mis un pied dedans, soit la lumière du jour tu reverras, soit des nouveaux amis tu te feras... Réponds aux énigmes et trouve l'énigme cachée si tu veux faire partie des grands vainqueurs ! Attention tu as une heure.
Une heure pour valider les mots mystères, une heure pour montrer que les rats ne te font pas peur, et une heure pour ne te prendre aucun un coup de jus ? Et une autre heure ou 2 minutes selon tes dons d'observation pour l'énigme mystère.
Luminopolis est une exposition en mode escape game qui a lieu au Quai des Savoirs à Toulouse. Cette exposition a été produite par Cap Sciences à Bordeaux.
Sauras-tu percer les mystères de la Cité des lumières ?
Entrée de l'exposition © C. Camarella
Le médiateur de la Cité des lumières t'invite à te réunir en équipe, puis choisir un parcours.
Avec tes amis, tu as le choix entre le parcours lumineux, le parcours éclatant ou le parcours flamboyant.
Selon le parcours choisi, il y a entre 10 et 18 énigmes à résoudre, et de 1 à 5 erreurs possibles. Soit vos erreurs sont pardonnées soit l'erreur est fatale ! Vous pourrez, une fois partie à la conquête de la lumière dans le parcours, choisir de répondre à des énigmes difficiles, (cela rapporte plus de points).
Selon ton score, ton équipe sera affichée sur le grand écran, là au choix tu pourras partir la tête basse ou alors t'exclamer haut et fort de ta réussite ! Tout en restant modeste bien sûr.
Après avoir choisi tes brillants coéquipiers, le médiateur, maître de Luminopolis et savant transmetteur de lumière te donne une plaquette qu'il faut disposer sur un scan à chaque dispositif pour lancer l'énigme. Il s'agit toujours de trouver un seul mot, pas de mot composé ni d'expression de plusieurs mots. Ces mots sont en rapport avec la lumière, nous sommes à Luminopolis quand même !
Vous l'avez bien compris, ceci est un escape game, pas d'échappatoire.
Dispositif avec oeillères © C. Camarella
Méfiez-vous des savants transmetteurs de lumière, ils pourront vous donner des indices...ou alors ajouter des réponses fausses si vous oubliez de désactiver la borne pour rentrer les mots trouvés aux énigmes. Et oui maintenant qu'ils ont rassemblé toutes les connaissances sur la lumière, ils ont certainement envie de distraction. Restez méfiants et toujours un œil sur le chrono, la lumière se propage vite.
Dispositif pour constater différentes déformations © C. Camarella
Les énigmes sont accessibles à tous. Sur un même dispositif, il peut y avoir 3 mots lumineux à trouver ou 1 mot flamboyant. Ensuite, il faudra rentrer ces réponses sur une borne noire avant que l'heure s'écoule. Ici, l'erreur peut être fatale. N'oublie surtout pas de déconnecter ta plaque sinon un des savants transmetteurs de lumière s'empressera d'y inscrire une fausse réponse pour te faire perdre ! Et d'autres voyageurs prêts à tout pourront y trouver leurs réponses manquantes.
Borne fatale où écrire les réponses aux énigmes © C. Camarella
Nous sommes une équipe de 3 pour tenter l'aventure, le contenu est accessible selon les niveaux. Les différents niveaux sont bien équilibrés et les dispositifs très variés. Au début, nous avons été désorientés par le parcours, les visiteurs peuvent suivre le chemin qu'ils souhaitent, et si tu fais comme nous et que tu veux commencer par la sortie par mégarde (nous les rats, ça nous fait pas peur !), un médiateur t'avertira à la hâte qu'il vaut mieux faire les énigmes pour avoir une chance de sortir ! Les médiateurs sont bienveillants, et jouent le jeu pour embarquer le visiteur dans l'aventure. Même si tu veux essayer une énigme difficile et que tu es bloqué, n'aies crainte tu ne resteras pas enfermé jusqu'à demain matin, quelqu'un viendra t'aider pour résoudre l'énigme et t'expliquera en te délivrant du contenu. C'est une manière ludique qui plaît, le Quai des savoirs accueille beaucoup de visiteurs grâce à ce concept d'escape game. Apprendre en s'amusant ce n'est pas que pour les petits. L'escape game permet à tout le monde y compris aux adultes, de se défier et de se prendre au jeu tout en acquérant mine de rien du contenu. Le jeu pour apprendre, c'est prouvé, ça marche. Cela nous a remis en mémoire plusieurs mots et explications que nous avions appris pendant nos études et oubliées depuis. Le timer et les points nous motivent, c'est un challenge d'équipe, voire personnel lorsque tu te retrouves à regarder tous les recoins du tunnel lumineux.
Manipes dans l'espace d'exposition © C. Camarella
Une des manipes, niveau flamboyant, consiste à replacer des aimants sur les heures d'une journée pour recréer le rythme circadien de ton corps. Sais-tu ce qu'est le rythme circadien ?
Tu pourras le comprendre grâce à des questions comme : Quelle est la température corporelle la plus basse ? A quel moment de la journée la pression artérielle est-elle la plus élevée ? A quel moment dors-tu en sommeil profond et à quelle heure de la journée atteints-tu ton éveil maximal ? Pour répondre à cette question, c'est à 10 heure, ne vous étonnez donc pas de ne pas être totalement réveillé avant cette horaire précise. C'est donc pour cela que les personnes qui vivent dans les pôles peuvent être en mauvaise forme, celles-ci peuvent maintenant faire de la luminothérapie pour pouvoir palier le manque de lumière qui régule le corps. Lorsque tu as trouvé la réponse à l'énigme et que tu enlèveras ta plaque, les aimants tomberont.
L'énigme mystère à trouver dans le tunnel lumineux © C. Camarella
Challenge d'équipe, ou challenge personnel avec cette énigme mystère ? Certaines voyageuses de mon équipe n'ont rien lâché. Au bout de 45 minutes, et quelques indices des maîtres de Luminopolis, nous avons trouvé la réponse à cette énigme et pu retrouver la lumière du jour en paix.
Pourquoi on a aimé ?
Pendant l'instant d'une heure, nous avons joué le jeu et nous nous sommes immergées dans la Cité de Luminopolis. Les médiateurs nous font des blagues, tentent de nous induire en erreur si l'énigme est trop facile, mais nous viennent en aide lorsque cela devient compliqué. Pendant une heure, nous discutons d'un seul sujet, la lumière. Pour se couper du monde extérieur et espérer ne pas réellement finir dans la cave avec les rats, c'est réussi. Le complément de contenu ajouté lorsqu'ils nous expliquent des énigmes que nous ne comprenons pas nous aide énormément à acquérir des nouvelles notions. Les manipes sont claires, accessibles et variées. Il y a des accessoires à utiliser pour trouver les mots, mais aussi de la VR pour s'immiscer complètement. La scénographie permet de nous plonger dans l'expérience, les jeux de lumières y participent également. Les manipes sont bien organisées dans l'espace avec des coins à dénicher à notre niveau mais aussi en dirigeant notre regard vers le haut. Nous aurions beaucoup aimé pouvoir faire un 2e round, car en une heure nous n'avons pas le temps de faire toutes les énigmes. Nous attendons avec impatience de savoir si l'exposition itinèrera dans un autre lieu !
Hé Jami un « Escape Game », c’est quoi et ça vient d’où ?
Avant de devenir IRL (in real life), l'escape game prend sa source des jeux vidéos où le but était de pouvoir s'échapper d'un endroit. Les premiers jeux vidéo d'évasion connus ont été conçu par Toshimitsu Takagi dès 2005.
C'est pourquoi, ce concept s'est d'abord développé en « Escape room » pour s'échapper d'une salle ou d'un bâtiment avant de se développer davantage. Les « Escape room » se trouve dans des lieux dédiés au jeu avant d'entrer dans les musées, les châteaux, les zoos...
Les escape games se sont d'abord développés en Asie avant de s'étendre à l'Europe.
L'idée est la même, cependant en Asie les escape games sont davantage dans un esprit de compétition tandis qu'en Europe c'est l'expérience immersive qui est mise en avant.
En français, nous dirions « jeu d'évasion réel » ou grandeur nature. Sous la forme de séance qui dure généralement une heure, des joueurs, souvent en équipe, sont immergés dans un environnement particulier comme une reconstitution d'un bateau, ou une contextualisation des années 80... A partir d'un scénario écrit, les joueurs doivent collaborer pour pouvoir sortir de l'endroit où ils sont enfermés. Des indices ou mini-jeux permettront de trouver généralement un code, un objet, la solution d'une enquête pour pouvoir sortir. Un maître du jeu surveille la partie pour donner éventuellement des indices si l'équipe a du mal.
Les escape games débarquent en France vers 2013.
Depuis peu, de plus en plus d'Escape Game apparaissent dans les lieux culturels ou institutions. D'ailleurs, les escape games auraient investi d'abord les lieux culturels avant d'être pensé le concept d'une exposition. Les game designers sont appelés à investir le Louvre, l'Opéra Garnier ou encore La Monnaie de Paris, dans le but de proposer aux visiteurs une expérience interactive. Ce n'est plus du simple divertissement, c'est l'occasion pour le musée de faire connaître ses lieux secrets, ses collections, les coulisses d'habitude impénétrables, et surtout un moyen de raviver la flamme avec ces visiteurs...
Le must : ce n'est pas que pour les enfants ou les gamers, et peu importe ton niveau !
Affiche de l'exposition Inside, Palais de Tokyo © site internet Club innovation culture
Un des précurseurs de ce concept en France au niveau artistique serait le Palais de Tokyo. En 2014, le Palais de Tokyo propose une exposition Inside, qui explore le thème de l'enfermement, où l'artiste Valia Fetisov propose une installation, Installation of Experience. Le visiteur se retrouve enfermé seul dans une pièce vide sans indication. La solution se trouve en lui même. Le game master (un médiateur) attendra une heure pour venir en aide au visiteur si celui-ci ne parvient pas à trouver la réponse.
Luminopolis, exposition au Quai des savoirs, Toulouse © C. Camarella
Tu veux participer ? L'aventure Luminopolis fermera ses portes au Quai des Savoirs à Toulouse le 1er septembre 2019.
N'hésites pas !
C. Camarella
#escapegame
#Luminopolis
#Quaidessavoirs
Pour en savoir plus :
- https://www.quaidessavoirs.fr/la-grande-expo#/?_k=p1xycw
- http://www.club-innovation-culture.fr/tour-du-monde-escape-games-culture-science-patrimonial/
Maisons-musées d'artistes : show just go on ?
D’Alexandre Pouchkine à Elvis Presley, visitez les maisons-musées autrement
Les maisons-musées d’artistes sont aujourd’hui très populaires. Qu’on soit un amoureux de peinture, de littérature, de théâtre ou de musique, ces formes d’expositions permettent non seulement de redécouvrir les œuvres d’artistes majeurs, mais le plus souvent de plonger le visiteur dans l’intimité d’une idole, dans le contexte de l’Histoire.
Etudions trois cas précis : l’appartement-musée d’Alexandre Pouchkine à Saint-Pétersbourg (Russie), la maison de Claude Monet à Giverny (France) et enfin, la maison d’Elvis Presley, à Memphis (États-Unis) et découvrons ce qui fait l’exception de ces lieux !
Alexandre Pouchkine : le cas russe
Au cœur de la ville de Saint-Pétersbourg, situé sur les quais de la Moïka, l’appartement du poète Alexandre Pouchkine se visite depuis 1999. Aussi bien prisé des touristes que des Russes, cet appartement est en réalité celui où le poète vécut ses derniers instants, de 1836 à 1837, soit le jour du duel qui lui coûta la vie. Déjà avant son décès, il était estimé comme le plus grand écrivain russe de son siècle. Sa mort le métamorphosa en véritable légende.
Notons que l’intérieur a été précieusement reconstitué. Précieusement, voire excessivement : une véritable volonté de présentation brute, aussi fidèle que possible d’une demeure dite noble des années 1830. Le visiteur est invité à déambuler dans les différentes pièces de l’appartement, recréées avec les objets du quotidien de l’artiste et de son époque, mais aussi des gravures, des copies de manuscrits et, évidemment, des bibliothèques débordantes de livres (environ 4 000) dans les 14 langues que le poète maitrisait. Ceci jusqu’au fameux et non moins légendaire cabinet de travail, où l’on peut découvrir la lettre -que Pouchkine écrivit en français- qui fut à l'origine du duel qui lui fut fatal. Comme figé dans le temps, l’appartement se visite différemment, au point même de porter des sur-chaussons, à placer par-dessus les semelles de ses chaussures.
Cette visite sera qualifiée d’indispensable pour les amoureux de la littérature, les fans déjà conquis.
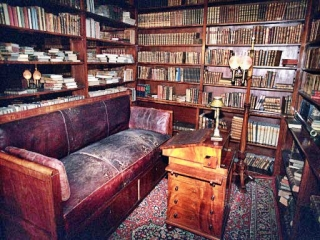
Cabinet de travail © Franchet, culture-libre.org
Claude Monet : une renommée internationale au cœur d’un village français
Domaine inscrit aux Monuments Historiques, Giverny, petite bourgade de l’Eure, fait la renommée internationale des jardins et de la maison du peintre Claude Monet. Les chiffres l’attestent : avec une moyenne de 627 000 visiteurs en 2014, par exemple.

Giverny © Fondation Monet
Tout comme le cas de l’appartement-musée d’Alexandre Pouchkine, la maison-musée de Claude Monet a pour volonté de restituer l’univers temporel dans lequel vivait l’artiste. Soulignons la particularité : les visites se déroulent non seulement dans la maison, mais aussi dans les jardins. La maison reste sur le même modèle que le cas Pouchkine : les visiteurs naviguent dans les pièces du rez-de-chaussée, en apercevant la cuisine, la salle-à-manger et sa collection d’estampes japonaises, les salons, pour ensuite accoster à l’étage pour y trouver les chambres et appartements privés du peintre. Le tout évidemment agrémenté d’objets personnels de l’artiste, marquant le contexte et les mœurs de son temps. Les jardins occupent cependant le premier rôle : il s’agit là d’une véritable attraction, aussi bien pour les locaux que les touristes. Qui ne connait pas les Nymphéas et leur fameux pont vert japonais traversant un bassin, à toute heure du jour, à toute saison ? C’est ce passage des saisons et de la lumière si chers à Monet qui fait la vie du lieu.

Cuisine familiale © Danièle Nguyen Duc Long
Giverny, au-delà du simple plongeon dans l’univers historique du peintre, est une véritable invitation au voyage au plus profond de l’intimité de son propriétaire, mais aussi de ses inspirations.

Le Pont Japonais © Fondation Monet
Graceland : the show must go on
Graceland est le manoir du compositeur-interprète Elvis Presley, légende du Rock’n’roll devenu une des icônes culturelles majeures du XXe siècle.

Elvis in Graceland © Michael Ochs Archivs/Corbis
En 2012, pour le 35ème anniversaire de sa mort, le site officiel de l’artiste annonçait le milliard de vente d’albums atteint. Mais, et surtout, sa maison de Memphis, dans le Tennessee, est devenu un véritable lieu de pèlerinage : le nombre de visiteurs varie de 600 000 à 700 000 par an. Ouverte au public depuis 1982, Graceland a accueilli quelque 15 millions de personnes. Contrairement aux maisons-musées précédentes, ce lieu ne désire pas reconstituer un intérieur, mais plutôt de le conserver tel une relique. A la mort d’Elvis Presley en 77, l’intérieur du manoir était déjà comme exposé. Il a simplement fallu pousser quelques meubles pour créer une allée de visite. Autre particularité notable, le meditation garden (jardin des méditations) : tous les Presley, le King inclus, sont enterrés au fond du jardin de la propriété. Graceland se place donc au-delà de la maison-musée pour devenir un véritable lieu de « pèlerinage ».

Grand Salon © Franck Parisel
En refusant de s’envisager comme les musées habituels, ce temple d’Elvis propose en annexe un espace d’exposition (The Entertainer Career Museum) dédié aux lubies de l’artiste, spécialement créé pour exhiber ses instruments, ses costumes de scène, ou encore les quelques 14 voitures, dizaine de motos, avion et jet privé que « Le King » possédait. Vous voilà transportés…

Elvis’ costumes © Elvis Presley Enterprises, Inc
Maisons-musées : lieux sacrés ?
Du lieu éducatif et commémoratif au véritable pèlerinage, ces maisons-musées varient par leurs approches culturelles, mais conservent toutes un point commun : la sacralisation de l’artiste et la recherche d’authenticité.
Une sacralisation qui se remarque par l’approche analogique commune aux trois lieux remarqués : l’esprit de formolisation. La maison, lieu de vie privé où l’artiste adulé se trouve à l’abri des regards extérieurs, devient alors un musée, lieu ouvert au public. Une intimité sacralisée où le visiteur est invité à entrer.
De Saint-Pétersbourg à Memphis, cette sacralité s’incarne en fonction de l’approche culturelle du pays de l’artiste : l’intelligence et la sensibilité d’Alexandre Pouchkine, l’émotion de l’homme inspiré qu’était Claude Monet, et enfin la bête de scène, le show dramatique sur-joué à l’américaine qu’incarne le souvenir d’Elvis Presley…
Julia Parisel
#artistes
#maisonsmusées
#homesweethome
Pour en savoir plus :
Fondation Claude MonetGraceland, Home of Elvis Presley
Musée des Illusions : un musée qui porte bien son nom ?
Faux musée, attrape touriste, fastfood de la culture, arnaque… Bien des surnoms me viennent en tête après avoir visité le Musée des illusions, mais je ne le qualifierais surement pas de musée.
Photo du parcours de visite ©A.S.
Un nom plus que discutable
Selon la nouvelle définition de l’ICOM parue en août 2022, “Un musée est une institution permanente, à but non lucratif et au service de la société, qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l’interprétation et l’exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. Les musées opèrent et communiquent de manière éthique et professionnelle, avec la participation de diverses communautés. Ils offrent à leurs publics des expériences variées d’éducation, de divertissement, de réflexion et de partage de connaissances. » L’autoproclamé « Musée » des illusions imite la structure muséale dans sa forme : une billetterie, un parcours de visite, des cartels, une boutique… mais en vérité, il est bien loin d’un musée tel qu’il est défini aujourd’hui.

Photo du parcours de visite ©A.S.
Faisons la liste :
- il n’y a pas de collection, il n’y a donc aucune mission de conservation ou valorisation.
- s’il donne à voir des illusions, les explications sont très limitées voire inexistantes donc le rôle éducatif est presque réduit à néant.
- ils (au pluriel) n’existent qu’à but lucratif !
De la définition du musée, ne reste que le divertissement. Nous pouvons alors nous demander : quelle différence avec une simple attraction touristique ? Aucune. Il existe uniquement pour des raisons lucratives. Et ce à travers le monde.
Un champ de franchises fleurissant
Il s’agit en effet d’une franchise qui pollue le paysage culturel de nombreux pays et de nombreuses villes. Il suffit d’observer la liste sur leur site.

Capture d’écran du site du musée montrant toutes les localisations
Il en existe un dans toutes ces villes :
Athènes, Belgrade, Bruxelles, Budapest, Busan, Le Caire (cairo), Dallas, Doha, Dubai, Hambourg, Istanboul Istiklal et Anatolia, Kansa City, Kuala Lumpur, Lyon, Maastricht, Madrid, Milan, New Delhi, New York, Orlando, Paris, Philadelphie, Riyadh, Seville, Shanghai, Stuttgart, Split, Taichung, Tbilisi, Tel Aviv, Thessaloniki, Toronto, Vienne, Zadar, Zagreb
S’ajoutent à la liste ces derniers qui sont en cours de création :
Atlanta, Austin, Boston, Charlotte, Chicago, Denver, Dublin, Dubrovnik, Houston, Las Vegas, London, Mall of America, Manchester, Marseille, Melbourne, Montréal, Nashville, Rome, San Diego, Scottsdale, Seattle, Sydney, Valence, Washington
Comment ça marche ? Pour la maudite somme de 40 000€ vous pourriez ouvrir un musée des illusions, avec un business plan tout prêt établi. Par la suite il suffit de reverser mensuellement 15% des recettes au propriétaire du concept. Les tarifs d’entrée compris entre 12 euros pour les enfants et 18 euros pour les adultes en font un investissement particulièrement rentable.

Photo du parcours de visite ©A.S.
Il suffit de trouver le lieu, même s’il n’est pas propice apparemment. C’est du moins le cas de la version parisienne qui se déroule sur deux étages particulièrement étroits. Les tranches horaires de visites sont en théorie instaurées pour garantir un confort de visite en limitant le nombre d’entrées selon la capacité d’accueil. Mais malgré cela, la circulation est compliquée. Il est presque impossible de suivre le parcours de visite tel qu’il a été pensé sans avoir l’impression de faire constamment la queue. Serait-ce une simple stratégie marketing pour créer la demande ?
Un contenu creux

Photo de « cartels » ©A.S.
Le sujet de l’illusion semble pourtant aux yeux des muséographes être du pain béni puisqu’il est propice à l’implication physique du visiteur et de ses sens. Il permet d’aborder les lois de la physique, la logique d’espace ou encore les neurosciences et l’optique. Ici, toutes les « explications » ne font que décrire l’observable, restent à l’effleurement de la surface.


Photo d’expôt ©A.S.
Les effets d’illusions sont encadrés et accrochés comme des tableaux accompagnés de simples cartels écrits mais pauvres en contenu. À travers tout le parcours, seul un schéma permet d’aller un peu plus loin dans le contenu mais celui-ci est peu alléchant. Trop scientifique, trop complexe, trop long, les visiteurs passent sans le lire.

Photo des manipes ©A.S.
En guise de manip, trois petits casse-têtes sont laissés à disposition sur une table sans explication. L'utilité de ces derniers est-elle de faire comprendre un mécanisme, de transmettre une idée ou un contenu ? Non. Leur seule utilité est de donner envie de les acheter dans la boutique en sortant.

Photo des manipes ©A.S.
Ce qui captive le plus le public dans ce lieu sont les espaces photo qui ponctuent la visite. A chaque fois, il est possible de se mettre en scène de façon différente et de se prendre en photo. Certaines mises en scène présentent un intérêt scientifique qui n’est nullement exploité (encore une fois) et d’autres ont pour seul but de faire une photo rigolote.
Le musée des illusions, s’il donne l’illusion d’un musée, n’en est véritablement pas un. Il n’en a ni les missions, ni les intentions. La critique principale exprimée ici concerne le flou créé par l’appellation « musée ». Ce mot évoque un ensemble de choses au visiteur qui ne sont pas applicables dans ce lieu. Et ce lieu, à défaut d’être le lieu de culture, comme il tente de le suggérer, est simplement un lieu de divertissement et de consommation.
Aimé Sonveau
Pour en savoir plus :
- Si vous souhaitez prendre un billet : https://museedelillusion.fr/
- Si vous souhaitez ouvrir votre propre « Musée des illusions » : https://www.museumofillusions.com/
#illusions #photo #arnaque
Musée en tous sens !
J’ai visité l’exposition « corps rebelles » au musée des confluences de Lyon. Afin de favoriser l’immersion du visiteur dans l’univers de la danse,le son prenait une place importante : dès l’entrée où se font entendre des bruissements de vêtements, des battements de cœurs, des mouvements de corps. Tout du long, l’ouïe est sollicitée par la musique sur laquelle se déplacent les danseurs, les paroles qu’ils prononcent sur leur pratique, ou les bruits qui émanent de leurs danses. Cette immersion est d’autant plus importante que chaque visiteur porte un casque.
Visuel de l'Exposition Corps rebelles © Jessy Bernier
Jouer sur les différents sens, offrir une nouvelle expérience au visiteur, mobilisant différentes sensations et émotions cela est à mon sens primordial dans l’exposition. La vue est le sens le plus monopolisé au musée. Le public voit les œuvres, lis les cartels, regarde les détails d’un objet, etc. Quelques musées proposent des expériences où l’on coupe ce sens afin d’utiliser les autres, mais cela est très rare, et le musée est avant tout un lieu visuel où le public vient pour « voir » des choses. La scénographie prend alors une place importante afin de mettre en valeur les objets, en les surélevant, les encadrant, les contextualisant, etc. Dans les musées de beaux-arts notamment l’expérience du beau est essentielle, un soin particulier est donc accordé à la mise en spectacle de l’objet. Mais aujourd’hui, le visuel n’est plus le principal sens sollicité au musée, ainsi d’autres éléments apparaissent dans la scénographie tel que la sonographie.
Le musée dans l’imaginaire commun est encore perçu comme un lieu de silence, dans lequel il faut rester calme et ne pas faire de bruit. Faire entrer l’ouïe au musée n’est donc pas chose commune. C’est d’ailleurs ce que précise Cécile Corbel dans son introduction à un article sur le son au musée : « Avant toute chose, je voudrais dire que j’ai trouvé « amusant » — certains diront décourageant — lorsque je faisais part de mon sujet à mes connaissances — dont des amis musiciens — de constater leur étonnement, voire leur incompréhension, quant au rapprochement des sons et de l’univers du musée »[1].
Cette démarche non évidente existe pourtant. Ainsi le son fait son apparition de manière individuelle avec les audio-guides, qui sonorisent le discours du musée. On peut aussi le trouver comme objet des collections avec par exemple la diffusion d’extraits de musique dans l’exposition. Au musée Dauphinois de Grenoble pour l’exposition Nunavik, un chant de gorge inuit était diffusé pour illustrer la pratique de ce peuple, ce chant créait aussi une ambiance sonore puisqu’il s’entendait avant d’apprendre à quoi il correspondait. L’utilisation du son comme créateur d’ambiance est un autre usage. L’ouïe est beaucoup utilisée dans les musées, bien que sa sollicitation ne soit pas évidente, le brouillage entre pistes sonores étant à éviter. Les dispositifs travaillant ce sens sont trèsintéressant car ils posent plusieurs questions. Lorsque l’on déclenche un dispositif manuellement que d’autres visiteurs peuvent entendre, ne va--ton pas les gêner ? Le son peut être invasif. Il est certes possible d’utiliser des dispositifs individuels, à ce moment-là la coupure avec les autres est plus nette. Les dispositifs avec casques ferment aux autres, ils recentrent sur lemusée, permettent l’immersion dans l’exposition mais plus l’interaction avec les autres visiteurs, ce que je trouvais dommage dans l’exposition « corps rebelle ». Il y a alors la solution des douches sonores qui ne transmettent pas le bruit à tout le monde mais qui permettent d’avoir des dispositifs individuels sans se couper des autres.
Le toucher est sûrement le 3ème sens le plus utilisé, surtout aujourd’hui avec l’apparition des écrans tactiles qui permettent plus de médiation active. A une époque le visiteur pouvait toucher à sa guise les objets des cabinets de curiosité et musée, mais les dernières années on fait des objets muséographies des objets saints, alors « prière de ne pas toucher ». De nouvelles médiations proposent de faire d’objets de collection des objets de médiation. Et de plus en plus de reproductions sont tendues aux mains des publics dans les visites. Certains musées font même pied de nez à toutes les autres institutions comme au musée de Tinguely qui propose l’exposition PRIÈRE DE TOUCHER.
Visuel de l'exposition Prière de toucher © Musée de Tinguely
Par convention le visiteur est éduqué à ne pas toucher dans le musée, même si l’envie de transgression est forte, il faut souvent indiquer la possibilité de le faire pour que le visiteur se permette d’apposer sa main sur les objets exposés. On notera qu’en dehors des dispositifs de médiation pour des publics particuliers : handicap visuel, enfant, etc., le musée a tendance à être un lieu où il faut mieux garder ses mains dans ses poches.
Enfin l’odorat et le goût sont des sens peu mobilisées dans le musée. Pourtant il existe des médiations gustatives et olfactives, mais très rare. Ces sens peuvent être au cœur de l’exposition comme lors de l’exposition Gourmandises ! – Histoire de la gastronomie à Lyon,sans pour autant être mobilisés. Des dispositifs permanents faisant appel à ces sens sont trop contraignants, et ils sont surtout une histoire de médiation ponctuelle, par exemple au musée portuaire de Dunkerque pour l’exposition Banane, un atelier de confection de cake avec ce fruit était proposé en médiation pour les enfants.
Bananes suscitant le goût pour l’exposition Banane © Musée portuaire de Dunkerque
Ces médiations peuvent être nommée visite sensorielle, comme au musée de La Piscine à Roubaix[2].
Les 5 sens sont donc beaucoup sollicités en médiation, peu de collections font appel à l’odorat et le goût, bien certains objets liés à ces sens soient inscrits dans notre patrimoine, comme le patrimoine gastronomique français. Il est déjà difficile de mettre en place des dispositifs faisant appel aux autres sens. Les enceintes des dispositif audio finissent par grésiller, les objets donnés au toucher s’abiment, les odeurs s’évanouissent et les aliments sont périssables. Cela nécessite donc beaucoup de contraintes, et de maintenance, mais cela n’est-il pas plus intéressant de favoriser le multi sensoriel pour que le visiteur bénéficie d’une expérience de visite optimale ?
C’est un sujet large que les 5 sens au musée, pour satisfaire au mieux la soif de connaissance sur ce qui a pu être fait, les articles du magazine de L’art de muser ont de quoi vous nourrir :
Quenelles, grattons, bugnes et autres spécialités des bouchons à l'honneur : médiation gustative
La Maison-Musée Hector-Berlioz: à voir et à entendre : médiation auditive
L'alimentarium de Vevey, un musée vivant pour explorer notre alimentationL'alimentarium de Vevey, un musée vivant pour explorer notre alimentation : médiation gustative
Un audio-guide au cœur des oeuvres
Mmmmmmmh! : médiation gustative
Au musée de Flandre de Cassel, "cette oeuvre est à toucher"
Touchez la musique!" Lancez vous dans le parcours du musée de la musique.: médiation auditive
Au musée j'ai touché...!Au musée j'ai touché...! : médiation tactile
La Nuit met nos sens en éveil! : multisensoriel
Faire l'expérience de la conservation-restauration à l'Ashmolean Museum d'Oxford : médiation tactile
La Piscine, championne de médiation : médiation olfactive
Océane De Souza
Le Musée de Tinguely propose des expositions basées sur les 5 sens.
Les médiations gustatives ou l’art de la mise en bouche. Emmanuelle Lambert : complément sur la médiation gustative
#5sens
#Médiation
#Rétrospective
[1] Cécile Corbel, « L’intégration du sonore au musée », Cahiers d’ethnomusicologie [Enligne], 16 | 2003, mis en ligne le 16 janvier 2012, consulté le 03 janvier 2017. URL : http://ethnomusicologie.revues.org/571
[2] A ce propos : http://lartdemuser.blogspot.fr/2012/10/la-piscine-championne-de-mediation.html?q=la+piscine

Musées, devenez vivants !
En période de second confinement en France, les conférences en lignes se multiplient. Elles viennent pleinement nourrir la réflexion sur ce qu’est un musée. La séance De quoi le musée est-il le nom ? proposée par l’ICOM ou les lives du Musée de l’immigration, sont des ressources très intéressantes qui donnent de l’espoir pour faire évoluer l’image des musées. Dans ces conférences, de nombreux acteurs tentent d’apporter des clés pour cette future définition.
En parallèle des débats en ligne, depuis plus d’un an, avec le master nous parcourons différentes intuitions culturelles et scientifiques pour découvrir comment certains professionnels travaillent. Du Palais des Beaux-Arts de Lille au Préhistomuseum à Liège, ces visites nourrissent aussi la réflexion sur ce que pourrait être les lieux culturels de demain.
Quelle place pour l’actualité dans les musées ?
Les institutions culturelles doivent se positionner face aux actualités et disfonctionnements de notre société, même si j’entends souvent que l’engagement, les actualités politiques n’ont pas leur place dans les musées. Certaines visites m’ont permis de penser que cette affirmation est fausse, notamment celle au Préhistomuseum où le discours porté dans les salles est engagé et montre qu’un discours n’est jamais neutre car il écrit soit par une personne ou un groupe.

Capture d’écran sur le site du Prehistomuseum, Janvier 2021, ©Prehistomuseum.
Ses actions sont également engagées, dernièrement l’action solidarité sapiens est mise en place pendant la crise sanitaire liée à la covid. En soutien aux soignants belges, pour chaque place achetée par des entreprises, le Préhistomuseum offre des places aux soignants pour qu’ils puissent se ressourcer.
Parallèlement, les propos de Bruno Brulon, en charge du comité pour la nouvelle définition des musées, pendant la soirée-débat ICOM atteste aussi son engagement, en disant :
« Définir le musée est une tâche politique. »
De ce fait, si les musées peuvent participer aux changements sociétaux, il est donc nécessaire qu’ils s’engagent, prennent position, pour favoriser la connaissance et la pluralité des dialogues. Un musée doit être un espace de vie. Même si l’une de ses missions est de conserver et donc de limiter les dégradations des œuvres/objets il doit aussi être un lieu de transmission et d’expression.

Capture d’écran présentation Nathalie Bondil, soirée-débat ICOM, ©AV.
Nathalie Bondil, pendant cette même soirée-débat de l’ICOM met en avant l’intercultulturalisme en proposant d’inclure de nouvelles voix et de décentrer le propos pour mieux repenser les expositions. Ainsi, dans le parcours permanent du Musée des Beaux-Arts de Montréal de nouvelles mises en espaces sont réalisées. Le musée présente passé et enjeux contemporains face à face, ce qui offre un nouveau regard sur les collections. C’est également l’occasion pour l’institution de s’engager pour des causes contemporaines telles que l’écologie.
Dans le live Le Musée part en live #6 organisé par le Musée de l’immigration sur Facebook dédié à la liberté d’expression, Elisabeth Caillet (Fondation Thuram) replace au centre le rôle de la médiation. Pensé comme un outil, il peut être produit et utilisé rapidement, et ne représente pas obligatoirement des investissements colossaux pour les institutions culturelles. Les visites au Musée Delacroix avec Lilian Thuram, ou au Louvre avec Françoise Vergès en 2018, proposent une autre dimension et attribuent un propos aux œuvres d’arts qui font déplacer les foules. Bien plus qu’une visite classique d’histoire de l’art, ils produisent une programmation culturelle en lien avec les acteurs concernées et en lien avec l’actualité intéresse les visiteurs car il implique leurs quotidiens.
Un dialogue pour tous et toutes.
Promouvoir le dialogue au sein du musée et des institutions culturelles est la conclusion forte de la soirée-débat de l’ICOM. Cet élément est déjà présent dans la dernière définition refusée à Kyoto. Il est intéressant de promouvoir cette optique au sein des institutions culturelles, car elles permettent de rendre actif l’espace muséal. En effet, par cette conception, il ne s’agit plus de promouvoir qu’un seul et même discours propre à l’institution. Bien au contraire. Par exemple, les visites organisées par des intervenants extérieurs tels que Feminist in Paris au Musée d’Orsay ou la visite LGBTQ+ au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux participent à la création d’un dialogue entre les visiteurs.
En parallèle des visites orales, les cartels dans le parcours permanent ou dans les expositions peuvent s’inscrire dans cette volonté de dialogue. Récemment, avec le master MEM, nous avons réalisé un workshop en ligne sur la future refonte des cartels du Palais des Beaux-Arts de Lille, qui visait à remettre ces outils scientifiques au service des visiteurs.
Les cartels n’existent pas là simplement pour mettre en lumière les éléments scientifiques tels que le titre, l’artiste ou le numéro d’inventaire. Ils permettent de transmettre une certaine vision de l’œuvre, un savoir.

Cahiers des lissiers, Cité internationale de la tapisserie, Aubusson, ©AV.
Par exemple, à la cité internationale de la tapisserie, lorsque vous découvrez l’espace dédié à ce savoir-faire, des cahiers retraçant les impressions, notes des lissiers vous accompagnent le visiteur dans la découverte de ces œuvres.
Introduire le tutoiement, le jeu, différents niveaux de lectures, à ses supports peuvent rendre ces supports accessibles et rythmer la visite. Par ailleurs, la lecture n’est pas la seule manière de découvrir une œuvre. Plusieurs tentatives pour solliciter les sens ont déjà été réalisées dans certains musées tels qu’au Mucem où des objets tactiles dédiés dans un premier temps aux publics malvoyants, sont pris d’assauts par les publics valides. Au Musée des Arts décoratifs et du design de Bordeaux, pour l’exposition Houselife en 2017 avait valorisé certaines œuvres avec l’odorat. Nombreuses sont les pistes qui restent à exploiter, notamment dans le domaine des Beaux-Arts.
Désacraliser les Musées des Beaux-Arts.
Apprendre ou admirer n’est pas la seule raison pour laquelle le visiteur se déplace dans un musée des Beaux-Arts. Même si personne ne demande et ne souhaite que les Musées des Beaux-Arts deviennent des parcs d’attractions, Disneyland et le Parc Astérix se débrouillent très bien dans ce domaine, l’expérience vécue est tout de même essentielle.
La Piscine à Roubaix ou le Palais des Beaux-Arts de Lille l’ont bien compris. La question des sens est notamment exploitée à la Piscine, pendant le temps de visite vous pouvez être surpris par des cris d’enfants se précipitant à la piscine. Or, aucun enfant à l’horizon ne crie ou ne se précipite dans la piscine. Et ce sont ces petites surprises et décalages qui rendent les visites attrayantes.
Partir du principe que les œuvres ne sont plus la seule motivation de visite est peut-être la clé pour créer de nouvelles habitudes chez les visiteurs. Venir chercher des réponses à l’actualité, à des enjeux économiques, sociaux et culturels contemporains est un axe qu’il ne faut pas évacuer trop vite. Car qui de mieux placé que le musée pour laisser place à la pluralité des voix qui seront le passé de demain.
Anaïs
#Musées
#ICOM
#Muséepartenlive
Pour aller plus loin :
Captation vidéo de la soirée-débat du 26 novembre 2020, De quoi le Musée est-il le nom ?
Captation du débat : Le musée part en live, Liberté de création : la culture à l’épreuve des revendications identitaires ?
Article de Serge Chaumier, « Musées engagez-vous », lettre de l’Ocim, n°187, Janvier-Février 2020.
Image de couverture de l'article : Museum and local development – from Islands to Hubs – The future of Museums ©Lord cultural ressources and Brittany Datchko.

Museo Transpi
Comme l’ont sans doute déjà remarqué nos nombreux abonnés et lecteurs assidus, l’Art de Muser s’adresse en tout point à une cible en particulier : vous, muséophiles en herbe ou muséologues aguerris, amateurs d’art ou experts en histoire de l’art !
Or, à force de nous faire pâlir d’envie avec des visites de musées toujours plus attrayantes, ou des comptes-rendus d’expositions qui inciteraient presque les personnes atteintes du syndrome de Stendhal [1] à vaincre leurs angoisses, ce blog en oublie parfois que certains ne trouvent plus le temps de vaquer à d’autres occupations. Mais rester assis face son écran d’ordinateur pour lire les articles publiés sur ce blog (avouons-le, c’est difficile de s’arrêter une fois que l’on a commencé) n’est pas l’idéal pour se maintenir en forme physiquement.
Sans oublier ces professionnels du secteur, qu’ils soient muséologues ou sociologues reconnus dans le monde entier qui n’hésitent pas à se priver de nourriture, et à sauter des repas dans la journée afin de gagner du temps pour enchaîner des visites à la pelle. (Nous ne citerons pas le nom de ces personnes qui tiennent à rester anonymes). Nous évoquerons plutôt les sportifs, et on sait à quel point ils sont nombreux à nous suivre (si, si !). Peu importe que vous soyez un athlète confirmé, ou un simple sportif du dimanche, vous vous retrouverez forcément dans cet article.
Notre sujet : notre corps, sa dépense au musée !Si vous avez l’immense privilège de vivre à New-York, vous pourrez pratiquer vos séances de yoga au Brooklyn Museum avant d’accéder aux collections de l’institution [2]. Avouons que ce n’est pas donné à tout le monde, hormis si vous êtes l’heureux détenteur d’un jet privé qui vous permettrait de faire l’aller-retour. De manière plus réaliste, pour un Français, l’une des meilleures solutions demeure Paris qui regorge de musées pour tous les goûts, et plus abordables qu’un billet pour New-York. Quoique, « petits budgets », quand nous voyons le prix d’entrée de la majeure partie d’entre eux... Mais là encore, l’éternel débat sur la gratuité dans les musées n’est pas à l’ordre du jour.
Yogaau Brooklyn Museum de New-York © Musée-Oh !
Toutefois, Paris n’est pas à portée de tous, non plus. Et emprunter les transports en commun ne maintient pas la forme physique. Amoins que vous ne vous laissiez tenter par des pompes ou autres exercices d’abdominaux dans le métro, le RER, voire même les escalators à vos risques et périls. Et cela ne préservera pas forcément de faire la queue à l’extérieur des musées, où l’on ne va pas s’adonner à des pratiques sportives, mais à un lent piétinement.
Ah bien heureux les détenteurs de cartes ICOM et autres cartes de guides-conférenciers dispensés des files d’attente ! Une fois à l’intérieur, autant le dire : qui oserait pratiquer des fractionnés ou se servirait d’une corde à sauter au sein d’une salle d’exposition remplie de vitrines ? Si l’on tient compte du fait qu’il est parfois à peine permis de se déplacer librement sous peine de se faire mettre à la porte [3], ou que l’accès peut nous être refusé selon notre tenue vestimentaire [4] ; qui tenterait de faire un footing en tenue de sport dans les locaux d’un musée parisien ?
Alors, si vous ressentez toujours cette furieuse envie de vous dépenser, et que vous avez cette chance immense de vivre dans cette magnifique région que sont les Hauts-de-France (qui rappelons-le tout de même, est la deuxième plus grande région de France en matière de densité de musées par habitant, rien que ça !), nul besoin d’aller bien loin ! En effet, le Musée de Flandre à Cassel a la solution pour vous, et se fera le plaisir de vous proposer une activité mêlant balade en pleine nature, et découverte des collections de ce riche musée à travers une exposition autour de l’art contemporain. Intitulée « A poils et à plumes », cette exposition est programmée jusqu’au 9 juillet 2017 (raison supplémentaire pour vous y rendre au plus vite !)
Affiche de l’exposition "A poils et à plumes"
Musée de Flandre àCassel © Joanna Labussière
Qui l’eut-cru, et par ailleurs me direz-vous, quel est l’intérêt, un dimanche après-midi, de se rendre à une exposition – qui plus est sur l’art contemporain – à laquelle nous craignons de ne pas comprendre grand-chose ? Mais surtout, où est le sport dans tout ça ? L’avantage ici, c’est que cette visite s’adresse à un large public, dans la mesure où vous le verrez par la suite, elle peut être pratiquée autant par les enfants que par les personnes d’âge mûr. La seule condition étant de savoir se servir de ses deux jambes et d’aimer marcher (Marcher avec un grand M).
Concernant l’exposition, inutile d’être doctorant en histoire de l’art, ou spécialiste international de la représentation animale dans l’art contemporain. Qu’on se le dise aussi, les animaux ça plaît aussi bien aux petits qu’aux grands. Enfin, avec les beaux jours qui approchent (si, si on vous assure il y’a parfois du soleil dans le Nord), vous n’aurez plus aucune excuse !
Alors, c’est parti pour cette escapade ! Les amoureux de la nature s’en trouveront d’autant plus comblés. « Du haut de ses 176 mètres, la charmante petite ville de Cassel domine merveilleusement la plaine de Flandre. C'est depuis le sommet du mont Cassel, sur lequel se dresse un joli moulin à vent en bois du XVIIIe siècle, que les promeneurs pourront bénéficier d'une belle vue sur la campagne environnante » [5].
Le Moulin de Cassel ©Samuel Dhote
Et le Musée de Flandre ? « Situé à Cassel, au sommet du mont de Flandrele plus élevé, le musée départemental de Flandre […] favorise le dialogue entre œuvres anciennes et créations contemporaines, de la culture flamande du XVème siècle jusqu’à aujourd’hui, au-delà des frontières. » [6]
Si vous souhaitez profiter pleinement de la balade bucolique, l’idéal pour vous est d’aller en train jusqu’à la gare de Cassel (la surprise sera d’autant plus grande). Jusqu’ici rien de compliqué donc. Si vous avez en plus le privilège de passer par la garede Hazebrouck, vous pourrez vous sustenter au Monop’Station où vous attendent quelques spécialités régionales.
Nous vous recommandons chaudement le beignet chocolat-noisette surgelé « pas piqué des hannetons ». Cet encas vous sera d’autant plus recommandé compte tenu de ce qui vous attend par la suite. Profitez également de votre trajet pour charger votre téléphone parmi les prises disponibles dans votre wagon (en espérant qu’il y en ait), car vous allez avoir besoin de batterie (pas de panique, on y vient).
Une fois le bitume de la gare de Cassel franchi, débute votre périple. Car si vous avez omis de vérifier les informations indiquées sur le site du musée, la gare de Cassel n’est pas située à Cassel même, mais à Bachinvore, à environ une trentaine de minutes du musée. C’est ce qu’indique entout cas l’application Plans pour iPhone, car il faut bien le dire : nul panneau n’indique la direction à prendre pour se rendre au musée depuis la gare.
Qu’à cela ne tienne, après tout, une demi-heure de marche, ce n’est pas la fin du monde ! Excepté quand le GPS ne précise pas que ce musée en question se trouve au sommet du mont de Flandres (si vous avez bien retenu), et qu’il va falloir grimper un minimum. Il ne s’agit pas non plus de l’ascension du Mont-Blanc vous allez me dire, mais c’est tout de même une sacrée surprise. Une surprise tout compte fait des plus agréables tant cette ascension vaut le détour, et vous allez rapidement vous rendre compte pourquoi !
C’est à partir d’ici que votre GPS devient véritablement votre allié le plus précieux ! Il vous suffit simplement de suivre ses indications, et d’emprunter la route goudronnée à votre gauche après avoir quitté la gare. Une fois sur cette route, rien de bien difficile : vous continuez tout droit, en longeant le parking qui se situe sur votre droite. Prenez garde aux véhicules qui circulent si véhicules il y’a, car le trottoir est tout simplement inexistant (on vous aura prévenus). Profitez-en pour admirer les quelques commerces aux alentours, car ce sont les derniers que vous serez amenés à croiser jusqu’à votre destination finale.
Continuez dans la même direction jusqu’à la prochaine intersection, puis tournez à droite. Et là : SURPRISE ! Avouez qu’on vous a bien mis l’eau à la bouche et que ça valait le coup de patienter ! On vous prévient tout de même : inutile de vous attendre à un environnement urbain, et préparez-vous plutôt à atterrir dans un cadre purement rural. Pour vous plonger dans l’ambiance : imaginez-vous en train de vous promener en pleine campagne, sur une route goudronnée séparée par une clôture où s’étend du côté inverse des champs à perte de vue.
© Annaëlle Lecry
Aucun bâtiment à l’horizon, si ce n’est une ou deux bâtisses. Pas à un bruit, à part le bruissement des feuilles caressées délicatement par le doux vent du Nord, et le sifflement mélodieux des oiseaux. Sans parler de cette sublime odeur quasi impossible à décrire telle quelle, mais que vous reconnaîtrez forcément dès lors qu’on évoque la campagne, LA VRAIE Bouffée d’air frais garantie, de quoi réoxygéner vos poumons de citadins contaminés par la pollution. Et si avec un peu de chance, il fait grand beau comme on dit dans le coin, le soleil achèvera de réchauffer votre petit cœur débordant d’euphorie face à tant de magnificence. Avouez que ça fait rêver, et que notre surprise est de taille !
© Annaëlle Lecry
Pour en revenir à l’itinéraire, rien de bien compliqué puisqu’il vous suffira de continuer tout droit. De ce fait, vous n’aurez plus les yeux rivés sur votre smartphone, mais levés au ciel de sorte à pouvoir observer ce paysage unique qui s’offre à vous. Petit plus : le chemin goudronné qui laisse place à un sentier forestier. Une balade en pleine nature qui permet de se déconnecter de la réalité, et en même temps de se reconnecter à soi-même, loin des tumultes de la ville. Léger inconvénient : la montée qui vous attend vous laissera sans doute quelques courbatures le lendemain. Mais cette promenade vous transportera dans un tel état d’euphorie, ajouté à ça les endorphines libérées par votre cerveau.
Fermez les yeux et projetez-vous dans cette atmosphère bucolique emprunte de sérénité. Tentez de mettre vos sens en éveil et laissez venir les émotions qui s’offrent à vous. Non, vous n’êtes pas au cœur d’une séance de médiation, mais la promesse de ces sensations doit bien vous donner une raison supplémentaire de partir à la découverte de la faune et la flore casseloises. Clou du spectacle : l’arrivée à Cassel, avec son architecture flamande pleine de charme, et son panorama. Petit bijou architectural, le Musée de Flandres sera le bouquet final avec sa remarquable collection flamande.
© Annaëlle Lecry
© Joanna Labussière
Si après ces arguments, nous n’arrivons pas à vous convaincre, au moins nous aurons eu le mérite d’avoir essayé. Toujours est-il que vous avez la preuve qu’il est désormais possible de concilier activitéphysique et flânerie muséale. Ne dit-on pas d'ailleurs : pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière et visitez cinq musées par semaine ? Surtout, ne perdez pas de temps car l’exposition « A poils et à plumes » est visible jusqu’au 9 juillet au Musée de Flandre. Exposition présentée dans un autre article que nous vous invitons vivement à lire : http://lartdemuser.blogspot.fr/2017/06/a-cassel-le-cri-sourd-des-animaux.html .
Joanna Labussière
#Sport
#Campagne
#FauneetFlore
#Flandres
#MuséedeCassel
Pouren savoir plus sur le Musée de Flandre de Cassel : http://museedeflandre.lenord.fr/fr/Accueil.aspx
Plusd’informations sur le patrimoine culturel et naturel flamand : http://www.tourisme-nordpasdecalais.fr/Arts-Culture/Patrimoine/Les-paysages-flamands-des-panoramas-a-couper-le-souffle
[1] Syndromede Stendhal – Vulgaris Médical, définition : trouble psychosomatique qui se caractérise par une surcharge d'émotions chez les voyageurs en admiration devant une œuvre d'art (http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/syndrome-de-stendhal).
[2] CASEDAS Claire, [Génial ou Grotesque ?] Suez au musée !, dans Musée-Oh !, publié le 10 mars 2017, [en ligne] : http://musee-oh.museologie.over-blog.com/2017/03/genial-ou-grotesque-suez-au-musee.html
[3] RANC Agathe, Le musée d’Orsay (de nouveau)accusé de discriminer des élèves, dans L’Obs,publié le 8 avril 2017, [en ligne] : http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170408.OBS7755/le-musee-d-orsay-de-nouveau-accuse-de-discriminer-des-eleves.html
[4] ADAOUST Camille, On me traite comme une criminelle, sur FranceInfo, publié le 24 janvier 2017, [en ligne] : http://www.francetvinfo.fr/culture/quand-s-arretera-la-discrimination-une-jeune-femme-gothique-raconte-comment-le-louvre-lui-a-refuse-l-entree-a-cause-de-son-apparence_2033649.html
[5] Cassel – Guide Tourisme & Vacances : http://www.france-voyage.com/tourisme/cassel-1151.htm
[6] Musenor– Cassel, Musée départemental de Flandre : http://www.musenor.com/Les-Musees/Cassel-Musee-Departemental-de-Flandre
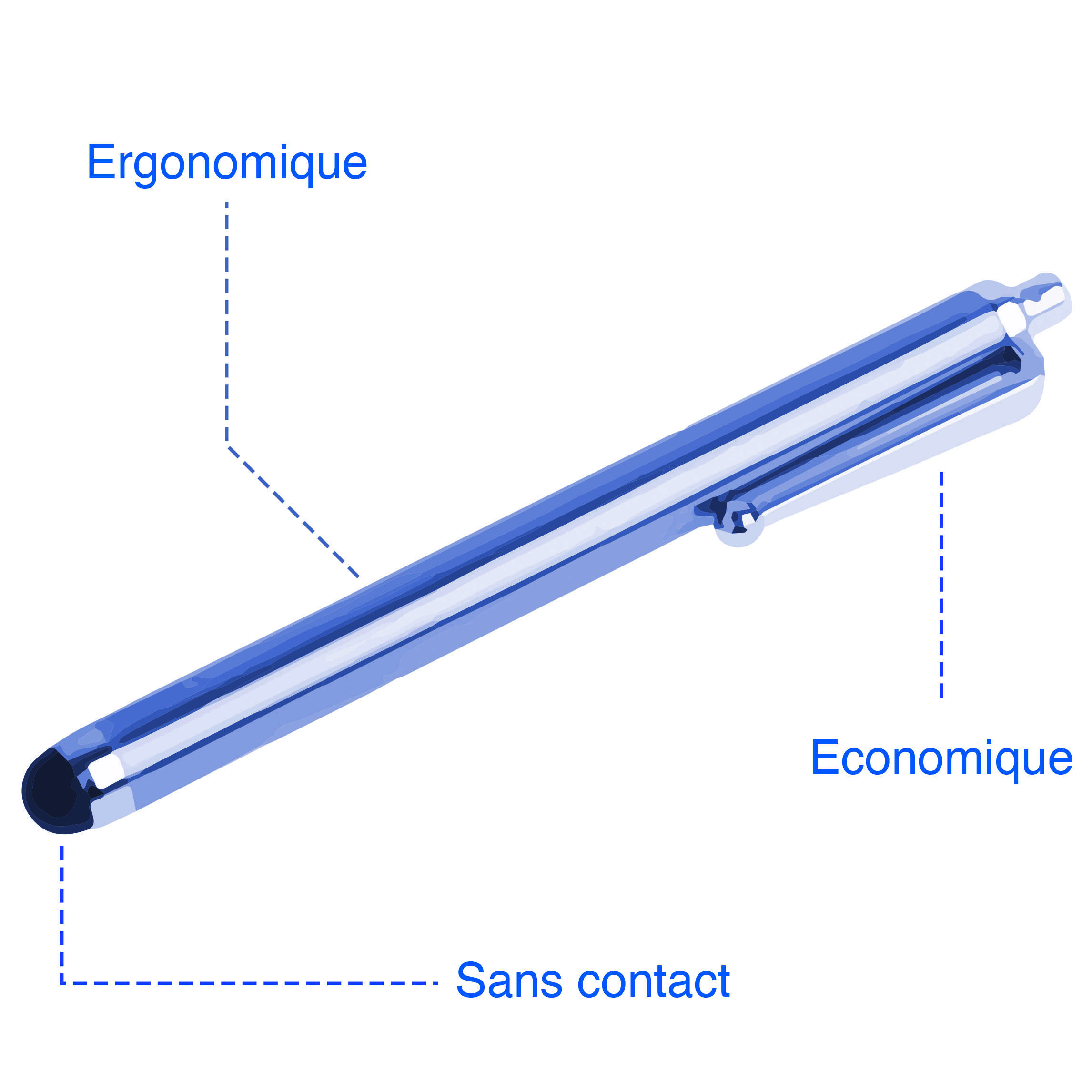
Ne pas toucher
S’adapter au moment de la réouverture, les projets déjà construits :
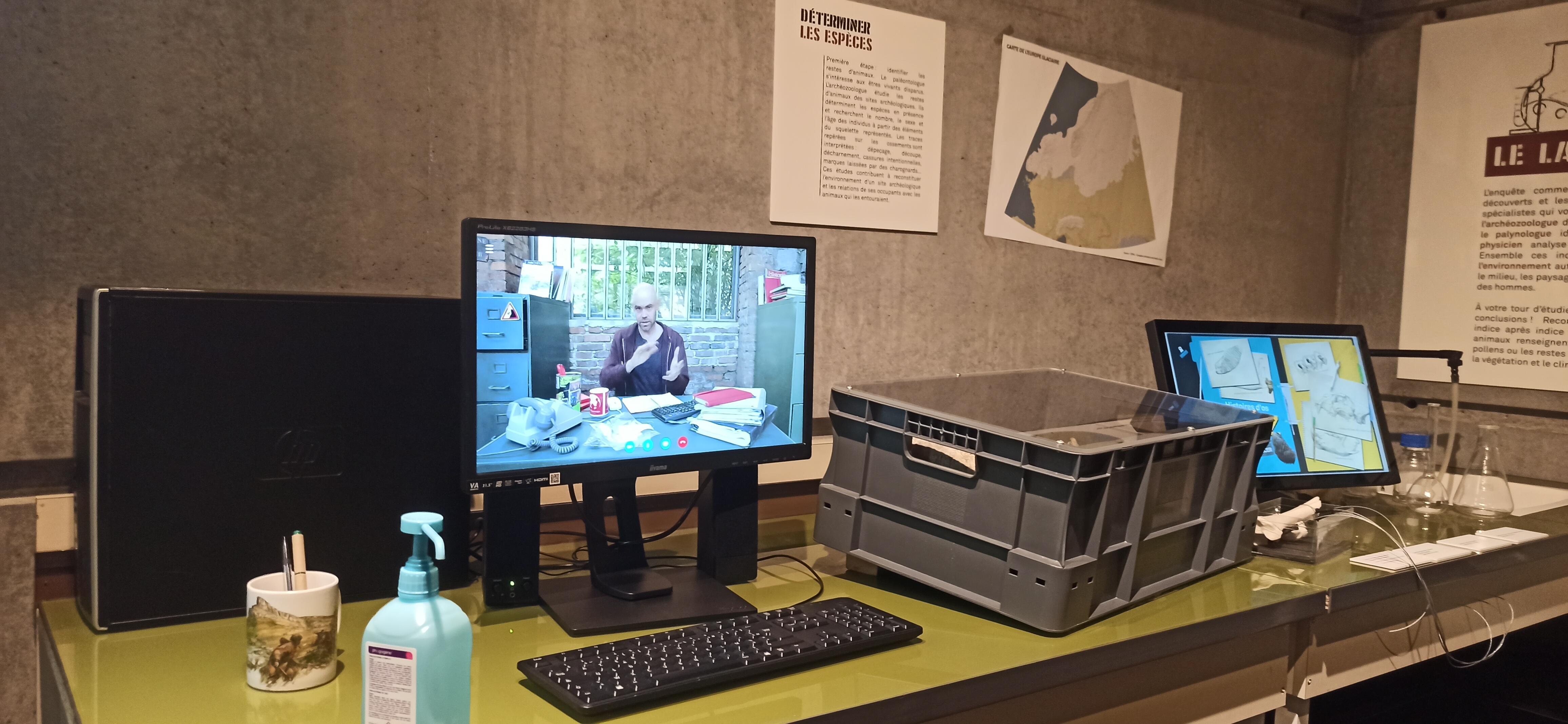

Exposition “Animaux disparus: enquête à l’âge de glace” - Musée départemental de Préhistoire de Solutré ©Juliette Dorn
Le nouvel accessoire indispensable ?
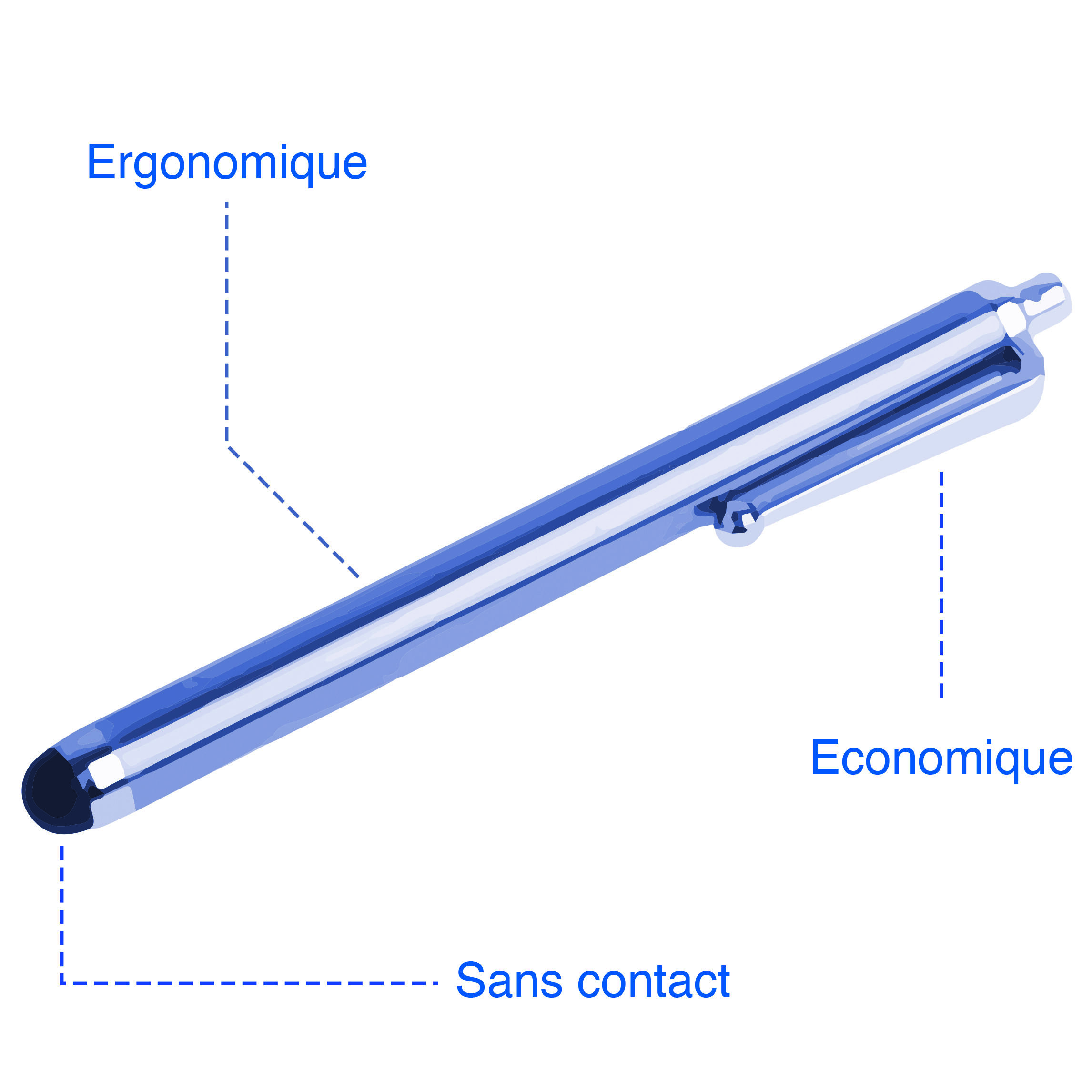
Illustration ©Juliette Dorn
Hors service


Pour des économies de stylet , ce pictogramme “toucher avec le coude” du plus bel effet à Citéco. Un exemple de dispositif sonore à Confluence et son étiquette “ne pas toucher”. photos ©Juliette Dorn



Panneaux de l’exposition “Tous super” ©Jérémy Antonio et Elodie Martini
Préparer une future réouverture : quel avenir pour les manips de contact?
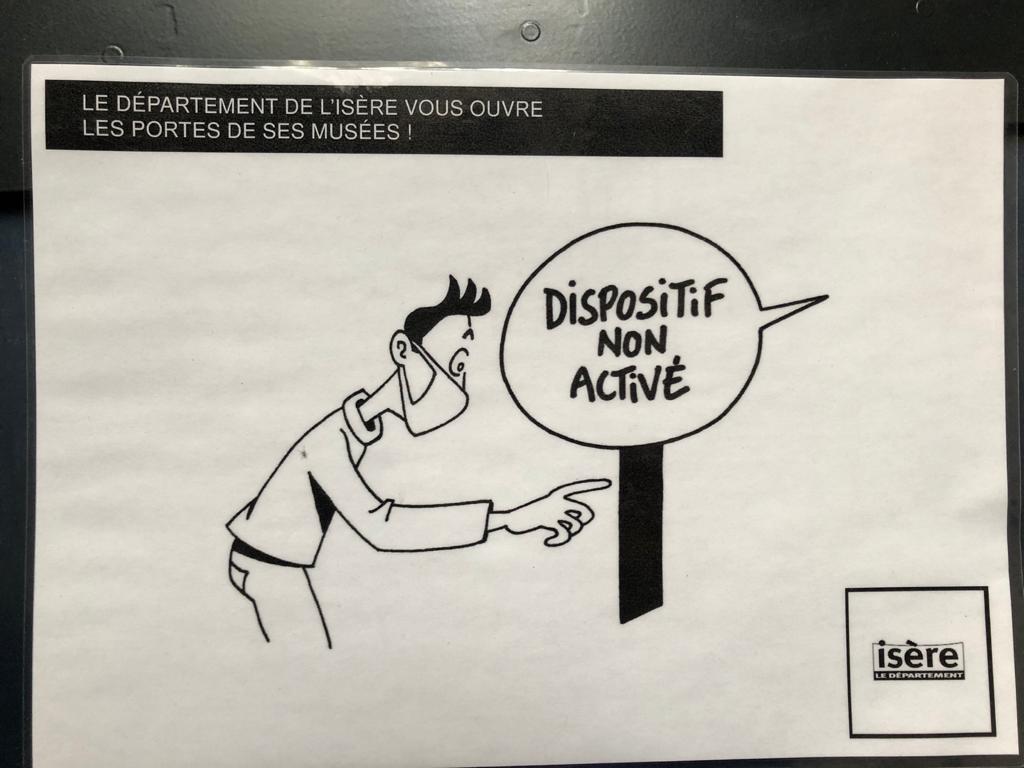

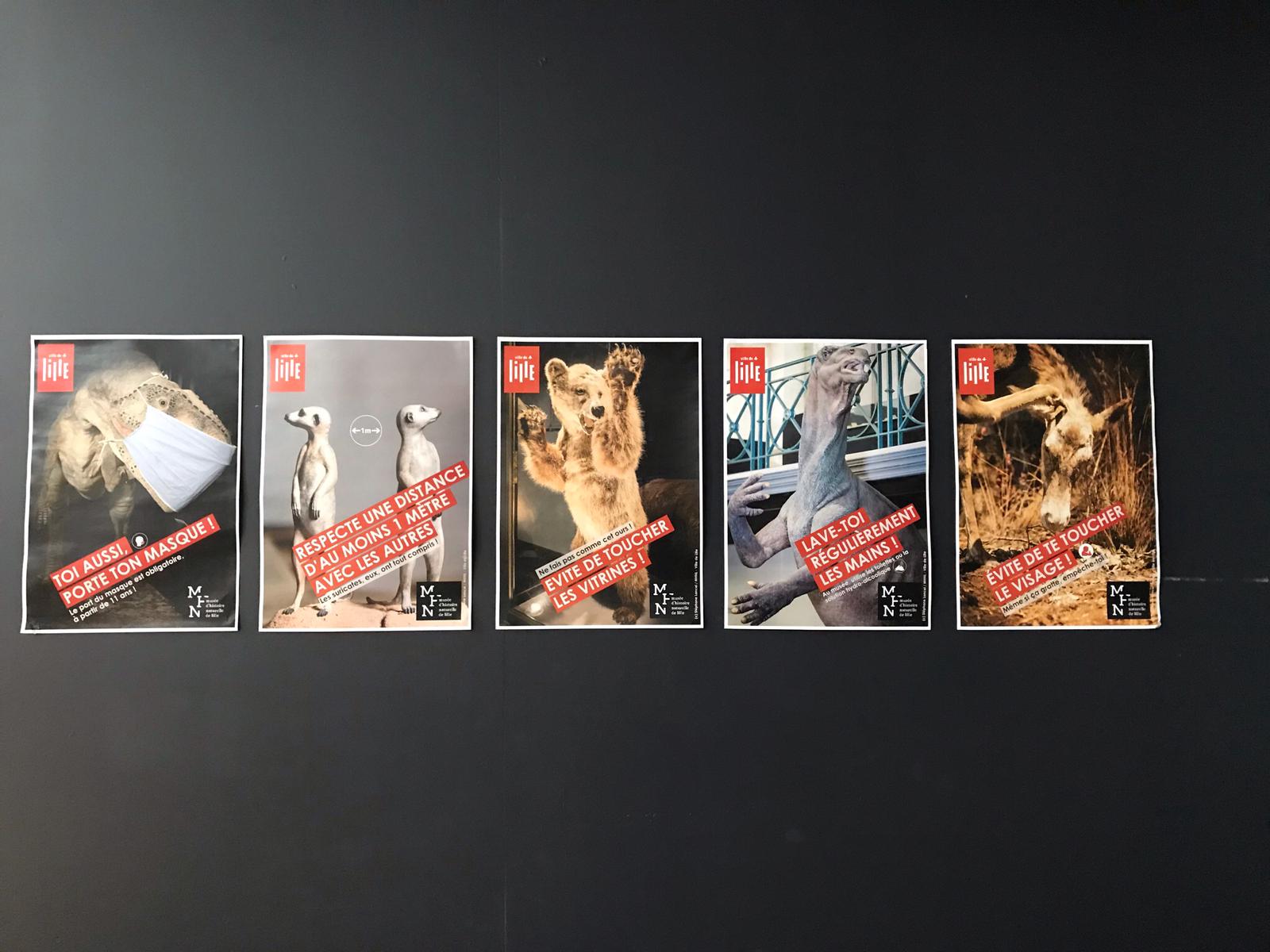
Pictogramme de mise hors service au Vaisseau ©Margot Coïc
Panneau dans les musées du département de l’Isère ©Charlène Paris
Affiches du protocole sanitaire du Muséum d’Histoire Naturelle de Lille ©Anaïs Verdoux
Pour aller plus loin :
- Quelques solutions pour les multimédias
- Une observation internationale des pratiques muséales post-confinement
- Démarche #Nepas d’Omer Pesquet

Ne rien lire sur les murs, ou si peu
L’article de la semaine dernière vous parlait de Lire sur les murs, poursuivons à travers une expérience critique de visite au Musée Magritte de Bruxelles. La question porte toujours sur ce que nous offrent les murs des musées.
Façade du Musée Magritte lors de travaux © Routard
Sur les murs du Musée Magritte de Bruxelles, que voir ?
1. Les œuvres (ce qui semble normal pour un musée Magritte)
2. De longues frises chronologiques illustrées à l’entrée de chaque étage. Vous savez, là où tout le monde se presse, entre par paquets et vous invite à surtout ne pas stationner.
3. Des citations. De courtes citations, qui permettent demieux connaître l’artiste, d’entrer dans ses pensées. Ces citations sont belleset s’intègrent parfaitement à la scénographie. Elles sont écrites en creux sur les murs, se détachant par leur couleur bois clair sur le fond bleu foncé des salles. C’est beau, c’est réussi. Mais aucune information ne nous est donnée sur la provenance de ces citations. Viennent-elles d’un écrit singulier ou sont-elles piochées dans plusieurs ? J’ai demandé à un gardien de salle qui n’était pas certain que toutes les citations soient bien de Magritte… Je n’ai pas insisté auprès du gardien de salle croisé ensuite, occupé à interdire les photographies.
4. Des cartels. Mais pas développés. Juste le strict minimum d’informations sur les œuvres. Le titre, la date, le numéro d’inventaire…
Exemple de cimaises du Musée Magrittede Bruxelles © Musée Magritte de Bruxelles (magritte.be)
Ce qui est bien au Musée Magritte, c’est que les cartels sont disposés juste à côté des œuvres. Vous n’avez pas besoin de parcourir plusieurs mètres pour avoir une information. De plus, ils sont plutôt lisibles et situés à une hauteur adéquate. Ce pourrait être une belle réussite muséographique si l’on tient compte des remarques évoquées dans l’article précédent… mais le problème vient du manque d’informations dans toute l’exposition !
Les frises chronologiques sont les seuls moyens d’en apprendre plus sur Magritte, sa vie et son œuvre. Malheureusement, les conditions ne sont pas des plus propices. Elles sont situées à l’entrée des étages, dans une sorte de couloir qui n’est pas assez large pour permettre de stationner tandis que d’autres y circulent simultanément. Cela est particulièrement visible à l’entrée du premier étage auquel nous accédons par groupes en sortant de l’ascenseur qui donne accès à l’exposition.
Le parti-pris du Musée Magritte est de laisser le visiteur se plonger dans l’univers de l’artiste. Il est vrai que l’œuvre du peintre mérite de se laisser porter, de voyager par nous même dans ce monde, sans interférences. La balade de tableau en tableau proposée par le Musée Magritte est plaisante : les citations font écho aux œuvres, nous plongeons facilement dans leur contemplation.
Mais nous passons parfois à côté d’éléments et nous ne comprenons pas forcément tout le parcours suivi par Magritte. C’est finalement le guide feuilleté à la librairie en fin de visite qui nous livre certaines clefs et donne l’envie de retourner dans les salles regarder plus attentivement un tableau dont nous n’avions pas saisi le sens en le croisant dans une salle.
Aénora Le Belleguic-Chassagne
Pour en savoir plus :
- http://www.musee-magritte-museum.be
#Textes
#Magritte
#Exposition

Noël s'expose en ville !
Les fêtes de Noël sont achevées, les magasins sont dévastés et les ventres remplis. Alors vous me direz pourquoi encore parler de Noël ?
Frise Noel, Crédits : expographe.com
Parce que pendant ce mois de décembre cette fête envahit notre quotidien et notamment la ville ! Vous pensez peut-être que ma formation me monte à la tête – vous avez raison – et que je deviens folle en supposant qu'on puisse lier la muséographie et Noël. Vous avez tort ! Voici 5 raisons qui vous prouveront à coup sûr que les muséographes que nous sommes devrions nous pencher sur cette opportunité professionnelle :
-
Une ville scénographiée
Noël s'expose dans toutes les grandes villes de France, Paris, Lille, Strasbourg, Bordeaux mais également dans les petits villages. Elles rivalisent d'imagination pour offrir le spectacle le plus somptueux. Eclairages majestueux, grandes roues, marchés de Noël, etc. sont conçus dans un véritable programme scénographique ! Si certaines villes ont une vision « artistique » de l'agencement des décorations de Noël – on pensera à la rue Faidherbe de Lille par exemple – d'autres organisent réellement leur boulevard et place comme des scènes. Dans ce cas l'image la plus flagrante est certainement celle des Champs-Elysées !
Décoration du rond point des Champs Elysées, Crédits : Laparisienne.com
-
Un parcours de visite :
Ce qui caractérise aussi une exposition est le parcours qui nous est offert, impossible de me contredire là-dessus ! Et bien ce parcours est également proposé au sein de la ville lors des festivités de Noël. Tout comme pour les musées les plus rigides, la ville nous contraint dans les marchés de Noël à suivre un parcours imposé dont il est quasiment impossible de dévier ! Je vous mets au défi de faire le test, entre la conception de l'espace – entrée et sortie bien signalées, moment-clés de l'exposition avec des chalets plus importants que d'autres – et la foule ne formant qu'un seul homme, vous suivez le parcours qu'on vous dicte !
Des parcours plus libres sont proposés également au sein de la ville, cependant des moments forts sont signalés, représentés ici par les grandes avenues décorées. Vous ne vous baladez pas aux hasards mais les lumières de Noël sont les lignes directrices de votre visite.
-
Des expôts dans les vitrines
Il existe en effet de véritables objets d'expositions, et nous les connaissons tous ! Chocolats, coquilles1, jouets, tenues de soirée, etc. Les vitrines des grands magasins sont souvent des lieux d'exposition extraordinaires, où les objets vendus sont mis au second plan pour laisser transparaitre tout l'imaginaire de Noël. Osez me dire que vous ne vous êtes jamais arrêtés devant des installations mécaniques composées par exemple d'ours polaires, de pingouins et d'inuits bougeant de manière synchronisée sur un chant traditionnel. Ces clichés si kitschs nous font rêver, c'est indéniable.
Notons que pour une fois le public et le privé travaillent en harmonie sur cette thématique, et rien que pour cela on devrait aimer Noël !
Quelques exemples de vitrines représentant les parti-pris des magasins :
1- Noël à Saint Pétersbourg chez Habitat (2014), vitrine classique reprenant l'iconographie traditionnelle de cette fête © Le Journaldes Vitrines par Stéphanie Moisan
2- Vitrines des galeries Lafayette (2014) reprenant la tradition des installations mécaniques © localnomad3& 4-Franck et Fils, La Fôret Magique (2014) vision lyrique et artistique de Noël © Le Journal des Vitrines par Stéphanie Moisan(1)
-
Un contenu construit par le public
Jusqu'ici je ne doute pas de vous avoir convaincu par mon exposé riche et pertinent, mais dans un coin de votre tête une question reste en suspens, le contenu. Ne s'agit-il pas uniquement de marketing pour vendre les produits de Noël ? Et bien non pas du tout – ou si peu – les villes sont des institutions à la pointe de la modernité muséale, en utilisant, inconsciemment certes, la notion deco-construction. Cette notion que l'on voit exploser partout dans les musées, consiste à inclure la participation du public dans la construction du contenu et/ou de l'exposition. Dans ce cas ce n'est pas la ville qui nous propose le contenu mais bien le spectateur et les grands magasins qui co-construisent main dans la main l'histoire de Noël. Après avoir discrètement écouté les conversations des passants, ce qui ressort lorsqu'ils achètent des cadeaux hors deprix est bien que cette fête était mieux avant !
Les sujets abordés sont très souvent liés aux traditions de cette fête :
-
les bougies sur le sapin, et le sapin qui brûle
-
les oranges et le chocolat chaud pour les enfants
-
les grandes réunions de famille où les adultes dégustaient leurs trois entrées et leurs cinq desserts, de façon bien arrosé
-
les jouets en bois
-
les cadeaux faits main
-
l'assiette mise en plus pour l'invité inconnu
La Grande Roue, Grand Place de Lille, Crédits : La voix du Nord
-
Des débouchés professionnels exceptionnels
Devant la montée du chômage, devant la baisse des subventions culturelles, Noël est un terrain à conquérir pour les muséographes que nous sommes ! Scénographie, parcours, public cible, graphisme, marketing culturel, parti-pris, etc. sont des mots-clés que nous connaissons bien ! Il nous revient donc de droit d'offrir une vision innovante sur Noël, en explicitant son histoire mais en prouvant aussi qu'elle peut être autre chose qu'une fête commerciale ! Faire aimer Noël, voilà notre mission !
En plus cela nous permettrait de faire un vernissage thématique : foie gras, huitres, saumon fumé, point vin chaud et j'en passe, sont à mon sens l'argument ultime pour vous convaincre ! Alors qui me suit ?
Marion Boistel
1 Cette fabuleuse brioche de Noël juste pour rappel
Gif de Noel, Crédits : petitemimine.centerblog.net

Notre-Dame-des-Landes ou l’émergence d’une utopie « agri-culturelle »
Dans la neuvième édition hors-série du magazine Socialter intitulée « Renouer avec le Vivant », l’anthropologue Alessandro Pignocchi publie une courte bande dessinée dans laquelle il se projette au cœur d’un futur hypothétique. Il imagine une visite au musée : une mère et son enfant contemplent les restes de ce que fut le monde avant le grand renouveau, qui prit pour point de départ les luttes des Zones à Défendre.
Image d'en-tête : Croquis in vivo © MCmarco
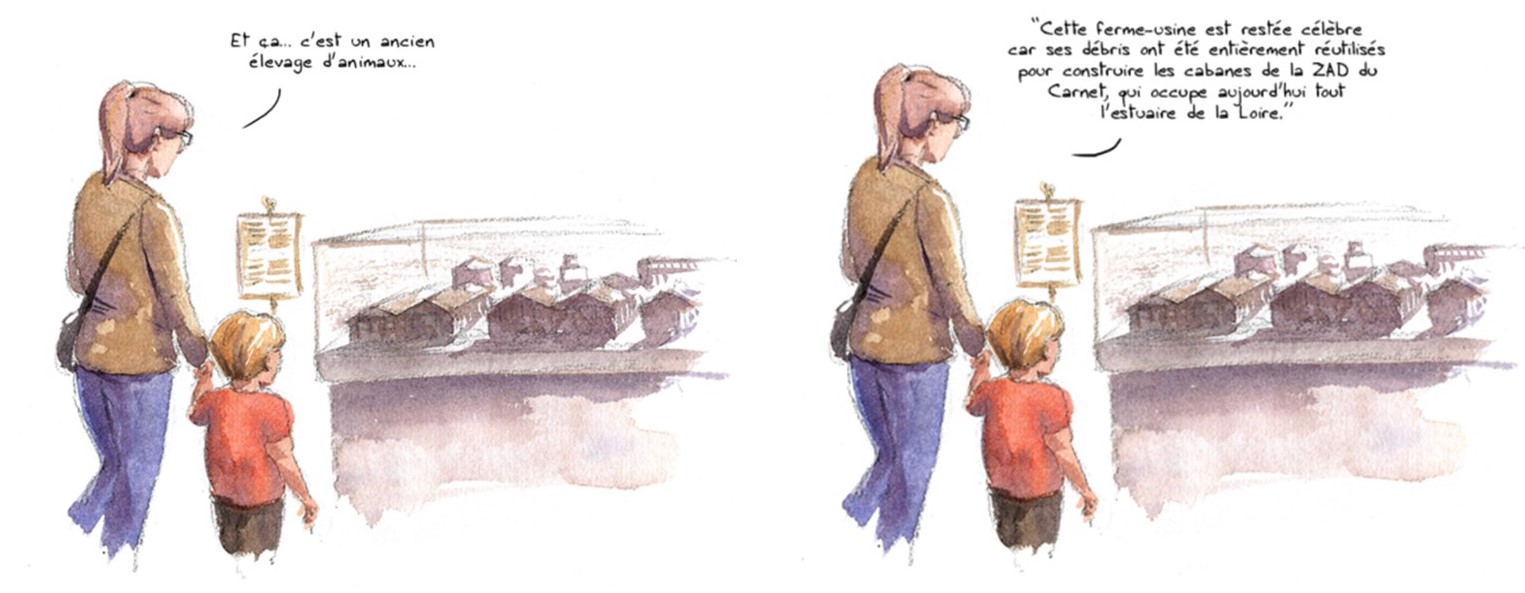
Extrait de la bande-dessinée créée par Alessandro Pignocchi pour le magazine Socialter © Alessandro Pignocchi ; Socialter 2021
Si le nouveau monde n’est pas encore là, il est cependant certain que les problématiques écologiques et sociales soulevées par les occupants des ZAD sont de plus en plus prégnantes au sein de notre société occidentale. La Zone à Défendre de Notre-Dame-des-Landes est un territoire rural où sont pratiquées des activités d’agriculture et d’élevage. Pour autant, l’organisation du site, mise en place par les occupants depuis une dizaine d’années, tend à faire évoluer le statut de cette zone par les activités économiques, artisanales, culturelles et sociales qui y sont pratiquées. Se trouverait-on ainsi confronté à l’émergence d’une véritable zone « agri-culturelle », fruit d’un projet que d’aucuns considèreraient comme utopiste et qui pourtant perdure ?
Le besoin de renouveau
La Zone à Défendre de Notre-Dame-des-Landes est un lieu d’expérimentation collective. Au sein de ce territoire de 1650 hectares se développent, depuis plusieurs décennies, des activités en tout genre. Qu’ils relèvent de l’agriculture, de l’artisanat ou même de la culture, les projets qui « poussent » sur la ZAD se proposent comme de véritables alternatives à nos modes de vies occidentaux contemporains. Ils s’inscrivent au sein d’un territoire en lutte, un territoire « à défendre » contre un système imposé : celui du chacun pour soi, de l’industrialisation à outrance, celui de la mondialisation, de la globalisation et de l’obsolescence programmée. La ZAD de Notre-Dame-Des-Landes constitue de fait un territoire riche aux enjeux très particuliers. Bocage marqué par le mouvement de lutte contre le projet de transfert de l’aéroport de Nantes sur le site de Notre-Dame-des-Landes, il a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes, d’âges et de milieux sociaux très variés, depuis les années 1970. L’abandon du projet de l'Aéroport du Grand Ouest, le 17 janvier 2018, a ouvert la possibilité, pour les quelques trois-cents personnes aujourd’hui installées sur la zone de manière pérenne, de se projeter et d'entreprendre sur le long terme. Il est alors question d’enraciner les initiatives collectives et écologiques, de vie et de lutte partagées, qui s’étaient construites petit à petit sur le territoire. Des expériences de chacun, mais également de la connaissance pointue des milieux et des enjeux locaux, a émergé un projet cohérent et dynamique pour le territoire de l'ex-zone d'aménagement différé.
Territoires pol(ys)émiques
En plus des activités agricoles, ont également émergées sur le territoire de la Zone à Défendre des activités d’artisanat. Les artisans sont regroupés au sein d’un collectif et travaillent en lien avec les autres activités du territoire. Il s’agit par exemple de fabriquer des outils qui serviront aux activités agricoles du territoire. L’objectif poursuivi est bel et bien de créer un « territoire vivant » en renforçant les dynamiques locales et en utilisant des techniques et des matériaux traditionnels. Les zadistes espèrent de fait transmettre et sauvegarder les savoir-faire de métiers qui tendent aujourd’hui à disparaître et qui pourtant font partie intégrante du patrimoine culturel régional. Un véritable écomusée à ciel ouvert.
Ainsi cohabitent sur la ZAD une forge, nécessaire à la fabrication et entretien de l'outillage pour les projets agricoles des alentours et l'atelier de bûcheronnage, une maroquinerie pour la fabrication d'objets artistiques en cuir, mais également un atelier de céramique impliqué dans la fabrication de vaisselle, de sanitaires, éviers et poêles à bois. S’y trouve également un atelier de menuiserie pour la fabrication de manches pour les outils issus de la forge et des objets d’art. Un espace dédié à la papeterie et à la sérigraphie se propose de réaliser du papier, des affiches et des visuels graphiques. Cet espace s’attèle aussi à cultiver des plantes tinctoriales destinées à la confection d'encre végétale. Ces activités artisanales se répartissent dans différents lieux de la ZAD. Il s’agit souvent d’anciennes fermes récupérées par les zadistes pour y établir des « communs » ou espaces communautaires destinés à l’ensemble de la communauté. Ainsi la ferme de Bellevue, située au cœur du territoire, près de la forêt de Rohanne, comprend une cuisine collective, une fromagerie, une boulangerie ainsi que des espaces dédiées à la couture et à la forge. Les habitants de la ZAD ont donc une production foisonnante et originale, en lien direct avec leur mode de vie particulier : un mode de vie rural et ancré dans un climat de lutte depuis des décennies.
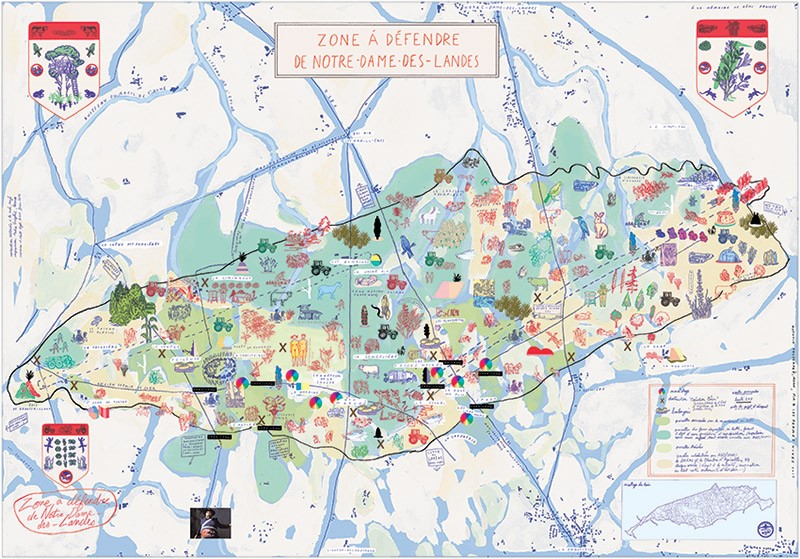
Cette carte dessinée situe les lieux de vie et activités dans la ZAD © Geoffroy Pithon, Quentin Faucompré, Mano et Pia ; éditions À la criée 2016
Mais la ZAD organise également régulièrement de grands évènements et bénéficie d’une vie culturelle riche, ponctuée de concerts, de lectures, de spectacles, de projections, de conférences… Les zadistes le disent eux-mêmes : « Jamais hameau de quelques centaines d’habitant.es n’a connu une telle vitalité socio-culturelle ! ». En guise d’exemple, mentionnons l’espace de la Wardine, situé au nord-ouest du site dans les bâtiments de l'ancienne ferme de Saint-Antoine, qui sert d’espace de discussion. En effet, le collectif en charge de ce lieu particulier souhaite qu’il puisse servir à un « tas d'activités politiques » et programme ainsi régulièrement des rencontres, des projections et des discussions. La Wardine propose également une salle de concert, afin de profiter de musiques expérimentales et « souvent inouïes », une salle de sport où il est possible de pratiquer de la danse, des arts du cirque ou encore de la self-défense, ainsi qu’un espace permettant d’accueillir les enfants du territoire.
Un autre lieu permet de profiter d’activités sociales et culturelles sur le territoire de la ZAD. Il s’agit de l’Ambazada, située quelques kilomètres à l’est de la Wardine. L’Ambazada est un bâtiment construit par les zadistes au cours de chantiers collectifs et à l’aide de matériaux locaux, principalement du bois. Au cœur de la seule pièce de l’édifice s’organise une multitude d’événements culturels, allant des rencontres avec des artistes, des scientifiques ou des auteurs, aux formations relatives aux questions d’agriculture et d’environnement, sans oublier les concerts et les projections. Les occupants de Notre-Dame-des-Landes disposent également de leur propre bibliothèque. Située au cœur du périmètre de la ZAD, sur la parcelle de la Rolandière où l’on rencontre également le « phare », la bibliothèque du Taslu rassemble plus de cinq mille ouvrages. On y trouve ainsi des romans, de la poésie, du théâtre, des bandes dessinées, etc. Les zadistes ont également réuni des fonds thématiques sur l’histoire des luttes, le monde paysan et les diverses activités du territoire.
De la ZAD au musée (et inversement)
La ZAD lance régulièrement, via son site internet, des appels à artistes pour que ces derniers viennent « peupler le bocage d’imaginaires en action ». Le territoire attire donc de nombreux artistes, auteurs, intellectuels. Philippe Graton, photographe, s’est régulièrement rendu à Notre-Dame-des-Landes de 2014 à 2019. En 2020, il exposait au Musée de la photographie de Charleroi ses clichés en noir et blanc présentant des moments de vie et de lutte sur la ZAD.

Photographie publiée dans les Carnets de la ZAD du photographe Philippe Graton © Philippe Graton
Alain Damasio, romancier et Grand prix de l’imaginaire, se rend également régulièrement sur la Zone à Défendre. Là-bas, il se prend à rêver de « musée de plein air » et d’ « opéra arboré ». Notre-Dame-des-Landes est par ailleurs devenue une grande source d’inspiration pour l’auteur, puisque les ZAD sont un des thèmes principaux de son tout dernier roman, intitulé Le Furtifs et publié aux éditions La Volte en 2019. Mais la ZAD de Notre-Dame-des-Landes n’est pas la seule à être à être source de propositions créatives : parmi les créations récentes, citons l'AMusée, un « musée inversé » créé en février 2021 sur la ZAD de Gonesse (Val d’Oise). L’AMusée, aujourd’hui détruit, reposait sur un concept simple : c'est à l'extérieur de ce lieu, et « jusqu'aux confins de l'univers » que se trouve l'Art. L’installation avait donc pour vocation de rendre visible et de défendre un autre rapport à l'Art et prenant la forme d'une cabane en palettes et carton cousu. Trois ouvertures pratiquées dans les murs permettaient d’observer les œuvres éphémères créées pour l’occasion.
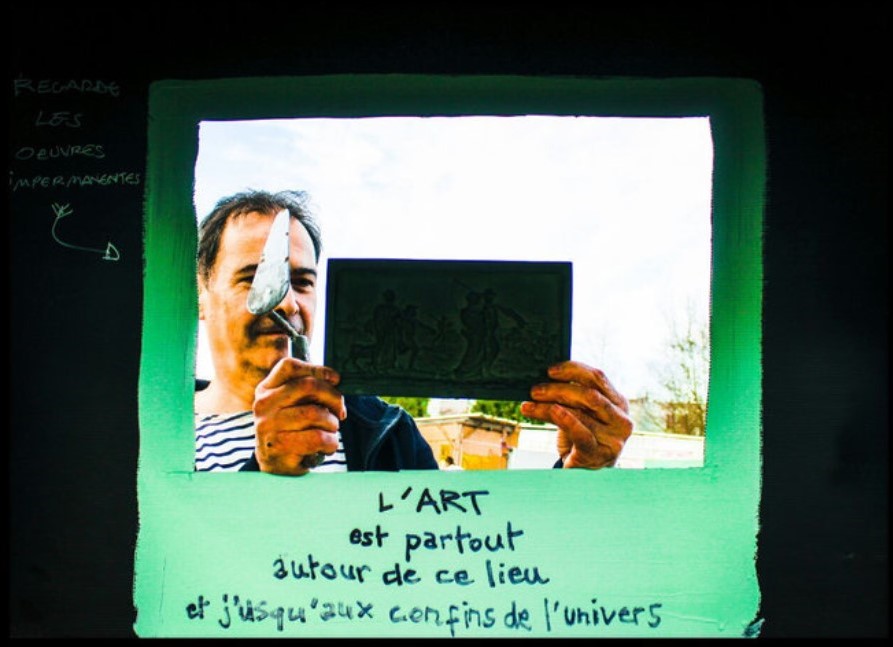
Photo de la performance de l’artiste plasticien Morèje pour l’AMusée sur la ZAD de Gonesse © Vitalia
Finalement, par la remise en question profonde du mode de fonctionnement de nos sociétés « fondées sur les notions de hiérarchie, de domination et d’exploitation », la Zone à Défendre a permis l’émergence de nouveaux modes « d’habitat, de gouvernance et de solidarité » en mettant en place « le partage des communs, le réinvestissement des rituels, la permaculture ou encore la monnaie locale ». Elle semble ainsi bel et bien matérialiser le concept d’hétérotopie (topos : « lieu », et hétéro : « autre » : « lieu autre ») tel qu’il fut définit par Michel Foucault, c’est-à-dire comme une localisation physique de l'utopie. Les hétérotopies seraient ainsi des espaces concrets hébergeant « l'imaginaire ». Car c’est bel et bien cela que nous proposent les occupants de la Zone à Défendre de Notre-Dame-des-Landes: une invitation à repenser nos imaginaires. En effet, selon Philippe Vion-Dury, rédacteur en chef du magazine Socialter, le terme d’imaginaire renvoie à nos représentations « sociales, politiques, temporelles, anthropologiques » et, en définissant ce qui est « bon ou mauvais, normal ou anormal, souhaitable ou non », détermine les normes de la société dans laquelle nous vivons. Ainsi, selon lui, la construction d’un imaginaire collectif revêt une importance considérable dans nos vies, puisque c’est elle qui est à l’origine des logiques d’émancipation ou d’asservissement culturellement acquises. Les « imaginaires alternatifs », qui s’opposent aux imaginaires traditionnels qui ont « fait faillite » entrent aujourd’hui dans nos foyers. Au moment où j’écris ces lignes, nul ne sait si la Zone à Défendre de Notre-Dame-des-Landes réussira à perdurer et à garder son statut d’« antichambre d’un monde nouveau ». Ce qui est pourtant sûr, c’est qu’au sein de cette communauté d’ « artisans-artistes », la culture vit par les gestes au sein d’un véritable musée à ciel ouvert, un laboratoire des possibles.
Image vignette : cabane médicinale et traversée solaire © ZAD NDDL Info
Pour aller plus loin :
ZAD NDDL Infos, la page Facebook des habitants la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Pour retrouver les actualités et les RDV de la ZAD : https://www.facebook.com/zadnddlinfo
Renouer avec le Vivant : https://www.socialter.fr/article/hors-serie-9-renouer-avec-le-vivant-avec-baptiste-morizot
L’Amusée : https://blogs.mediapart.fr/edition/inverse/article/040421/lamusee
La Zone à Défende, du spectacle au rite : https://www.franceculture.fr/emissions/la-theorie/la-transition-culturelle-du-vendredi-17-janvier-2020
(P)artisan.ne.s, le collectif d’artisans de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes : https://zad.nadir.org/spip.php?rubrique96
#ZoneADéfendre #Alternatives #UnAutreMondeEstPossible

Œuvre vidéo ou vidéo d’une œuvre ?
Lors de ma dernière visite au Centre Pompidou pour Faire son temps de Christian Boltanski, j’ai re-découvert une œuvre bien connue et aussi chère à mes yeux qu’elle me pose problème. C’est Animitas Chili.
Questionnements
Découverte à la biennale de Venise en 2015, le contexte d’exposition était bien particulier. Il est certain que mon regard et ma maturité ont changé depuis, mais les propositions, l’installation, le propos en général, est bien différent d’ici, au Centre Pompidou, bien que la même pièce soit exposée. Et à chaque fois, devant cette œuvre je reste de longs instants contemplative, ressassant la même question : qu’est ce qui fait œuvre ?
Pour en faire une description succincte, il s’agit d’une vidéo avec son d’une installation de 2014 au pied du volcan Lascar, dans le désert d’Atacama au Chili. On voit des centaines de longues barres de métal (huit cents cinquante environ) d’à peu près deux mètres de haut, plantées verticalement dans le sol. La projection est à échelle 1. Ces longs bâtons sont incurvés à leur moitié pour former un léger angle. Au bout de ces pics sont accrochées de petites clochettes japonaises, et des languettes de plastique transparent, flottant dans le vent. Vu de dessus, les points matérialisés par les barres de métal dessinent la carte des étoiles, vue depuis l’hémisphère sud la nuit du 6 septembre 1944, nuit de naissance de l’artiste. On entend les clochettes sonnant au gré des vents, et l’installation dans le désert ne sera jamais enlevée. Ici, à Paris, la vidéo est projetée derrière un parterre de foin très odorant. De l’autre côté de la pièce, la vidéo a son pendant hivernal Animitas blanc(2017), le paysage y est glacé, et le sol recouvert de boules de papier symbolisant la neige que l’on retrouve dans la vidéo.
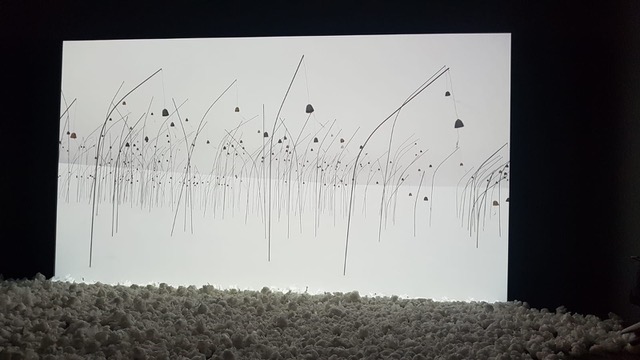
Christian Boltanski, Animitas blanc, 2017 © Gilles Delmas
Il y a eu quatre Animitas au total, installées aux quatre coins du monde : au Chili, au nord du Québec (Blanc, 2017), près de la mer Morte (2017) et sur l’île de Teshima, au Japon (La Forêt des Murmures, 2016), mais c’est sur l’installation chilienne que je vais m’attarder.
Est-ce que c’est la vidéo d’une œuvre ou une œuvre vidéo ? Qu’est ce qui va en changer la perception ? Pour en saisir toute la portée, le visiteur doit-il se rendre dans le désert au Chili et faire l’expérience de l’œuvre ?
Je ne sais rien, alors je reste assise des heures au son des clochettes et du vent.
Fantômes
Prenons les choses dans l’ordre car c’est une œuvre conceptuelle à plusieurs tiroirs. Tout d’abord son lieu d’implantation, le désert d’Atacama au Chili, était le lieu de prédilection de Pinochet pour y jeter les cadavres de l’opposition au régime. Aujourd’hui, beaucoup viennent encore chercher leurs morts dans ce désert et un important travail de mémoire sur cette période sombre de l’histoire est en cours au Chili. Pour ce qui est du titre, les animitas sont des autels dressés sur le bord des routes, par les Chiliens, à la mémoire de leurs morts. Ce terme veut dire « petites âmes, âmes errantes ». C’est une préoccupation récurrente chez Boltanski, la mort, la disparition, la mémoire des fantômes et leur présence. Il dit lui-même : « Je pense qu’il y a des fantômes autour de nous ».
Moins politiquement et plus poétiquement, il est important de préciser que l’œuvre a été créée pour une exposition à Santiago qui s’appelait Alma (âme, en espagnol), du même nom que le plus grand observatoire astronomique du monde, implanté dans ce désert. C’est l’endroit où toutes les conditions sont réunies pour faire le meilleur terrain d’observation des étoiles et de l’univers. D’ailleurs, comme je l’ai dit précédemment, les bâtons plantés dans le sol forment la carte du ciel vue depuis l’hémisphère sud la nuit de naissance de l’artiste. Cependant ce dessin n’est visible qu’à vol d’oiseau, et impossible à discerner avec la seule vue de la caméra - point de vue immersif, au cœur de l’œuvre, notre œil est à la hauteur de l’horizon du désert. On ne peut qu’imaginer ce dessin, mais il est nécessaire de savoir que ce dernier existe pour appréhender l’œuvre. Maintenant que je le sais, je le vois.
Pour ce qui compose techniquement l’installation, Boltanski choisit des clochettes japonaises utilisées pour adresser des vœux et installées devant les portes des maisons. Ceci dit, au Japon, ce n’est pas un plastique transparent qui y est accroché, mais un papier avec une phrase, une prière. Quand le vent fait entendre le carillon de la clochette, c’est comme redire la prière. Chaque pic dans la terre est une porte vers un autre monde, un au-delà possible. Le carillon produit par la multiplicité des clochettes évoque pour l’artiste « la musique des âmes, la voix des âmes flottantes ». C’est pour expérimenter le murmure de ce grand et délicat instrument résonnant au rythme du vent, que les vidéos ont été faites, pour se plonger dans l’état de méditation que l’artiste a cherché à susciter.
Précisons que pour les Animitas ce n’est ni lui ni personne qui va enlever l’installation, la détruire : le désert va l’absorber et l’assimiler. Un an après sa mise en place, il n’y avait peut-être plus que deux cents clochettes, puis sûrement plus qu’une vingtaine maintenant. On ne sait pas ce qu’il reste de la musique des âmes aujourd’hui.
Land art ?
Partons du principe que la vidéo est la documentation d’une œuvre in situ. Il s’agit d’une proposition installée dans un environnement ouvert, naturel, il n’y a pas d’indication sur sa nature. Le temps et les évènements dégraderont l’œuvre progressivement. De plus, se pose la question du parcours vu qu’il y a plusieurs Animitas dispersées de par le monde. Peut-on alors parler de land art ? Sans avoir répondu à la première question où je me demandais qu’est ce qui fait œuvre dans Animitas, s’ajoute à savoir quelle différence y a t’il entre cette installation dans le désert et une installation de land art ?

Pascale Planche, Convergences © Sophie Delmas
Pour exemple, cette œuvre de Pascale Planche, visible depuis les berges du lac du Tremlin en Brocéliande. Il n’y a pas de cartel sur place, pas de nom, aucune indication de l’artiste, juste l’œuvre dans son lac. Elle n’est constituée que de chêne, matériau que l’on trouve en abondance en Brocéliande. Elle existe et aucun doute n’est permis sur sa nature. C’est une œuvre d’art, inscrite dans un parcours défini, dans le cadre d’une manifestation précise (Etangs d’Art, 2018). Soit, il est vrai que le principe même du land art impose au spectateur de se déplacer et d’aller faire l’expérience de l’œuvre qui ne peut pas être virtuelle ou vécue par le biais d’un intermédiaire. La vidéo d’une œuvre de land art restera de la documentation et ne sera pas œuvre en elle-même.
Mais alors y a-t-il des visiteurs dans le désert d’Atacama, autres que les scientifiques et amoureux des étoiles ? Y a-t-il des gens pour écouter les carillons et les prières faites au vent ? Personne. L’artiste a été aidé, pour installer Animitas Chili, par une communauté Chilienne et elle seule sait où se trouve l’œuvre. Tout est détruit et reste cette vidéo comme unique témoignage de la création.
Ce n’est finalement pas comparable, cela supposerait d’emblée qu’Animitas Chili est la documentation vidéo d’une œuvre et non une œuvre vidéo et elle n’est pas présentée ainsi. Le cartel n’indique qu’« Animitas Chili, 2014 - Vidéoprojection avec son, format 16/9, couleur, 13 heures 16 sec., foin, fleurs ». L’œuvre est fixée, reproductible, et le musée est l’environnement dont elle a besoin pour exister et faire œuvre. Si le land art peut avoir de l’autonomie dans son environnement, l’œuvre de Boltanski a besoin d’un cadre, d’un écrin, de s’inscrire dans un discours et dans un parcours. La vidéo est-elle devenue l’œuvre au moment où le corps de l’œuvre à disparue ? Je ne suis pas allée dans le désert d’Atacama, mais je sais qu’Animitas Chili a existé et qui sait ce qu’il en reste. C’est peut-être là où est l’indice que j’avais toujours raté pour me dire que ce qui fait œuvre, c’est finalement ce que je vois et vis dans le présent, devant ce parterre qui sent l’écurie, et ces clochettes dont le carillon jamais ne cessera.
Sophie Delmas
Christian Boltanski, Faire son temps, Centre Pompidou visible jusqu’au 16 mars 2020
Commissariat Bernard Blistène & Annalisa Rimmaudo
#boltanski
#fantômes
#landart

On a discuté de muséographie et de culture avec l’IA Chatpgt
L’intelligence artificielle est un champ de recherche en pleine expansion qui suscite de nombreux débats et qui voit émerger de nouvelles explorations dans tous les domaines d’expertises, notamment le milieu muséal. Ces nouvelles interfaces ont déjà commencé à trouver leur place aussi bien dans les collections permanentes que dans les expositions temporaires. Cela se matérialise par exemple avec le projet du centre Pompidou en collaboration avec l’association KADIST qui ont pu acquérir des premières oeuvres générées par IA pour un projet de réflexion sur les pratiques artistiques, aussi avec l’exposition “IA : double je” au quai des savoirs à Toulouse en co-production avec la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris, ou encore au Nasher Museum of Art de l’Université Duke, où une intelligence artificielle a assumé le rôle de curateur pour une exposition.
Image générée par ChatGPT
Les intelligences artificielles sont des programmes algorithmiques complexes qui simulent certains traits de l’intelligence humaine tels que la capacité d’apprentissage ou de raisonnement. L’outil le plus répandu actuellement auprès du grand public est Chatgpt "Chat Generative Pre-trained Transformer", développé par OpenAI. Ce modèle de langage artificiel est alimenté à partir d’une base de données extraites de livres, d’articles, de sites web, de textes de tous genres ou encore de banques d’images.
Selon Nicolas d’Alessandro, ingénieur et designer chez Hovertone, ce qui fait la spécificité de ces nouvelles technologies, c'est la capacité de communiquer avec la machine à travers un langage naturel. Cette transition du "mot clé", comme avec Google, au prompt (un court texte entré par un utilisateur pour initier une conversation avec ChatGPT) ouvre de nouveaux horizons qui favorisent une interaction plus intuitive avec les logiciels mais soulèvent également de nombreuses questions éthiques, notamment en matière de créativité et de production de contenus.
Cet article ne prétend pas résoudre ces débats complexes mais plutôt de donner à voir le potentiel et les limites de ces nouveaux outils. Quel est réellement l’étendue des connaissances et des capacités de chatgpt ? Quelle intégration peut-il avoir dans nos milieux professionnels ? Pour éclairer ces questions j’ai proposé à Myrrha Bouly, muséographe à la Cité des Sciences à Paris, de se prêter pour la première fois au jeu de la discussion avec l’intelligence artificielle pour parler de ses sujets de prédilections :
Myrrha : A quoi servent les musées ?
Chagpt 3.5 :Les musées servent à préserver le patrimoine culturel de l'humanité, en conservant et en présentant des œuvres d'art, des artefacts historiques et d'autres éléments significatifs. Ils jouent un rôle crucial dans l'éducation en offrant des expériences d'apprentissage uniques et en stimulant la curiosité intellectuelle des visiteurs. Les musées fournissent également des opportunités de divertissement et de loisirs, en proposant des expositions interactives, des événements spéciaux et d'autres activités engageantes. De plus, les musées soutiennent la recherche académique en permettant aux chercheurs d'étudier et d'analyser les objets de leur collection. Enfin, les musées contribuent au renforcement de l'identité culturelle en célébrant la diversité et en mettant en valeur les traditions et les réalisations des différentes cultures à travers le monde.
Myrtha : Je suis muséographe, comment concrètement peux-tu m'aider ?
Chagpt 3.5 : En tant que muséographe, je peux vous aider de plusieurs façons :- Conception et planification : Je peux vous aider à concevoir et à planifier votre exposition, en vous fournissant des idées créatives, des concepts thématiques et des suggestions pour la disposition spatiale des éléments de l'exposition.
- Recherche et contenu : Je peux vous aider à effectuer des recherches sur des sujets spécifiques liés à votre exposition, en vous fournissant des informations historiques, culturelles et artistiques pertinentes pour enrichir le contenu de votre exposition.
- Écriture et rédaction : Je peux vous aider à rédiger des textes d'interprétation, des panneaux d'exposition, des cartels et d'autres supports écrits pour votre exposition, en vous fournissant un contenu clair, précis et engageant pour informer et captiver votre public.
- Sélection des médias et des supports : Je peux vous aider à choisir les médias et les supports les plus appropriés pour présenter votre contenu, en vous proposant des idées pour l'utilisation de l'imagerie, de la vidéo, de l'audio, des objets physiques et d'autres éléments interactifs dans votre exposition.
- Évaluation et rétroaction : Je peux vous fournir des commentaires et des conseils sur votre projet d'exposition, en vous aidant à évaluer son efficacité et son impact potentiel sur le public cible, ainsi qu'en identifiant des domaines où des améliorations pourraient être apportées.
- Utilisation de la technologie : Je peux vous conseiller sur l'intégration de la technologie dans votre exposition, en vous proposant des idées pour l'utilisation de dispositifs interactifs, d'applications mobiles, de réalité virtuelle ou augmentée, et d'autres outils numériques pour améliorer l'expérience des visiteurs.
Myrrha : Comment choisit-on un sujet d'exposition?
Chagpt 3.5 : Le choix d'un sujet d'exposition peut être influencé par plusieurs facteurs. Tout d'abord, il est souvent déterminé par la mission et la vision du musée, ainsi que par les intérêts et les objectifs spécifiques de l'institution. Par exemple, un musée d'art moderne peut choisir d'organiser une exposition sur un artiste contemporain émergent afin de promouvoir de nouveaux talents, tandis qu'un musée d'histoire peut opter pour une exposition sur un événement historique important pour commémorer un anniversaire ou une commémoration.
De plus, les musées peuvent tenir compte de l'intérêt du public et de la demande du marché lorsqu'ils choisissent un sujet d'exposition. Les expositions sur des sujets populaires ou d'actualité peuvent attirer un plus large public et contribuer à augmenter les revenus de billetterie.
Parfois, les musées collaborent avec des chercheurs, des conservateurs, des historiens de l'art et d'autres experts pour identifier des sujets d'exposition pertinents et novateurs. Ces collaborateurs peuvent proposer des idées basées sur leurs recherches et leurs connaissances spécialisées dans un domaine particulier.
Enfin, le contexte culturel, politique et social peut également influencer le choix d'un sujet d'exposition. Les musées peuvent choisir de traiter des questions contemporaines ou des problèmes sociaux importants à travers leurs expositions afin de stimuler la réflexion critique et de susciter le dialogue au sein de la communauté.
Dans l'ensemble, le choix d'un sujet d'exposition est un processus complexe qui peut impliquer une combinaison de facteurs, y compris la mission du musée, l'intérêt du public, les contributions des experts et le contexte culturel et social.
Myrrha : Quelle expo aimerais-tu voir en ce moment si tu étais humain ?
Chagpt 3.5 : Si j'étais humain, j'aimerais probablement voir une exposition qui explore l'intersection entre la technologie et l'art contemporain. Cette exposition pourrait présenter des œuvres d'art numérique, des installations interactives et des expériences multimédias qui explorent les possibilités créatives offertes par les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
Je serais également intéressé par une exposition qui met en lumière les cultures du monde, en mettant en valeur l'art et les traditions de différentes régions et communautés. Cette exposition pourrait offrir une perspective diversifiée sur la richesse et la diversité de la culture humaine à travers le temps et l'espace.
Enfin, une exposition sur l'histoire de la science et de la découverte pourrait également captiver mon intérêt, en explorant les grandes avancées scientifiques et les figures emblématiques qui ont façonné notre compréhension du monde et de l'univers.
Ces sujets d'exposition reflètent mon intérêt pour la technologie, l'art, la culture et la connaissance, et j'apprécierais certainement l'occasion de les explorer à travers des expositions captivantes et stimulantes.
Myrrha : Peux- tu citer 4 thématiques intéressantes pour une expo courte sur l’accouchement, avec un point de vue féministe engagé ?
Chagpt 3.5 : Si vous souhaitez adopter un point de vue féministe plus engagé dans votre exposition sur l'accouchement, voici quatre thématiques qui pourraient être explorées :
- Autonomie et empowerment des femmes enceintes : mettez en avant les droits des femmes enceintes à prendre des décisions éclairées sur leur propre accouchement, en mettant en lumière les choix de naissance respectueux, l'autonomie des patientes et l'importance du consentement éclairé dans les soins obstétricaux.
- Déconstruction des normes de genre et de la médicalisation de l'accouchement : explorez comment les normes de genre et la médicalisation de l'accouchement ont historiquement limité la capacité des femmes à contrôler leur propre expérience d'accouchement, en mettant en évidence les mouvements pour des soins de maternité centrés sur la femme et respectueux des choix des femmes.
- Défense des droits des femmes enceintes : abordez les enjeux contemporains liés aux droits des femmes enceintes, tels que les disparités en matière de soins de santé maternelle, les violations des droits reproductifs, la stigmatisation de la grossesse et les défis auxquels sont confrontées les femmes enceintes marginalisées.
- Solidarité et soutien entre femmes : mettez en avant l'importance de la solidarité entre femmes et du soutien communautaire dans le processus d'accouchement, en mettant en lumière les rôles des doulas, des sage-femmes et des réseaux de soutien entre pairs dans l'autonomisation des femmes enceintes et dans la promotion du bien-être maternel.
En adoptant un point de vue féministe plus engagé, votre exposition peut servir de plateforme pour remettre en question les normes patriarcales et médicales entourant l'accouchement, tout en faisant progresser les conversations sur les droits reproductifs, l'autonomie des femmes et la justice en matière de santé maternelle.
Myrrha : J’ai un budget de 500 euros, quels matériaux choisir ?
Chagpt 3.5 : Avec un budget de 500 euros, vous pouvez envisager d'investir dans des matériaux tels que du carton recyclé pour la construction de panneaux d'exposition, du papier et de l'encre pour l'impression de supports visuels, des matériaux de bricolage pour la création d'installations artistiques, et des fournitures de bureau pour la création de supports informatifs et éducatifs. Vous pourriez également envisager d'utiliser des matériaux recyclés ou récupérés pour réduire les coûts et adopter une approche écologique.
Myrrha : Que penses-tu de la restitution des œuvres dans les musées européens ?
Chagpt 3.5: La question des restitutions d'œuvres d'art dans les musées européens est complexe et soulève des questions importantes sur la propriété, la restitution historique et la justice culturelle. Voici quelques points à considérer :- Histoire coloniale et pillage culturel : de nombreuses œuvres d'art dans les musées européens ont été acquises pendant la période coloniale, souvent par des moyens contestables tels que le pillage, la confiscation forcée ou la transaction inégale. Ces acquisitions soulèvent des préoccupations concernant la restitution des œuvres volées ou spoliées à leurs pays d'origine.
- Justice culturelle et réparations : pour de nombreux pays d'origine, la restitution des œuvres d'art revêt une importance symbolique et culturelle significative, représentant la reconnaissance des injustices passées et la réparation des dommages causés par la colonisation et le pillage culturel.
- Débats éthiques et juridiques : les restitutions d'œuvres d'art soulèvent des questions éthiques et juridiques complexes, notamment en ce qui concerne la propriété légale, les droits de restitution et les limitations de prescription. Les musées européens doivent naviguer avec précaution dans ces débats pour garantir des solutions justes et équitables.
- Dialogue et coopération : le dialogue et la coopération entre les musées européens et les pays d'origine sont essentiels pour aborder ces questions de manière constructive. Les musées peuvent travailler en partenariat avec les gouvernements, les institutions culturelles et les communautés locales pour trouver des solutions mutuellement bénéfiques qui respectent les droits.
Myrrha : Fait une blague qui ferait rire un muséographe.
Chagpt 3.5 : Pourquoi les cimaises sont-elles toujours de bonne humeur au musée ?
Parce qu'elles savent toujours comment accrocher !
Suite à cette expérience, Myrrha indique que les réponses sont intéressantes mais génériques et neutres. Elle conclut qu’elle peut envisager l’outil comme un point de départ pour sa réflexion professionnelle, mais qu’il est important de vérifier les informations et d'apporter des perspectives originales afin d'aller au-delà des réponses standardisées.
On peut voir que les interactions avec ChatGPT n'apportent pas toujours de nouvelles connaissances (ni les meilleures blagues) mais elles donnent un condensé de recherche qui peut être intéressant sur certains sujets. Si on espère que les machines ne prennent pas le pas sur l’humain dans le processus créatif, elles peuvent être de bons alliés dans les pratiques professionnelles de demain.
C’est d’ailleurs un sujet abordé dans l’exposition “IA: Double Je”, actuellement au Quai des Savoirs à Toulouse, avec la notion de métier remplacé et métier épaulé. Un quizz permet de découvrir quelles missions pourraient être automatisées, telles que des tâches répétitives avec une application stricte de règles et de consignes ne nécessitant pas la compréhension des émotions ou du langage non verbal. Ainsi, le dispositif met en avant le fait que peu de métiers disparaîtront, mais qu’ils sont plutôt voués à évoluer.

Quizz “Es-tu remplaçable ?”, exposition “IA: double je”, Quais des savoir et Cité des Sciences et de l’industrie
Dans cette évolution, il est important de reconnaître le potentiel des musées dans l’éducation et la sensibilisation à ces nouvelles technologies. En tant qu'espace de facilitations, il y a un rôle à jouer dans la compréhension de ce que sont les outils d’intelligences artificielles.
Pour aller plus loin :
- https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/exposition-ia-double-je/
- https://www.icom-musees.fr/ressources/et-demain-intelligence-artificielle-et-musees
#intelligenceartificielle #mediationinnovante #muséenumérique

On refait la visite !
Samedi 4 Mars. Jour de pluie. Nous avons choisi de visiter le Musée d’Histoire Naturelle de Lille. Lieu étrange baigné dans une atmosphère emprunte de nostalgie, sa visite fait naître chez nous bien des discussions.
© A. Erard et O. Caby
Océane [replie son parapluie et s’exclame] : Quel endroit sombre !
Anna[cherchant l’accueil du regard] : Alors, où se trouve l’accueil ?
Océane : Viens voir ! Cette vitrine est utilisée comme boutique ! Il y a deux livres et quelques cartes postales.
Anna : Ah oui … il n’y a pas grand-chose ! Bon, quel est le sens de visite ?
Océane : Il n’y a pas vraiment de sens de visite, on peut suivre l’ordre chronologique ? Je veux commencer par voir les dinosaures.
Anna : Ils sont imposants, tu crois qu’ils sont à l’échelle des dinosaures de l’époque ? C’est assez bien fait…
Océane : C’est dommage qu’ils soient mal éclairés.
Anna: Oui, mais ils sont représentés dans leur environnement, à l’époque carbonifère, ils ne se sont pas contentés de les poser juste là.
Océane : C’est vrai, il y a même une maquette montrant l’état des sols de cette période mais elle n’est pas très claire.
Anna [se dirigeant vers l’escalier] : Regarde ! Des fossiles, ils sont bien cachés, et ce n’est pas très lumineux. Cet espace n’est pas attrayant, nous sommes les seuls visiteurs à cet endroit-là.
Océane : Il y a quand même un jeu à côté des arbres carbonifères, il permet aux enfants de reconnaître des empreintes d’animaux et des fossiles de plantes. Tu vois le principe du jeu : Les faisceaux lumineux éclairent les animaux du décor, et l’enfant doit les associer avec les fossiles. C’est une sorte de QCM en trois dimensions.
Anna [montant les escaliers] : C’est incroyable, j’ai l’impression d’avoir fait un saut dans le temps, on se croirait dans un cabinet de curiosité du 18ème siècle !
Océane : Oui, avec cette accumulation d’objets on croirait vraiment avoir changé d’époque !
Anna : Encore des fossiles ! Les équipes du musée ont choisi de nous donner les explications de deux façons : des cartels ou bien des panneaux au mur.
© A. Erard et O. Caby
Océane : Oui, il y a des cartels qui sont récents et d’autres, ces petits-là [montrant des écriteaux jaunis autour d’une vitrine] sont clairement d’un autre âge.
Anna : Comme les fossiles !!
Océane : Le langage utilisé est complexe et je ne suis pas certaine que ces cartels apportent réellement des éléments de compréhension au visiteur.
Anna : D’autant plus que certains cartels sont déchirés, décollés, et d’autres ne sont associés à aucun contenu. Regarde ce cartel par exemple, il indique un jeu qui consiste à ouvrir des tiroirs pour découvrir des informations mais il n’est même pas possible de les ouvrir. Ce jeu nécessite vraiment une mise à jour… comme beaucoup d’autres éléments. Autrement, les informations sont intéressantes pour tous ceux qui veulent acquérir plus de connaissances scientifiques.
Océane : Le regard est attiré au premier abord vers le contenu des vitrines plus que vers les cartels explicatifs. Souvent, le visiteur ne les lit que lorsqu’il veut véritablement en apprendre plus sur les éléments exposés parce qu’ils l’intriguent.
Anna [continuant la visite] : Des aquariums ! Étonnant de tomber sur des poissons vivants juste après être passés devant des fossiles.
Océane : Ils illustrent le passage de la vie dans la mer à la vie sur terre. Les poissons sont les premières espèces à avoir évolué mais il existe encore des poissons préhistoriques dans les océans.
Anna : Je suppose que nous ne devrions pas être surprises de voir ces crânes conservés en vitrines, puisque nous nous trouvons à un mètre d’un squelette de baleine suspendu au-dessus de nos têtes …
Océane : Regarde : une des vitrines présente des crânes humains, c’est une reproduction de ce qui se faisait au XIXe siècle, à l’époque des théories raciales. Sur le cartel il est écrit : “Cette vitrine, ancienne (XIXème s), est conservée au titre de témoignage de théories idiotes, racistes et dangereuses qui ont pu avoir cours par le passé.” C’est très intéressant de montrer ça au visiteur !
© A. Erard et O. Caby
Anna : J’ai l’impression d’être dans le cabinet du professeur Rogue dans Harry Potter !
Océane : Justement, regarde ces bocaux là-bas !
Anna : Tiens-toi prête, j’espère que tu ne crains pas les bestioles conservées dans des bocaux !
Océane : Tout dépend du type d’animaux conservés dans le formol !
Anna [imitant un guide de visite] : Après les poissons en aquarium, vous trouverez sur votre droite de jolis exemplaires de poissons morts conservés dans du formol pour le bien des études scientifiques ! Mais ce n’est pas tout, étendez votre regard, et voyez donc ces spécimens de reptiles allant du lézard au serpent, de quoi faire de merveilleuses potions magiques !
Océane : Quelle plongée dans l’ambiance d’un cabinet d’étude ! Toutes les prochaines vitrines exposent des animaux empaillés en surnombre ! Redescendons voir ce qui reste à visiter au rez-de-chaussée.
Anna : Je perçois vaguement des insectariums, va voir, je crois qu’il y a des mygales ! Regarde celui-ci ! A ton avis, combien y-a-t-il de blattes ? Elles sont toutes les unes sur les autres.
Océane : Au moins ça fait le bonheur des enfants ! Regarde, ils sont tous fascinés par ces insectes !
Anna : Ce qui est sûr c’est que de voir des serpents ça ne fait pas mon bonheur…
Océane: Pourquoi le musée a-t-il fait le choix de montrer des animaux vivants à côté de leurs collections d’animaux empaillés ?
Anna : Pour montrer l’évolution de certains animaux ? Rendre le musée attractif ? S’adresser à un public large ?
Océane : Ce qui est intéressant c’est la vitrine dans laquelle la taxidermie est expliquée. Elle permet au visiteur de comprendre en quoi cela consistait et pourquoi était-elle si couramment utilisée au cours des siècles derniers.
Anna : Les reconstitutions d’habitats sont assez étonnantes. Voir ces animaux empaillés sous vitrine et surtout dans des positions improbables, ne rend pas vraiment compte de la réalité. Regarde ce lièvre, ils l’ont mis dans une posture qui laisse penser qu’à cette allure il risque de se cogner violemment contre la vitre.
© A. Erard et O. Caby
Océane : Au contraire, ces illustrations sont assez réalistes, mais ces scènes en arrêt sur image ont beau être probables elles paraissent étranges ainsi suspendues. Je pense que ces reconstitutions sont surtout adressées à un public plus jeune afin de montrer différents espaces naturels et les animaux qui les habitent.
Anna : Passons à la salle suivante !
Océane : … étrange, cette salle ne comprend que des vitrines remplies d’oiseaux empaillés !
Anna: Quel est l’intérêt de montrer autant d’espèces et où sont les cartels ? Il y a tellement d’oiseaux et d’informations visuelles que l’on passe très vite devant ces vitrines. Cela serait plus intéressant si certaines espèces avaient été mises en avant. Particulièrement des spécimens rares. Cela attirerait davantage notre regard et changerait le rythme de la visite.
Océane [passant à la dernière salle] : Cette dernière salle est vraiment plus épurée que les précédentes. Les animauxne sont plus sous vitrines ce qui crée une réelle proximité avec le visiteur. Les explications des cartels sont d’ailleurs plus claires.
Anna : Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un dauphin à côté de toutes ces espèces, c’est le seul animal aquatique de cette pièce et il est placé sur un socle au même titre que les autres.
Océane : C’est peut-être parce que tout le monde aime les dauphins ! Mais il n’y a pas véritablement de lien avec le reste des animaux représentés, bien qu’il soit positionné à côté d’une otarie.
Anna : La dernière vitrine crée un bel effet. Bien que les animaux ne fassent pas tous partie du même environnement, l’agencement et le décor rendent la reconstitution intéressante. L’espace est en hauteur, tous les animaux ne sont pas placés sur un même niveau. Nous sommes loin de l’impression d’empilement de la pièce ornithologique malgré le grand nombre d’espèces représentées.
Océane [se dirigeant vers la sortie] : En reprenant les codes d’exposition des siècles passés, le musée peut parfois être oppressant. Cela dit il nous permet de nous rendre compte de ce qu’était les premiers musées d’histoires naturelles ou cabinets de curiosité. Après ce type de visite il est facile de voir l’évolution muséale qui s’est appliquée dans ces structures mais sans doute ce musée va-t-il être modernisé ?
Anna : Effectivement il doit l’être, quitte à restreindre le nombre d’objets ou d’espèces présentées … Actualiser les cartels et les informations écrites permettrait de proposer une expérience de visite plus attractive. Les vitrines renfermant les animaux empaillés sont elles aussi à reconsidérer.
Océane : Cette visite étant réellement intéressante, j’ai l’impression d’avoir fait un voyage dans le temps !
Anna : Et puis c’est sympa de visiter un musée dont la boutique ne propose pas de peluches banales. Il est assez représentatif des anciens musées d’histoire naturelle avec ses vitrines d’époque.
Océane Caby & Anna Erard
#mhnlille#histoirenaturelle
Pour en savoir plus :
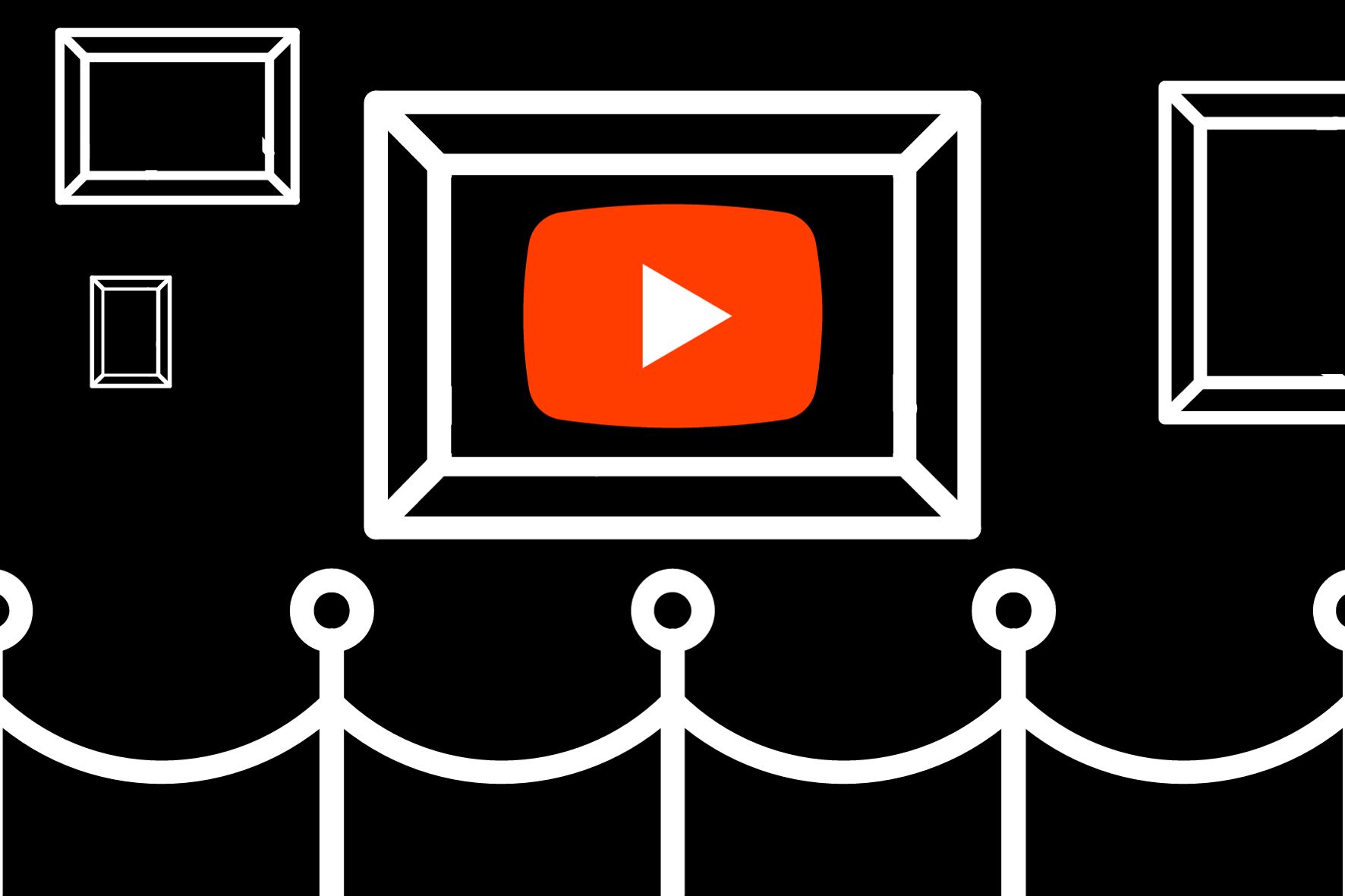
Où sont les musées sur Youtube ?
L'art, l'histoire et la culture sont-ils vraiment à portée de clic ? Partons à la découverte de quelques initiatives !
Youtube en quelques chiffres :
- YouTube est le 2eme site le plus visité au monde derrière Google.
- 40 millions de Français utilisent YouTube chaque mois.
- YouTube Shorts enregistre 50 milliards de vues par jour dans le monde.
- En moyenne, les utilisateurs de YouTube y passent 27h26 par mois, ce qui en fait la 2eme plateforme sociale en termes de temps passé par mois, derrière TikTok (33h38).
- Les 15-24 ans passent 1h08 par jour en moyenne sur YouTube.
Emma Levy
Pour en savoir plus :
- Appoline Reisacher, Chiffres YouTube : les statistiques à connaître en 2023, 13 novembre 2023

Pied-il ? Vos pas au musée...
Les musées investissent de plus souvent dans des outils de médiations mobilisant les sens : odorat, ouïe, vue, toucher. Des artefacts sont reproduits pour permettre au public de créer un lien avec l’objet, découvrir un de ses aspects, ses détails, de véritables outils
peuvent même parfois être touchés et les manipes manuelles connaissent un grand succès en particulier dans les musées scientifiques. Mais les mains peuvent être porteuses de germes et rendre frileux les musées à la suite de la covid 19. Quand est-il de leurs cousins, les pieds ? Souffre-douleur des visites muséales, peuvent-ils devenir des alliés ?
Marcher dans l’art
Certaines œuvres d’art demandent un engagement du corps : en jouant avec la sensibilité des pieds, premiers explorateurs du monde physique, l’artiste imprime son œuvre à travers la peau du visiteur.
Au Japon notamment, enlever ses chaussures relève d’une pratique culturelle, de respect et de politesse, pour éviter de salir les sols et de marquer la différence entre l’intérieur et l’extérieur. Au musée d’art de Teshima sur l’île de Taoshima, l’île musée du Japon, cette séparation intérieur / extérieur est floutée par l’œuvre permanente Matrix de Rei Naito, créée en 2010. Dans ce bâtiment en forme de goutte, le visiteur déchaussé entre dans un dôme blanc ouvert sur le ciel et évite les gouttes d’eau apparaissant sur le sol lisse légèrement pentue. Le silence du lieu est rempli par le chant calme de la nature et les gouttes d’eau qui ruissellent, grossissent, finissent en flaques et disparaissent. L’espace invite à déambuler, laisser les gouttes vivre, méditer, se reposer. L’apaisement et la proximité avec l’instant présent s’installent. La séparation intérieur / extérieur n’existe plus.

© Licence creative commons, Matrix by Ryue Nishiazwa in Teshima Art Museum, Taoshima, 12 mars 2011
Les membres de TeamLab Planets et TeamLab Borderless de Tokyo vont encore plus loin dans les sensations décuplées par nos voûtes plantaires. Nouveau musée d’art numérique faisant intervenir le corps dans l’art, leurs dispositifs sont plébiscités par le public connecté et leurs réseaux sociaux. Les salles sont des œuvres digitales interactives géantes réalisées par différents artistes où ni chaussures ni chaussettes sont les bienvenues.
Au TeamLab Planets basé à Toyosu Tokyo, tantôt, une pièce est recouverte du sol au plafond de coussins rebondissants, tantôt, elle est remplie de centaines de guirlandes lumineuses se reflétant dans les miroirs recouvrant la salle. Entre les moments d’euphories et d’émerveillements, les pieds traversent de longs couloirs sombres et noirs les préparant aux prochaines sensations. Peu à peu, un pédiluve incontournable apparaît, et plus loin, l’eau commence à monter. Il faut relever ses vêtements au-dessus des genoux. L’eau blanchâtre est trouble : le dégoût d’imaginer les objets flottants provenant des milliers de participants journaliers est balayé par un savant spectacle. Des carpes stylisées et multicolores tournent autour des individus, explosent en fleurs de cerisier s’ils osent passer sur une carpe, le tout en rythme sur des compositions sonores originales. À la sortie, des agents veillent à donner des serviettes individuelles. Des bancs permettent de se sécher et de lire pour les rares curieux le cartel explicatif, toujours exposés après l’expérience.
Contrairement à Teshima, où une place est faite à la nature, à la médiation et où les photos sont interdites, depuis 2018, TeamLab Borderless à Tokyo exploite le numérique et sa force visuelle engloutit les réseaux. L’usage du corps devient sensationnel. Les espaces de calme où sont exposés les uniques outils de médiations que sont les cartels, sont disponibles entre chaque salle, mais voient surtout passer à la chaîne des visiteurs notifiant peu les cartels. Visiter Teamlab demande de réserver des jours en avance : ce succès économique et médiatique montre l’appétit du public pour l’interactivité et l’usage du corps, quoi qu’il touche. Cependant, le manque de médiation et d’information concernant la collecte, la conservation et l’interprétation de ce nouveau patrimoine numérique ne permet pas encore de classer ce lieu parmi les musées au sens de l’ICOM.

© Tiphaine Schriver, Teamlab Planets, Tokyo, mai 2024
En Europe, le centre d’architecture danois a réussi à marier l’aspect méditatif, sensible et pédagogique des sensations plantaires avec son exposition Irreplaceable landscapes de 2019 dédiée à quatre projets d’architecture sur des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. En marchant déchaussé sur la reproduction échelle 1 d’une partie d’un toit en paille, le visiteur ressentait à travers son corps la fragilité et la puissante de ces sites, traduire dans cette architecture. En marchant ou en s’allongeant sur ce toit, le piquant et la résistance des milliers de pailles rassemblés se ressentait à travers les vêtements. Des projections des paysages de la mer du Nord, des sons d’oiseaux et de vagues étaient diffusées tout autour.

© Rasmus Hjortshøj, Irreplaceable Landscapes, Dansk Arkitektur Center, Copenhague, 2019
Les bâtiments muséaux sont eux-mêmes des œuvres, des terrains à découvrir déchaussés. Noémie Boudet analysait en 2012 les visites guidées pieds-nus multisensorielles de la piscine de Roubaix. Ces visites offrent le temps “d’apprécier la texture du sol, la différence de température” et sont un “prétexte pour découvrir La Piscine et son [1]”. A première vue déconcertantes, ces visites jouant avec les sens et menées par des professionnels convainquent même les plus réfractaires. Treize années après, le succès des médiations de la Piscine ne sont plus à prouver.
Le sol : un terrain pour l’apprentissage
La scénographie, porteuse de sens, peut s’amuser à enrichir le discours muséographie en travaillant les sols.
La première salle du Musérial au Fort des Dunes à Dunkerque projette un court-métrage sur l’histoire de la mer du Nord. Surprise : le sol de la salle, d’une matière proche des sols amortissants de parc pour enfants, a les courbes de dunes, comme si le visiteur était sur le bord de la mer. Le sol est mou, couleur sable. Chaque petite dune peut devenir une assise et des bancs sont installés. Pour les visiteurs arrivés au musérial depuis la terre, cela permet de localiser le musée sur son littoral et de donner un contexte.
Au musée Moesgård, situé à Aarhus au Danemark, l’espace est consacré à la période historique de 500 av. n. è. et 800 de n. è., raconte les perturbations du mauvais temps sur l’agriculture et les paysages danois. Cet espace symbolise également une tourbière. Les pieds s’enfoncent de quelques centimètres, l’équilibre est vite retrouvé, et les visiteurs comprennent que les objets qui les entourent ont été retrouvés dans cette terre, alors gorgée d’eau et difficilement exploitable. Au centre, la tourbière révèle le corps momifié de l’Homme de Grauballe, le corps des tourbières le mieux conservé au monde grâce à la composition de sa terre.
Enfin, le sol peut faire vivre des expériences et apprendre. SPARKOH !, musée descience à Mons en Belgique a une plaque vibrante sur laquelle il faut se mettre debout pour ressentir des séismes de plus en plus fort. Au 30ème anniversaire de la Maison de la Brique à Saint-Martin-d’Aubigny, un parcours sensoriel extérieur invitait à se déchausser pour reproduire le “marchage”, une technique ouvrière passée. En foulant les pierres, l’eau s’imprégnait de manière homogène dans la fosse de pourrissage. Grands et petits foulaient sur la fosse différents matériaux de l’univers de la brique, découvraient ce lieu et cette
technique, le tout, en un parcours sensoriel et pédagogique. Un sentier similaire de 1600
mètres a été développé au Préhistomuseum de Flémalle, en Belgique. Le parcours pieds nus situé dans la forêt déjà très apprécié des visiteurs a été complété en 2023 de 17 expériences sensorielles telles que marcher sur différents matériaux naturels, écouter le vent secouant les feuilles, sentir les plantes, raconter des histoires sur l’origine de la Terre...
Le sens de la marche
Employer le pas et le pied de manière différente de leur fonction habituelle de déplacement dans une exposition peut donc se révéler porteur de sens, émerveiller et redynamiser la visite. Dans ces exemples, l’expérience du sol est profondément liée à l’environnement naturel et permet de renouer avec la sensibilité de cette partie du corps qui nous relie à la Terre.
Un contre-exemple, peut-être révélateur de l’efficacité du lien pied / nature, et de l’importance de l’objectif artistique ou pédagogique de son usage, est celui de la Villa Carmignac, à Porquerolles, en France. L’exposition intérieure se visite pieds nus. Le but : créer une proximité et être plus détendu selon le directeur. Initiative originale et amusante au début, cela ne suffit tout de même pas à combler la distance entre le visiteur et les œuvres contemporaines. Les longs cartels, le manque de bancs pour profiter des vues sur le jardin, et le nombre de médiateurs, bienveillants, aussi nombreux que les visiteurs une après-midi de vacances scolaires, n’aident pas. La pierre fraîche du sol reste lisse et monochrome tout au long du parcours intérieur. A son terme, il n’y a plus qu’à remettre ses chaussures.

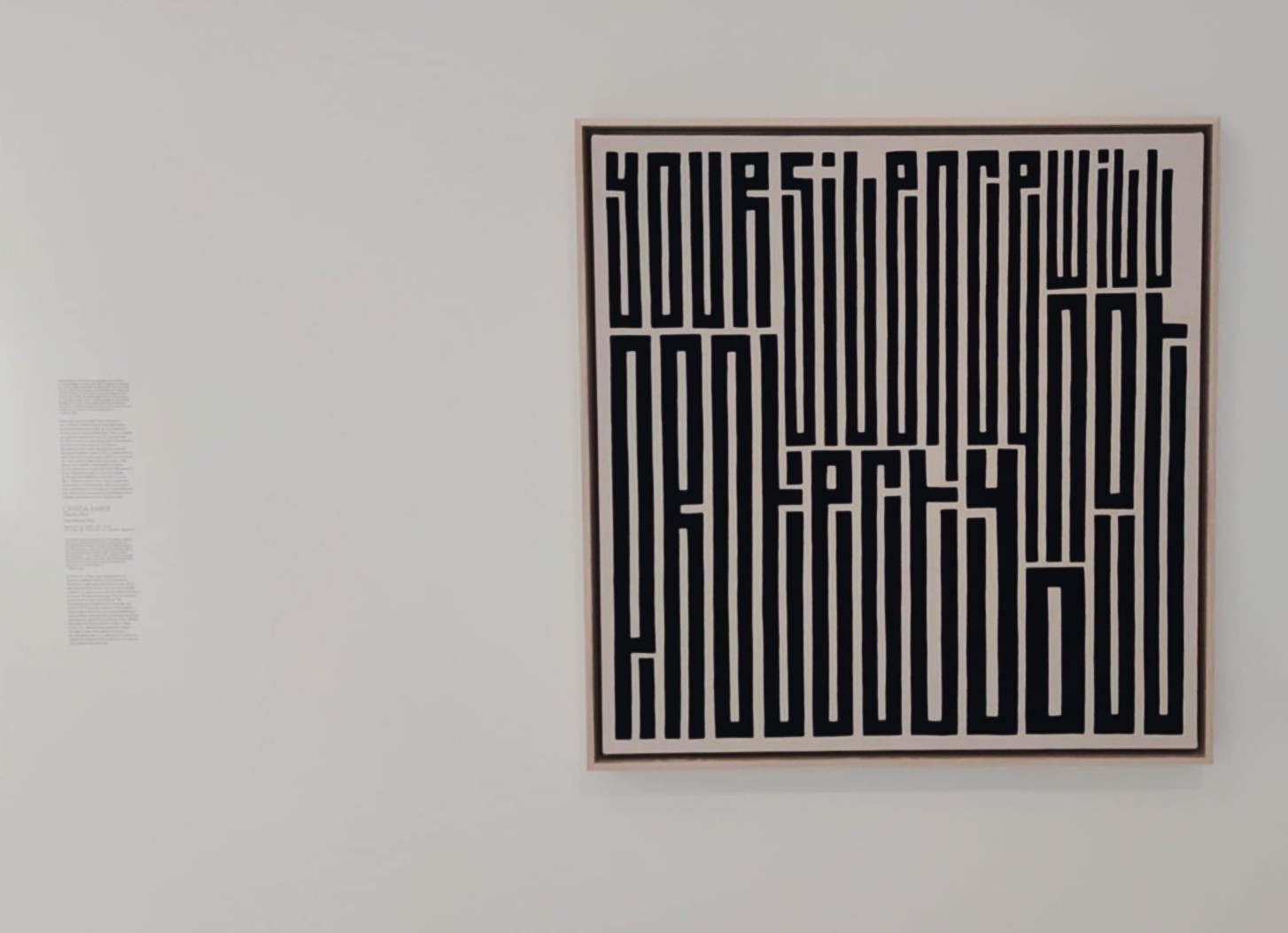

© Tiphaine Schriver, Exposition The Infinite Woman, Villa Carmignac, Porquerolles, octobre
2024
Tiphaine Schriver
[1]Voir l’article “La Piscine, championne de médiation”, rédigé par Noémie Boudet, publié le 28 octobre 2012, sur le blog L’art de Muser ↩

Pour des transports d'œuvres plus respectueux de l'environnement
Lorsqu’on s’intéresse à l’impact écologique des expositions temporaires, trois facteurs extrêmement polluants sont en première ligne : le transport des visiteur·euse·s, la manutention des œuvres (leur emballage et leur transport) et la scénographie. Dans cet article, il sera question du transport des œuvres : comment est-il possible de réduire son impact environnemental ? En quoi cette réduction peut être bénéfique pour la sécurité des œuvres ?
Image d'en-tête : Le transport durable @Sophie Delmas
Les impératifs du transport des œuvres
Le transport d’œuvre implique à la fois son acheminement, en bon état et dans les délais impartis, mais aussi bien souvent son emballage et l’accompagnement des institutions. Le transport se fait souvent par externalisation, c’est-à-dire que les institutions culturelles font appel à une société extérieure, qui a un rôle de coordinateur et d’organisateur. Celle-ci va accompagner les musées dans des démarches administratives (comme les douanes), les conseiller sur le mode de transport adéquat, superviser le chargement et déchargement des œuvres, etc. C’est un métier soumis à de nombreuses contraintes : d’une part les sociétés sont soumises aux exigences des institutions (budgets limités, changements de dernières minutes, etc.), d’autre part elles doivent pallier les risques présents lors du transport de l’œuvre.
Les moyens de transports les plus utilisés
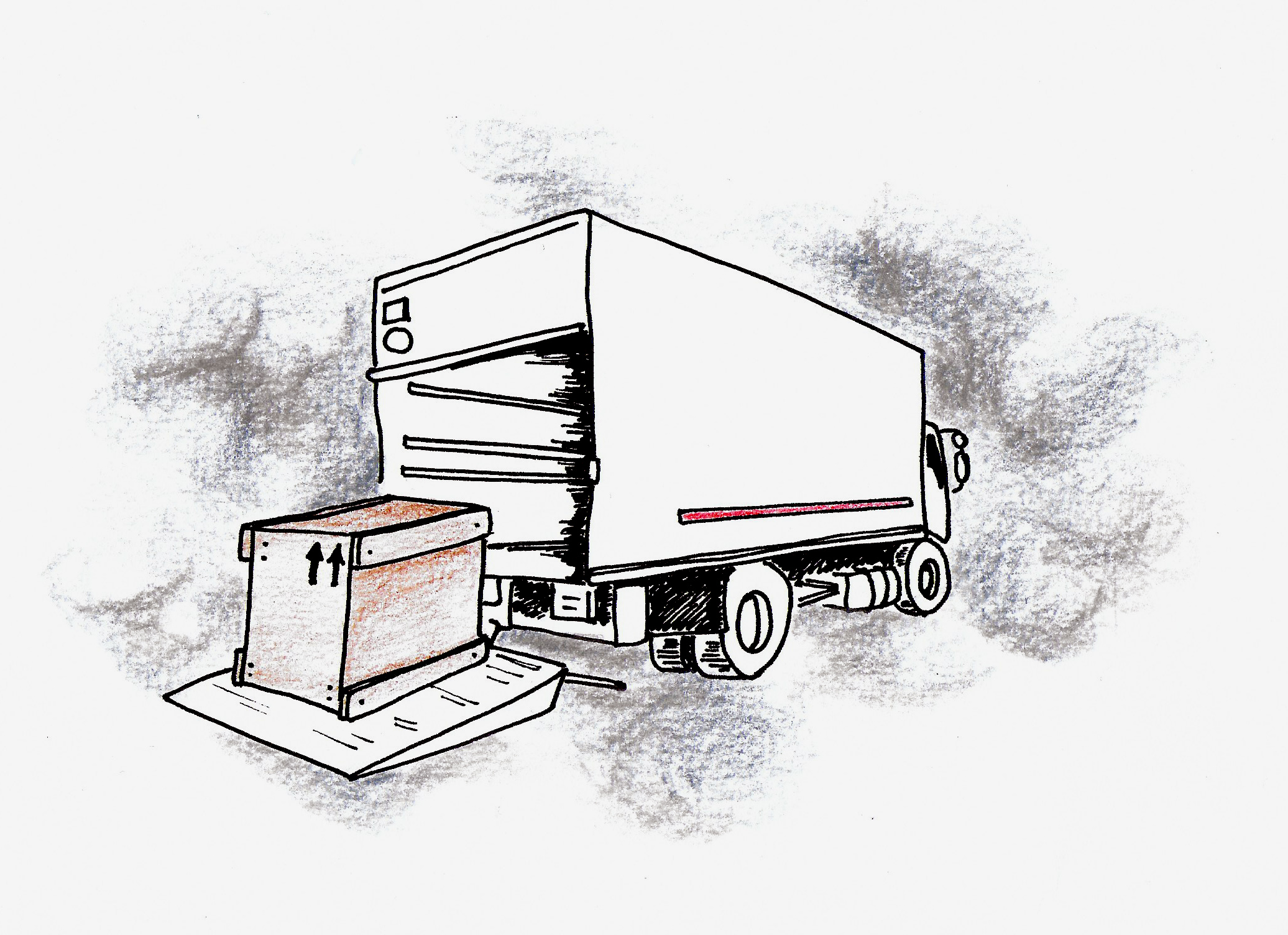
La pollution c’est moche – @Sophie Delmas
D’autres alternatives à explorer ?
Utiliser d’autres modes de transports
Certain·e·s professionnel·le·s de musée dénonce ces modes de transport, en particulier l’avion. C’est notamment le cas de Peter Cannon-Brookes, conservateur britannique, dénonce notamment ce recours systématique à la voie aérienne dans son article « Le transport d'œuvres d'art : diversifier les stratégies ». Selon lui, les stratégies de transports développées par les musées privilégient d’après lui la réduction de la durée d’exposition à la protection de l’œuvre. L’auteur défend l’idée selon laquelle le recours systématique à l’avion découle d’une méconnaissance et d’un manque de pratique des autres moyens de transports. L’avion aurait souvent été plébiscité comme le moyen le plus sûr, les sociétés minimisant les risques pour les œuvres et arguant que ceux-ci étaient surtout liés à des agissements délictuels et aux incendies. Pourtant, les demandes d’indemnisation causées par de mauvaises manipulations ou un environnement défavorable excèdent celles liées aux agissements criminels ou aux incendies. Si l’avion n’est donc pas le mode de transport le plus sûr pour l’œuvre, et qu’il en plus extrêmement polluant, vers quels moyens de transports les musées peuvent-ils se tourner ?
Cependant, tout comme le train, le bateau a lui aussi connu des améliorations et aujourd’hui des objets précieux voyagent par la voie maritime. C’est un moyen de transport particulièrement économique, comparé à l’avion. Les conteneurs maritimes assurent une plus très grande stabilité climatique à l’œuvre.
Mutualiser transports et convoyeur·euse·s
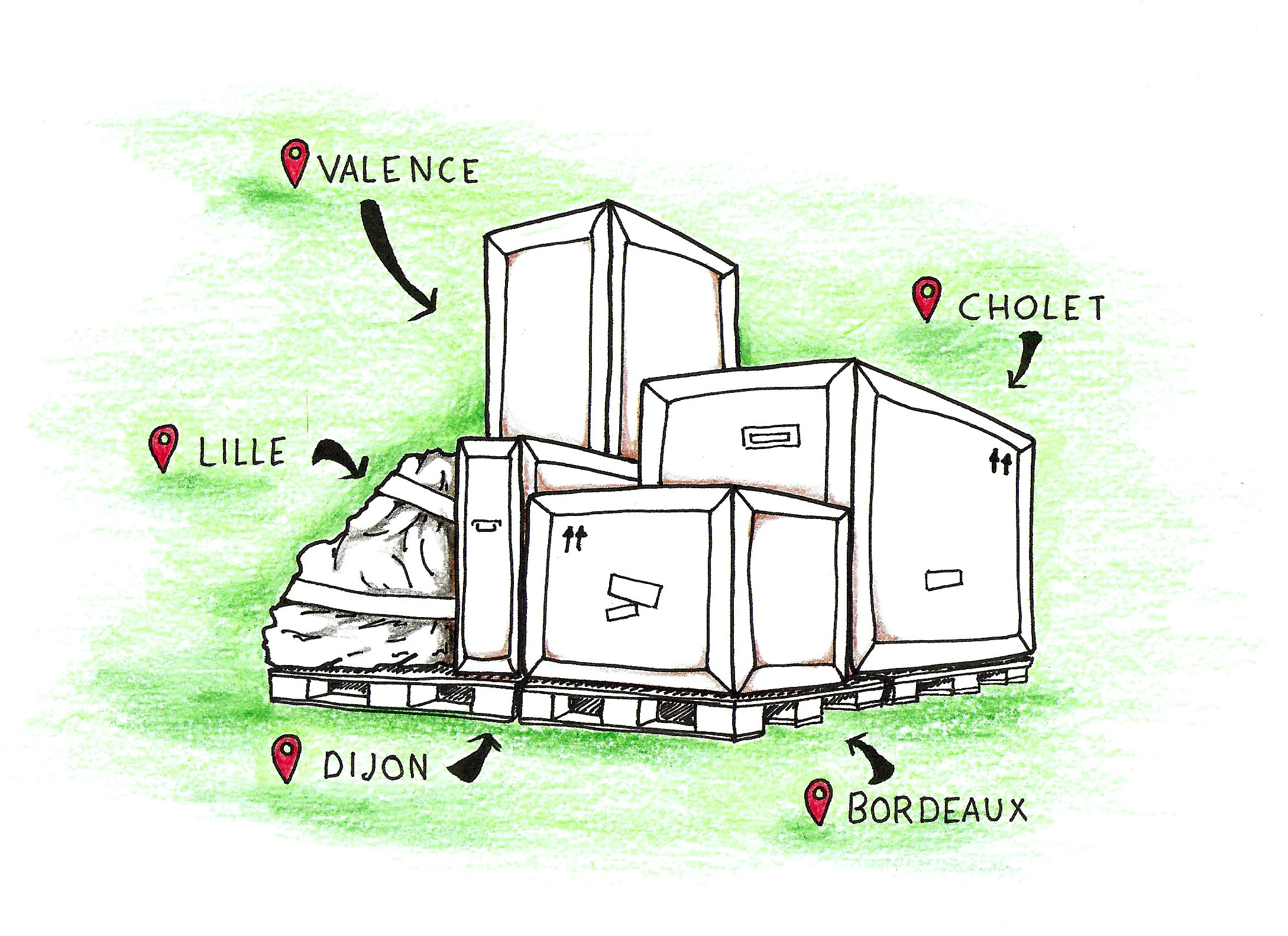
Vive la mutualisation des transports ! – @Sophie Delmas
E. V-P
[1]Les oxydes d’azote (NOx) sont produits par la combustion d’énergies fossiles et entraînent une pollution de l’air (contrairement aux GES qui entraînent un dérèglement du climat). Ils favorisent la formation de la couche d’ozone dans les basses couches de l’atmosphère, et jouent un rôle dans l’apparition de particules fines. Les NOx sont 40 fois plus toxiques que le monoxyde de carbone (CO) et sont très dangereux pour la santé ↩
Bibliographie :
- Elise Vassiliadis-Poirey, Une exposition temporaire et durable est-elle possible ? Une revue raisonnée des pratiques de l’éco-conception, Mémoire de recherche : Master 2 de recherche appliquée à la muséologie, sous la direction de Cécilia Hurley-Griener, Elsa Boromée et Mai Ngyuen, Janvier 2021.
- European Environment Agency, European Union emission inventory report 1990-2018 under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP), mai 2020, en ligne, [PDF, téléchargé sur : https://www.eea.europa.eu//publications/european-union-emission-inventory-report-1990-2018].
- GIEC, Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, en ligne, [URL : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_full.pdf].
- LP ART, Le guide : transport d’œuvres d’art et expositions, 2007, en ligne, [URL : https://www.lpart.fr/api_website_feature/files/download/5196/LE-GUIDE-DU-TRANSPORT-D-UVRES-D-ART-ET-D-EXPOSITIONS.pdf].
- Marie Fekkar, Transport des œuvres et développement durable, concilier l’inconciliable, Mémoire d’étude : Master 1 de muséologie, sous la direction de Florence Bertin et d’Emmanuelle Bas, École du Louvre, Mai 2013.
- Nathan Stolow, La conservation des œuvres d’art pendant leur exposition et leur transport, Paris, UNESCO, 1980.
- Peter Cannon-Brookes, « Le transport d'œuvres d'art : diversifier les stratégies », in Museum International, Paris, UNESCO, n°186, vol. 47, n°2, 1995.
- Pierrette Besse, Le développement durable dans la production des expositions temporaires : les moyens mis en œuvre par la Bibliothèque nationale de France et les institutions muséales, Mémoire de stage : Master 2 Métiers du Patrimoine, sous la direction de Hélène Vassal, Isabelle Loutrel et Anne-Hélène Rigogne, École du Louvre, Mai 2012.
#écoconception #transport #développementdurable

Prescription anti-blues d'hiver
Docteure BONHEUR
Médecine muséale
TEL : JPPDLDPRME
ENCADBLUES
Comment apaiser le stress, l’anxiété ? L’association des Médecins Francophones du Canada ont misé sur les bienfaits du musée. Les études ont prouvé que l’art avait un impact sur la santé alors cette ordonnance s’adresse aux patient.es atteint.es de différentes pathologies, quelles qu’elles soient.
MUSEOLEN (Ralentir)
Le musée. A la rencontre de l’art, des autres ou de soi-même. Lieu d’échanges, de transmission. Se perdre dans le temps, l’oublier. S’arrêter, respirer. Au temps où nos vies vont à un rythme effréné, nous ne prenons pas le temps de faire une pause. Le musée ou autre lieu d’art, nous propose de contempler, d’observer les œuvres, et de s’observer soi. Prendre le temps ramène à un rythme cardiaque plus lent car nous vivons dans un monde où observer s’apparente plus à capter, capter une image, un mouvement, un souvenir sans trop regarder de près, chercher ou s’attarder. En soi, observer apaise, puisque toute notre énergie se concentre sur une œuvre.
PRESEXPERUM (Prescriptions Médicales)
« On s'est dit que ce serait plus facile de convaincre les patients d'aller au musée que de s'engager dans un atelier d'art-thérapie », explique la docteure Hélène Boyer1, vice-présidente des Médecins Francophones du Canada. L’association a mis en place une phase expérimentale de « prescriptions médicales ». Depuis le 1er novembre 2018, des médecins de l’organisme MdFC sont autorisé.es à faire des ordonnances médicales pour prescrire des visites gratuites dans les musées à leurs patient.es. 2000 médecins participent à cet essai et peuvent prescrire cinquante ordonnances. Cette phase de tests pour quelques mois s’adresse en particulier à des patient.es présentant des difficultés psychologiques, des problèmes d’anxiété et de stress ainsi que de la morosité quotidienne. L’intérêt est double : vérifier que l’art a réellement un impact sur la santé et peut « guérir », et amener les patients à fréquenter ces lieux plus souvent. Cela questionne évidemment l’effet placebo et les limites de ces prescriptions.
ARTOBAM (Le Bam de l’art)
L’essai se fait avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Déjà sensibilisé à l’art-thérapie par de nombreux programmes et ateliers, le musée a souhaité s’investir dans ce projet qui tient particulièrement à cœur à Nathalie Bondil, directrice et conservatrice du MBAM. Le MBAM a notamment déjà mis en place un « atelier international d’éducation et d’art-thérapie » en 2016. Organisés par Michel de la Chenelière passionné d’art et d’éducation accompagné d’un art-thérapeute, ces ateliers proposent par exemple des séances de yoga au musée pour les 65 ans et plus souffrants de pathologies liées à l’âge.

Yoga-danse pour enfants au Musée des Beaux-arts de Québec © MNBAQ
THERXION (Art-Thérapie)
Alain de Botton, auteur d’Art et Thérapie, ou comment l’art nous aide dans notre quotidien, estime qu’il est primordial à notre vie parce qu’il propose des pistes de réponses à nos dilemmes. Pour le psychiatre Christophe André, la peinture se situe entre la littérature et la musique. La musique2 nous immerge, la littérature ouvre vers la réflexion : l’art donne le choix de l’immersion par les émotions et/ou l’ouverture vers la réflexion. Ainsi, l’art-thérapie stimule la créativité et l’ouverture aux sentiments. C’est une prise de conscience de soi. La contemplation d’une œuvre d’art permet d’accéder à soi-même. Si nous pouvons ressentir une émotion face aux œuvres, il faut aller vers quelques œuvres particulières, assumer sa subjectivité. Pour Alexia Guggémos, créatrice du Musée du Sourire, « face à une œuvre, on est émetteur et récepteur d’émotions »3. Il est également préférable de ne pas chercher les effets des œuvres, car « la magie de l’art peut opérer » quand on ne la cherche pas. L’intérêt donc devant une œuvre est de se laisser immerger pour laisser venir ses effets, puis dans un second temps de faire une pause introspective.
ET MON CORPS LA-DEDANS ?
« L’art est bon pour le cerveau » dit le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux4. Mais comment l’art joue-t-il sur notre corps ? Selon Hélène Boyer, les hormones sécrétées lors d’une visite sont « responsables de notre bien-être »5. Aussi, que se passe-t-il dans notre cerveau ? D’après Jean-Pierre Changeux, devant une œuvre, « notre rétine répond aux couleurs »6. Les données enregistrées par la rétine sont transmises par les nerfs optiques au cerveau dans les aires du cortex spécialisées. Combinées, nous avons dans notre cerveau une représentation formelle de l’œuvre. Tous nos souvenirs, nos images et idées se retrouvent alors directement assemblées par rapport à cette projection intérieure. Concrètement, une émotion vient parce que l’œuvre fait un rappel à un sentiment, à un souvenir. Ce sont ces échos en nous qui sont intéressants et qui font du bien.
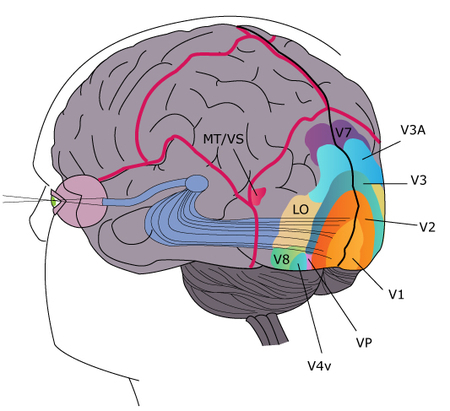
Aires du cortex cérébral © Maxicours.com
Aire V3 pour les formes et Aire V4 pour les couleurs.
Aller au musée pour s’apaiser et se recentrer est la mission première de ces prescriptions médicales particulières, sans effet secondaire. L’art-thérapie semble déjà avoir fait ses preuves et cette nouvelle initiative pourrait amener le Musée des Beaux-Arts de Montréal à créer des partenariats, par exemple en France avec le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice.
L.L.
#Antistress
#Prescriptionsmédicales
#Art-thérapie
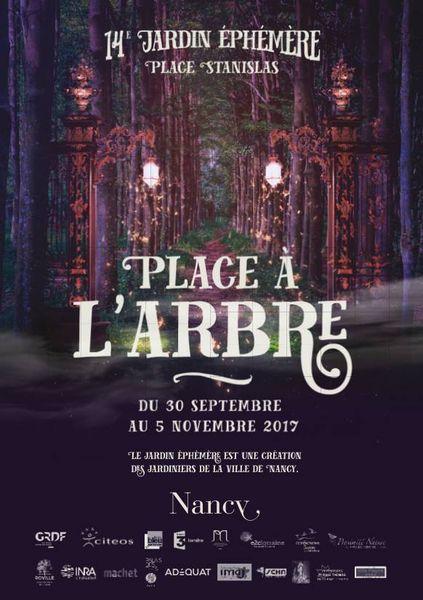
Quand la forêt s'invite sur les pavés
Pour sa 14ème édition, la ville de Nancy proposait un jardin éphémère permettant aux citadins de se plonger dans une forêt enchantée.
Pour sa 14ème édition, la ville de Nancy proposait un jardin éphémère permettant aux citadins de se plonger dans une forêt enchantée. Grâce à « Place à l’arbre », la statue de Stanislas et ses environs se paraient d’une dentelle végétale tout en plaçant au centre des attentions la figure de l’arbre. En effet, si les années précédentes les jardiniers de la Ville avaient mis en avant des dates anniversaires (205ème anniversaire du rattachement de la Lorraine à la France) ou encore questionnaient la place de la technologie dans les jardins pour l’édition passée ; cette année c’est la nature elle-même qui étaient montrée et racontée. « Place à l’arbre » vient sensibiliser le passant ou l’habitant sur le passé, le présent et le devenir de l’arbre au détour de 12 scènes végétales. Le jardin d’une surface de 3580 m² venait se déployer sous la forme en plan d’une feuille d’érable.
© Nancy-tourisme.fr
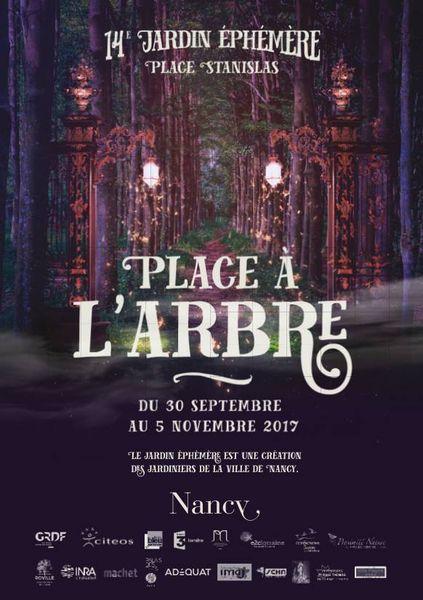 L’arbre. Ce végétal qui passe presque inaperçu dans nos espaces urbains vient s’épanouir au sein de cet ensemble architectural du XVIIIe siècle et révéler ses nombreux bienfaits. Par ce jardin éphémère le souhait de la Ville a été de rappeler le rôle de l’arbre comme acteur écologique et économique de notre Terre. Ainsi chaque espace d’exposition était agrémenté de textes venant informer le visiteur tant sur la surexploitation que sur l’utilisation des arbres dans le milieu médical.
L’arbre. Ce végétal qui passe presque inaperçu dans nos espaces urbains vient s’épanouir au sein de cet ensemble architectural du XVIIIe siècle et révéler ses nombreux bienfaits. Par ce jardin éphémère le souhait de la Ville a été de rappeler le rôle de l’arbre comme acteur écologique et économique de notre Terre. Ainsi chaque espace d’exposition était agrémenté de textes venant informer le visiteur tant sur la surexploitation que sur l’utilisation des arbres dans le milieu médical.
Dans cet espace de nature luxuriante pas moins de 219 arbres et 20 000 végétaux différents se côtoient. Le visiteur est invité à s’asseoir sur les bancs en bois ou à se balancer entre deux palmiers dans un hamac afin de prendre le temps, de respirer, de contempler. Dans un monde où le rythme de disparition de certaines espèces est 10 à 100 fois supérieur au rythme d’extinction naturel, l’Homme est convié à s’interroger sur le devenir de ces végétaux. On nous présente alors des plantes dites « endémiques », qui ne sont connues qu’en un seul lieu, vouées à disparaître si elles ne sont pas protégées.
© M. S.
 Ainsi les jardiniers de la Ville sensibilisent sur une de leur mission, à savoir la conservation et la protection de ces plantes « menacées ». Les jardins botaniques du Grand Nancy en partenariat avec l’Université de Lorraine, ont pour particularité de sauvegardes les plantes provenant des îles Mascareignes et de la Nouvelle Calédonie. Dans un propos plus large, « Biosphère III » (5ème tableau végétal), propose une prise de conscience collective en rappelant de manière poétique l’expérience « Biosphère II » (Nevada, 1987). Il s’agissait de créer un écosystème placé dans un dôme scellé, afin de voir s’il était viable pour la colonisation spatiale. L’échec de cette expérience incite donc à protéger l’existant, si dur à faire perdurer dans un écosystème qui n’est pas le sien.
Ainsi les jardiniers de la Ville sensibilisent sur une de leur mission, à savoir la conservation et la protection de ces plantes « menacées ». Les jardins botaniques du Grand Nancy en partenariat avec l’Université de Lorraine, ont pour particularité de sauvegardes les plantes provenant des îles Mascareignes et de la Nouvelle Calédonie. Dans un propos plus large, « Biosphère III » (5ème tableau végétal), propose une prise de conscience collective en rappelant de manière poétique l’expérience « Biosphère II » (Nevada, 1987). Il s’agissait de créer un écosystème placé dans un dôme scellé, afin de voir s’il était viable pour la colonisation spatiale. L’échec de cette expérience incite donc à protéger l’existant, si dur à faire perdurer dans un écosystème qui n’est pas le sien.

© M. S.
© M. S.
 Le jardin prend aussi un souffle artistique par diverses installations. Le bourgeon, future branche et symbole de croissance vient se matérialiser sous les mains d’un charpentier des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Ce bourgeon, en bois tortueux, vient se refléter et s’admirer dans un miroir dévoilant ainsi la naissance d’un autre. Le renouvellement de la nature est alors assuré. Cette structure vient en écho de l’œuvre du sculpteur Rachid Khimoune, l’Arbrœuf. Image d’une symbiose imaginaire entre le monde végétal et animal. L’œuf vecteur de vie, espace clôt et rassurant vient se conjuguer à la force de l’arbre, devenant le squelette de l’oeuvre.
Le jardin prend aussi un souffle artistique par diverses installations. Le bourgeon, future branche et symbole de croissance vient se matérialiser sous les mains d’un charpentier des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Ce bourgeon, en bois tortueux, vient se refléter et s’admirer dans un miroir dévoilant ainsi la naissance d’un autre. Le renouvellement de la nature est alors assuré. Cette structure vient en écho de l’œuvre du sculpteur Rachid Khimoune, l’Arbrœuf. Image d’une symbiose imaginaire entre le monde végétal et animal. L’œuf vecteur de vie, espace clôt et rassurant vient se conjuguer à la force de l’arbre, devenant le squelette de l’oeuvre.
Au détour d’un pont suspendu au-dessus d’un bassin, le visiteur survole une forêt équatoriale peuplée d’érables du Japon. Au milieu de ces végétaux aux multiples couleurs une percée noire et rouge attire l’attention. D’un coup, le croassement des corbeaux et le crépitement du bois surprend. Marc Namblar, audio-naturaliste musicien, vient manipuler les ondes sonores et plonge les passants dans une atmosphère particulière. La fumée s’échappant d’un tas de branches calcinée laisse deviner le rôle économique de l’arbre.
Le visiteur, observateur et acteur était invité à laisser une trace de son passage grâce à une craie, faisant de son message tout comme le jardin une action éphémère dans la ville.


© M. S.
Par ailleurs, cette nouvelle édition permet à la ville de Nancy de montrer son engagement écologique par le biais du plan « Zéro phyto », mis en place depuis 2005, assurant la non-utilisation de pesticides ou d’engrais sur tous les espaces verts de la ville. Pour ce tableau vivant, Pierre Didierjean, directeur des parcs et jardins de la ville de Nancy, s’est entouré dans un premier temps d’experts, avec une contribution bénévole parfois. C’est le cas de Jean-Paul Corneveau, architecte de la métropole, qui a aidé à la réalisation des structures, dont le foyer tropical. La ville met un défi supplémentaire à l’organisation de l’événement en ne mettant à disposition qu’une enveloppe de 10000€ de budget.
 Ainsi toutes les astuces sont permises comme la récupération ou encore l’écoconception, avec cette année la formation des jardiniers à la technique du « bois cousu ». Dans ce jardin rien ne se perd, tout se transforme. Une vingtaine de partenariat locaux a notamment permis le prêt des bancs, les perruches d’un éleveur ou encore les champignons d’une céramiste locale. L’événement automnal fermait ses portes ce 5 novembre et a comptabilisé plus de 720 200 visiteurs. Il ne vous reste plus qu’à vous réserver un week-end durant l’automne 2018 pour visiter le nouveau jardin éphémère conçu par les jardiniers de la ville de Nancy.
Ainsi toutes les astuces sont permises comme la récupération ou encore l’écoconception, avec cette année la formation des jardiniers à la technique du « bois cousu ». Dans ce jardin rien ne se perd, tout se transforme. Une vingtaine de partenariat locaux a notamment permis le prêt des bancs, les perruches d’un éleveur ou encore les champignons d’une céramiste locale. L’événement automnal fermait ses portes ce 5 novembre et a comptabilisé plus de 720 200 visiteurs. Il ne vous reste plus qu’à vous réserver un week-end durant l’automne 2018 pour visiter le nouveau jardin éphémère conçu par les jardiniers de la ville de Nancy.
© M. S.
Maëlle Sinou
#jardin
#nature
#nancy
Pour en savoir plus :
Le Jardin éphémère de la Place Stanislas
Quand le visiteur devient acheteur
Achètera, n’achètera pas, le visiteur du musée ne peut plus compter sur les musées pour sortir quelques instants de la société de consommation. Le passage par la boutique du musée, plus particulièrement dans les musées de Beaux-Arts, devient à lui seul obligatoire pour une exposition permanente à l’étal.
Image d'intro : Boutique de l’Exposition Munch au Musée d’Orsay©J.P
Une arrivée déroutante des boutiques dans les musées
Les premières boutiques informelles des musées remontent après la révolution où les élèves peintres, ayant un accès au Musée du Louvre avec les jours de la semaine réservés pour eux, vont copier les peintures de grands maîtres sur la demande d’un client. Ceci sera leur gagne-pain. Les boutiques, telles qu’elles sont aujourd’hui, apparaissent dans les années 1990 dans les musées et bâtiments patrimoniaux ouverts au public. Mais ces magasins ont la forme de petites boutiques avec quelques cartes postales accompagnées le plus souvent par un catalogue d’exposition. Depuis quelques années, ces boutiques se sont agrandies. Le visiteur se trouve souvent face à de multiples articles : livres, crayons, bonnets, savons, goodies.

Article de la boutique Musée d’Orsay©J.P
Ce phénomène ne cesse de s’étendre jusqu’à poser la question de savoir quel est l’espace demandant le plus d’énergie entre la boutique et l’exposition permanente ? Et ce qui attire le plus les visiteurs ?
Désormais quel musée n’a pas sa boutique, plus ou moins grande, et elle est accessible aux visiteurs, à l’entrée du musée ou bien en accès depuis l’extérieur sans passer par le hall d’entrée.
Posons-nous la question de l’origine des boutiques. Pourquoi ces dernières sont arrivées dans le musée ? Lieu qui semblerait être un endroit culturel et de détente. Les premières boutiques, comme magasin, sont apparus en France afin de permettre aux petits musées d’obtenir une source de revenus complémentaire aux aides de l’Etat ou au prix d’entrée versé par les visiteurs. C’est une forme de publicité gratuite du musée au travers d’objets customisés, qui repartaient dans les sacs des touristes en direction de toute la France et même du monde. Le musée alors dynamique attire le public. Et ce phénomène épouse le mouvement général d’une société de consommation, accrue dans les années 60.
Des boutiques devenant des lieux concurrentiels de l’exposition
Les boutiques sont majoritairement en sortie de l’exposition ou entrée du musée. Dans certains grands musées parisiens, comme le Musée d’Orsay, ces magasins seront même présents à tous les étages et dispersés dans tout le musée avec des articles liés aux œuvres de l’étage. La technique commerciale veut que le visiteur n’ait pas d’autre choix que de passer par la case de la boutique. Ainsi, tous les moyens sont bons : chemin banalisé, parcours obligatoire, présence à chaque fin d’époque exposée, etc. Tout est fait pour que le visiteur avant de sortir traverse la boutique dans son entièreté. Les vendeurs ne se privent pas alors d’exposer des articles plus attrayants les uns que les autres afin d’attirer le client. Les boutiques de certains musées, comme celui du parfum, deviennent à elles seules des vitrines d’expositions de musée, mais sans propos muséographiques, juste des vitrines du fait de la beauté des vitrines, de la présentation des articles et de leur spécificité. Entre les boucliers, et robes de princesses pour les enfants, les adolescents pourront trouver la trousse ou bien le tee-shirt souvenir, et les adultes un livre avec un lien plus ou moins lointain avec le musée. Il arrive même de trouver des éléments consommables, comme du thé ou bien du café, dans les boutiques de musées comme celui du Louvre à Paris. Le plus souvent, les boutiques se parent de cartes postales, objets souvenirs ou encore de coussins représentant une œuvre d’art. C’est à devenir la course entre les différentes boutiques pour trouver l’objet le plus original. De plus, l’appel à un scénographe pour créer la boutique est également réalisé par certains musées ou espaces d’exposition, comme les Machines de l’île de Nantes.

Boutique du Musée de Fragonard©CC - BY NC ND
Des boutiques en confrontation avec la vision du musée
Comment situer cette pratique au regard de la définition du musée de l’ICOM ? Selon cette dernière, le musée est « une institution permanente, sans but lucratif ». Même si un musée n’a pas comme fin de récolter le plus d’argent, il devient un excellent moyen d’en tirer des ressources. Et cela, les gestionnaires des boutiques l’ont compris. N’est-il pas courant de voir à la sortie du Louvre une queue de touristes attendant de pouvoir acheter le torchon ou encore le mug customisé avec la célèbre Joconde ? Les boutiques sont investies en fin de semaine, moment clé des ventes.
Mais n’oublions pas que l’ouverture des boutiques a été aussi un moyen de résistance des musées. Durant les fermetures obligatoires, les magasins ayant le pouvoir d’ouvrir leurs portes, les musées ont ouverts à leur tour leurs boutiques. Ainsi, à Marseille, le musée d’Histoire étant à côté d’une galerie commerciale ouverte, le conservateur du musée a décidé d’ouvrir la boutique. Une manière de pointer que si la boutique était ouverte, le musée devrait l’être. Il en a été de même au Musée de l’imprimerie à Lyon ou bien encore le Musée Gadagne. Le conservateur n’a pas forcément tout pouvoir sur la gestion de la boutique du musée. Il va avoir un pouvoir plus ou moins important en fonction de la taille de son musée : plus ce dernier sera petit, plus son impact sera important. Mais tout dépend du mode de régie de cette boutique au sein du musée, par exemple pour les musées relevant des collectivités territoriales. La régie sera directe quand le service, c’est-à-dire la gestion de la boutique, est incluse dans la gestion du musée. La gestion sera déléguée lorsque les services diffèrent pour la boutique -qui peut être un espace loué-et l’administration du musée. Ce mode de gestion est décidé par les collectivités territoriales en lien avec la direction du musée.
Cet aperçu sur la place des boutiques dans les musées, et notamment ceux de Beaux-Arts, ne doit pas négliger leur rôle pédagogique à l’égard du public. Pour exemple, une pratique courante dans tout musée est de proposer le catalogue qui approfondit les propos de l’exposition, ceux des experts du comité. Et les livres proposés concernent bien le sujet de l’exposition.
Il serait juste de doser la présence de la boutique comme le dit Laure Danilo : « une boutique de musée […] doit nécessairement être pensée comme un service au public, une continuité de la visite ».
Jeanne Pagès
Pour allez plus loin :
- Laure Danilo, Boutiques de musées : écueils et bonnes pratiques, La lettre de l’OCIM, n°174, novembre-décembre 2017,
#boutiques #exposition #consommation

Quizz de l'année 2019
BON JEU!
1) 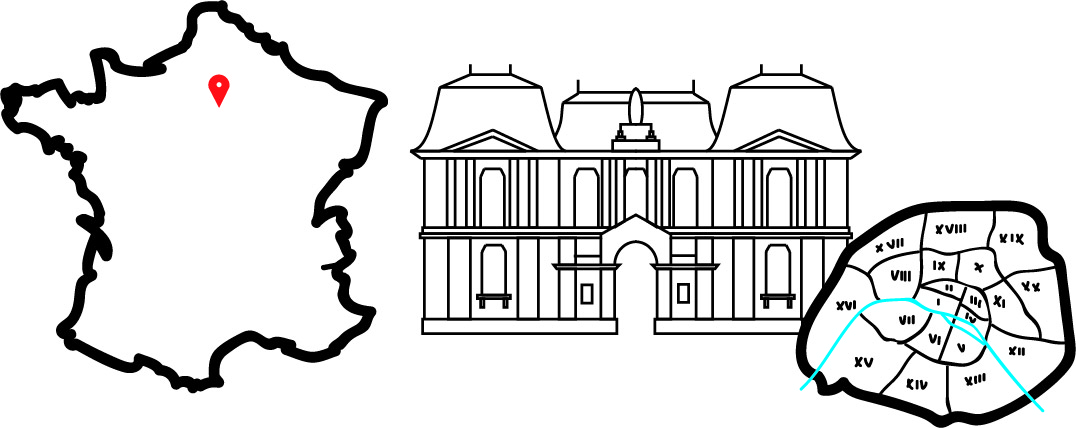
Réponse : Le musée...
En travaux depuis 2016, le Musée Carnavalet est dédié à l’histoire de Paris. L’objectif de cette rénovation est de rendre le « parcours "plus fluide" et d'"apprivoiser" un musée à l'ancienne en contextualisant mieux les œuvres, en les rendant le plus accessibles aux handicapés, en installant des dispositifs numériques.»
2) 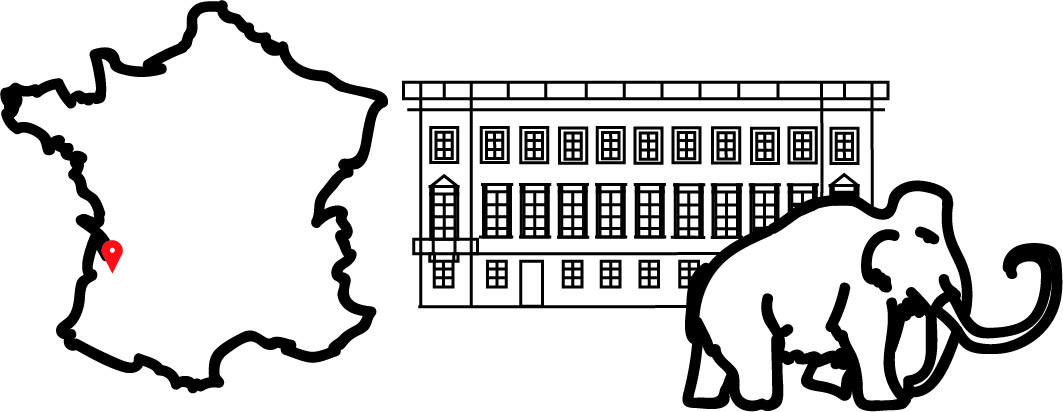
Réponse : Le muséum...
3) 
Réponse: La maison...
La Maison Zola est fermée au public depuis 2011 pour restauration et aménagement d’un musée consacré à Dreyfus dans l’une des dépendances. Cette maison, ouverte au public depuis 1984, a été acquise par Emile Zola en 1878.
4) 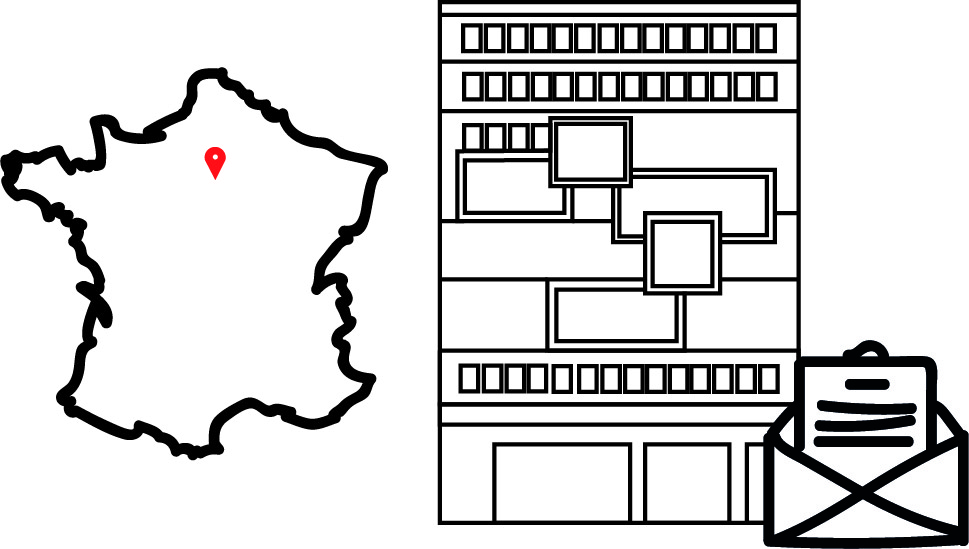
Réponse: Le musée...
5) 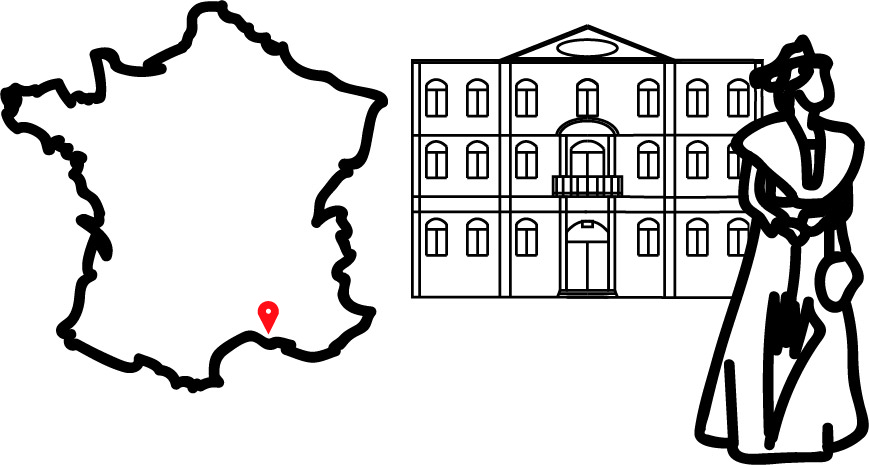
Réponse: Le museon...
6) 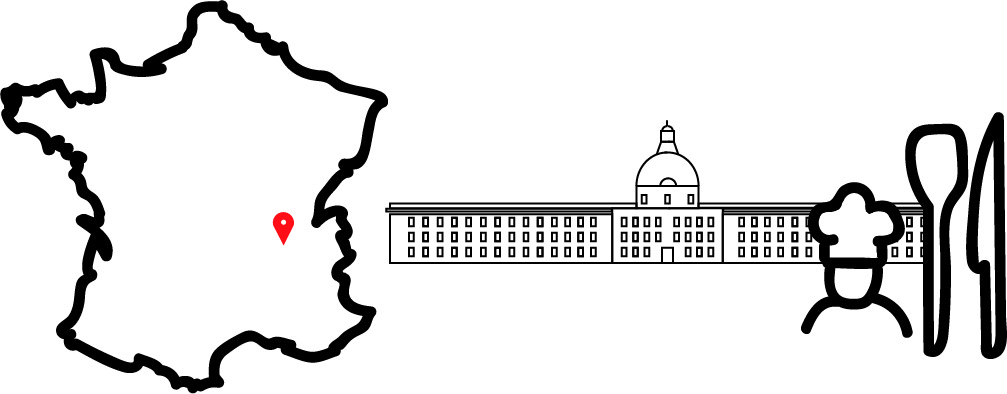
Réponse: La cité...
7) 
Réponse: Le musée...
Le musée de Picardie, construit entre 1855 et 1867, est fermé au public depuis 2017 pour rénovation et extension. Les travaux ont cependant commencé dès 2016. Il accueillera des espaces nouveaux : une salle de conférences, une salle pédagogique, des locaux techniques et des bureaux.
8) 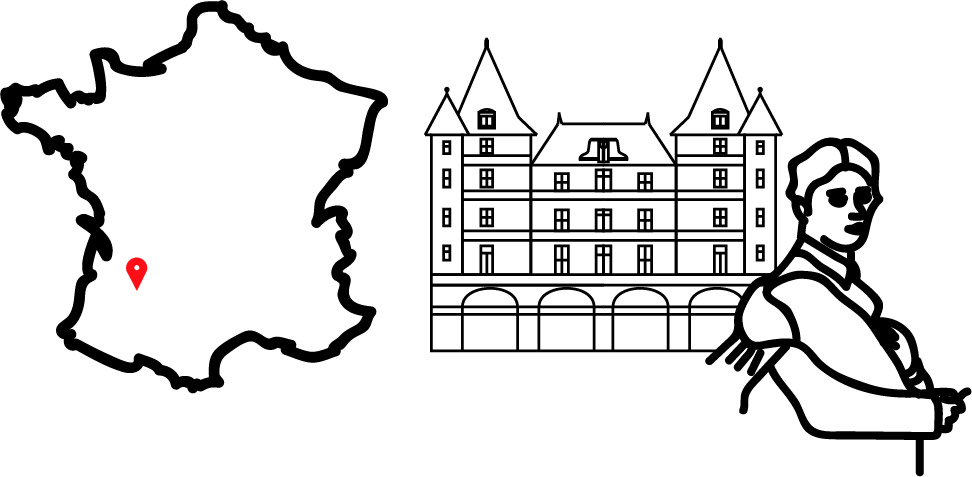
Réponse: Le musée...
9) 
Réponse: La cité...
La Cité de l’économie est une nouvelle institution culturelle dont l’ouverture est prévue au printemps 2019. Elle prendra place dans l’hôtel Gaillard situé dans le 17e arrondissement de Paris. Ce lieu est destiné à expliquer les notions et les mécanismes de l’économie.
10. 
Réponse: Le musée...
Le Musée des Beaux-arts de Dijon fermera ses portes pendant une courte période : du 31 décembre 2018 au 17 mai 2019. Des travaux qui viendront parachever un chantier de rénovation-extension mené depuis bientôt 10 ans dans le musée resté jusque-là ouvert au public.
Clotilde Villain
#2019
#réouverture
#ouverture

Quoi de nouveau au MAM ?
Aujourd'hui, l'Art de Muser vous propose la mise à jour d'un musée. Cliquez ci-après pour lancer l'installation :
Au cœur du Vieux Lyon et du secteur Unesco, l’hôtel de Gadagne accueille le musée d’histoire de Lyon depuis aujourd’hui 100 ans, ainsi qu’un musée à part entière, le Musée des Arts de la Marionnette. Ce musée, auparavant nommé le musée international de la marionnette puis le musée des marionnettes du monde, a intégré le musée d’histoire dès 1950, et fut agrandi en 2009. Unique musée de ce type en France, c’est naturellement à Lyon, lieu de naissance de Guignol, qu’il prend place à la suite d’une décision amenée par George Henri Rivière d’effectuer un important dépôt du Musée National des Arts et Traditions Populaires.

Vue d’une salle du musée jusqu’en 2009 / Terry O’Neill - Musée des Arts de la Marionnette - Gadagne
En changeant de direction en 2015, le Musée d’Histoire de Lyon (MHL) et le Musée des Arts de la Marionnette (MAM) entament une nouvelle refonte, en accord avec leur nature de musées de société, en s’ancrant toujours plus dans leur territoire et leur époque. Du côté du MHL, l’ancienne muséographie du parcours permanent laisse place à quatre nouvelles expositions, inaugurées l’une après l’autre, sur un rythme annuel. Après une première ouverture en 2019 de l’exposition Portraits de Lyon, servant d’introduction au musée mais aussi à la vie lyonnaise, le MHL propose depuis mai 2021 le deuxième volet de cette refonte, Les pieds dans l’eau.

Vue de l’exposition Les pieds dans l’eau ouverte en mai 2021 / Jade Garcin
Des changements chez les marionnettes
Les marionnettes aussi ont droit à une nouvelle jeunesse. Repensé afin de présenter à la fois les origines de la marionnette et la création contemporaine, le MAM devient un modèle d’intégration des contraintes de l’exposition d’un art vivant, ce qui tient d’ une de ses spécificités : sa nature d’exposition semi-permanente… ou évolutive, disons en rotation.. ou peut-être de référence ?
Un problème de définition
Si ce projet était bel et bien présenté comme une exposition “semi-permanente” dans les premières années, les enjeux concentrés dans cette dénomination ne correspondaient pas à ceux réellement présents. Lorsque l’on parle de semi-permanent, on pense à une exposition temporaire durant plus longtemps que la normale, comme la Galerie de la Méditerranée au Mucem, présentée durant 3 ans avant de changer, ou celle du musée ethnographique de Neuchâtel conçue en assemblant différentes expositions régulièrement renouvelées, et unifiées graphiquement.
En évoluant tous les 4 ans, le Musée des Arts de la Marionnette pourrait-il être une exposition évolutive ? Si l’on considère le paysage expographique actuel, cette dénomination semble consacrée à une typologie d’expositions relevant de la production artistique, régulièrement construite avec participation des visiteur·euse·s, en tant qu'œuvre en elle-même. Ce qui ne correspond pas au cas du MAM.
Parler de la “rotation” d’une exposition donnerait à penser que les enjeux derrière seraient purement en terme de conservation préventive des collections, et il serait inexact de penser que cela ne relève que de ça.
Faire référence !
Peut-on alors parler d’“exposition de référence” ? L’on retrouve ce terme non loin de Gadagne, au bout de la presqu’île lyonnaise. Pour Michel Coté, ancien directeur du musée des Confluences, il n’était plus question dans ce cas de parler d’expositions permanentes ou temporaires, mais respectivement d’expositions “de synthèse et de référence” et d’expositions “de déclinaison”. Selon lui ”L’exposition doit faire autorité au sens où ce qu’elle explique doit être rigoureusement fondé sans exclure pour autant la présentation de points de vue différents".
Le Musée des Arts de la Marionnette version 2017/2018 prend le parti de montrer la création marionnettique contemporaine, et de répondre à ses grandes questions structurantes par des exemples de techniques, de compagnies, ou encore de spectacles variés et diversifiés. En multipliant les réponses, les points de vue, ce musée se place alors en tant que référence dans la présentation de compagnies contemporaines et des sujets qui les animent.

Première salle du MAM depuis 2017 / Xavier Scwhebel - Musée des Arts de la Marionnette - Gadagne
Cap sur 2022
En décidant de faire évoluer le parcours tous les 4 ans, le musée se prête à un exercice de réactualisation de son contenu, en exposant de nouvelles pièces de sa collection mais surtout de nouvelles compagnies et des spectacles récemment créés. Il élargit le panorama des techniques, des pays, des thématiques… et complète, cycle après cycle, le le paysage marionnettique contemporain international. Cela apporte aussi un regard neuf sur le parcours muséographique et devrait - cela est souhaité - avoir le même effet sur la fréquentation des publics que l’ouverture d’une exposition temporaire classique.
Quelles spécificités ?
Mettre en place un projet tel que celui-ci engendre cependant des problématiques propres sur différents aspects. La scénographie, la régie, la sphère administrative et bien entendu la muséographie font partie des éléments qui doivent être pensés de manière spécifique à l’exercice.
La muséographie
La réflexion autour du discours sur les objets est un des points clefs de cette forme expographique. Le parcours a été pensé comme une base à réagencer, repenser, reformuler… Il s’appuie sur des questions fortes, autour desquelles s’articulent d’innombrables déclinaisons possibles de réponses. En mêlant collections du musée et dépôts de compagnie et d’institutions, le parcours s’ouvre là encore à de nombreux possibles.
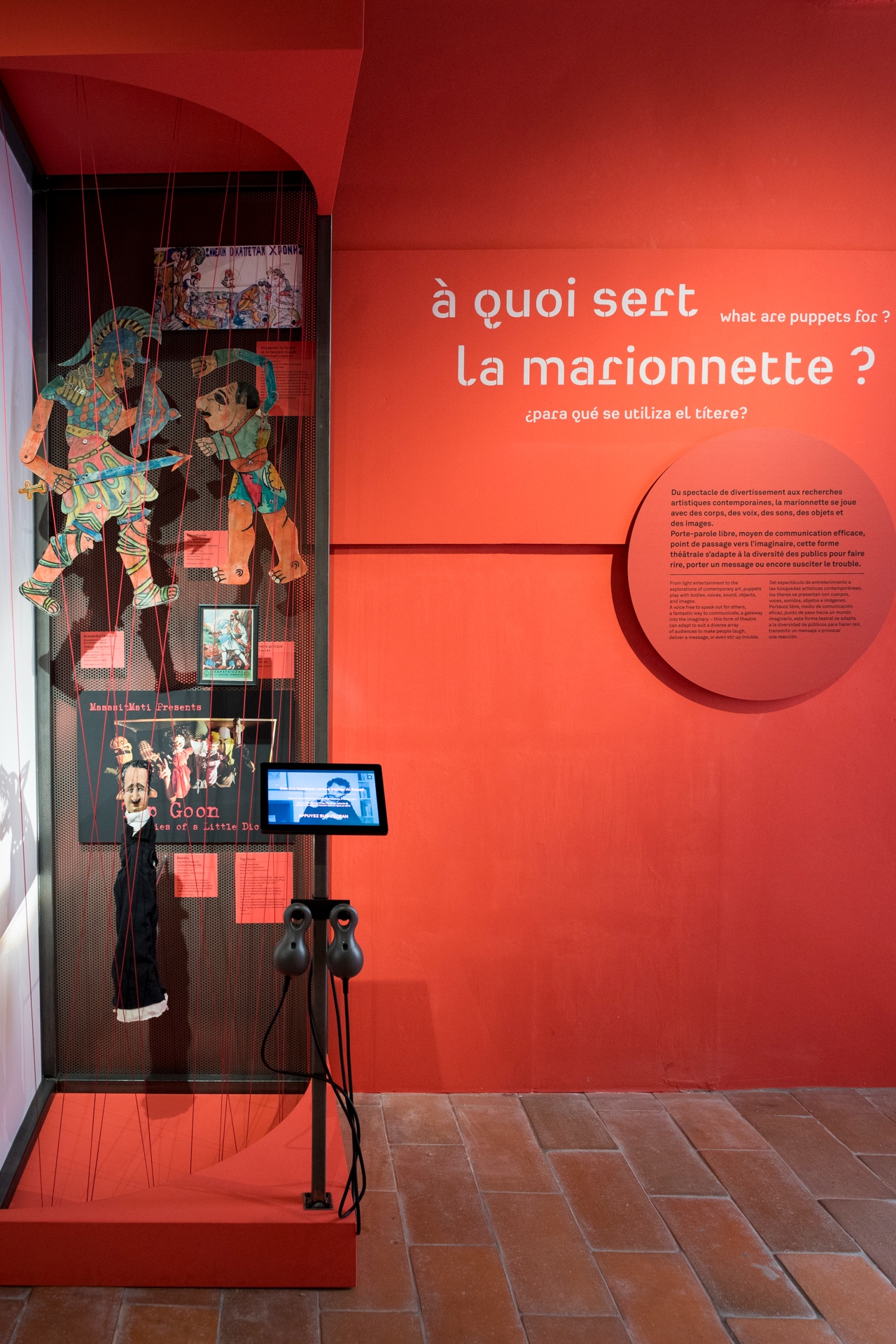
Une des grandes questions structurantes, et vitrine sur “le rire contre l’opression” / Xavier Scwhebel - Musée des Arts de la Marionnette - Gadagne
La scénographie et l’agencement
Renouveler les objets exposés est synonyme de nouveaux soclages, de mouvements dans les salles, de réécriture des textes, mais pas nécessairement de budget permettant de reprendre entièrement l’agencement tous les 4 ans. Ainsi, des astuces scénographiques ont été trouvées pour pallier ces contraintes. On trouve alors au musée des grilles perforées au fond de la plupart des vitrines, sur lesquelles peuvent venir se placer à l’endroit souhaité tous les soclages, réalisés en interne. On peut aussi, sur ces mêmes grilles, placer et replacer les cartels imprimés sur un support aimanté et donc repositionnables à l’infini sans laisser de trace.
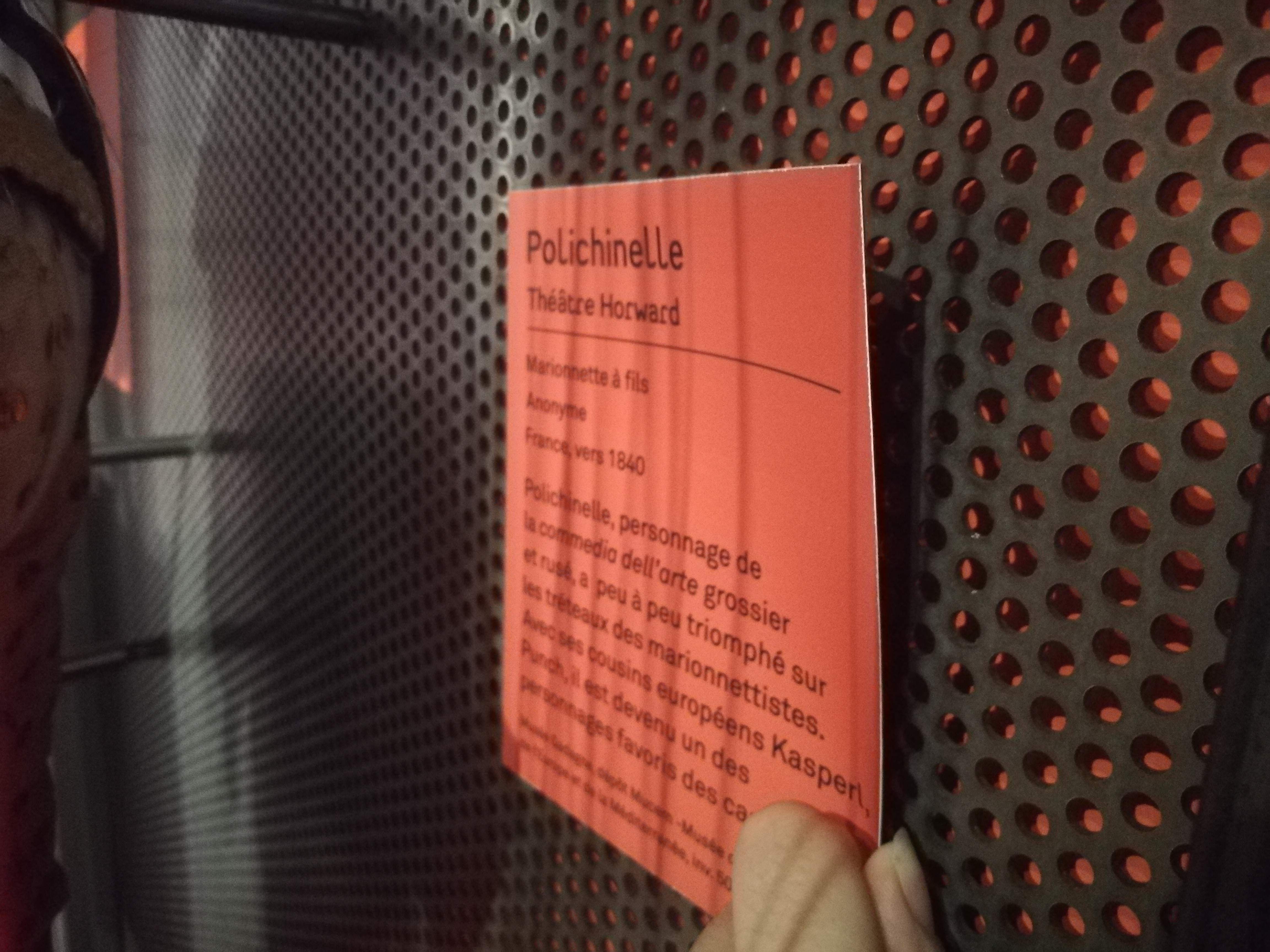
Cartel magnétique et panneau perforé / Jade Garcin
Une question d’organisation
D’un côté pratique, la régie ou encore l’aspect administratif doivent aussi s’adapter à ce format et cette temporalité particuliers. Si certains des objets exposés appartiennent à Gadagne, d’autres sont empruntés à des compagnies pour une durée minimum de quatre années et demi. Cela implique alors un fonctionnement par dépôts, renouvelables, sur cette période. Le lien avec les spectacles vivants se perçoit ici également, car si certaines marionnettes ont arrêté leur tournée, d’autres retrouvent encore ponctuellement leur public, et quittent alors le musée pour une courte durée.
Le renouveau des possibles
Outre son parcours principal, cette exposition propose un espace dit “la salle carte blanche”, prêté à un artiste pour une période de 2 à 3 ans. C’est alors un nouveau lieu pour se renouveler et laisser place à un autre regard. Actuellement, Renaud Herbin y présente son travail à la croisée de la marionnette et de la danse, en laissant une grande part à la matière. Présentée comme une salle à part entière, elle s’intègre en réalité dans le parcours, spatialement, mais aussi en participant à rendre chaque visite unique.
Pour aller plus loin :
#rotation #marionnettes #Gadagne

Ranger mais pas trop, zoom sur le Vaisseau
Le jour de la réouverture, le 19 mai dernier, après des mois sans voir de visiteur.euses, l’heure était à la fête. Nous venions tout juste de terminer un nouvel espace d’exposition permanente : La Pépinière. C’est un espace d’exposition permanente où les enfants de 3 à 6 ans peuvent explorer le tinkering – qui signifie littéralement la bricole, faire quelque chose avec ses mains –, viennent bidouiller et semer les graines de la créativité en composant des réactions en chaîne et en inventant des circuits de billes. Cette parcelle haute en couleur s’incarne comme un prolongement du jardin.

La Pépinière éclairé par la douce lumière du matin © M.D

La Pépinière à la fin de la première journée d’ouverture © M.D

Nathalie, médiatrice, en plein rangement des carrés potagers © M.D
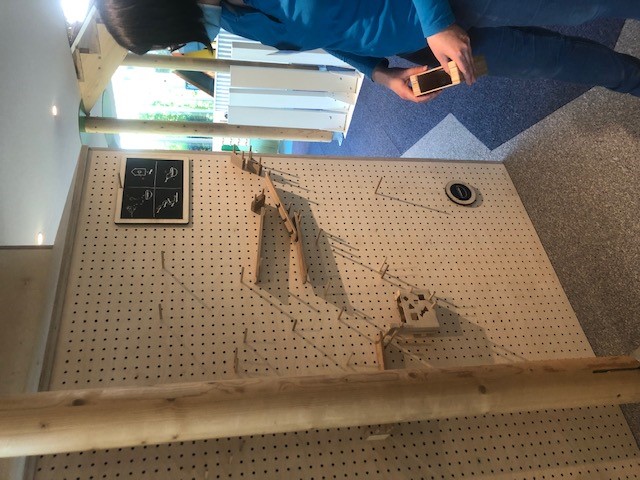
Nathalie, devant le cabanon de La Pépinière, en train de créer des amorces pour les circuits à bille © M.D
Manon Deboes
#Rangement #Centreculturescientifique #Enfants
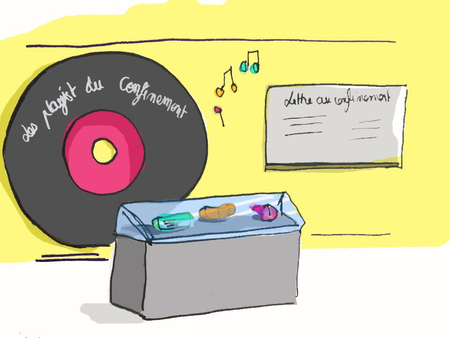
Recueillir le confinement : Musées de sociétés et Archives au cœur de la collecte
En période de confinement, les musées fermés n’ont jamais autant été visibles virtuellement : c’est peut-être simplement le fait de passer plus de temps sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram..) ou d’une offre proposée plus grande. Ne serait-ce pas le moment d’incarner le rôle social du musée en proposant de nouvelles expositions retraçant les créations artistiques du confinement ?
Pour transmettre et conserver la trace laissée par cette épidémie dans nos quotidiens certains musées de sociétés développent des appels aux dons, ou à la collecte.
Le temps du confinement dans les Musées
C’est le choix du Musée de civilisation européenne et méditerranéenne (Mucem) qui invite tous ceux qui le souhaitent à faire don d’un objet, de document, ayant eu un rôle dans ce drôle de quotidien, plusieurs institutions incitent les particuliers aux dons.
Se plaçant en « Musée du contemporain et du quotidien », le Mucem promeut l’image dynamique d’un musée se voulant transmetteur de l’actualité pour les générations futures. La collecte « Vivre au temps du confinement » va donner naissance à une nouvelle collection qui sera un témoin direct de nos habitudes, nos vies à cette période. Ces objets, ces documents pourront par la suite être étudiés, ou mis en lumière dans diverses expositions.
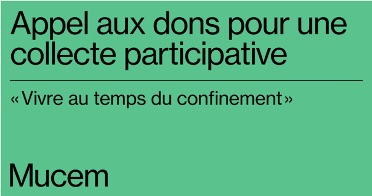
Capture d’écran de l’affiche du Mucem ©Mucem
Des masques au musée, c’est sans doute l’un des objets qui était le plus attendu dans cette collecte. C’est d’ailleurs ce que souligne la directrice scientifique et des collections, Émilie Girard du Mucem. En effet, ces masques, objets essentiels pendant cette pandémie deviennent une denrée rare et le symbole du virus, mais aussi l’expression de créativité et de solidarité.
Pourtant, ce ne sont pas eux qui affluent en masse, bien au contraire. Objets réinventés, échanges épistolaires ou en vidéos, paroles de soignants et banderoles de manifestations à 20 heures rythment les propositions envoyées au Mucem. Accompagnés d’un texte court, ces témoignages donnent vie à ces objets. Cette transmission écrite devient aussi importante que l’objet, pour certains cas ces textes donneront lieux à des échanges oraux. Se sont donc des collectes mêlant matériel et immatériel qui se développent.
Initiative similaire au Musée de la vie wallonne, qui propose également de récupérer des archives tels que des dessins, affiches et des objets pour créer la mémoire locale de cette crise sanitaire. Là encore des masques aux couleurs des équipes de foot locales sont attendus. Même si aucun objet n’est encore arrivé dans le musée, articles de presses, affiches relatant les consignes sanitaires, éléments témoignant du télétravail reflètent le confinement et donc l’intérêt de ces collectes pour les musées de société. Il ne s’agit pas simplement de retracer la vie confinée mais de montrer les alternatives locales mises en place par les entreprises comme par exemple une brasserie se tournant vers la production de gels hydroalcooliques.
Les musées de sociétés à leurs manières permettent de regrouper ces éléments au moment où certains souhaiteront voir disparaître ces objets associés au virus, à la crise ou à la mort. La mise en lumière du vivre local prône. Se sont donc les alternatives sous toutes ses formes pendant le confinement et le déconfinement que souhaitent (re)découvrir ces collectes.
À l’instar du Musée de l’Éducation Nationale de Rouen qui réfléchit également à lancer un appel à la collecte pour témoigner de l’impact du confinement sur l’enseignement. L’école à la maison c’est du jour au lendemain imposé dans de nombreux foyers. Véritable phénomène, plusieurs parents ont dû faire preuve d’imagination pour varier les enseignements. Collecter ces témoignages et ces alternatives proposées soit par les instituteurs/professeurs ou soit par les familles représente un vrai enjeu, parti pris.
Les archives départementales et municipales sont elles aussi au rendez-vous pour collecter et recevoir les dons.
#Mémoiredeconfinement, c’est le hashtag choisi par les Archives départementales des Vosges pour recevoir une partie des témoignages par le biais des Réseaux Sociaux. Les Archives du Monde du travail (Roubaix) participent à cette initiative dont la volonté est ici de documenter la transformation du travail dont le fameux télétravail. En effet, nombreux d’entre nous se sont retrouvés en télétravail donnant lieu à des situations soit inattendues soit peu propices au travail. Participer à cette collecte, c’est construire une mémoire collective des impacts tant positifs que négatifs que le télétravail a joué dans nos vies.
Les archives d’Aix-en-Provence, des Yvelines ou encore celles de Saint-Étienne développent elles-aussi ces nouveaux appels pour concevoir ce nouveau patrimoine en constante évolution. Ce sont donc les archives de demain qui se préparent.
Comment mettre en lumière ces initiatives et de quelle manière pouvons-nous leur donner une place dans les futurs évènements culturels ? Une fois les différentes collectes effectuées une grande exposition donnera-t-elle rendez-vous à la fois aux personnes qui ont participé mais à tous ceux qui le souhaitent également ! Et si ce n’est pas une exposition, quelles mises en commun et collaborations peuvent être faites entre les musées, les archives et les participants. Des rencontres, des colloques sont des pistes possibles à envisager. Et dans combien de temps après 2020 ?
Vers l’exposition du confinement ?
Depuis plusieurs années parler d’expositions immersives, participatives est de plus en plus courant pour les institutions culturelles. Dans ce cas précis, chacun d’entre nous peut partager une part de son confinement au musée et peut être à l’origine de ces collections. L’essence même du participatif ne se trouverait-il pas là ?

Le confinement s’expose ©Coline Declecrq et AV
Dans une future exposition, j’imagine déjà les masques tant chirurgicaux qu’en tissus, les listes interminables (en tout cas les miennes), les objets du quotidien, mais surtout les dessins, les musiques, les lettres et les témoignages illuminant les murs du musée… Tout pour mettre en lumière le chamboulement provoqué par ce virus au sein de nos foyers et de nos sociétés.
Ce rôle social attribué au musée prend alors tout son sens, les visiteurs pourront à la fois découvrir le confinement mais indirectement celui des autres. Ces expositions pourraient également être le lieu de témoignages et de mise en valeur de ces nouvelles collections. À cette idée, mon imagination est en ébullition.
Pour le Mucem, intégrer une partie de la collecte « Vivre au temps du confinement » dans une future exposition est déjà en cours de réflexion. Notamment dans l’exposition consacrée au Sida qui est prévue pour 2022, c’est la fin de la collecte que certaines pistes émergeront. Il ne reste qu’à espérer que l’ensemble de ses témoignages, de ses objets, trouve les musées et les centre d’archives et que ces propositions deviennent visibles auprès de tous et toutes.
Anaïs
Pour découvrir les initiatives du Mucem et du Musée de la vie Wallonne :
#Confinement
#Exposition
#Collectes

Redécouvrir un musée, la maison de la Vache qui rit

© C CARON
© C CARON
Je suis invitée à commencer par les caves, lieu historique de l’usine ou Léon BEL lancé sa production de fromage.
Le sas d’entrée me plonge dans la planète BEL avec quelques affiches publicitaires, arbre généalogique et un petit dessin animé mettant en scène la vache qui rit de la préhistoire à nos jours tantôt héroïne, tantôt Joconde. Les affiches et le petit film d’animation sont une manière ludique de faire appel aux souvenirs du public.

(Aménagement 2018) - © Maison de la Vache qui rit

(Aménagement 2013) © Maison de la Vache qui rit
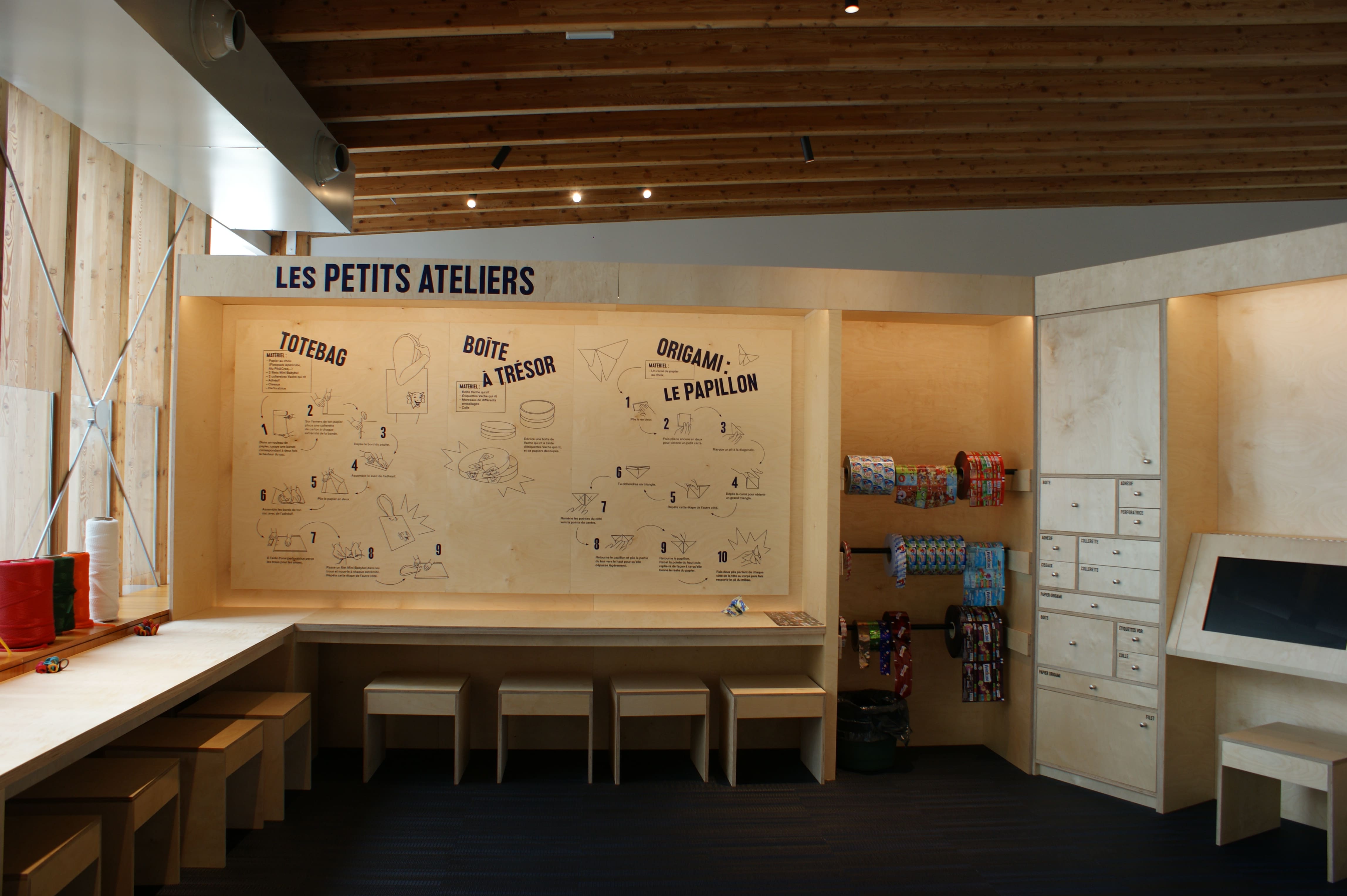
© C CARON
L’étage est divisé en plusieurs ambiances :
- Maquette d’une chaîne de production
- Espace de jeux numérique et créatif
- Espace de projection d’un film illustrant l’exportation du produit la vache qui rit dans le monde entier
- Espace de jeux
- Fondation d’art
- Produits du groupe BEL
Ces items traduisent les valeurs de la Marque et son emprise
Pour les visiteurs habitués, l’espace nouvellement conçu ne fait plus écho aux affiches publicitaires, humoristiques, aux figurines, l’illustration fait place aux questions sociétales du groupe.

Aménagement 2013 © C CARON
Le partis pris de l’équipe muséale, d’un espace immersif où l’on propose de nouveaux modes d’appréhension tout en transmettant les valeurs de marque à la société semble réussi ! le ton de l’exposition est d’ailleurs dans l’émotion (la fierté, l’échange, le jeu, la famille, la gourmandise, grandir). Mobilier moderne, scénographie assez épurée, médiateurs disponibles pour nous accompagner dans des ateliers et répondre à toutes questions. Le site propose peu d’écrans et tablettes numériques, seulement 3 à disposition des enfants des jeux numérique. La volonté d’un musée familial pour échanger et partager semble être une des explications.
Pour l’ensemble des espaces, le visiteur est acteur de sa visite, il choisit ou non de lire les îlots, d’ouvrir ou non les cachettes ou même de s’arrêter sur les hublots de la frise. A l’étage, il peut décider de traverser la plateforme comme se poser pour jouer, fabriquer.
La dimension ludique a été mon fil conducteur, j’ai pu grâce à l’épopée de l’illustration de Benjamin Rabier à la dimension 3D, aux ateliers vivre une visite.
Le dernier espace est l’atelier de cuisine et l’exposition temporaire consacrée, cette année au Sénégal « NAK BOU BEG ».
© C CARON
Cette exposition permet d’évoquer la présence du Groupe au sein de ce pays mais plus largement l’international. L’exposition temporaire invite au voyage et à la découverte d’artistes du Sénégal, artistes peintres, sonore, sculpteur, tricoteuse et graphiste qui se sont rencontrés autour de ce projet. Quel est le point d’orgue de ma visite ? L’écran 180° évoquant l’implantation de la vache qui rit dans le monde (une forte présence humaine, la description des quartiers, des villes en image et l’idée de regard croisé) ? L’atelier de cuisine permettra d’accueillir les ateliers enfants et goûters propose par le service des publics. Ces derniers sont tournés sur la nutrition, la gourmandise et le développement durable. La définition du directeur « Nous avons travaillé à la non définition d’un lieu, afin qu’il soit incubateur d’idée, laboratoire, centre aéré, centre d’art, atelier cuisine et Fab lab. », semble prendre tout son sens dans ces espaces comme l’illustre le concept de l’exposition temporaire.
Camille Caron
1 Laurent BOURDEREAU
2 Explication de Laurent BOUDEREAU dans Connaissance des Arts

Régie et collections, quel avenir?
Cet article met en relation et le questionnement de deux articles parus sur ce même blog. Tout d’abord, celui-ci, qui explore l’impact écologique de la scénographie d’exposition, et son avenir. Il nous rappelle que si la création d’expositions est un métier exaltant et nécessaire à la société, c’est aussi une consommation énorme de ressources et d’énergie, souvent à court terme. Cet article me rappelle différents conditionnements d’objets que j’ai pu rencontrer dans des réserves. Il y avait des objets bardés de mousses en tout genre, parfois même des plateaux de mousse, alors que l’objet conditionné n’est pas en contact avec ce plateau. Mais j’ai pu voir d’autres conditionnements, réalisés avec la volonté de conditionner sans utiliser autant de plastique et de matériaux polluants, parfois non recyclables. Gain d’espace, de matériel, et une conservation toujours aussi efficace pour l’objet. C’est parfait ! Exactement ce que je rêverais de voir dans toutes les réserves de France (et du monde !).
Le second article présente un workshop de régie réalisé en 2020 au Muséolab du Louvre-Lens Vallée. Nous, la génération biberonnée à l’écologie, n’avons pas assez pris en compte dans nos conditionnements, bien qu’adéquats pour le stockage des collections, leurs impacts sur l’écologie. Au moins en avions-nous pris conscience.
Panique à bord, si des démarches et des réflexions sont engagées du côté de la scénographie, est-ce suffisamment le cas du côté de la régie des collections et de la conservation des institutions muséales. Je ne doute pas un instant que les petits établissements et les lieux avec de petits budgets fassent attention à leur consommation de matériaux, mais peut-être serait-il bon de faire de ces habitudes d’économies des habitudes d’écologie communes aux différents musées et lieux abritant des œuvres et des réserves ?
La régie et le développement durable, qu’est-ce qu’on en dit ?
En menant l’enquête, je m'aperçois qu’il existe de nombreuses ressources.
J’ai découvert ici (p.61) que le développement durable est discuté au sein des institutions muséales et par les professionnels depuis de nombreuses années, mais que ces travaux sont rarement accessibles au grand public (par leur nature tant que par leur forme). Par exemples :
-
HENRY Michael C., « From the outside in : preventive conservation, sustainability, and environmental management » [en ligne], Conservation perspectives, 2007, vol. 22, n° 1, p. 4-9 <http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/22_1/feature.html>
-
Getty Conservation Institute ( GCI). 2007. Expert’s roundtable on sustainable climate management strategies. Alternative climate controls for historic buildings [en ligne]. URL : www.getty.edu/conservation/science/climate/climate_experts_roundtable.html
-
2009 Going green : towards sustainibility in conservation. The British Museum, 24 April 2009. Résumés non publiés.
-
JOUDRIER Aurélien, « L’alliance de la conservation préventive et du développement durable au château de Fontainebleau », Techné, 2011, n° 34, p. 63-66
-
Etc…
Cela fait donc plus de 10 ans que cette problématique est discutée et étudiée, comme en témoignent de nombreux documents. On retrouve, entre autres, une formation permanente de l’INP - dont la bibliographie, très complète, est accessible en ligne - le mémoire d’une étudiante de l’Ecole du Louvre, et une journée d’études de l’Association française des régisseurs d’œuvres d’art sur le sujet (à laquelle a participé le Master), et d’autres documents. De façon plus accessible, la lettre de l'OCIM nous instruit à ce sujet.
Un manque d’outils didactiques ?
Pourtant, à l’heure où l’avenir de la planète (et le nôtre) est sur toutes les lèvres et tous les claviers, je m’interroge. On a ici énormément de documentation, et des professionnels prennent le temps de réfléchir à ces questions mêlant conservation et développement durable. Pourtant, aucun guide pratique, concis, didactique, récent. D’un autre côté, il existe plusieurs de ces guides pratiques pour l‘éco-conception d’exposition, qui s’inspirent des principes de l’éco-conception. Certains journaux grands publics ou un peu plus spécialisés y ont même consacré des articles : Le Monde ou encore Le Journal des Arts. Pourquoi cette absence en régie muséale de guide d’écoconception, d’écogestion, ou d’écoconservation ? Est-ce qu’il suffirait qu’une structure se lance pour que d’autres suivent, comme ce fut le cas pour les guides d’écoconception d’exposition publiés par la Cité des Sciences et de l’Industrie et la BnF ?
Du côté de la régie, les quelques articles existants sont généralement réservés aux abonnés de revues spécialisées (ici) ou ne sont pas disponibles en ligne (là). Ces dernières années, on a vu apparaître en parallèle plusieurs choses : un essor du développement durable dans tous les aspects de la société, et un intérêt grandissant du public pour les “envers du décor” dans de nombreux domaines, et donc de plus en plus de tentatives de rendre les réserves “ouvertes” au public (voir ce très bon article). Alors pourquoi ne pas plus médiatiser ce que fait la culture en matière d’écologie, pourquoi ne pas créer des ateliers de recherches de solutions etc ? Mettre en valeur ce qui se fait dans les musées pour donner à voir des aspects de nos métiers qui peuvent intéresser ?
Deux guides à écrire ?
De mon point de vue extérieur à la régie dans les musées, je vois deux grandes thématiques liées à la régie dont pourraient traiter ce genre de guides.
La thématique des prêts et des expos temporaires, et celle du conditionnement et de la conservation des œuvres. Pour ces deux thématiques, on peut s’appuyer sur ce qui se dit en écoconception d’exposition et sur les principes généraux de l’écoconception, et notamment sur l’analyse expographique réalisée à ce sujet par les étudiantes du MEM à l’automne 2020.

Schéma des phases d'écoconception ©Explorathèque
Il ne s’agit jamais - et surtout pas en matière de transports ou de conservation d’œuvres et d’objets de collections - de créer des contraintes pour la structure, mais de se poser des questions tout au long d’un processus de conservation, de transport, ou autres pour s’assurer qu’il n’existe pas de façon plus écologique de réaliser certaines actions.
Par exemple, serait-il possible de réduire au maximum l’impact écologique des déplacements d'œuvres, ou encore celui de la création de mobilier et son transport, montage, recyclage… (les scénographes discutent de ces questions, notamment Les Rad!cales) ?
Il serait également possible de réutiliser le mobilier de réserve d'autres structures si celles-ci changent leur parc, ou de mettre en commun des mobiliers utilisés pour que les structures ne rachètent pas toujours du neuf.
En plus de ces différents principes, on peut également s’interroger sur plusieurs concepts qui vont sans doute prendre de plus en plus de place dans nos sociétés et donc dans nos musées : produire moins et mieux ; penser et prévoir le recyclage dès la production ; créer et utiliser des réseaux de réemploi, des outils participatifs...
Pour ce qui est du conditionnement et de la conservation des œuvres, peut-être est-il également possible de minimiser les retombées environnementales. On pourrait par exemple réfléchir à des conditionnements moins gourmands en matériaux (parce que l’image juste en dessous, c’est très bien pour un transport mais c’est un festival de gâchis pour une conservation censée durer plusieurs années, pour un objet qui ne sera pas amené à être déplacé) : plutôt qu’un bloc de mousse dans lequel la forme de l’objet est creusée, choisir d’utiliser des cercles de mousses qui viendraient soutenir l’objet sans l’enfermer, à intervalles réguliers ?
D’autres questions sont sans doute à poser pour approfondir cette démarche.

Sabre conditionné lors d’un workshop régie © C C
Néanmoins, peut-être que toutes ces questions et bien d’autres trouveront des réponses en juin 2021, lors de la parution de la prochaine édition de Museum International. Ce magazine préparé par l’ICOM dont le thème sera « Les réserves des musées » abordera sans doute la question du développement durable dans les réserves, comme on peut le voir ici .
#Régie
#Ecologie
#Ecoconception

Réinventer le musée
Chaque année, de nombreuses structures muséales se lancent dans des rénovations, quand d'autres en sortent. Si chaque projet est unique, et que tous les musées ne poursuivent pas forcément le même but en commençant un chantier de rénovation ou d’agrandissement, une volonté revient souvent : celle d’ « améliorer le confort et l’expérience de visite ».
Dans le cadre d’une rénovation d’un musée ou de la création d’une extension, les institutions ont chacune une démarche qui leur est propre et qui relève du fonctionnement inhérent à la structure. Il existe donc autant de façons de réinventer le musée que de musées. A l’appui d’exemples de musées récemment visités par les étudiants du Master Expographie Muséographie, voici une courte synthèse de ce qui me semble important dans une « bonne » rénovation.
Réinventer… la mise en espace
Dans le cadre d’une rénovation ou de l’agrandissement d’un musée, plusieurs éléments sont remis en questions, repensés, retravaillés, réinventés. Lors de la réouverture, le plus frappant pour le visiteur est le changement de la mise en espace des collections et du propos. On pourrait considérer qu’une rénovation est réussie lorsqu’il est possible de constater une cohérence entre le fond et la forme, entre les contenus et les ambiances. Une mise en espace réussie doit présenter une théâtralisation adaptée, une ambiance particulière qui englobe le spectateur et le fait voyager, rêver, ressentir.
En principe, un projet de rénovation ou d’extension de site démontre une volonté de renouvellement, de changement et de nouveauté. Pourtant, toutes les institutions ne poursuivent pas ce but. L’exemple du Musée Carnavalet de Paris, qui a rouvert en 2021 après quatre ans de travaux, est assez parlant : malgré la rénovation du lieu, la mise en espace reste très classique. Certes, la scénographique s’adapte d’abord au bâtiment : dans le cas de bâtiments anciens et classés, tels que le Musée Carnavalet, créer une scénographie nouvelle et immersive peut s’avérer un défi de taille. De taille, mais pas impossible, puisque c’est le choix qu’ont fait d’autres musées qui présentent le même type de collections. Il en va ainsi du Musée d’Aquitaine, à Bordeaux, avec ses nouveaux espaces consacrés aux XXème et XXIème siècles qui ont ouverts en 2021. Comme Carnavalet, il s’agit d’un bâtiment classé, avec de nombreuses contraintes et une collection variée.
Les collections d’Histoire, comme les collections ethnographiques sont « difficiles » à traiter : éviter la théâtralisation caricaturale, ne pas figer les objets derrière des vitrines… Comment agencer une collection comme celle-ci, et faire face à son aspect « pétrifié » dans le temps et dans l’espace ? Le Musée d’Aquitaine, pour son nouveau parcours, met en avant les mutations de la métropole bordelaise et les aspects attractifs de l'espace aquitain. Il invite à découvrir l'histoire récente de Bordeaux. Sculptures, peintures, objets d'ethnographie et maquettes se mélangent donc à des projections en grand format, des écrans interactifs et des ambiances sonores qui donnent au visiteur une véritable impression de « voyage ». Le tout est scénographié sobrement : les panneaux en bois prennent des formes variées qui rythment subtilement la visite.

Salle du Musée d'Aquitaine de Bordeaux dédiée au XXème siècle© L.G.L.
Une scénographie plus immersive est donc très appréciable aujourd’hui si elle est correctement construite. Le musée de la Chasse et de la Nature, à Paris, qui présente lui aussi des collections variées allant des spécimens naturalisés aux œuvres d’art en tout genre (peintures, dessins, sculptures, tapis, tapisseries, orfèvrerie, céramiques, armes, trophées, armures, meubles, installations, photographies, vidéos…) a fait le choix, tant pour l’étage rénové et rouvert en 2021 que pour les espaces plus anciens, d’une mise en espace immersive au sein de laquelle le visiteur est plongé dans un cabinet de curiosité XXL. Cette originalité fonctionne et fait d’ailleurs la renommée du musée, puisqu’elle laisse au visiteur un souvenir impérissable.

Ambiance « cabinet de curiosités » au Musée de la Chasse et de la Nature, à Paris© L.G.L.
Il est impossible d’évoquer la scénographie immersive sans dire un mot du Naturalis Biodoversity Center de Leyde, rouvert en 2021 après des années de travaux et l’installation des collections dans un bâtiment flambant neuf. Cette rénovation a permis de déployer un parcours immersif sur près de 6000 m², plongeant le visiteur dans une véritable expérience sensible. Naturalis représente le parfait exemple de ce que signifie un « musée d’aujourd’hui » : un musée qui fait la part belle à la scénographie, de plus en plus importante, mise en valeur en tant que telle (on admire autant la beauté du « décor » que la perfection des spécimens naturalisés ou la clarté du discours).
Ainsi, les nouveaux projets muséographiques qui, à l’instar de Naturalis, se veulent modernes, auront tendance à aller vers un parcours très immersif pour faire le lien entre le public et les collections. Cela peut être, on s’en doute, à double tranchant, car il faut toujours veiller à l’équilibre entre la forme et le fond, si l’on ne veut pas tomber dans « l’exposition spectacle » à l’anglo-saxonne, où le fond passe parfois totalement au second plan. Un musée rénové réussi est donc un musée qui donne à voir une scénographie réfléchie.
Réinventer… la médiation
La médiation est également repensée dans le cadre de projets d’extension et de rénovation. Le contact avec les publics est nécessairement remis en cause, et nécessite une réflexion quant au devenir du personnel de médiation.
Le Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux, rouvert en 2021, propose un dispositif de médiation qui n’a, à première vue, rien de novateur, et qui n’est pourtant pas si courant dans ce genre de structure. En effet, le Muséum emploie, en contractuel, une équipe d’une quinzaine de jeunes médiateurs scientifiques, qui déambulent dans les salles du musée accompagnés d’un chariot de démonstration (contenant des spécimens naturalisés, fossiles, minéraux, etc.), et proposent aux visiteurs intéressés quelques explications supplémentaires. La création de ce contact est doté d’un tel potentiel que cette initiative semble être le plus gros atout du Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux.

Un médiateur scientifique et son chariot de démonstration au Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux© L.G.L.
Rien ne remplace la médiation humaine et l’échange pour permettre la compréhension d’un contenu. La création de liens avec la collection au travers d’une personne est sans aucun doute ce qui rend l’expérience mémorable. Je pense notamment aux publics dits « éloignés », qui n’ont pas accès aux musées et à la culture et à qui une institution de ce genre peut paraître obscure, imperméable. La présence des jeunes médiateurs au Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux est une solution pour répondre à cette problématique.
Pour autant, l’apport de la médiation numérique dans les musées n’est pas à négliger. Cela reste un bon moyen de faciliter l’entrée dans le contenu ainsi que son approfondissement. La démocratisation du numérique dans les musées est encore sujet très actuel, bien qu’il soit sur le devant de la scène depuis quelques années maintenant. Sans m’y attarder, j’aimerais pointer du doigt un exemple du « trop » de numérique. Le Muséon Arlaten, rouvert en 2021 après onze années de fermeture pour travaux, a en effet fait le choix de ne plus présenter les cartels des œuvres exposées dans les vitrines. Les informations concernant un objet sont désormais à aller chercher sur des tablettes numériques situées dans les pièces. S’il est évident que l’objet « cartel » peut être repensé dans le cadre d’une réfection de parcours, il semble important de garder, pour chaque objet, un cartel propre et auquel le visiteur peut avoir accès d’un coup d’œil. Cela favorise la découverte, quand l’élément de médiation mis en place par le Muséon Arlaten faillit selon moi à son rôle en favorisant la perte d’informations.
La salle « LivingScience » du Naturalis Biodiversity Center est un espace où sont présentées des collections, où sont organisées des projections, mais également où se trouvent des laboratoires « ouverts » où il est possible d’observer les chercheurs de l’institution en plein travail. Ouvrir ces espaces rarement accessibles aux publics constitue l’un des points forts de Naturalis avec sa pédagogie autour de laboratoires visibles et mis en scène. En misant sur des notions d’ouverture et de transparence, le musée met en exergue ses activités ainsi que les savoir-faire qui participent à leur mise en valeur. Bien plus qu’une vocation éducative, l’institution cherche à avoir un impact sur la vie culturelle, scientifique et sociale. Véritable laboratoire de recherche, Naturalis permet aux publics d’échanger avec ceux qui font la science. Ce procédé tend à valoriser l’implication des publics dans les innovations culturelles et scientifiques, et à créer un engouement pour des sujets hors du commun. La médiation s’insère donc dans un parcours de visite qui se veut participatif à l’aide de dispositifs permettant l’échange et le contact. Faire du visiteur un acteur à part entière, qui développe son propre regard critique, est essentiel.

Le laboratoire ouvert de l'espace "LivingScience" au Naturalis Biodiversity Center de Leyde© L.G.L.
Cet aperçu sommaire n’a pas vocation à servir de référence, mais à montrer que réinventer le musée n’est pas chose aisée. Évidemment, toutes les expositions ne posent pas les mêmes contraintes, spécifiques à chaque lieu. De même, les moyens et liens entre les différents acteurs d’un projet de rénovation ou d’extension sont propres à l’institution et à ses partenaires. Mais dans ces conditions, il convient de bien s’entourer, puisque l’on a constaté par exemple l’importance de la scénographie « médiatrice » et son influence sur le visiteur, l’état d’esprit de ce dernier et son appréciation globale de l’exposition. Une mise en espace intelligente constitue un premier contact réussi entre le public et les collections, mais élaborer des concepts plus modernes pour redonner un nouveau souffle à certains espaces ne suffit pas toujours. La médiation humaine reste indispensable au sein des musées. L’intégration des publics dits « éloignés » ne se fait que grâce au contact humain.
Lucile Garcia Lopez
Pour aller plus loin :
- Compte-rendu de la journée de réflexion « Musée à rénover » du Museon Arlaten
#Rénovation #Muséographie #NouveauxMusées
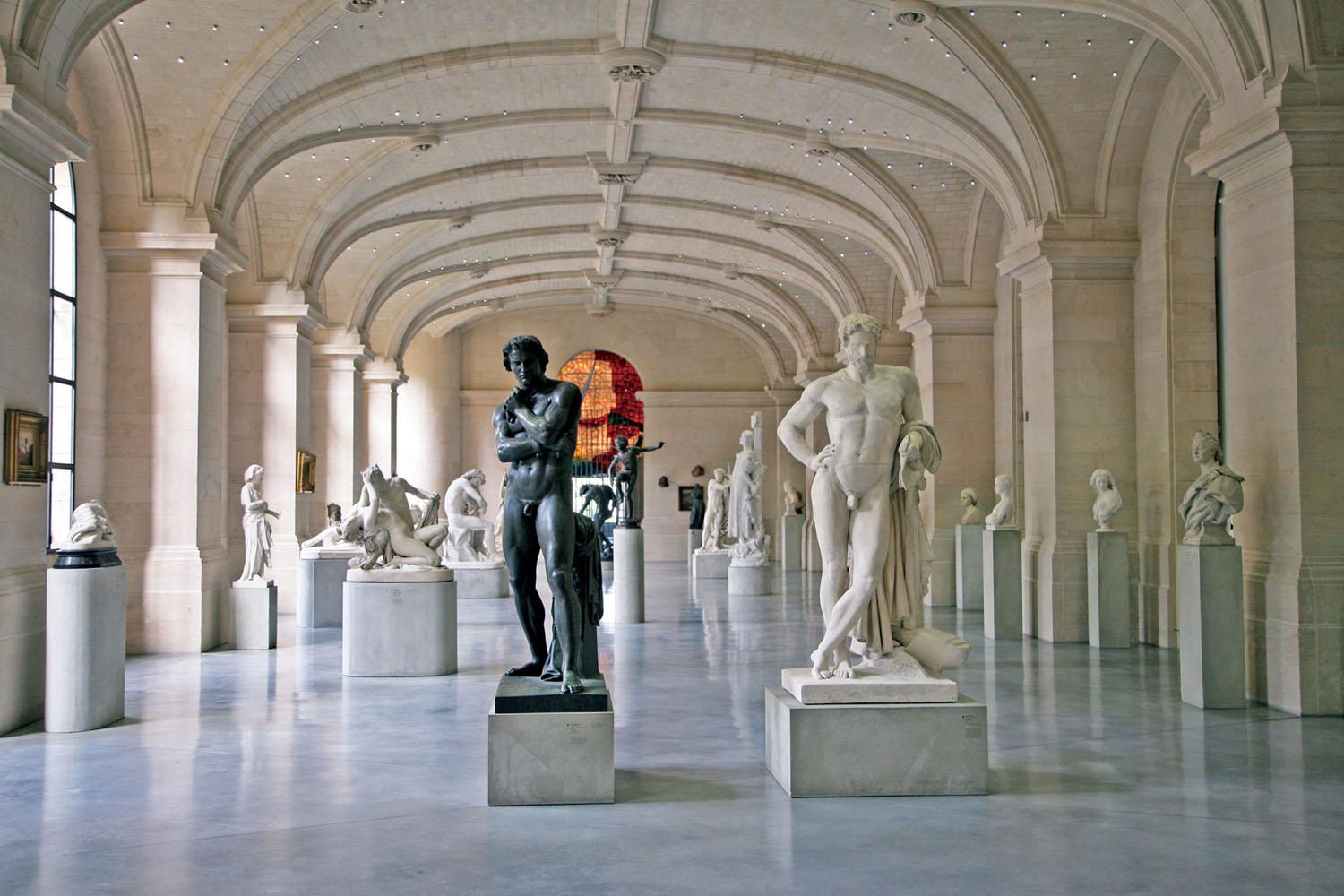
Rêveries au Palais des Beaux-Arts
Nerveux, ses petits mocassins de cuir frappent le sol tandis que ses yeux veillent à bien l'aiguiller : les petits pas dépassent bien des jambes, bien des pieds, même ces baskets blanches qui foulent allègrement le passage piéton. « Moi tu sais, je ne m'ennuie pas, je sors ». Délestée du présent, Jeannine marche vers ses souvenirs. Le passé est fidèle, il s'accroche ou la rattrape, contrairement à cette seconde qui la fuit. Puisque c'est ainsi, autant aller dans un endroit où tout n'est qu'imaginaire, où les personnages qu'elle ne reconnaît pas ne lui demanderont jamais qui elle est ni ce qu'elle fait ici. Jeannine a souvent visité le musée. Tenant la main de son petit garçon, fuyant un après-midi gris, puis aujourd'hui pour s'entourer de cette famille de marbre et de peinture qui lui ouvrent une fenêtre sur elle-même.
Au rez-de-chaussée mais déjà beaucoup plus haut que ses pas, il s'érige au-dessus d'elle comme pour la narguer. Elle lui tourne autour. Ombre immense au milieu de ces compagnons blancs, ses membres effilés se prétendent ornement. Pourtant sa main ne parvient pas à saisir le pied prisonnier de la piqûre d'abeille. Ridicule, enfermé dans ce long corps à jamais dérangé, tel est pris qui croyait prendre n'est-ce pas ? L'insecte ou bien la rose, le dard et l'épine l'ont piégé. Inutile de regarder aux alentours : le traître est ce corps qui lui devient étranger. Tu n'es pas si différent de moi alors, petit Cupidon. Amusée et victorieuse, les plis de ses joues se creusent pour esquisser un sourire.
Du pied à la main, il n'y a qu'un escalier. Ses chaussures crissent sur les planches du parquet : Jeannine rencontre cette figure concentrée, blanche enfant aux jambes infinies repliées près de son buste de glace. Elle se penche pour lire la petite étiquette : « Damalis ». Damalis ? Non, Catherine. Cette rondeur, ces plis de marbre, ce sont les traits de sa fille qu'elle a imaginé durant l'hiver 1960. « Oui je m'en souviens bien, penses-tu, j'étais perdue quand j'ai su que j'avais donné naissance à un garçon. ». Alors voilà, ce chignon retroussé, le pied offert à ces doigts habiles : ils sont le fruit d'une maternité rêvée pour l'éternité. Cette petite main serait un prolongement de la sienne.
Pour ne plus sentir ces allées humides qui sillonnent ses pommettes, remettons-nous à marcher. Tournons ici, enfin à droite ou à gauche, qu'importe. Face à elle le silence est un rempart, ou mieux, une parure. Cette Marie-Madeleine de bois semble agenouillée entre le repentir, la prière et l'espérance. Les portes de sa chevelure découvrent un ailleurs qui promet d'apaiser la vieille dame.
Ces statues qui habitent le musée, ses souvenirs les habillent. Et les yeux fatigués, plissés sur des images vibratiles, se lèvent. Comme le pouls de la ville, la pluie battante sonne le glas de ses absences.

Jean-Antoine Marie Idrac, L'amour piqué,1976, bronze
© Ecole Prevert-Exupéry : http://www.saint-exupery-linselles.net/

Antoine Etex, Damalis,1838, sculpture, H. cm : 84 ; L. cm : 61 ; Profondeur en cm : 73,
Palais des Beaux-Arts, Lille. © Palais des Beaux-Arts de Lille : pba-opacweb.lille.fr

Georges Lacombe, Marie-Madeleine,1897, sculpture en bois d'acajou, H : 108 ; L. cm 42.5 ; Profondeur en cm 53.5, Palais des Beaux-Arts, Lille.
© Palais des Beaux-Arts de Lille : https://pba.lille.fr/collections
E.B
#PBALille
#sculpture

Sens des objets, collections sensibles
De retour de la soirée-débat de l’ICOM et de la journée d’étude organisée par le master médiation du patrimoine et de l’exposition de Paris-Sorbonne sur la sensibilité d’exposer certaines collections, je me sens stimulée par ces deux temps de réflexions riches en interventions. Mais peu de réponses ont émergé face à cette grande question : Comment pouvons-nous exposer des collections dites « sensibles » ? Comment mettre en lumière leur sens ? Ou encore est-il nécessaire d’exposer certaines œuvres/objets d’arts pour comprendre le propos d’une exposition ?
Soirée-Débat Le Sens de l’objet, 29 Janvier 2020
Dès le début de cette soirée, les propos de la directrice de l’ICOM France, Juliette Raoul Duval résonnent dans l’auditorium. Elle nous explique que cette soirée-débat annonce les futures concertations de l’ICOM France pour proposer une nouvelle définition des musées. Au programme, conservateurs, directeurs de musées et de pôle muséal proposant chacun et chacune leur propre conception de l’objet.
Plusieurs des interventions auxquelles nous avons assisté soulèvent une problématique sous-jacente à celle de l’objet. Comment désigner une collection, un objet dans un musée. Plusieurs termes sont utilisés tout au long de la soirée : œuvre d’art, objet d’art, objet sensible, objet polémique etc. Sa désignation semble évoluer en fonction du sens donné au musée. La nouvelle définition proposée par l’ICOM en ce qui concerne le lien entre les objets musée ne vise-t-elle pas d’ailleurs à équilibrer cette différenciation ? François Mairesse fait remarquer que le terme œuvre d’art disparait de la définition pour favoriser la recherche, la collecte, la communication et la présentation des collections.
Au fur et à mesure de cette soirée-débat, le discours s’oriente progressivement sur la nécessité de croiser les regards dans les expositions pour donner plus de sens aux objets. La multidisciplinarité pour valoriser une collection serait donc la réponse la plus appropriée.
« OBJETS INANIMÉS,
AVEZ-VOUS DONC UNE ÂME
QUI S’ATTACHE À NOTRE ÂME
ET LA FORCE D’AIMER ? »
Alphonse de Lamartine, Milly ou la Terre natale.
Ces quelques lignes d’Alphonse de Lamartine mis en exergue dans le texte qui nous est remis à l’entrée de la conférence rejoint l’intervention d’Emmanuel Kasarhérou adjoint au directeur du département du patrimoine et des collections du musée Quai Branly – Jacques Chirac et de Madeleine Leclair, conservatrice du département d’ethnomusicologie et des archives internationales de musique populaire au Musée d’Ethnographie de Genève. Ces deux interventions ont profondément questionné la mise en scène et présentation des objets. Le fait d’exposer un objet dans un musée, lui donne automatiquement un sens nouveau car il est dépouillé de son contexte et lieu d’origine. Tout dépend donc du sens que le musée souhaite donner à la présentation de ses collections.
Collections sensibles, déontologie, et précautions à l’Institut Giacometti
Ma quête pour trouver des réponses continue le 8 Février 2020, où la question de l’objet et de la collection est remise à l’honneur par le Master médiation du patrimoine et de l’architecture. Pendant cette après-midi le propos cible de manière plus précise mes interrogations soulevées lors de la soirée-débat de l’ICOM. Pouvons-nous tout exposer au musée ? Et si oui, comment pouvons-nous le faire ? Les différentes interventions proposent chacune à leur manière, un élément de réponse pour mettre des collections dites « sensibles » en lumière.
Premier intervenant, Guillaume Nahon, Directeur des archives de Paris, nous présente comment les archives ont constitué une collection des mémoires des attentats de Paris en 2015 ; c’est ainsi que les personnes présentes découvrent ce que peut être une collection sensible. Après les détails concernant la collecte de ces objets, Guillaume Nahon nous explique comment la numérisation a permis de rendre cette collection accessible à tous sans réellement l’exposer de manière physique.
Pendant cette prise de parole, deux affirmations m’interpellent : la collection peut devenir sensible en fonction du lieu où elle est exposée et la sensibilité d’une collection se détermine en fonction de la charge émotionnelle qu’elle représente. Ces deux arguments me servent de premiers éléments de réponses.
Ce n’est que lors de la seconde présentation que la notion de collection sensible est enfin définie par Florence Potosniak : « ensemble de document susceptible de provoquer le trouble au sein de la société du fait du contenu idéologique qu’ils véhiculent et/ou de la résurgence d’une mémoire historique douloureuse ». Est mise en avant c’est la nécessité de prendre en compte le contexte historique et de surtout faire preuve de prudence dans la valorisation de ces collections.
Cette après-midi se termine par l’intervention d’Alice Martel, chargée des publics et de la médiation culturelle de l’Institut Giacometti, qui partage ses conseils pour accompagner un propos ou des œuvres dites « sensibles » présentées au public. En référence directe à l’exposition Giacometti/Sade : Cruels objets du désir. Une médiation développée et l’accompagnement du public répondrait à la problématique.
Entre sens et sensibilité : regards croisés sur les collections
Les musées tout en s’assurant de conserver et de transmettre des collections sensibles doivent faire face aux polémiques et remises en question actuelles. Que dire de l’Institution Giacometti qui participe à cette réflexion des collections sensibles et de déontologie tandis que dans le même temps Giacometti/Sade : Cruels objets du désir expose des œuvres au propos dérangeant sans préambule ni accompagnement… (Voir article Giacometti/Sade : « L’homme la violait »)
Pour quel public les collections deviennent-elles sensibles ? Les objets sacrés, les objets religieux, les objets hérités de la guerre, les objets politiques, appartiennent à cette catégorie de collection sensible. Or l’exposition de ces objets ne provoque pas la même gêne suivant le visiteur ou son appréhension de l’objet. Par ailleurs, ce n’est peut-être pas l’objet en lui-même qui est considéré comme sensible mais le lieu, l’importance culturelle qui lui est associé. Le fait de les exposer ne les dissocie pas de leur sens et leur symbolique. Prendre en compte la manière dont ils étaient utilisés et le pouvoir qu’ils représentent est essentiel. La connaissance de ces objets et le dialogue auprès des visiteurs héritiers participent à leur valorisation.
Donc, dans quelle mesure pouvons-nous exposer des objets lorsque son propos, son sens posent problèmes ? Vous m’auriez posé la question il y a quelques mois, la première de mes réponses, aurait été de répondre qu’inscrire l’objet dans son contexte historique et social permet de justifier son exposition. Mais cet argument-là ne connaît-il pas sa limite ? Et jusqu’où un musée ou une institution culturelle est-il prêt à aller pour présenter une collection ?
La réponse à ces questionnements se trouve peut-être dans la manière de présenter les objets que nous regardons. Si la conception et la mise en espace de ces collections n’est pas encore habituelle, plusieurs musées proposent des scénographiques pouvant s’adapter à la présentation de ces collections sensibles.
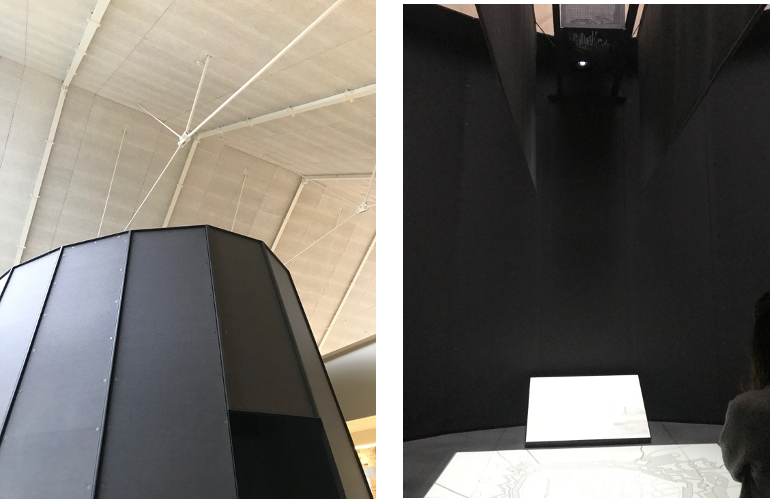
Début du parcours muséographique, Mons Mémorial Museum, ©AV
Au Mons Mémorial Museum, une première structure introduit le visiteur dans le parcours muséographique. Si aujourd’hui, elle représente l’évolution cartographique de la ville de Mons pendant la guerre, ce changement d’espace illustre une possibilité scénographique pour mettre en avant des collections sensibles.
En écrivant ces lignes, je pense également au Musée Juif de Berlin que j’ai visité il y a quelques années. J’ai le souvenir qu’à certain moment la mise en espace des collections se faisait par une découverte progressive des objets exposés, laissant le temps au visiteur de les découvrir.
L’architecture et la scénographie sont de véritables atouts qui mettent en avant les collections sensibles. Créer des sous-espaces, des zones délimitées dans les expositions sont déjà des habitudes prises notamment pour la diffusion de séquences vidéos ou audio. Cette pratique peut aussi être déclinée pour valoriser les collections sensibles.
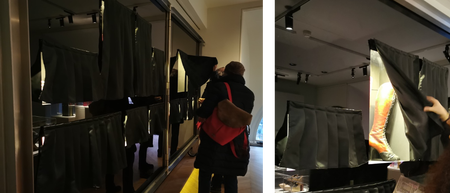
Vitrines dans l’exposition Marche et Démarche, Janvier 2020, ©Estelle Brousse
Une autre manière d’exposer vue dans l’exposition de Marche et Démarche au Musée des Arts Décoratifs, pourrait faciliter la même mise en scène de collections plus sensibles. Ainsi, par exemple, cacher des chaussures derrière des rideaux, laisse le choix au visiteur s’il le souhaite ou non, de découvrir l’objet dissimulé. Le but n’étant pas de rendre ludique ou voyeuse l’action même de découvrir ces objets mais de proposer une découverte plus intime entre le visiteur et l’objet.
C’est peut-être la question du choix qui est donné au visiteur de découvrir ou non les collections sensibles qui m’a manqué lors de ces deux séances de réflexions. Quelquefois effleuré, ce point de vue était à mon sens peu développé, ce qui continue de m’interroger.
Anaïs
Pour compléter cet article :
La soirée-débat de l’ICOM :
Présentation
Captation vidéo
Publication
Collections sensibles, Déontologie, et précautions
Hommages aux victimes des attentats de 2015 – Archives de Paris
Article sur l’exposition Giacometti/Sade : Cruels objets du désir
#Objets
#ICOM
#Collectionssensibles

Smile Safari : Au pays d’Instagram, le selfie est roi.
Genèse du projet
Tik Tok et Instagram sont deux plateformes de partage de photos et de vidéos dont le succès n’est plus à faire. Les ados en sont particulièrement friands et rivalisent d’originalité pour créer le buzz. Pour parvenir à ses fins, il faut respecter des codes bien précis : couleurs vives, esthétisme, décors à couper le souffle … La mise en scène est l’apanage des réseaux sociaux.
Espace Yum Smile. Thème 7 : Vive les frites ! - Smile Safari Lille, 2021. ©Marie Thérasse
Le Smile Safari bouleverse le statut du musée. Né à Anvers en 2019 à l’initiative de Hannes Coudenys (de l’agence Hurae) et Dieter Veulemans (agence CityCubes), le projet de départ était de collaborer avec des marques en les intégrant dans les différents décors de l’exposition. Ces derniers ont été choisis méticuleusement par les deux concepteurs, après avoir visité des musées similaires aux États-Unis. Né en 2016 à New-York, le Museum of Ice Cream fut le premier du genre. L’objectif du Smile Safari était de s’inspirer du modèle américain, tout en y apportant des changements afin d’y faire la publicité de marques partenaires.
Deux autres musées ont ensuite ouvert à Bruxelles au Anspach Shopping Center et à Lille, dans le centre commercial Euralille. Pour l’heure éphémères, ils deviendront permanents si le succès est au rendez-vous. Dans le cas contraire, ils fermeront leurs portes le 2 janvier 2022.
Rendez-vous en terrain connu
Surnommé « Musée d’Instagram et de Tik Tok », il possède 8 espaces répartis sur 1000m² dont les 37 décors « instagrammables » permettent aux visiteurs de créer du contenu à poster sur les réseaux sociaux. Les différents espaces sont regroupés sur le thème des emojis : celui qui est mort de rire, qui se lèche les babines, qui a des étoiles dans les yeux ou encore, qui verse une larme. Derrière ces smileys se cachent différentes thématiques : la nourriture, la célébrité, l’enfance, les marques Fnac et Acer, le psychédélique et la fête, pour la plupart bien agencées. La visite se fait progressivement en déambulant dans les différents décors.

Plan du Smile Safari de Lille. ©Marie Thérasse
Munis de leur smartphone, les visiteurs partent à la chasse au selfie. Illusions d’optique, couleurs flashy, miroirs, néons, piscines à balles, tous les éléments sont réunis pour se mettre en scène. Certains décors fonctionnent assez bien et sont amusants à utiliser. La baignoire de frites et ses étagères de ketchup font l’unanimité et la Cadillac rose fait partie des incontournables. Les espaces qui possèdent des miroirs et des néons offrent une excellente luminosité pour prendre des selfies. A contrario, la montagne de flutes à champagne et l’univers Acer sont boudés, faute d’extravagance.


⇑ Espace général. Thème 5 : Bienvenue au paradis des smiles - Smile Safari de Lille, 2021. ©Marie Thérasse
⇓ Espace MDR Smile. Thème 13 : Prêt à retourner en enfance –Smile Safari Lille, 2021. ©Marie Thérasse
Au début du parcours, le visiteur doit renseigner ses coordonnées via un écran tactile et le système génère un QR code à scanner dans les différents espaces. Des bornes photos sont disposées à plusieurs endroits de l’exposition, le visiteur scanne son QR code et prend la pose dans le décor en question. Les photos qui auront été prises lui seront ensuite envoyées par e-mail. Des employés font office de médiateurs en se promenant dans les salles pour aider les visiteurs à se prendre en photo ou leur prodiguer des conseils.
Borne photo. ©Marie Thérasse
La présence du Smile Safari dans des centres commerciaux attire de nombreux curieux et lui donne de la visibilité auprès du jeune public. Toutefois, l’activité n’est pas à la portée de toutes les bourses. Le prix d’une entrée sur place s’élève à 20€ pour les jeunes de 4 à 16 ans et à 22€ pour les adultes. Un prix peu démocratique qui en dissuade plus d’un qui, attiré par la vitrine, s’aventure dans la billetterie pour prendre la température.
D’abord intrigués, les parents font demi-tour à la vue des tarifs et les ados repartent déçus. De ce fait, les visites en famille sont peu nombreuses. Le Smile Safari a loupé le coche. Pourquoi ne pas proposer l’entrée à un prix plus abordable ? Surtout que les créateurs du musée visent plutôt un public jeune : les scolaires et les écoles supérieures.
Décors sans fond
Si le Smile Safari se prétend musée, quid de son contenu scientifique ? Le musée doit s’assurer de tenir un discours capable de donner pertinence aux espaces. C’est là que le bât blesse. Le dit « musée » ne tient aucun discours concernant les réseaux sociaux en général, pas même sur Instagram et Tik Tok. Aucun panneau n’est présent dans les salles et cela manque cruellement pour le visiteur qui ne possède pas les codes de ces plateformes. Il serait pourtant intéressant d’intégrer un historique concernant leur naissance et l’évolution des pratiques et, pourquoi pas, expliquer à papy Bertrand comment prendre le selfie parfait en guise de médiation. Utiliser Instagram et Tik Tok pour attirer la jeunesse au musée ? Pourquoi pas, à condition de ne pas négliger le fond pour ne privilégier que la forme.


Espace Flirty Smile. Thème 27 : Gold Digger – Smile Safari Lille, 2021. ©Marie Thérasse
Espace Famous Smile. Thème 12 – J’arrive dans ma tchop -Smile Safari Lille, 2021. ©Marie Thérasse
Sans ces clés de compréhension essentielles, le musée devient hermétique pour de nombreux visiteurs. Deux options s’offrent alors à vous : se contenter de regarder ou se prendre au jeu en imitant les autres visiteurs. Le manque de discours crée un clivage important entre générations. Le musée s’adresse essentiellement à un public d’adolescents (génération Z) et à la génération Y, dite des millennials. Il s’agit d’un parti-pris puisque le projet initial était d’amener les jeunes au musée et les utiliser pour diffuser les logos des marques participantes sur Instagram. Puisque, tout ce qui est digne d’être posté sur Instagram attire les ados sans difficulté, les musées « instagrammables » leur plaisent : le Museum of Ice Cream de New York et le Museum of Selfies en sont l'exemple. L’idée du Smile Safari n’est pas assez aboutie et donne lieu à des expressions narcissiques. Les parents désespérés de voir leurs enfants faire des Tik Tok à longueur de journée seraient pourtant séduits par l’idée de découvrir leur monde à travers une institution muséale.
Smile Safari ou la chasse au musée
Peut-on véritablement qualifier le Smile Safari de musée ? Entre musée éphémère, exposition temporaire ou parc de loisir, son statut est ambigu. Il s’auto-proclame musée, mais ne possède aucune collection. Les éléments du décor sont-ils considérés comme faisant partie d’une collection à venir ? Bien que questionnable, cet aspect ne condamne pas le Smile Safari, car il existe plusieurs types de musées, certains écomusées, dont les collections sont immatérielles. Cependant, si l’on se fie à la définition du musée adoptée en 2007 par l’ICOM, le Smile Safari ne répond pas à toutes ses fonctions. Il n’est pas une institution permanente et n’a pas pour vocation de faire de la recherche sur ses collections. De plus, l’absence de discours remet en cause l’appellation dont il se réclame. Néanmoins, depuis plusieurs années le statut de musée évolue et la nouvelle définition est toujours en discussion. Qu’en sera-t-il dans dix ans ?

Vitrine du Smile Safari, Euralille. ©Marie Thérasse
Pour aller plus loin :
- Site internet du Smile Safari
- Article sur les musées instagrammables
- Article sur la permanence des collections muséales
#SmileSafari #MuseumInstagram #MuseumSelfieDay

Soirée foot au musée
A quelques jours du coup d’envoi de la coupe du monde 2018, le foot est au cœur de l’actualité sportive. Dans la rue, au boulot ou dans le métro, le foot occupe une place de choix dans les conversations. A l’occasion de ces compétitions internationales, les musées se mettent également à parler foot et certains en adoptent les codes le temps d’une soirée ou d’une exposition temporaire.
Mais peut-on réellement faire dialoguer culture sportive et culture muséale ? Le foot présente un gros avantage pour les musées, il rassemble toutes les générations et toutes les catégories sociales. Le foot a cette faculté de pouvoir réunir une ville, un pays derrière son équipe. Si le foot est entaché par les dérives du mercato ou la violence de certains matchs, il reste le symbole de la culture populaire.
Et alors, réunir et rassembler, n’est-ce pas là l’une des missions du musée du XXIème siècle ? Le sport et le foot en particulier peut sembler un bon médiateur pour désacraliser le musée, le démocratiser et toucher un public plus large. Mais comment exposer le foot ? Les objets, les témoignages, les vidéos peuvent-ils raconter une ambiance, la convivialité et parfois la violence?
L’approche muséale aborde le foot comme une culture populaire immatérielle. Ainsi, les joueurs, les supporters, le spectacle ou la politique sont abordés comme les caractéristiques de la culture foot. Ces approches sont parfois réussies, surtout quand elles ne se prennent pas trop au sérieux.
Retour sur les dernières rencontres foot - musées français.
Des joueurs, petite rétrospective
A l’occasion de l’Euro 2016, plusieurs événements culturels consacrés au foot ont eu lieu. A l’Hôtel de Ville de Paris, l’exposition “Football de légendes, une histoire européenne” met à l’honneur les joueurs stars. Car chaque club, chaque pays a sa star et se souvient du “temps de...”. Dans cette exposition panneaux, trente écrivains commentent trente photos de trente joueurs mythiques de la coupe d’Europe. Les portraits des joueurs dressés par les écrivains créent un dialogue entre culture littéraire et culture footballistique. L’approche est intéressante, parfois poétique. Ici, les joueurs sont érigés en héros populaires, en héros tout court.

L'exposition "Football de légendes, une histoire européenne", à l'Hôtel de Ville de Paris - 2016 © Présidence de la République
Des supporters
Si les Lençois ne vont pas au Louvre-Lens, c’est le Louvre-Lens qui vient à eux avec l’exposition RC Louvre. En 2016, le Louvre-Lens reprend les couleurs sang et or ainsi que le nom du RC Lens pour toucher les supporters lensois. Car ce sont bien les supporters qui sont mis à l’honneur dans cette exposition. La démarche est presque louable puisque le Louvre-Lens est allé à la rencontre des lensois pour collecter les objets. Collections personnelles de vignettes Panini, trophées, maillots dédicacés ou monuments à l’effigie du RC Lens, l’ensemble est exposé dans un certain désordre. Si cette exposition a été entièrement conçue pour les supporters du RC Lens, il n’existe aucun dialogue avec les collections du Louvre-Lens. Une occasion manquée entre le RC Lens et la Galerie du temps.
L’exposition “Nous sommes Foot” a eu lieu début 2018 au Mucem. 800 m² sont consacrés au foot et à sa culture. Le Mucem adopte complètement les codes du foot en mettant en jeu 11 séquences qui se visitent en 90 minutes.Cette exposition veut rassembler en s’adressant aux passionnés de foot, aux supporters du dimanche et aux intolérants. Car, le rassemblement est bien le maître mot, le fil rouge de cette exposition. Le foot est abordé comme une pratique capable d’unir un quartier, une ville, une nation au delà de toute fracture sociale ou ethnique. Le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée parle foot à travers une approche sociologique, culturelle et politique. Un contenu qui analyse cette culture combiné à une programmation riche en événements étonnants comme une battle de DJ OM – PSG.

Nous sommes Foot - Mucem - Marseille – 2018 © Humanité
Du spectacle
Le temps d’une soirée inopinée en juin 2018, le Muséum aquarium de Nancy chausse ses crampons pour une soirée foot conjuguée au féminin ! Une soirée qui met à l’honneur le foot féminin est chose assez rare pour qu’elle soit soulignée. Babyfoot humain, démonstrations de free-style, quiz, séance photo façon vignette panini, il y en a pour tous les goûts, fans de foot ou pas. Le spectacle est bien au rendez-vous dans cette soirée à la fois sportive et culturelle qui reprend les codes du foot sans se prendre au sérieux. Tous les ingrédients sont rassemblés pour un match réussi : l’ambiance, le spectacle et la buvette !
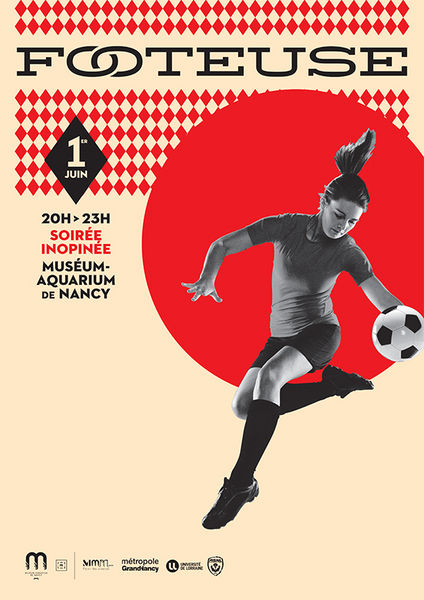
Soirée footeuse - Muséum aquarium de Nancy – 1er juin 2018 © Muséum aquarium de Nancy
Au parc de la Villette, le festival Foot Foraine est un événement festif pour l’Euro 2016. Le festival propose une exposition artistique 100% foot dont le parcours reprend le cheminement de la Galerie du temps du Louvre-Lens. Le festival prévoit également de nombreuses activités, tournois, ateliers, battle… avec une mi-temps au café des sports ! Nous retrouvons bien la signature du parc de la Villette et de ses tiers-lieux dans cet événement qui combine art, culture, sport et détente.
Si les joueurs, les supporters et le spectacle sont des caractéristiques du foot, la politique est aussi bien présente dans la culture foot. En 2016, l’exposition “Le foot, une affaire d’état” aux Archives nationales interroge l’impact du foot sur la société. L’Etat s’investit financièrement pour créer et modifier les infrastructures sportives car, à chaque championnat, et quand il y a victoire, le foot flatte l’opinion publique. Cette exposition montre aussi une autre facette du ballon rond. Le football est le reflet des évolutions sociétales avec la montée de la violence dans les stades, la place des joueurs d’origine étrangèreou l’essor du football féminin. Le football est aussi facteur de l’intégration, c’est ce que tente d’aborder l’exposition “Allez la France ! Football et immigration, histoires croisées” au Musée de l’immigration en 2010.
Dans les dernières minutes de ce match amical foot-musée, toutes ces initiatives footballistiques et culturelles montrent que bien plus qu’un sport, le football est une culture.
M.D.
#foot
#culturefoot
#sport
#expositions
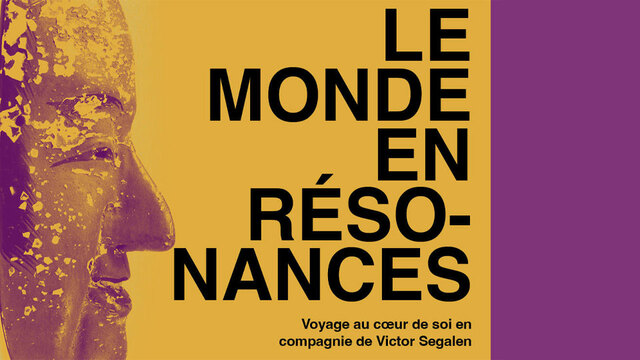
Sortir des clous (2/2) – se dérouter, pour mieux se retrouver, le monde en résonances
Ce deuxième volet de « Sortir des clous » est consacrée à l’exposition Le monde en résonances : voyage au cœur de soi en compagnie de Victor Segalen au Musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux, à voir jusqu’au 30 mai 2025. Pensée comme un dispositif expérimental de psychologie de l’orientation, elle invite les visiteurs et visiteuses à « répondre mieux et de façon ‘créative’ à des changements ou des transitions plus ou moins subies » dans leur vie personnelle.
Espace d’introduction de l’exposition © JT
Respirer, inspirer, expirer

Résonance 5 : Les traces. © JT
Ces moules, la cinquième résonance de l’exposition, sont un pont entre la démarche clinique de Jacques Pouyaud, l’œuvre littéraire de Victor Segalen et la philosophie libératrice d’Hartmut Rosa. Écoutons ce dernier :
« Nous sommes non aliénés là où et lorsque nous entrons en résonance avec le monde. Là où les choses, les lieux, les gens que nous rencontrons nous touchent, nous saisissent ou nous émeuvent, là où nous avons la capacité de leur répondre avec toute notre existence »[1].
 |
 |
Espace intérieur et espace extérieur © JT
La dérive en ville
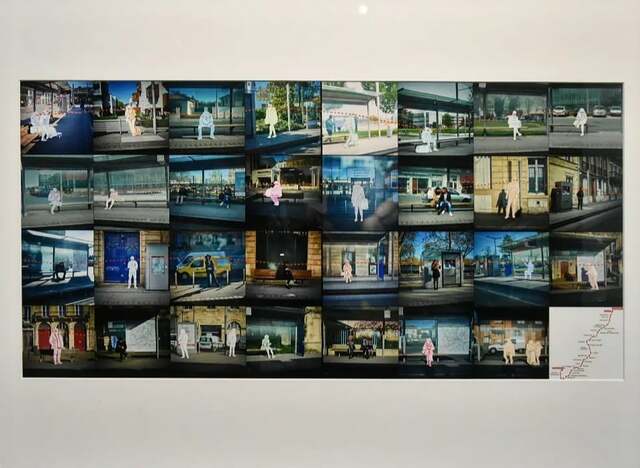 |
 |
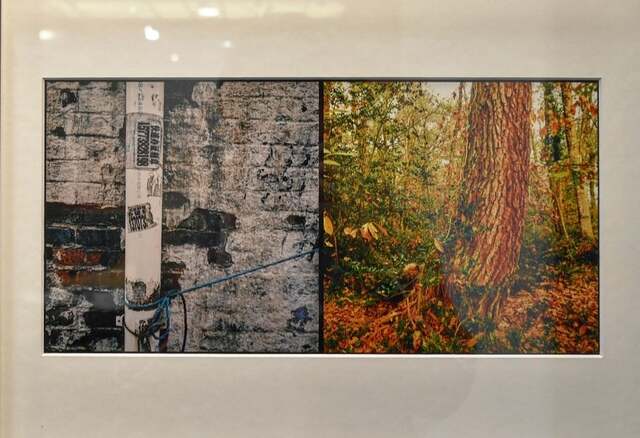 |
Trois des 5 projets photographiques (Les événements de vie et le parcours, L’identité, Le milieu de vie) © JT
 |
 |
Deux objets sans cartel scientifique, le premier appelé « sacrifice », le deuxième « les félures » © JT
« Une ou plusieurs personnes se livrant à la dérive renoncent […] aux raisons de se déplacer et d’agir qu’elles connaissent généralement, aux relations, aux travaux et aux loisirs qui leur sont propres, pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et de rencontres qui y correspondent »[3].
« Nous devons mélanger intimement des zones d’ambiance évoquant la ville et des zones d’ambiance évoquant l’intérieur d’une maison. […] Je considère ce mélange intérieur-extérieur comme le point le plus avancé de notre construction expérimentale »[4].
La stèle, l’objet et la résonance
- Face au midi - la Loi (律), les règles et normes qui s’imposent à nous : quelle est votre expression ou devise préférée ?
- Face à l’Ouest – l’adversité (挑), construire du sens pour surmonter les épreuves : vous faites peut-être face actuellement à des choix, des transitions ? Quelles questions vous posez-vous sur vous-même et votre parcours de vie ?
- Face au Nord – l’amitié (朋), quête d’un milieu de vie par l’intermédiaire d’autrui : quels journaux, séries, émissions, radio, site internet, etc… aimez-vous consulter ou suivre régulièrement ? Décrivez ce que l’on y trouve et les personnes qui y participent.
- Face à l’Est – l’amour (愛), hybridation de deux récits individuels en une forme partagée : quand vous aviez entre 6 et 10 ans, qui étaient vos héros ? En dehors de vos parents, quelles personnes étaient pour vous des modèles que vous admiriez, qu’ils soient réels ou fictifs ?
- Au centre - le soi (中), perdre le midi quotidien : quel est votre plus ancien souvenir d’enfance ?
- Au bord du chemin – (道), chemin fait de hasard et de rencontres : quel serait votre livre, roman, film de chever à emporter sur une île déserte ? Quelle histoire raconte-t-il ?
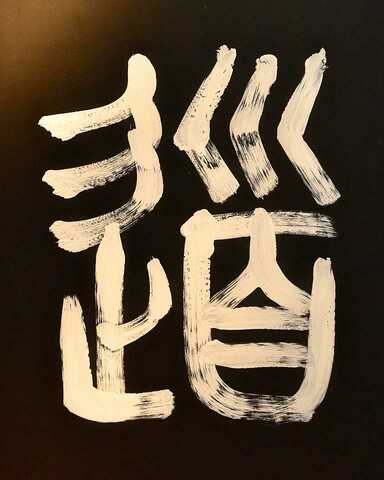 |
 |
Idéogramme calligraphie et espace d’« Au bord du chemin » © JT
Un espace de participation ?

La vitrine centrale est participative, une visiteuse y a déposé une paire de chaussures de danse © JT
Conclusion
Pour aller plus loin :
- Cohen-Scali Valérie, Psychologie de l’orientation tout au long de la vie: défis contemporains et nouvelles perspectives, Malakoff, Dunod, 2021.
- Poyaud Jacques, L’entretien sculptural d’orientation, Habilitation à diriger es recherches, Université de Bordeaux, Bordeaux, 2022.
- Rosa Hartmut, Zilberfarb Sacha et Raquillet Sarah, Résonance: une sociologie de la relation au monde, Paris, la Découverte, 2018.
- Segalen Victor, Stèles, Pei-King, Pei-T’ang, 1912.
Notes
Sous la peau là où dialoguent les cultures
« Everyonein the world has an attitude toward tattooing. No one is indifferent to it ». Bakatyin Tucker 1981: 47[1]
Me sachant à Paris et passionnée par les tatouages, Alice, ma chère amie transalpine, chercheuse infatigable d’expositions et d’événements dans le monde entier, m’avertit : « tu ne peux pas rater Tatoueurs, Tatoués !»
Intriguée, je vais voir tout de suite le site du Quai Branly où, il y a un peu plus d’un mois, malgré l’absence d’informations détaillées sur l’exposition, j’y trouvai, triomphante, une reproduction de l’affiche.
L'affiche de l'exposition Tatouers, Tatoués |© Musée du Quai Branly
Je me dis, toujours le même cliché : c’est le corps d’une femme qui est représenté, nue, à l’exception des parties non tatouées puisque de toute façon elles ne nous disent rien de plus sur ce corps. Tout ce qui parle aux yeux est là, dans sa partie centrale – justement celle qui est représentée – celle qui montre la peau marquée par deux des sujets classiques les plus légendaires : un dragon et une fleur de pivoine.
Une semaine après l’inauguration de l’exposition, sceptique depuis ma découverte de l’affiche, je me dirige vers la mezzanine ouest du musée où dialoguent les cultures.
C’est l’arrivée des beaux jours à Paris, les manches des chemises retroussées et les chevilles découvertes laissent entrevoir les corps des visiteurs touchés profondément par la question : il y a beaucoup de tatoués, et parmi eux peut-être même des professionnels du milieu.
Bien que l’exposition s’adresse évidemment à tout le monde, c’est eux dont elle parle, c’est eux qu’elle montre : les tatoueurs, les tatoués, et tous ceux qui, au fil du temps et dans différentes parties du monde ont été happés par ce phénomène, ont écrit son histoire et déterminé sa complexité actuelle, l’amenant à assumer ces contours et nuances pour lesquels nous le connaissons aujourd’hui.
Depuis longtemps, si de nombreux anthropologues s’interrogent sur les origines du tatouage et des psychologues cherchent les motivations profondes qui conduisent à prendre la décision de marquer sa propre peau, ce n’est que plus récemment que, dans denombreux pays, les médecins se sont intéressés à ce phénomène, veillant à ce que les normes de salubrité dans lesquelles la pratique est effectuée soient respectées.
Mais tous les aspects et les questions soulevés par l’encre sous la peau n’ont pas encore été mis en évidence. Un exemple ? Sa valeur artistique. A ce propos il y a encore beaucoup à dire et Tatoueurs, Tatoués vise précisément cet objectif, aller un peu plus loin, sonder cet aspect trop souvent pris pour acquis – le tatouage est une pratique artistique – qui le rend invisible aux yeux des critiques potentiels et des chercheurs du secteur artistique.
Pourarriver à aborder le sujet du tatouage contemporain comme une forme d’art, Anne et Julien – commissaires de l’exposition, ainsi que fondateurs de la revue HEY! Modern, art and pop culture – ont fait un pas en arrière juste et nécessaire se montrant des vrais connaisseurs en la matière.
L'un des 13 volumes de jambe, de buste et de bras en silicone réalisés par des maîtres de l’art contemporainedu tatouage | © Musée du Quai Branly
Le voyage sous la peau commence par un cadre historique du phénomène. Le visiteur est pris par la main, mais on le laisse libre de s’arrêter, d’une station à l’autre, où son intérêt est sollicité... Et il y en a vraiment pour tous les goûts ! En effet, il y a plus de 300 œuvres exposées – dont une trentaine spécialement conçues pour l’occasion – qui caractérisent, avec leur spécificité, les cinq riches sections dans lesquelles l’exposition est divisée.
Mais reprenons du début.
C’est par une carte des peuples tatoués à travers le monde que commence le voyage-aperçu des fonctions principales qui ont été attribuées, au cours de l’histoire, à ce signe sous la peau, aussi bien ailleursqu’en Occident.
Indicateur du rôle social, lié à la sphère du religieux ou impliqué dans les dynamiques de la mystique, les significations et les rôles historiquement attribués au tatouage dans les sociétés soi-disant « primitives » sont représentés, entre autres, par un manuscrit original du XIXe siècle appartenu à un tatoueur birman et par quelques bandes de peau humaine tatouée au Laos, qui, dans la même période ont rempli leur fonction essentiellement magico-religieuse.
Une toute autre histoire, ensuite, est celle du tatouage en Occident, une histoire de marginalité et d’exercice du pouvoir sur des corps « faibles » : de l’antiquité classique jusqu’au XIXe siècle, avec de rares exceptions, le tatouage était en fait considéré comme le « signe de Caïn », une expression de la brutalité primitive ou bien le signe infâme sur les peaux des prisonniers, des esclaves, des détenus, des prostituées et des sujets marginaux en général.
Les témoins de cette partie de son histoire sont les corps tatoués des femmes arméniennes qui ont réussi à s’échapper du génocide dans les années vingt, mais aussi ceux qui sont accusés par l’anthropologie positiviste de Lacassagne et de Lombroso de contenir en eux-mêmes la déviance dont les tatouages n’auraient été que l’expression.
A la fin Du global au marginal – la première étape de notre voyage – le ton devient plus léger : le public est transporté dans la dimension passionnante des side shows d’hier où, grâce à un film réalisé spécialement pour l’occasion, les étalages de corps à la frontière entre l’horrible et le merveilleux sont habilement rapprochés du tournage de plusieurs performances des conventions de tatouage contemporaines qui se révèlent n’être que leurs héritiers.
Les bases sont posées, le visiteur est familier avec le sujet, le chemin peut enfin prendre une tournure artistique, le propos même de l’exposition. A partir d’Un art en mouvement, en effet, l’accent est mis sur l’aspect artistique du tatouage, basé sur un critère principalement géographique, proposant une rétrospective de toutes les zones géographiques considérées emblématiques à cet égard.
Place donc aux foyers créatifs : le Japon, l’Amérique du Nord et l’Europe, qui avec leurs caractéristiques stylistiques, les noms des grands maîtres et une longue liste de dates clé, ont contribué à la diffusion de la pratique et à son élévation au statut d’art.
Peau neuve : renaissance du tatouage traditionnel – nous sommes arrivés à la troisième station – qui se tourne vers les régions de la Nouvelle-Zélande, Samoa, la Polynésie, Bornéo et encore l’Indonésie, les Philippines et la Thaïlande.
A ce moment là une question légitime se pose : quel est le critère de cette association ? Ce qui réunit ces domaines est la révolution qui a renversé leurs styles traditionnels. Ces derniers, à la suite des contacts avec l’autre et les échanges avec le monde extérieur, ont subi des modifications importantes et ont émergé sous une forme nouvelle, la forme hybride des nos jours.
Nouveauté et contemporanéité sont les sujets dont traitent les deux dernières sections, celles qui parlent le plus aux yeux des visiteurs : Nouveaux territoires du monde et Nouveaux encrages.
Dans l’avant-dernière partie ce sont les nouvelles écoles de tatouage en Chine et celles liées au tatouage latino et chicano qui sont les protagonistes : exemples emblématiques du mélange de codes, ces écoles offrent des résultats atypiques, fruits des influences de l’iconographie populaire traditionnelle et d’images tirées de la vie quotidienne.
Le voyage se termine sur huit photographies,[2] accompagnées du film Mainstream Mode, qui interrogent le public sur le mode inédit d’expression de nombreux artistes-tatoueurs contemporains.
Ne vous inquiétez pas, ce n’est que le voyage de cette exposition qui se termine ! Le Quai Branly ne s’arrête pas là et, à partir de Tatoueurs, Tatoués, crée plus d’occasions de pénétrer sous la peau.
Il faut voir la boutique du musée qui propose un large éventail de titres : non seulement le catalogue de l’exposition mais des textes rares à côté des dernières sorties éditoriales.
En outre, sept spectacles sont prévus, à partir du 31 mai, pour accompagner le public dans l’épopée du tatouage du XVe siècle à nos jours.[3]
Je sors seule de la mezzanine ouest du musée Branly, le scepticisme avec lequel j’avais franchi le seuil deux heures avant s’est évaporé là, à une des stations du voyage, ne demeure qu’une interrogation persistante : le tatouage est-il ou n’est-il pas de l’art ?
Ne suivez pas ce scepticisme, ou vous serez probablement déçus.
Tatoueurs, Tatoués en fait, se pense bien plus subtilement au-delà du réductionnisme de la relation question - réponse. S’il ne vous fournit pas une seule réponse définitive, en fait, c’est tout simplement parce qu’il n’y a pas de réponse définitive quant à l’épineuse question. Cette exposition est d’autant plus remarquable qu’elle ouvre une voie jusqu’ici peu empruntée, devenant ainsi l’endroit idéal où s’interroger.
Rodée aux expositions surle tatouage, je suis particulièrement satisfaite de celle-ci, je sors intriguée et intéressée, et tourne mon regard à nouveau vers l’encre sous ma peau.
Beatrice Piazzi
#QuaiBranly #tatouage
#art
#corps
[1] TUCKER, M.(1981), “Tattoo: the state of the art”. Dans Artforum International Magazine, New York, pp. 42-47.
[2] La relation entre tatouage et photographie a été questionnée récemment par le magazine en ligne Our age isthir13en | http://www.ourageis13.com/dossiers/semaine-du-19-05-14-tatouages-histoires-et-regards/
[3] La programmation Autour de l’exposition est disponible en ligne |

Sur les pas des Aurignaciens à la Caverne du Pont D'Arc
L’Ardèche regorge de curiosités et d’histoire, et en ces fortes périodes de chaleur les grottes accueillent les visiteurs dans des températures avoisinant les 14°C. Alors nous avons décidé de visiter la Grotte Chauvet, ou plutôt la Caverne du Pont d’Arc, réplique de la grotte ouverte au public en 2015. Oui, une reconstitution, mais faisons comme si nous nous replongions 36 000 ans dans le passé, au temps des Aurignaciens, en laissant de côté nos avis mitigés réservés sur ces murs de béton implantés sur une colline non loin de la véritable Grotte Chauvet. Après tout, il s’agit là du pacte passé avec le médiateur culturel à l’entrée de la caverne.
C’est donc sous un porche à l’entrée de ce gigantesque bloc de béton que les groupes de visiteurs s’entassent en attendant de voir leur tour arriver. A ce moment-là nous ressentons un mélange d’émotions. Tout d’abord la chaleur s’abat sur nous ! 35°C à l’ombre et une très grande envie de pénétrer les murs de la fameuse caverne qui nous promet un réel rafraichissement. L’attente au milieu de tous ces visiteurs ayant réservé leur parcours sur internet nous laisse perplexe. Quelques jeunes femmes en talons hauts, des enfants nerveux, des parents tentant de les calmer … laissons ces premières images de côté. C’est avant tout la petite voix enregistrée qui appelle les groupes de visiteurs par leur horaire de passage qui donne le ton de la visite. « Le groupe de 12h10 ! » … « 12h15 » … . Des visites chronométrées toutes les cinq minutes, cela promet un chahut à l’intérieur de la caverne. 12h20 tapante, c’est notre tour ! On nous distribue des casques, quelques tests et consignes et c’est parti. Nous faisons partie d’un groupe de vingt visiteurs mais nous apercevons déjà à quelques mètres de nous le groupe qui nous précède, et celui d’avant, et encore celui d’avant. Le médiateur s’adresse à nous adoptant le ton d’une voix préenregistrée. La consigne à suivre : « sur chaque passerelle, formez un arc de cercle, les petits devant et les grands derrières », consigne entendue une bonne dizaine de fois au cours de la visite. Trêve de médisance !

Peintures murales dans la caverne du Pont d’Arc
C’est sur ces jugements hâtifs que nous démarrons donc la visite. Le médiateur, réel passionné de la préhistoire nous propose de déambuler sur des passerelles agencées de telle sorte que non seulement nous puissions profiter de chaque fresque aux murs mais également pour que les groupes de visiteurs gardent la distance nécessaire au bon déroulement de la visite. Précisons que la reconstitution de la grotte faisant 3 000 m² au sol, elle est nettement plus petite que la véritable grotte. Les peintures sont donc bien plus rapprochées afin d’avoir une vision d’ensemble au cours d’une visite d’une heure. Jules (le médiateur) nous explique l’histoire de la découverte de la grotte par trois archéologues dans les années 90. Régulièrement il établit des comparaisons avec les répliques de la grotte de Lascaux sur la découverte des peintures qui y ont été faites. Nous sommes déjà émerveillées par ce lieu, calme, malgré le nombre de visiteurs, et ressemblant réellement à l’intérieur d’une grotte.
Je n’ai pu m’empêcher de toucher l’un des murs et c’est là que la reconstitution a pris tout son sens. Moi qui m’attendais à voir une reconstitution en plastique avec les traces des coulures de colle, je me suis bien trompée. Des lumières éclairent les peintures, Jules nous en explique les moindres détails en insistant sur le fait que les Aurignaciens étaient dotés des mêmes capacités intellectuelles qu’une personne vivant au 21ème siècle et que chaque dessin était préalablement pensé. Tout comme son emplacement dans la grotte. Nous découvrons alors des jeux de perspectives, des renfoncements ou des volumes permettant de mettre en relief chaque animal. La visite devient passionnante, et c’est sur ce ton enjoué que nous avançons sur les traces des Aurignaciens. Quelques crânes de loups au sol, de gigantesques trous représentant l’empreinte des ours en hibernation, des peintures dessinées à la paume de la main et encore une fois la trace des éléments vivants qui se sont appropriés cette grotte au fil des millénaires. En effet, Jules ne cesse d’évoquer des anecdotes permettant de valoriser l’histoire de ce lieu. Sensibles à la cause animale nous retenons la trace au sol du petit ourson qui a glissé dans ce que les chercheurs appellent la « pouponnière à oursons », ou encore les griffures des ours qui viennent compléter les dessins des hommes.
La visite se termine sur quelques échanges avec le médiateur (nous découvrons un peu plus sa réelle passion pour le sujet) suivis de quelques remerciements et un grand sentiment de satisfaction quant à la visite et à la véracité de cette reconstitution.
Après une pause nous nous replongeons dans la lecture de la brochure du site. Très bien faite par ailleurs puisque qu’elle propose un plan et un descriptif détaillé des espaces à visiter, des activités et des ateliers.

Plan de la Caverne du Pont d’Arc
Le site est immense et les chemins en terre permettent d’arpenter le lieu en appréciant la flore de la région. Nous nous dirigeons alors vers l’espace d’exposition, la Galerie de l’Aurignacien.
La visite débute par un film de quatre minutes, dans lequel on voit un petit groupe d’Aurignaciens découvrir l’existence de la grotte et y laisser leur empreinte. Puis, les portes à l’arrière de la salle de cinéma s’ouvrent sur l’espace d’exposition. Pour le plus grand plaisir des plus jeunes nous découvrons la reconstitution de l’espace il y a 36 000 ans, un lion empaillé, un rhinocéros laineux et toutes sortes d’animaux sauvages prennent la pose dans un décor plutôt réaliste.

Espace d’exposition « La combe et la grotte du pont d’Arc » ©AE
Le parcours est ponctué de bornes interactives permettant l’accès à différentes informations. Quelle était la faune à l’époque, à quoi ressemblaient les Aurignaciens, quelle était la place de l’art dans leur culture, comment chassaient-ils etc.
En poursuivant la visite nous découvrons un ensemble d’espaces d’expositions proposant une scénographie et une muséographie élaborées. Une carte interactive au mur, plusieurs tables tactiles devant lesquelles les enfants s’émerveillent, un parcours enfant avec des jeux sur tablettes, des témoignages de chercheurs permettent de répondre aux questions des visiteurs …
Dispositifs interactifs ©AE

Dispositifs interactifs ©AE
On ne s’ennuie pas. Les panneaux explicatifs sont d’ailleurs bien pensés puisque les textes sont concis. Nous remarquons cependant beaucoup de répétitions, pas seulement avec ce qui nous a été dit par le médiateur de la caverne mais également avec les informations des autres espaces d’expositions. Autre problème, plusieurs dispositifs interactifs ne fonctionnent plus. Nous fermons les yeux dessus, mais ce n’est pas le cas de tout le monde ! Un homme passant derrière s’exclame « Ah ! C’est bien une muséographie à la française ! Rien ne fonctionne ! ». Passant notre chemin nous arrivons dans la dernière salle, des colonnes centrales permettent une fois de plus de visionner des témoignages. Aux murs plusieurs écrans tactiles nous proposent de dessiner comme un Aurignacien. Il ne m’en fallait pas plus pour me réjouir, mais là encore aucun écran ne fonctionne.

Ecran « vous êtes l’artiste » dans l’espace d’exposition ©AE
Sur cette note mitigée nous décidons de quitter le lieu et de nous rendre vers les reconstitutions des habitats, des tentes en peau devant lesquelles sont postés plusieurs médiateurs afin de réaliser des démonstrations ou plutôt de donner des explications sur le mode de vie d’un Aurignacien. Cinq ou six tentes sont donc disposées dans le parc, à quelques mètres les unes des autres. Nous découvrons alors les outils de la chasse, la fabrication d’un vêtement en peau, les « instruments de cuisine » etc. Puis, à quelques pas de ces tentes se trouvent d’autres habitats où des médiateurs donnent les mêmes explications en anglais. Le site est parfaitement accessible à un public étranger mais également au public en situation de handicap.

Démonstration des instruments de musique ©AE
Alors oui, la réflexion que nous nous faisons est que nous pouvons retrouver ces reconstitutions dans n’importe quel site de ce genre. Mais le constat est que cela fonctionne puisque le lieu compte plus de 600 000 visiteurs par an et développe son offre d’activités chaque année. Ainsi des ateliers variés sont proposés durant les vacances scolaires et c’est non sans regret que nous renonçons à assister à l’atelier d’étude des étoiles au microscope le soir-même.
Il y aurait donc des choses à redire sur la dimension de parc d’attraction de la Caverne du Pont d’Arc qui brasse des visiteurs, sur certains éléments d’exposition qui ne fonctionnent pas ou encore sur la répétition du discours à certains moments de la visite, mais nous arrivons facilement à faire abstraction de tout cela pour apprécier le contenu de ce parcours. Le public familial étant particulièrement bien représenté, nous pouvons nous demander quelle serait par contre la réception du discours transmis lors de la visite pour un chercheur ou un visiteur aguerri.
Anna Erard
#Médiation
#Patrimoine
#Immersion
#Caverne du Pont d'Arc

Test : quel musée de sciences es-tu ?
1. Quel est ton scientifique préféré ?
❀ Newton, parce que sans lui je pourrais pas twitter toute lajournée !
☾ Copernic, la tête dans les étoiles !
⚯ Einstein, pour faire des explosions dans mon labo !
✩ Déso, j’en connais pas, j’ai fait L.
2. Si tu devais avoir un compagnon de laboratoire ce serait :
⚯ Un poulpe, tellement drôle
☾ Une chouette, qui m’apporterait mon courrier
❀ Une pomme, simple mais redoutable
✩ Marty MacFly
3. Ta matière préférée c’est :
☾ Mathématiques, géométrie, astronomie
❀ Sciences et vie de la terre
⚯ Physique-chimie
✩ La corde à sauter dans la cour de récré
4. Ton icône absolu :
☾ Thomas Pesquet, et ses photos magiques
✩ Rihanna, tu peux pas test’
⚯ Heisenberg, because “I am not indanger Skyler, I am the Danger”
❀ Nicolas Hulot, de la fondation Hulot
5. L’ambiance de ton espace de travail c’estplutôt :
❀ Une cabane au fond du jardin, rien de plus inspirant que Mèrenature
☾ Cabinet de curiosité de la Renaissance (Ah le charme à l’italienne…)
⚯ Laboratoire de Marie Curie : explosif !
✩ Mon lit, tellement douillet !
6. Ta citation préférée :
❀ “Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.” Einstein
☾ “Le doute est père de la création”, Galilée
⚯ “2.21 Gigowatts ! 2.21 Gigowatts ! Mon dieu ! [...] Je devais être complètement dans les nuages !” Dr. Emett Brown, Retour vers le futur
✩ “Mais enfin, c’est quoi un gigowatt ?” Marty MacFly, Retourvers le Futur
7. Tu préfères :
☾ Dormir, tu adores rêver !
⚯ Cuisiner et mettre la main à la pâte
❀ Développer de la permaculture sur ton balcon
✩ Passer des heures sur Youtube, ils sont tellement mignons ces chatons !
8. Tu ne peux garder qu’un seul de ces films, lequel choisis-tu ?
⚯ Une merveilleuse histoire du temps, Eddie Redmane qui joue Hawking ! Mon choix est vite fait !
☾ Les figures de l’ombre, trois nanas noires badass qui envoient le premier homme en orbite pendant la guerre froide.
❀ Dans les pas de Paul-Emile Victor, quel homme...
✩ “Toc, toc, toc, Penny ?!”, Big Bang Theory, sans hésiter !
9. Si tu étais l’un des quatre éléments, tu serais :
✩ L’air, si volatile…
❀ L’eau, à l’origine de tout.
⚯ Le feu, ton côté savant fou pyromane.
☾ La terre... et pourtant elle tourne.
10. Enfin, si tu devais te définir en un mot :
❀ Curieux.se
☾ Inébranlable
⚯ Dynamique
✩ Courageux.se... mais pas téméraire
©Palaisde la Découverte, Galileo, PASS, Exploradôme
Résultats :
Si tu as le plus de ⚯
Toi, tu es le Palais de la Découverte ! Tu es là depuis 80 ans pour émerveiller petit.e.s et grand.e.s. Toutes les écoles et les collèges de la région parisienne se déplacent pour venir te voir. Ton côté vieillot fait certes une grande partie de ton charme mais tu prouves sans cesse que tu es plus dynamique que jamais. Une nouvelle salle dédiée à l’informatique et au numérique qui a ouvert en octobre 2016, la semaine des jeunes chercheurs, Muséomix 2017 en préparation et ta nuit des Musées 2017 qui dure 24h ! On peut dire que tu sais fêter un anniversaire toi !
Ton atout charme ? Tes médiateurs bien sûr ! Ils animent des exposés impressionnants pour nous raconter le système solaire, la vie de labo avec les rats, l’électricité statique, etc. Et puis, certain.e.s sont quand même très attirant.e.s… Eh ! Qui a dit qu’on ne pouvait plus draguer au musée ?!
Palais de la Découverte, Paris, France
http://www.palais-decouverte.fr/fr/accueil/
Si tu as le plus de ☾
Ciao Museo Galileo ! Prix ICOM 2010, on peut dire que tu sais prendre soins de tes collections. Avec tes conditions de conservation préventive optimales, chez toi l’objet est bichonné. De l’outil demesure à la mappemonde gigantesque en passant par les moulages anatomiques, toutes les conditions sont requises pour mettre en valeur tes étonnantes collections dans un esprit cabinet de curiosités à l’Italienne, bellissimo !
Attention tout de même à ne pas te reposer sur tes acquis. Car ton visiteur, aussi averti soit-il, peut vite se sentir submergé par l’ennui face à ce flot infini d’objets savants.
Petit conseil : pourquoi ne pas inclure plus d’expériences dans les salles d’exposition ?
Quelques pistes à explorer avec ta lunette astronomique : médiation innovantes, manips, numérique, expériences ludiques… Rien n’est trop beau pour Galileo !
Musée Galilée, Florence, Italie
Si tu as le plus de ❀
Tu es le PASS, un vrai aventurier. Entre tes expositions, tes parcours, tes animations et ton jardin, tu sollicites autant le corps que l’esprit !
Avec tes ateliers et tes activités pour tous les publics, on peut dire que chez toi on ne s’ennuie pas. Mention spéciale pour tes parcours en extérieur avec tes nombreux observatoires, rien de tel pour comprendre l’environnement qui nous entoure !
Trait de caractère dominant : l’expérience est pour toi un moyen d’explorer les découvertes d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Toujours positif, tu fais confiance en l’intelligence des hommes pour trouver ensemble des solutions pour l’avenir.
Innovation, interpellation, découverte, plaisir, sont là tes maîtres mots ! Toutes ces aventures sont aussi exaltantes qu’épuisantes… Attention tout de même à ne pas trop tirer sur les jours de récupération.
PASS, Frameries, Belgique
Si tu as le plus de ✩
Tu es allergique aux musées de sciences. Désolées, on peut rien faire pour toi !
Non on rigole. Si tu as envie d’essayer mais que tu es un peu frileux.se, un conseil : l’Exploradôme d’Ivry. A deux pas du MAC/VAL ce musée où il est interdit de ne pas toucher permet de découvrir moultes phénomènes scientifiques en t’amusant. Cinquante manipulations réparties autour de cinq thématiques : énergie, climat et météo, le chemin des illusions (d’optiques), structures et formes et mouvements. Toutes t’invitent à te déplacer, essayer, manipuler, appuyer, toucher des choses pour découvrir et comprendre tous ces phénomènes scientifiques qui te semblent bien obscures aujourd’hui !
Qu’est-ce que tu attends ?!
Exploradôme, Vitry-sur-Seine, France
C’est pas tout ça, mais nous à force de crapahuter dans le Pass’âge des Aventuriers, de découvrir l’électricité statique, de nombreux objets anciens et de toucher à tout, on est épuisées, on va prendre notre goûter !
Marie & Margot
#test
#muséesdesciences
#aventures

The museum of everyday life
Ce qui est un déchet pour quelqu'un, est peut- être un trésor pour un autre. C'est avec cette philosophie en tête que Clare Dolan a créé le "Museum of Everyday day", le musée de la vie quotidienne dans la région du Vermont, à Glover aux Etats-Unis en 2011.
Infirmière, marionnettiste et philosophe, c'est avec ses idées et son activisme au sein de la compagnie de théâtre "Bread and Puppet" que Clare a développé au fur et à mesure des années la volonté de créer ce musée qui rend gloire aux objets de l'ombre, ceux que l'on oublie...
Image d'introduction : "Mirror, Mirror" 2016 © clare dolan
A quoi peut ressembler un musée non rempli d'objets rares, mais avec des objets de tous les jours ? A quoi peut ressembler un parcours de visite non traditionnel qui défie l'exposition des objets et leurs cartels ? Et comment peut -il être possible de créer une exposition avec des objets banals, étranges, de curiosités, amateurs, hors du cadre... Avec en esprit la participation de bénévoles, une collecte d'objets via des donateurs et chinés.

"Draw the Line and Make Your Point: the Pencil and the 21st Century" 2013 © Clare Dolan
Les visiteurs réguliers du musée sont plutôt des artistes, des habitants de Glover, des passants un peu curieux, des étudiants, des collectionneurs d'objets atypiques, qui donnent également de leur temps pour construire les expositions, le bâtiment et sa rénovation. Engagé, les bénévoles peuvent également devenir médiateurs de visite guidée et animateurs de performance artistique au musée, qui a pour objectif d'illuminer l'avant et l'arrière, l'essentiel, la relation entre les objets et les Hommes ?
A force de toujours rester au même endroit, dans notre train-train quotidien, on en oublie l'environnement qui nous entoure. A Glover, on reçoit et examine les objets à travers leurs vies, leur histoire singulière, et toutes leurs utilisations dans l'histoire Humaine. A chaque exposition, un objet est mis en avant. La première exposition, en 2011 avait pour thématique l'allumette. A partir d’une collection de boîtes d'allumettes était retracée l’histoire de cet objet : son invention, et son utilisation à travers les décennies. On pouvait également y découvrir des instruments de musique (violon et banjo) en allumettes, des théâtres miniatures en boîte d'allumettes, un bestiaire extérieur et géant d'allumettes à travers le monde, ainsi que d'autres curiosités traitant de la friction, de la cendre, du bois qui brûle, de l'étincelle, de la chaleur entre des personnes qui s'aiment...
En 2012, le thème était "L'incroyable histoire de l'épingle", collection provenant du monde entier en relation avec un essai philosophique de Christopher Morley en 1920, qui rend hommage à l'épingle à nourrice comme cadeau de l'humanité : elle a permis d'attacher deux bouts de tissus ensemble, et ainsi de tenir chaud, rassembler les individus autour du feu, créer des liens sentimentaux, de haine, de convivialité, construire des civilisations jusqu'à devenir le symbole de cultures alternatives, ou à contre-courant comme le mouvement Punk dans les 60/70.
Se sont enchainées une exposition sur le stylo en 2013, la brosse à dent en 2014, la poussière en 2015, le miroir en 2016, la cloche et le sifflet en 2017, la clef et les serrures en 2018, les ciseaux en 2019, et enfin le nœud et la corde depuis 2020,toujours présentée.
Une logique low-tech est également mise en avant : il y a très peu de numérique (seulement pour des éclairages, mises en ambiance). L'objet peut aussi servir à provoquer l'éveil, la réflexion et faire travailler son imaginaire. Chaque objet est un prétexte à évoquer une idée sous-jacente : l'exposition "Bells & Whistles", la cloche et le sifflet en 2017, avait en double lecture l'engagement de mettre les objets avec une seule utilisation en opposition au téléphone portable avec quoi tout est possible : prendre des photos, aller sur internet, téléphoner, jouer, lire, se repérer, écouter de la musique, se connecter aux réseaux sociaux, calculer, trouver un restaurant... Le minimalisme de la fonction d'un sifflet met en avant l'importance des origines, de la recherche de la source, du tangible, de l'accessible, de l'essentiel et de l'honnêteté qui ne va jamais trahir. Cela permet aussi d'aborder le son, le bruit, la révolte, cet objet permet de se faire entendre pour donner son opinion, en débattre, protester contre l'Injustice !
Malgré la longue histoire de la clef et les serrures, le pas de côté de l'exposition "Locks & Keys" en 2018 met en avant (en plus d'un historique de la création de la serrure : de 3 blocs de pierre aux portes blindées des banques) un sentiment essentiel dans l'histoire de l'Humanité : l'inévitable satisfaction de pouvoir se cacher et se protéger des autres. Cela est-il une preuve d'un échec à vivre tous en harmonie ? L'Humain n'est-t'il pas un animal social, avec un besoin maladif de partager, de serrer dans ses bras, et de s'ouvrir à l'autre ? Pouvons-nous encore faire autrement, ou est-il trop tard ?
Interrogée sur la difficulté d'exposer de tels objets, Clare réponde que justement, cela permet de mettre en lumière des sujets politiques aux Etats-Unis comme le rôle clef de la corde dans l'histoire du meurtre des Afro-Américains.
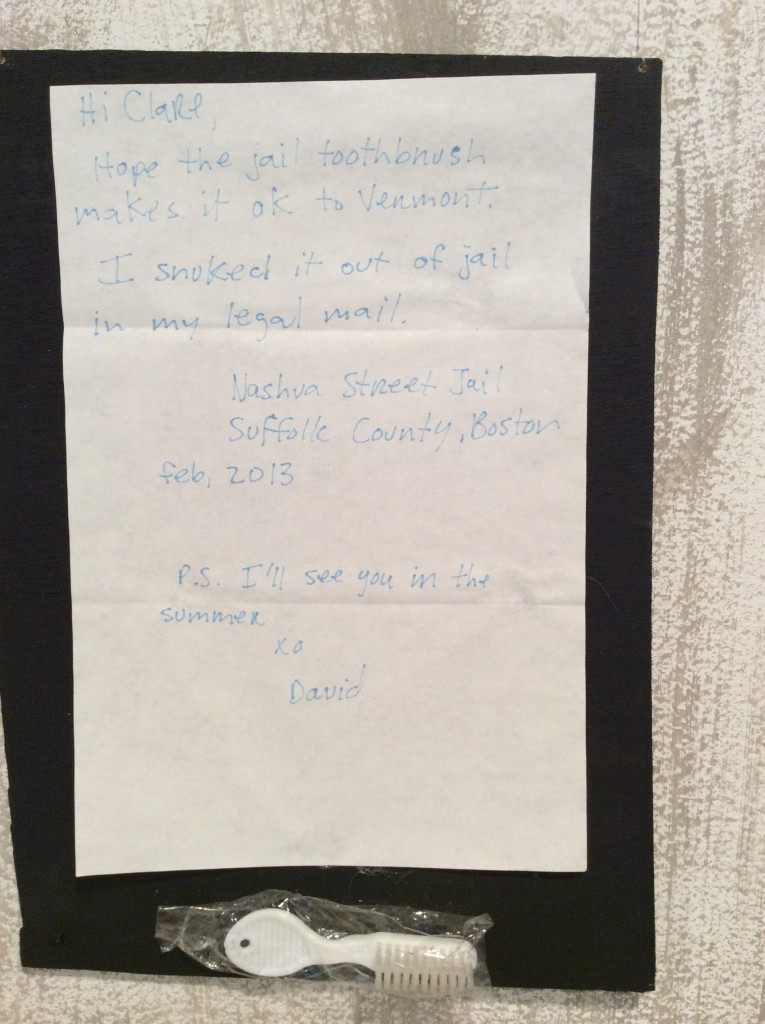
Lettre pour l'exposition "Toothbrush from Twig to Bristle In All Its Expedient Beauty" envoyé par un prisonnier avec sa brosse à dent à Clare, 2014 © Clare Dolan
Le parcours de visite :
"Allumer la lumière quand vous entrez, et n'oublier pas de l'éteindre à la sortie" ! Le musée se décompose en 3 séquences : la première, une salle d'écriture, de théorisation, et de publication philosophique à propos de la relation humain/objet, des méthodes de conservation et leur inventaire. La deuxième, une scène intérieure/extérieure pour accueillir les performances, spectacle de marionnettes, activités extérieures avec le public toujours en écho avec l'exposition en cours. La troisième (et la plus importante), le musée, qui rend tangible le travail théorique, la mise en place des pensées expérimentales de l'équipe muséographique du musée. "Fais ce que tu penses"... La visite peut être individuelle ou en groupe, seule ou guidée par ceux qui ont aidé à la conception l'exposition ou avec l'équipe présente au musée, tous prêts à vous transmettre leur passion pour l'inhabituel. L'équipe du musée met un point d'honneur sur une de ses missions principales, les workshops ! Elle souhaite, et le plus possible, intégrer ceux qui le souhaitent dans des ateliers et partager leur passion, leurs connaissances et laisser l'alchimie entre les participants prendre corps. Pour cela des résidences avec des artistes sont ponctuellement organisées, ainsi que des formations aux échasses, à la création de marionnettes en papier mâché, avec éventuellement des interventions de voisins de tous âges, et de collègues d'autres musées.
Nous sommes dans une société où on vénère l'exotique, l'autre, le rare et le précieux, autant que des célébrités... Cependant, n'est-il pas important de nous créer une place qui nous ressemble ? Nos histoires de vie sont toutes aussi singulières, et la connexion avec les objets qui nous accompagnent tout au long de notre existence mérite bien d'en faire un musée.
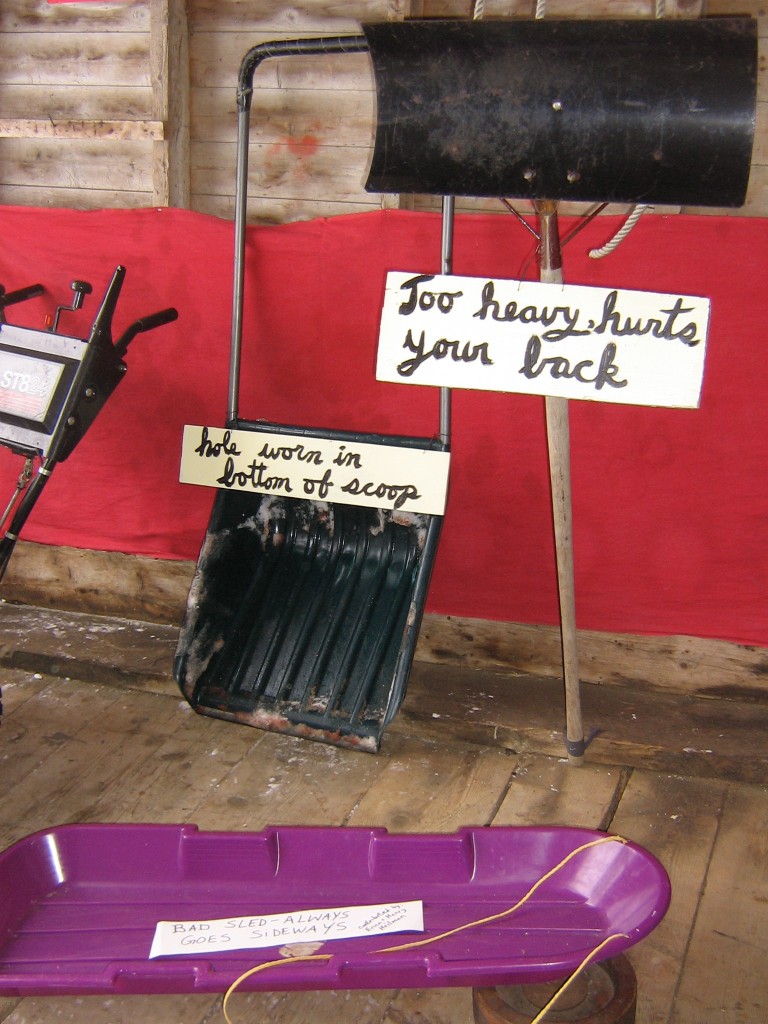
Cartel experimental © Clare Dolan
Pour aller plus loin :
- Site du musée : https://museumofeverydaylife.org/
- Constasoria/mediation "The Answers to Four Questions" https://www.youtube.com/watch?v=14xgE6AEQbk
- Hurricane Manifesto #1 : https://www.youtube.com/watch?v=bLfb0hi4Gk4&t=11s
- Constatoria/mediation "Hurricane Manifesto #1" à l'Ecosocialist Convergence de Northampton sur le changement climatique en 2012 : https://www.youtube.com/watch?v=bLfb0hi4Gk4&t=11s
#MediationSingulière #NosInclassables #PatrimoineSociété

Tirer, ouvrir et soulever
Dans les musées, la mise en exposition des éléments qui constituent le parcours (objets, œuvres, textes), parfois nous sature : tant de choses à voir ! Au risque d’une appréhension très superficielle de l’ensemble des objets, qui, mis à côté les uns des autres peuvent même finir par tous se ressembler ! Un de mes dispositifs favoris prend le contrepied de cette tendance : il cache l’objet de la vue. Dispositif simple, il permet un peu plus d’action de la part du visiteur et attire notre curiosité pour un objet que nous ne voyons pas encore. Non il ne s’agit pas de tirer la bobinette mais d’ouvrir, oh sésame, un tiroir !
Musée des Commerces et des Marques, Tourouvre @NP
Ce dispositif convient à des collections et thèmes différents, du textile (dentelle, tissus) aux objets ethnographiques. Quoi de plus logique et bien pensé dans le Musée des Commerces et des Marques qu’un « placard d’exposition » qui s’ouvre sur des objets du quotidien passé ou présent, comme d’anciens ustensiles de rasage ou encore un Moulinex ? L’appareil devient l’objet d’une curiosité nouvelle de notre part, nous qui d’habitude ne le regardons que pour son aspect fonctionnel... Ces objets ne sont donc pas mis au placard autant qu’il paraît !
Musée des Commerces et des Marques, Tourouvre @NP
Petite typologie du tiroir d’exposition
Bien évidemment, ce dispositif a d’autres fonctions évidentes : tout d’abord la conservation, quand il est utilisé avec un système de lumière qui se déclenche à l’ouverture du tiroir. Il laisse ainsi les collections se reposer tranquillement à l’obscurité quand elles ne sont pas observées et il est donc très utilisé pour les collections fragiles comme celles textiles ou graphiques.
Musée Quesnel-Morinière, Coutances @NP
Parfois, il fait partie de la scénographie, pour recréer une armoire ou un tiroir rempli d’affaires personnelles dans un élément d’exposition focalisé sur un personnage notable.
Musée des Beaux-Arts et d'Histoire, Saint-Lô @NP
Au musée de la Chasse et de la Nature, il vient s’inscrire dans une scénographie mystérieuse et poétique et nous invite à partir à la découverte des traces du loup, du cerf ou encore du sanglier…
Les « armoires » duMuséede la Chasse et de la Nature @Ndgh59
Ce dispositif permet aussi de placer le visiteur dans une position plus « active » : notre rôle ne se limite pas à l’appréhension, à la compréhension et l’interprétation du discours. Nous sommes engagés physiquement dans l’exposition, comme dans beaucoup d’expositions didactiques, où nous sommes amenés à faire des gestes simples comme tirer, soulever, se baisser ! Sinon nous ne pouvons accéder à l’objet. Et bien sûr, il nous permet d’être dans l’attente de la découverte, il réenchante les objets d’exposition en les drapant d’une aura de mystère…
Au visiteur de dévoiler les objets
Cacher à moitié les objets, pour n’être visibles que pour les visiteurs qui s'en approchent : les centres de sciences utilisent des logiques un peu comparables pour certaines manipes simples et efficaces. Ci-dessous, une manipe cache les contenus et expose l’objet (ici, un fac-similé) : la question qui l’accompagne interpelle et attire la curiosité sur le contenu scientifique transmis par le musée. Le visiteur est à la fois invité à toucher l’objet et à soulever la plaque pour chercher la réponse à la question posée sur le dessus.
Paléospace l’Odyssée, Villers-sur-Mer @NP
Enfin, le dernier cousin éloigné de cette famille permet de regarder les œuvres à travers une fente, ou un petit espace. Le visiteur, un peu voyeur, est engagé d’une autre façon : c’est lui qui décide s’il s’approche pour voir ce que le musée propose. Un exemple intéressant est l’exposition "La Disparition des Lucioles" présentée en 2014 dans la prison Saint-Anne d’Avignon. Celle-ci proposait, en jouant avec l’architecture pénitentiaire, de regarder certaines œuvres à travers le Judas de la porte, perché sur un tabouret.
Him, Him, Him (Coyote, Felt and Glass Cane), Rémi Cleiz à la Prison Saint-Anne pour "La Disparition des Lucioles" @NP
Et vous, vous souvenez-vous d’autres tirettes ? Comment votre curiosité est-elle piquée dans une exposition ?
NP
#découvrir
#magie
#visiteurs

Toutankhamon à Paris : des expositions pharaoniques
Toutânkhamon et son temps : la révolution des expositions temporaires
De plus, l’exposition dure : initialement prévue pour 4 mois, elle fermera finalement ses portes au bout de sept. L’affluence qui en découle est aussi un des facteurs d’innovation. Chacune des 1 200 000 entrées fut payante, afin de sauvegarder les trésors de Nubie. Même les scolaires devaient payer 1 franc pour entrer. La fréquentation est elle-même exceptionnelle : 108436 élèves sont venus admirer le trésor du pharaon. Toutânkhamon et son temps fait partie des premières expositions grand public qui contribue aux réflexions des musées sur les publics. La presse est à la hauteur de l’événement : quelques mois avant le début de l’exposition, un reportage télé présente l’arrivée d’une partie des œuvres à l’aéroport. Le 9 mai suivant, la visite du Général De Gaulle fait sensation en durant plus d’une heure.

Toutânkhamon et son temps : l’exposition du siècle ©Rue des Archives/AGIP
Mais plus encore, l’exposition propose une muséographie qui marque un tournant dans le milieu. L’objectif pour Christiane Desroches-Noblecourt est de mettre les objets en situation. Cette volonté s’inscrit parfaitement dans la mouvance de l’époque, en parallèle de la « muséographie sur fil de nylon » de Georges-Henri Rivière. Les objets sont présentés dans une scénographie sombre, alors que l’usage était de présenter les objets en pleine lumière. Les salles étaient baignées dans l’obscurité, permettant aux expôts de se détacher grâce à un éclairage soigneusement travaillé. Après quelques salles expliquant le pouvoir du pharaon de son temps, le visiteur entre ensuite dans un tunnel, signe de la mort du jeune roi. Après avoir tourné sur sa gauche, il découvre les salles en enfilades présentant le voyage funéraire grâce au trésor du pharaon. La scénographie propose également une salle présentant les tout débuts de l’immersif, concept inédit dans les expositions pour l’époque. Dans la « salle des papyrus », un marécage est suggéré grâce aux plants de papyrus. En son sein, une petite figurine rappelle la renaissance du pharaon après la mort. La visite se termine sur une salle abritant le masque funéraire du pharaon, apportant l’émerveillement aux visiteurs.

Le plan de l’exposition de l’exposition ©Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Une borne culturelle importante
L’exposition Toutankhamon a véritablement provoqué une petite révolution dans le milieu de la muséologie, de par sa muséographie novatrice et les conséquences d’une telle fréquentation. Face au succès grandissant que rencontrent les grosses expositions (Vermeer à l’Orangerie 1966, Picasso au Grand Palais 1966, Toutânkhamon au Petit Palais 1967), la Réunion des Musées Français (RMN) est mise en place plus vite que prévue, pour gérer ces événements. Comme l’explique Pascal Ory, l’exposition s’inscrit dans un contexte inédit de muséographie. Les premiers remous ont eu lieu en 1937, avec l’exposition Van Gogh au Nouveau Musée d’Art Moderne : l’exposition, très novatrice, est même considérée comme « trop pédagogique » pour l’époque. C’est durant cette exposition que la réflexion sur l’audimat débute. En parallèle, le ministère des Affaires Culturelles se développe. Quelques mois avant Toutânkhamon, les trésors du pharaon, André Malraux doit se battre pour obtenir « 25 km d’autoroute ». La culture « à la Malraux » est finalement à son apogée durant l’exposition, qui s’inscrit dans la volonté de la France pour trouver une place dans la culture internationale grâce à ces expositions hors-normes qui présentent des chefs-d’œuvre.
Toutânkhamon influence le milieu de la culture. Ce sont les débuts de la « religion culturelle » (Pascal Ory) : l’art devient la religion des temps nouveaux, dont les expositions sont les pèlerinages et les artistes les nouveaux dieux. Cette exposition et son succès illustrent la spectacularisation progressive des expositions d'art, et l'entrée dans une ère de mise en scène de la culture par l'état. Elle se situe aussi au début de la culture mesurée à l'aide de statistiques sur lesquelles planchent parfois des chercheurs comme Pierre Bourdieu.
Le trésor du pharaon est une mine d’or
Il est impossible de nier que l’exposition de 2019 se base sur des arguments moins nobles que celle de 1967. Tout d’abord, l’exposition n’est pas française mais internationale. En itinérance dans les plus grandes villes du monde entre 2019 et 2022, le « Toutânkhamon tour » est avant tout un véritable tour de force économique. L’Etat égyptien a décidé de sous-traiter l’organisation par la société internationale d’organisation d’évènements IMG. Cette exposition est pour l’Egypte une triple opération commerciale : une manière de faire de la diplomatie culturelle, d'attirer à nouveau des touristes que la crainte d'attentats terroristes avait fait fuir, et de financer la restauration de ses sites archéologiques et du futur "Grand musée égyptien" en cours de construction près des pyramides. De même, l’entreprise ne cache pas sa volonté de dépasser la barre des 10 millions de visiteurs. Le prix des billets est mirobolant : 24€ le tarifs plein et 22€ le tarif réduit. La boutique a elle aussi tout d’une grande : d’une taille outrageuse, elle regroupe babioles et autres tour Eiffel ensablées qui n’ont rien à voir avec le discours scientifique de l’exposition. Ici ce n’est pas une exposition classique, mais une exposition blockbuster, un grand business model américain.
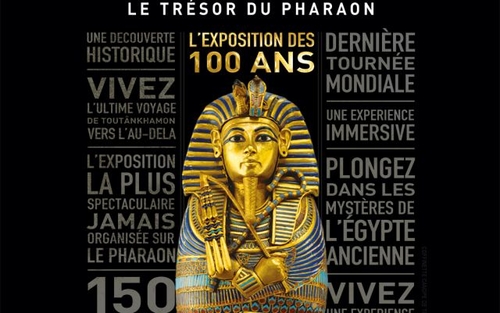
Affiche de l’exposition Toutânkhamon, les trésors du pharaon : tous les ingrédients du marketing sont réunis ©La Villette
La muséographie est quant à elle dans l’ère du temps : sombre, immersive, elle reprend tous les codes des grandes expositions-spectacles. Après une salle d’introduction avec un film qui nous présente le contexte, la foule – répartie par demi-heure – est lâchée dans un dédale de salles présentant les 150 objets réunis pour l’occasion. Les expôts sont joliment mis en valeur grâce à un éclairage bien géré… si seulement le visiteur arrive à les apercevoir devant la foule qui s’amasse. Le grand atout de l’exposition est de présenter les bijoux et autres objets précieux de sorte à voir l’avant et l’arrière de l’œuvre. Cela est d’autant plus agréable que le verso est souvent peu présenté alors qu’il est tout aussi intéressant que le recto.
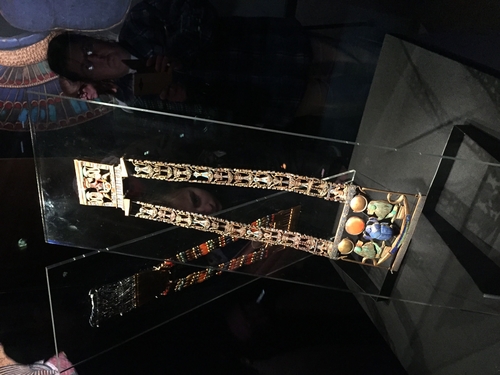

Le pire et le meilleur de Toutânkhamon 2019 : une foule incessante et le recto-verso des expôts ©C.DC
Les conditions de conservation des œuvres, déjà hautement novatrices en 1967, sont encore montées d’un cran. Ici le visiteur ne peut pas admirer les pièces maîtresses de la collection, tel que le masque funéraire, la momie ou encore le trône royal qui n’ont pas fait le voyage.
L’égyptomanie, une passion française
D’aucun ne peut nier la véritable égyptomanie qui secoue la France lorsqu’une exposition ayant trait à l’Egypte a lieu. L’égyptomanie désigne la fascination pour la culture et l’histoire de l’Egypte antique. Les Français, de par le succès des expositions et leur part importante dans le tourisme égyptien, sont connus et reconnus comme friands de cette culture. En 2006, une exposition de répliques de la tombe est programmée, que Paris accueille en 2012 à la porte de Versailles. Le succès est immédiat : environ 250 000 visiteurs ont fait face à ces copies.
Pour l’exposition de 2019, les visiteurs sont bien informés du véritable blockbuster qu’ils ont face à eux. Pourtant, cela ne les fait pas reculer : la volonté de voir une dernière fois les objets du pharaon est plus forte. L’exposition dépasse le statut d’événement pour gagner celui de rite. Aujourd’hui, celle-ci est immersive, en accord avec son temps : tout y est pensé pour vibrer plus que pour voir. Le visiteur vient voir l’éternité, un homme inscrit dans l’histoire pour toujours, qui ne meurt jamais. Tout réside dans le fait que ces trésors ne devaient être vus par personne, dédiés qu’ils sont à l’au-delà. Ici, la culture n’est plus un loisir, mais plutôt « l’ensemble des réponses mystérieuses que peut se faire un homme lorsqu’il regarde dans une glace ce qui sera son visage de mort », (18 avril 1964 Inauguration de la maison de la Culture de Bourges Discours d'André Malraux, ministre des Affaires culturelles).
A l’image de l’exposition de 1967, les visiteurs des expositions effectuent une sorte de rite. Jacques Attali explique que ces expositions, par effet de perspective, permettent au visiteur d’interroger son rapport contemporain au temps. Le rapport à la mort et à ce qui se passe après la mort fascine, et la civilisation égyptienne représente parfaitement cette ambiguïté. « C’est une vision qui nous donne un regard sur les choses que les Egyptiens ne voulaient pas que l’on voit et qui nous fascine parce que cela nous renvoie à la façon dont ce peuple pensait son immortalité, qui est bien différente de la nôtre ». (Jacques Attali).
Clémence de CARVALHO
#Toutankhamon
#blockbuster
#revolution
#1967
#egyptomanie
Pour aller plus loin : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/egyptomanie-24

TripAdvisor au Château de Ferney-Voltaire
Le château de Ferney Voltaire a ré-ouvert ses portes en juin 2018, après plus de deux ans de travaux.
L’ancienne demeure de Voltaire a été totalement rénovée et un nouveau parcours de visite a été imaginé, repositionnant l’homme des Lumières au centre de son château, qu’il acquit en 1758.
Voltaire reconstruit ce château à sa guise et aménage également le parc, créant son verger, son potager, ainsi qu’une charmille où il aime se promener. Il fait de sa demeure un lieu intense de vie sociale et littéraire. Il y continue son combat contre l'intolérance et écrit quelques 6000 lettres, le Dictionnaire Philosophique, le Traité sur la Tolérance, des tragédies... Il donne des représentations théâtrales au château et reçoit des hôtes venus de toute l'Europe des Lumières. Voltaire s’affiche également comme le bienfaiteur, le patriarche de Ferney, créant de l’emploi en développant notamment l’industrie des montres de Ferney.
A la mort de Voltaire, le château a eu une succession de propriétaires qui ont tour à tour permis de conserver l’âme du maître des lieux, en modifiant pourtant plus ou moins la distribution des pièces : La chambre de Voltaire change de place et devient un véritable lieu de mémoire, la cloison tombe entre la salle à manger et la bibliothèque. L'État acquiert finalement ce lieu en 1999.
A la manière d’une page trip advisor, voici des avis de personnes célèbres, majoritairement contemporaines à Voltaire suite à leur visite du lieu et leur rencontre avec Voltaire. Des parties de ces propos ont bien été écrites par les personnes en question. Nous les avons extraits de leur contexte, à la manière d'opinion d'internautes.
Château de Ferney Voltaire




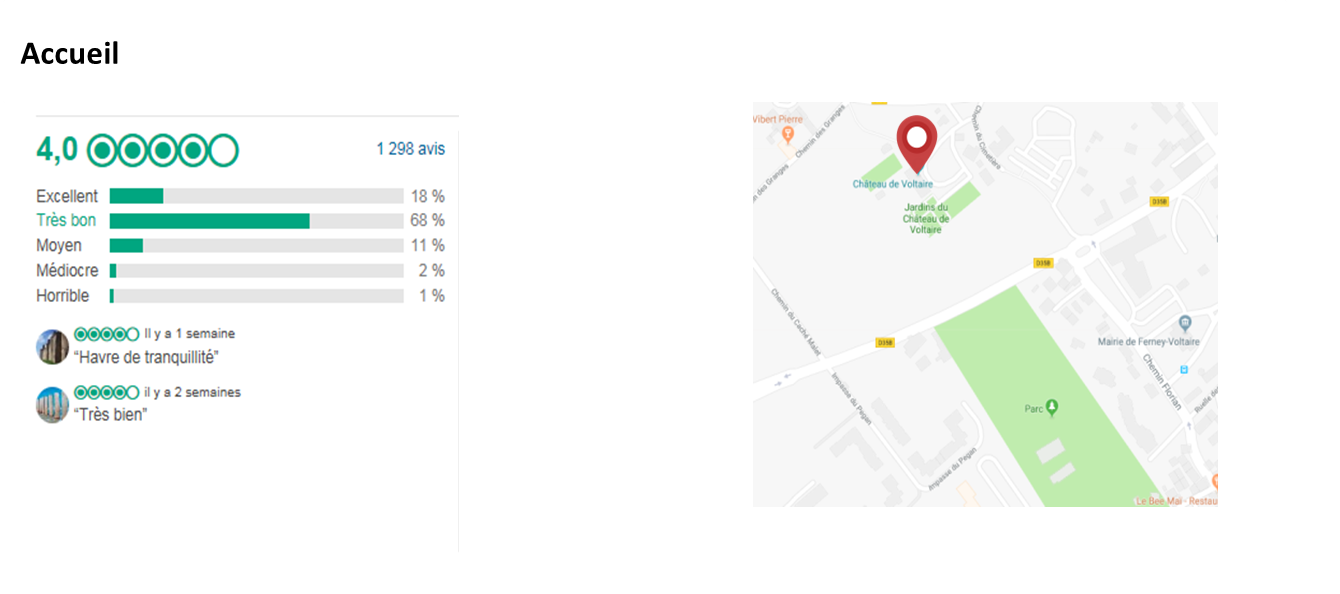
Infos pratiques
Le château est ouvert de 10h à 17h tous les jours, et de 10h à 18h du 1er avril au 30 septembre. Dernier accès 45 minutes avant la fermeture.
Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 6,5€
Accès en Bus par les lignes Y et F, arrêt Ferney mairie
Accès en voiture : parking municipal à 5minutes à pieds
Avis
Madame de Genlis :
Je suis de passage à Ferney en 1776. Je n’apprécie pas beaucoup le personnage, et je trouve ces écrits de fort mauvais goût. J’avoue m’être finalement laissé charmer par l’homme.
Il organisa une promenade en voiture. Il fit mettre ses chevaux, et nous montâmes dans une berline, lui, sa nièce, madame de Saint Julien et moi. C’est un homme qui aime son jardin, domaine. Il nous mena dans le village pour y voir les maisons qu'il a bâties et les établissements bienfaisants qu'il a formés. Il est plus grand là que dans ses livres, on y voit là sa bonté ! On ne peut se persuader que la même main qui écrivit tant d'impiétés, de faussetés et de méchancetés, ait fait des choses si nobles, si sages et si utiles pour son village, qu’il aime montrer à ses invités et dont il parle simplement avec bonhomie. Il vous instruit de tout ce qu'il a fait, et cependant il n'a nullement l'air de s'en vanter (je ne connais personne qui pût en faire autant).
En rentrant au château la conversation a été fort animée. On parlait avec intérêt de ce qu'on avait vu. Malgré un très fort niveau sonore au repas et l’impression que monsieur de Voltaire est toujours en colère contre ses gens, le moment fut très plaisant e je ne suis partie qu'à la nuit. Monsieur m'a proposé de rester jusqu'au lendemain après dîner, mais j'ai voulu retourner à Genève.
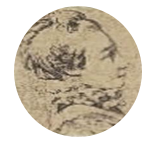 Amélie Suard, juin 1775 :
Amélie Suard, juin 1775 :
En juin 1775, j’obtiens enfin le but de mes désirs et de mon voyage à Genève, je rencontre Monsieur de Voltaire, que j’admire tant. Quel personnage, quel homme, quelle demeure !
Jamais les transports de sainte Thérèse n’ont pu surpasser ceux que m'a fait éprouver la vue de ce grand homme ! Il me semblait que j'étais en présence d'un dieu ! Rencontrer enfin celui longtemps chéri, adoré ! Enfin il m’était donné de pouvoir lui montrer toute ma reconnaissance et tout mon respect. Quel honneur pour moi qu’il accepta de me recevoir chez lui, qu’il me laissa partager sa demeure, son quotidien. Quel bonheur que de goûter les produits de son potager, de son verger, et son bon vin (car Monsieur possède de nombreuses vignes), je suis conquise !
 Edward Gibbon :
Edward Gibbon :
Je vais chez Voltaire en voisin à l’été 1763. J’assiste à l’une de ses performances théâtrales. Mais je reste un peu mitigée. La pièce jouée était pourtant ma préférée : L'Orphelin de la Chine. Voltaire incarnait lui-même Gengis mais il m'est apparu comme un comédien vociférant et manquant de naturel.
Peut-être ai-je aussi été trop frappé par l'absurdité de la scène : Voltaire, 70 ans, sous les traits d'un conquérant mongo. Perturbant…
 Jean Le Rond d’Alembert, 1770 :
Jean Le Rond d’Alembert, 1770 :
Je suis allé à Ferney en 1770, j’y avais emmené avec moi le jeune Condorcet. J’ai trouvé Voltaire si plein d’activité et d’esprit qu’on serait tenté de le croire immortel ! Il fait dans son canton plus de bien que n’en ont jamais fait les évêques d’Annecy depuis François de Sales.
C’est toujours un honneur pour moi que de le tenir informé des affaires de la capitale. J’ai séjourné longuement aux Délices, sa précédente demeure à Génève, mais on sent qu’il a fait de sa demeure à Ferney son véritable havre de paix, qu’il s’y est installé en patriarche de son village et qu’il gère ses affaires à sa guise, tel un homme libre, âgé mais apaisé.
 Condorcet :
Condorcet :
Je n’ai que 27 ans lorsque Jean Le Rond me fait l’honneur de m’amener avec lui voir son ami Monsieur de Voltaire.
C’est un privilège pour moi que de rencontrer ce vieil homme si lettré, si brillant, véritable symbole de notre époque. Je me sens alors si jeune et vierge de tous savoirs ! Mon cœur bat la chamade lorsque j’aperçois le grand homme. Je me sens alors si petit, qui suis-je donc face à lui ? Mais il m’approche avec la plus grande considération et le plus grand respect. Il me considère comme un égal et dit de moi que je serai le continuateur de l’œuvre commune par-delà de sa propre mort.
Je n’oubliai jamais ses paroles, je n’oubliai jamais cette intense rencontre.
 Boswell :
Boswell :
Je suis anglais, élève d’Adam Smith, je suis très intéressé par les grands hommes. Je suis passé à Ferney en 1764.
C’est pour moi un château enchanté, tenu par un magicien, qui me fit l’honneur d’apparaitre peu avant le diner. Quel homme savoureux, quel homme brillant ! Voltaire m'a ravi avec ses nombreux traits d'esprit. Je le fis parler anglais. Lorsqu'il parle notre langue, il est animé d'une âme tout à fait britannique, c’est admirable. Et Il a de l'humour. Il est tout à fait extravagant.
J’ai passé une merveilleuse soirée au château de Ferney Voltaire, que je suis loin d’oublier, et que j’ai hâte de partager avec mes compatriotes anglais à mon retour.
 Princesse Daschkov :
Princesse Daschkov :
Monsieur de Voltaire nous a longuement promené à travers ses terres. Il nous fit découvrir le joli village de Ferney, dont il contribua vivement au développement. Fatiguée par cette longue ballade, je suggérai de rentrer, mais il décida de nous amener dans les appartements de sa nièce Madame Denis. Nous discutons un peu avec la dame en tête à tête mais très vite son oncle nous rejoint pour le souper. Je fus surpris du caractère très simple de sa nièce, qui contraste avec l’extravagance de monsieur.
Lorsque nous primes congés, Voltaire demanda à me revoir lors de mon séjour à Genève. Je lui demandai alors la permission de venir le voir certains matins afin d’apprécier sa compagnie dans son cabinet ou son jardin. Une permission qu’il m’accorda sans réserve. C’est avec grand plaisir que je retournai plusieurs fois dans ce château au si joli jardin.
 Madame d’Epinay :
Madame d’Epinay :
Je pars pour Genève en 1758, j’y séjourne jusqu’en 1759.
J’ai toujours été un peu réservée à l’égard de Voltaire, je ne saurais vraiment dire pourquoi mais le personnage ne m’attire pas confiance.
Cependant, à mon arrivée chez Voltaire, ce déjà vieil homme semble très aimable, plus gai que ce que j’imaginais, et même assez extravagant. Un ton de familiarité s’installe assez vite entre nous. Il m’a fait tout plein de déclarations les plus plaisantes du monde. Un hôte d’excellente compagnie, à la demeure très plaisante.
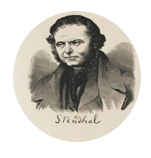 Stendhal :
Stendhal :
Je n’ai pas eu la chance d’être un contemporain de Voltaire, mais en me rendant chez lui une trentaine d’années après sa mort, j’ai tout de même eu l’impression de m’approcher au plus près de ce grand homme.
A Ferney, on m'a répété le conte suivant : Voltaire, en homme d'esprit, voulait tout faire par lui-même; il avait tracé avec sa plume le plan du château qu'il faisait bâtir. Il avait indiqué les murs d'un trait; mais quand on fut au premier étage, toutes les pièces parurent petites, et on s'aperçut que, dans le plan, Voltaire avait oublié l'épaisseur des murs. Mon grand-père, était allé cinq fois à Ferney. Il m’avait conté ses rencontres avec Voltaire.
Lors de ma visite, tout semblait comme je l’avais imaginé d’après les récits de mon grand-père. Sa chambre était encore parfaitement dans l’état où il la laissa en partant pour Paris peu avant sa mort : tenture de taffetas bleu passé, portraits du roi de Prusse, de Madame du Châtelet, de Lekain, une belle demeure, remplie d’âme. Ses livres étaient remplis d'une infinité de petites marques en papier de trois lignes de large et six pouces de long: elles portaient un mot. Quand Voltaire voulait un fait, il grimpait au haut de l'échelle de sa bibliothèque, et lisait rapidement les mots de toutes les marques d'un volume.
J.S.
#Ferney-Voltaire,
#château
#Voltaire
#CMN
#Centre des Monuments Nationaux,
#Patrimoine
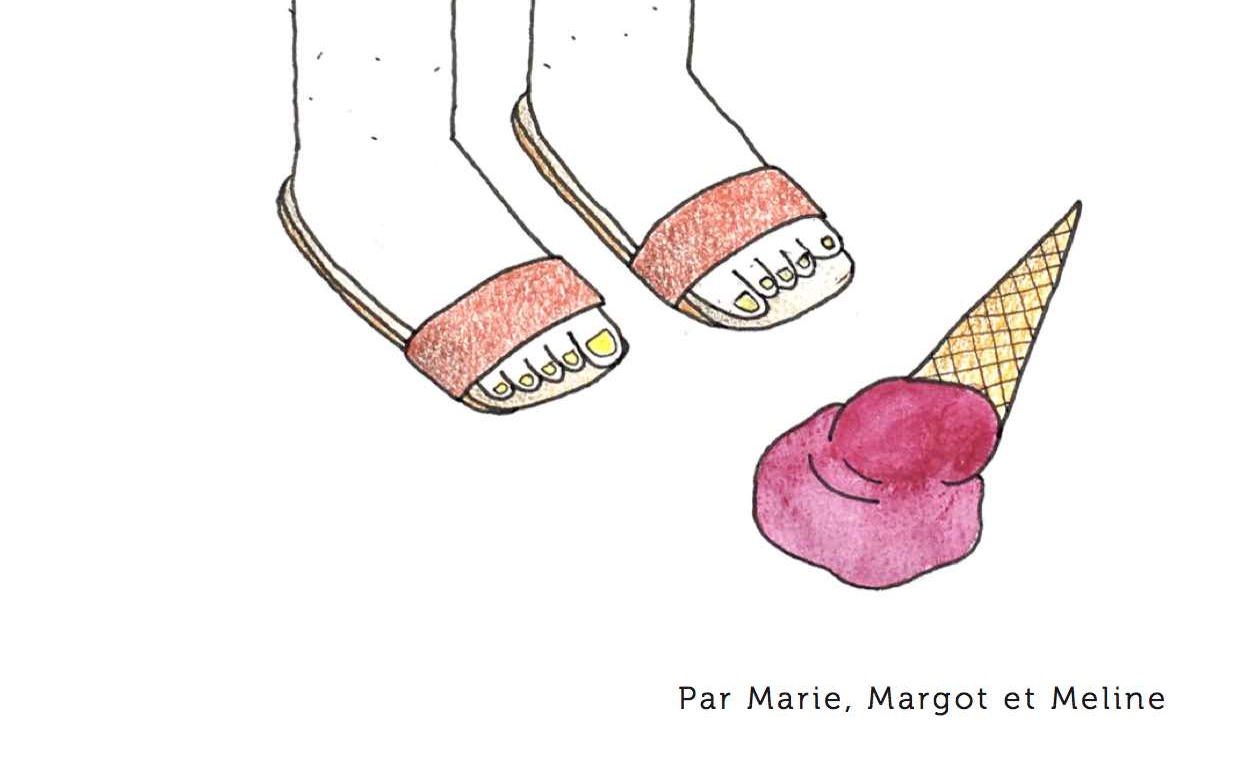
Un cahier de l'été ?
Quoi de mieux pour t'accompagner cet été qu'un cahier de jeux ?! Retour en enfance, avec ces “cahiers de vacances” qu’on ne finissait jamais... Pourtant, ici le contenu est adapté aux grands enfants et centré sur notre passion : les musées !
Les petits, les gros, les poussiéreux, les tout neufs, ceux qui se cachent dans de petits villages ou les stars internationales tous sont concernés ! A l’aide de jeux, de blagues, et de labyrinthe tu retrouveras ici un moyen de plonger dans les musées d’une manière décalée et rafraîchissante !
Ce “MUST HAVE” de l’été t’accompagnera partout : dans les transports entre deux destinations de rêve ou simplement en route vers le bureau, sur la plage pendant que tu parfais ton bronzage, devant ton café frappé du petit déjeuner... Où tu voudras !
Ne dit-on pas “visiter cinq expositions par semaine est bon pour la santé ?”
Au sommaire : Des mots mélangés, un horoscope de l’été, un labyrinthe, un « Qui a dit ? », un bingo de l’été, des mots-croisés, un tuto.... Alors, téléchargez vite le PDF et amusez-vous bien !
Marie, Margot & Meline
Voici le contenu du PDF en version image :
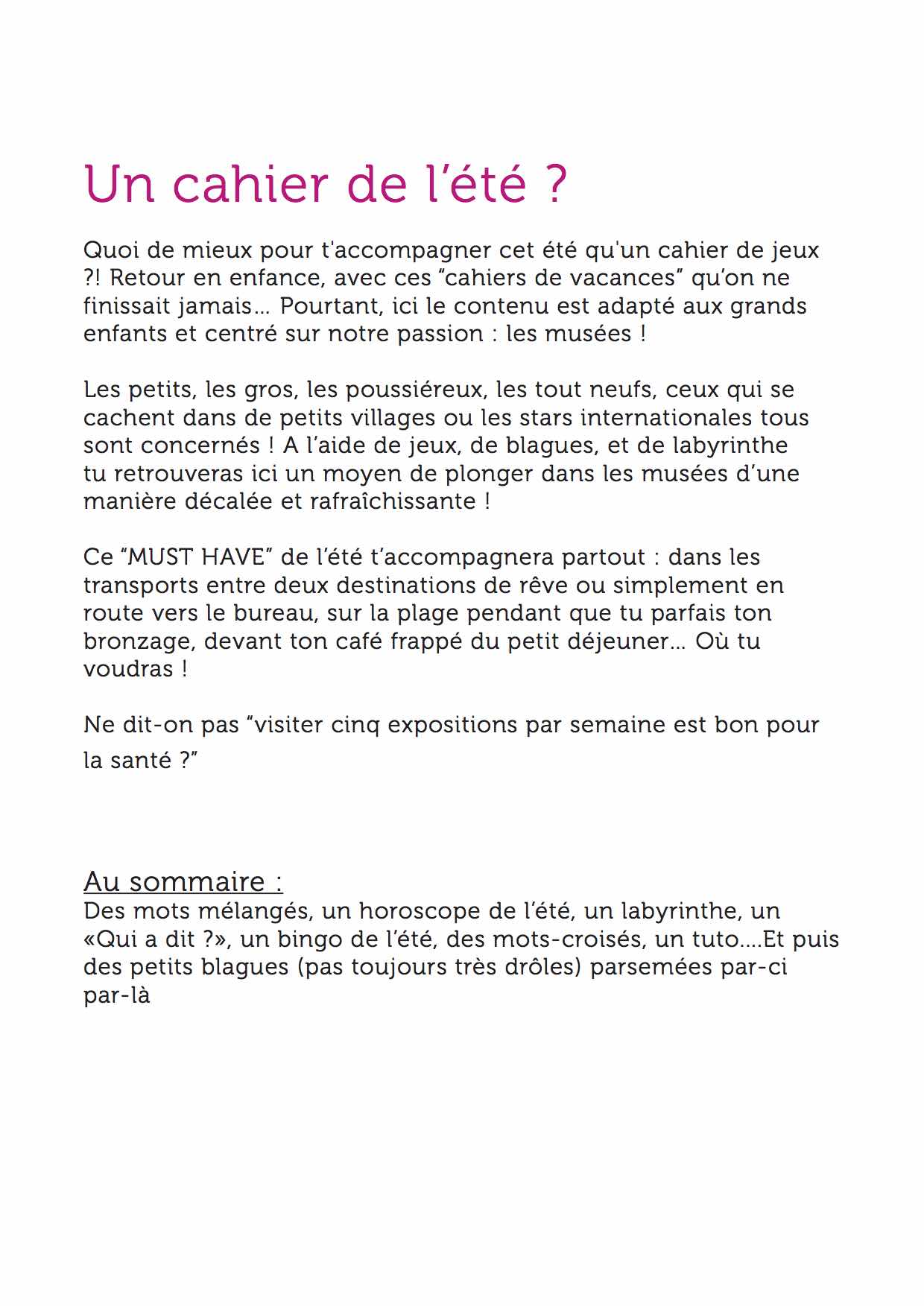
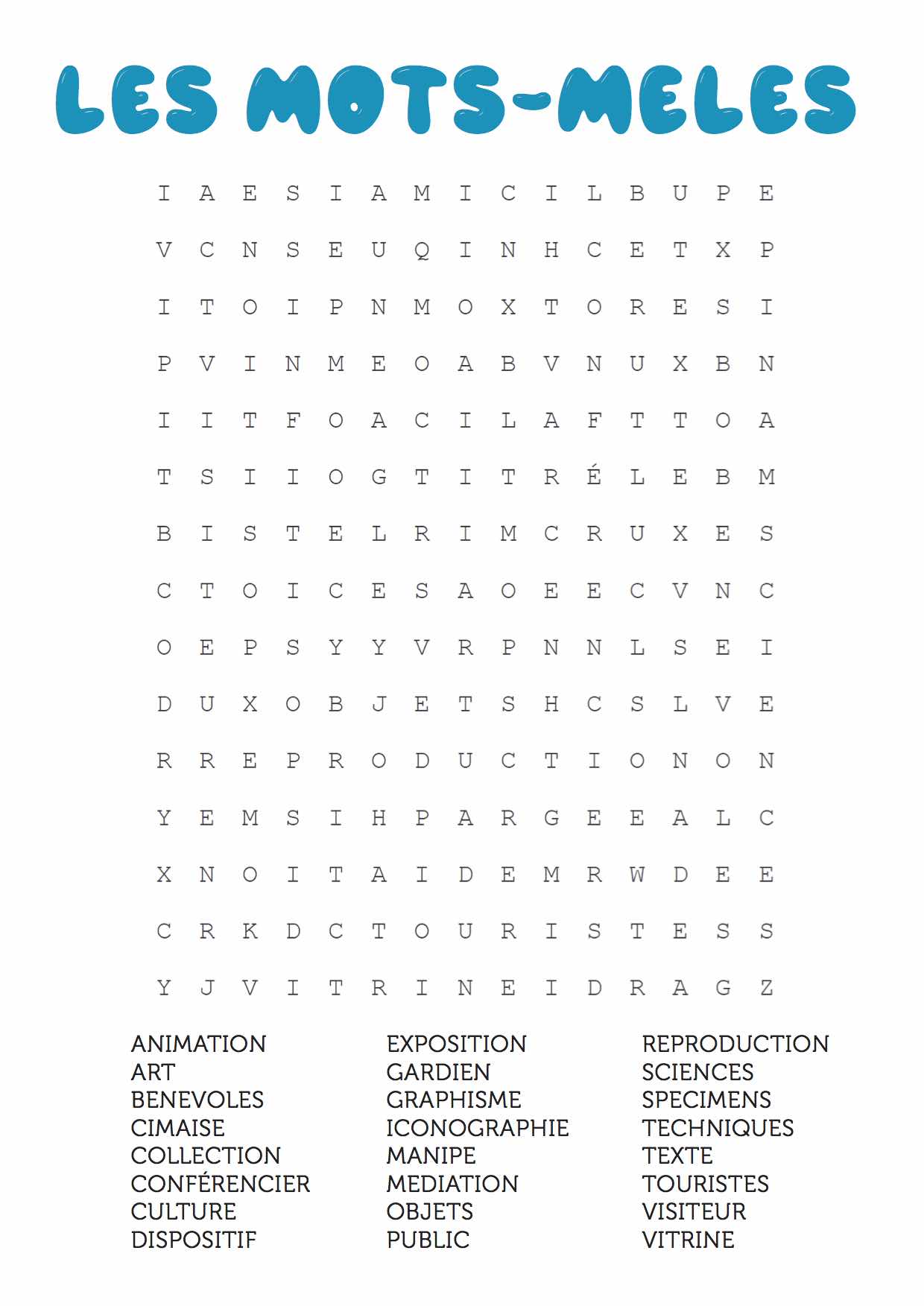
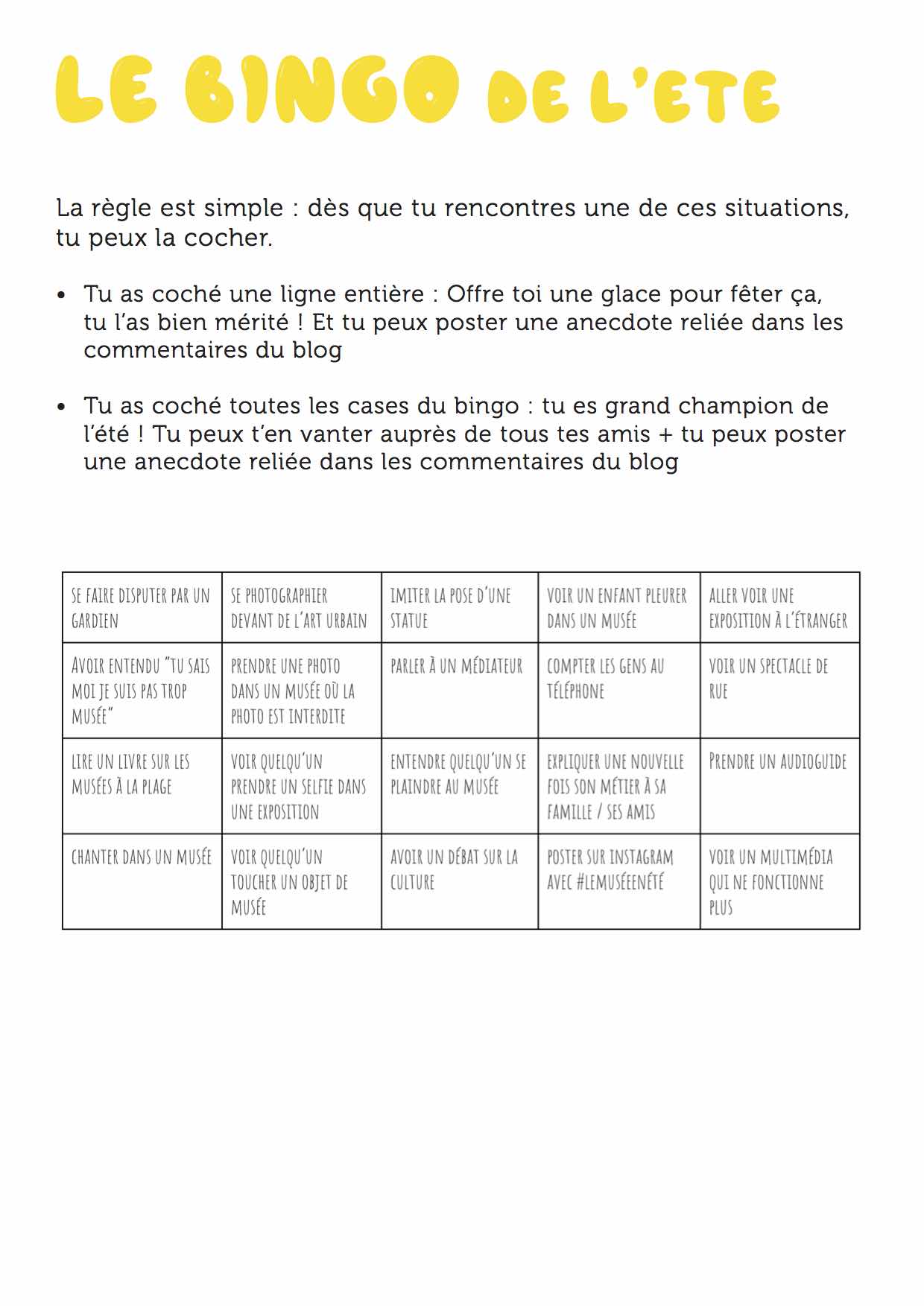
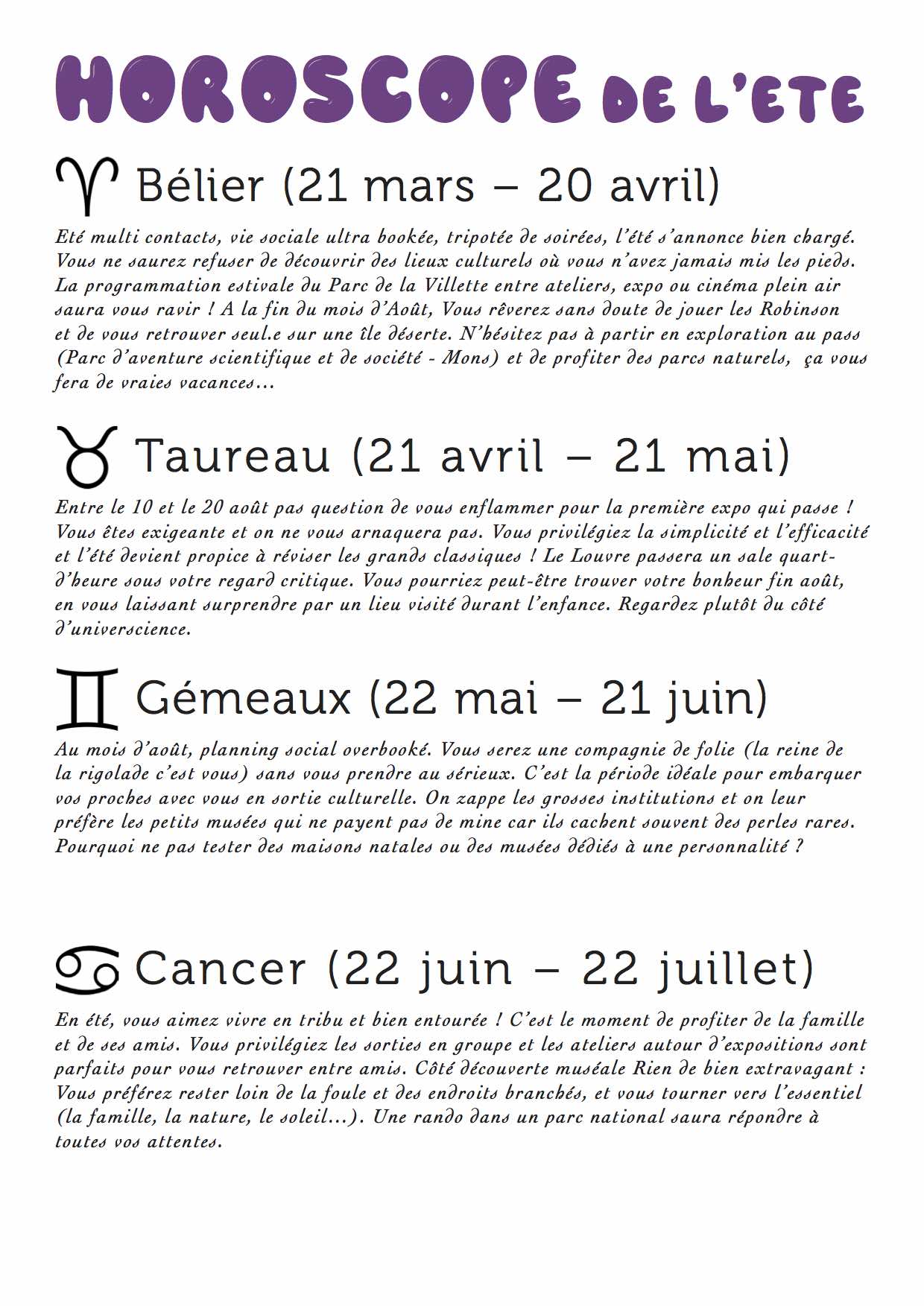
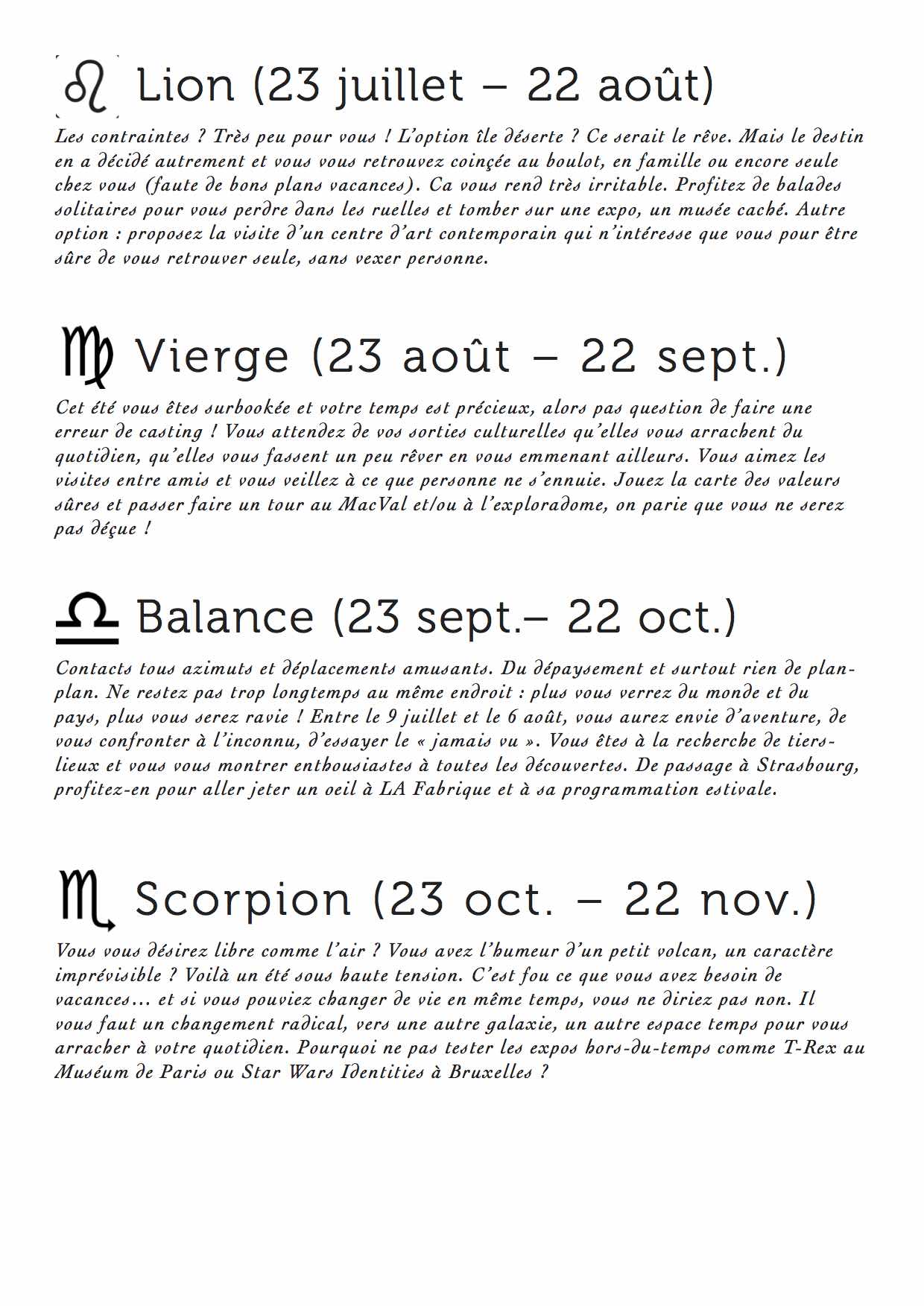

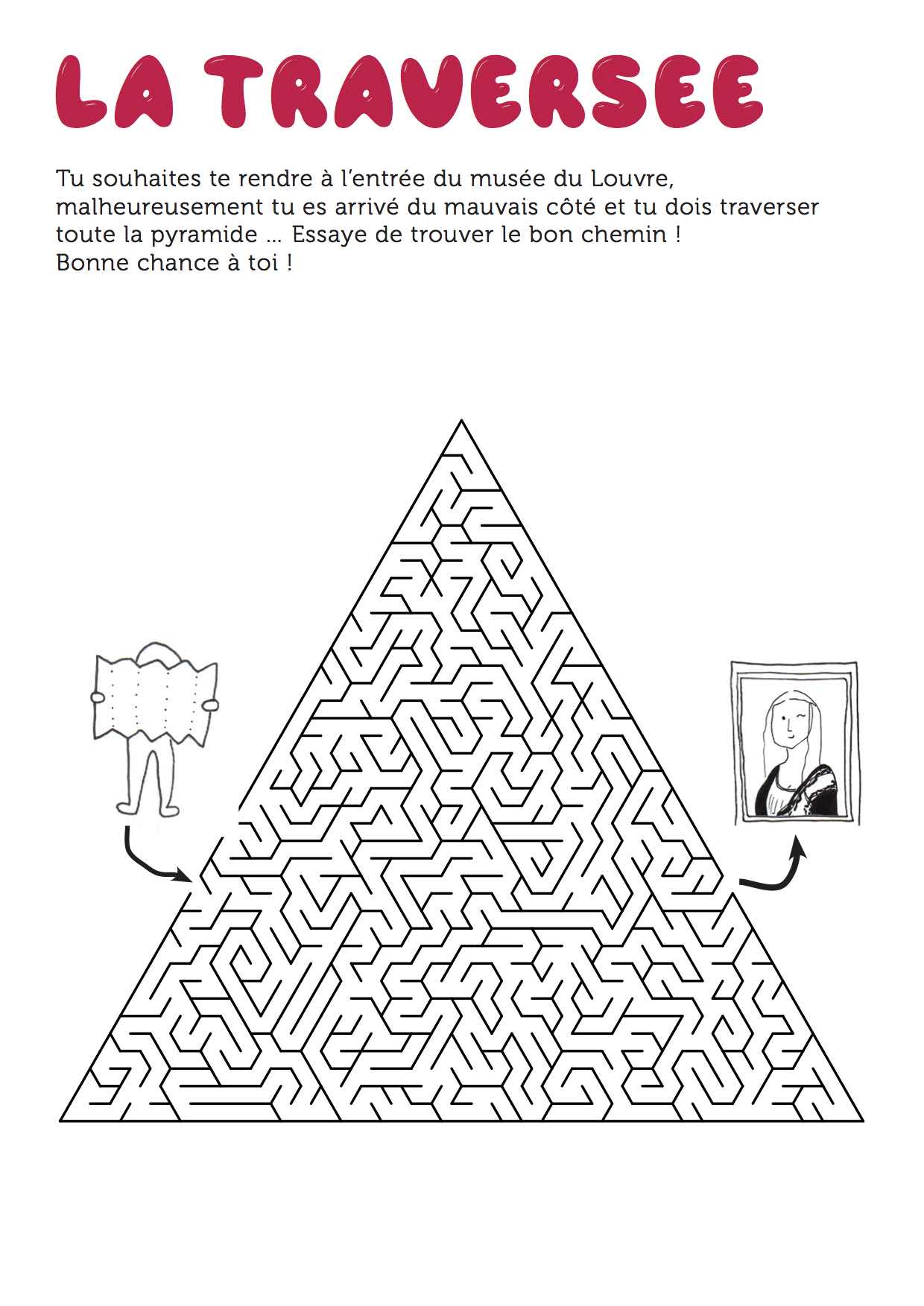
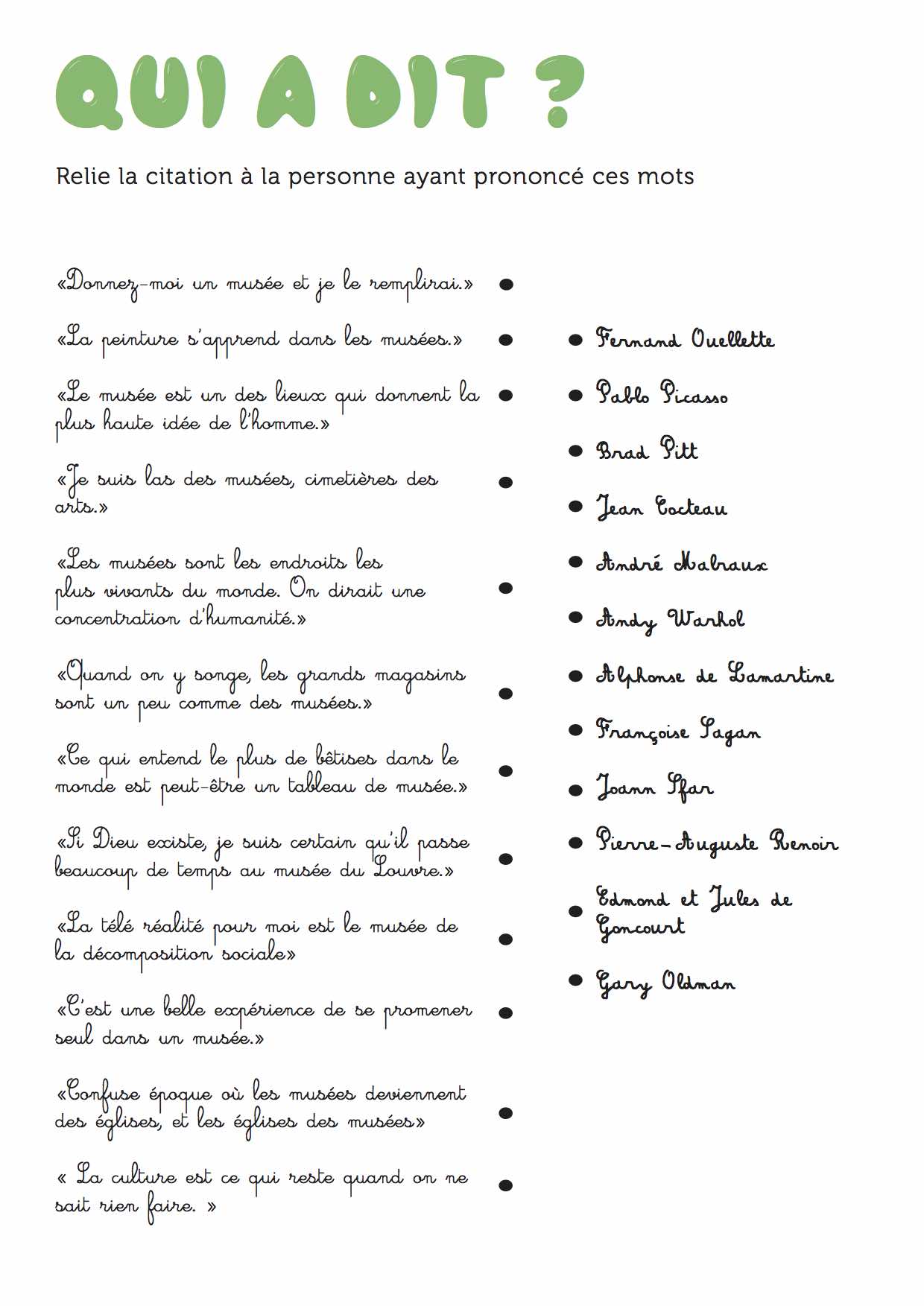
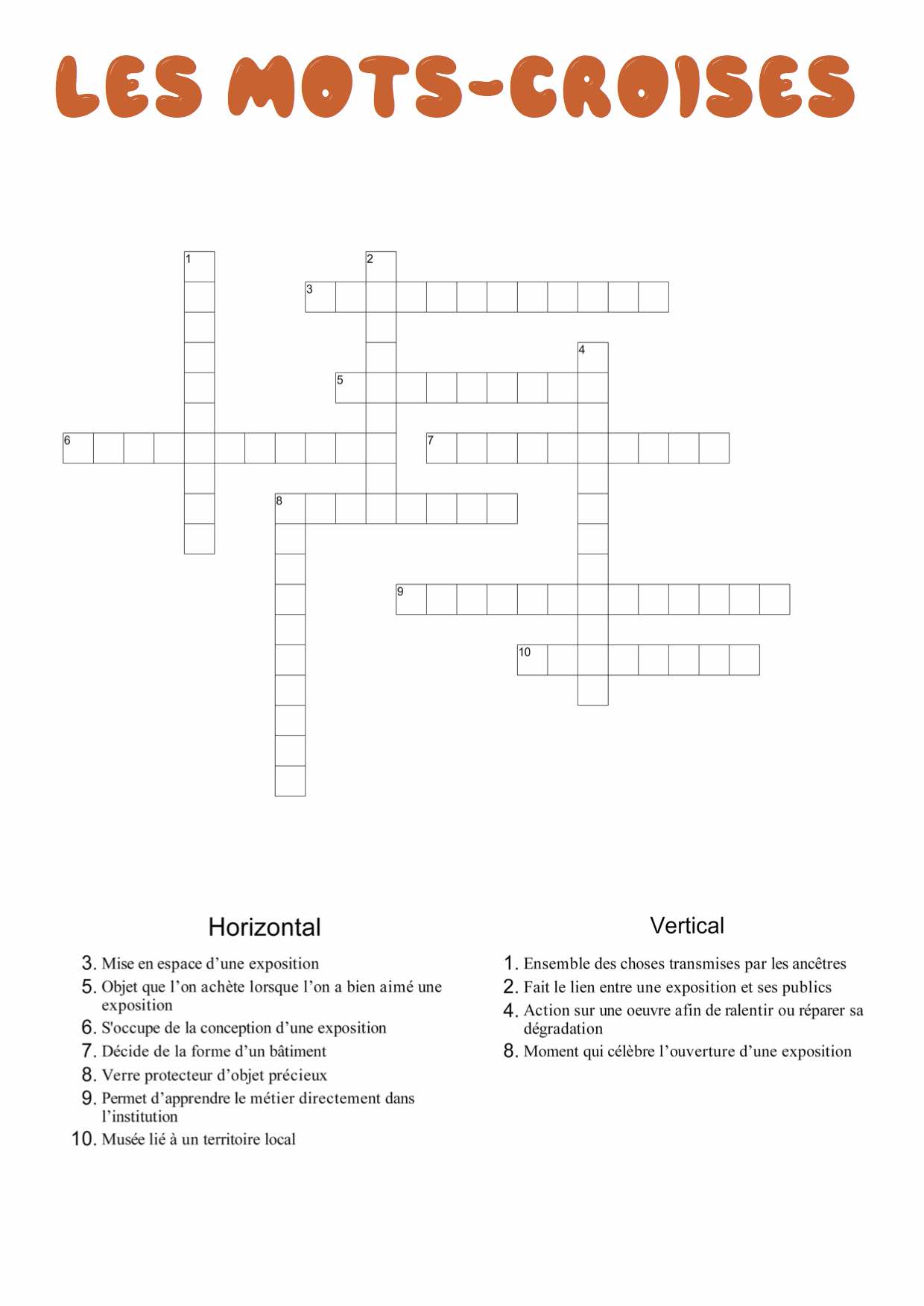


Un promenoir infini
Retour sur la 27ème édition du Festival International des Jardins où la pensée est mis à l'honneur au coeur du domaine de Chaumont-sur-Loire. Laissez-vous embarquer dans cette déambulation bucolique avec des installations éphémères qui n'ont pas fini de vous inspirer !
Le château de Chaumont-sur-Loire © Eric Sander
Surplombant la Loire à 40 mètres de hauteur, le château de Chaumont-sur-Loire allie architecture défensive de la période gothique et architecture d’agrément de la Renaissance. Bâti au XVème siècle, le château vit au cours du XVIIIème et XIXème siècles une forte période d’effervescence intellectuelle. Devenu la propriété de Jacques-Donatien Le Ray, le monument accueille des artistes renommés tels l’écrivaine Germaine de Staël et le sculpteur Nini. Seront également reçues des personnalités internationales, parmi lesquelles Benjamin Franklin. Cette période fructueuse se poursuit jusqu’en 1938, date à laquelle l’édifice est transmis à l’Etat par la Princesse de Broglie, dernière propriétaire privée du château suite à son acquisition en 1875.
Le parc historique © Joanna Labussière
D’ancienne forteresse à demeure d’agrément, le domaine ne possédait pas de jardin du XVIème siècle. C’est au XIXème siècle que le comte d’Aramon y fait planter de nombreux espèces d’arbres, dont des cèdres. Le parc tel qu’on le connaît à l’heure actuelle est conçu par le Prince de Broglie et le paysagiste Henri Duchêne. Crée dans un style paysager à l’anglaise, le parc se distingue par un relief légèrement vallonné, constitué de pelouses délimitées par des allées curvilignes. Isolés ou groupés en bosquets, les arbres orientent le regard vers les éléments phares du domaine : le château, le fleuve et la forêt. En parallèle, un second parc a été conçu en 2012. Réparti sur 10 hectares, le Pré du Goualoup regroupe des jardins représentatifs des grandes civilisations.
Le Pré du Goualoup © Joanna Labussière
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire est réputé pour être le premier Centre d’Arts et de Nature exclusivement dédié à la liaison entre la création contemporaine et le patrimoine paysager. Y sont organisés chaque année une saison d’art contemporain ainsi que le Festival International des Jardins, rendez-vous incontournable de l’innovation jardinistique consacré à la relation entre la culture et le paysage. Ce dynamisme culturel se reflète dans la programmation mise en œuvre au cœur de ce domaine, ancienne propriété de Catherine de Médicis et de Diane de Poitiers : expositions photographiques, installations contemporaines et jardins de création rythment le site au fil des saisons.
La 27ème édition du Festival International des Jardins
Lancée le 24 avril 2018, la 27ème édition du Festival International des Jardins convie les visiteurs à explorer les jardins du château parsemés d’espaces éphémères. Architectes, jardiniers et paysagistes ont façonné leurs créations autour du thème « Jardins de la pensée » et déclinés à leur manière. Des productions fructueuses qui donnent lieu à une balade agréable et saisissante au cœur de ce domaine verdoyant planté au-dessus de la Loire. Cette année, le jury présidé par l’écrivain Jean Echenoz, a examiné près de 300 candidatures provenant du monde entier (Canada, Chine, Etats-Unis, France et Russie, etc.) avant de sélectionner les lauréats invités à investir le parc jusqu’en novembre.
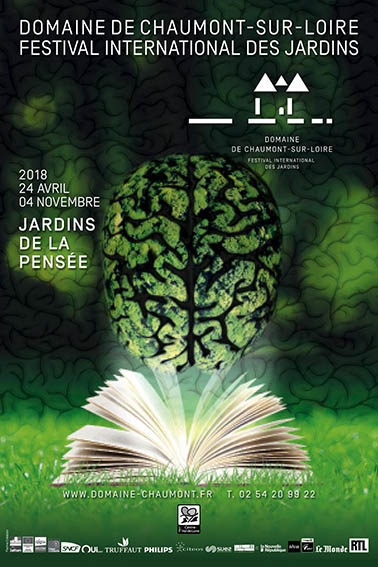
Affiche du festival © Domaine de Chaumont-sur-Loire
Ainsi, c’est la pensée sous toutes ses formes qui est mise à l’honneur, comme le souligne Chantal Colleu-Dumont, directrice du domaine de Chaumont-sur-Loire et du festival : « Quand on regarde la littérature, la philosophie, la pensée a une relation privilégiée avec le jardin. C’est l’endroit où elle se libère, où elle prospère. C’est aussi l’endroit où il est le plus facile et le plus agréable de réfléchir. On y va pour oublier ses soucis et on finit par se retrouver soi-même. » Ancienne professeure de latin grec, Chantal Colleu-Dumont confesse que le thème de cette nouvelle édition lui tient d’autant plus à cœur : « Nous avons deux références à Jose Luis Borges, une à Montaigne, une autre à Shakespeare et même à Michel Houellebecq. C’est effectivement un thème qui m’est cher. Pour moi la pensée est forcément connectée avec la littérature. Pour bien réfléchir, il faut lire en permanence. Je sais, cela peut faire un peu intello comme ça. Mais dans les jardins, c’est plus ludique et léger. »
La possibilité d’une île (Ulli Heckmann) © Joanna Labussière
C’est là toute la magie de l’événement. Nul besoin d’être un connaisseur avisé pour profiter de ce spectacle luxuriant aux installations toutes plus inspirantes les unes que les autres. Si l’on regrette parfois le manque d’informations relatives aux œuvres, on se laisse très facilement porter par cette déambulation bucolique qui n’en finit pas de nous émerveiller ; y compris par la beauté du domaine en lui-même. Coup de cœur en particulier pour « La possibilité d’une île », jardin minimaliste avec une étendue d’eau plantée d’un érable. De même pour « Sculpture de verre », composé de volutes en dégradés de bleu faisant office de support à des plantes grimpantes dans des tonalités similaires.
Sculpture de verre (Dale Chihuly) © Joanna Labussière
Expositions :
- Les 10 ans d’art (château, parc historique, écuries et cour de la ferme) : du 31 mars au 4 novembre 2018
- Les 10 ans d’art (Pré du Goualoup) : du 24 avril au 4 novembre 2018
Festival International des Jardins :
- Jardins du Festival et Pré du Goualoup : du 24 avril au 4 novembre 2018
Pour en savoir plus :
- Sur le Domaine de Chaumont-sur-Loire et le Festival International des Jardins : http://www.domaine-chaumont.fr/
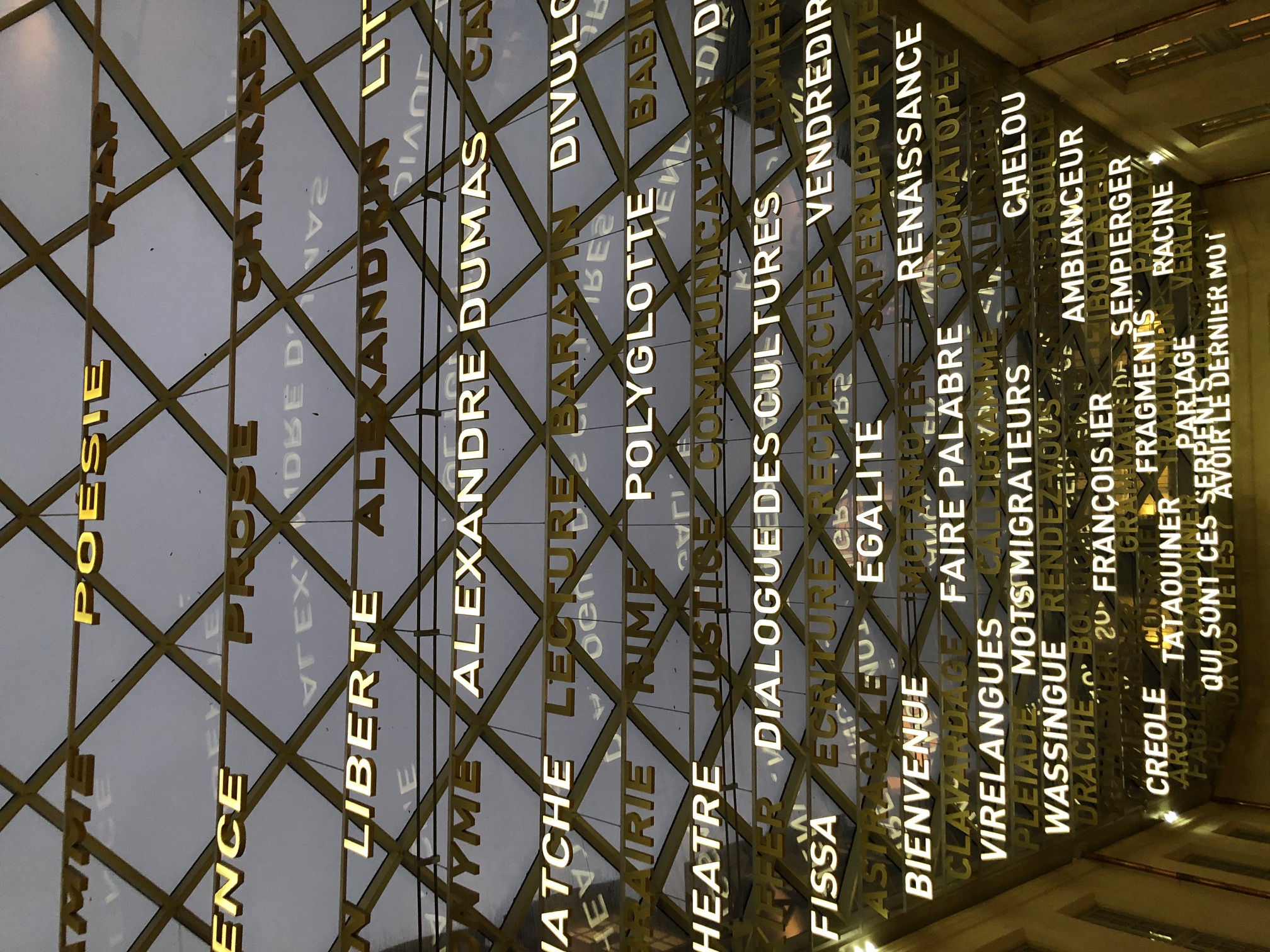
Un voyage en francophonie
« Cette Cité n’est pas un musée, c’est une institution culturelle profondément originale. C’est la première fois que, dans notre pays, une institution culturelle est consacrée à cet objet patrimonial et culturel qu’est la langue française », Elysée (Paris, octobre 2023).
Un territoire emblématique de l’histoire littéraire ?
Au centre d’une ville de 10 000 habitants telle que Villers-Cotterêts, dans l’Aisne, un imposant château se dresse. Riche d’histoire, ce fut le lieu où François Ier, en 1539, signe une ordonnance imposant l’usage du français dans les documents officiels, administratifs et juridiques. Cette signature généralise dès lors la propagation du français sur le territoire. Ancienne demeure royale transformée par Napoléon en dépôt de mendicité puis en maison de retraite en 1889, ce château subit plusieurs dégradations et tombe en désuétude, jusqu’à totalement être abandonné en 2014. Depuis 2018, lorsque le Président de la République Emmanuel Macron annonce son réaménagement, ce château de 23 000m2 reprend vie au cours de cinq années de travaux afin de devenir la Cité internationale de la langue française. Ce chantier titanesque est inauguré le 30 octobre 2023 comme site culturel dédié à la francophonie. La région Hauts-de-France est le terreau d’écrivains tels qu’Alexandre Dumas - le musée Alexandre Dumas se situe à Villers-Cotterêts - Jean Racine, Jean de la Fontaine, Paul Claudel ou encore Jules Verne, Marguerite Yourcenar, non évoqués dans la salle d’introduction dédiée à l’attractivité du pays du Valois. L’enjeu est sans doute moins de devenir un carrefour régional, même si cette dimension se trouve évoquée en préambule du parcours, que d’offrir une vision de la riche dimension internationale de la francophonie.
Lorsque le visiteur pénètre dans le hall d’accueil, il trouve à sa gauche la billetterie à laquelle est accolée une petite salle d’exposition temporaire. Sur sa droite se trouve une librairie-boutique, un café-salon de thé et, en face, des salles de réunion et un auditorium. Des locaux sont aménagés pour l’accueil des chercheurs dans le domaine linguistique, des studios pour des résidences d’enseignants, d’intellectuels et d’artistes. Situé au premier étage du logis royal, entre interactivité et ludisme, le parcours permanent en trois sections se répartit en quinze salles, et est précédé d’une salle d’introduction présentant le château et son territoire.
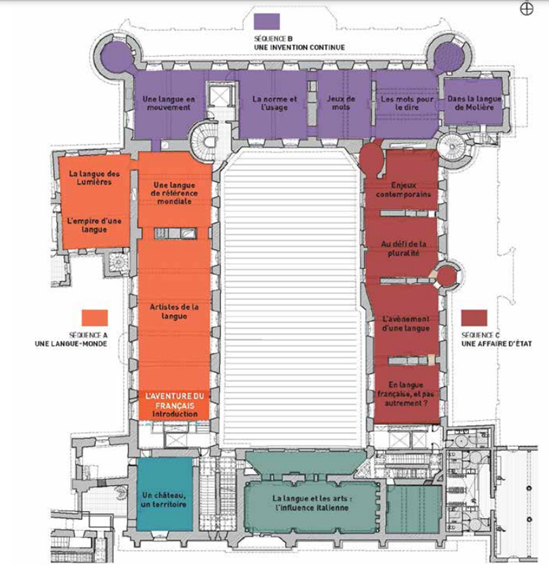
Plan de visite du parcours permanent de la Cité internationale de la langue française, au premier étage du Logis royal du château de Villers-Cotterêts ©SB
Projet politique, contenu scientifique, expérience numérique ?
« Premier lieu dédié à la langue française, par le cinéma, l’écriture, la littérature, le théâtre », Rima Abdul Malak, ministre de la Culture.
Le parcours permanent de la Cité offre une immersion complète au cœur de la langue française. Emmanuel Macron souhaite mettre à l’honneur et faire honneur, dans ce « château de la francophonie », aux figures essentielles que sont les écrivains, les comédiens, les traducteurs, les professeurs, en bref, ceux et celles qui, constamment, transmettent et font vivre le français. L’ambition de la Cité est d’expliquer, échanger et nourrir les recherches autour de la manière dont la langue française s’est formée et se formera.
Dans la séquence « Une invention continue », des dispositifs numériques sont présentés comme « La leçon d’orthographe » animée par les humoristes Arnaud Hoedt et Jérôme Piron. Linguistes de formation, ils trouvent que les Français sont peu exigeants, non pas avec leur propre orthographe ou celle des autres, mais avec l’orthographe elle-même. Ici, il ne s’agit pas de juger la langue, mais bien l’orthographe. La frontière entre l’orthographe et la langue elle-même est fine. Mais l’orthographe n’est pas la langue, l’orthographe c’est l’écriture de la langue. Sur un écran positionné face au visiteur, les deux humoristes énoncent un mot prononcé d’une seule façon mais avec deux propositions d’orthographe (par exemple, « mécanique » et « méchanique »). Quelques secondes sont laissées au visiteur pour se placer à gauche ou à droite de l’écran, en fonction de son choix. Puis la réponse correcte est donnée. Aucun score n’est attribué et aucun jugement n’est appliqué, seulement une histoire de l’étymologie. À la question « est-ce que ça se dit ? », Arnaud et Jérôme répondent invariablement « oui, tu viens de le faire ». Leur objectif à travers ce dispositif est alors de dédramatiser les fautes commises, et de pouvoir améliorer son orthographe par le jeu. Pour ces deux linguistes, la simplification de l’orthographe serait un nivellement par le haut à tout problème d’orthographe car les personnes ne feraient pas moins bien, mais mieux. Cette dictée un peu particulière décomplexe vis-à-vis des exigences de ce type d’exercice, et permet de souligner avec malice les incohérences et exceptions qui constituent la norme de la langue française. Ce dispositif, qui donne à voir les subtilités de la langue française, peut s’adresser à tout public, enfant, adolescent, comme adulte, car c’est un soutien pour découvrir, apprendre, ou améliorer, sa grammaire. Néanmoins, ce dispositif manque le défi de la traduction en une autre langue pour les étrangers ne parlant pas ou difficilement la langue française, afin que ces derniers puissent toutefois participer au jeu.

« La leçon d’orthographe » proposée par Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts, ©S.B.
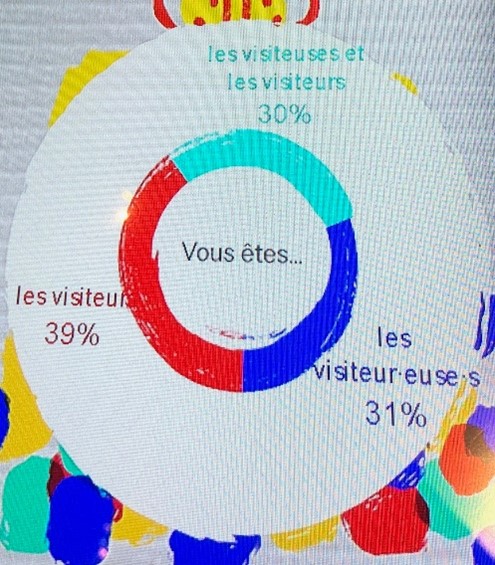
Un autre exemple de ce dispositif : « Vous êtes… les visiteurs, les visiteuses et les visiteurs, les visiteur.euse.s ? » Réponses en date du 16 novembre 2023. ©S.B.

Expressions idiomatiques francophones, section « Une langue de référence mondiale », Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts, ©François Nascimbeni (AFP).
Et par-delà la France ?

Les cartes de Frédéric Bruly Bouabré, 1991-2007, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts, ©S.B.

Le dôme des mots voyageurs, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts, © Franck Levasseur.
Et après ?
« La langue française unit, permet de partager un passé mais aussi de vivre au présent et d’inventer un avenir commun », Marie Lavandier, présidente du Centre des monuments nationaux.
Le sujet de la langue est pour le moins sensible, quand est envisagée la langue française comme langue coloniale. En comparaison, il peut sembler querelle de chapelle de s’attarder sur la langue au prisme de l’orthographe, de la langue inclusive, du genre, mais c’est le parti-pris de cet article. Chaque modification de l’orthographe fait l’objet de tribunes enflammées, et chaque entrée dans le dictionnaire de l’Académie française provoque de nombreux désaccords. Le ciel de mots est déjà un acte politique en choisissant des mots de dialecte, patois, des régionalismes, des mots récemment entrés dans les dictionnaires. À titre d’exemple, le mot « wassingue », un régionalisme du Nord signifiant « serpillère », ne relève pas d’un français académique, et les habitants des autres régions de France n’ont pas connaissance de ce vocabulaire. Ceux qui utilisent le mot « wassingue » argueront que ce mot est français, car venant d’une région française, les Hauts-de-France, même si ce mot francisé est emprunté au flamand « wassching » ("action de laver »).
Entre vocation éducative, culturelle et artistique, ce lieu ambitionne de devenir un pilier majeur de la diffusion et la préservation de la francophonie à travers le monde. Modernité oblige, interactivité et immersion sont au rendez-vous. À l’image d’une langue française caractérisée par sa diversité, vivifiée et réinventée en permanence, les dispositifs numériques devront ne pas manquer d’être réactualisés au fil des générations. Même si des contenus comme dans la salle des humoristes font date par leur exemplarité, certains contenus devront être réactualisés. La question de la maintenance et du renouvellement du contenu se posera à terme.
Article publié sur https://www.litteraturesmodesdemploi.org/ ; https://www.litteraturesmodesdemploi.org/carnet/cite-internationale-de-la-langue-francaise/
#Langue ; #francophonie ; #culture
Pour en savoir plus :
La faute de l’orthographe, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, TEDxRennes ; https://www.youtube.com/watch?v=5YO7Vg1ByA8
Podcastics, La Cité internationale de la langue française. Découverte d’un nouveau lieu culturel au château de Villers-Cotterêts ; https://www.podcastics.com/podcast/episode/la-cite-internationale-de-la-langue-francaise-263587/
Radio France, Cité de la langue française : le français, éternel enjeu politique ; https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/france-culture-va-plus-loin-l-invite-e-des-matins/cite-de-la-langue-francaise-le-francais-eternel-enjeu-politique-7556097

Une expérience de régisseur.se réjouissante !
Du 26 au 28 novembre notre promotion du master MEM s’est associée avec celle du Master 2 Régie des Œuvres et Montage d’expositions d’Amiens, pour participer au Workshop Régie encadré par Serge Chaumier, Simon Texier et Sylvain Sorgato. Deux régisseurs du Musée des Beaux-Arts d’Arras, Marie Fouré et Stéphane Derancourt ont accompagné nos réflexions et nos gestes. Cet événement fut l’occasion d’une première expérience du conditionnement d’objets ! Les deux formations ont investi les locaux du Louvre Lens Vallées et de son Muséolab. Nous voilà partis pour prendre en main les machines du Fab Lab et les matériaux propres aux conditionnements.
Le Louvre-Lens Vallée se définit comme un lieu “centré sur l’humain” qui favorise et accompagne les transformations du territoire, en accord avec sa population. Véritable incubateur de projets à vocation culturelle, sa création se situe dans le prolongement du Louvre-Lens. C’est en ce lieu que se trouve le Muséolab, mis en place par l’université d’Artois et sous la direction scientifique de Serge Chaumier. Ce Fab Lab permet de construire des prototypes, notamment grâce à des imprimantes 3D, une découpeuse laser, et une machine de découpe au fil chaud. Le Fab Manager, Léo Marius, nous a aidé à nous approprier ces outils et à canaliser nos esprits curieux face à tant de nouveauté !
Avant le Workshop, nous avions chacune des expériences et/ou connaissances différentes à propos du travail de régisseur.se. Ce métier relativement récent (d’une quarantaine d’années) a pour mission, entre autres, d’assurer la conservation et l’inventaire des collections d’un musée. L’augmentation ces dernières décennies des prêts et des expositions temporaires justifie d’autant plus l’importance des régisseurs.ses. Le workshop nous a offert l'opportunité de mettre à profit les cours du master MEM dispensés par Anaïs Raynaud, ancienne régisseuse du Mémorial de la Grande Guerre de Meaux. Elle nous avait entre autres présenté les missions d’un service régie de musée et nous a accompagnées dans la confection d’un nuancier des principaux matériaux utilisés pour le conditionnement d’objets. A partir de cet outil, nous avions toutes en possession les connaissances des matériaux et supports nécessaires à la conservation des collections. Maintenant, place à la prise en main des matériaux !
Le Workshop Régie avait pour enjeu de nous familiariser manuellement avec les matériaux utilisés pour le conditionnement et de solliciter notre réflexion et curiosité autour des objets et des machines mises à disposition. Nos travaux furent pensés au prisme de l’écologie. À ce titre, du carton de récupération était disponible, et nous étions toutes attentives au gaspillage et aux réemplois des chutes. Nous avions également eu accès aux factures pour l’achat de matériel de régie. Cela nous a permis de quantifier le coût de production de nos conditionnements, et ainsi aborder un aspect très concret du métier.
Suite à la présentation du Muséolab et les différentes équipes de travail étant constituées (4 étudiant.e.s venant des deux formations), nous avons pris connaissance des expôts sur lesquels nous allions travailler. C’est avec une grande confiance que le Musée d’Histoire et d’Archéologie de Harnes nous a prêté une vingtaine d’objets datant des deux guerres mondiales. Être responsable pendant trois jours d’une collection historique s’est avéré très valorisant. Toutes les précautions professionnelles et de sécurité étaient évidemment de rigueur pour les manipuler. Présentant des problématiques et des états de conservations très différents, chaque groupe avait comme mission de proposer un conditionnement respectant toutes les spécificités de chacun de ces objets. La mixité des formations au seins des groupes de travail suscitait un échange de savoir faire et de connaissances.
Nous avons choisi de présenter ici deux objets conditionnés par deux groupes différents, pour mettre en lumière les techniques et contraintes selon les matériaux.
Le masque à gaz et son étui
Parmi les objets à conditionner se trouvait un masque à gaz français datant de la fin de la Première Guerre Mondiale, ainsi que son étui de rangement. Cet appareil respiratoire à cartouche était dans un état de dégradation très avancé, et il a donc représenté un véritable défi pour la fabrication du conditionnement. Il fallait lui créer une boîte où seraient rangés le masque et l’étui côte à côte, sans que le masque soit en tension avec la mousse de polyéthylène, pour ne pas l'abîmer lorsqu’il sera mis en réserve.
Le masque en lui-même est constitué de cuir, sec, rigide, et cassant ; de tissu pour les lanières d’attache ; de plastique, jauni par le temps, pour les « lentilles » placées au niveau des yeux ; et d’attaches métalliques, rouillées, pour régler la taille des lanières. Il fallait être très précautionneux lors de la manipulation de l’objet, pour ne pas l’abîmer davantage.
Après avoir observé l’objet sous tous les angles, mesuré chaque partie, et pris de nombreuses photos, nous avons imaginé plusieurs solutions de conditionnement possible, avant de parvenir à une idée qui permettrait de protéger au mieux l’objet tout en étant attentif à sa conservation.

Masque à gaz et son étui © M.P.
Nous pensions d’abord suspendre le masque grâce à un crochet au niveau de la cartouche, et laisser la partie « souple » en cuir reposer sur un coussin, mais cela aurait créé des tensions qui auraient dégradé l’objet au fil du temps. La solution choisie devait permettre de laisser reposer le masque, mais sans qu’il s’écrase sous son propre poids. Après quelques croquis et des questions aux régisseurs nous accompagnant, nous avons élaboré une solution avec différentes couches de mousses, qui soutiendraient les différentes parties du masque, pour soulager au mieux les tensions dû à la vieillesse du cuir, qui s’est rétracté sur lui-même au fil du temps.
Nous avons donc décidé de créer un rangement en mousse polyéthylène avec un creux accueillant la cartouche du masque, et une cale permettant au cuir du masque et aux lanières de reposer sans que le poids ne pèse sur l’objet. Pour éviter que le cuir s’affaisse au niveau du visage, nous avons glissé un petit coussin de Tyvek dans le masque, en soutien, ainsi que quelques autres adaptations permettant de conditionner l’objet dans de bonnes conditions. Une vidéo a été réalisé par Coline pour présenter le conditionnement du masque, la voici : https://youtu.be/J6403Id1JPE

Masque à gaz et son étui dans la mousse de polyéthylène © C.D.
Nous avons ensuite créé la boîte et son couvercle en polypropylène cannelé qui abriterait le socle de mousse. Après les cutters et les crayons, la perceuse et les rivets !
Et quelques heures de travail plus tard, sans aucune blessure, nous pouvions rendre au Musée de Harnes une boîte transportable, dans laquelle l’objet était en sécurité, et aussi immuable que possible.
Le sabre de carabinier allemand
Un autre des objets à conditionner était un sabre de carabinier allemand. N’ayant pas d’indications sur la datation, nous avons supposé à partir de nos recherches qu’il datait des années 1870. Cela nous a aidé à soumettre des hypothèses, quant à la technique et aux matériaux de fabrication. Le sabre est donc constitué de deux parties, une lame en acier et une monture dont le matériau n’a pas été identifié. La soudure constitue un potentiel point de fragilité, il est alors important que le conditionnement le prenne en compte, sans poids sur un des deux côtés du sabre. Afin de le manipuler correctement, il faut donc penser à placer une main sous la lame et l’autre sur la monture.
Nous avons demandé à Léo, le Fab Manager, de nous montrer le fonctionnement de la découpeuse laser, de façon à ce que la forme de la mousse de polyéthylène suive avec précision la courbe de la lame et de la monture. Deux encoches ont été creusées, pour une meilleure préhension de l’objet s’il doit être sorti de sa boîte de conditionnement. Du tyvek est inséré dans le polyéthylène, là où est posé le sabre. Le contact de la mousse risquerait de détériorer le sabre, déjà en proie à des oxydations. La boite est entièrement faite à partir de plaques de polypropylène cannelé.

Le sabre est dans la boîte ! © C.C.
Avec les factures fournies, nous avons calculé de manière approximative le coût du conditionnement. Pour ce sabre, il monte à quasiment 40 euros. On se rend compte alors que la conservation préventive peut rapidement être coûteuse, notamment pour des structures comme des musées associatifs.
Le Workshop Régie s’est avéré une véritable opportunité pour réfléchir sur les objets et problématiser les enjeux de leur conservation. La prise en main réelle des objets de collection et des matériaux de régie fût très formatrice. Les conditions de travail étant exceptionnelles, elles ne représentaient pas à l’identique celles que l’on retrouve dans un cadre professionnel. Mais c’est avec satisfaction et fierté que nous avons tou.te.s. présenté nos travaux !

Quelques boîtes de conditionnement faîtes avec soin ! © M.P.
Cécile C. et Maud P.
#régie
#workshop
#museolab
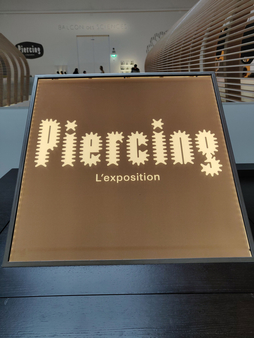
Une histoire de piercings
Présenter une exposition temporaire sur les piercings ? Défi relevé par le Musée de l’Homme ! L’exposition a pris place sur le Balcon des sciences entre le 13 mars 2019 et le 9 mars 2020, l’occasion d’aborder l’histoire de ces pratiques, ainsi que ses significations dans les cultures du monde entier.
Avant toute chose, rappelons que le mot « piercing » désigne à la fois la pratique consistant à percer la peau du corps pour y fixer un objet mais aussi le nom des bijoux. Popularisé dans les années 70 et plutôt associé à la contreculture, le piercing s’inscrit aujourd’hui dans les usages courants. Ses origines remontent cependant à la nuit des temps, ce qu’aborde la première partie de l’exposition.
Préhistoire
Existant depuis la Préhistoire, le piercing est initialement conçu à partir d’os, de bois ou encore de métal. Il sert à la fois à orner un corps mais aussi à affirmer un statut social ou une appartenance à un groupe. On en voit particulièrement au niveau des oreilles, du nez et de la bouche puisqu’il s’agit de zones plus directement visibles et qui permettent une meilleure cicatrisation – tout ce qui peut éviter de blesser ou de gêner son porteur. Les fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour de nombreux piercings retrouvés à proximité de dépouilles, mais les chercheurs restent cependant incertains quant à l’association avec des tatouages ou autres modifications corporelles au cours de la Préhistoire. Ils sont cependant certains que ces pratiques ont suivi les migrations humaines, ce qui explique qu’on en trouve dans toutes les contrées du monde.

Piercing – L’exposition : espace Préhistoire © Camille Quernée
Traditions
Le piercing sous toutes ses formes peut s’apparenter à des coutumes ou à des traditions mais aussi bien s’apparenter au conformisme social. Les hommes de la tribu des Kayapo d’Amérique du Sud ont par exemple pour tradition de porter un labret (un trou au niveau de la lèvre inférieure), qui marque la supériorité de parole des hommes. Ces bijoux permettent d’affirmer un statut social au sein d’une société, ce qui n’est pas forcément le cas en France. En effet, les trous aux oreilles des jeunes filles ou femmes y sont un signe de féminité. Les formes, les couleurs et les matériaux utilisés sont beaucoup plus variés et les boucles d’oreilles confèrent à priori plus de fantaisie que d’assise au sein d’une collectivité ou d’un groupe social. Une vidéo de témoignages étaie la relation entre les femmes et les bijoux d’oreilles, elles témoignent avec plus ou moins de fierté, du jour où elles ont pu se les faire percer.

Piercing – L’exposition : espace Traditions © Camille Quernée
Renaissance
Le regain d’intérêt pour le piercing a lieu dans les années 70, en Californie. Les bijoux n’ornent plus seulement le visage mais aussi la langue ou les parties intimes. L’utilisation de l’acier chirurgical et les antiseptiques les rendent plus facilement réalisables. Ils apparaissent surtout dans les milieux liés à la contre-culture et à l’esthétisme, s’ajoute une sorte de fétichisation. La création de la première boutique spécialisée en 1978, The Gauntlet marque un tournant dans l’histoire du genre. Le rendre accessible à tous dans des conditions hygiéniques favorables le rend plus sûr et socialement plus acceptable. Les lois exigent désormais que les pierceurs aient en leur possession des diplômes certifiant l’obtention d’une formation aux conditions d’hygiène et de salubrité.

Piercing – L’exposition : détail d'un vitrine de l'espace Renaissance © Camille Quernée
Explosion
Sa diffusion a largement été permise au travers de son appropriation par certains mouvements culturels et musicaux comme le Punk. Marquant alors la révolte et la souffrance, le piercing se présente comme le symbole d’une génération antisystème. Sa place n’est cependant pas figée et évolue encore actuellement, il est rendu plus visible et conventionnel par le biais d’Internet et des réseaux sociaux ou encore par de grands noms de la mode. Des sites spécialisés comme BME.com (Body Modification Enzine) ont aussi permis la diffusion d’images des amateurs.

Piercing – L’exposition : détail d'un vitrine de l'espace Explosion © Camille Quernée
Analyse de l'exposition
Le balcon des sciences est un espace gratuit pour les visiteurs du Musée de l’Homme, il s’agit d’une mezzanine dont le centre offre une vue sur un espace de convivialité. L’espace d’exposition exploite les quatre côtés latéraux et est percé de deux arches : l’une d’entre elle est la sortie de l’exposition temporaire plus conséquente et la seconde permet d’entrer et sortir de l’espace. Une des grandes difficultés du balcon des sciences est donc de servir à la fois d’espace muséographique et de zone de circulation. Le parti pris du musée a été de concentrer les informations scientifiques (comme les textes de sections, les cartels) ainsi que les expôts, le long des balustrades donnant sur l’étage inférieur. Cette solution technique permet à la fois de créer des mises à distance supplémentaires sans pour autant empiéter sur les couloirs permettant aux visiteurs de se déplacer.
Les parties de l’exposition sont clairement identifiées et identifiables, l’utilisation de couleurs pop sous les vitrines et les panneaux suspendus permet de définir visuellement les univers. Si les formes sont variées, on note une unité graphique ainsi qu’une personnalisation en fonction des thématiques abordées. Les assises qui ponctuent le parcours permettent de visionner les contenus vidéos de l’exposition et d’impliquer le corps. Les éléments visuels affichés sur les murs créent une connexion entre le lieu et l’exposition, de l’inscrire à l’intérieur d’un espace. Ils participent à l’ambiance et indiquent au visiteur sortant de l’exposition précédente que l’univers dans lequel il pénètre n’est pas le même que celui qu’il quitte, et qu’il est libre de s’y laisser absorber.
Les vitrines colorées présentent une variété d’expôts, certains sont anciens et issus de fouilles archéologiques alors que d’autres sont disponibles dans des boutiques actuelles. Cette approche anthropologique ancre le sujet dans un contexte historique et social fort, où le piercing, mais aussi les modifications corporelles ne sont pas des phénomènes purement contemporains. Les pratiques et les perceptions ont certes évolué depuis 45 000 ans, mais l’humain s’est toujours exprimé à travers son corps, qu’il s’agisse d’affirmer sa place en tant qu’individu, ou sa pensée artistique.
Le choix du sujet est surprenant et peut provoquer une gêne chez certains visiteurs. Il n’est pas anodin de se faire percer la peau, encore moins pour y placer un ornement. Certains soulèvent la question de l’hygiène corporelle ou considèrent cela comme des mutilations volontaires. D’autres se sentent fiers de pouvoir se parer de nouveaux attributs et d’affirmer leur identité à travers ces bijoux. De manière plus extrême, il existe un terme pour désigner les amateurs de modifications corporelles : la stigmatophilie. Celle-ci s’apparente plutôt au fétichisme et à priori aux pratiques liées au milieu BDSM qui sont mentionnées dans l’exposition. Percer son corps est aussi une manière de découvrir de nouvelles sensations et d’y ouvrir son esprit. Ces expérimentations ne sont pas novatrices et s’inspirent de pratiques amérindiennes, où la suspension permet aux jeunes hommes de devenir guerriers.
Le Musée de l’Homme prend le parti d’évoquer le piercing sous l’angle de l’anthropologie historique. Il se s’agit pas d’en parler comme de pratiques isolées, mais plutôt de les ancrer dans une réalité rendue tangible par l’évocation d’exemples variés, à la fois dans le temps et l’espace. Croiser les disciplines pour évoquer un élément du quotidien fait le lien entre les cultures du passé et les cultures actuelles. Il ne s’agit pas de dénoncer un phénomène de mode, mais plutôt de démontrer son historicité. Il est toutefois surprenant de voir exposés côte à côte un morceau d’os ayant servi de bijoux il à 45 000 ans et des piercings industriels disponibles dans les boutiques. Ces derniers ne sont alors plus perçus comme de simples éléments décoratifs, ils étayent le propos de l’exposition et acquièrent une valeur d’objet de collection. Le Musée de l’Homme n’est certes pas le premier à muséaliser des objets du quotidien contemporain, les expérimentations se font plus régulières depuis les dernières décennies, notamment au Musée d’Ethnographie de Neuchâtel.
L’Europe n’est pas éludée, comme c’est usuel pour bien des musées et sujets d’ethnographie. Intégrer la culture et les pratiques locales à une exposition permet de traiter plus globalement, de ne pas montrer du doigt ce que font les autres mais d’inscrire l’être humain dans une démarche d’imitation collective. Il s’agit de montrer l’espèce humaine dans sa globalité et pas uniquement de parler des cultures étrangères, pouvant être considérées comme indigènes.
L’exposition Piercing est une réussite, notamment par la maitrise d’un espace d’exposition complexe mais aussi pour avoir abordé un sujet qui, malgré l’évolution des mœurs est encore marginalisé. La filiation forte entre le piercing et certaines pratiques marginales liées au milieu gay et BDSM n’est pas abordée de manière péjorative, il s’agit d’une page de l’Histoire à valeur égale avec les autres. Un message fort de l’exposition est qu’il faut prendre en considération ces ornements, symboles d’une infinité de valeurs et d’esthétisme.
Camille Quernée
#museedelhomme
#expositiontemporaire
#antropologie

Une pause déjeuner entre cultureux
Pour en savoir plus sur le FRAC - Nord Pas de Calais, ses expositions, ses actions culturelles...
A.H.
Pour en savoir plus sur le FRAC - Nord Pas de Calais, ses expositions, ses actions culturelles,... : http://www.fracnpdc.fr/
#Politique
#FRAC
#Expositions

Urbex et culture avec la Clermontoise de Projection Underground
Depuis 2014 je participe tous les ans à l'Underfest, un festival culturel qui proposed'assister à des concerts et des projections de courts métrages dans des lieuxinhabituels.
Underfest 2014, The Delano Orchestra © Clermontoise de Projection Underground
Tous les Clermontois le savent, la butte de la vieille ville est trouée de caves, formant un formidable labyrinthe souterrain. Grâce à la Clermontoise de Projection Underground, ces caves accueillent musique et cinéma le temps d'une soirée au début de l'été.
Pour participer, il faut s'inscrire via la page Facebook de l'organisation. Le jour même de l'évènement, on reçoit une heure et un point de rendez-vous, ainsi qu'une liste d'équipements nécessaires, gants, vêtements chauds et résistants, lampe frontale, … Quelques heures plus tard, les participants se regroupent àl'heure et au lieu dit, nous sommes une quinzaine, parfois près de trente mais pas plus, il faut rester discret …
Édition 2014, Julien Estival © Clermontoise de Projection Underground
La soirée débute par un concert, joué par un groupe ou un artiste clermontois, j'ai eu la chance d'assister aux performances de Morgane Imbeaud et Guillaume Bongiraud, The Delano Orchestra, Julien Estival ou encore The Arberdeeners cette année. Petite cave exiguë ou immense espace vide, éclairé à la bougie, l'effet est saisissant, l'ambiance intimiste.
En 2015, les concerts étaient remplacés par une rencontre avec un.e chef clermontois.e et une dégustation. Les chefs ont cuisiné devant nous, tout en présentant leurs produits et parfois partageant leurs recettes. Chips violettes, panacotta à l'agar-agar, tourte aux orties, des mets originaux mais surtout délicieux. Le nombre d'assiettes étant restreint, tout le monde partage et discute avec son voisin.
Édition 2015. Tourte aux orties, fleur de mauve et tomates anciennes.
Après le concert / la dégustation, petite pause exploration, tout seul ou en petit groupe, tout le monde s'éparpille lampe de poche au poing. Certaines caves semblent ne jamais se finir, les salles voutées et les escaliers se succèdent, s'enfonçant toujours plus sous la terre. La première année, alors que nous étions réunis dans un cave près de la place de la Victoire, accompagnés de l'organisateur de l'évènement, nous nous sommes aventurés plus loin. Nous avons tous rampé dans une petite ouverture à travers une porte à moitié défoncée communicant avec la cave d'à côté. Encore quelques mètres plus bas et nous étions sous la place de la Victoire. Surprise, on peut y voir les restes d'un aqueduc, datant probablement de l'antiquité tardive ou du haut Moyen Âge.
Chaque soir, la projection propose plusieurs courts métrages autour d'un thème choisi. Lors de ma première participation au festival, tous les courts métrages traitaient de l'Urbex. Ce fut une sacrée découverte pour moi et depuis cette soirée je regarde la ville différemment, rêvant moi aussi de m'introduire dans les réserves d'un grand musée parisien ou d'explorer une friche industrielle. Cet été, j'ai pu voir La Jetée, réalisé par Chris Marker en 1962. S'agit-il d'un clin d’œil du centre de documentation du même nom dédié au festival du court métrage de Clermont-Ferrand ?
Édition 2016, The Aberdeeners. On aperçoit les photographies derrière le groupe. ©Clermontoise de Projection Underground
Les caves ne sont pas l'unique terrain de jeu de la Clermontoise de Projection Underground. Le festival s'est introduit plusieurs fois dans un bâtiment en travaux sur une des rues les plus passantes de Clermont-Ferrand. Alors le soir, il ne faut pas trop s'approcher des vitres avec nos lampes, pour ne pas attirer l'attention. Dans ce bâtiment, un photographe a installé ses créations, des portraits noir et blanc, imprimés en grands formats. Quiconque s'introduit dans le bâtiment peut venir les contempler, aussi longtemps qu'il le souhaite et à n'importe quelle heure, ce musée n'a pas d'horaires...
L'illégalité du festival signifie que chacun engage sa propre responsabilité, pas d'assurance pour les blessés ! À chaque festivalier de faire attention là où il marche et à se conduire de façon responsable.
Quelques heures plus tard, les festivaliers émergent, les vêtements souvent salis par la poussière ou la boue, suffocant dans leurs vêtements trop chauds pour la saison mais comblés.
L'Underfestallie culture et exploration urbaine, festival gratuit, il se veut accessible à tous (enfin, ceux qui connaissent!), avec une forte dimension locale, promouvant des artistes de Clermont-Ferrand et faisant écho au festival ducourt métrage. Pour les participants, c'est l'occasion de découvrir des espaces auxquels ils n'ont pas accès en temps normal et d'assister à des évènements culturels dans des lieux insolites, dans une ambiance chaleureuse et détendue. L'enjeu est de s'approprier l'espace urbain et de jouer avec, de sortir la culture des musées ou des salles de concert.
Clémence L.
Facebook de la Clermontoise de Projection Underground
#urbex
#arts
#cinéma
#concert
#culturealternative

What’s in my régie bag
Si tu es apprenti·e régisseur·euse, fauché·e et/ou débutant.e dans la conservation préventive, cet article est fait pour toi ! Alors sors ta plus belle banane et prépare ton matériel.
Dans ton sac, il te faut :
Les outils
Les outils indispensables © Sophie Delmas & Juliette Dorn
- Une règle : aussi étonnant que cela puisse paraître, cet outil permet de prendre des mesures
- Du ruban adhésif, type ruban de masquage : très pratique pour scotcher des choses, en plus on peut écrire dessus. Privilégie du ruban de masquage en papier car son PH est neutre (sans acide).
- Un carnet, de préférence petit pour le glisser dans ta banane : il permet de prendre des notes en tout genre
- Un feutre, un crayon bref, de quoi écrire
- Des ciseaux : toujours utile pour découper des choses
- Un plioir : cet outil permet de faciliter le pliage de cartons, papier canson ou autre, lors de la création de boîte pour la conservation
- Une tripotée de pinceaux : à utiliser en toutes occasions, pour dépoussiérer, pour coller des papiers décollés.
- Un sachet congélation : très pratique pour récupérer des morceaux d’œuvres
- Une lampe de poche : pour inspecter les objets sous toutes les coutures. Et peut aussi s’avérer utile en cas de panne de courant.
- Un mètre, un mètre ruban : comme la règle, cet outil permet de prendre des mesures
- Une lampe de poche UV : permet de mettre en évidence de possibles restaurations antérieures et d’étudier les surfaces picturales et surfaces vernies
- Un cutter : pour découper tout type de matériaux
- Des gants (plus ou moins) blanc : pour manipuler en toute tranquillité vos objets. Des gants en latex ou en nitrile peuvent aussi être utilisés dans les cas où les gants de coton seraient glissants, ou risqueraient de déposer des fibres de coton sur les œuvres
Les matériaux
Les matériaux de base de la régie / conservation préventive © Sophie Delmas & Juliette Dorn
- Du carton
- Du tissu de coton
- Du Tyvek®
- Du papier de soie
- Du film à bulles
- De la mousse
- Du tissu non-tissé
How to : Prendre les mesures de Régisse
Pour cette vidéo, notre cobaye se prénomme Régisse. Régisse est la sœur presque jumelle d’une statuette gallo-romaine. Aucune Régisse n’a été maltraitée pendant le tournage de cette vidéo.
Prendre les mesures de Régisse 2021.1.1 © Sophie Delmas & Juliette Dorn
Régisse se prénomme 2021.1.1 - C’est le nom qui lui est donné une fois rentrée à l’inventaire de son musée. [2021] correspond à l’année d’entrée de Régisse dans les collections, c’est son millésime. [.1] est son numéro de collection, Régisse fait partie de la première série d’objets (qui proviennent d’un même site de fouille archéologique par exemple) de 2021. Le deuxième [.1] correspond au numéro d’ordre de l’année dans la série, Régisse est donc le premier objet de la première série inventoriée en 2021.
Il est très important d’emballer Régisse. Une fois inscrit à l’inventaire, son petit numéro en poche, il faut lui donner une place dans les réserves. Pour cela, la première étape est de prendre ses mesures, qui seront reportées dans le logiciel de gestion des collections. Ces mesures permettront de créer un conditionnement adapté, ou de l’exposer dans les meilleures conditions.
Notation des mesures en cm : Longueur L; largeur l ; hauteur H ; profondeur P
How to : Emballer Régisse
Disclaimer : Régisse n’est pas une œuvre picturale, ni une œuvre graphique. C’est un objet en trois dimensions, une statuette en pierre. Les différents conditionnements proposés sont donc adaptés à Régisse.
Une fois ses mesures prises, il y a plusieurs façons de l’emballer et de lui trouver une petite place en réserve.
Emballage 1 : Sans prise de tête, mais emballé tout de même.
La protection basique de Régisse 2021.1.1 © Sophie Delmas & Juliette Dorn
Régisse est une personne fragile, aussi pour la protéger de la poussière et des dégradations extérieur, tu peux l’emballer dans un tissu en coton (le moins cher tant qu’il est 100% coton), de tissu non-tissé, ou si tu as le budget pour, du Tyvek®, le tout maintenu par un peu de ruban adhésif. Le mieux est d’écrire son numéro d’inventaire sur son emballage afin de retrouver Régisse au premier coup d’œil. Il est important d’être précis sur sa position dans les réserves, dans l’inventaire : n’importe qui est censé retrouver Régisse en moins de 3 minutes !
Pour transporter Régisse sans souci, l’emballage est à compléter d’un film à bulle, si tu veux éviter la casse.
Le tout est à déposer dans un bac gerbable norme Europe avec ses compères, sur une des étagères de ta réserve.
Exemple de bac gerbable norme Europe ©Juliette Dorn
Emballage 2 : Dans un sachet plastique
Un sac plastique pour Régisse 2021.1.1 © Sophie Delmas & Juliette Dorn
Si Régisse doit être emballée de manière temporaire, par exemple en attendant de la transférer sur son lieu de résidence, il est envisageable de la mettre dans un sachet en plastique avec Zip. Mais attention, de la condensation risque de se créer : retient bien que cela doit être temporaire. Par contre, on peut emballer sans souci dans des sachets plastiques des os ou du métal. Le tout est à déposer dans un bac gerbable norme Europe avec ses compères, sur une des étagères de ta réserve.
Emballage 3 : Créer un écrin (à mettre dans une boîte)
Faire un écrin sur mesure à Régisse 2021.1.1 © Sophie Delmas & Juliette Dorn
Enfin le plus abouti, le plus clean, le plus beau (roulement de tambour) : l’écrin !
C’est l’équivalent du lit king size ou de l’hôtel 5 étoiles de Régisse : un lit douillet de mousse tapissé de Tyvek, le tout sur-mesure.
Dans de la mousse polyuréthane, commence par découper une forme à la taille de Régisse avec un cutter (s’il coupe bien c’est encore mieux), le tout en gardant ton calme. Puis fais une rainure autour de cette forme, découpe un bout de Tyvek légèrement plus grande et tapisse le lit de Régisse en bloquant le Tyvek dans la rainure.
Le nec plus ultra est de réaliser une boîte en carton à la taille de l'écrin pour y caler celui-ci, mais si tu as une boîte un peu plus grande, il suffit de remplir les trous avec de la mousse jusqu’à ce que Régisse ne puisse plus bouger.
Le tout est à déposer directement sur une étagère dans ta réserve.
Mettre Régisse 2021.1.1 dans une boîte © Sophie Delmas & Juliette Dorn
Et voilà ! Tu es maintenant un·e apprenti·e régisseur·euse fauché·e un peu plus informé·e.
Sophie Delmas & Juliette Dorn
Ressources :
https://ocim.fr/repertoires/fournisseurs-des-musees/
http://www.afroa.fr/fr/association/
Workshops régie du MEM :
http://www.formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1996-workshop-regie
https://www.youtube.com/watch?v=_FmfGyRoK48
#régie #conservationpréventive #Tyvek




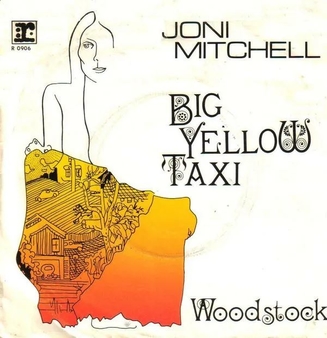






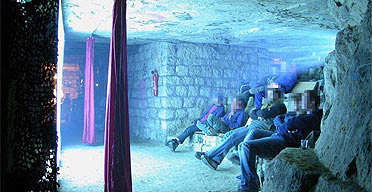



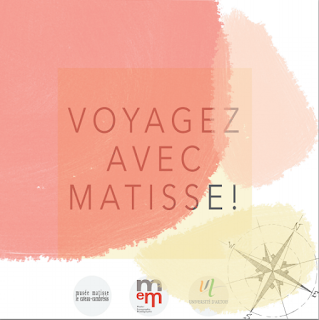
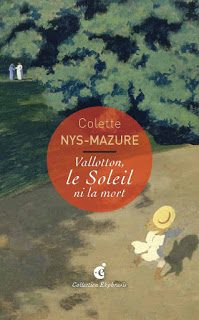
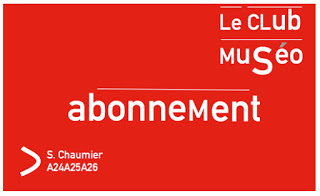
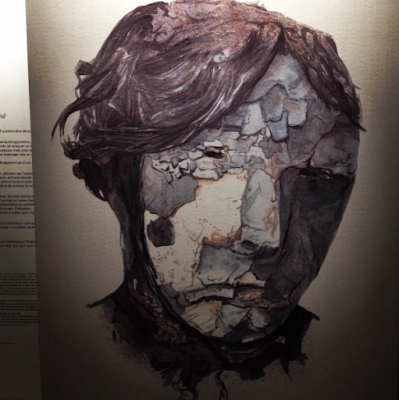
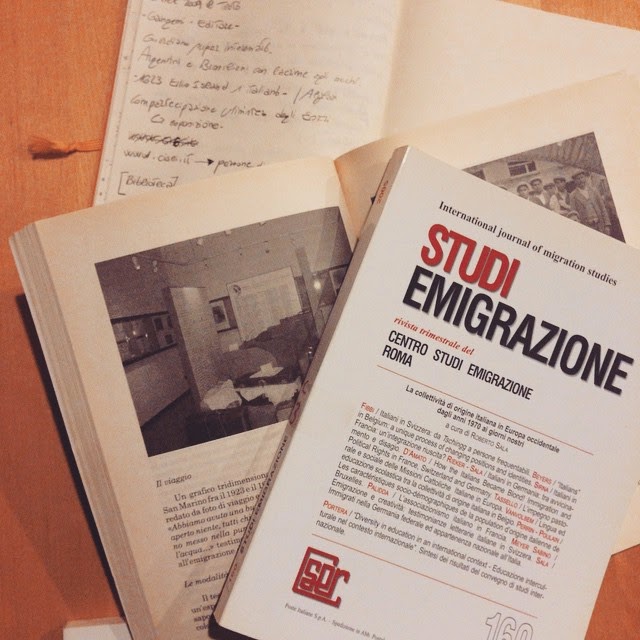

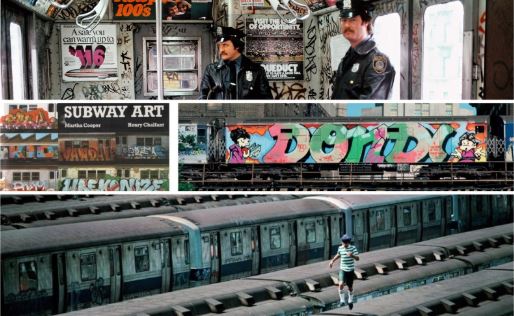
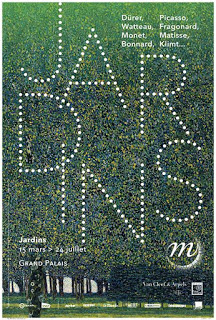
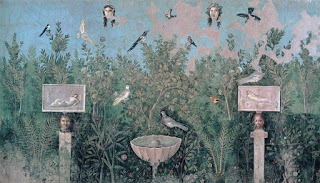

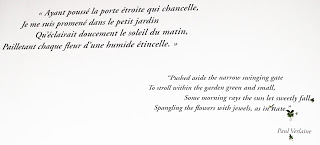









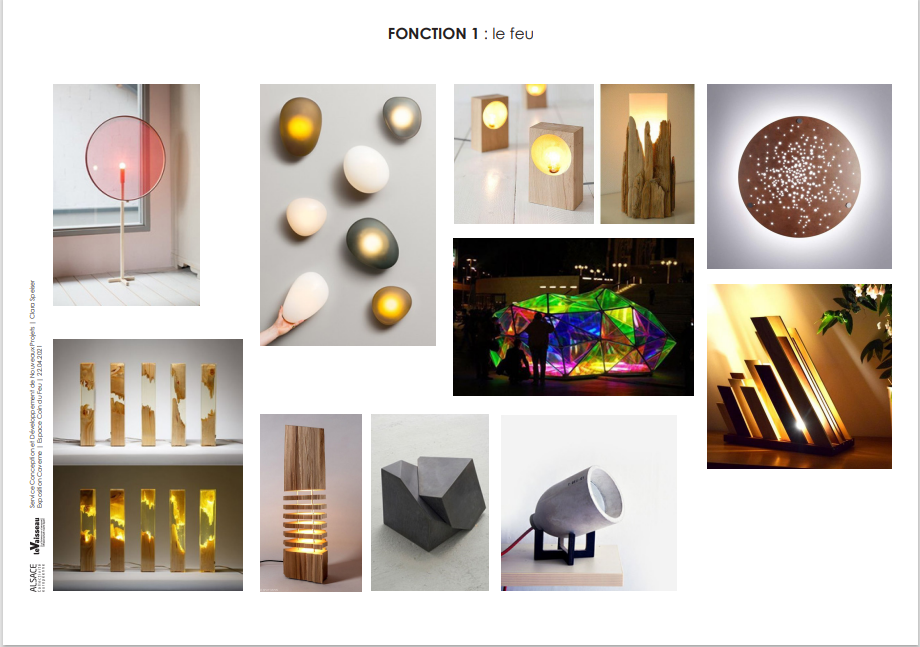
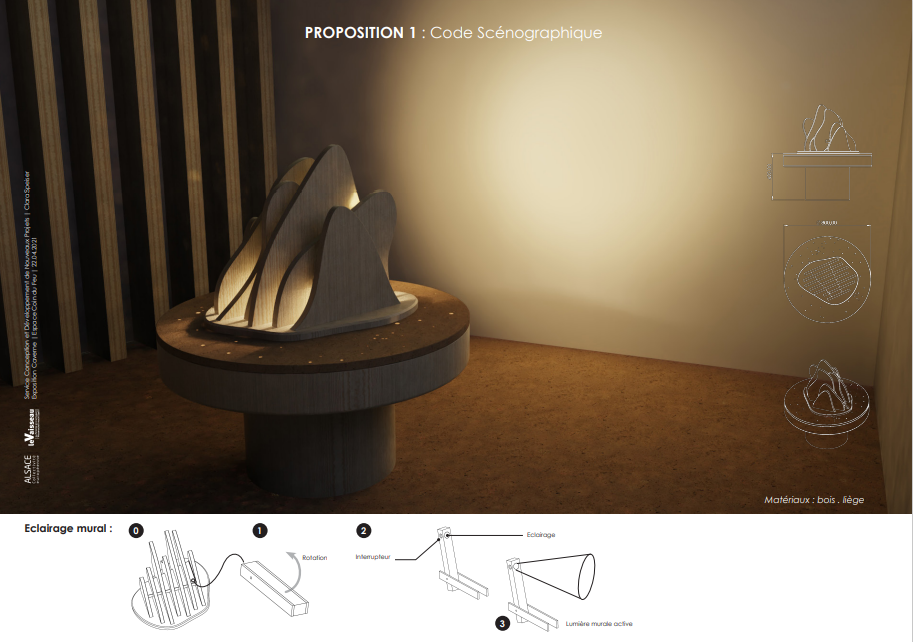

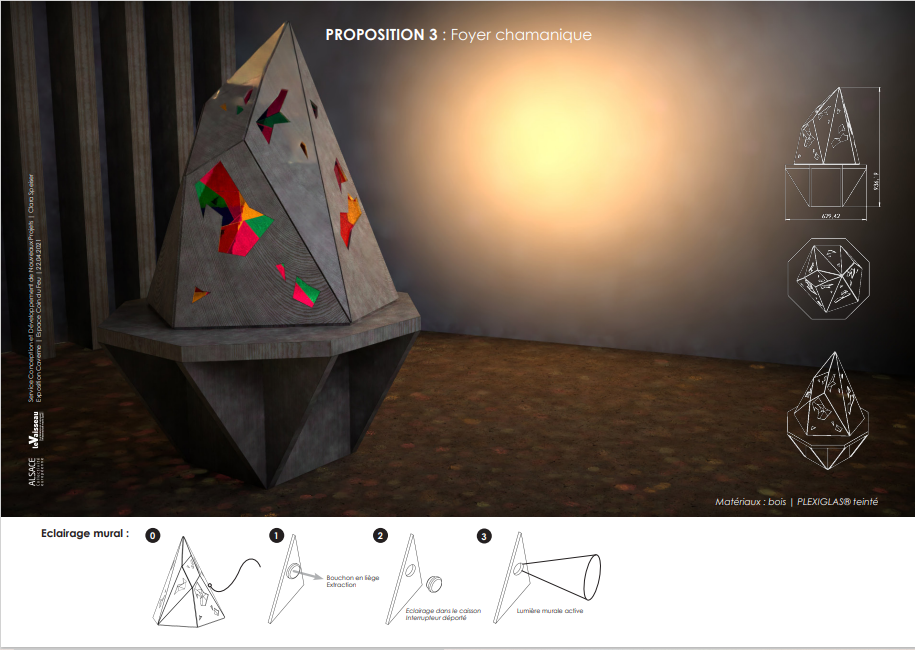
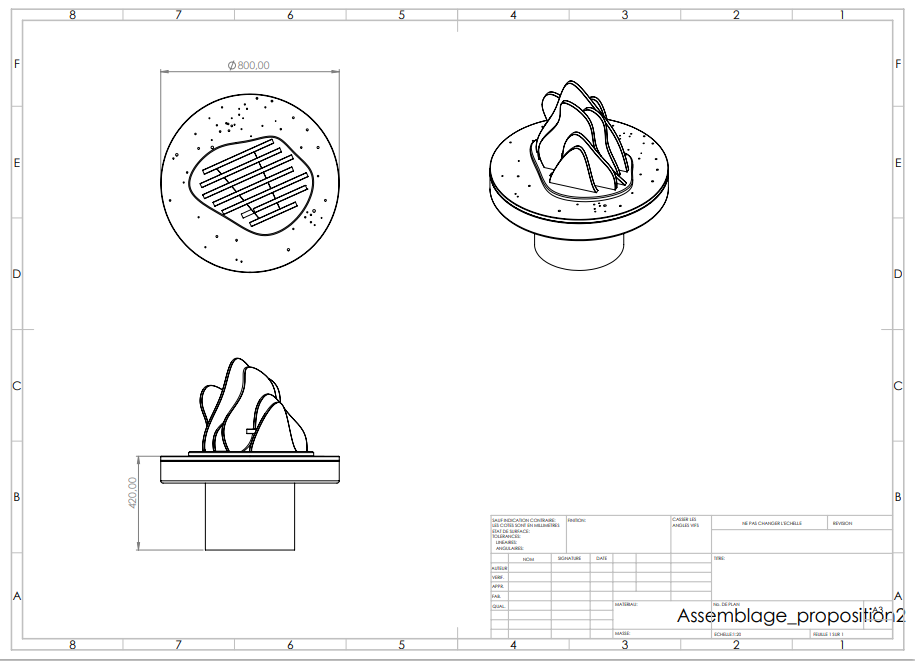











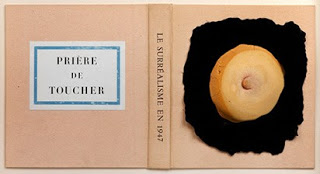


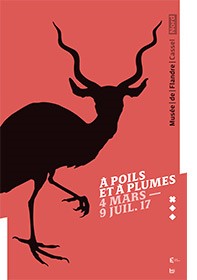










.jpg)
.jpg)