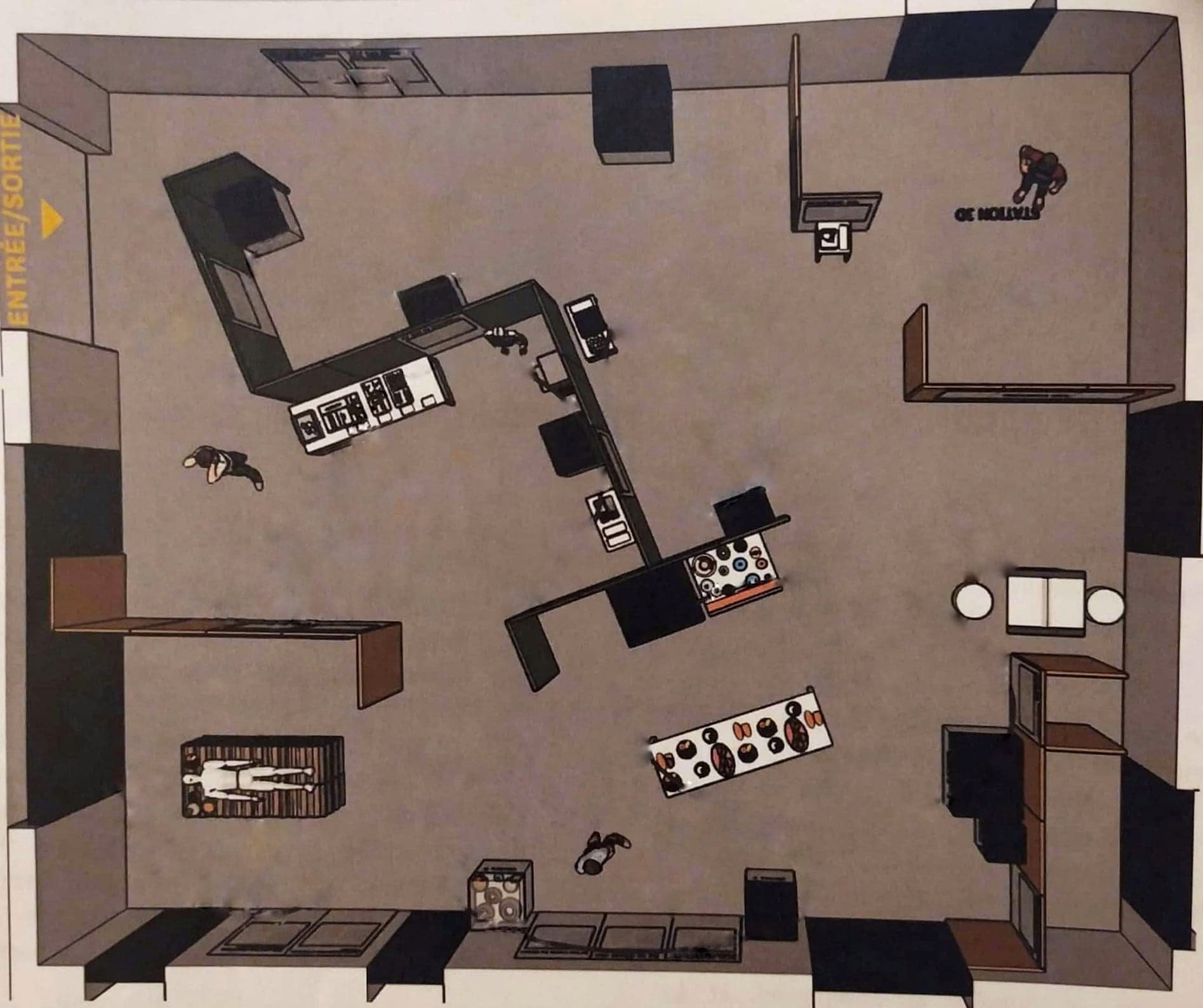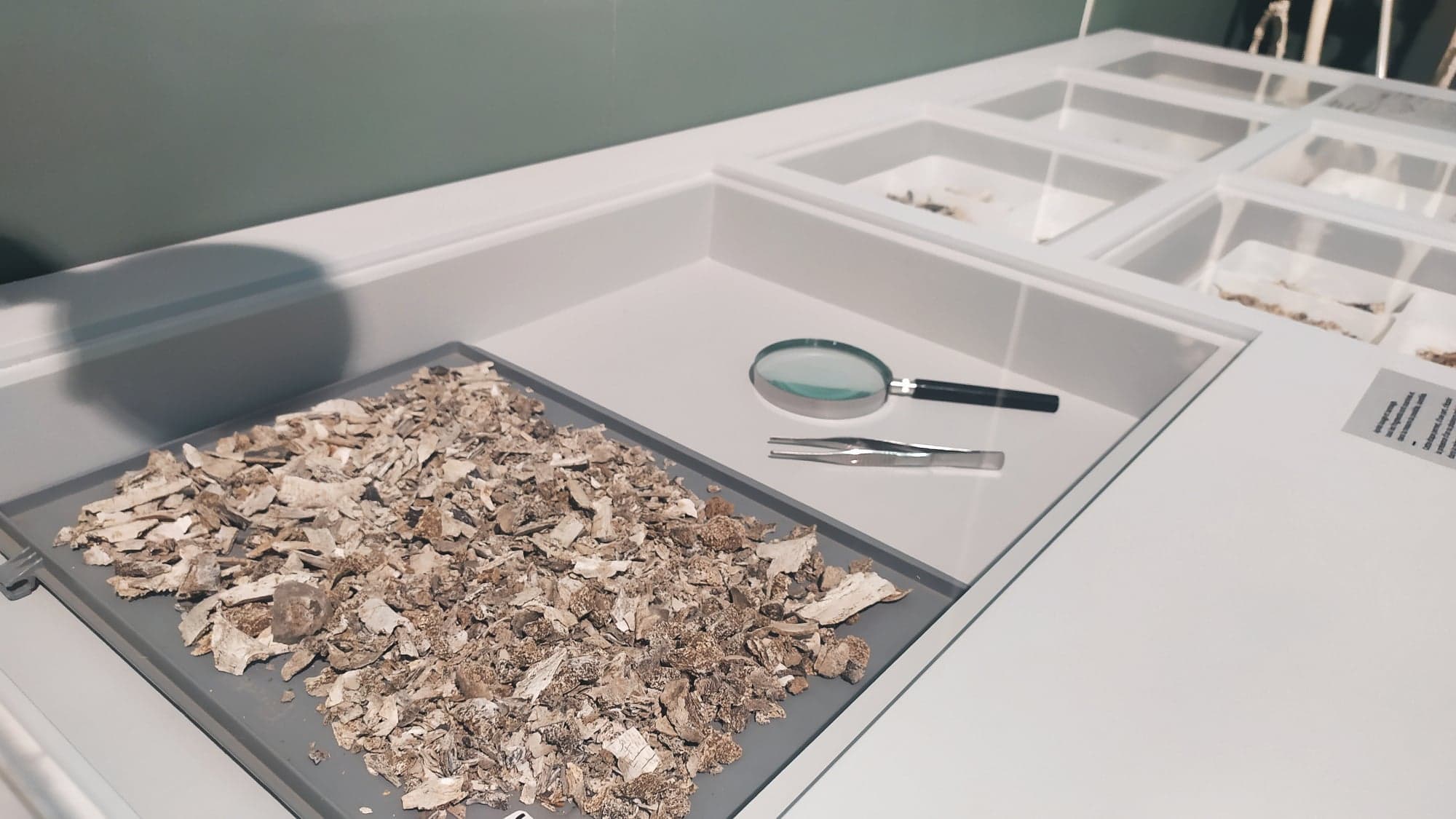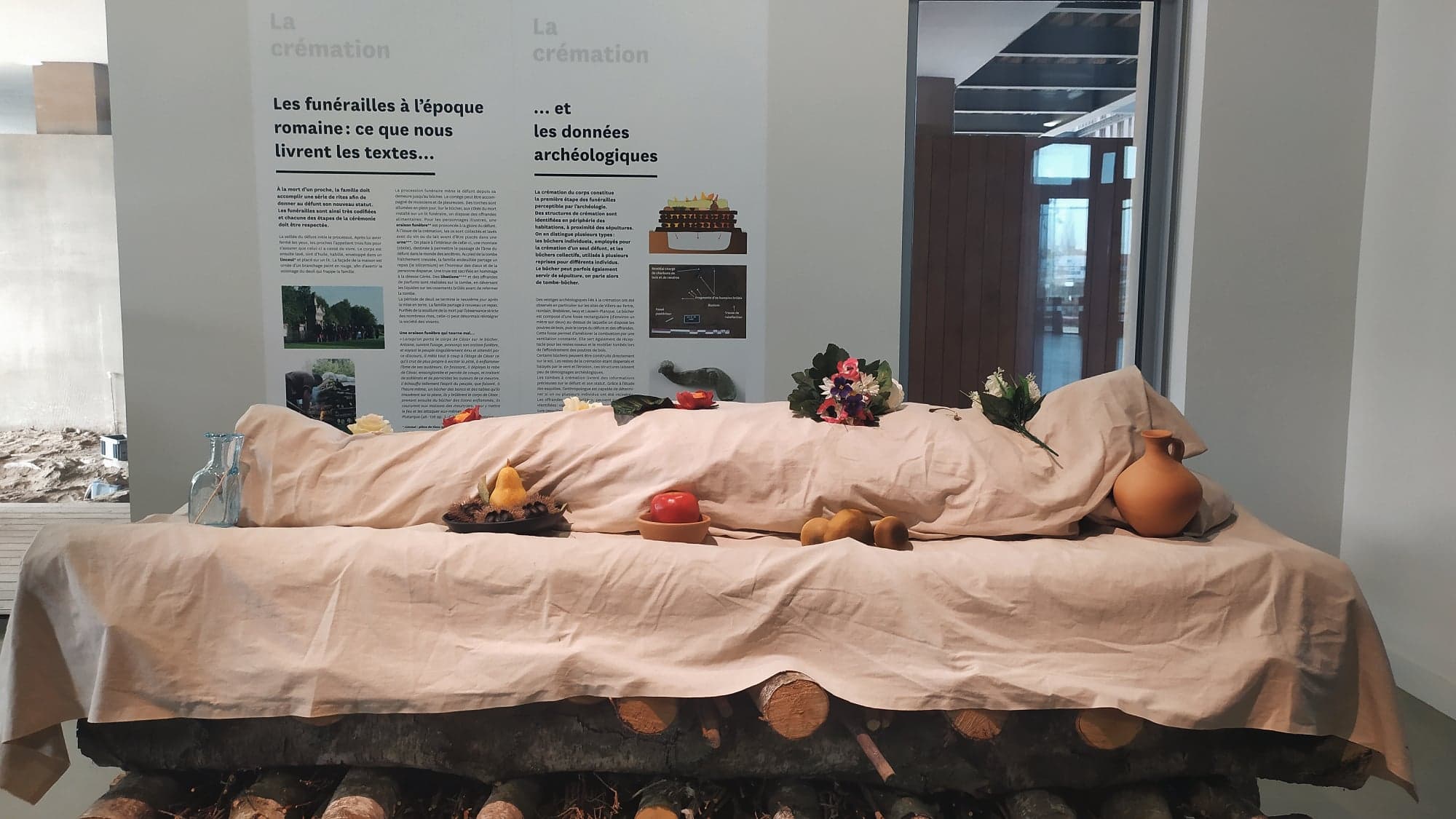Archéologie - Histoire - Mémoire

A la conquête du MuCEM !
Il existe des musées qu'on découvre sans fioritures, un peu abruptement parfois, et dont il suffit de pousser la porte pour accéder aux collections, tant la transition entre l'espace public extérieur et l'espace muséal intérieur se fait rapidement, provoquant ainsi parfois chez le visiteur un sentiment de « décalage » quand bien même l'exposition des collections se situe dans des bâtiments à forte valeur historique et patrimoniale.
Il y en a d'autres qui ne se révèlent que peu à peu, qui ne se dévoilent que progressivement, qui se méritent en provoquant chez le visiteur un effort physique et intellectuel bien avant d'en avoir franchi le seuil... le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée en fait partie !
QUID DU MuCEM ?
Contrairement à l'idée répandue depuis son inauguration le 7 juin 2013 dans le cadre de Marseille-Provence 2013 capitale européenne de la culture, le MuCEM ne se résume pas uniquement en la prouesse architecturale commise par l'architecte Rudy Ricciotti, même si force est de constater que c'est bien ce nouveau bâtiment qui attire regards et commentaires.
Symbole fort du transfert d'un musée national dans une grande capitale régionale (anciennes collections du musée des Arts et Traditions Populaires à Paris), le MuCEM est composé de trois sites, détaillés à la fin de l'article, pour le lecteur avide de connaissances que vous êtes tous !
Associée à cette dimension tricéphale du lieu, la multiplicité de l'accès au MuCEM est à souligner elle aussi : par l'esplanade à quelques mètres de la villa Méditerranée, par le Vieux-Port à la base du Fort Saint-Jean mais surtout par la passerelle Saint-Laurent reliant les hauteurs de ce dernier au quartier du Panier.
Je ne saurais trop vous déconseiller la première possibilité, son seul atout à mes yeux étant l'accès direct au bord de mer permettant une cure d'embruns...
L’EXPÉRIENCE D'UN PARCOURS HORS NORME
Ombrièredu Fort Saint-JeanCrédits : S.V
Au contraire, les deux accès via le fort, quant à eux, se valent bel et bien : au courageux et téméraire chevalier amoureux des vieilles pierres et sensible à l'introduction de matériaux plus modernes (rampes d'escaliers, garde-corps, ombrière en métal... transats, tables et assises en bois), s'offre progressivement un paysage à couper le souffle : vue sur les bateaux du Vieux-Port et les quartiers de la cité phocéenne bien sûr, et plus précisément sur ses édifices patrimoniaux : le Fort Saint-Nicolas, la cathédrale Major, le Pharo, le tout avec la bénédiction de Notre-Dame de la Garde... sans oublier l'attraction exercée par la mer Méditerranée !
Le choix de l'ascension combiné à la vue à 360 degrés depuis les hauteurs du fort suscite chez le visiteur une émotion, un rappel à l'ordre aussi de sa position d'être humain face à la majesté des lieux et des paysages, qui n'en est qu'à son premier choc visuel et esthétique à cette étape de ce parcours quasi initiatique...
Car, pour l'avoir fait, l'assaut du MuCEM se fait en vagues successives réservant son lot de surprises et de révélations.
En effet, la déambulation sur les hauteurs du fort conduit à la découverte d'une autre passerelle aérienne longue de 115 mètres réalisée par Rudy Ricciotti également. S'y lancer, c'est certes enjamber et embrasser de part et d'autre la Méditerranée mais c'est surtout accepter de déposer les armes de la méfiance et de s'en remettre à l'inconnu...
Et c'est là que la notion de promenade architecturale, chère à Le Corbusier, lui aussi présent à Marseille au travers de la Cité Radieuse, prend tout son sens : c'est par étapes successives que l'architecture du MuCEM se dévoile ne se révélant qu'au fur et à mesure des pérégrinations du visiteur jusqu'à l'apothéose finale... le J4 !
L'ASSAUT FINAL...
Lapasserelle reliant le Fort Saint-Jean au J4Crédits :S.V
Une fois surmontées les étapes de l'ascension du fort et de la traversée de la passerelle certes toutes relatives (mais mon âme d'enfant est toujours latente), cette [con]quête du lieu atteint son apogée par la découverte du J4. Déposé sur un plancher de bois, quasiment au même niveau que le toit du MuCEM, le visiteur éprouve à nouveau de multiples sensations : liberté, espace, calme, apaisement, sérénité et ce en dépit d'une fréquentation du lieu importante au quotidien et depuis l'ouverture du musée (dans un article paru le 8 novembre 2013, le journal Le Monde évoque le cap de 1,4 million de visiteurs franchi en 5 mois à la date du 25 octobre avec une proportion de un tiers de visiteurs payants pour deux tiers qui s'y promènent). C'est un lieu de déambulation qui mixe les origines sociales, ethniques, culturelles en écho évidemment à la collection permanente, à la ville de Marseille et à la volonté de son « créateur », l'architecte Rudy Ricciotti dont le propos était de « démuséifier » l'endroit.
Pari réussi donc, et ce, en grande partie, grâce à la conception du bâtiment qui regorge lui aussi de surprises ! La première et non la moindre réside dans le matériau employé et l'aspect esthétique des formes qui lui ont été données : l'emploi du BFUHP (béton fibré à ultra haute performance) à la porosité extrêmement faible (qualité nécessaire quand on a les pieds dans l'eau !) allié à un rendu visuel qualifié par certains de résille noire, de dentelle provençale ou encore par d'autres de moucharabiehs...
Tour du Fanal du Fort Saint-Jean
vue depuis le J4 Crédits :S.V
Ce jeu de transparences vers le paysage extérieur maritime et d'ombres portées à l'intérieur assez évocateur d'une sensualité toute féminine, aiguise la curiosité, interpelle, ne laisse pas insensible, d'autant plus que l'envie insatiable d'en découvrir plus encore est satisfaite par une proposition originale de Ricciotti : le visiteur au sommet du J4 peut accéder directement à l'intérieur du musée par un système d'ascenseurs regagnant le rez-de-chaussée dont la billetterie, mais pour les plus contemplatifs, une nouvelle promenade est proposée. On contourne le bâtiment par une descente en pente douce sur plusieurs niveaux et là, ni tout à fait dehors, ni tout à fait dedans, le visiteur déambule entre structure de verre et structure de béton, avec vue sur la partie administrative du musée, sur les bureaux et leurs occupants, peut-être faut-il y voir là une intention de mettre à l'honneur ceux qui font le MuCEM en particulier et les musées en général ?
Au final, l'atterrissage / amerrissage se fait tout en douceur et l'envie de prolonger ce moment qui s'achève se fait sentir de façon impérieuse... alors qu'il reste tant de découvertes à mener au sein même des collections.
Et si, assez paradoxalement, le parcours constitué par l'enchevêtrement du Fort Saint-Jean et du J4 ne constituait pas tant un sublime écrin aux collections du MuCEM qu'un unique chef d'œuvre, accessible à tous ?
Sabrina Vérove
Pour le lecteur curieux, assoiffé de connaissances et futur visiteur du MUCEM que vous êtes, sachez que les trois entités sont :
-
le Centre de Conservation et de Ressources (CCR), situé sur 10000 m2 dans le quartier de la Belle de Mai à proximité de la gare Saint-Charles est un lieu ouvert au public, conçu par l'architecte Corinne Vezzoni.
http://www.mucem.org/fr/le-mucem/un-musee-trois-lieux/le-centre-de-conservation-et-de-ressources
-
Le Fort Saint-Jean, inscrit sur l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1964, restauré par le ministère de la Culture et de la Communication est un site complexe de 15000 m2 de nouveau accessible au public depuis 2013.
Associant d'une part les vieilles pierres de plusieurs monuments permettant de retracer une partie des vingt-six siècles d'histoire de Marseille et d'autre part des éléments de rénovation s'y intégrant parfaitement (architectes : François Botton pour les monuments historiques et Roland Carta pour l'aménagement et l'accessibilité des bâtiments), le Fort Saint-Jean accueille des espaces d'expositions permanentes et temporaires, le jardin des migrations en accès libre et gratuit ainsi que le l'Institut Méditerranéen des Métiers du Patrimoine (I2MP) en collaboration avec l'Institut National du Patrimoine (INP).
http://www.mucem.org/fr/le-mucem/un-musee-trois-lieux/le-fort-saint-jean
-
Le cube J4, qui accueille entre ville et mer, sur l’ancien môle portuaire J4, un bâtiment de 15 500 m2 comportant les espaces d’exposition :
l'exposition permanente nommée la Galerie de la Méditerranée, ainsi que deux expositions temporaires: Au bazar du genre : féminin-masculin en Méditerranée et Le noir et le bleu : un rêve méditerranéen, toutes deux jusqu'au 6 janvier 2014,
mais aussi d'autres espaces, un dédié aux enfants, un auditorium pour la présentation de conférences, de spectacles, de concerts, de cycles de cinéma, une librairie, un restaurant doté d’une terrasse panoramique et les « coulisses » indispensables à un équipement de ce type : ateliers, lieux de stockage, bureaux. Ses architectes sont Rudy Ricciotti et Roland Carta.
http://www.mucem.org/fr/le-mucem/un-musee-trois-lieux/le-j4
Plus d'informations sur les sites ou PDF suivants :
http://www.mp2013.fr/ouverture-du-musee-des-civilisations-de-leurope-et-de-la-mediterranee/
http://www.oppic.fr/pages/operations/fichesOP_PDF/MucemFortstjean_J4_%20122012etann.pdf
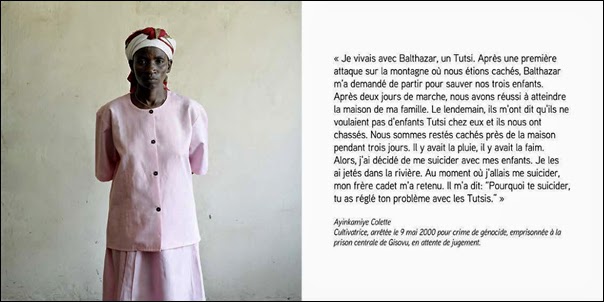
" Rwanda " - Les représentations et les espaces blancs de Cordesse
« C’est impossible de toutraconter dans les détails […] c’est une longue histoire […] c’est difficile à expliquer, c’est lourd pour moi ».
Marthe
J’avais huit ans quand, en Italie, sur les nouvelles du soir, passaient les images brutes de ces cadavres et mes parents changeaient de chaîne ou me disaient de fermer les yeux, comme si la seule perturbation passait à travers ce qui peut être vu, en ignorant combien d’anxiété peut être transmise par la voix et la musique qui les accompagnent.
C’était en1994, et les images étaient celles du génocide qui se déroulait au Rwanda, où, en moins de 100 jours, d’avril à juillet, entre 800 000 et un million de personnes ont été tuées.
Alexis Cordesse en 1994 était à Sarajevo où, en tant que photojournaliste, il était engagé afin de documenter la guerre en Bosnie. Il est arrivé au Rwanda pour la première fois à 25 ans, après deux des massacres qui ont déchiré le pays dit des « mille collines ».
Pour Alexis Cordesse venir au Rwanda n’a pas été un voyage quelconque, mais le début d’une réflexion sur l’après-génocide qui l’a ramené à plusieurs reprises dans le cœur de l’Afrique, un vrai chemin de maturation en constante redéfinition. Il a constamment revu, essayé à nouveau, pensé autrement, articulé la dimension sonore, la puissance de l’image photographique et l'immédiateté de la parole écrite.
Mes parents et ma directrice m’ont supplié de changer de sujet quand, en 2008, le temps de choisir le sujet de mon mémoire à l’Université de Gênes, j’avais choisi d’étudier le génocide rwandais.
Je voulais acheter mon billet d'avion pour Kigali, aller faire du terrain sur ces collines africaines ; eux, en m’empêchant de partir, ils voulaient me protéger, me demandant, comme quand j'étais petite, de fermer les yeux. Moi, j’avais 22 ans, étant têtue et courageuse, je suis partie de toute façon.
J’ai fait mon terrain, j’ai recueilli les témoignages de ceux qui avaient vécu le génocide à leur dépens, en perdant leurs chers, les amis d’une vie, échappant par hasard ou après de nombreuses vicissitudes à ces machettes enfourchées sur des principes ethniques ayant des racines coloniales. A Murambi[1], j'ai vu l'enfer, la même horreur qui vivait dans les yeux des personnes qui ont péniblement revécu avec moi leurs histoires.
Après ma soutenance, j’ai caché le mois passé là-bas dans le tiroir le plus éloigné de ma mémoire, je pensais en avoir terminé pour toujours avec le Rwanda.
Aujourd’hui, vingt ans après toute cette horreur, la galerie Les Douches La Galerie présente « Rwanda », exposition du photo reporter français qui pour la première fois montre au public la totalité de son travailsur le sujet.
Je monte les escaliers au premier étage d'un immeuble du 10ème – c’est là que vous trouverez la galerie – et m’accueille le blanc. Celui du plancher, des murs et même du plafond. Je suis surprise par tout ce blanc, et puis par tout cet ordre, tout composé, si loin de la réalité du Rwanda.
À première vue, je me sens presque déçue, au fond un peu trompée, mais malgré l’égarement initial j’essaie de mettre de côté mon expérience, « mon » Rwanda, et de me laisser emmener confiante par ce blanc enveloppant. Tout prend ensuite sa place.
Alexis Cordesse, pour rendre le génocide « concevable », sentait qu’il devait le représenter, conscient de ce qu’un tel acte de représentation devrait exiger impérativement de mise en distance, de structuration d’un espace vide, neutre, où pouvoir s’arrêter et s’interroger, bref d’un espace blanc.
Voici que « Rwanda » se révèle être une clé d'accès aux espaces blancs qu’il a vécu, à ces laps de temps qui se sont écoulés entre ses trois voyages dans le pays, dans ses trois expériences de vie qui ont jalonné son propre questionnement en l’amenant, au fil du temps, à structurer les trois représentations complémentaires qui aujourd’hui dialoguent ensemble à la galerie Les Douches La Galerie.
C’est le documentaire Itsembatsemba, le génocide au Rwanda un plus Tard (1996)[2] qui retourne sur la première expérience de Cordesse dans le pays.
Né de la collaboration avec le cinéaste Eyal Sivan,ce court-métrage présente un mélange de photographies en noir et blanc, des enregistrements sonores réalisés par Alexis principalement lors des cérémonies de commémoration ainsi que l’exhumation des corps des victimes.
Itsembatsemba – qui est directement visible dansla galerie grâce à la création d’un poste vidéo équipé d’écouteurs – est le résultat du montage de ces documents dans les séquences, également accompagnées par des extraits audiodes archives de Radio télévision libredes Mille Collines, la fameuse « radio de la haine »[3].
Douze diptyques 30x40 cm constituent L'Avenu (2004), le fruit de son second voyage.
Dix ans après le génocide au Rwanda, Alexis est de retour – plus précisément dans la province de Kibuye – en tant que correspondant pour le quotidien Libération[4].
L’un des diptyques qui composent L’Avenu (2004)© Alexis Cordesse
A cette époque, encouragées par la réduction des peines et des libertés provisoires, dans les prisons, de nombreux détenus ont commencé à avouer les crimes de génocide commis. Alexis les interviewe et les photographie : certains sont en liberté provisoire, la plupart en attente de jugement.
Les diptyques sont des portraits frontaux d’hommes et de femmes qui ont participé au génocide et des extraits des aveux dans une interaction entre image et texte qui renvoie toute la complexité de ces personnes sans jamais exprimer de jugement moral.
En espaçant les diptyques réalisés neuf ans plus tôt, Absences (2013) brisent la tension : tirages photographiques de grand format[5] représentant la nature intacte du Rwanda, ils sont une bouffée d’air.
Deux diptyques de L’Avenu(2004) et l’un des paysages d’Absences (2013)│Vue d’ensemble à la Les Douches La Galerie© Alexis Cordesse
Aucune trace d’un être humain, seuls les espaces ouverts sur les collines de la région de Kibuye, la forêt de Nyungwe et encore des plaines de la régionde Bugesera sont le contrepoint de la chose la plus horrible que l’homme puisse commettre.
Mais tout n'est pas comme il semble, ou mieux, ces immenses espaces, en dépit de leur charme, ont été, il y a vingt ans, le théâtre de la haine aveugle. La nature que les persécutés croyaient être l’abri maternel s'est avéré être le pire des pièges, une tombe à ciel ouvert.
A ces silencieux trompe-l’œil naturalistes donnent voix les témoignages de trois femmes – deux survivantes et une hutue « juste »[6] – recueillies par le photographe lors de son dernier séjour.
Ce sont les portraits sonores de Marthe, Odette et Joséphine – traduits dukinyarwanda en français – écoutables dans la galerie grâce à un deuxième post emis en place juste à côté de celui qui permet la visualisation de Itsembatsemba (1996).
Alexis Cordesse une fois de plus ne demande pas au visiteur de prendre position mais structure un espace neutre, une chance « blanche » qui le prédispose à lancer son imagination : imaginer ce qui s’est passé dans l’écart entre des paysages silencieux et des témoins anonymes de la destruction humaine.
« Rwanda » se révèle être avant tout l’occasion de réfléchir et d’entrer en contact avec une réalité encore trop souvent méconnue en Occident.
Loin d'être un guide historique des événements, l’exposition semble même ne pas vouloir proposer de sensibiliser le public sur une plus grande échelle : le travail de Cordesse est ici exposé aux Les Douches La Galeriequi, comme son nom l’indique, est une galerie, de petite taille, au premier étage d’une rue latérale du 10ème : il est peu probable que vous tombiez par hasard sur ses expositions et les œuvres en vente.
Eh bien oui, même ses œuvres sont achetées directement dans la galerie, alimentant le débat toujours ouvert sur l’éthique et la légalité de la misesur le marché du travail artistique qui porte sur des tragédies humaines.
Flashback : la terre d'argile rougeâtre, des palmiers sur le lac Kivu, la coopérative de Butare, des moustiquaires et des nuits sans sommeil, le paludisme, « alors: vous faites ou ne faites pas le vaccin contre le paludisme ? », la main de Macibiri, la cheminée, les uniformes roses, les agriculteurs de Gatare, les camions de l’armée à la tombée de la nuit.
J’avais fermé mon « chapitre Rwanda », pensais-je, avant de rencontrer Cordesse.
Beatrice Piazzi
#LesDouchesLaGalerie
#Rwanda
#photographie
#témoignages
Pour aller plus loin :
[1] Murambi, Nyamata, Bisesero et Gisozi dans leur ensemblesont des sites mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsis entre les mois d’avril et juillet 1994 au Rwanda.Murambi, notamment, était un institut technique bâti quatre ans avant 1994 oùil est devenu l’un des lieux de la persécution. Encouragées par lesautorités locales et les anciennes forces armées rwandaises à s’y réfugier sous prétexte de garantir leur sécurité, entre 45 et 50 mille personnes vivant dans les collines environnantes, ils n’ont en fait trouvé que la mort. Aujourd’hui monument mémorial, ce complexe de douze locaux est devenu un site d’exposition de restes humains, d’objets utilisés par les tueurs ainsi que des éléments d’identification des victimes.
[2] Itsembatsemba, Rwandaun génocide plus tard │Un film d’Alexis Cordesse & Eyal Sivan │Documentaire│1996 │ 13 mn │ B/W │ 4:3 │ STEREO VO: kinyarwanda – sous-titres:français © Etat d’urgence (FR) Momento Production (FR).
[3] Créée en 1993 par des extrémistes Hutus, « la radiode la haine » transmettait alternativementde la musique populaire et des incitations racistes. D’abord elle a joué un rôle essentiel dans ladiffusion de l'idéologie ethnique,par la suite elle a directement coordonné et directement motivé les tueurs.
[4] Ce travail a fait l’objet, en 2004, d’un cahier spécialdu quotidien.
[5] Il s’agit de tirages satin-argentique 120 x 160 cm qui ont été réaliséscette année à Paris.
[6] Les « Justes » sont ceux Hutus rwandais quiont caché, protégé et souvent sauvé la vie de Tutsis pendant le génocide.
----------------------------
“Rwanda”. Le rappresentazioni e glispazi bianchi di Cordesse
« C’est impossible de toutraconter dans les détails […] c’est une longue histoire […] c’est difficile àexpliquer, c’est lourd pour moi ».
Marthe
Avevo otto anni quando, in Italia, al telegiornale della sera, passavano lecrude immagini di quei corpi senza vita e i miei genitori cambiavano canale omi dicevano di chiudere gli occhi, come se il turbamento passasse soloattraverso ciò che può essere visto, ignorando quanta inquietudine possanotrasmettere le musiche e il parlato che le accompagnano.
Era il 1994 e le immagini erano quelle del genocidio che si stava compiendoin Ruanda, dove, in meno di 100 giorni, da aprile a luglio, trovarono lamorte tra le 800 000 eil milione di persone.
Alexis Cordesse nel 1994 era a Sarajevo dove, in quanto fotoreporter, eraimpegnato a documentare la guerra in corso in Bosnia. In Ruanda ci arrivò perla prima volta a 25 anni, a distanza di due dai massacri che straziarono ilpaese detto delle “mille colline”.
Per Alexis Cordesse non fu un viaggio qualunque quello in Ruanda, mal’inizio di una di riflessione post genocidio che lo ha riportato più volte nelcuore dell’Africa, un vero e proprio percorso di maturazione in costanteridefinizione. Ha riesaminato continuamente, cercato nuovamente, pensatoaltrimenti, articolato la dimensione sonora, al potere dell’immaginefotografica e all’immediatezza della parola scritta.
I miei genitori e la mia relatrice mi supplicavano di cambiare argomento quando,nel 2008, giunto il momento di scegliere l’argomento della mia tesi di laureaall’Università di Genova, avevo scelto d’occuparmi del genocidio ruandese.
Io volevo comprare il mio biglietto aereo per Kigali, andare a fare del camposu quelle colline africane; loro, impendendomi di partire, volevanoproteggermi, mi chiedevano, come quando ero piccola, di chiudere gli occhi. Io,22 anni, testarda e impavida partii comunque.
Ho fatto il mio campo, ho raccolto le testimonianze di chi quel genocidiolo aveva vissuto sulla propria pelle perdendo familiari cari, amicizie di unavita, sfuggendo per pura casualità o dopo mille peripezie a quei macheteinforcati dietro presupposti etnici dalle radici coloniali. A Murambi[2] ho visto l’inferno, quellostesso indicibile orrore che abitava gli occhi delle persone che dolorosamentehanno ripercorso con me le loro storie.
Una volta discussa la tesi, ho nascosto quel mese passato laggiù nelcassetto più remoto della mia memoria, pensavo d’aver chiuso per sempre con ilRuanda.
Oggi, a vent’anni di distanza da tutto quell’orrore, la galleria LesDouches La Galerie presenta “Rwanda”, personale del photoreporter franceseche per la prima volta mostra al pubblico la totalità del suo lavoro sul tema.
Salgo le scale che portano al primo piano di uno stabile del 10° – è lì chesi trova la galleria – e ad accogliermi,il bianco. Quello del pavimento, delle pareti e ancora del soffitto. Misorprende tutto quel bianco, e poi tutto quell’ordine, tutto così composto,tutto fuorché Ruanda.
A primo impatto mi sento quasi delusa, in fondo in fondo un po’ tradita, manonostante lo smarrimento iniziale provo a lasciare da parte la mia esperienza,il “mio” Ruanda, e a lasciarmi condurre fiduciosa dal bianco avvolgente. Tuttoallora si riposiziona.
Alexis, per rendere “pensabile” il genocidio, sentiva di doverlorappresentare, consapevole che tale atto di rappresentazione necessitasseimperativamente di una messa a distanza, della strutturazione di uno spaziovuoto, neutro, dove poter sostare per interrogarsi, di uno spazio biancoinsomma.
Ecco quindi che “Rwanda” si dimostra essere una chiave d’accessoinnanzitutto agli spazi bianchi da lui vissuti, a quei lassi spazio-temporaliche sono intercorsi tra i suoi tre viaggi nel paese, a quelle tre esperienzeesistenziali che hanno ritmato il suo proprio interrogarsi portandolo, neltempo, a strutturare le tre complementari rappresentazioni che oggi dialogandocoralmente a Les Douches La Galerie.
É il documentario Itsembatsemba, Rwanda un génocide plus tard(1996)[3] a restituire la primaesperienza di Cordesse nel paese.
Nato dalla collaborazione con il cineasta Eyal Sivan, questo cortometraggiopresenta un assemblaggio di fotografie in bianco e nero e di registrazionisonore realizzate da Alexis principalmente in occasione delle cerimonie dicommemorazione e delle esumazioni dei corpi delle vittime.
Itsembatsemba –che é visibile direttamente in galleria grazie all’allestimento di unapostazione video dotata d’auricolari – é il risultato del montaggio di talidocumenti in sequenze, accompagnate altresì da estratti audiodell’archivio della Radio Televisione Libera delle Mille Colline, lacelebre “radio dell’odio”[4].
Dodici dittici formato 30x40 cm costituiscono L’Avenu (2004), il frutto del suo secondo viaggio.
A dieci anni di distanza dal genocidio Alexis è tornato in Ruanda – piùprecisamente nella provincia di Kibuyé – come inviato del quotidiano Libération[5].
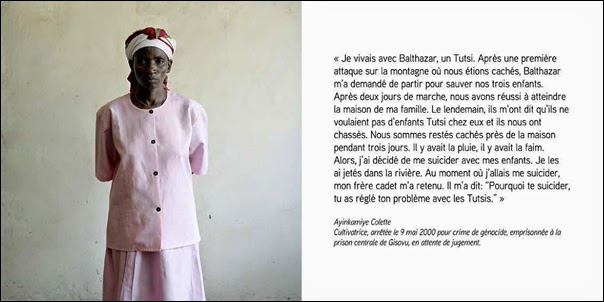 Uno dei dittici che compongono L’Avenu (2004)© AlexisCordesse
Uno dei dittici che compongono L’Avenu (2004)© AlexisCordesse
In quel periodo, incoraggiati dagli sconti di pena e dalla libertàvigilata, nelle prigioni, molti detenuti cominciarono a confessare i crimini digenocidio commessi. Alexis li intervista e li fotografa: alcuni sono in libertàprovvisoria, la maggior parte in attesa di processo.
I dittici rappresentano ritratti frontali di uomini e donne che hannopartecipato al genocidio e degli estratti delle confessioni in un’interazione traimmagine e testo che restituisce compiutamente la complessità di queste personesenza mai esprimere alcun giudizio morale.
Inframezzando i dittici realizzati nove anniprima, Absences(2013) spezzano la tensione: stampe fotografiche in gran formato[6] rappresentanti l’incontaminatanatura ruandese, sono una boccata d’ossigeno.
Due dei dittici de L’Avenu (2004) e un paesaggio d’Absences (2013)│Visione d'insieme alla Les Douches LaGalerie© Alexis Cordesse
Nessuna traccia d’essere umano, solo gli spazi sconfinati delle collinedella regione di Kibuye, della foresta di Nyungwe e ancora delle piane deldistretto di Bugesera, sono il contrappunto a quanto di più orribile possacommettere l’uomo.
Ma non tutto é come sembra, o meglio, questi immensi spazi, contrariamenteal loro fascino, vent’anni fa sono stati lo scenario dell’odio cieco. La naturache i perseguitati ritenevano essere materno rifugio si rivelò essere lapeggiore delle trappole, una tomba a cielo aperto.
A questi silenziosi trompe-l’œil naturalistici danno voce letestimonianze di tre donne – due sopravvissute e una “giusta”[7] hutu – raccolte dalfotografo nel corso del suo ultimo soggiorno.
Sono i ritratti sonori di Marthe, Odette e Josephine – tradotti dal kinyarwanda al francese – ascoltabili in galleriagrazie ad una seconda postazione allestita giusto accanto a quella che permettela visione di Itsembatsemba (1996).
Alexis Cordesse, ancora una volta non chiede al visitatore di prendereposizione ma struttura uno spazio neutro, un’occasione “bianca” che lopredisponga ad attivare la propria immaginazione: rappresentarsi quanto accaddesostando nello scarto tra i paesaggi muti e le testimonianze senza volto delladistruzione umana.
“Rwanda” si dimostra essere innanzitutto un’occasione per rifletteree entrare in contatto con una realtà della quale ancora troppo spesso poco sisa in Occidente.
Lungi dall’essere una guida storica agli eventi, l’esposizione sembra nonsi proponga neppure di sensibilizzare il pubblico su larga scala: il lavoro diCordesse è qui esposto alla Les Douche La Gallerie che, come lo indicail nome stesso, è una galleria, di piccole dimensioni, al primo piano di unavia secondaria del 10°: è difficile che ci si imbatta per puro caso nelle sueesposizioni e nelle opere che propone in vendita.
Ebbene si, anche le sue opere sono direttamente acquistabili in galleria,alimentando quel dibattito sempre aperto sull’etica e la legittimità diimmettere sul mercato artistico lavori che portano su tragedie dell’umano.
Flashback: laterra d’argilla rossastra, le palme sul Lago Kivu, la cooperativa di Butare, lezanzariere e le notti insonni, la malaria: “allora: lo fai o non lo fai ilvaccino contro la malaria?”, la manina di Macibiri, il camino acceso, leuniformi rosa, i coltivatori di Gatare, le camionette dell’esercitoall’imbrunire.
Avevo chiuso il mio “capitolo Ruanda”, pensavo, prima di incontrareCordesse.
Beatrice Piazzi
[1] “E’ impossibile raccontare tutto nei dettagli [...] è una lunga storia [...]è difficile spiegare, è dura per me” Marthe [traduzione dal francese di chiscrive].
[2]Murambi, Nyamata, Bisesero et Gisozi nel loro insieme sono i siti memoriali delgenocidio perpetrato contro i Tutsi tra i mesi d’aprile e luglio del 1994 inRuanda. Murambi, nello specifico, era un istituto tecnico costruito quattroanni prima di quel 1994 in cui si trasformò in uno dei luoghi dellapersecuzione. Esortate dalle autorità locali e dalle ex-forze armate ruandesi arifugiarvisi dietro pretesto di garantirgli sicurezza, tra le 45 e le 50 milapersone abitanti le colline circostanti vi trovarono in realtà null’altro chela morte. Oggi memoriale, questo complesso di 12 locali é oggi il luogo dell’esposizionedei resti umani, degli oggetti utilizzati dagli assassini e di alcuni elementid’identificazione delle vittime.
[3] Itsembatsemba, Rwanda un génocide plus tard │Un film d’Alexis Cordesse & Eyal Sivan │Documentario │1996 │ 13 mn │ B/N │ 4:3 │ STEREO VO: kinyarwanda – sottotitoli:francese © Etat d’urgence (FR) Momento Production (FR).
[4] Creata nel 1993da alcuni estremisti Hutu, “la radio dell’odio” trasmetteva alternativamentemusica popolare e incitazioni razziste. Se dapprima giocò un ruolo essenzialenella diffusione dell’ideologia etnica, successivamente coordinò e motivòdirettamente i carnefici.
[5] Questo lavoro èstato oggetto, nel 2004, di un allegato speciale al quotidiano.
[6] Si tratta distampe satinato-argentiche formato 120 x 160 cm realizzate quest’anno aParigi.
[7] I« Giusti » ruandesi sono quegli Hutu che hanno nascosto, protetto espesso salvato la vita dei Tutsi durante il genocidio.
"Je pense donc Je suis "... en vitrine
Après six ans de travaux, le musée de l’Homme a rouvert en octobre 2015. À cette occasion, la plupart des articles de presse ont signalé un objet incontournable : le crâne de René Descartes. La fascination suscitée par la célébrité du défunt a visiblement été renforcée par le fait qu’il s’agit de l’original et non d’une copie. À ce sujet, Michel Guiraud, directeur des collections du MNHN dont dépend le musée de l’Homme, a affirmé : « Le public ne paierait pas pour voir sa réplique en plastique [1]». Cette remarque m’a interpellée et je me suis demandée si les visiteurs ont besoin devoir du vrai pour décider de visiter un musée d’anthropologie.
Crâne du philosophe René Descartes © M.N.H.N / JC Domenech
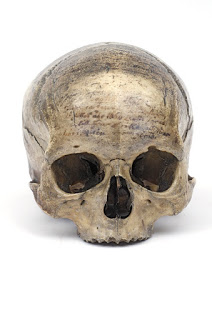 Regardons un peu plus d’un siècle en arrière. En 1898 par exemple, la galerie d’anthropologie du Muséum d’histoire naturelle de Paris est dotée d’une longue vitrine emplie de véritables squelettes présentant des malformations. Même si, à l’époque, réserves et exposition ne sont pas encore dissociées, la place dédiée aux anomalies anatomiques est considérable. De plus, les textes scientifiques décrivantces malformations corporelles ne suffisent pas à assouvir la curiosité dupublic. Les conservateurs doivent accompagner chaque reste humain d’un récit de son histoire personnelle pour le rendre attrayant. La rareté, l’exceptionnel et l’anecdotique font alors le régal des visiteurs. Et ce à tel point que dans les musées, la science de la singularité prime sur la « vraie » science. Heureusement, au XXe siècle, la science basée sur les curiosités dela Nature est considérée plus sévèrement, jusqu’à faire évoluer le goût du grand public – du moins, espérons-le.
Regardons un peu plus d’un siècle en arrière. En 1898 par exemple, la galerie d’anthropologie du Muséum d’histoire naturelle de Paris est dotée d’une longue vitrine emplie de véritables squelettes présentant des malformations. Même si, à l’époque, réserves et exposition ne sont pas encore dissociées, la place dédiée aux anomalies anatomiques est considérable. De plus, les textes scientifiques décrivantces malformations corporelles ne suffisent pas à assouvir la curiosité dupublic. Les conservateurs doivent accompagner chaque reste humain d’un récit de son histoire personnelle pour le rendre attrayant. La rareté, l’exceptionnel et l’anecdotique font alors le régal des visiteurs. Et ce à tel point que dans les musées, la science de la singularité prime sur la « vraie » science. Heureusement, au XXe siècle, la science basée sur les curiosités dela Nature est considérée plus sévèrement, jusqu’à faire évoluer le goût du grand public – du moins, espérons-le.
Le visiteur est-il un voyeur ?
Revenons au XXIesiècle : qu’attendent les visiteurs d’une exposition d’anthropologie biologique : des sensations ou un propos pédagogique ? Existe-t-il aujourd’hui des substrats de ces pratiques de visite quelque peu voyeuristes du siècle dernier ? La question semble appartenir au passé et pourtant deux exemples récents nous disent le contraire.
Il suffit de se rappeler l’exposition "Our body, à corps ouvert" qui présenta en 2006, dix-sept corps dépouillés de leur peau et parfaitement conservés grâce au procédé de la plastination. Le doute sur la provenance licite des corps et leur exploitation à des fins (pseudo-)scientifiques mais également commerciales suscitèrent de nombreuses controverses. Après avoir totalisé 200000 visiteurs en France, elle fût fermée par décision de justice.
Exposer les nains et les géants
Autre exemple : les squelettes du Nain et du Géant déjà présents au début XXedans la vitrine des malformations anatomiques furent ressortis des réserves du Muséum d’histoire naturelle en 2006, pour l’exposition "Planète cerveau". Placés dans une vitrine, derrière des moulages de cerveaux illustrant le fonctionnement cérébral, ils étaient uniquement destinés à captiver le regard du visiteur. Ils n’avaient donc qu’une fonction d’appel. Pourtant, ce pseudo-recul sur l’objet mis en scène renforce au contraire le caractère choquant de l’utilisation d’un reste humain traité ici comme un décor…
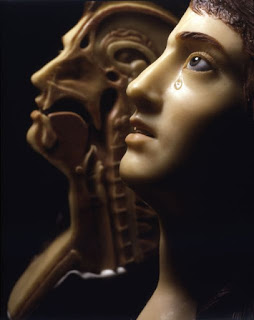
En 2015, la réouverture du musée de l’homme a permis de privilégier enfin le but didactique et pédagogique. Malgré les 30 000 pièces de restes humains présents dans les réserves, le comité d’éthique du musée a déterminé ce qui n’était plus montrable en 2016 : enfants ou fœtus, corps nus… Il a également choisi de laisser cette fois de côté le sujet des anomalies anatomiques. Les rares exceptions à cette règle ont fait l’objet d’un mode de présentation plus digne : hauteur, mise en exergue, présentation du contexte funéraire…
Par ailleurs, la séquence réservée à la céroplastie [2] peut heurter les âmes sensibles, pourtant elle ne vise pas à illustrer une leçon anatomique frôlant parfois la spectacularisation du corps décharné. Cettepartie relève en fait du domaine de l’anthropologie de la médecine et retrace les pratiques des études médicales au temps de l’interdiction de la dissection humaine et le fait que les bustes en cire anatomique furent en vogue au XIXe.
« Femme à la larme », cire colorée modelée, André-Pierre Pinson, 1784. © M.N.H.N / B. Faye
Le problème des restitutions
En outre, l’exposition de restes humains issus d’autres cultures pose le problème de la restitution. À l’image des deux cas tristement célèbres du corps de Saartjie Baartman, dite « la Vénus hottentote » et du crâne d’Ataï, chef de l’insurrection kanak en 1878, certains pays colonisateurs comme la France ou les États-Unis se sont emparés de restes humains sans se soucier du droit à la dignité humaine (reposant sur le consentement du défunt ou de ses ayants-droits). Au-delà de ce problème de la vision colonialiste des collections, nous posons tout simplement la question de la légitimité d’un musée à montrer l’original d’un reste humain alors qu’il peut en faire une copie, un moulage par exemple. Ainsi, au nouveau Musée de l’Homme, l’autre star de l’exposition permanente disputant la vedetteau crâne de Descartes est un moulage : c’est celui du squelette de Lucy (fossile d’Australopithèque vieux de 3,2 millions d’années, découvert en 1974 et exposé en Ethiopie, son pays d’origine).
Squelette de Lucy © L. Cailloce
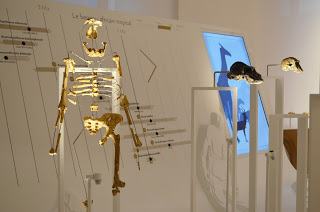 Mais l’authenticité du crâne de Descartes n’a peut-être pas comme fonction première la satisfaction de la curiosité morbide. Jean Davallon a écrit : « à force de vouloir dire le monde, à force de rationalité (…),toute exposition utilise des objets pour produire un mondeautre, un monde mystérieux, attirant (l’exposition, comme la publicité est condamnée à plaire), un monde en rupture avec le monde quotidien, réel[3] ». Or, il me semble que le crâne de Descartes remplit parfaitement la fonction de lien entre le monde réel et ce monde en rupture, décrit par Jean Davallon. Puisqu’il est un reste humain véritable, dénué de l’intervention du concepteur d’exposition (à la différence d’un moulage), le public se sent – naïvement sans doute, en prise directe avec un objet provenant du même monde que lui, le monde réel, lui livrant toute sa vérité, sans intermédiaire. Cette concession d’exposer un reste humain véritable est le prix à payer pour que le public ressente inconsciemment une perméabilité entre le monde de l’exposition, mystérieux, et son monde du quotidien, le réel. Et finalement, ce crâne n’a pas été choisi au hasard. Il est probablement le seul qui puisse s’exposer avec dignité dans la mesure où le cartésianisme prônait la mise à l’épreuve du jugement par la science.
Mais l’authenticité du crâne de Descartes n’a peut-être pas comme fonction première la satisfaction de la curiosité morbide. Jean Davallon a écrit : « à force de vouloir dire le monde, à force de rationalité (…),toute exposition utilise des objets pour produire un mondeautre, un monde mystérieux, attirant (l’exposition, comme la publicité est condamnée à plaire), un monde en rupture avec le monde quotidien, réel[3] ». Or, il me semble que le crâne de Descartes remplit parfaitement la fonction de lien entre le monde réel et ce monde en rupture, décrit par Jean Davallon. Puisqu’il est un reste humain véritable, dénué de l’intervention du concepteur d’exposition (à la différence d’un moulage), le public se sent – naïvement sans doute, en prise directe avec un objet provenant du même monde que lui, le monde réel, lui livrant toute sa vérité, sans intermédiaire. Cette concession d’exposer un reste humain véritable est le prix à payer pour que le public ressente inconsciemment une perméabilité entre le monde de l’exposition, mystérieux, et son monde du quotidien, le réel. Et finalement, ce crâne n’a pas été choisi au hasard. Il est probablement le seul qui puisse s’exposer avec dignité dans la mesure où le cartésianisme prônait la mise à l’épreuve du jugement par la science.
Si le crâne de Descartes fait aujourd’hui figure d’exception dans un paysage dominé par la sacralisation de la dépouille mortelle et les préoccupations éthiques, certains scientifiques défendent une autre idée. Au sujet de la mission scientifique du Musée de l’Homme, Alain Froment, responsable des collections d’anthropologie biologique, rappelle : « L’intérêt de cette collection, c’est de ménager l’avenir, de conserver une archive humaine (…). En cas de restitution ou de réinhumation, on se prive de ce moyen d’exploration du passé, notamment pour les sociétés qui n’ont pas d’écriture. [4] »
Entre devoir de science et protection de la dignité individuelle, la solution se trouve peut-être dans les réserves. À la différence d’autres collections essentiellement destinées à la fois à être vues par le plus grand nombre et conservées, les objets d’anthropologie biologique font sans doute figure d’exception en échappant à cette règle de la démocratisation culturelle. Le lieu de mémoire à préconiser serait, une fois n’est pas coutume, soustrait au regard du grand public mais ouvert à la venue des chercheurs et des générations futures.
Véronique Marta
En savoir plus :
http://www.museedelhomme.fr#restes humains#anthropologie#musée de l'Homme
[1] « Des squelettes dans les limbes », Hervé Morin, Le Monde,12 octobre 2015
[2] Technique de modélisation anatomique mêlant l’utilisation de la cire à des restes humains.
[3] Jean Davallon, La Mise en exposition, Claquemurer pour ainsi dire tout l’univers, Centre de création industrielle / Centre Pompidou, 1986, p. 242.
[4] « Des squelettes dans leslimbes », op. cit.
"Je veux continuer à vivre, même après ma mort !"
Une chose est sûre, si je suis curieuse de toute forme d’établissements culturels, je n’accroche absolument pas avec les maisons de personnages célèbres. Si certaines exposent des œuvres, mettent en valeur le bâtiment et son histoire, et se renouvellent avec des expositions intéressantes, d’autres se contentent de placer quelques meubles où l’artiste aurait peint ou écrit ses plus grandes œuvres le tout figé dans le temps et dans la poussière.
Anne Frank © Fondation Anne Frank
Visiter la maison d'Anne Franck
Pourtant, en voyage à Amsterdam, il était inenvisageable pour moi de manquer la très célèbre maison d’Anne Frank. Située sur les canaux du centre-ville, ce musée est un incontournable pour tous les touristes d’Amsterdam, qui forment des files d’attentes interminables autour de la maison. Cependant, la maison Anne Frank n’est pas une maison de personnages célèbres comme les autres ; la maison est indissociable de l’histoire d’Anne Frank, c’est le cadre et la limite de la majorité des écrits d’Anne Frank dans son très célèbre Journal. Comme une prison et un refuge, une ennemie et une amie, l’histoire de la Maison d’Anne Frank est forte et complexe et la visite promettait d’être une expérience riche en émotions.
Le Journal d’Anne Frank est un livre qui parle à toutes les générations et à toutes les nationalités cequi explique son succès depuis près de 70 ans. Les écrits de cette jeune adolescente m’ont profondément marquée pendant mon enfance, et cette maison cachée appelée l’Annexe, je l’ai imaginée de nombreuses fois en souhaitant pouvoirun jour en franchir le seuil.
« C’est une sensation très étrange, pour quelqu’un dans mon genre, d’écrire un journal. Non seulement je n’ai jamais écrit, mais il me semble que plus tard, ni moi ni personne ne s’intéressera aux confidences d’une écolière de treize ans. »
Anne Frank, 20 juin 1942
Voilà pourquoi je me suis retrouvée à attendre deux longues heures dans le froid d’Amsterdam pour avoir la chance de visiter ce lieu symbolique et historique. En entrant enfin dans le musée, je comprends pourquoi la file d’attente est si longue ; non seulement il y a énormément de visiteurs mais la billetterie arrête de vendre des billets tous les vingt visiteurs environ pour quelques instants. En effet, l’Annexe est très exigüe et cette mesure permet également de pouvoir se retrouver en petit comité dans les pièces et parfois même seul. C’est sûrement aussi pour des questions de sécurité, d’évacuation et de conservation ; dans tous les cas les conditions de visite sont appréciables.
L’Annexe
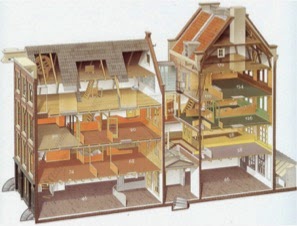 Petit rappel des faits : en 1942, les mesures anti-juives s’intensifient, la famille Frank entre alors en clandestinité au 263 Prinsengracht aux côtés de quatre autres personnes. Le bâtiment est composé de deux parties : une maison côté rue et derrière une annexe invisible. S’ensuit deux années de clandestinité et de cohabitation où il est impossible de sortir de cette annexe et où Anne Frank écrit un journal intime pour s’échapper de son quotidien difficile. En 1944, les clandestins seront dénoncés et déportés. Otto Frank, père d’Anne Frank et seul survivant des camps parmi les huit clandestins, décidera en 1947 de publier le journal intime de sa fille. Le musée ouvrira ses portes en 1960 sur les indications d’Otto Frank pour la reconstitution des pièces.
Petit rappel des faits : en 1942, les mesures anti-juives s’intensifient, la famille Frank entre alors en clandestinité au 263 Prinsengracht aux côtés de quatre autres personnes. Le bâtiment est composé de deux parties : une maison côté rue et derrière une annexe invisible. S’ensuit deux années de clandestinité et de cohabitation où il est impossible de sortir de cette annexe et où Anne Frank écrit un journal intime pour s’échapper de son quotidien difficile. En 1944, les clandestins seront dénoncés et déportés. Otto Frank, père d’Anne Frank et seul survivant des camps parmi les huit clandestins, décidera en 1947 de publier le journal intime de sa fille. Le musée ouvrira ses portes en 1960 sur les indications d’Otto Frank pour la reconstitution des pièces.
Plan de la maison et de l'annexe - © Wikimonde
Le parcours débute par la maison devant l'annexe qui abritait l'entreprise de Otto Frank ; l'entrepôt, les bureaux et enfin le dépôt. Ici, les pièces ont peu d'intérêt, mais permettent de rappeler le contexte historique au moyen d'archives filmographiques et de photographies. L'ambiance est pesante, les sources de lumière sont calfeutrées, l'éclairage est tamisé et il en sera ainsi pour tout le reste de la visite. Le moment charnière du parcours est le palier de l'annexe cachée avec sa très célèbre bibliothèque pivotante en guise de porte. Cette bibliothèque, d'origine, permet d'entrer dans la maison des clandestins ; l'atmosphère est étouffante avec des couloirs étroits, des escaliers raides (« un vrai casse-pattes hollandais » selon Anne Frank) et de grands rideaux noirs obstruant toute lumière du jour.
« Notre cachette est devenue une cachette digne de ce nom. En effet, M. Kugler a jugé plus prudent de mettre une bibliothèque devant notre porte d’entrée »
Anne Frank, 21 août 1942
La Chambre d'Anne Franck
Après avoir visité la chambre des parents et de la sœur d'Anne Frank, j’arrive enfin dans la chambre d’Anne Frank (partagée avec Fritz Pfeffer) où les murs sont couverts de photographies découpées dans les magazines et de cartes postales. Regarder ces photographies de stars de cinéma (Greta Garbo) ou de célébrités de l’époque (la Princesse Elisabeth) devant lesquelles Anne Frank rêvait des heures entières et qui constituaient le seul moment où elle pouvait s’échapper de la réalité et contempler le monde extérieur est un moment fort de la visite de l’Annexe. Viennent ensuite la salle d’eau, la salle de séjour commune et la chambre de Peter van Pels. Le grenier est la dernière pièce de l’Annexe et est importante dans l’histoire d’Anne Frank ; c’est le seul endroit où elle pouvait se réfugier seule et voir la lumière du jour. C’est également dans ce grenier qu’elle connaîtra ses premiers émois amoureux avec Peter. Comme il est impossible d’y monter pour des raisons de sécurité et de conservation, un grand miroir est installé pour permettre au visiteur de voir l’intérieur à partir du bas de l’échelle.
« Je ne suis jamais seule dans ma moitié de chambre et pourtant j’en ai tant envie. C’est aussi la raison pour laquelle je me réfugie au grenier. Là-haut, et auprès de toi, je peux être un instant, un petit instant,moi-même. »
Anne Frank, 16 mars 1944
Le vide de l'absence
En entrant dans cette annexe, je me suis interrogée sur le vide des pièces : mis à part quelques photographies et quelques documents d’époques des clandestins sur les murs (cartes, liste de commissions, traits de croissance d’Anne et de Margot etc.), il n’y a aucun meuble qui permettrait de reconstituer les différents espaces. L’explication est donnée à la fin du parcours : l’Annexe est restée vide à la demande d’Otto Frank, et représente le vide laissé par les millions de personnes déportées. D’abord déstabilisée par l’absence de contenu, j’ai réalisé rapidement que ces pièces vides laissaient une impression bien plus forte au visiteur ; ces murs ont une mémoire, et nul besoin de lits, de commodes ou d’armoires pour ressentir et comprendre l’histoire de ces huit clandestins. Deplus, des maquettes et des photographies de reconstitution des pièces permettent de voir comment elles étaient agencées.
« Pense comme ce serait intéressant si je publiais un roman sur l’Annexe ; rien qu’au titre, les gens iraient s’imaginer qu’il s’agit d’un roman policier. Non mais sérieusement, environ 10 ans après la guerre, cela fera déjà sûrement un drôle d’effet aux gens si nous leur racontons comment nous, les juifs, nous avons vécu, nous nous sommes nourris et nous avons discuté ici. »
Anne Frank, 29 mars 1944
Le parcours au 263 Prinsengrachtse termine au dernier étage de la maison officielle (façade donnant sur la rue) ayant comme thème « la Shoah ». Nous pouvons alors connaître le destin de chaque clandestin après son arrestation le 4 août 1944 ; seul Otto Frank reviendra du camp de concentration et Anne Frank mourra du typhus seulement quelques semaines avant la libération en mars 1945. Les protecteurs, également arrêtés, survivront à la guerre. Dans cette partie de l’exposition, les papiers d’identité des huit clandestins sont exposés ainsi qu’un grand livre répertoriant les millions de déportés ouvert à la page de la famille Frank. Une vidéo particulièrement touchante de Hanneli Goslar est projetée où elle explique sa relation d’amitié avec Anne Frank, et comment elles se sont retrouvées au camp de Bergen-Belsen.
Quittons maintenant l’Annexe et les années 40 pour retourner au présent et au musée accolé à la Maison Anne Frank.
Le Musée Anne Frank
La maison Anne Frank- © Fondation Anne Frank
 Le Musée est composé de trois salles d’expositions, d’un restaurant et d’une librairie. La première salle est un hommage à Otto Frank, à ses combats contre les discriminations tout au long de sa vie et à l’histoire de la publication du Journal d’Anne Frank. Une vidéo d’une interview d’Otto Frank est projetée sur l’histoire de sa vie avant et après la guerre.
Le Musée est composé de trois salles d’expositions, d’un restaurant et d’une librairie. La première salle est un hommage à Otto Frank, à ses combats contre les discriminations tout au long de sa vie et à l’histoire de la publication du Journal d’Anne Frank. Une vidéo d’une interview d’Otto Frank est projetée sur l’histoire de sa vie avant et après la guerre.
La deuxième salle est une salle clef dans le musée : on peut y voir le fameux Journal d’Anne Frank, petit carnet à carreaux rouges qu’elle avait reçu à l’occasion de son treizième anniversaire avant d’entrer dans la clandestinité. Lorsqu’il est plein, elle continue à écrire dans des cahiers puis sur des feuilles volantes. Anne Frank n’écrit pas seulement son journal intime mais aussi des nouvelles et recopie des belles phrases qu’elle trouve dans ses lectures. Son plus grand rêve est dedevenir écrivaine et de publier un livre sur la vie à l’Annexe après la guerre ; malgré sa mort prématurée, son rêve aura été réalisé au-delà de ses espérances. Les écrits d’Anne Frank sont d’ailleurs entrés au Patrimoine Mondial Documentaire de l’Unesco en 2009.
Enfin, le dernier espace est destiné à accueillir les expositions temporaires, expositions qui permettent d’approfondir l’histoire de la famille Frank. L’exposition en cours traite des protecteurs de l’Annexe, c’est-à-dire de toutes les personnes qui ont aidé les huit clandestins pendant la guerre. L’espace d’exposition est restreint et l’hommage à ces quatre personnes est vibrant mais bref.
« Kugler qui parfois a du mal à supporter la responsabilité colossale de notre survie à tous les huit et qui n’arrive presque plus à parler tant il essaie de contrôler ses nerfs et son excitation. »
Anne Frank, 26 mai 1944
La visite se termine avec la projection d’un film « Reflexion sur Anne Frank » qui rassemble les témoignages de personnes célèbres, de visiteurs du musée et de personnes ayant connu Anne Frank qui racontent leur relation avec elle et son journal. Chacun peut alors laisser une trace, un témoignage, une histoire de vie sur les tablettes numériques qui font office de livre d’or numérique.
L'émotion pour ne pas oublier
Avant de visiter ce musée, j’avais peur que les conditions de visites soient mauvaises dues augrand nombre de visiteurs et que Anne Frank soit trop « marchandisée ». Mes doutes se sont vite dissipés et j’ai autant apprécié l’Annexe cachée que le musée. Vous n’irez sûrement pas visiter ce musée pour la scénographie (soignée mais pas exceptionnelle) ni pour les expositions temporaires mais pour ressentir la puissance de l’histoire et de l’émotion dans lequel baigne ce lieu. Suite à ma visite, je me suis d’ailleurs replongée dans le Journal et j’en ai extrait les passages ici reproduits. La Maison Anne Frank vous permettra de (re)découvrir et de (re)lire le Journal d’Anne Frank et de ne jamais oublier l’histoire de cette jeune fille qui représente les millions de déportés pendant la seconde guerre mondiale.
Les extraits sont tirés du Journal d’Anne Frank
Laura Tralongo
.Pour aller plus loin :
Site officiel de la Maison Anne Frank
#annefrank
#amsterdam
#reconstitution

« Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique » : un rendez-vous manqué ?
Du 9 octobre 2020 au 25 juillet 2021, le musée du Quai Branly – Jacques Chirac présente l’exposition « Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique ». Si une exposition sur les Olmèques avait déjà été présentée aux États-Unis (« Olmecs, colossal masterworks of Ancient Mexico », Los Angeles County Museum of Art, octobre 2010 – janvier 2011 ; de Young Museum, San Francisco, février – mai 2011), ce sujet est encore inédit en Europe. Dédiée à la mise en lumière de civilisations encore peu connues, du grand public et même des archéologues, cette exposition présente le brassage culturel qui a caractérisé le Golfe du Mexique durant près de trois millénaires.
Un parcours qui met en lumière ces cultures…
L’exposition commence dès le hall d’entrée du musée par la présentation d’une tête colossale, caractéristique de l’art Olmèque. Présentée sur un socle de couleur bleu canard, cette œuvre invite le.a visiteur.euse à emprunter la rampe pour en découvrir davantage.

Tête colossale présentée dans le hall du musée © E. V-P
En entrant dans l’exposition, présentée sur la mezzanine Est du musée, le.a visiteur.euse découvre alors le début du parcours. Celui-ci commence par une courte présentation du propos de l’exposition : les Olmèques, et leur influence sur les autres cultures de cette région mésoaméricaine. Le texte informe aussi le.a lecteur.rice de ce qu’il va voir : des objets exceptionnels, jamais montrés en France.
La première séquence, au fond bleu canard, est dédiée plus spécifiquement aux Olmèques, la période durant laquelle ils se sont développés mais aussi leurs caractéristiques, comme l’organisation en ville ou la statuaire monumentale. À côté de ce texte introductif, une frise rappelle la chronologie mésoaméricaine et les différentes périodes – préclassique, classique et postclassique. Des objets illustrent alors les caractéristiques de cet art olmèque, comme le groupe des monuments 7 à 9, dit « Ensemble des Azuzules », retrouvé sur le second site de San Lorenzo. Cette séquence présente aussi plus en détail les villes de San Lorenzo et de La Venta, considérées comme les capitales olmèques. Un film diffusé au milieu de cette séquence retrace de manière assez romancée l’histoire de la culture.

Texte de la section « Les Olmèques », frise et carte © E. V-P
La deuxième séquence, sur murs jaunes, aborde la question centrale de l’écriture et de la linguistique dans la culture olmèque. Si les populations n’ont développé une forme d’écriture que tardivement, celle-ci va considérablement influencer les cultures qui la suivent, jusqu’aux Mayas et aux Aztèques. Les stèles présentées sont décryptées sur le mur leur faisant face, des dessins soulignant les photographies des glyphes.
La séquence suivante, intitulée « femmes et hommes du Golfe », sur fond blanc, présente l’influence de l’art olmèque sur les autres cultures du Golfe. Au centre de la pièce est placée une sculpture olmèque, entourée d’autres pièces de cultures contemporaines ou suivantes. Seulement une seule d’entre elle est mise en avant : les Huastèques, dont un court texte présente l’origine et le développement.
La quatrième séquence, avec des cimaises et des murs de nouveau bleus, « Offrandes », présente des groupes d’offrandes retrouvés sur des sites archéologiques comme les sculptures en bois d’El Manatí ou le dépôt de La Merced. Cette section met en lumière les fouilles et le contexte de découverte des différents objets, ainsi que l’importance des rituels pour les cultures du Golfe.

Section « Offrandes » © E. V-P
L’avant-dernière séquence, aux murs rouges, met en avant les interactions qu’ont entretenues les cultures de la côte du Golfe avec les régions voisines. Les recherches ont montré que les populations possédaient des caractéristiques communes comme la linguistique, les motifs architecturaux ou le jeu de balle.
Enfin, l’exposition se conclut sur le site de Tamtoc, cœur du développement huastèque, et la sculpture dite « La femme scarifiée ». La scénographie de cette section évoque le contexte de découverte de l’œuvre. Celle-ci fut découverte dans un réservoir d’eau.

Présentation de la « femme sacrifiée » © E. V-P
… mais une muséographie et un propos difficilement compréhensible
« Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique » est une exposition très dense, tant au niveau du nombre d’œuvres présentées, appartenant aux Olmèques et aux cultures du Golfe, que de la quantité d’informations délivrées aux visiteurs. Si la division des séquences est perceptible grâce au code couleur mural dans l’exposition, le propos l’est parfois moins.
Les Olmèques sont une culture encore mal connue, d’abord à cause du peu d’objets qui nous sont parvenus, mais aussi à cause de la lecture soit raciste, soit eurocentrée et évolutionniste des témoins culturels qu’ils ont livrés. Si aujourd’hui la théorie d’un peuple éthiopien qui se serait perdu dans l’océan est abandonnée, les chercheur.euse.s ne sont pas tous d’accord sur le foyer de développement de la culture. Certains s’accordent à dire qu’il s’agit d’une culture qui s’est développée sur la côte du Golfe, d’autres formulent l’hypothèse d’une population venue de la côte pacifique et qui aurait ensuite voyagé.
La culture Olmèque est donc identifiée par le développement de cités avec une organisation spécifique. Il est néanmoins difficile de déterminer précisément l'organisation de ces villes : est-ce qu'il y avait un chef.fe commun ? est-ce qu'ils s'agissaient plus de cités-états ? est-ce qu'ils s'agissaient de capitales ? L’exposition n’aborde pas toutes ces incertitudes qu’ont les chercheur.euse.s, par exemple en présentant les villes de San Lorenzo et La Venta comme des capitales, alors qu’il est difficile de l’affirmer ou de l’infirmer. Les Olmèques sont aussi identifiés par ce qu'on appelle le « style olmèque ». Celui-ci est caractérisé par une bouche aux commissures tombantes, des lèvres charnues, un nez épaté, qui a longtemps été décrit comme des « traits négroïdes » et qui a fait dire que les Olmèques étaient un peuple africain. Cette théorie est aujourd’hui abandonnée. Ce style, et l’organisation en cités, ont influencé des cultures contemporaines et postérieures, appelées les épi-olmèques, comme les Huastèques, culture épi-olmèque la plus connue et la mieux identifiée. Néanmoins le terme « culture » est lui aussi soumis à des controverses. Il s'agit de villes ou de sites où l'on a retrouvé des traces d'une influence olmèque, mais il est difficile de dire s'il s'agissait véritablement d'une culture. L’exposition ne montre pas les difficultés qu’ont les chercheur.euse.s et archéologues d'identifier ces cultures.
En raison le manque de connaissances de ces cultures du Golfe, leur distinction n’est pas claire. En effet, l’exposition ne présente pas que des objets olmèques, c’est d’ailleurs là tout son propos. Néanmoins, les objets assimilés aux Olmèques ne sont pas différenciés de ceux appartenant à d’autres cultures. Ainsi, dans la première séquence, le.a visiteur.euse peut avoir l’impression que toutes les œuvres proviennent des Olmèques, ce qui n’est pas le cas. Cette difficulté d’appréhension brouille d’ailleurs la compréhension de la culture olmèque, allant dans le sens opposé du but de l’exposition. Cela est d’autant plus vrai dans la séquence intitulée « femmes et hommes du Golfe », présentant des œuvres de différentes cultures. Sur les cartels, aucune mention de ces cultures n’est faite. La seule différence de traitement réside dans le fait que l’œuvre olmèque est au centre, et les autres sont positionnées autour. Cette mise en avant muséographique est claire pour un néophyte, mais l’est-elle autant pour un.e visiteur.euse moins averti ? Ce n’est que dans l’avant dernière section que des cartels feront mention d’une autre culture : maya ou aztèque.


Stèle 6 du site de Cerro de las Mesas et son cartel, mentionnant le terme épi-olmèque, sans que celui-ci ne soit explicité © E. V-P
Pourquoi ne pas mentionner le nom de ces différentes cultures ? Un.e visiteur.euse non averti va-t-il comprendre qu’il ne s’agit pas seulement d’œuvres olmèques ? L’absence de mention de ces cultures peut être due au fait qu’encore aujourd’hui nous les connaissons très mal. Il est donc difficile d’affirmer avec précision de quelles populations il pouvait s’agir. Pourtant, il aurait été pertinent d’en faire mention. Pour une exposition se targuant de célébrer « les résultats de plusieurs missions archéologiques », la mise en lumière de la recherche actuelle semble cohérente dans le propos. La mention « culture inconnue » aurait probablement pu aider les visiteur.euse.s à mieux se repérer et à comprendre cette influence.
Enfin, les dernières sections sont assez complexes et leur présence dans l’exposition n’est pas claire. En effet, après la séquence « femmes et hommes du Golfe », dédiée à l’influence olmèque, la section « offrandes » revient sur la culture et les rituels caractéristiques. La séquence, « interactions », aborde de nouveau la question des échanges, déjà évoquée en section « femmes et hommes du Golfe ». Enfin, la dernière séquence, ainsi que la conclusion sur le site de Tamtoc, est sûrement la plus complexe. En effet, elle fait appel à des connaissances extérieures à l’exposition, notamment sur le site de Teotihuacan. Ces séquences sont plus dédiées à un public spécialiste, et n’ont peut-être pas leur place tout à la fin de l’exposition, après une heure de visite et une certaine fatigue accumulée.
Plus largement, comment comprendre le terme culture ? La mention des « cultures du Golfe » dans le titre permet d’englober l’aire géographique, sans que ces cultures ne soient clarifiées. Mais, l’exposition participe à la confusion entre styles et cultures. L’exposition mentionne plusieurs fois les « traits olmèques », qui est un style qu’on retrouve au-delà du Veracruz, et du Golfe même. Dans le monde épi-olmèque, c’est-à-dire après les Olmèques, les styles sont plus locaux, par site presque. À la fin de l’exposition, comment le visiteur définirait-il les « cultures du Golfe » ?
Si cette exposition a le mérite de mettre en lumière des cultures peu connues, et de montrer une richesse d’objets, elle garde un regard empreint de pratiques occidentales et un discours au niveau de lecture parfois difficilement compréhensible.
E. V-P
Pour aller plus loin :
#exposition #MuséeQuaiBranlyJacquesChirac #Olmèques
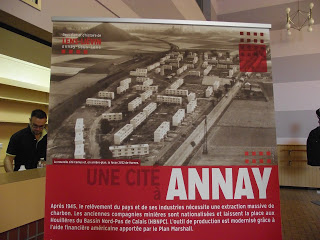
« Vivre en Camus » gravé dans les mémoires
Crédits : K.F
L’exposition « Vivre en Camus » à Annay-sous-Lens donne aux anciens camusards l’occasion de retrouver le voisinage qu’ils ont longtemps aimé côtoyer. Ils s’exclament à la vue d’un ancien ami. Ils rient en regardant les photographies qui leur rappellent assurément des souvenirs chaleureux .
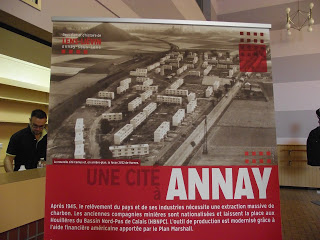
Les Mines sont un univers à part entière, reconnues depuis 2012 patrimoine mondial de l’Unesco, et source d’inspiration pour nos conceptrices d’exposition du Master Expo-Muséographie à l’Université d’Artois. « Vivre en Camus » impulsé par nos professeurs Isabelle Roussel-Gillet et Serge Chaumier, a été mis en œuvre par nos collègues, Mathilde, Lucie, Isabelle et Mylène qui ont fait de ce projet d’exposition un lieu extraordinaire de prise de conscience d’un patrimoine en voie de disparition (avec le soutien de la mairie d’Annay-sous-Lens et le Pays d’Art et d’Histoire de Lens-Liévin).
Les cités Camus s’écroulent alors que dans le cœur des camusards, elles sont toujours présentes et significatives.
Crédits : K.F

Et au cœur de l’exposition, une salle de projection improvisée offre aux visiteurs l’opportunité de passer la porte de l’un de ces Camus. Accueillis chaleureusement par M. et Mme Monchaux, les visiteurs suivent la visite guidée de la maison où la simplicité de nos hôtes donne à voir le grand cœur des gens du Nord, inimitable, sincère, unique !
Mathilde, Lucie, Isabelle, Mylène, vous avez fait des heureux, je l’ai vu, je l’ai entendu ce public enthousiaste ! C’était magnifique !
Katia Fournier

À l'abordage au Musée portuaire !
Le musée « à flot » du Musée portuaire de Dunkerque
Ça vous dirait une petite balade en bateau sans avoir le mal de mer ? Rendez-vous au Musée portuaire de Dunkerque où vous pourrez visiter trois bateaux des collections du musée. Oui, oui, visiter !
Des bateaux ancrés dans le port
Le Musée portuaire : musée « à quai » et musée « à flot »© www.lineoz.net
 En se baladant dans le port de Dunkerque, le promeneur aperçoit quatre bateaux légèrement en retrait par rapport aux autres bateaux du port et légèrement... décalés. L'un d'entre eux, avec ses splendides mâts et cordages, signale son appartenance à un autre siècle. Que fait-il dans le bassin du commerce ? Tiens, n'est-ce pas le Musée portuaire qui se dessine à l'horizon ? En s'approchant, le promeneur comprend que ces bateaux font en fait partie des collections du musée mais, surprise, ils ne sont pas uniquement là pour être admirés de l'extérieur, on peut monter à bord et les visiter ! Parmi les six bateaux de la collection du musée, dont quatre sont amarrés devant le musée, trois sont ouverts au public. Le musée ouvre le premier bateau au public, le trois-mâts Duchesse Anne, en 2001, le deuxième, la péniche Guilde, en 2003 et le troisième, le bateau-feu Sandettie, en 2006. La Pilotine n°1 est visible sur le quai mais non ouverte au public et les deux autres bateaux, le remorqueur l'Entreprenant et la vedette balisage l'Esquina,ne sont pas exposés dans le bassin. Car oui, on peut utiliser le terme « exposés » pour qualifier la mise en espace des bateaux. En tant qu'objets de collection, ils sont exposés dans le bassin du commerce comme un tableau est exposé dans une salle. À la différence près, et non négligeable, que ces bateaux constituent ce que le musée appelle le musée « à flot », par rapport au musée « à quai ». Nominalement, les bateaux se distinguent donc des autres objets de collection du musée et, plus intéressant encore, ils sont eux-mêmes désignés comme étant un musée. Alors, objet de collection ou musée ?
En se baladant dans le port de Dunkerque, le promeneur aperçoit quatre bateaux légèrement en retrait par rapport aux autres bateaux du port et légèrement... décalés. L'un d'entre eux, avec ses splendides mâts et cordages, signale son appartenance à un autre siècle. Que fait-il dans le bassin du commerce ? Tiens, n'est-ce pas le Musée portuaire qui se dessine à l'horizon ? En s'approchant, le promeneur comprend que ces bateaux font en fait partie des collections du musée mais, surprise, ils ne sont pas uniquement là pour être admirés de l'extérieur, on peut monter à bord et les visiter ! Parmi les six bateaux de la collection du musée, dont quatre sont amarrés devant le musée, trois sont ouverts au public. Le musée ouvre le premier bateau au public, le trois-mâts Duchesse Anne, en 2001, le deuxième, la péniche Guilde, en 2003 et le troisième, le bateau-feu Sandettie, en 2006. La Pilotine n°1 est visible sur le quai mais non ouverte au public et les deux autres bateaux, le remorqueur l'Entreprenant et la vedette balisage l'Esquina,ne sont pas exposés dans le bassin. Car oui, on peut utiliser le terme « exposés » pour qualifier la mise en espace des bateaux. En tant qu'objets de collection, ils sont exposés dans le bassin du commerce comme un tableau est exposé dans une salle. À la différence près, et non négligeable, que ces bateaux constituent ce que le musée appelle le musée « à flot », par rapport au musée « à quai ». Nominalement, les bateaux se distinguent donc des autres objets de collection du musée et, plus intéressant encore, ils sont eux-mêmes désignés comme étant un musée. Alors, objet de collection ou musée ?
Quand les collections deviennent des espaces de visite
Les trois bateaux ouverts à la visite, dont deux d'entre eux sont classés aux monuments historiques, sont des objets de collection. Un objet de collection est destiné à être exposé au public et effectivement les bateaux le sont. Le visiteur peut les admirer de l'extérieur comme il admire un objet dans une vitrine, mais il peut aussi monter à bord pour découvrir ce qui n'est pas visible de l'extérieur. Pour cela, ce n'est pas une obligation d'ouvrir au public les bateaux, des outils de médiation pouvant permettre une visite virtuelle de leur intérieur. Le musée a néanmoins décidé de les ouvrir au public pour offrir une qualité de visite exceptionnelle et complémentaire de la visite des salles d'exposition du musée « à quai ». Seulement, il ne se contente pas de faire monter les visiteurs à bord, et c'est là que le terme de musée « à flot » prend tout son sens : les bateaux sont à la fois objets d'exposition et lieux d'exposition. C'est un pari osé de la part du musée car il faut faire de ces bateaux des espaces muséaux tout en conservant et respectant leur âme et leur statut d'objet de collection. Pour cela, le musée a tenu compte de l'histoire de chaque bâtiment afin que l'offre muséographique soit la plus pertinente possible. À chaque bateau correspond donc une offre différente qui semble conquérir le public par son aspect ludique puisqu'un quatrième bateau, la Pilotine n°1, va bientôt être ouvert au public. Et si l'on faisait un petit tour à bord ?
La vie à bord
La Duchesse Anne Crédits : Lilia Khadri

Puis destination le Sandettie, un patrimoine maritime spécifiquement dunkerquois puisque ce bateau était chargé de signaler les bancs de sable face à l'entrée du port aux autres navires. Le bateau dévoile au visiteur ses différents espaces de vie contextualisés par des cartels et expôts aidant à la compréhension de l'activité du bateau présentée notamment dans la première salle, la salle commune des officiers, où est installé le matériel de transmission. Aller, un dernier et retour sur la terre ferme ! La visite se termine par la péniche Guildeaménagée pour accueillir dans ses cales une exposition permanente, La vie au fil de l'eau, qui présente l'histoire de la batellerie en évoquant le lien entre la vie professionnelle et familiale des bateliers. Petite originalité, cette exposition permanente est...itinérante ! Contradiction ? Non car la péniche, habitée par un couple de mariniers retraités, peut encore naviguer et se déplace en fonction de la demande pour montrer son exposition. La visite terminée, le visiteur regagne le quai et laisse les bateaux reposer paisiblement dans le port jusqu'à la prochaine visite. Enfin, pas tout à fait, parce que si l'on jette un œil sur ce qui s'y passe en-dehors des heures de visite, on découvre que bien d'autres activités y sont organisées...
Exposition La vie au fil de l'eau Crédits : Astrid Molitor
C. D.
Informations pratiques : Ouvert à 15 heures les dimanche et mercredi hors période de vacances scolaires et tous les jours d'ouverture du musée pendant les vacances scolaires – Fermé de fin novembre aux vacances scolaires de février.
Pour aller plus loin, cap sur :
– Griffaton Marie-Laure (dir.), Les bateaux-feux : histoire et vie des marins de l'immobile, Somogy Editions d'Art, 2003
– Louvier Patrick (dir.), Neptune au musée, Presses universitaires de Rennes, 2014
– http://www.museeportuaire.com/spip.php?rubrique32
– http://www.dailymotion.com/video/xklm94_la-duchesse-anne_creation
Mots clés : Musée portuaire, patrimoine flottant, bateaux, muséographie

A la découverte des mystérieux et majestueux Indiens !
« La terre a un chant. Elle porte les sons de l’univers. Chaque créature a un chant. Chaque plante a un chant.» Citation Indienne
Qui n'a jamais imité les Indiens, rêvé d'avoir une tente ou encore de dormir à la belle étoile ? Qui n'a jamais été bercé par les contes décrivant l'univers paisible et poétique de ces peuples ? Les Indiens d’Amérique sont des peuples passionnants, dont la disparition fut rapide et tragique. Ils ne sont plus que quelques milliers, vivant dans des réserves ou dans des villes et villages contemporains. Qui sont ces peuples que nous nommons Indiens ? Cheyennes, Comanches, Apaches, Dakota… entrez dans leur monde, au musée du Quai Branly…
Un exemple de tipi indien Crédits : L.K
 Cette exposition révèle les productions artistiques des Indiens d’Amérique et nous fait découvrir leurs modes de vie chronologiquement.
Cette exposition révèle les productions artistiques des Indiens d’Amérique et nous fait découvrir leurs modes de vie chronologiquement.
En plus des vitrines présentant les œuvres, les murs de l'exposition sont aussi des supports muséographiques. En effet ils sont recouverts de frises, de cartes et de descriptions de certains événements historiques qui ont entraîné des évolutions et des perturbations dans la vie des Indiens. Ajouté à cela, nous découvrons les noms de chaque tribu indienne, même les moins connues et apprenons à les localiser sur le continent américain.
Nous pouvons remarquer que les thèmes représentés dans leurs œuvres et objets d'arts varient lorsque de nouvelles apparitions ont eu lieu. Parexemple, une fois que les Indiens ont découvert les chevaux et les ont utilisés dans leur vie quotidienne, ils les ont représentés sur certaines peintures. Avec l'importation de masse les Indiens ont pu avoir accès à de nouveaux matériaux.
Le parcours est structuré en sections thématiques très précises, par exemple la vie dans les grandes plaines (1700-1820), la mort du bison(1860-1880), les communautés et diaspora (1910-1965) et le renouveau artistique (1965-2014)...
Crédits : L.K
Une scénographie épurée
 Nous découvrons une centaine d'objets uniques et précieux crées par les Indiens d'autrefois et par les Indiens d'aujourd'hui. Ces peuples étaient tous de grands artistes qui ont transmis leur passion à leurs descendants. La tradition se perpétue ! Ces œuvres d'art et utiles quotidiennement témoignent d'un amour spirituel pour la nature et les éléments terrestres.
Nous découvrons une centaine d'objets uniques et précieux crées par les Indiens d'autrefois et par les Indiens d'aujourd'hui. Ces peuples étaient tous de grands artistes qui ont transmis leur passion à leurs descendants. La tradition se perpétue ! Ces œuvres d'art et utiles quotidiennement témoignent d'un amour spirituel pour la nature et les éléments terrestres.
Des objets indiens variés
Cape indienne représentant une bataille encadrée par le soleil et la luneCrédits : L.K
 C’est un ravissement de pouvoir découvrir la culture indienne à traversces peintures, dessins, sculptures, broderies, parures de plumes et même calumets de la paix ! Si colorées, détaillées et impressionnantes !
C’est un ravissement de pouvoir découvrir la culture indienne à traversces peintures, dessins, sculptures, broderies, parures de plumes et même calumets de la paix ! Si colorées, détaillées et impressionnantes !
« Certaines pièces ont 300 ou 400 ans d'histoire. C'est déjà un miracle qu'elles soient parvenues jusqu'à nous. C'est un ensemble absolument exceptionnel car il n'y pas l'équivalent ailleurs dans le monde. Certainement pas en Amérique du Nord, où on a collecté des objets indiens beaucoup plus tardivement, au XIXe siècle » dixit André Delpuech, conservateur en chef du Patrimoine, chargé des collections Amériques au Musée du quai Branly.
Les stéréotypes sur les indiens
Et à votre avis, l'image que nous avons des Indiens est elle-vraie ou bien erronée ? N’a-t-elle pas été grandement façonnée parle cinéma ? Aussi une salle diffuse-t-elle les extraits de différents films américains des années 1960 et plus, évoquant les stéréotypes qui étaient véhiculés sur les Indiens. Certaines scènes tournées à la dérision nous font sourire. Nous prenons conscience que les réalisateurs employaient des stéréotypes dérisoires... excessifs... ce qui en devenait ridicule. Dans cette première production cinématographique, les Indiens étaient représentés avec dédain tels des guerriers sauvages recouverts de peintures, des sortes de clowns ou encore des hommes sanguinaires. C’est seulement dans les années 70 qu’ils seront un peu plus considérés et que le métissage est envisagé en racontant des histoires d'amours entre un homme dit blanc et une princesse indienne, alliance mixte symbole d’une entente commune.
Une robe contemporaine de toute beauté Crédits : L.K
 Bémols, vous avez dit bémols ? A la fin de l’exposition sont représentés deux tipis contemporains à taille humaine. Ceci nous permet de nous faire une idée cependant chaque visiteur aurait souhaité rentrer dedans, mais c’est impossible, ce qui est bien dommage et provoque une frustration finale chez l’enfant autant que chez l’adulte. De plus il est frappant que l'extermination des Indiens par les colons soit à peine évoquée, les commissaires d'expositions n'ont pas souhaité appuyer un point de vue mis à part celui de déconstruire les stéréotypes. Puis, certaines œuvres sont peu mises en valeur à cause d'un manque flagrant de lumière et des cartels presque introuvables puisque mélangés parmi d'autres. Les auteurs de ces oeuvres artisanales ne sont même pas mentionnés !
Bémols, vous avez dit bémols ? A la fin de l’exposition sont représentés deux tipis contemporains à taille humaine. Ceci nous permet de nous faire une idée cependant chaque visiteur aurait souhaité rentrer dedans, mais c’est impossible, ce qui est bien dommage et provoque une frustration finale chez l’enfant autant que chez l’adulte. De plus il est frappant que l'extermination des Indiens par les colons soit à peine évoquée, les commissaires d'expositions n'ont pas souhaité appuyer un point de vue mis à part celui de déconstruire les stéréotypes. Puis, certaines œuvres sont peu mises en valeur à cause d'un manque flagrant de lumière et des cartels presque introuvables puisque mélangés parmi d'autres. Les auteurs de ces oeuvres artisanales ne sont même pas mentionnés !
Mais le déplacement vaut le coup, soyez en sûrs. Venez-vous émerveiller, en immersion dans les plaines amérindiennes !
Lilia Khadri
Pour aller plus loin
Exposition - Indiens des plaines
# Indiens
# Civilisations
# Artisanat

À qui appartiennent les objets ?

Le Trésor des Marseillais reconstitué en 3D par le MAP © MAP (UMR CNRS/MCC 3495)
Le Trésor des Marseillais et les sanctuaires panhelléniques
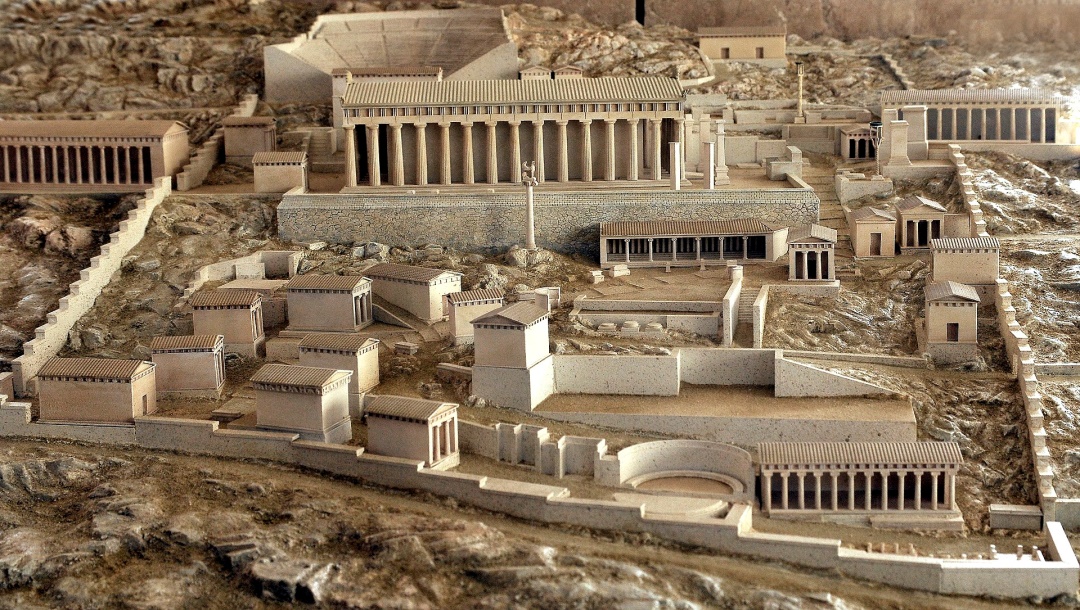
Maquette du sanctuaire d’Apollon reconstitué, exposée au Musée Archéologique de Delphes © Luis Bartolomé Marcos
Restitution, propriété et héritage culturel
Le rôle du musée et des nouvelles technologies en question
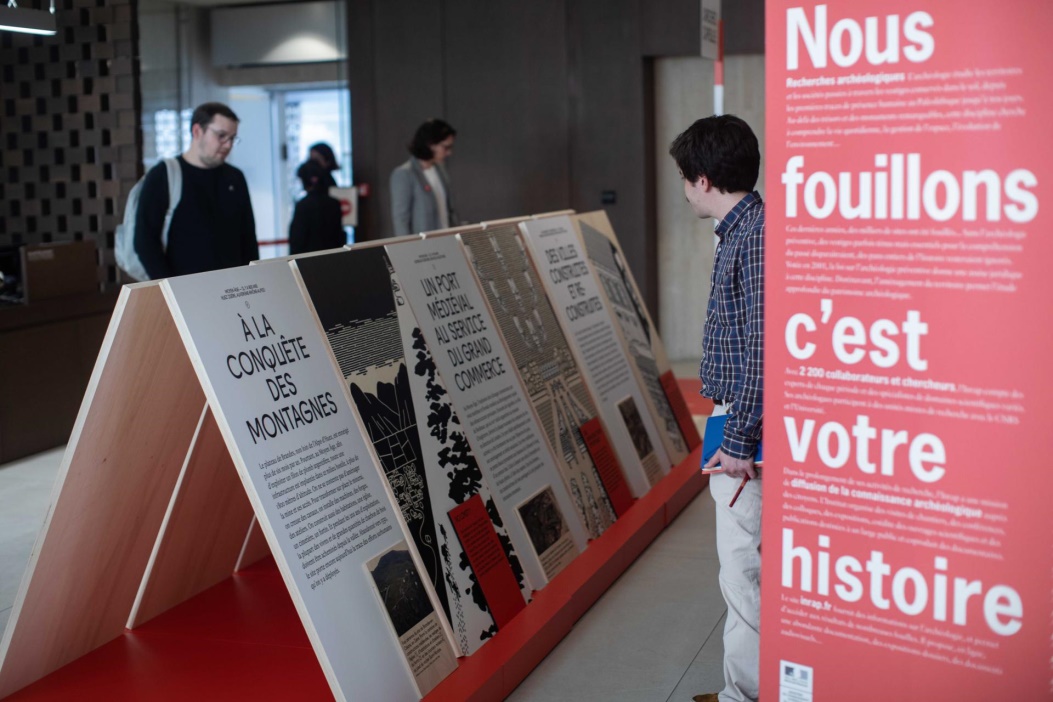
Visite de l'Archéocapsule « Archéologie de l'aménagement du territoire » au Musée de Cluny © Inrap
# Collections# Patrimoine# Héritage
Pour aller plus loin, bibliographie et sitographie thématiques…
-
Le Trésor des Marseillais et les sanctuaires panhelléniques
Colonge Victor, Le rôle des grands sanctuaires dans la vie internationale en Grèce aux Ve et IVe siècles av. J.-C, Thèse de doctorat en Histoire Ancienne, sous la direction de Nicolas Richer, Lyon, École Normale Supérieure, 2017, 900 p.
Poirier Henri-Louis et Musée d’archéologie méditerranéenne, Le trésor des Marseillais: 500 av. J.-C., l’éclat de Marseille à Delphes, Paris, Somogy, 2012, 247 p.
Centre de la Vieille Charité - Marseille, https://vieille-charite-marseille.com/archives/le-tresor-des-marseillais-500-av-j-c-l-eclat-de-marseille-a-delphes
Le Trésor des Marseillais : récit d’une expérience | Maud Mulliez, http://restauration-peinture.eu/archeologie/le-tresor-des-marseillais-experience/
-
Restitution et politique culturelle
Collège de France, Annuaire du Collège de France 2016-2017: résumé des cours et travaux : « À qui appartient la beauté ? Arts et cultures du monde dans nos musées », 117e année, 2019.
Kowalski Wojciech W., Restitution of works of art pursuant to private and public international law, Leiden, Boston, Brill, 2008, 244 p.
Prott Lyndel et O’ Keefe Patrick, « “Cultural Heritage” or “Cultural Property”? », in : International Journal of Cultural Property, no 2, vol. 1, 1992, p. 307.
Savoy Bénédicte, Sarr Felwine, Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle, 2018, 232 p.
-
Le musée et les nouvelles technologies
Martin Yves-Armel, « Innovations numériques / révolution au musée ? », in : Publications du musée des Confluences, no 1, vol. 7, 2011, pp. 117‑128.
Inrap | Archéologie et société : les Archéocapsules, https://www.inrap.fr/archeologie-et-societe-les-archeocapsules-13968 , 30 octobre 2018
Repenser le musée à l’aune de l’archéologie contemporaine, https://www.icom-musees.fr/actualites/repenser-le-musee-laune-de-larcheologie-contemporaine , 19 février 2019
(Image de couverture © Sylvie Puech.)
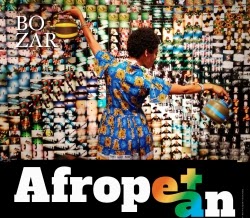
Afropean+ : une expérience polymorphique ?
Quand on fait son stage dans un musée travaillant des questions aussi complexes que « C’est quoi l’Afrique subsaharienne contemporaine ? Qu’est-ce qu’une diaspora ? Quelle mémoire les Belges et les Congolais partagent-ils ? De quelles manières la partager et la transmettre de part et d’autre de la méditerranée ? » L’événement Afropean+ peut apporter des réponses.
Affiche Afropean+ © Bozar
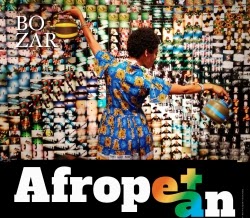 Me voila donc à Bozar, à Bruxelles, par un samedi de janvier particulièrement ensoleillé, prête à m’enfermer pour une journée d’événements culturels autour de la notion d’afropéanité. Le public est au rendez-vous, il est en majorité issu des diasporas subsahariennes et non africaines, j’aimerai voir encore plus de monde, encore plus de métissage. Etpourtant l’ambiance est cordiale, passionnée, aux aguets. C’est la première fois que j’entends, ou plutôt lis le terme afropean inscrit en grosses lettres sur le programme de la journée. Qu’est ce donc que ce néologisme, cette contraction d’africain et d’européen ?
Me voila donc à Bozar, à Bruxelles, par un samedi de janvier particulièrement ensoleillé, prête à m’enfermer pour une journée d’événements culturels autour de la notion d’afropéanité. Le public est au rendez-vous, il est en majorité issu des diasporas subsahariennes et non africaines, j’aimerai voir encore plus de monde, encore plus de métissage. Etpourtant l’ambiance est cordiale, passionnée, aux aguets. C’est la première fois que j’entends, ou plutôt lis le terme afropean inscrit en grosses lettres sur le programme de la journée. Qu’est ce donc que ce néologisme, cette contraction d’africain et d’européen ?

Le premier indice pour tenter d’approcher une définition du terme se trouve dans sa forme même, deux mots tranchés et cousus ensemble.
Bozar, plateforme de rencontres
Le second indice se situe dans la forme même que prend l’événement et dans le lieu où il se déroule. Bozar est une plateforme, une succession de salles où cohabitent une multitude de projets culturels validés par une direction dont la caractéristique principale est de savoir mettre le doigt sur des problématiques sociétales et contemporaines émergentes. La forme que prend Afropean + est pluridisciplinaire. C’est une journée où se succèdent des propositions variés comme un marché créatif, des expositions, des courts et longs métrages, des concerts, des lectures, des débats, des spectacles. L’ensemble venant se télescoper quand le visiteur prend le temps d’assister à plusieurs propositions. Notons au passage que seuls les concerts sont payants.
Continuum of Repair : The light of Jacob’s Ladder, Kader Attia, Bozar, 2015 © O.L
Un lieu d'échanges, de débats et de révélations
Le troisième indice est l’installation de l’artiste Kader Attia. Dans une salle en retrait du majestueux hall Horta où se trouve le marché créatif, l’artiste propose la métaphore d’une situation, celle de l’être traversé par plusieurs cultures, cultures reliées entre elles souvent violemment par la colonisation. L'œuvre est un cabinet de curiosités qui n'utilise pas le principe de l'originalité, du bizarre, de l'extra ordinaire comme historiquement mais est un espace polyphonique où par les objets (essentiellement des livres) les voix scientifique, politique, religieuse trouvent leur place les unes avec les autres. La suture entre les mondes (entre le ciel et la terre reliés par l'échelle de Jacob, entre le pouvoir politique symbolisé par les bustes d'hommes blancs et les textes bibliques et coraniques...) se fait par le regard englobant de l'artiste. C'est une couture entre les différents éléments de l'installation faite avec bienveillance, sans hiérarchisation entre les objets. Leur accumulation forme un constat : le scientifique, le religieux, le politique sont des possibles non hiérarchisés. Ce dispositif offre aux regards la plasticité et la polymorphie d’un monde qui permet une construction des identités.
Continuum of Repair : The light of Jacob’s Ladder, Kader Attia, Bozar, 2015 © O.L

S'exprimer par la scène
Le cinquième et dernier indice est la lecture-spectacle Autrices de « Ecarlate la compagnie » à partir d’extraits choisis du texte Ecrits pour la parole de l’auteure française Léonora Miano. Deux femmes, deux voix accompagnées par une création sonore inédite. Moment fort où la langue de Miano surgit, s’incarne dans le corps blanc des deux actrices. Et c’est cette incarnation du texte interrogeant « le rapport souvent conflictuel qu’entretiennent les afropéens avec les notions d’intégration et de double culture »[1] qui donne sens à l’afropéanité. Afropéanité est un mot dépassant la couleur pour interroger des identités qui restent dynamiques et uniques. En écho j’entends la voix de Léonora Miano dire : « Je sais très bien que je suis le produit de la rencontre entre deux mondes, qui, d’ailleurs, se sont mal rencontrés. Mais, enfin, j’existe. »[2] La voie à tracer pour se reconnaitre, se rencontrer, ne se situerait-elle pas dans ce retour aux conditions de la rencontre entre Afrique et Europe ? Il semble que pour construire les identités contemporaines, il nous faille faire un retour sur notre passé , sur ce que nous avons en commun.
Ophélie Laloy
Pour aller plus loin :
http://www.bozar.com/activity.php?id=15637
#Afropéanité
#Événementiel culturel
#Postcolonialisme
[1] Programme Bozar
Albert Khan : se dévoiler par nuances
Les deux promotions du Master MEM ont rencontré Valérie Perles et Jean-Christophe Ponce lors de leur « semaine expographique ». Cette dernière permet aux étudiants de rencontrer des professionnels qui fourniront un point de vue concret sur un thème prédéfini : celui de cette année est la rénovation et l’extension de musées. La conservatrice et le scénographe se sont libérés en pleine période de travail pour une journée d’échange afin d’exposer le projet de rénovation du Musée Albert Khan.
Un autochrome, s’il s’apparente à une des premières formes de photographie en couleur, se rapproche de la peinture par l’apport de couches successives afin de former une image. Cette dernière est captée grâce à l’application de vernis, de fécule écrasée, de carbone et d’émulsion sensible. Le résultat donne une photographie à l’aspect un peu décalé, voire poétique. La couleur tranche franchement avec l’aspect solennel des premières photographies, elle leur donne un ressort qui promet à celui qui prend le temps de les regarder un aperçu vivant et succinct du passé. Toutefois, l’autochrome est fragile, son procédé nécessite des conditions particulières de conservation qui ne permet pas une exposition sur le long terme. Des reproductions sont nécessaires pour pouvoir révéler ce qu’un autochrome veut donner à voir.
La plus grande collection d’autochromes a été formée par Albert Khan dans ce qu’il a appelé « Les Archives de la planète ». Ce banquier français a fait converger sa fortune et ses idéaux philanthropiques pour mobiliser des photographes et cameramen sur plus de 60 pays entre 1909 et 1931. Cela afin de saisir « des aspects,des pratiques et des modes de l’activité humaine » dont Khan avait -déjà- conscience de la disparition prochaine. Cet engouement documentaire a permis de constituer une collection de 72000 autochromes, portant sur les coutumes, les paysages, les portraits. Ce projet avait pour but de faire connaître les cultures étrangères afin de promouvoir le respect de chacune dans une optique pacifiste. Quatre axes permettent de comprendre la démarche de départ : le voyage, la géographie,l’actualité, l’ethnologie.
N°A69 807 X © Collection Archives de laPlanète - Musée Albert-Kahn/Département des Hauts-de-Seine
N°A70 472 XS © Collection Archives de laPlanète - Musée Albert-Kahn/Département des Hauts-de-Seine
Mais ce projet documentaire avait aussi vocation à être diffusé : Khan invitait dans sa maison de Boulogne-Billancourt artistes & diplomates internationaux dans le but de les confronter à l’étranger, au dépaysement et à sa propre sensibilité. La visite se déroulait alors entre deux espaces : la sphère intime avec le cabinet de projection et l’extérieur dans les quatre hectares de jardin qui entourent la maison, composés de serres, de reconstitutions d’architectures asiatiques.
Dans les années 1930, le krach boursier n’épargne pas Albert Khan : le département de la Seine rachète alors collections et jardins afin d’en faire un musée éponyme. Il ouvre ses portes au public en 1937. Le musée actuel prend place à Boulogne-Billancourt dans l’ancienne maison du banquier et s’accompagne des jardins départementaux qui le corroborent. Si le jardin est retravaillé dans les années 1990, la rénovation du musée débute en 2013, quatre ans après, les espaces d’exposition sont en phase d’aménagement ;
N°B778 S © Collection Archives de la Planète- Musée Albert-Kahn
© Département Hauts-de-Seine
Quel a été ce projet de rénovation ? Comment travailler à la fois sur une démarche universelle et sur la personnalité d’Albert Khan ?
Il était question alors de donner une cohérence à la pluralité des domaines qui composent les collections du musée : de l’immatériel recueilli, un jardin immense, des heures de films, des objets personnels, une maison.. et les fameux autochromes des Archives de la Planète. Dans le musée Albert Khan, le parti pris a été de se concentrer sur la démarche à la fois documentaire et philanthropique du banquier afin de plonger le visiteur dans le temps, le remettre dans les pas des invités d’antan. Mais alors serait-ce une énième immersion biographique à coup de dioramas, de photographies personnelles illustrant l’œuvre d’Albert Khan ? Loin de là, ici point d’épitaphe surannée, mais un voyage immobile, où l’imagination du visiteur est sollicitée afin de recréer l’univers de Khan, où on suggère un espace temporel plutôt qu’on ne l’impose.
© Scenorama- esquisse de parcours
Il existe une porosité entre le présent et le passé, rappelé par à-coups par la forme du mobilier, le dispositif scénographique, les montages sonores… Le portrait chinois d’Albert Khan en est représentatif : un plâtre de Rodin, un écorché, un vase en porcelaine bleue, une paire de lunettes … Khan est présenté au visiteur à travers une évocation de sa personne plutôt qu’une illustration explicite des différentes étapes de sa vie. Cette mise à distance permet en même temps une approche plus intime du personnage, une rencontre anachronique avec une personnalité pacifiste et réformiste.
L’évocation de la transmission des Archives de la Planète est aussi visible à travers un bâtiment nouveau qui propose un aperçu original et poétique des collections, articulant modernité et patrimoine. Le cabinet de diffusion du banquier est présenté par un espace voué à la projection des autochromes.
© Scenorama- esquisse du cabinet de diffusion
La salle n’est pas une reconstitution mais la suggestion dudit cabinet : le visiteur prend place face à l’écran aux côtés d’un extrait du mobilier original. Un montage sonore accompagne cette rencontre entre deux époques et propose au voyageur de comprendre d’emblée l’esprit documentaire et humaniste de Kahn.
Au milieu du désordre ambiant que propose l’actualité, aller au musée Albert Khan à sa réouverture en février 2018 promet une méditation sur les liens entre cette période et la nôtre ainsi qu’une pause poétique à travers le temps. Le projet du musée Albert Khan se comprend finalement comme un autochrome : par suggestions, il propose au visiteur un parcours réflexif sur une personnalité emblématique de son temps ; par touches successives, il met en exergue les nuances de l’âme humaine.
Coline Cabouret
#nuances
#autochromes
#rénovation
_________________________________________________________________________________
Pour en savoir plus : http://renovation.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/

Application augmentée, défi relevé
Avec 4 millions de visiteurs par an, difficile de profiter comme il se doit de l’intérieur de la cathédrale de Strasbourg. Mais l’équipe du projet « le Défi des bâtisseurs » a pensé à tout en redéfinissant le principe même de la visite, grâce à une application mobile gratuite disponible sur l’Appstore et Google Play qui vous fera découvrir les chefs-d’œuvre gothiques de la vallée du Rhin, avec les cathédrales d’Ulm et de Fribourg comme points de chute remarquables. Cet outil est intégré à un projet transmédia global, comprenant un film en 3D et un web-documentaire toujours autour du thème de la cathédrale et de ses bâtisseurs.
 © Inventive Studio
© Inventive Studio
La ville de Strasbourg est la première à bénéficier, de ce qui est la première version de l’application. Deux langues sont actuellement disponibles au téléchargement, le français et l’allemand, bientôt enrichi d’une version anglaise. La technologie développée intègre QR code et tag NFC disséminés dans et aux alentours de la cathédrale, proposant ainsi divers points de vue sur l’édifice. Ces différents points d’intérêts, une vingtaine en tout, permettent de débloquer des contenus très variés. Nous avons par exemple des vidéos, issues du film qui a été tourné sur la cathédrale dans le cadre de ce projet, des zooms sur des détails à peine discernables à l’œil nu grâce à la modélisation 3D de l’édifice, ainsi que des mini-jeux et des challenges liés au web-documentaire, autre média intégré à cette expérience globale. C’est grâce à cette enveloppe fictionnelle et ludique que l’utilisateur s’approprie facilement les informations historiques. Cette application constitue donc un outil parfait pour devenir incollable sur la cathédrale de Strasbourg. Car la diversité des éléments proposés ne nous donne pas le temps de nous ennuyer une seconde. Nos yeux sont captivés par la réalité augmentée qui nous emmène des différentes places autour de la cathédrale, jusqu’aux salles du Musée de l’Œuvre Notre Dame.
 © Inventive Studio
© Inventive Studio
Cette utilisation des nouvelles technologies rajeunit l’image de l’édifice et plus globalement de la ville. L’application est clairement destinée à un public jeune, adepte des nouvelles technologies, visitant ou habitant Strasbourg. A nous la vie de gargouille et de bâtisseur, on nous invite d’ailleurs à poursuivre cette dernière chez soi par le biais du web-documentaire, où il nous est proposé à l’aide d’experts de construire une deuxième tour à la cathédrale. Grace à la réalité augmentée, vous pourrez ensuite retourner sur place pour visualiser votre création, ainsi que celle des autres utilisateurs sur votre écran. Si vous êtes comme moi, émerveillée du résultat, vous avez la possibilité de voter pour votre tour préférée et de la partager sur les différents réseaux sociaux.
Au final, nous avons une réalisation soignée et convaincante malgré les manques affichés par la première version. En effet, comme souligné précédemment, la version anglaise n’est pas encore disponible. De même pour les liens avec les autres lieux remarquables tel Fribourg, qui sont pour le moment bien moins explorés que ceux avec les autres média de ce dispositif d’un nouveau genre. Mais des mises à jour sont d’or et déjà prévues pour combler ces manques. En attendant rendez-vous à Strasbourg pour cette visite augmentée.
Anaïs K.

Au temps des faluns, visite d’exposition à 15 millions d’années
Une remontée dans le temps
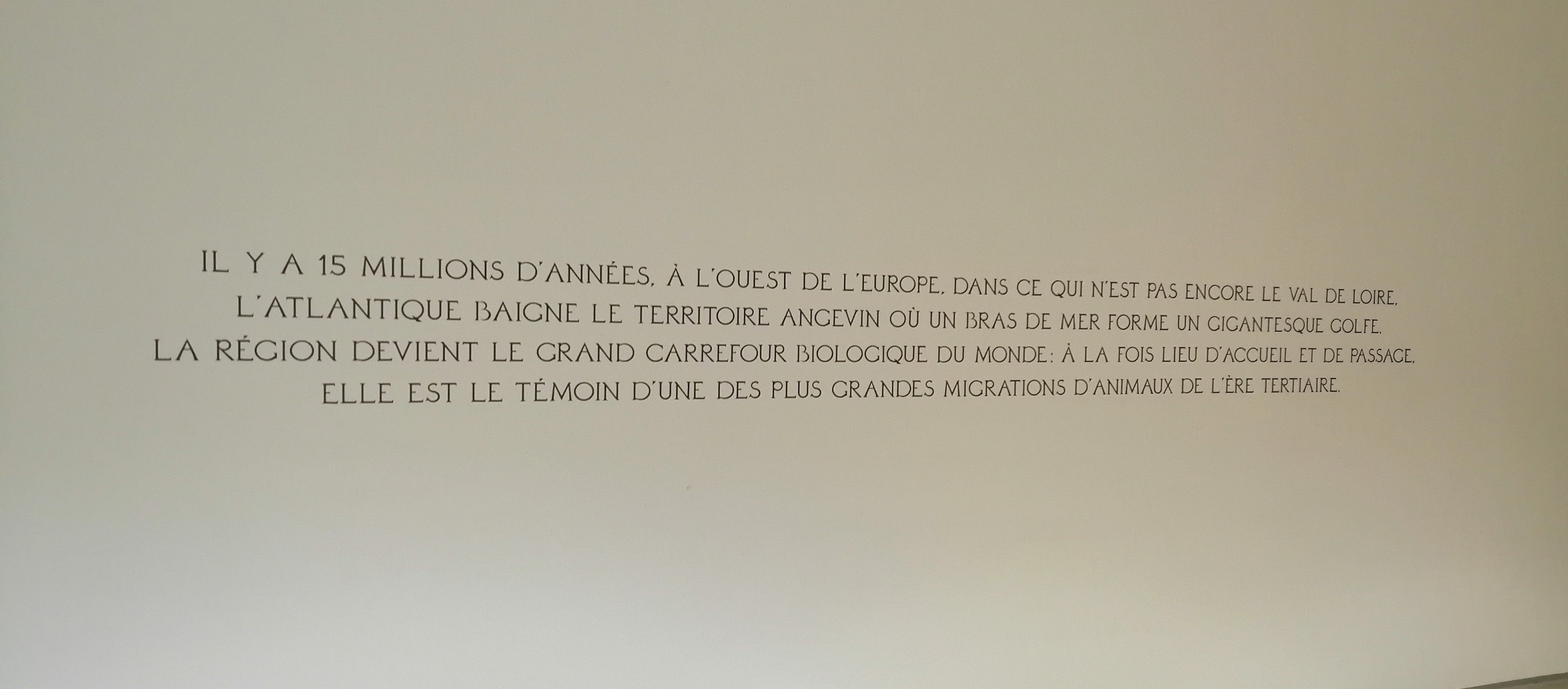
Vue de l’entrée de l’exposition Au temps des faluns ©GM

Vue de l’exposition – @GM ; [scénographie Raphaël Aubrun, Musées d’Angers]
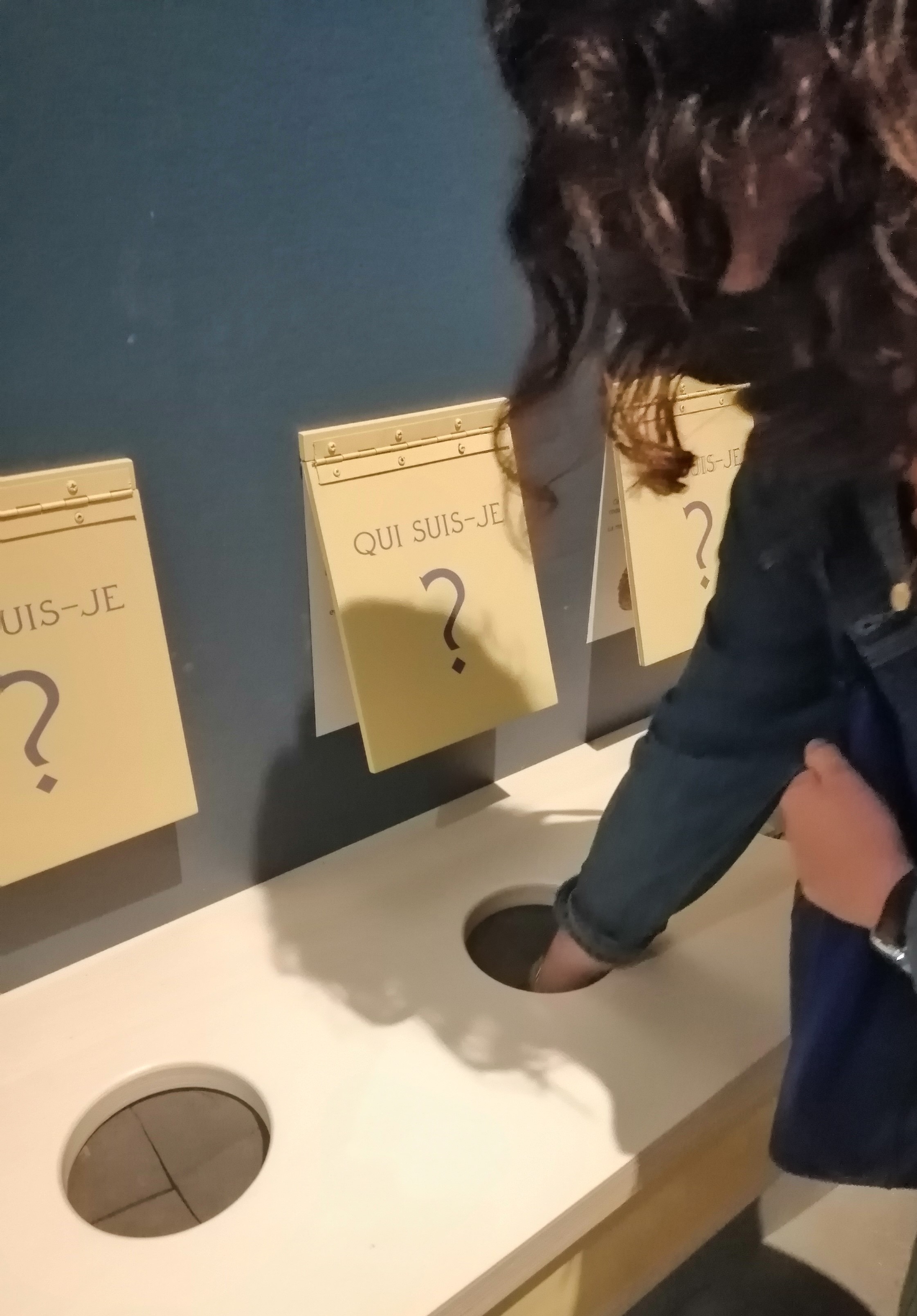
Dispositif tactile [vue de l’exposition Au temps des faluns] – ©GM
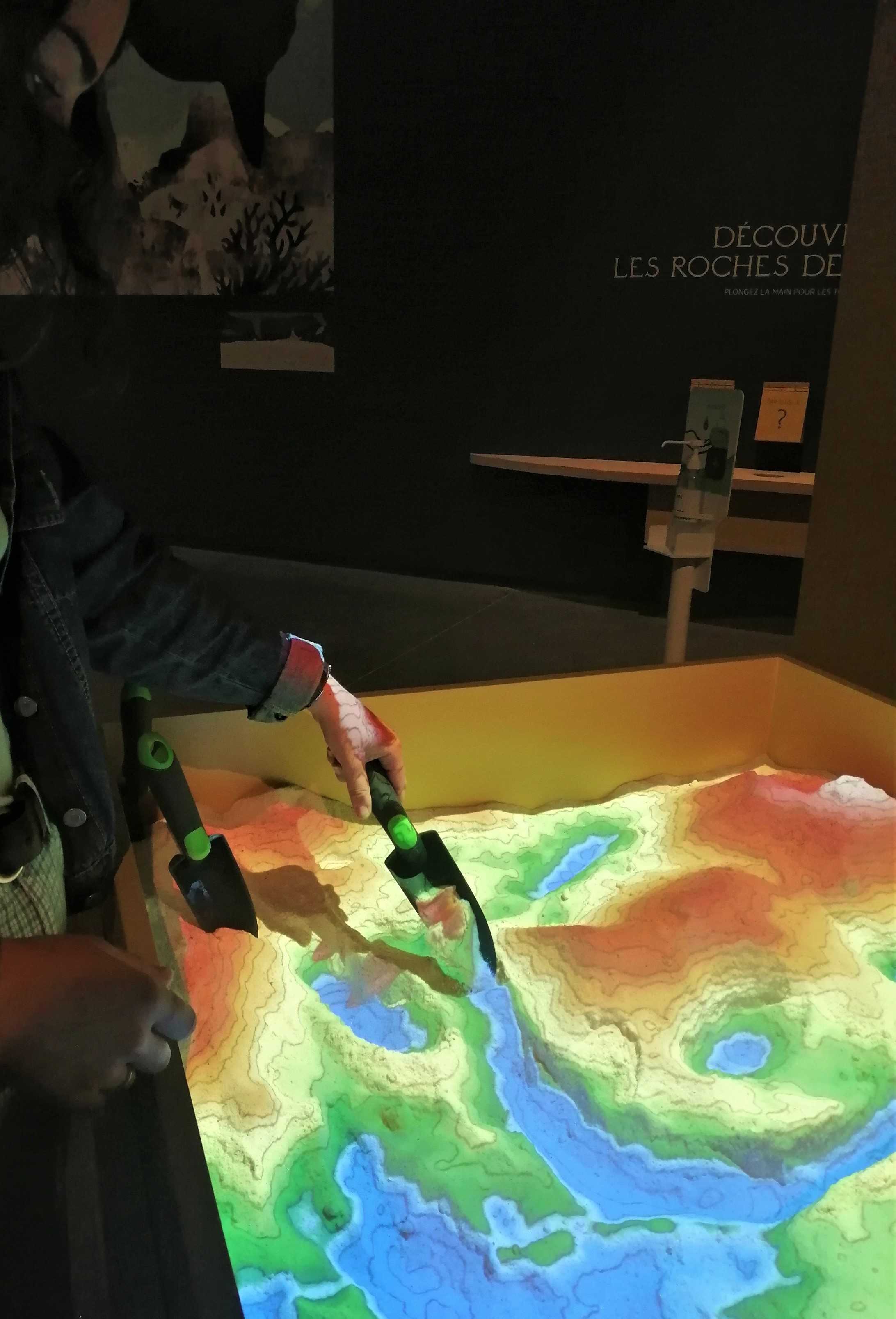
Bac à sable à réalité augmentée [vue de l’exposition Au temps des faluns] - ©GM

« Le monde marin », vue de l’exposition au temps des faluns @GM
Après avoir déambulé autour de ces deux îlots en longueur, où le regard est invité à se poser à la fois sur l’infiniment petit – un microscope permet d’observer des bryozaires ! – et le plus grand – la reconstitution inédite du Deinotherium fait son effet – nous terminons par les deux séquences en bout de plateau.

Vue de l’exposition @GM ; [scénographie Raphaël Aubrun, Musées d’Angers]
Ces séquences sont disposées autour de ce qui semble de loin être un grand bac à sable sur estrade. Il s’agit de plus près d’un dispositif de médiation in situ proposant de s’essayer aux fouilles archéologiques dans les faluns. Nous avons quitté le Miocène et revenons vers des périodes plus contemporaines.
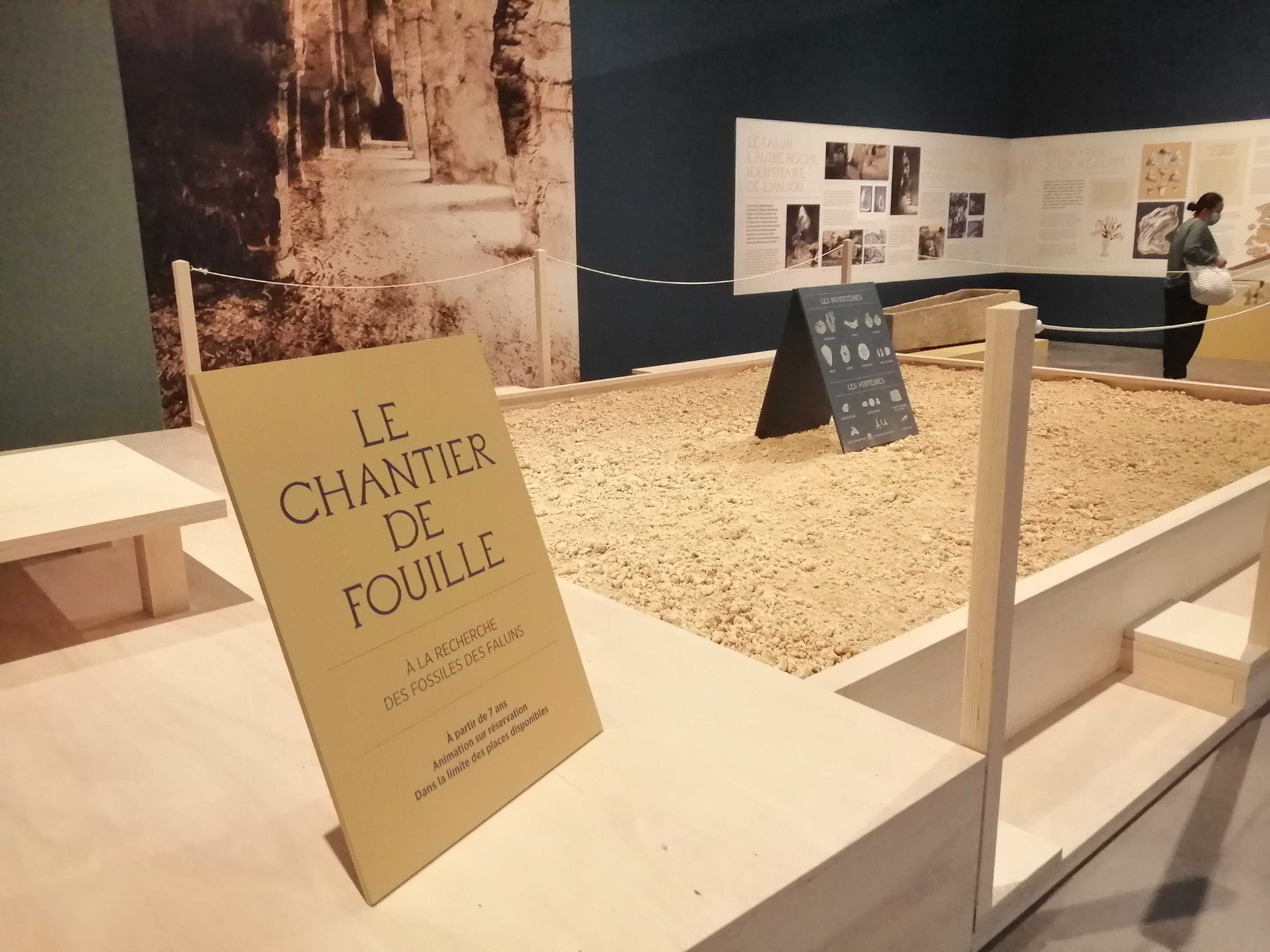
Vue de l’exposition @GM ; [scénographie Raphaël Aubrun, Musées d’Angers]
La séquence 5 propose donc un regard plus patrimonial, intitulé « le falun, l’autre roche sédimentaire de l’Anjou » on y découvre sa répartition géographique, ses usages et son exploitation mais aussi les mythes qui l’entourent – notamment les légendes liées à l’abondance des dents de requins qui y sont trouvées ! Une maquette accompagne la séquence et permet d’observer ces différents aspects en un ensemble, elle présente notamment les fameuses caves cathédrales de Doué-en-Anjou.
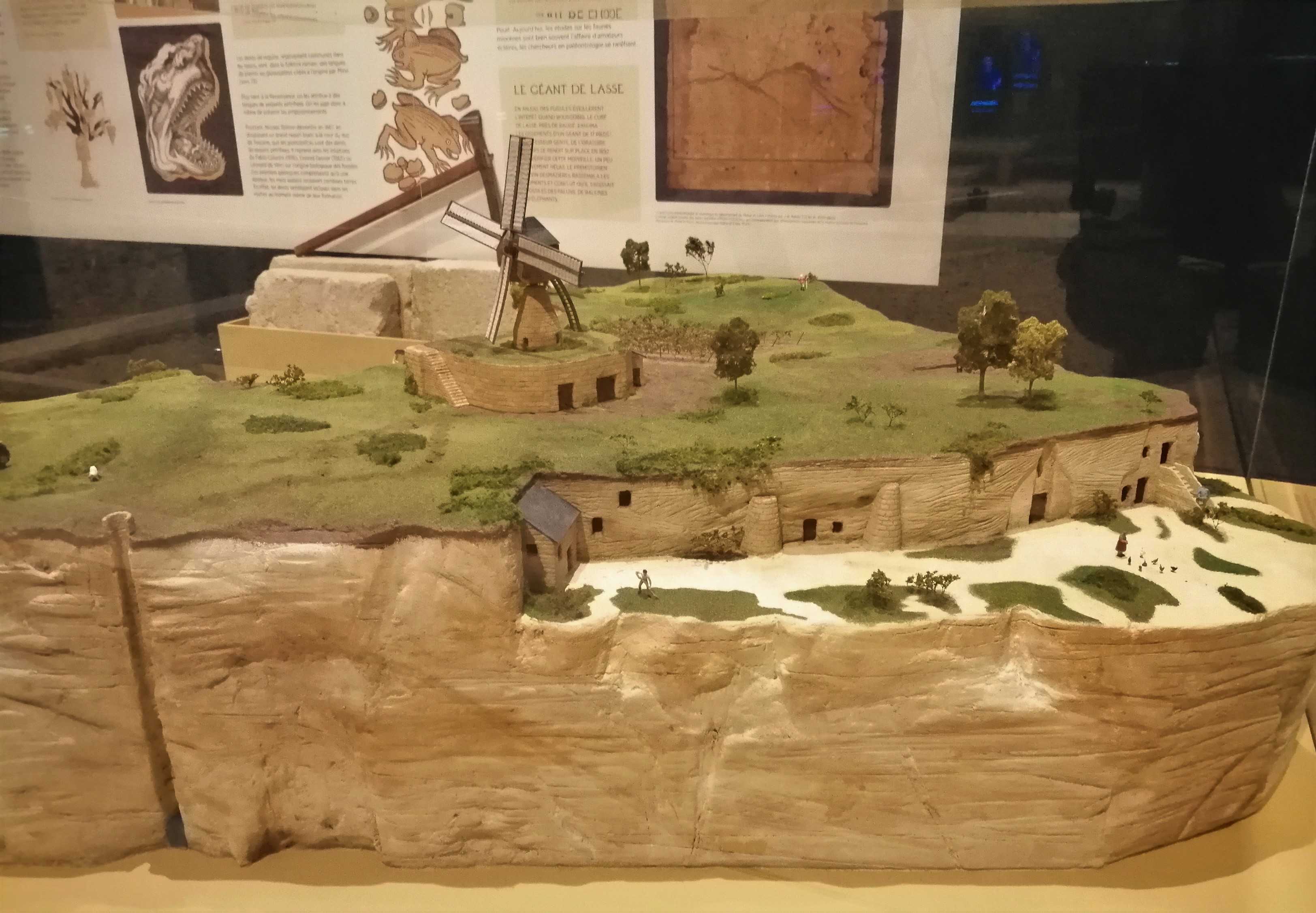
Vue de l’exposition @GM ; [scénographie Raphaël Aubrun, Musées d’Angers]
La dernière séquence, intitulée « les regards sur les faluns », se veut plus intime : si des scientifiques abordent leurs recherches, d’autres professionnelles évoquent leur rapport à la roche. Une table tactile offre une bibliothèque numérique où l’on peut choisir à loisir les entretiens que l’on souhaite voir et aussi un « making-off » du montage de l’exposition qui met en valeur les métiers mobilisés.
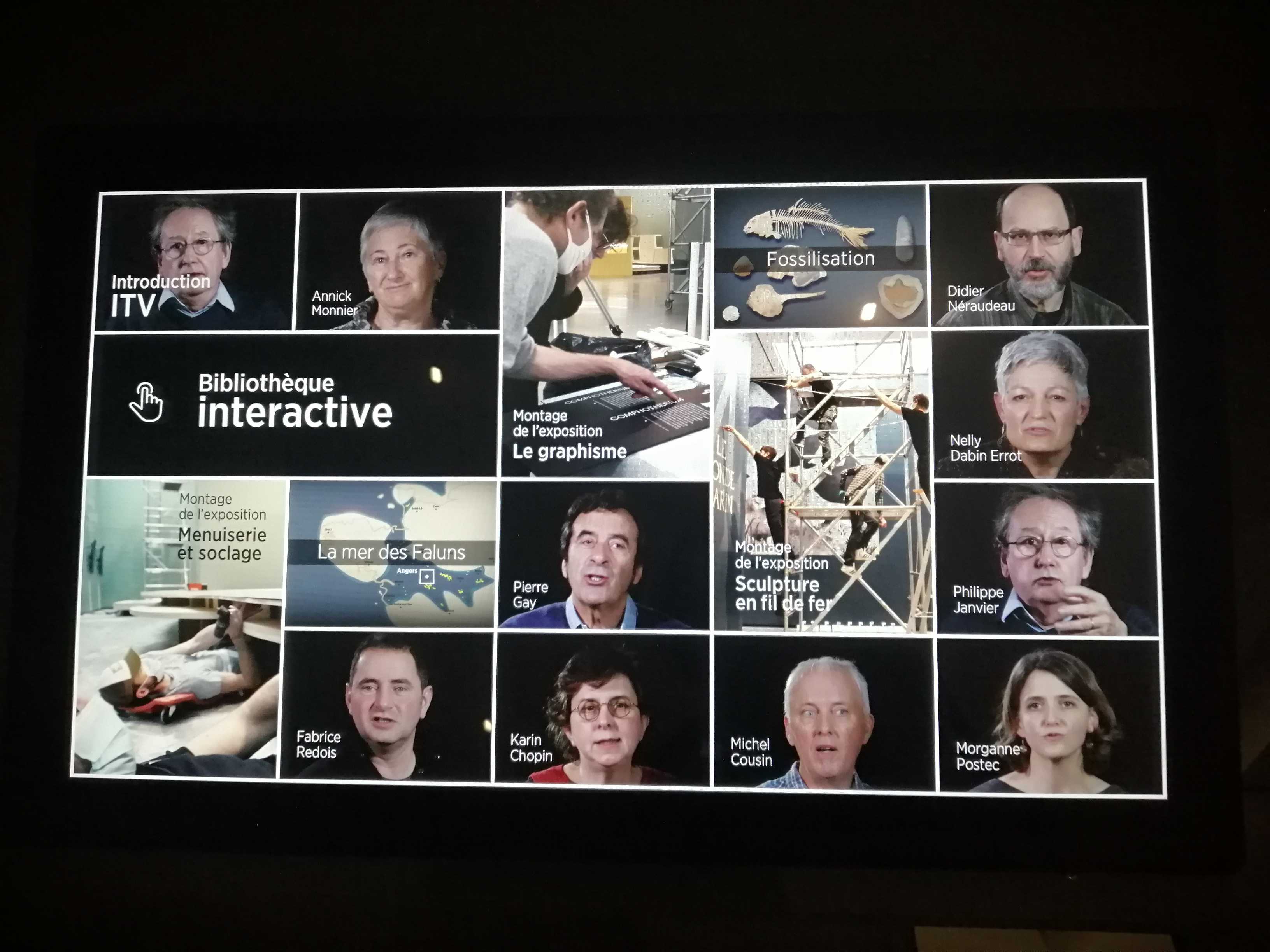
Vue de la bibliothèque interactive – Au temps des faluns ©GM
« Au temps des faluns » est une exposition grand public et pédagogique. La scénographie fluide à la lumière agréable (auxquelles les photographies ci-présentes ne rendent pas hommage) permet de suivre le parcours dans le sens numéroté ou plus librement sans pour autant perdre le message d’ensemble. Les expôts de provenances variées étayent le propos autant qu’ils peuvent intriguer ou émerveiller. Certains niveaux de lecture peuvent satisfaire les visiteuses ou visiteurs aux connaissances scientifiques plus poussées tout en restant accessibles à tous les publics.
Les dispositifs de médiation (numériques ou de manipulations) équilibrent l’ensemble et permettent une position plus active dans le parcours.
Je regrette seulement le manque de propos sur la paléobotanique ou la flore de la région au Miocène ou bien une mise en perspective Sciences et Arts que l’on pourrait attendre pour une exposition scientifique dans un musée d’arts.
L’exposition se prolonge également dans le site troglodyte des Perrières à Doué en Anjou avec une installation son et lumières intitulée « Le Mystère des Faluns ».
Bien plus qu’un caillou qui s’effrite, le falun est un témoin d’un temps pas si lointain à l’échelle de la Terre dont des fragments nous sont présentés au Musée des Beaux-Arts d’Angers jusqu’au 20 février 2022 !
GM
Pour en savoir plus :
- http://www.musees.angers.fr/expositions/au-temps-des-faluns/index.html
- https://le-mystere-des-faluns.com/exposition-au-temps-des-faluns/
#Faluns#Angers#Sciences
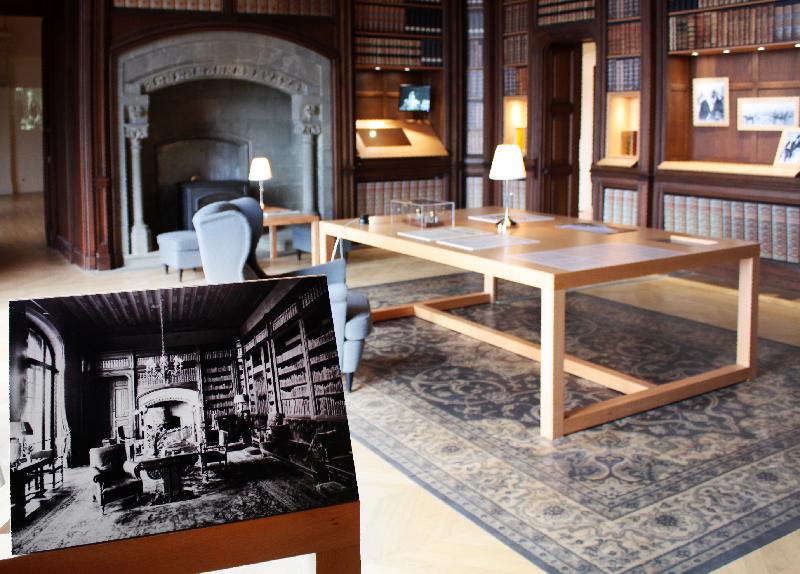
Bâtir un rêve ou comment évoquer ce qui a disparu
Le château © Cdp29
Depuis 2016, l’exposition permanente Bâtir un rêve permet de découvrir l’intérieur du château, sur les traces de James de Kerjégu. Seuls le rez-de-chaussée et le premier étage sont accessibles. La scénographie proposée par l'Atelier KLOUM évoque la grandeur du château au temps de James de Kerjégu. Ne vous attendez pas à trouver des salles richement décorées, entièrement fournies en mobiliers : la plupart ont disparu lors de la Seconde Guerre mondiale. L’évocation se fait par des objets ou du mobilier symbolique, quelques décors en citation, comme dans la bibliothèque où un tapis est reproduit et des rangées de livres factices couvrent les étagères.
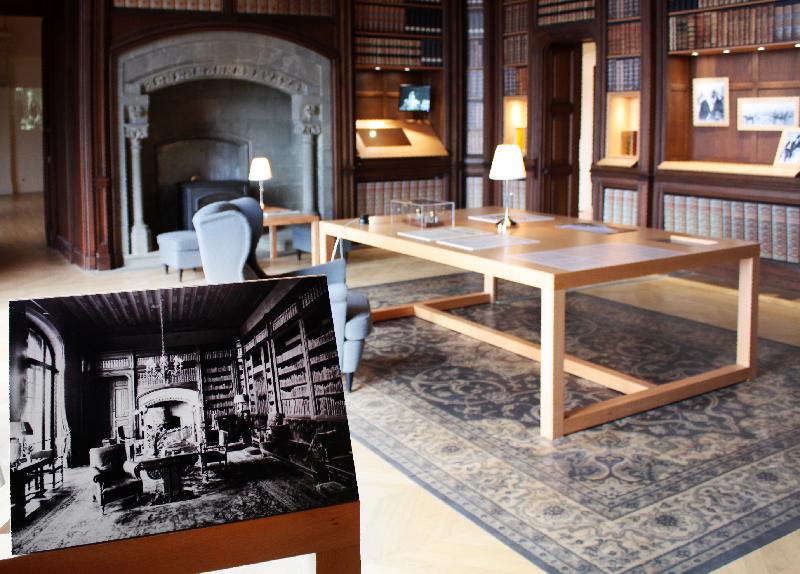
La bibliothèque © Atelier KLOUM
Il est impossible pour le visiteur de croire que ce qu’il voit est la vérité, des pupitres judicieusement placés révèlent l’intérieur de la demeure de James de Kerjégu. Ça et là, des audiovisuels nous racontent James de Kerjégu, la vie pendant la Belle Époque, la construction de Trévarez.
Dans la salle à manger, on se retrouve dans la peau d’un invité : faîtes le tour de la table, prenez place… Vous ne savez pas quels couverts utiliser ? Appuyez sur les boutons pour connaître la réponse ! Les dispositifs interactifs parsemés sur le parcours de visite illustrent les codes de l’époque, de la présence discrète des domestiques au luxe des appartements.

La salle à manger © Atelier KLOUM
A l’étage, une ouverture judicieusement placée nous dévoile les “piscines” réservées aux invités, des baignoires démesurées. Peu meublées, les salles n’en sont pas moins animées : quelques notes de musique, des extraits de films et de nombreuses conversations ponctuent le parcours.

Le grand salon © J. Lagny
Le “clou du spectacle” se situe là où on l’attend le moins : dans la pièce la plus abîmée, le grand salon. Le plafond n’existe plus, il n’y a qu’un trou béant qui permet de voir les étages supérieurs. Le sol est neuf, c’est une chape de béton. Mais, même abîmés, les murs sont de toute beauté. L’emprunt d’une tablette numérique permet de les voir reconstitués grâce à la réalité augmentée.
https://www.youtube.com/watch?v=fULTEp0ZXvE © Artefacto
Actuellement en phase de travaux, les appartements de James de Kerjégu sont en cours de reconstitution. Une partie du mobilier d’origine a été sauvegardée (lit et boiseries), mais quel sera le traitement du reste ? Comment distinguer l’authentique?

Chambre de James de Kerjégu vers 1910 © Cdp29

Vue de la chambre, Atelier d’architectes du patrimoine Le Bris – Vermeersch © Cdp29
Le concept scénographique de citation choisi par l’Atelier KLOUM rend tout à fait justice au lieu. Grâce à l’évocation par la reproduction factice (tapis, livres) ou par le mobilier contemporain empruntant à l’esthétique de celui du XIXème siècle, la scénographie ne tombe pas dans le piège de la reconstitution qu’on pourrait attendre d’un tel lieu. Les pièces dénudées laissent le visiteur imaginer la splendeur passée du lieu, grâce aux vestiges et au discret mobilier. Bâtir un rêve transmet si bien l’ambiance du château de Trévarez au début du XXème siècle, de manière efficace mais sans manquer de poésie.
J. Lagny
#domainedetrévarez
#epcccheminsdupatrimoineenfinistère
#patrimoine
#belleépoque
Pour en savoir plus :
EPCC Chemins du patrimoine en Finistère - Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
02 98 26 82 79
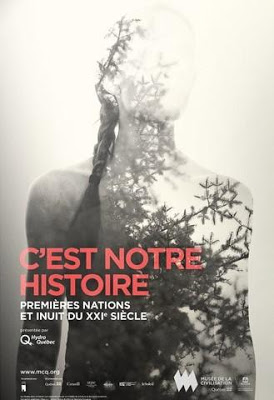
C'est notre histoire !
C’est notre histoire, Premières Nations et Inuit du XXIe siècle, ce titre de l’exposition permanente du Musée de la civilisation de Québec sur les Autochtones du Québec est lourd de sens. Il porte haut et fort que l’histoire des Premières Nations et des Inuit est celle, certes des Autochtones du Québec, mais aussi de tous les Québécois. L’exposition raconte l’histoire des peuples autochtones du Québec, plus de 12 000 ans, elle aborde l’histoire coloniale française et anglaise. Elle explique comment l’histoire partagée entre Européens et Autochtones a transformé les modes de vies et les cultures traditionnelles. Elle montre également comment ces peuples vivent aujourd’hui, les traditions qu’ils ont su sauvegarder et développer. Enfin, elle présente les enjeux sociaux et politiques liés à la décolonisation. L’exposition repose avant tout sur la parole de différents Autochtones, des téléphones rouges disséminés dans la salle permettent de faire entendre leurs voix sur les différents événements. Des vidéos d’interview accompagnent le visiteur et des œuvres d’art contemporain transmettent autrement leurs récits. La force de cette exposition repose sur le fait qu’elle a été créée en collaboration avec les principaux concernés. Une grande importance a été accordée à la parole des nombreux participants autochtones au processus de création.
Affiche de l’exposition C’est notre histoire © Musée de la civilisation
C'est notre histoire et le Temps des Québécois
Le Temps des Québécois, l’autre exposition de référence du musée, qui vient de se refaire une petite beauté, parle du Québec depuis les premières nations jusqu’aux enjeux de notre monde contemporain. Elle s’appuie essentiellement sur une muséographie d’objets mettant en valeur les artefacts faisant du sens pour les Québécois.
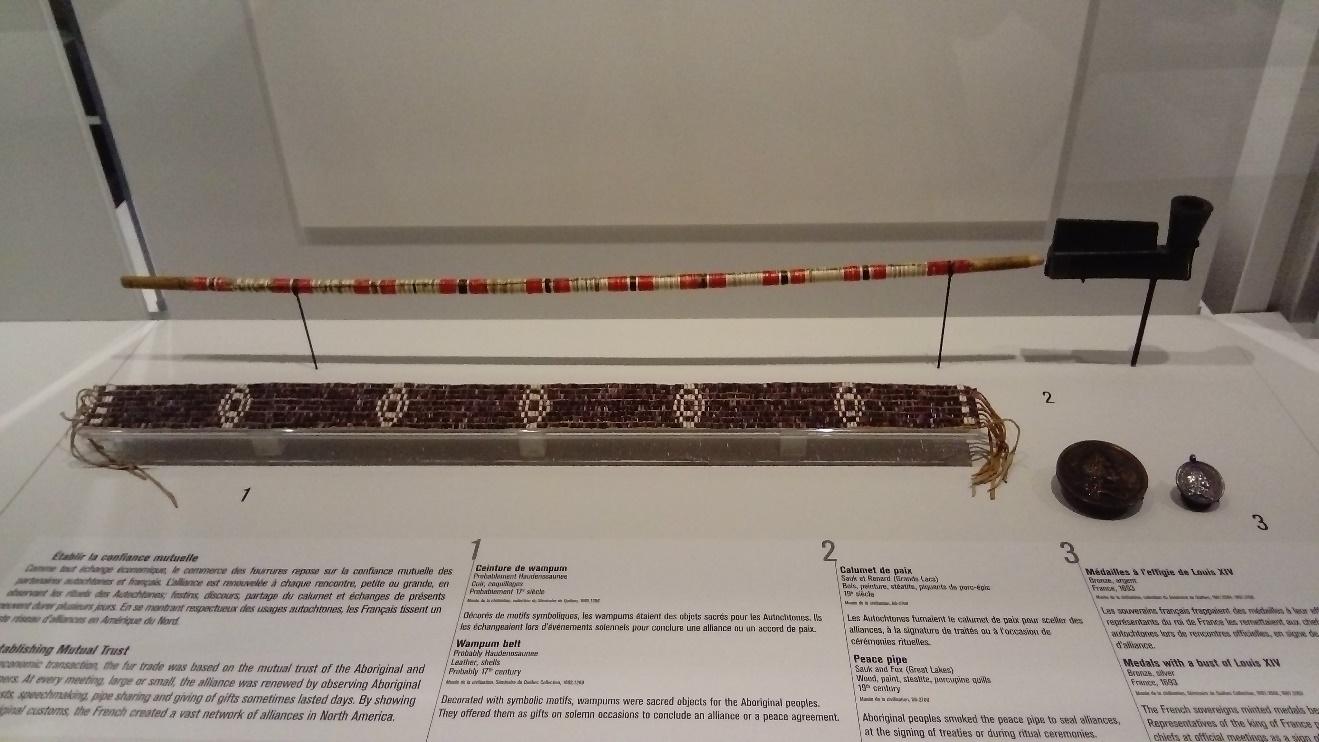
Objets de premières nations et de colons français dans la même vitrine dans l’exposition Le temps des Québécois © O. de Souza
En visitant ces expositions, j’ai réalisé que je ne connaissais pratiquement rien de ces histoires. En France, à l’occasion de la visite de l’exposition Nunavik En terre inuit, j’avais déjà constaté mes lacunes à propos de cette histoire, mais au Musée de la civilisation j’ai pu prendre l’ampleur de ces dernières. Me demandant si je n’avais pas été attentive durant mon secondaire, j’ai décidé de mener l’enquête autour de moi. Commençant par interroger mon colocataire, français aussi, celui-ci m’avoue qu’il ne savait même pas qu’il y avait des Premières Nations à Québec. Je demande alors à ma sœur de chercher dans ces manuels scolaires si elle trouve quelque chose : aucune trace de notre lien avec le Québec. Elle va alors interroger son professeur d’histoire au lycée, celle-ci lui explique que ce n’est pas au programme, mais qu’il arrive que cette histoire soit évoquée à titre d’exemple. Puis elle me rapporte la parole de son amie qui adore le Québec, mais qui pensait que le français y était parlé à cause d’une immense vague d’immigration (certes, on pourrait parler d’une immigration colonisatrice). Je mesure donc que ces lacunes concernent d’autres Français.
Chaque année, des milliers de Français partent au Québec, cette province est vue comme un eldorado, un morceau du rêve américain sans barrière de la langue. Et pourtant on s’attarde rarement sur le fait que ce pays est francophone, car nous l’avons colonisé dès 1534, que des guerres avec les peuples autochtones ont éclaté et que nous avons détruit une grande partie de leur population, de leur civilisation. Cela n'a rien d'étonnant si on nous appelle « maudits Français », on ne connaît pas notre histoire commune, on ne fait pas l’effort de se souvenir de notre lien avec ce pays, ce qu’on y a fait. Et pourtant l’histoire du Québec c’est aussi une partie de l’histoire de France.
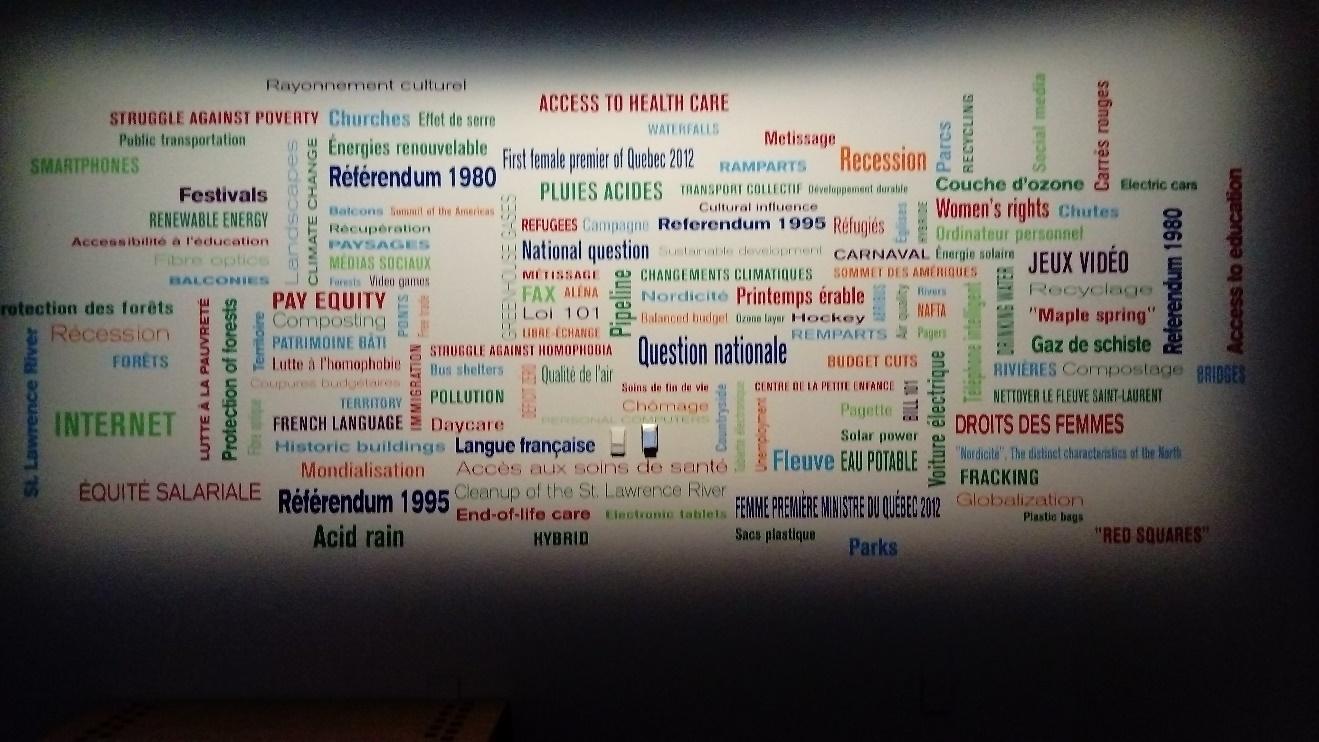
Nuage de mots à la fin de l’exposition Le temps des Québécois répondant à la question : « Le Québec contemporain c’est… » © O. de Souza
Je n’ai pas la prétention de chercher des réponses pour savoir pourquoi cette histoire est « oubliée » ni de débattre sur les enjeux de la réappropriation et la revendication de cette histoire. Je ne parlerai pas de la complexité à comprendre ce récit qui concerne plusieurs nations, plusieurs cultures, il n’est pas bilatéral comme les habituelles histoires de colonialisme. Pour rendre compte de toutes les complexités, c’est à un autre exercice littéraire qu’il faudrait s’atteler : une thèse!
Néanmoins, n’oublions pas : C’est notre histoire.
Océane De Souza
#Québec
#Expositions
#Histoire
- Pour en savoir plus sur cette histoire des premières nations : https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1307460755710/1307460872523
- Pour en savoir plus sur l’histoire du Québec :http://www.histoireduquebec.ca/
- http://www.cieq.ca/
- http://www.biographi.ca/fr/special_top100_fr.html
- Pour visiter le musée de la civilisation et ses expositions : https://www.mcq.org/fr/?gclid=CjwKCAjwu4_JBRBpEiwATmPGp0GMzFNVf6my21wI7909kHDzuoCKzYlQA6RWb2JoyBSJMH8STmO6hRoCX8cQAvD_BwE

Carrière Wellington : une rénovation express
Le 9 avril 1917, plus de 20 000 soldats se préparent pour la Bataille d’Arras, la plus grande attaque surprise de la première guerre mondiale. 7 jours avant la bataille, les soldats britanniques se sont terrés dans les carrières de la ville, aménagées par des tunneliers néo-zélandais pendant 6 mois. Ces carrières du Moyen-Âge se trouvaient sur le front pendant la première guerre mondiale. A 5h30 du matin, les soldats sortent des souterrains pour surprendre les positions allemandes.
Inaugurée le 1er mars 2008, la Carrière Wellington - Mémorial de la Bataille d’Arras, a pour objectif de mettre en avant la stratégie militaire, l’engagement des alliés et la Bataille d’Arras. Cette carrière, comme les autres de la ville, a servi au Moyen-Âge à extraire la craie pour construire Arras. Elle deviendra par la suite un quartier général allié pendant la Première Guerre mondiale et un refuge pour les Arrageois pendant la Seconde.
Après 13 ans d'ouverture, le mobilier a vieilli et le public a changé : de moins en moins de visiteurs anglophones et davantage de public plus local. De plus, depuis 2018, le nombre de visiteurs est de 80 000, pour une capacité de 60 000 visiteurs par an.
Une plongée historique
Le scénario emmène les visiteurs de l’arrivée des Néo-Zélandais à Arras jusqu’au départ des soldats pour la bataille d’Artois le 9 avril 1917 à 5h30.
C’est à côté de l’accueil, dans la salle d’exposition temporaire, que la visite guidée de 1h30 commence. Chaque visiteur est équipé d’un casque de sécurité sur le modèle du casque brodie britannique. Il est assez lourd, ce qui peut devenir gênant en fin de visite, mais le dispositif est original. Audioguide en poche, les visiteurs écoutent le guide décrivant le déroulement de la bataille d’Arras et surtout la place importante des tunneliers néo-zélandais. La visite se poursuit par un ascenseur vitré descendant à 20 mètres sous terre.
Muni d’une tablette, le guide contrôle chaque effet, animation et audiovisuel, ce qui permet, en théorie, d’aller à la vitesse du groupe. La visite commence avec les explications du guide sur des cartes et des costumes afin de bien comprendre le contexte géographique et militaire. Grâce aux explications du guide et de l’audioguide, le visiteur apprend que 500 tunneliers néo-zélandais se relayaient jour et nuit pour relier les carrières sur 19 kilomètres pendant 6 mois. De grandes images et vidéos de témoignages projetées contre la craie accompagnent la visite jusqu’au jour J de la bataille. Devant un escalier menant à la sortie du souterrain, une vidéo se déclenche montrant les ombres des soldats attendant l'assaut. 5h30, une explosion retentit, les ombres s’élancent vers la sortie, sans promesse de retour. En remontant à la surface, les visiteurs se rendent dans une salle de projection pour visionner un film qui reprend les informations de la visite. Tous les mémoriaux de Hauts-de-France leur sont alors montrés, ce qui complète la visite.
Sur les pas des soldats : scénographie et muséographie
La scénographie est très sobre, des modules blancs et vitrés, des projections de cartes, des vidéos, des vitrines tables exposant des objets et des tenues de soldat. Une discrète frise chronologique entoure la salle.
L’ascenseur qui descend par un ancien puits d'extraction est vitré, des lumières éclairent les parois rocheuses. En sortant, les visiteurs marchent sur des passerelles en bois sous plus de 4 mètres de plafond. Beaucoup de jeux de lumière accompagnent et plongent le visiteur dans une visite à la lueur de la bougie. A cela s'ajoutent des bruitages en haut-parleurs et dans les écouteurs pendant la marche ainsi que des musiques que chantaient les Anglais avant la bataille.

Projections murales ©M.T
Le principe d’avoir un guide qui explique et des audiovisuels qui complètent par des témoignages permet de structurer le discours. Malheureusement, cette visite apporte tellement d’informations qu’il est difficile de toutes les assimiler.
A la fin de la visite, le visiteur a la possibilité de retourner dans la salle permanente. Une zone m’a particulièrement interpellée : selfie point. Après avoir découvert que près de 150 000 soldats anglais sont morts, disparus ou blessés, vous pouvez vous prendre en selfie avec un casque militaire devant ces fameuses marches. Cet emplacement est-il le meilleur choix ? Le selfie a-t-il sa place dans un mémorial ? Pour accompagner ce dispositif, un cartel explique la présence d’un studio photographique, l’un des plus prisés d’Arras pendant la Grande Guerre où de nombreux soldats se sont rendus.
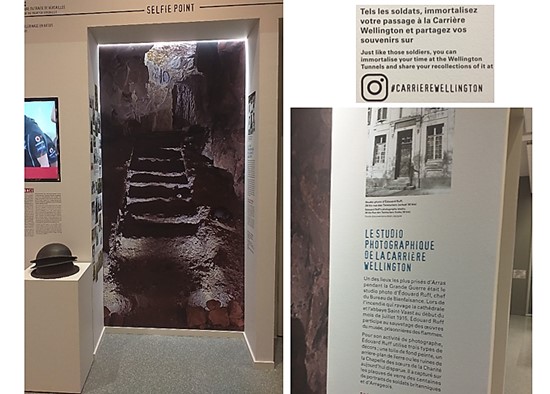
Selfie point ©M.T
Les travaux ont duré 3 mois pendant lesquels la Fabrique Créative avec Henri Joaquin (scénographe) et Ubiscène avec Michel Kouklia (Assistance à maître d’ouvrage) sont intervenus sur toute la partie du site ouverte au public. Le coût des travaux de scénographie s’élève à 1,2 million d’euros.
La rénovation, avant/après
Pour cette rénovation, le musée a voulu remettre le visiteur au centre. La réflexion sur le changement du public en est une preuve, il faut adapter le discours aux francophones sans délaisser les anglo-saxons. La première grande nouveauté est l’accueil, complètement repensé, composé d’une boutique et d’une salle d’exposition permanente et gratuite pour comprendre l’histoire, c’est d’ailleurs là que commence la visite guidée.
Petite remarque sur la boutique, le visiteur est obligé de la traverser pour accéder à la salle d’exposition, des modules d’exposition sont présents parmi les goodies, ce qui incite le visiteur à s’y attarder.
Mélanie TERRIERE
Pour aller plus loin :
- Site internet de la Carrière Wellington : https://www.carrierewellington.com/
#premièreguerremondiale #mémorial #rénovation

Carte Postale du Familistère
Le Palais Social ou Familistère imaginé par Jean-Baptiste Godin se trouve dans la petite ville de Guise, dans l’Aisne. C’est une ville typique du nord, rues sinueuses et maisons en briques rouges. Les rues sont calmes en ce samedi ensoleillé, seuls quelques badauds profitent des derniers rayons automnaux. Sur une immense place minérale se dresse le Palais et plusieurs bâtiments connexes. Je devine une intense activité passée. La ville, au plus haut de sa démographie, comptait 8000 habitants, dont 1750 personnes vivant au Familistère.
Je profite de la nuance si particulière des briques rouges au soleil, puis m’engage dans le premier bâtiment, à l’époque un économat. Aujourd’hui c’est un parcours muséal composé de documents d’archives, de maquettes de la ville et du lieu, et de vidéos documentaires sur l’usine Godin actuellement. Un guide-coférencier suivi par un petit groupe pointe de son laser les différentes parties du bâtiment, je saisi quelques bribes d’informations. « Godin refusait le travail des enfants et a ouvert une école mixte et laïque en 1862 ainsi qu’une nourricière pour permettre aux femmes de travailler tout en ayant des enfants », « le Familistère est construit d’après les plans du Phalanstère de Fourrier ».
Je ne m’attarde pas et pénètre dans le bâtiment de résidence central que Godin, dans une volonté de repenser le travail et la vie en société, a fait construire en premier. Son idée était que tous les moyens possibles devaient être mis en oeuvre pour provoquer les changement sociaux voulus, l’architecture en étant un. Le palais social est donc conçu comme une espace pour inviter les gens à se côtoyer et à se connaitre.
« La régulation du comportement se fait par la pression du regard »Godin
Le familistère est un ensemble d’appartements sur 5 étages, construits autour d’un atrium central, par lequel tout à chacun doit passer pour entrer ou sortir du Familistère. L’atrium est couvert d’une verrière, et au moins une fenêtre par appartement donne sur l’intérieur de la cour. Chacun peut observer l’intérieur de son voisin. C’est d’ailleurs le sujet de vives critiques dès sa construction : Emile Zola note cette transparence comme un défaut qui interdit toute solitude ou intimité, même familiale, c’est une une privation de libertés.

Espace intérieur © Tiphaine Stainmesse
Godin avait bien conscience que cette configuration poussait les habitants à « bien se tenir », mais selon lui le grand bouleversement était que ce sont les membres du familistère qui se surveillent les uns les autres, pas de gardien ou de surveillant ici.
Je poursuis ma visite et entre dans les appartements. Le premier est une reconstitution façon période room d’un logement type avant la fermeture en 1968.
Vue d’un intérieur d’appartement © TC
Le mobilier exposé est celui utilisé par les habitants, restauré puis réinstallé à l’identique. J’y découvre le système de chauffage qui utilise la chaleur dégagée par les machineries de l’usine pour chauffer les appartements et l’eau, un procédé de récupération étonnament écolo pour l’époque.
La culture comme facteur d’enrichissement
Je passe ensuite à la salle de projection, appelée l’Epicerie d’après son ancien rôle au sein du Palais, elle sert également d’auditorium. Espace moderne, acoustique de qualité, fauteuils moelleux. La vidéo présentée suit un artiste photographe, Gaël Clariana, invité pour immortaliser le familistère avant la rénovation de la troisième et dernière unité d’habitation. Son exposition Paysages Intérieurs s’est tenue en 2014 au Familistère. Une succession de plans fixes montre des appartements quittés à la va vite, des objets du quotidien, des peluches, des meubles… Il est facile de s’imaginer le quotidien des familles ayant vécu ici. C’est un documentaire silencieux mais plein d’émotions, j’en suis à confondre ces lieux avec ces villes fantômes, figées, pendules arrêtés (vous pouvez retrouver la bande annonce du film ici).
Je continue ma promenade au travers d’appartements reconvertis en espaces d’exposition de l’entreprise Godin, affiches publicitaires de l’époque vantant la qualité du chauffage en fonte, célèbres poêles, objets produits dans l’usine. Je passe.
Puis je pénètre dans la Fabrique des utopies, une salle qui regroupe et présente des essais de fonte d’une société nouvelle à travers le monde depuis 1880. Matériel numérique, galerie d’objets, c’est un voyage à travers le temps et l’espace, où l’on découvre les théories socialistes - notamment celles de Fourrier - anarchistes, hippies, en Europe, en Amérique et aussi en Asie. Microcommunautés ou grands villages, certaines sont même encore en activité.

La buanderie © TC
La piscine avec fond modulable © TC
Godin, dans ses conceptions, envisageait à raison la culture comme un facteur d’enrichissement et d’émancipation. Il a donc non seulement construit des habitations, mais aussi des espaces culturels comme le théâtre.
Je poursuis en découvrant la buanderie et la piscine. Godin voulait permettre aux habitants d’apprendre à nager mais aussi leur inculquer des notions d’hygiène.
D’ailleurs, il n’y avait pas l’eau courante directement dans les appartements, il fallait se rendre dans le couloir. Cela permettait un contrôle de l’hygiène au sein de la communauté, et également de pousser les habitants à se rencontrer. Dans ma grande naïveté, j’espérais que la piscine soit toujours en fonctionnement, mais un complexe aquatique existant dans la ville, la municipalité n’y a probablement pas vu d’utilité.
Un lieu toujours actif culturellement
Le familistère est également un lieu d’exposition d’art contemporain : trois espaces de 130 m2 chacun situés dans le pavillon central. Le familistère organise des résidences d’artistes. Les thématiques exploitées ont toujours, de près ou de loin, à voir avec les sujet abordés par cette expérimentation sociale, l’architecture et l’urbanisme, l’histoire sociale, le patrimoine industriel, l’écologie. J’ai pu y découvrir un exposition d’Olivier Darné et de son collectif le Parti Poétique. L’artiste utilise un médium pour le moins étonnant : l’abeille. Plusieurs ruches ont été installées dans les jardins du familistère, mais aussi dans une chambre inoccupée rebaptisée pour l’occasion chambre de pollinisation. L’analogie est simple mais efficace. Les bien nommées ouvrières ont été installées au printemps 2018 et un miel du Familistère a été produit. Je découvre des ruches artisanales prêtées par le Musée de la vie rurale et forestière de Saint-Michel-en-Thiérache. Un peu plus loin, c’est une colonie d’enfumoirs qui sont présentés, une bombe d’aérosol insecticide cachée parmi eux. On se trouve à mi-chemin entre l’art contemporain et l’exposition de la tradition apicultrice.
Le Théâtre © TC
Le théâtre, lui, est toujours en activité. Il propose une programmation variée, de l’opéra au one man show, en passant par du rock. En moyenne se sont deux à trois spectacles par mois qui sont présentés. Et cela fonctionne, les habitants sont au rendez-vous et sont bien contents de cette vie culturelle animée pour leur ville de 5000 habitants.
Il est en outre intéressant de noter que quelques personnes vivent toujours au familistère, ceux ayant refusé de quitter les lieux. Et le nombre d’habitants va augmenter, deux projets distincts sont en cours de réalisation : l’un envisageant la réhabilitation de 70 logements pour le proposer à la location avec des espaces de vie collectifs ; l’ouverture d’un espace hôtelier pour tous qui serait accessible pour les étudiants, les familles, les séminaires… Une façon de continuer à faire exister le Familistère comme un espace de vie.
Si les habitants du familistère sont presque tous partis, le lieu, lui, vit toujours, et son avenir est assuré à la fois par la qualité des équipements culturels et par les habitations en cours de rénovation. Une visite qui vaut le détour.
Tiphaine Stainmesse
#familistère
#palaissocial
#fouriérisme

Ceci n'est pas qu'un musée !
La sémantique du MuCEM (1) : le cas singulier d'un carrefour des polysémies (2)
© Agathe Gadenne
Comment appréhender un nouvel espace muséal avant d'y entrer ? Àpartir des noms qui lui ont été donnés. Les mots sont importants comme nous le rappelle Pierre Tavanien, militant engagé pour la défense des libertés publiques : « vivre dans l'omission de cette évidence laisse la voie libre aux plus lourds stéréotypes, amalgames, sophismes et présupposés ». La sémantique vient à notre secours à travers la chasse aux signifiés. Elle nous permet d’éclaircir les rapports de sens parmi les polysémies du MuCEM,en particulier ce que la Galerie de la Méditerranée cache derrière son moucharabieh. Nous attirons l'attention notamment sur l'usage des mots #galerie #méditerranée #genre dans l'espace public de cet établissement.
Le musée-galerie
Crédits : Anaïs Dondez

La galerie pédologique. Toutefois comme dans un luxueux centre commercial les visiteurs comprennent vite le cadre général tout en ayant des difficultés à repérer l'organisation interne des différents grands thèmes. Aussi, l’enchaînement des sous-parties n’étant pas explicites, c'est aux visiteurs d’établir des connexions entre les artefacts et leurs significations. Prenons la deuxième salle par exemple consacrée aux religions de la Méditerranée : les visiteurs y jouent le rôle de trait d'union entre les différents objets qui évoquent les lieux, les pratiques et les croyances des trois confessions pour découvrir finalement qu'elles sont faites de la même matière. La galerie, elle-même, devient alors le sédiment où les visiteurs tracent leur chemin sémantique comme dans une taupinière.
La galerie théâtrale. La Galerie devient également un espace théâtral quand nous faisons référence à la mise en scène des collections. Nous devons à Adeline Rispal l’ambiance permettant aux visiteurs de s’immerger dès leur premier pas. La scénographie évocatrice fait tout d’abord référence au paysage méditerranéen : aux terrasses à travers des îlots en bois, puis à la douceur du climat à travers la transparence des voiles. Les visiteurs sont comme placés aux balcons d'une salle de théâtre et peuvent sentir cette mise en espace discrète en prenant de la hauteur.
Un Musée méditerranée
Le Mucem a pour vocation de vouloir exposer des collections représentatives d'un espace culturel international, voir intercontinental : la Méditerranée. Mais quelles sont ses frontières de significations finalement ?
Un musée départemental de la Méditerranée. La Méditerranée était un département français lors du premier empire. Le Mucem étend son champ culturel aux limites qui correspondent au bassin méditerranéen. Dans la troisième partie les visiteurs deviennent citoyens de la Méditerranée, un message les invite à s'attacher à l'ensemble des peuples méditerranéens et à refuser les frontières nationales.
Un musée-berceau. Par ailleurs si les visiteurs regardent la Galerie avec une approche civilisationnelle, ils se sentiront prendre part à la riche histoire des régions du pourtour méditerranéen : le sud de l'Europe, le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. A l’exception de certaines anomalies géographiques pouvant troubler les visiteurs, comme par exemple la statuette préhistorique de l'homme-lion d'origine allemande, le reste de la Galerie montre les richesses du bassin méditerranéen et conduit à se sentir tous partie d’une même oliveraie autour de ce bassin miniature qu’est la Galerie.
Une mer pour tous. La Méditerranée est une mer située entre l’Afrique, l’Asie et l'Europe. Elle est la véritable scénographie de la Galerie qui le visiteur aperçoit au delà des lourds rideaux, la Grande Bleue où les collections se situent idéalement. C’est un fort appel qui dirige le regard de l’observateur de l’objet vers l’extérieur et qui l’englobe dans une étreinte maternelle. Il s’agit d’un aller-retour qui influence l’état d'esprit et l'appréhension des visiteurs.
Un musée hors genre
Quel genre de Musée ? Le terme 'genre' est redéfini au Mucem. Sa définition est remise en cause indirectement dans chaque brique de cet établissement. Classé comme musée des civilisations, il trouve dans ce statut l’inspiration pour oser une exposition comme Bazar du Genre et déclenche un débat sur l'amplitude de ce terme. Bien que temporaire, cette exposition pourrait s'élever au rang de manifestodu lieu qui l'accueille au profit du visiteur quidans un seul endroit se retrouve dans un musée d'histoire (des derniers 10.000 ans), d'archéologie (la culture matérielle est représentée et contextualisée), d’ethnographie (les différentes traditions de boulangerie de la Méditerranée par exemple), d'histoire naturelle (pingouins, blés, oliviers), et enfin de société.
Quel genre de collections ? La Galerie héberge un ensemble d'objets ayant normalement la même origine, la Méditerranée, mais pas nécessairement le même statut. Installations d'art contemporain, objets de tradition populaire ou liturgique, spécimens naturalistes, céramiques, vidéos, vestiges, tableaux, tout cet ensemble coexiste dans un même espace. Les visiteurs retrouvent ces objets liés par un discours qui précède la collection. Finalement la collection du Mucem devient une collection de discours autour de l'homme et de la méditerranée.
Quel genre de public ? Le public qui franchit la porte du Mucem est très divers : jeunes, adultes, familles, scolaires, retraités, salariés, chômeurs, cadres. Toutefois ce n'est pas cette hétérogénéité démographique et sociale qui révèle le succès du musée. Non, il faut voir ailleurs, parmi les nombreux signes et codes de vêtements que nous portons tous. Alors nous pouvons peut-être apercevoir des personnes moins familières de ces lieux. Par exemple des dames voilées que visitent ce musée "d'occident", où elles se reconnaissent dans cette histoire et y trouvent leur place.
Ilario de BIASE
(1) Je tiens à remercier AnaïsDondez et Daniel Bonifacio pour leurs relectures.
(2) La polysémie est la qualité d'un mot ou d'une expression qui a deux, voire plusieurs sens différents (Wikipedia).
#Mucem
#Galerie de la Méditerranée
#genre
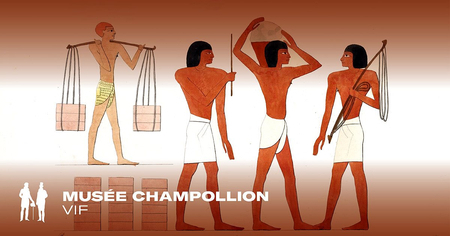
Chroniques d’une ouverture : le Musée Champollion à Vif
Épisode 1 : annonces
Dans le prolongement de la rue commerçante de Vif, petite commune du Sud-Grenoblois, on trouve un bâtiment 19ème avec un mur aveugle où apparaissaient, encore il y a peu, des hiéroglyphes. Non loin de là, sur la petite Place des onze Otages la pizzéria s’est appelée, un temps, le Kheops. Puis les propriétaires ont changé, le nom à consonance égyptienne du restaurant aussi. Parfois, les locaux désignent la bâtisse comme « le Musée Champollion ». Certains se souviennent l’avoir visité en famille, un dimanche après-midi. Les plus jeunes se rappellent seulement les jardins, une grande étendue verte où stylo bille dans une main, réglette pochoir dans l’autre, ils s’étaient appliqués à tracer leurs prénoms en symboles égyptiens.
C’était il y 15 ans, en 2004. La maison du frère de Jean-François Champollion - Jacques-Joseph, également intellectuel de renom et archéologue - ouvrait temporairement au public à l’occasion de la tenue à Grenoble du Congrès international des Égyptologues. Le domaine composé d’une maison bourgeoise, de dépendances et d’un vaste parc de 2,5 hectares ainsi que le fonds familial des frères Champollion avaient étés acquis par le Département de l’Isère trois ans plus tôt, en 2001. La collectivité s’était alors engagée, conformément aux vœux des descendants de Jacques-Joseph, à rendre ce patrimoine accessible à un très large public.
Le parcours de visite installé dans la maison familiale en 2004 rencontra d’ailleurs un franc succès : la bâtisse accueille 45 000 visiteurs malgré des horaires réduits et une jauge limitée. Déjà, une équipe scientifique départementale s’attèle à l’étude des collections et à l’écriture d’un premier projet scientifique et culturel (PSC). Le document vient légitimer le projet de valoriser le fonds Champollion au sein d’un nouvel espace muséal, à créer.
Fin 2016, Jean-Pierre Barbier, président du Département de l’Isère annonce la création d’un musée dans le domaine « Les Champollion ». Il deviendra le onzième musée du réseau départemental. Des articles paraissent alors dans la presse : « Dans trois ans, Vif aura son Musée Champollion », titre le dauphine.com le 4 mars 2017. La visite sur site de Jean-Pierre Barbier, en novembre 2018 donne un nouveau regain journalistique au projet, puis la présentation du chantier en mai 2019 à l’occasion d’un évènement de préfiguration permet au grand public de découvrir l’avancée des travaux.
A l’occasion d’une exposition pédagogique pour présenter le projet, le Musée Champollion communique quelques précisions budgétaires et scientifiques que la presse locale relaye avec intérêt. Le Département de l’Isère investit 4,6 millions d’euros dans le projet de rénovation ; l’État et la Ville de Vif participent au montage financier. Un investissement qui en vaut la peine selon la direction de la Culture et du Patrimoine du Département, qui mise sur une fréquentation de 50 000 visiteurs par an. La présentation des collections – près de 500 pièces de mobilier, textiles, peintures et arts graphique – mettra en valeur les deux frères Champollion et leurs activités de recherche à l’origine d’une nouvelle discipline, l’égyptologie. Le parcours permanent cherchera un équilibre entre des espaces reconstitués et une muséographie contemporaine dédiée. Un programme prometteur pour un pari de taille : innover sur un sujet attendu et apprécié du grand public. Affaire à suivre […].
C.R
Photographie introductive : Le Domaine « Les Champollion » dans lequel sera installé le futur musée © Musée CHAMPOLLION / Denis Vinçon
#MuséeChampollion
#Égypte
#Ouverture

Cités millénaires, comment évoquer ce qui disparaît ?
Il y a quelque temps, j’ai eu la chance de visiter l’exposition « Cités millénaires. Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul », visible du 10 octobre au 17 février 2019 à l’Institut du Monde Arabe à Paris. À grand renfort d’outils numériques performants, l’IMA en partenariat avec l’Unesco a fait revivre Mossoul, Alep, Leptis Magna et enfin Palmyre. Ces villes et sites, tous classés au patrimoine culturel mondial de l’humanité sont le symbole d’une histoire vieille de plusieurs siècles, mais également l’emblème de la lutte contre l’État islamique.
Cette exposition qui proposait une expérience innovante et immersive qui contraignait le visiteur à s’interroger sur la notion de re-constructionet sur ce qui vient Après le déluge.
Grâce à l’acquisition de données multiples, il est possible de restituer, par le biais d’images, les formes architecturales, les différentes phases de transformation ou de destruction. À partir des restitutions, il est possible d’envisager une reconstruction : « Construction d’un édifice ou d'un ensemble d'édifices en totalité ou en partie, dans le respect ou non de la forme initiale, après qu'ils aient été détruits ou fortement endommagés. Une reconstruction peut inclure des opérations de reconstitution »[1]. La reconstitution est quant à elle invérifiable, « elle sort donc du champ strict de la science pour aller vers celui de la création artistique ou de la fiction. »[2].
Une exposition singulière
Une fois les quatre sites localisés grâce à la carte et une brève introduction rappelant que le patrimoine présenté dans l’exposition est « l’emblème d’un passé adoré par les uns, haï par les autres. », le visiteur pénètre dans la salle consacrée à Mossoul, à la scénographie surprenante et spectaculaire.
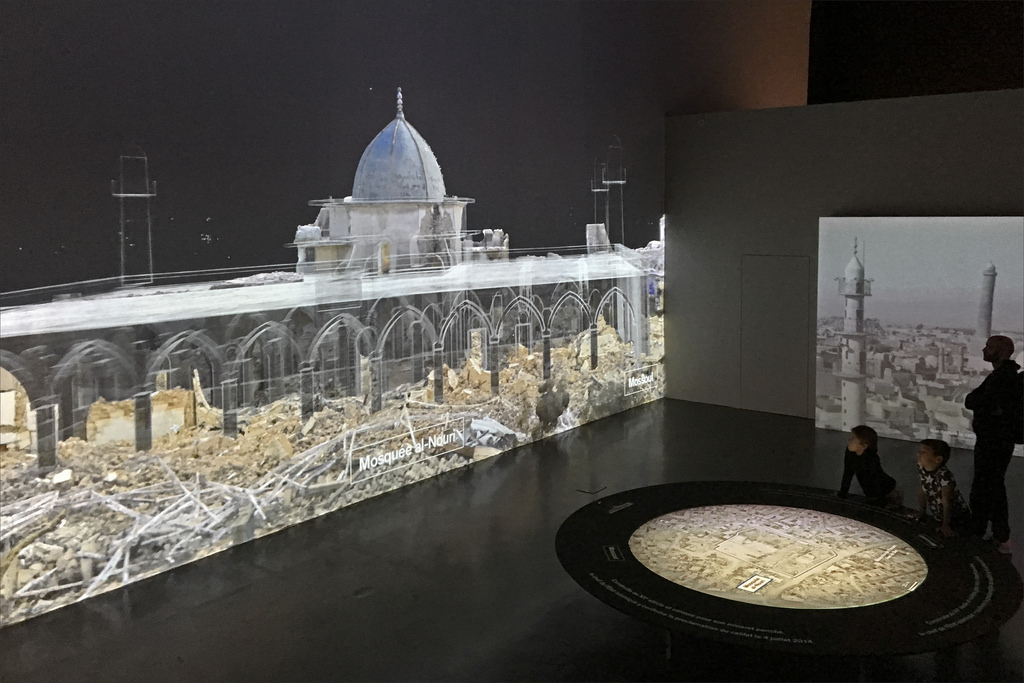
Salle consacrée à la ville de Mossoul en Irak, projection de la restitution 3D de la mosquée al-Nouri © Jean-Pierre Dalbéra
La société Iconem, qui a pour mission de « contribuer à la conservation de ces endroits menacés en les numérisant pour l’exploration et l’étude, aujourd’hui et demain. », a réalisé les images projetées grâce à des prises de vue par drones, qu’elles soient aériennes ou au ras du sol.
L’exposition est extrêmement bien rythmée, chaque section du parcours se fait sur le même modèle :
- Un écran géant dévoilant des images 3D de lieux éventrés, vides d’habitants et dépourvus de couleur. Les images actuelles de destruction et de désolation laissent ensuite place à l’ancienne armature des bâtiments détruits.
- Une table circulaire situe géographiquement les lieux présentés et affiche des citations.
- D’anciennes photographies en noir et blanc des lieux sont projetées, datant principalement du 20ème siècle.
- Des focus vidéos sur d’anciens habitants et des professionnels qui témoignent face caméra donnent corps aux civils qui se battent pour sauver leur civilisation à travers la sauvegarde du patrimoine. Ainsi, des visages remplacent l’habituel sanglant anonymat des guerres.
- En dehors de ces grands espaces, de petites pièces où sont projetés des films sur différents thèmes ponctuent le parcours et complètent l’exploration. Elles peuvent accueillir une dizaine de personnes maximum. Ce système d’alcôves, même s’il favorise isolement et recueillement fonctionne bien lorsqu’il n’y a pas de foule. Autrement, il devient assez difficile d’y accéder, le confort de vision n’est pas assuré, d’autant plus que personne n’est chargé de la régulation des flux.
Au sein de ce parcours, aucun objet patrimonial n’est exposé. Entre chaque section des citations peintes sur des mûrs jaunes, qu’elles soient littéraires, religieuses ou savantes rappellent l’importance des lieux évoqués et de leur histoire. Hormis cela, il y a très peu de texte.
Personnellement, l’émotion était au rendez-vous même si davantage de médiation aurait été bienvenue. Les « tables de médiation dynamiques »[3] présentes au centre de chaque espace et auxquelles il ne faut pas toucher auraient gagné à être interactives. Ce sont elles qui apportent le contenu relatif à ce qui est projeté sur grand écran.
Utilisation réussie du numérique
À la fin du parcours, juste avant la conclusion, le visiteur est invité à mettre un casque de réalité virtuelle et à explorer pendant quelques minutes six lieux présents dans le parcours. Insérer de la réalité virtuelle permet de faire venir du public et surtout de l’élargir d’autant plus que l’IMA a beaucoup joué sur la côte d’Ubisoft, créateur d’Assassin’s creed en proposant notamment des nocturnes de l’exposition où il est possible de tester plusieurs jeux d’Ubisoft (à partir de 12 ans). Ce type de dispositif est assez rarement proposé compte tenu de son coût d’installation et d’entretien, ce qui participe à l’attractivité de l’exposition. Trois personnes s’occupaient d’installer les casques et de réguler la file d’attente d’environ trente minutes mais n’avaient pas forcément le temps de répondre aux questions des curieux ne connaissant pas nécessairement le concept. Enfants comme personnes âgées se prennent au jeu et l’expérience semble remporter un grand succès. C’est un partenariat bienheureux entre Ubisoft, géant du jeu vidéo, l’IMA et Iconem. Au-delà de la performance technologique, c’est intéressant pour le visiteur de pouvoir voir « de l’intérieur » les lieux qu’il a pu observer auparavant dans le parcours. Le fait que cette « activité » soit purement contemplative ne m’a pas dérangée. Cela permet de prendre la mesure de la nécessaire sauvegarde du patrimoine de l’humanité, à la fois fragile et invariable.
« Un acte de résistance contre la barbarie »[4]
La résistance se voit principalement à travers les témoignages des civils qui sont essentiels et jalonnent le parcours de l’exposition. Greetings from Aleppo de Issa Touma est à mon sens la vidéo la plus émouvante de l’exposition. Elle donne à voir pendant 17 minutes le quotidien dans une ville à feu à sang, l’adaptation puis la résilience des habitants.

Captures d’écran de la bande annonce disponible sur © www.film-documentaire.fr
Les personnes interrogées dans le cadre des focus vidéos présents à chaque étape, que ce soit de simples civils ou des professionnels des musées, témoignent de l’importance de la culture et du patrimoine dans la construction d’une civilisation. Certains d’entre eux évoquent le possible développement du tourisme ultérieur.

Capture d’écran des vidéos présentes en salles, visibles sur YouTube © IMA
Faut-il reconstruire le patrimoine détruit ?
Au-delà de l’aspect spectaculaire de l’exposition, deux questions sont posées : faut-il reconstruire le patrimoine détruit ? Comment prendre soin du patrimoine qui reste ?
Traditionnellement, les professionnels des musées sont opposés aux reconstructions au risque de lisser l’histoire en même temps que le patrimoine. Pour beaucoup, les cicatrices sont essentielles à la compréhension de l’histoire d’un lieu. Mais, nous pouvons légitimement nous poser la question de ce qu’il convient de faire lorsque les cicatrices elles-mêmes s’abiment sous l’effet du temps. De plus, l’un des risques encourus est la récupération politique de la reconstruction. Il n’empêche qu’après les nombreuses attaques des extrémistes contre le patrimoine, il semblerait que l’UNESCO et le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) soient davantage favorables à la reconstruction[5]. En 2017, le Comité du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO a pris des décisions concernant le « patrimoine mondial en péril » et les possibles reconstructions des monuments détruits que ce soit à cause de catastrophes naturelles, à cause d’attaques terroristes ou encore à cause de négligences etc. Elle a notamment pris en compte que la reconstruction peut servir à la régénération d’une nation et ainsi lui permettre de regagner une identité dissoute. Pour la reconstruction, la documentation est primordiale, afin de limiter la part d’interprétation. C’est pourquoi le travail entrepris par la société Iconem est très important. La reproduction à l’identique est impossible, puisque les conditions de réalisations sont très différentes. Il ne s’agit pas de faire des répliques, ni des « Disneyland »[6] figés dans le seul but d’attirer des touristes. Le terme Disneyland est employé par Michel Al-Maqdissi, interrogé par l’IMA sur la reconstruction de Palmyre, et dont le témoignage est visible au sein de l’exposition. Il affirme également « Comment voulez-vous qu’un monument qui a été explosé à ses bases et qui est devenu pratiquement de la poussière, comment voulez-vous reconstruire ce bâtiment ? ». Selon lui, « Faire visiter le site avec la destruction actuelle, c’est envisageable, on peut associer cette visite à des écrans (…) où on présente l’état avec la destruction en 3D ça pourrait être une option. ». Chaque cas est unique, il faut prendre en compte la variété des situations. Par exemple à Alep, qui a été détruite à près de 45%, la reconstruction du souk est envisagée car elle est constitutive de l’identité des habitants, commercer a une valeur culturelle mais aussi cultuelle. Lorsque le souk a été détruit, c’est également un patrimoine immatériel qui l’a été, celui qui liait commerçants et clients. Leptis Magna est assez particulière à cet égard car elle n’a pas fait l’objet de destruction pour le moment malgré sept années de guerre. Mais, compte tenu de la situation chaotique, de nombreuses dégradations ont été constatées dû à un manque d’entretien.
Cette très belle exposition pose plus de questions qu’elle n’en résout mais encourage aussi une prise de conscience des enjeux de la conservation et de la valeur mémorielle de la reconstruction.
Armelle Girard
#PatrimoineEnDanger
#InstitutDuMondeArabe
#Ubisoft
Pour aller plus loin :
- Conférence « Le monument et son double : peut-on reconstruire à l’identique ? », Julien Bastoen et Frédéric Didier, Cours public de l’école de Chaillot :https://www.dailymotion.com/video/x6jmkkl.
- Article de Christina Cameron « Faut-il reconstruire le patrimoine ? » : https://fr.unesco.org/courier/2017-juillet-septembre/faut-il-reconstruire-patrimoine
Pour en savoir plus :
https://www.imarabe.org/fr/expositions/cites-millenaires
[1] http://www.culture.gouv.fr/content/download/52715/409376/file/2012-022_Glossaire_termes_MH.pdf.
[2] https://raan.hypotheses.org/files/2018/06/Introduction-A_Badiepublication2.pdf
[3] C’est comme cela qu’elles sont présentées dans l’article de Franceinter consacré à l’exposition : https://www.franceinter.fr/culture/cites-millenaires-voyage-virtuel-de-palmyre-a-mossoul-du-10-oct-18-au-10-fev-19-a-l-institut-du-monde-arabe
[4] Dixit Emmanuel Macron lors de l’inauguration le 16 octobre 2018.
[5] https://fr.unesco.org/courier/2017-juillet-septembre/faut-il-reconstruire-patrimoine

Conversation: Une étrange défaite ? Mai-juin 1940
Le 25 février 2021, la conservatrice du Musée des Troupes de montagne et son équipe se sont rendues au Centre d’Histoire de la Résistance de la Déportation (CHRD) à Lyon afin de découvrir l’exposition Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 https://www.chrd.lyon.fr/chrd/edito-musee/exposition-temporaire-une-etrange-defaite pour laquelle le musée était un des prêteurs. Charlène Paris, chargée d’étude à la conservation des collections, échange avec Céline Boullet, actuellement chargée de régie des collections, qui a travaillé en tant que stagiaire sur l’exposition.

Céline et Charlène. Céline présente le livre de l’exposition Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 © Musée des Troupes de montagne
À quelle référence renvoie le titre Mai-juin 1940. Une étrange défaite ? De quoi traite l’exposition ?
Le titre de l'exposition est une citation de l’essai L’Étrange Défaite, rédigé de juillet à septembre 1940 par Marc Bloch. L’ouvrage, aux éditions Franc-Tireur, est publié pour la première fois en 1946, deux ans après l’assassinat de Marc Bloch par la Gestapo. Ce témoignage direct de la Seconde Guerre mondiale, par un officier et historien, a été une source d’inspiration afin de comprendre les raisons de la défaite française. Le point d’interrogation du titre donne le ton de l’exposition. Il s’agit de questionner la défaite de 1940 au sein des mémoires collectives. Tout au long de l’exposition, le visiteur est plongé dans un contexte de mythes et de contre-mythes. Il s’agit de déconstruire l’idée de la supériorité allemande, notamment en termes d’équipements et d’uniformes.
Comment s’articule le parcours et les thèmes de l’exposition ?
L’entrée en matière de l’exposition dans le hall d’entrée est un appel au temporaire marqué par un side-car motif camouflage et l’affiche du film La Bataille de France - titre en écho à Marc Bloch - de 1964. Puis, deux tenues militaires armées ouvrent le parcours situé au sous-sol. La re-contextualisation donne d’emblée le ton : la défaite s’explique par une mauvaise gestion politique liée au commandement et non par un souci matériel. L’affiche du film La 7ème compagnie, de 1973, incarne l’image d’un soldat gentillet mais peu débrouillard ; or, les soldats n’ont cessé de se battre pour défendre la France. Le parcours propose différents niveaux de lecture, dont un fil conducteur visuel sous forme de Bande Dessinée. L’image de la défaite est interrogée au travers de cinq grands thèmes : les forces en présence et son état des lieux, la drôle de guerre, le temps des combats, les séquences politiques et le sort des populations civiles.

Équipements et uniformes prêtés par le Musée de l’Armée, Paris https://www.musee-armee.fr/accueil.html © Musée des Troupes de montagne
Parlez-nous de la scénographie. Quel est le parti pris? Quelles ont été vos missions ?
La scénographie a été élaborée par l’agence L+M, localisée à Villeurbanne (69), composée de Louise Cunin, scénographe et Mahé Chemelle, graphiste. En tant que chargée d’exposition et de production pour la préparation de l'exposition j’ai pu assister aux réunions de scénographie et graphisme. L’idée principale était de baser la scénographie sur le mot débâcle, mot associé à la période mai-juin 1940, dont le sens renvoie à la “dislocation des glaces”. De grandes tables regroupant différents thèmes ont été créées. Elles évoquent les tables stratégiques militaires, rectilignes et ordonnées. En ce qui concerne mes missions, je me suis occupée de la relation avec les prêteurs : des constats d’états, des fiches d’assurances, du convoiement. J’ai également travaillé sur la relecture des textes scientifiques de l’exposition et du catalogue. Malgré la crise sanitaire, j’ai assisté à toute la mise en place de l’exposition, de la présentation de la première phase muséographique/scénographique en février 2020 à l’inauguration de l’exposition le 23 septembre 2020.
Les tables positionnées de manière dynamique et les couleurs évoquent l’esthétique du mouvement De Stijl, pouvez-vous nous en dire plus ?
Le visiteur choisit son parcours selon les points de vue qu’il souhaite découvrir. Trois couleurs ont été choisies afin de les différencier : le jaune pour le militaire, le bleu pour le politique, le rouge pour les populations civiles. Cette gamme chromatique permet alors d’entrecroiser les points de vue, les événements clefs et de rappeler le foisonnement d'événements qu’il y a eu durant cette courte période. Le visiteur déambule au centre d’un vide structuré par des tables « états-majors ».

Salle de l’exposition Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 © Musée des Troupes de montagne
Pourquoi avoir choisi un béret alpin et des raquettes dans les collections du Musée des Troupes de montagne pour cette exposition ?
Lors de la mise en place du processus de création de l’exposition, nous avons voulu mettre en avant les troupes de montagnes “armée invaincue” dans deux parties de l’exposition. Nous nous sommes alors entretenues avec le commandant Aude Piernas, conservatrice du musée des Troupes de montagne, avec qui nous avons travaillé pour le prêt d’objets issus des collections du musée. Ces deux pièces clefs incarnent deux sous-thématiques : les premiers combats avec Narvik et Namsos de l’Armée des Alpes. Elles sont également des témoignages en termes d’équipements techniques historiques de l’équipement du soldat de montagne. Les raquettes Narvik sont à redécouvrir dans l’exposition Armée des Alpes, Armées Invaincues https://www.museedestroupesdemontagne.fr/armeesdesalpes/ .

Raquettes du Musée des Troupes de montagne © Musée des Troupes de montagne
Trois points de vue, trois couleurs : le jaune pour le militaire, le bleu pour le politique, le rouge pour les populations civiles.
Et vous Charlène, pouvez-vous nous faire vos retours, impression sur l’exposition ?
Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 est l’occasion de découvrir ou redécouvrir l'œuvre citoyenne L’étrange défaite de Marc Bloch devenue un texte de référence. Le visiteur devient, tel l’historien capitaine engagé volontaire, témoin face à la débâcle de l’armée française. Mais surtout, il est amené à un examen de conscience, inséparable de son contexte. La faillite est d’ordre intellectuel et moral. Le dogmatisme est aveuglant, ce qui amène le Blitzkrieg (la guerre éclaire) combiné à l’esprit de renoncement, à une situation catastrophique. L’exposition est sous le niveau de la terre, comme le manuscrit qui a pu être sauvé parce qu’il avait été enterré par son ami clermontois : je trouve la métaphore intéressante. L’histoire immédiate et ses niveaux de lecture par couleurs montrent des mondes qui se côtoient mais ne se rencontrent pas forcément pour finalement causer des dommages collatéraux - on le voit bien avec l’extrait du film Jeux interdits de 1952-, en cela la disposition spatiale de la grande salle est efficace. J’aime beaucoup les choix muséographiques, comme celui de l’huile sur papier du musée de la Cavalerie de Saumur https://www.musee-cavalerie.fr La charge à la horgne du peintre de la Marine Albert Brenet. Avec son cartel, on comprend combien il est important de lire et décrypter les images, surtout lorsqu’elles relèvent de commandes et de légendes. Le fait que le parcours se termine par une étagère de livres est une idée originale, incitant le lecteur à poursuivre ses recherches sur cette période.
Charlène Paris
#àlarencontredesprofessionels:laformationMEMenlive
#histoire-mémoire
#brèvesd’apprentissage
#patrimoine-société
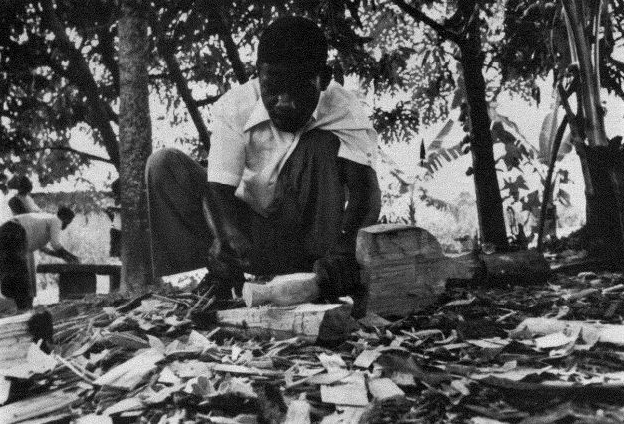
D'un masque à l'autre
L’« authenticité » dans les sculptures africaines : Le cas de la statuaire africaine subsaharienne
« Il n’y a peut-être pas d’autre art que l’Européen aborde avec autant de méfiance que l’art africain… »[1]
La question qui guida la rédaction de cet article fut toute simple : étant moi-même amateur de sculptures africaines, particulièrement de sculpture sur bois (masques et statuettes), je me suis interrogé sur l’« authenticité » des sculptures africaines aujourd’hui présentées au sein de collections muséales ? En effet, une statue ou bien une toile d’un artiste occidental est « authentique » ou non, et en ce cas, elle est une « copie » ou bien un « faux ». Mais est-ce aussi évident en ce qui concerne les sculptures africaines, pour lesquelles, souvent, la datation, la nature et la provenance d’acquisition restent floues sur les cartels de certains musées ?
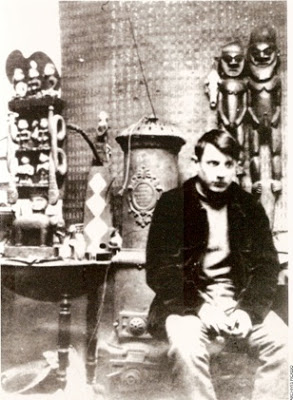 Petit retour historique ! Au début du XXe siècle, l’on sait que c’est principalement grâce aux artistes expressionnistes, primitivistes, fauvistes ou bien encore cubistes (Picasso, Braque, Brancusi, Matisse, Léger, etc.) que les sculptures africaines, tantôt classées dans des collections d’archéologie, tantôt classées dans des collections d’histoire naturelle et d’ethnographie, ont été, finalement assez récemment, promues au rang d’œuvres d’art à part entière.
Petit retour historique ! Au début du XXe siècle, l’on sait que c’est principalement grâce aux artistes expressionnistes, primitivistes, fauvistes ou bien encore cubistes (Picasso, Braque, Brancusi, Matisse, Léger, etc.) que les sculptures africaines, tantôt classées dans des collections d’archéologie, tantôt classées dans des collections d’histoire naturelle et d’ethnographie, ont été, finalement assez récemment, promues au rang d’œuvres d’art à part entière.
Pablo Picasso (1881-1973),dans son atelier du Bateau-Lavoir à Paris, v. 1908
© Gelett Burgess, Musée Picasso
Mais par leur ‘redécouverte’, ces artistes européens ont aussi ouvert l’appétit des collectionneurs pour ces créations africaines, en leur faisant découvrir et surtout en leur donnant goût à des représentations somme toute très nouvelles et étrangères dans le paysage artistique occidental, si bien que, très rapidement, se développe, en parallèle, un important commerce de copies et de faux. Non seulement l’envolée des prix sur le marché de l’art, mais aussi la raréfaction grandissante des sculptures africains « authentiques » – raréfaction imputable soit à des disparitions naturelles (l’environnement), soit à des destructions (volontaires, par les populations africaines elles-mêmes, ou forcées, par les missionnaires européens notamment), soit enfin à la colonisation et aux pillages européens –, créées alors un terrain propice pour les faussaires. Se pose dès lors la question de l’« authenticité » des sculptures africaines. Qu’est-ce finalement qu’une sculpture africaine « authentique » ?
Pour bien définir « l’authentique », il nous semble tout d’abord intéressant de parler de pièces « inauthentiques », afin d’isoler deux types de sculptures fabriquées dans le seul but d’être vendues à un public amateur. Premièrement, il y a tout simplement les sculptures « fausses », c’est-à-dire le produit de la fraude, et autrement dit les sculptures africaines fabriquées avec la volonté patente de tromper et de fausser « le jugement porté sur une œuvre » [2]. Une sculpture africaine « fausse » pourrait ainsi se définir comme une création vidée de toute identité, de toute valeur ethnique, puisque crée en tant que produit et mis sur le marché de l’art pour tromper intentionnellement. Et il faut bien avoir à l’esprit qu’un « faux » masque africain, ou qu’une « fausse » statuette africaine, n’est jamais la création d’un faussaire de génie – comme nous pouvons le connaître en Occident avec la figure du faussaire-artiste isolé, tels Han van Meegeren (1889-1947) pour la peinture, André Mailfert (?-?) pour l’ébénisterie, Alceo Dossena (1878-1937) pour la sculpture, etc. –, mais il s’agit au contraire toujours de réseaux de faussaires, que ce soit en Afrique, en Amérique et en Europe, les artisans-faussaires travaillant en atelier, et donc en clandestinité, et presque toujours d’après des photos. Ainsi, c’est en juin 2013 qu’en France le plus grand réseau de faussaires en sculptures africaines a pu être démantelé dans la périphérie parisienne, donnant lieu à 22 interpellations (artisans, intermédiaires, rabatteurs, et galeristes) et plus de 500 « fausses » sculptures saisies (vendues généralement entre 100.000 et 400.000 euros pièce !). Mais alors, me direz-vous, qu’en est-il des sculptures-souvenirs que l’on peut trouver derrière les vitrines des boutiques de la plupart des musées africains ? En effet, au sein d’une boutique de musée, la copie de masques présentés ou non dans le parcours muséal, peut, paradoxalement, trouver toute sa place, comme nous avons pu encore le constater dernièrement dans la boutique d’un musée d’ethnographie, où seul un petit cartel légitime leur présence et, par conséquent, leur commercialisation et leur entrée dans le marché du « faux » :
« Ces masques sont des objets d’artisanat. Malgré leur qualité esthétique, il ne s’agit en aucun cas d’objets d’art issus de collections muséales. Ces masques ont été réalisés par des artistes africains contemporains. »
 Que faut-il en penser ? En quoi ces objets seraient-ils plus légitimes que les produits de la fraude, qui, eux-aussi, sont des « objets d’artisanat » puisque créés par des artisans-faussaires ? Est-ce simplement la traçabilité de la production des dits objets ? Car en dehors du cadre légal de commercialisation, à savoir l’espace boutique d’un musée, la différence une fois acheté, entre un « faux » masque produit de la fraude, et un « faux » masque proposé dans une boutique de musée, est quasi-inexistante…
Que faut-il en penser ? En quoi ces objets seraient-ils plus légitimes que les produits de la fraude, qui, eux-aussi, sont des « objets d’artisanat » puisque créés par des artisans-faussaires ? Est-ce simplement la traçabilité de la production des dits objets ? Car en dehors du cadre légal de commercialisation, à savoir l’espace boutique d’un musée, la différence une fois acheté, entre un « faux » masque produit de la fraude, et un « faux » masque proposé dans une boutique de musée, est quasi-inexistante…
Peigne Ashanti authentique, Bois et pigments (H. 23 cm)
© Coll. privée
Peigne Ashanti faux / Bois et pigments (H. 20 cm) Produit de la fraude, saisi en 2010, détruit
Deuxièmement, à côté de ces « fausses » sculptures contemporaines fabriquées au cours des XXe et – principalement – XXIe siècles pour tromper délibérément (si l’on écarte les « faux » des boutiques de musées) et qui, fort heureusement, n’ont aucune place dans les musées, nous distinguerons les sculptures que l’on peut qualifier de « vraies-fausses » ou « fausses par destination », c’est-à-dire des sculptures, bien plus anciennes collectées en Afrique, qui furent spécialement réalisées pour répondre à une demande coloniale, pour les colons européens qui fréquentèrent les côtes africaines à l’époque moderne ou, plus tard à partir du XIXe siècle, en poste ou de passage dans une colonie. Dans une de ses œuvres majeures, L’Afrique fantôme [1934], l’écrivain, poète, ethnologue et critique d’art français Michel Leiris (1901-1990) décrit justement comment des masques africains furent détournés de leurs utilisations rituelles traditionnelles lors de fêtes villageoises orchestrées par l’administration dans les colonies françaises au début du XXe siècle (pour la fête du 14 juillet par exemple), celle-ci faisant par la suite rapidement rentrer ces objets dans le marché de l’art colonial européen.
Masque-Cimier Ciwara utilisé dans une colonie française,lors des festivités du 14 juillet 1932
© Anonyme, in Derlon, Brigitte, La Passion de l’art primitif, Paris, Gallimard, 2008, p. 283
Mais ces « vraies-fausses » sculptures apparaissent finalement sur les places marchandes européennes dès le XVe siècle, par le biais des premiers contacts entretenus par des armateurs, explorateurs et marchands qui fréquentèrent les côtes subsahariennes du continent africain. Et les exemples sont nombreux : on peut citer, entre autre, l’importante figure du marchand français Jean Barbot (1655-1712) qui écrit, dans son Journal de voyage posthume [1732], avoir spécialement commandé auprès de certaines populations autochtones africaines des sculptures sur bois afin de les exporter ; ou bien encore l’on peut déceler, dans un panneau de retable peint en 1527 par le peintre portugais Lopes Grégório (v. 1490-1550), La Mort de la vierge, la présence d’une de ces fameuses cuillers en ivoire, dites « afro-portugaises » et que les Africains fabriquaient alors spécialement (sur les côtes du Golfe de Guinée) pour répondre à une demande européenne, « hybrides extraordinaires et raffinés, destinés uniquement à la clientèle coloniale »[3] qui, selon l’historienne et ethnologue Jacqueline Delange (1924-1991), s’apparentaient déjà à un véritable « art commercial »[4].
Grégório Lops, Morte da Virgem, huile surchêne, 1527,H.128,5 cm x L. 87 cm, détail © Lisbonne, Museum Nacional de Arte Antiga
Face à cette production de sculptures africaines « fausses par destination » et qui, à partir du milieu du XXe siècle vont véritablement envahir le marché de l’art européen, une réflexion autour de plusieurs critères d’appréciation commence alors à se construire à partir des années 1970-1980, autant chez des conservateurs de musées que chez des marchands et des experts ; critères jugés pertinents pour évaluer, non de l’« originalité » de ces pièces qui, effectivement, sont originales puisque présentant forcément de légères différences entre elles, mais de leur « authenticité ».
Il faut d’abord se méfier du parallèle que nous faisons implicitement, en tant qu’occidentaux, entre l’« ancienneté » d’une pièce et son « authenticité », puisque, en ce qui concerne les arts africains, celle-ci n’a strictement aucun rapport avec sa date de création. Cas assez unique, nous semble-t-il, en histoire de l’art, si nous prenons en exemple les sculptures africaines, nous nous rendons compte finalement qu’une pièce « inauthentique » peut s’avérer être antérieure, plus ancienne, qu’une pièce « authentique », et qu’une pièce « inauthentique » et une autre pièce « authentique » peuvent provenir de la main d’un même artiste. C’est le cas par exemple avec l’artiste gabonais Simon Misère (?-?) qui, dans les années 1970 à Libreville, pouvait tout aussi bien réaliser des sculptures destinées au culte de sa propre communauté (sculptures « authentiques »), que des sculptures « fausses par destination » puisque destinées tout spécialement aux colons européens, soit en travaillant sur commande pour la préparation de festivités coloniales, ou bien en réalisant tout simplement des sculptures de pure décoration ; objets réalisés par un seul et même artiste, avec le même savoir-faire, avec les mêmes matériaux, mais dont la destination finale, l’utilisation, fait toute la différence.
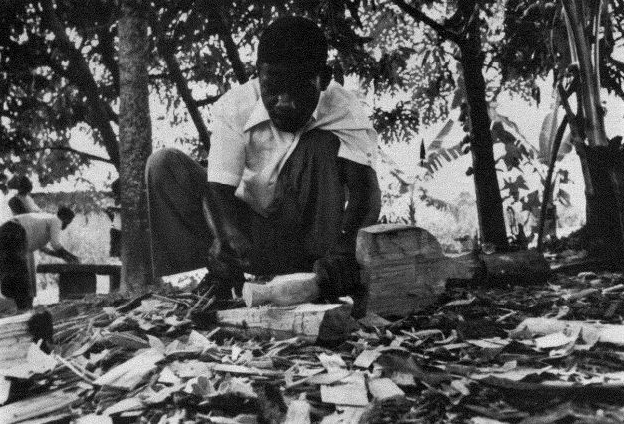
Simon Misère dans son atelier à Libreville (Gabon) dans les années 1970© Réginald Groux
Malheureusement, à défaut d’avoir un œil expert dans le domaine, nous remarquons qu’aujourd’hui encore, dans la grande majorité des musées d’art africain français, les sculptures « vraies-fausses » et celles « authentiques » ne se distinguent pas, puisque les cartels n’explicitent souvent pas le statut, la provenance et les particularités de chacune. Certains musées, tels que les Musées des Beaux-Arts de Grenoble, le Musée des Beaux-Arts d’Angoulême ou encore le Musée des Arts d’Afrique et d’Asie à Vichy, portent au contraire une grande attention à cette question, le cartel de chaque pièce exposée rattachant celle-ci à son contexte de fabrication et d’utilisation originelle, et lui donne une traçabilité visible en mentionnant son origine, si elle provient d’une collecte ou d’une collection particulière, etc. Le Musée de Vichy qui, justement, a organisé l’année dernière son exposition temporaire d’art africain avec pour fil directeur l’interrogation sur ce que furent ces objets dans leurs contextes d’origine, et sur ce qu’ils sont devenus suite aux contacts avec les occidentaux, et surtout sous le regard des occidentaux.
Un des critères fondamentaux de l’« authenticité » dans la sculpture africaine semblerait donc être la non-commercialisation : une sculpture africaine « authentique » n’est exécutée et destinée qu’à l’usage rituel ou fonctionnel de la communauté africaine dont il provient, fabriquée dans un but non lucratif, alors qu’en Occident toutes les formes d’art que nous connaissons sont presque toujours faites d’après une commande et pour être exposées et vendues. Admettons alors qu’une sculpture africaine n’est « authentique » que si elle a été fabriquée pour l’usage auquel elle correspond initialement, si elle est rentrée dans un système symbolique, dans des manifestations rituelles ou domestiques traditionnelles, devant, de fait, présenter une certaine patine d’usage attestant de son vécu. Mais en raison de l’avancée de la colonisation, du XVIe jusqu’au XXe siècle, et de ses effets sur les croyances et les cultures matérielles, le collectionneur et marchand d’art Henri Kamer, président de International Arts Experts Association, propose, dans un essai publié au début des années 1970, de distinguer trois grandes catégories de sculptures africaines pouvant être considérées comme « authentiques »[5] :
- - premièrement, les sculptures « n’ayant subi aucune influence extérieure », considérées comme un « art du début ».
- - deuxièmement, « les objets de la période intermédiaire », sur lesquels on peut constater des influences dues aux « apports étrangers à l’ethnie » (clous de cuivre, verroterie, peinture, etc. d’origine européenne).
- - et enfin, les sculptures de la « troisième période », présentant une influence qui peut-être aussi bien inter-tribale qu’européenne (les représentations de nus qui deviennent de plus en plus rares, par exemple).
Cependant, trente ans après la publication de cet essai, les recherches en histoire de l’art, mais aussi en histoire et en ethnographie, ont considérablement progressé en Afrique, et ce travail d’H. Kamer, bien qu’il fasse toujours référence dans le milieu de l’expertise des sculptures africaines, nous semble aujourd’hui discutable sur plusieurs points. Notamment, et pour ne prendre qu’un exemple assez significatif, cet essai peut être discutable au sujet du statut du créateur, puisqu’à l’époque d’H. Kamer, l’on considérait que le qualificatif d’« artiste » était impropre pour évoquer l’auteur d’une création africaine, mais que ce furent seulement des « artisans » qui exécutaient des commandes, et ce en suivant non leur inspiration propre mais des canons hérités dans leurs communautés ; H. Kamer parle alors, à ce propos, de « spontanéité du geste », et l’on considère, de fait, que les sculptures africaines (rituelles et domestiques) n’ont jamais été conçues en tant qu’œuvre d’art, mais que c’est uniquement le regard de l’amateur européen, éclairé, qui a pu révéler dans ces objets le caractère artistique. Or l’on sait aujourd’hui, grâce à certaines fouilles archéologiques menées en Afrique subsaharienne, qu’à côté des simples artisans, devant réaliser effectivement des objets pour répondre aux demandes de leurs communautés, des artistes ont bien existé en Afrique dès l’époque moderne – si ce n’est même antérieurement –, souvent réputés dans leurs sociétés et rattachés aux cours princières et royales de grands royaumes.
En somme, force nous est de constater que les critères pour déterminer l’« authenticité » d’une sculpture africaine n’ont cessé d’évoluer. Et ces critères montrent véritablement l’évolution du regard sur cet art particulier, « mettant clairement en évidence le fait que l’« authenticité » est un concept finalement assez large qui résulte d’un consensus entre collectionneurs sur l’origine d’un objet, les techniques de sa fabrication et ses usages ; critères qui renvoient implicitement à la construction même de la conception du monde et de la société dans une culture donnée »[6].
« Au sujet de l’art africain, les mots ‘’vrai’’ et ‘’faux’’ sont fréquemment employés comme qualificatifs pour décrire les objets faits au sud du Sahara. Pour moi, les termes ‘’vrai’’ et ‘’faux’’ me semblent être des notions extrêmement floues lorsqu’on parle d’art africain. Un ‘’vrai’’ quoi ? Un ‘’faux’’ quoi ? Ces termes simplistes sont employés pour appréhender un sujet extrêmement complexe. Dire d’un objet africain qu’il n’est pas ‘’vrai’’ signifie probablement ‘’n’ayant jamais été utilisé, ni fait pour être utilisé dans un but spirituel’’, par exemple un objet fait pour être vendu. Etant donné qu’un nombre de plus en plus grand d’objets de ces dernières décennies glissent peu à peu dans cette catégorie, une redéfinition du terme ‘’vrai’’ semble appropriée. Ces objets sont certainement ‘’vrais’’ dans le sens où ils font bien partie de la vie africaine. Certains sont indéniablement l’expression d’une vision individuelle en réponse à une forme sculpturale familière. À quel point un masque ou une statuette sacrée soi-disant ‘’vrais’’ sont-ils ‘’vrais’’ lorsqu’ils ne sont pas utilisés à des fins spirituelles ou cérémonielles ? Lorsqu’ils sont créés pour des festivités coloniales, exposés sous vitrine dans un musée ou accrochés au mur d’une chambre à coucher ?... »
WILSON, Fred (commissaire d’exposition), Cité in Flam, Jack, et Shapiro, Daniel, Western Artists / African Art, New York, Museum for African Art, 1994, p. 97
Pour en savoir plus :
- « Distinction Vrai-Faux : quelques réflexions sur la fabrication de « faux », sur creative-museum.com
- BONNAIN-DULON, Rolande, « ‘’Authenticité’’ et faux dans les Arts premiers », in BÉAUR, Gérard, BONIN, Hubert, LEMERCIER, Claire (dir.), Fraude, contrefaçon et contrebande, de l’Antiquité à nos jours, Genève, Droz, 2006, pp. 183-196
- COULIBALY, Marc, Des masques culturels au masque muséifié : leurs usages et représentations, Binche, Musée international du Carnaval et du Masque, 2014
- DEGLI, Marine, et MAUZÉ, Marie, Arts premiers : le temps de la reconnaissance, Paris, Gallimard, 2000
- DELANGE, Jacqueline, Arts et peuples de l’Afrique noire : introduction à une analyse des créations plastiques, Paris, NRF Gallimard, 1967, p. 209
- DERLON, Brigitte, et JEUDY-BALLINI, Monique, La passion de l’art primitif : enquête sur les collectionneurs, Paris, Gallimard, 2008
- KAMER, Henri, « De l’authenticité des sculptures africaines », in Arts d’Afrique noire, 1974, n°12, pp. 17-40
- LEIRIS, Michel, L’Afrique fantôme, Paris, Gallimard, 1992 [1934]
- MARCOUX, Camille Noé, Objets, de la Côte-de-l’Or à l’Europe des curiosités : échanges et regards (XVIe-XVIIIe siècles), Mémoire de master en Histoire de l’Art, réalisé sous la direction de Mme Catherine Cardinal, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2015
- MARTINEZ, Nadine, La réception des arts dits premiers ou archaïques en France, Paris, L’Harmattan, 2010
- SOMÉ, Roger, Art africain et esthétique occidentale, Paris, L’Harmattan, 1998
# arts premiers# sculptures africaines
# faux / authentiques
[1]EINSTEIN, Carl, La Sculpture nègre,Paris, L’Harmattan, 2002 [1915], p. 43
[2]BONNAIN-DULON, Rolande, « ‘’Authenticité’’ et faux dans les Artspremiers », in Béaur, Gérard, Bonin, Hubert, et Lemercier, Claire (dir.), Fraude, contrefaçon et contrebande, del’Antiquité à nos jours, Genève, Droz, 2006, p. 183
[3]BASSANI, Ezio, « Œuvres d’arts et objets africains dans l’Europe du XVIIesiècle », in Ouvertures sur l’artafricain, Paris, Dapper, 1986, p. 70
[4]DELANGE, Jacqueline, Arts et peuples del’Afrique noire : introduction à une analyse des créations plastiques,Paris, NRF Gallimard, 1967, p. 209
[5]KAMER, Henri, « De l’authenticité des sculptures africaines », in Arts d’Afrique noire, 1974, n°12, pp.17-40
[6]BONNAIN-DULON, Rolande, op. cit., p.189
De bateau-école à bateau-musée : la Duchesse Anne de Dunkerque
Un son de cloche retentit près du musée portuaire de Dunkerque, venant du navire La Duchesse Anne : à son bord, une enfant pleine de joie se rêve matelote, tenant du bout de ses bras la corde d’un gong des mers.
Le bateau-école La Duchesse Anne, devant le Musée Portuaire de Dunkerque, AD
Dès votre montée sur le trois-mâts, vous découvrez les cordages, les filets et tout ce dont un voilier avait besoin pour être manœuvré par plus d’une centaine de paires de bras, poussé à la simple force du vent afin de sillonner les eaux du globe. À vos yeux, le navire semble intact, comme s’il n’avait jamais navigué. Vous êtes sur La Duchesse Anne. Face à vous se dresse le mât principal, vous levez la tête pour apprécier ses 48 mètres de hauteur, mais à peine avez-vous atteint sa fusée que vous entendez un son de cloche provenant du pont supérieur à l’avant. Annoncerait-il le début d’un événement ? Comme une reconstitution de la vie des matelots sur le navire ? Vous vous approchez et voilà que sonne la cloche de nouveau, cette fois suivie d’un rire d’enfant. Lorsque vous l’apercevez, vous voyez une petite fille trônant fièrement au côté de la cloche, face à ses parents immortalisant le moment.
La cloche de quart n’est pas très grande, a fière allure et paraît ancienne. À ses pieds se trouve une corde qui remonte jusqu’au battant. La famille s’en va et deux visiteurs habitués s’approchent, empoignent la corde puis la tirent. Un son agréable et peu commun, mais une pensée vous submerge : « Comment est-ce possible ? Ce bateau fait partie de la collection du musée, c’est un objet patrimonial qu’il faut conserver. A-t-on vraiment le droit de le manipuler ? » Aucune barrière ni aucun panneau pour nous interdire de la toucher. D’ailleurs, vous ne le remarquez que maintenant, mais à l’exception de quelques panneaux narrant l’histoire du navire, il n’y a que très peu d’éléments muséographiques.

Cloche du bateau-école La Duchesse Anne, AD
Le bateau, entièrement rénové, est aujourd’hui un bateau-musée. La cloche est bien d’origine et on peut la manipuler, on y est même invité ! Tout comme plusieurs autres éléments du navire, que vous pourrez découvrir au gré de votre visite.
Le bateau-école
Ce navire a été construit en 1901 dans le chantier de Bremerhaven. Eh oui, à l’origine, c’était un navire allemand, et plus précisément un bateau-école qui servait à la formation des futurs matelots et officiers de la marine marchande jusqu’en 1932. Il s’appelait le Großherzogin Elisabeth. C’est au terme de la Seconde Guerre mondiale qu’il est passé sous pavillon français lorsqu’il a été offert par la Grande-Bretagne en tant que dédommagement de guerre. Depuis, la Marine nationale n’en avait guère l’utilité, à l’exception de quelques fois où il était utilisé comme dortoir pour des casernes ou des colonies de vacances. Petit à petit, il a été délaissé et régulièrement squatté, jusqu’en 1981 où il a été racheté par la ville de Dunkerque pour un franc symbolique.
Cet achat inaugure un nouveau cap pour la vie du navire devenu épave. L’association Les Amis de La Duchesse Anne est fondée pour le rénover entièrement et l’entretenir. Au terme de vingt années de labeur et en l’honneur de son centenaire, la Duchesse Anne devient un bateau-musée, fleuron de la flotte du Musée Portuaire de Dunkerque.
Conserver et exposer un bateau à flot
Avant de monter sur le navire, si vous demandez à l’agent d’accueil ce qui est visitable, il vous répondra : « tout, mais que les quartiers du capitaine sont actuellement fermés au public en raison d’infiltration d’eau ». Un comble pour un bateau. En effet, celui-ci n’a jamais été conçu pour être un lieu de médiation, ni même pour rester indéfiniment à quai. Non pas qu’il serait mieux conservé en mer, mais que son usage obligerait à entretenir et à remplacer ses pièces. Depuis qu’il fait partie des collections du musée, c’est à présent l’établissement et non plus l’association qui en a la charge. Bien qu’il soit régulièrement entretenu aux frais de la communauté urbaine, force est de constater qu’il subit les affres du temps : que la rouille se développe au même titre que la moisissure sur le bois, au point où même la végétation commence à y pénétrer. À noter que cette dernière était inattendue et plaisante à voir sur le pont, d’autant plus qu’elle dénote avec le caractère industriel du port.
Il ne restait pas grand-chose du navire lorsqu’il a été récupéré par Dunkerque : il n’y avait plus de voiles, une ancre manquait, sans compter le mobilier porté disparu, mais il restait la cloche de quart, qui est d’origine et qui n’avait par chance jamais bougé. La manipulation s’oppose sans doute à la conservation, mais quoi de mieux pour le visiteur, voire une cloche derrière une vitrine où la voir en action, ce pour quoi elle a été destinée ? Conserver, ce n’est pas uniquement faire perdurer un objet dans le temps. Conserver un objet c’est aussi conserver son usage. Comme les matelots, sonnons la cloche.

Ancre du bateau-école La Duchesse Anne & végétation sur le pont, AD
Dans la peau des matelots
De bateau-école à bateau-musée, le trois-mâts est un outil pédagogique. Son objectif muséographique est de faire découvrir aux visiteurs la vie des matelots et officiers à bord, en passant par le nettoyage des ponts, l’entretien des voiles, les cours de langue ou encore la cuisine. En dehors des visites guidées, les visiteurs ont à disposition un document-guide qui les conduit dans les différentes parties du navire : c’est lui qui narre l’histoire du bâtiment et le quotidien de ses occupants.
Je m’attendais à des mises en scène afin d’apprécier au mieux le quotidien des marins, mais le navire en était dénué. Il y a bien des tables d’époque, quelques hamacs et l’aménagement sommaire des quartiers des officiers, mais pas plus. Je n’avais que le document-guide, des panneaux et mon imagination pour entrevoir les activités qui s’y tenaient cent ans avant que j’y pose les pieds. Seules les quelques photographies d’époque de l’intérieur du navire permettent de se rendre compte de sa vie passée.

Quartier d'équipage du bateau-école La Duchesse Anne, aujourd'hui et avant, AD
Toutefois, la visite n’en reste pas moins impressionnante pour quiconque rêve un jour de mettre les pieds sur ces voiliers d’antan. La Duchesse Anne possède une histoire très riche, bien mise en avant. Quant à la volonté de nous faire découvrir la vie de ses matelots, c’est une idée développée lors des médiations, mais qui reste timide en visite libre, la faute à une scénographie légère. Aujourd’hui, le navire est toujours ouvert au public, sauf parties fermées dans l’attente d’une prochaine restauration, qui, avec un peu d’espoir et de financement, s’accompagnera d’une scénographie plus ambitieuse.
Antoine Dabé
Pour en savoir plus :
- Daniel Le Corre, Le Trois-mâts « Duchesse-Anne » : Collection Mémoires de nos voiliers, puis collection « Bretagne », Montreuil-Bellay, éditions CMD, 1999
- Jean-Louis Molle, Le Trois-Mâts carré « Duchesse Anne », ex voilier-école allemand « Grossherzogin Elisabeth », Punch Éditions, 1999.
- La Duchesse Anne sur le site de la ville de Dunkerque (ville-dunkerque.fr).
- Viste des bateaux : Duchesse Anne et Sandettié, Spirit of Dunkerque, tourisme et congrès (dunkerque-tourisme.fr).
- Duchesse Anne (trois-mâts carré), Wikipédia (fr.wikipédia.org)
#DuchesseAnne #Dunkerque #MuséeBateau

De la mémoire au patrimoine : les collections agricoles de la Ville de La Courneuve
La Ville de La Courneuve, située en Seine-Saint-Denis dans la très proche banlieue de l’agglomération parisienne, a engagé depuis 2019 un chantier des collections conséquent. Détentrice d’une collection agricole de plusieurs milliers d’objets issue d’un écomusée fermé depuis les années 1990, elle explore des utilisations patrimoniales non muséales pour ces dernières.
Image d’introduction : Vue de la ville de La Courneuve dans les années 1960 © Ville de La Courneuve
Raconter l’histoire du territoire
A l’aube des années 1980, la Ville de La Courneuve engage un processus de reconnaissance et de sauvegarde du patrimoine local. La constitution de ce dernier est l’occasion, pour la municipalité, de proposer une offre culturelle aux habitants mais également de mettre au point un récit de l’histoire locale dépassant les difficultés frappant le territoire, entre désindustrialisation et dégradation des immeubles de la Cité des 4 000 Logements bâtie au début des années 1960.
Ce processus se développe autour de trois thématiques : l’archéologie, le patrimoine bâti et le patrimoine rural, ce dernier témoignant des activités agricoles qui ont fait la gloire du territoire.Au milieu du XIXe siècle, La Courneuve fait, en effet, partie des trois centres principaux pourvoyant la ville de Paris en cultures maraîchères. Situé en plein cœur de la Plaine des Vertus, l’activité agricole se poursuit jusque dans les années 1960 avant de céder la place à l’urbanisation.
C’est ainsi qu’en 1981 une exposition sur l’histoire rurale du territoire est organisée à l’Hôtel de Ville afin de commémorer cet héritage. A la suite de cet évènement, des agriculteurs apportent à la direction des affaires culturelles de la Ville des objets en rapport avec leurs activités professionnelles, ce qui pousse les équipes à engranger la constitution d’une véritable collection ethnographique. En 1983, un « musée des cultures légumières » voit le jour au 11, rue de l’Abreuvoir, une ancienne maison maraichère. Ce musée se transforme progressivement en écomusée où contempler les espaces intérieurs et extérieurs d’une maison de cultivateurs avec ses mobiliers, ses outils, mais aussi des tombereaux et tarares. Cette installation, complétée par le jardin cultivé, crée un îlot de ruralité au cœur de la Ville.

Cour intérieure du musée des cultures légumières au début des années 1990 © Ville de La Courneuve
C’est l’Association Banlieue Nord, mise en place sous l’égide du Maire en 1983, qui est chargée de la gestion du musée et la valorisation de ce patrimoine courneuvien particulier. Ses membres sont notamment chargés de développer des recherches ethnologiques sur ce sujet, ce qui se traduit par un important travail de collecte de témoignages, d’archives et d’éléments patrimoniaux relatifs à l’histoire agricole courneuvienne et, plus largement, régionale, dans une approche comparative et pluridisciplinaire. Le musée rencontre, en 1992 et 1995, un certain succès, notamment auprès des publics scolaires. La mise en place du « Marché au musée », qui se tient deux fois par an sur le site, permet la découverte du musée par un public plus large.
Une impasse muséale
Le musée ferme en 1995, officiellement pour des raisons de sécurité dues au bâtiment. L’arrêt des activités muséales entraîne paradoxalement un accroissement des collections qui sont mises en réserve dans une friche industrielle, dans des conditions de conservation discutables et qui comprennent au début des années 2000 entre 6 000 et 8 000 objets. Dix ans plus tard, une nouvelle estimation indique 25 à 45 000 items. Ce volume finit par constituer une impasse, tout projet de conservation et de valorisation se trouvant contraint par cet excès d’objets.
En 2002, un audit commandé à l’entreprise Option Culture préconise la (re)création d’un structure muséale, portée par d’autres collectivités et dédiée au patrimoine rural régional. Pourtant, le Département et la Région s’opposent à ce projet, et la Ville se voit contrainte de rassembler seule les moyens humains et financiers pour concevoir un projet patrimonial cohérent, mais l’absence de lieu d’exposition limite le champ des possibles. Dès lors, il est décidé que la monstration des collections se fera hors-les-murs, et que la politique de valorisation des collections se fera par des prêts et dépôts auprès de partenaires issus ou non du champ patrimonial, à l’occasion d’expositions réalisées avec l’exposition Savez-vous planter les choux, réalisée au Parc de Bagatelle avec la Ville de Paris en 2012.

Vue de l’exposition Savez-vous planter les choux ?tenue au Parc de Bagatelles en 2012 © Ville de La Courneuve
La nécessité de libérer l’espace accueillant les collections pousse la municipalité à entériner un déménagement des collections en direction du sous-sol du Centre Culturel de la Ville. Le site présente en effet des conditions de conservation préventive satisfaisantes (température et hygrométrie stables) mais ne permet pas d’accueillir l’intégralité des collections. En 2018, la mise en place d’un chantier de déménagement est actée par la Ville, articulée à un chantier de tri. Une méthodologie est définie avec Fleur Foucher, conservatrice-restauratrice spécialisée en conservation préventive. Les éléments dont la conservation devient impossible en raison de leur état général (infestation par des insectes xylophages, corrosion, présence de champignons, etc.) sont éliminés. Cette approche sanitaire est complétée par une réduction du volume des ensembles récurrents (cagettes, sacs en toile de jute, vannerie etc.). Ce tri interroge la valeur patrimoniale de chaque objet, sa singularité, son lien avec le territoire ou son articulation avec un ensemble d’objets, un donateur-témoin, etc.

Chantier des collections en 2019, au sein de l’ancienne halle industrielle © Ville de La Courneuve
Finalement, le chantier mobilise pendant quatre mois une équipe de six spécialistes en conservation-restauration et six techniciens d’art ainsi que le chargé de projet de la Ville. Il aboutit à un inventaire de 2079 lignes d’inventaire pour un ensemble de 3575 items allant du véhicule hippomobile ou motorisé aux cloches à salades. Une restitution est réalisée en février 2020 lors du colloque annuel de l’APrévU (Association des Préventeurs Universitaires) au Mobilier National.
De nouvelles réserves pour un nouveau projet patrimonial
Mais ce chantier des collections est aussi et surtout le moyen d’envisager, au sein de la Ville, une refonte du projet patrimonial et culturel à partir d’une collection resserrée et dont la conservation est dorénavant soutenable. Le Conseil municipal valide ainsi le principe d’une « banque d’objets patrimoniaux » dans les sous-sols du Centre Culturel Jean Houdremont, prêtables à l’occasion de projets patrimoniaux mais aussi de projets de médiation au sens large. Un partenariat est notamment noué avec la Ferme ouverte de Saint-Denis, voisine du territoire et gérée par les Fermes de Gally dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de Saint-Denis. Cette structure vise à faire découvrir l’agriculture d’hier, aujourd’hui et demain aux publics, et dispose d’un espace muséographique intérieur et extérieur dans lequel les collections courneuviennes sont désormais visibles par les publics de façon permanente.

Vue d’une des salles de la Ferme de Gally, où sont exposées les collections courneuviennes © Lucile Garcia Lopez
La préparation du chantier d’implantation des réserves dans les sous-sols du Centre culturel est en cours. Il s’agit désormais d’installer en 2022 et 2023 du mobilier de rangement permettant de déconditionner les collections, actuellement stockées dans des caisses en plastique et sur palettes. A partir de la fin 2022, ces réserves permettraient un travail de valorisation auprès des acteurs concernés par ces thématiques. L’intérêt de plusieurs institutions patrimoniales nationales (Institut national du patrimoine, Centre national des arts et métiers, MuCEM) et la conduite de certains projets en lien avec les collections, sont autant d’éléments témoignant de l’attachement à ces collections, susceptibles d’être mobilisées dans différents projets.Enfin ce chantier s'inscrit dans une logique plus globale incluant également les maisons maraîchères du 9 et du 11, rue de l’Abreuvoir, dont les espaces cultivables pourraient être mis à la disposition du public dans le cadre de médiations dédiées au patrimoine agricole.
Ainsi, sur ce territoire où les espaces agricoles ont disparu, les collections de La Courneuve pourraient constituer un vecteur de la transmission d’une histoire locale aux nouvelles populations courneuviennes, originaires du monde entier. A l’aune de problématiques écologiques et urbaines toujours plus pressantes, le patrimoine rural se ferait ainsi tisseur de lien social, en capacité de mobiliser les habitants du territoire dans une démarche collective autour des questionnements sur nos modèles alimentaires et économiques contemporains.
Lucile Garcia Lopez
Pour aller plus loin :
- Site de la Ville de La Courneuve
- Mikaël Petitjean, « Quel projet pour quels objets ? », e-Phaïstos, IX-2 | 2021
#Patrimoine #Collections #Ethnologie

Déambuler dans les marges, et oublier Ronsard : le prieuré saint Cosme
Contre la fatigue muséale, pourquoi ne pas prendre le temps de déambuler dans les jardins ?
Overdose muséale… et littéraire
Travaillant dans un musée depuis plusieurs mois, j’ai parfois l’impression de manger musée, dormir musée, lire musée. Chaque weekend, je ressens davantage une fatigue muséale, qui retire une partie du plaisir de la découverte de nouveaux lieux : comment apprécier la visite de centres d’interprétation, musées et autres sites patrimoniaux, quand toute déambulation se mue en observation fine des vitrines, cartels, degré d’accessibilité des textes ? La tête remplie de tous ces critères d’évaluation, comment apprécier « simplement » la visite ?
Lorsque, à l’occasion d’une sortie entre amis, ces derniers proposent de quitter la ville de Tours pour visiter le Prieuré Saint-Cosme à La Riche, petite commune des alentours, j’appréhende. Je n’ai cette fois aucune envie de lire des textes, or nous allons vers une maison d’écrivain, la demeure de Ronsard…
J’imagine alors un vieux bâtiment religieux, remis au goût du jour alternant vieilles pierres et espaces d’interprétation un peu daté, saturé de textes, des guirlandes de poèmes envahissant les murs. J’imagine un personnage grisonnant accompagnant la visite, ponctuant les murs de citations pseudo-inspirantes. J’imagine des roses tapissant les murs, mon seul souvenir de l’écrivain étant ces vers issus des Sonnets pour Hélène(1578) croisés pendant mes études : « […] Vous serez au foyer une vieille accroupie // Regrettant mon amour et votre fier dédain. / Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain : / Cueillez des aujourd’hui les roses de la vie ». Me revient en mémoire alors l’indignation ressentie devant ces vers empreints de sexisme, le poète affirmant que la femme qu’il courtise ferait mieux de s’abandonner à lui dans sa jeunesse, car elle sera bientôt vieille, et donc selon lui fatalement laide et non désirable, regrettant l’attraction dont elle faisait jadis l’objet. Comme si la beauté de cette femme se résumait à sa jeunesse, comme si une femme était un consommable doté d’une date de péremption.
Avec la plus grande méfiance, et persuadée de détester cette visite, j’entre dans le prieuré.
Pour, finalement, me laisser surprendre.
Entrer…
L’hôte d’accueil nous propose dès l’entrée un jeu de piste pour accompagner notre découverte des lieux. Sur une planche, un classeur de quelques fiches successives nous invitent à deviner l’emplacement d’« indices ». Disséminés dans le parc et les bâtiments, ces indices gravés nous révèlent chacun un mot, à reporter sur la planche pour deviner les mots manquants d’un poème. La visite jouée nous est proposée spontanément, et ne semble pas destinée à un public enfant. Tout au long de la visite, nous chercherons donc ces indices, ce qui ravivera régulièrement notre intérêt.
L'aménagement du prieuré est assez récent : d'importantes fouilles archéologiques ont été menées entre 2009 et 2012, permettant de mettre au jour des bâtiments inconnus auparavant, comme l'église construite aux alentours de l'an Mil. Le site a pu rouvrir en 2015 avec un nouveau parcours de visite, qui comprend des salles d'interprétations, dont la réalisation scénographique a été confiée à In Site, mais également une succession de jardins mêlant inspirations médiévales et contemporaines, aménagés par Bruno Marmiroli, architecte et paysagiste.
En quittant l’accueil, une grande salle nous fait ainsi découvrir l’histoire du site, qui était autrefois une île de la Loire, et les découvertes archéologiques dont il a fait l’objet, notamment les tombes des moines ayant fréquentés le prieuré. Les objets sont peu nombreux et présentés très sobrement, en vitrine, et comme posés sur une sorte de sable noir. L’essentiel de la pièce est consacré à un dispositif numérique (réalisé par MG Design et 100 millions de pixels) : une reconstitution 3D du prieuré, qui permet d’en comprendre l’évolution sur plusieurs siècles, ainsi que la fonction des différents espaces que nous nous apprêtons à visiter (ou non, car tout n’a pas été restauré). Si cet effet 3D semble un peu daté malgré sa réalisation récente, les technologies de modélisation 3D évoluant souvent plus rapidement que le temps nécessaire à la réalisation d'un parcours muséal, la présentation est claire et la manipulation intuitive. Elle l’est d’autant plus que, même si une seule personne manipule la tablette, le contenu de l’écran est repartagé sur le mur du fond par une projection. Les autres personnes se trouvant au même moment dans la salle peuvent donc en profiter sans nécessairement attendre leur tour.

Vue du dispositif. (Photo : SN)
Déambuler
En sortant de cette salle, nous arrivons dans le parc. La signalétique, discrète, indique sobrement les différents bâtiments, sans qu’un ordre clair nous enjoigne à partir dans une direction précise.
Le temps est doux, il a plu les derniers jours et l’herbe est grasse autour de nous. Nous avançons, des hamacs se balancent entre les arbres et nous invitent. Nous nous y installons quelques minutes, avant de reprendre notre déambulation.

Vue des jardins. (Photo : SN)
Des bornes présentant des poèmes de Ronsard sont disséminées dans le parc, sans que nous nous sentions obligés de les lire. Nous avons simplement lu en arrivant que Ronsard avait été prieur dans ce lieu. A la direction du Prieuré Saint-Cosme, il s’est occupé de ses jardins et de sa rénovation pendant quelques années, tout en restant aumônier pour le roi Charles IX. Nous ne nous sentons pas obligés d’aller plus loin dans la compréhension de son œuvre, en revanche nous apprécions de pouvoir lire le paysage et comprendre l’esprit qui a guidé ses écrits et accompagné les dernières années de sa vie.
Les jardins odorants et colorés sont à la fois utilitaires (verger, potager, plantes médicinales) et « profanes » (jardin des parfums, espace dédié aux roses…), comme ils l’étaient de son vivant. La végétation ponctue notre visite, nous incitant aux pauses régulières.
L’espace se comprend de façon intuitive : certains espaces sont restaurés ou reconstruits, d’autres simplement suggérés. Une construction en bois symbolise l’ancien plan de l’église, dont il ne reste que les vestiges du chœur, au sein desquels fut inhumé Ronsard. Découverte au XXe siècle lors de fouilles, sa dépouille y a été réinhumée après identification. Nous nous arrêtons quelques instants devant sa tombe gravée d'une épitaphe qu'il avait lui-même choisie. Nous longeons le jardin du cloître jusqu’au miroir d’eau, censé évoquer les ablutions rituelles liés aux rites de purifications.

Vue des jardins, avec les vestiges de l’église et le plan d’eau. (Photos : SN)
Contempler
Après cette pause printanière, nous entrons dans le réfectoire. Cet espace est régulièrement occupé par des expositions temporaires, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui. Le lieu est vide, et en même temps, il semble rempli d’une présence. Des couleurs inhabituelles se projettent sur le sol et les murs. En levant la tête, les vitraux ressemblent davantage à des glaces peintes, mais peintes à l’encre de Chine. En 2010, Zao Wou Ki a ainsi installé 14 vitraux dans cet espace. Les formes esquissées sur les vitraux sont discrètes, et laissent apparaitre en transparence les arbres, des morceaux de ciel et les murs extérieurs du réfectoire.

Vitraux de Zao Wou-Ki pour le réfectoire. (Photos : SN)
En ressortant, nous croisons une forme étrange plantée dans l’herbe. Nous l’avons déjà vu à deux reprises dans le parc, sans l'identifier. Le livret de visite nous indique son utilité : il s’agit d’une installation de Bruno Salay, intitulée Contemplations.Constituée de sept assises réparties dans le parc, cette œuvre propose d’expérimenter le paysage. A la façon des plantes, qui poussent différemment en fonction de l’endroit où elles ont été plantées, Bruno Salay nous propose d’expérimenter ce que produit sur nous et en nous le fait d’être « ici et maintenant ». Face à cette brise, à l’ombre de cet arbre, ou en plein soleil au milieu des pierres, qu’est-ce qui change ? Qu’est-ce que je sens, qu’est-ce que je ressens différemment ? L’emplacement des assises est régulièrement modifié par les jardiniers, qui les sélectionnent avec soin au fil des saisons. Un QR code nous renvoie à une consigne sonore : « S’assoir. Regarder avec soin autour de soi. Mémoriser autant que possible les végétaux, les matières, les éléments architecturaux. Le temps nécessaire. Procéder lentement, avec un esprit paisible. »

Contemplations, Bruno Salay. (Photo : SN)
Créer à quatre mains
Le corps et l’esprit reposés, j’accepte finalement de bonne grâce d’entrer dans l’exposition littéraire située dans la cuisine du prieuré. La muséographie est minimaliste et très rudimentaire : quelques panneaux de textes, des vitrines alignées, des numéros renvoyant à des cartels groupés. Nous regrettons ce jeu de renvois par numérotation, mais apprécions les ouvrages qui y sont présentés : il s’agit de la collection de livres pauvres du prieuré : des feuilles pliées en quatre, sur lesquelles se déploient la collaboration d’un poète et d’un artiste plastique. Ces créations réduisent le plus possible le nombre d’intermédiaires classiques en évitant les imprimeurs, graveurs, ou relieurs. Chaque feuille est différente, métamorphosées par ces créations à quatre mains, qui réduisent parfois le papier à ses plis.
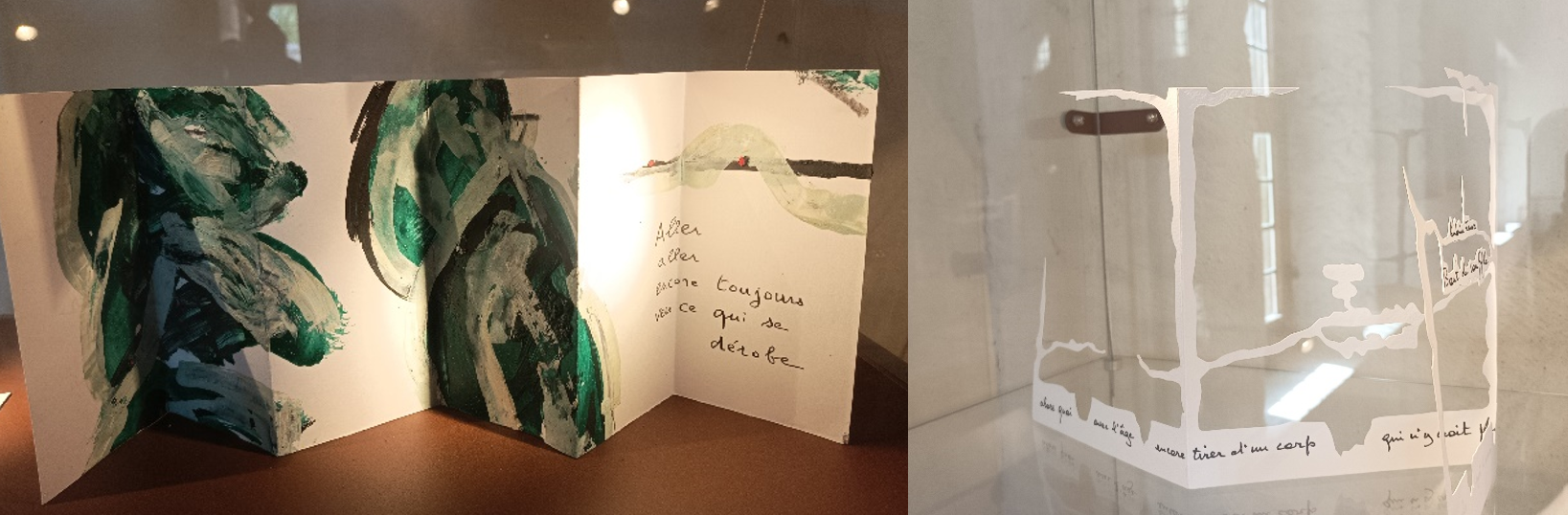
Livres pauvres de la collection du Prieuré. (Photos : SN)
Loin de se consacrer uniquement à Ronsard, le Prieuré donne ainsi à lire et à regarder quelques-uns de ses 2500, livres pauvres en éditions limitées réalisés par des auteurs et plasticiens tels que Daniel Leuwers, Michel Butor, Andrée Chedid, Annie Ernaux, Pierre Alechinsky, Michel Nedjar, Vladimir Velickovic… Et ici la littérature se fait discrète, modeste, qu’elle ponctue les jardins de quelques vers ou s’expose entre deux traits d’encre.
Elle m’envahit moins que ce que je craignais, elle ne me fait pas peur et se laisse aborder plus simplement. L’espace du Prieuré est lui-même poésie : tout comme l’espace laissé blanc est essentiel dans cet art, les espaces liminaires de la demeure sont tout autant travaillés que ceux qui exposent véritablement des contenus scientifiques, historiques ou littéraires. La place est faite au corps comme à l’esprit, par le recueillement, la déambulation, le rien qui n’est pas « rien ». Elle nous incite à regarder ce rien et y voir quelque chose.
Et pour Ronsard, on verra plus tard ?
Nous quittons les lieux un peu précipitamment. A tant errer dans les jardins, il est déjà un peu tard pour visiter le logis, lieu d’exposition des éditions originales de Ronsard, de reconstitutions de son espace de travail. Nous y passons rapidement, en se promettant de revenir les explorer davantage.
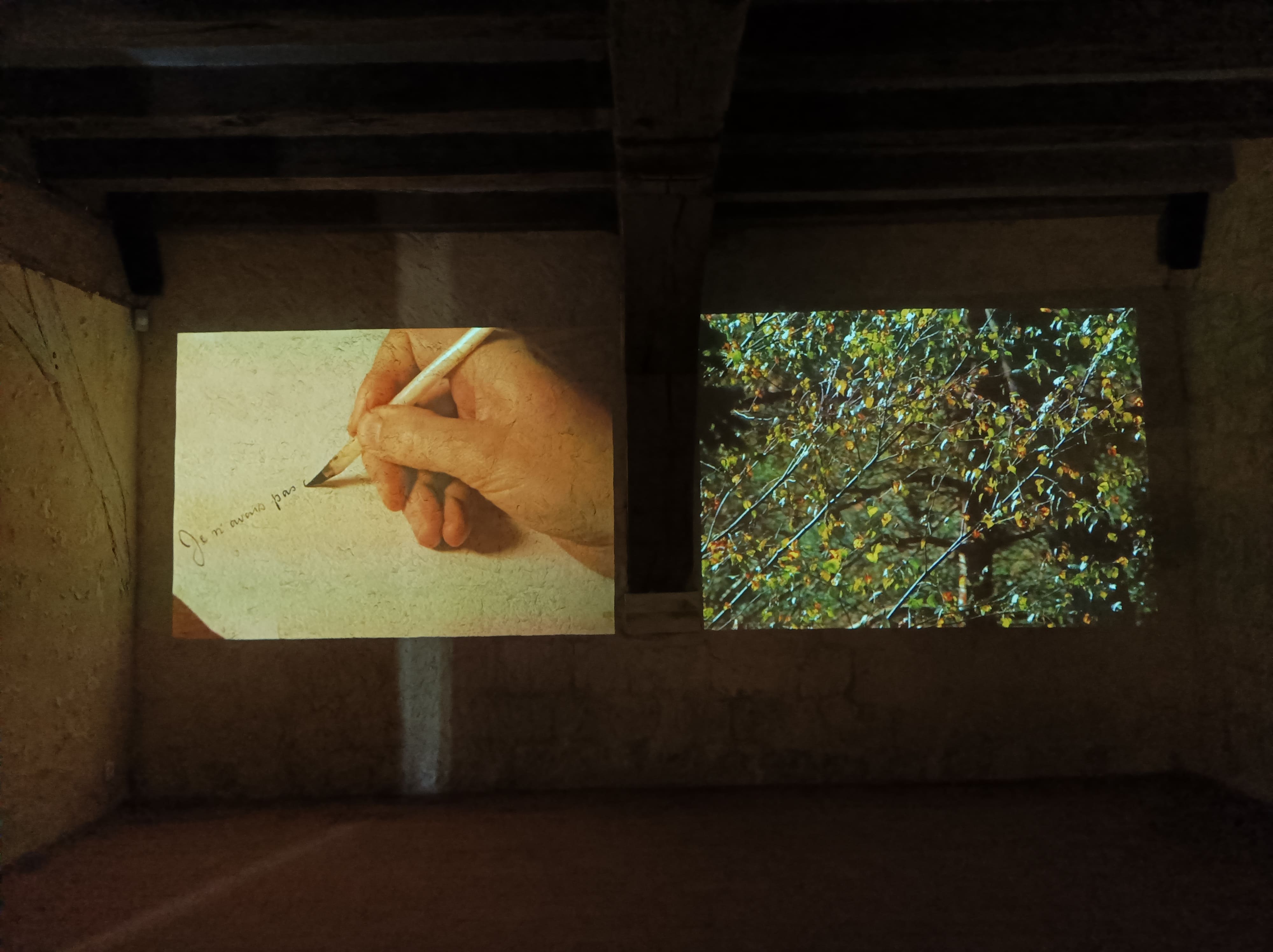
Film de présentation de la vie de Ronsard, réalisation : Compagnie Stasimon. (Photo : SN)
Je suspens pour l’instant mon jugement sur Ronsard. Je n’en connais finalement que des bribes, et si j’ai parcouru des murs qui lui sont consacrés, ce n’est finalement pas tant son œuvre que je retiens de ma visite mais davantage l’esprit du lieu, sa présentation tout en simplicité, et l’accueil fait au visiteur dans son entièreté, prêtant la même attention à son esprit, son corps et ses sens.
Sibylle Neveu
Pour en savoir plus :
- https://www.prieure-ronsard.fr/
- FlorenceCaillet-Baraniak, « Médiation numérique un site archéologique : à la rencontre entre réalité et virtualité », La Lettre de l’OCIM [En ligne], 172 | 2017, mis en ligne le 01 juillet 2018, consulté le 13 juin 2023. URL : http://journals.openedition.org/ocim/1811 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ocim.1811
- Vincent Guidault, « Le renouveau des jardins du Prieuré Saint-Cosme : Demeure de Ronsard », Jardins de France.org[en ligne], consulté le 13 juin 2023. URL : https://www.jardinsdefrance.org/le-renouveau-des-jardins-du-prieure-saint-cosme-demeure-de-ronsard/
#ronsard #prieuré #jardins
Découverte du musée du Folklore de Tournai par le biais d'une visite atypique à but créatif
Cet article a été rédigé à la suite de ma première visite de cette institution municipale, à l’occasion de l’opération Musées(em)portables, concours de film courts organisé par le SITEM. Dans ce cadre 3 étudiantes du MEM sont responsables du jumelage entre le Musée du Folklore de Tournai (lieu de tournage) et les étudiants de l’HELHa qui créent leur film sur place. Simple accompagnatrice de mes camarades, je n’ai été qu’observatrice des interactions et de la découverte des lieux par les septante étudiants (présence en territoire belge oblige je ne dirai pas soixante-dix par respect de la culture wallone).
Devant l'entrée du Musée du Folkore après avoir sonné la cloche © J. D.
Installé dans une maison tournaisienne derrière la Grand’Place, les collections du musée sont abritées derrière des façades datant du XVII et épargnées par les bombardements. Après que l’on ait fait sonner la cloche de la porte d’entrée, Jacky Legge responsable du lieu depuis septembre nous accueil. Il est une personnalité phare de la vie culturelle de Tournai puisqu’il est aussi coordinateur de la maison de Culture, et chargé de cours auprès des étudiants participants.
Crée en 1930 sous la direction du conservateur Walter Rivez, le Musée du folklore de Tournai en Belgique fut novateur notamment par la récolte importante des dons de la populations, pratique muséale que l’on retrouve aujourd’hui dans des institutions de plus grande échelle tel que le Musée national de l’Histoire de l’Immigration1.
Toutefois comme le concède le nouveau responsable des lieux à ses étudiants, l’ensemble est resté dans son jus. En parcourant les 23 pièces du musée nous découvrons effectivement dioramas, vitrines et maquettes qui évoque la vie quotidienne la région tournaisienne entre 1800 et 1950 aussi bien par les expôts que par-là scénographie.
Ce retour dans le temps c’est aussi bien la force et la faiblesse de ce musée (au point que cela en ferait presque un cas d’école). Les effets en sont donc multiples pour l’expérience du visiteur dépendant bien évidemment de son profil. La visite gratuite est un point fort car elle permet une visite plus « légère » sans pression de rentabilité du temps passé sur place. De même en cassant la barrière financière on révèle davantage les autres barrières d’entrées au musée. De par son sujet non élitiste, le musée du folklore de Tournai n’est certes pas concerné par l’inconfort que certains groupes qualifiés tantôt de « public empêché », « champ social » voir « non public » peuvent ressentir dans des lieux de culture dite légitime. Au contraire ces individus peuvent prendre goût à leur visite par le caractère authentique des lieux des artefacts présentés. D’autant plus s’ils reconnaissent des objets, décors, particulièrement si le groupe de visite est intergénérationnel. L’ancrage territorial du musée, ainsi que sa longévité renforce ce type de visite. En effet aux mémoires préservés dans les lieux par les collections s’ajoutent celles des visiteurs qui venaient enfants avec leurs parents, aujourd’hui adultes ils peuvent prendre plaisir à retrouver les liens tel qu’ils les ont connus et, évoquer leurs souvenirs de visite.
D’un autre coté si le groupe ne possède pas les codes de référence des époques traités, on pense aux jeunes non accompagnés par leurs familles ou enseignants, le ressenti est tout autre. C’est d’ailleurs ce que j’ai pu observer lors de cette visite, certes dans un cadre scolaire mais dont le but était la production d’un contenu créatif s’inspirant des lieux, collections, sujets. Aussi a aucun moment il n’y a eu à l’intérieur du musée de transmission traditionnel délivré par un « savant » à un « non-initié ». La classe s’est de suite dispersée, à la recherche d’un point de départ d’une fiction. Ils n’ont pas été déçu par l’image du musée figé et des éléments de mise en scène « un peu flippant »2 (voir les photos ci-dessous) car pour eux c’était la matière nécessaire à leur créativité.
Ce sont souvent les mannequins et poupées qui sont perçues de manière négatives par nos jeunes visiteurs.
Sentiments que nous étudiantes du MEM partageons. © J. D.
Aussi plus qu’au statut et au contexte d’utilisation des objets, c’était l’effet du visuel qui était recherché au prime abord par ces étudiants. Jacky Legge s’est d’ailleurs étonné qu’ils ne soient pas venus demander de renseignements complémentaires sur les objets alors qu’il avait spécifié qu’il était disponible et volontaire à ce sujet. Ce constat n’est pas pour autant négatif, il montre juste que leurs imaginations n’ont pas besoin (pour la plupart) d’être nourries par des faits scientifiques sur les sujets filmés. Il est fort probable qu’ils reviennent par la suite, lors du développement de scénario demander le contexte d’utilisation d’un objet particulier par exemple. Cette visite alternative en groupe peut aussi susciter la même curiosité qu’un visiteur individuel peut avoir, c’est à dire qu’il choisit l’objet qu’il souhaite approfondir en termes de connaissance.
Cependant le musée du Folklore de Tournai étant très chargé malgré ses 1000m2, la documentation n’est pas toujours accessible librement, aussi c’est souvent une personne physique qui est dans la capacité de renseigner le visiteur. C’est par ailleurs une chose que le personnel permanant (trois personnes au total sur place) réalise d’une manière remarquable. Sylvain passionné par son lieu de travail et les mémoires qu’ils conservent, n’a pas hésité à me faire une visite spontanée. Agissant comme un médiateur volant qui s’ignore. Les actions envers le public m’ont semblé du même acabit. Simples, tout en étant efficaces et sensibles, ici les défauts sont tellement flagrants, les actions de renouvellement de l’exposition tellement faites « mains » que l’on ait touché par ce nouveau souffle apporté au musée…
© J. D.
 C’est le cas pour les photos qu’une artiste a récolté en lançant un appel auquel professionnels reconnus et amateurs anonymes ont répondu. Elle a ensuite disséminé et mis en parallèles ces clichés avec la collection tout en y ajoutant des textes choisit de la même manière. Ce choix subjectif qui unit des clichés à un décor, un objet de manière surprenante, pertinente, savante,… Crée un fil rouge stimulant la visite habituelle, et renoue le musée au participatif.
C’est le cas pour les photos qu’une artiste a récolté en lançant un appel auquel professionnels reconnus et amateurs anonymes ont répondu. Elle a ensuite disséminé et mis en parallèles ces clichés avec la collection tout en y ajoutant des textes choisit de la même manière. Ce choix subjectif qui unit des clichés à un décor, un objet de manière surprenante, pertinente, savante,… Crée un fil rouge stimulant la visite habituelle, et renoue le musée au participatif.
Par ailleurs comme on peut le voir sur le cliché ci-haut cette intervention de l’artiste est signalée par un fil rouge noué. Il s’agit d’une table d’accouchement liée à une photo en noir et blanc d’une toile d’araignée (Bénédicte Hélin). Ce rapprochement permet de nombreuses interprétations : le fil serait cité comme une allusion au cordon ombilical. A cette association s’ajoute le texte « Si j’étais un fil je serai un filou philanthrope et je donnerai du fil à retordre » de Eric qui peut entrer en résonnance avec l’ensemble, si l’on pense par exemple qu’un accouchement peut donner du fil à retordre à la femme allongée sur la table ainsi qu’au gynécologue. Suivre cette idée conduit à des questionnements sur le contexte d’utilisation de l’objet valorisé, « A quel point cette table d’accouchement a-t-elle été bénéfique en terme pratique ? Est-ce que cela a été une révolution dans les arts obstétriques ? Est-ce que cela a permis de minimiser les risques ? ».
La liberté et surtout la présence du travail d’un artiste de manière temporaire dans un musée de société tel que le musée du Folklore de Tournai est à saluer. Ce sont des initiatives de ce genre que Jacky Legge peut poursuivre de manière plus fréquente, qu’à l’occasion de la programmation culturelle de la ville, dont le festival d’art contemporain l’Art dans la Ville3 (3ème édition en 2017) utilise le même principe de disposition d’œuvres en complicité avec des éléments, de l’espace urbain, de commerces et d’équipement culturels. Cette année, en octobre c’était Nicolas Verdoncq et sa proposition nommée L’île Noire qui s’est prêté au jeu au sein d’un musée du Folklore.
On peut imaginer que la participation du Musée du Folklore au projet Musées(em) portables grâce au jumelage avec les septante étudiants de l’HelHa pourra être valorisée tout en éclairant les collections grâce à la projection des films in situ.
Julie D.
#muséedufolklore
#tournai
#musées(em)portables
#HELHa
_________________________________________________________________________
1 Voir la galerie des dons du musée2 Citation de plusieurs élèves qui ont utilisé des objets dans leurs films pour faire un film reprenant les codes des films d’horreurs.3 https://artville.tournai.be/
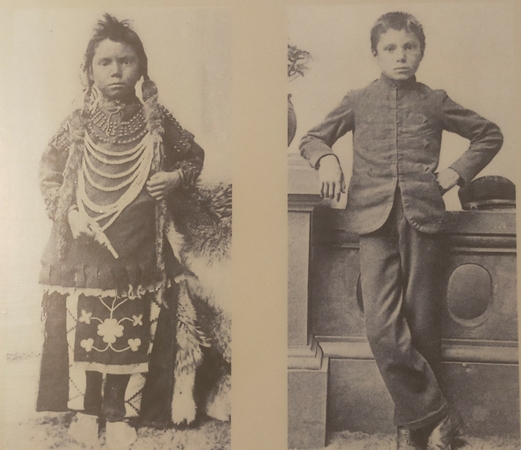
Des musées québécois qui (s’)exposent : l’histoire douloureuse des pensionnats autochtones
En exposant des histoires douloureuses, les musées s’exposent à des risques. Etudions comment les musées québécois traitent l’histoire des pensionnats autochtones dans trois récentes expositions : quels partis-pris muséographiques propres à ce défi délicat et sensible peut-on relever ?
Parmi les thématiques abordées dans les expositions, il est des histoires plus difficiles à raconter que d’autres. Parfois, le sujet est pointu, d’autres fois il est périlleux, mais il peut aussi être douloureux. C’est un travail complexe et sensible quand le musée décide de s’emparer du souvenir d’un passé difficile à accepter. Dans ce travail risqué d’équilibrisme muséographique, les professionnel.le.s peuvent garder en point de mire un espoir justifiant leurs efforts : une exposition n’est-elle pas un outil puissant pour travailler collectivement autour d’un passé douloureux ? Moyennant quelques tensions et frictions, le musée n’a-t-il pas ce pouvoir, quand il ose s’emparer de ces sujets sensibles, de penser – et peut-être de panser - les plaies de la société ?
Si toutes les sociétés ont sûrement dans leur histoire des épisodes difficiles à digérer collectivement, le cas du Québec est particulièrement intéressant à étudier ici. Les musées font partie des différents outils mis en place pour guérir les blessures et soulager les tensions créées par le passé colonial. C’est à travers un champ d’étude nommé « muséologie décoloniale » que le monde muséal affronte cette mission complexe.
Au sein du terrain d’observation privilégié qu’est la muséologie québécoise, un sujet est singulièrement pertinent pour éclairer cette question de la prise en compte de sujets difficiles à traiter : celui des pensionnats autochtones. Pour comprendre l’importance de cette histoire dans la société québécoise et notamment dans ses musées, il convient d’en dire un peu plus sur ces pensionnats autochtones, un pan de l’histoire canadienne trop peu connu, notamment en Occident.
Les pensionnats autochtones, point de crispation de l’histoire canadienne
Perte des terres et réserves, christianisation forcée, perte des traditions, violences, racisme de la justice et de la société tout entière, difficultés économiques et psychologique etc. : les sujets sont nombreux pour faire comprendre les impacts considérables de l’entreprise coloniale subie par les Premières Nations, Inuit et Métis du Canada. Le cas des pensionnats autochtones semble cristalliser particulièrement de tensions et de sensibilité.
Le système des pensionnats autochtones faisait partie de la politique d’assimilation des puissances coloniales européennes au Canada. En 1894, en modifiant la « Loi sur les Indiens », le gouvernement a imposé la fréquentation des pensionnats aux enfants autochtones qui, séparés de leur foyer et de leur mode de vie, étaient contraints d’y adopter une langue – le français ou l’anglais – une religion – le christianisme – et des coutumes nouvelles. 150 000 enfants, selon les estimations, ont été scolarisés dans ces écoles religieuses dont la dernière n’a fermé qu’en 1996.
Face à la violence de ce système, des résistances et protestations se sont élevées, pendant l’activité des pensionnats et après leur fermeture, afin de faire prendre conscience à la société canadienne des séquelles subies par les survivants. En 2008, le gouvernement a exprimé des excuses officielles. Des indemnisations ont été accordées, et ont permis la création de la Commission de vérité et réconciliation. En 2012, le rapport de la commission a été rendu public, énonçant 94 appels à l’action. Le 79ème demande « la commémoration des sites des pensionnats, de l’histoire et des séquelles de ces pensionnats et de la contribution des peuples autochtones à l’histoire du Canada. »
Si la réconciliation est l’affaire de l’ensemble de la société, les musées ont leur rôle à jouer dans la présentation de cette histoire pour ouvrir une discussion sur ses sujets traumatiques et donc participer à la réconciliation. De nombreuses expositions ont été réalisées sur ce sujet.
Récemment, le souvenir des pensionnats autochtones a rejailli avec la découverte, en 2021, de restes de plus de 200 enfants sur le site d’un ancien pensionnat, prouvant, si cela était encore nécessaire, la violence de ce que la commission de vérité et de réconciliation désigne comme un « génocide culturel ». Cette sombre actualité révèle encore l’importance du cas des pensionnats dans la discussion sur la relation coloniale entre Autochtones et Allochtones, discussion qui a comme terrain privilégié le musée.
Nous proposons de dégager quelques partis-pris muséographiques de la visite, l’été 2022, de trois expositions consacrées aux pensionnats dans des musées québécois : le Musée McCord Stewart à Montréal, le musée de la Civilisation à Québec et le Musée canadien de l’histoire à Gatineau. Mobilisés pour la présentation des pensionnats autochtones, ils sont autant de pistes qui pourraient être appliqués à d’autres sujets dont la présentation est compliquée par un poids émotionnel négatif trop fort.
Premier parti-pris : avertir le visiteur
Au même titre que les avertissement ou restrictions d’âge qui alertent avant le visionnage d’un film, le musée peut alerter le visiteur sur un contenu qui pourrait être choquant ou trop difficile émotionnellement à recevoir.

Musée canadien de l’histoire de Gatineau, Salle de l’histoire canadienne – Photographie : RV
Si vous préférez ne pas visiter cette section, vous pouvez continuer votre visite en vous dirigeant vers la gauche, en levant la barrière. »
Il est intéressant de noter que le sujet des pensionnats autochtones est le seul qui bénéficie de ce traitement particulier, alors même que d’autres sujets sensibles, comme les guerres mondiales ou les projets si choquants du Ku Klux Klan, sont traités dans le même parcours. Cela révèle la sensibilité particulière de cette thématique. L’impact émotionnel potentiel sur les visiteurs est tel que le musée relaye un numéro téléphonique de soutien de l’Indian Residential School Survivors Society.
On pourrait s’étonner que le musée, alors même qu’il décide d’affronter et de transmettre cette histoire trop souvent ignorée, mette en place une circulation particulière permettant aux visiteurs de ne pas s’y confronter. On peut toutefois comprendre ce choix - en pensant aux survivants, survivantes et leurs proches pour qui cette histoire représente un traumatisme – et même l’apprécier : cette précaution permet en effet de ne pas modérer le propos et de donner une vision franche de cette réalité.
Deuxième parti-pris : Plonger le visiteur dans une ambiance particulière grâce à la scénographie
Certaines atmosphères sont propices au recueillement personnel, quelle que soit la forme qu’il prenne selon les sensibilités. Par la scénographie, les musées peuvent mettre le visiteur dans les conditions de réception d’un sujet délicat. Cet effet de l’atmosphère est d’autant plus fort quand il contraste avec le reste de l’espace d’exposition.
Cette démarche est particulièrement visible dans l’exposition Voix autochtones d’aujourd’hui proposée par le Musée McCord Stewart de Montréal. La scénographie joue sur la symbolique de la forêt, si importante pour les sociétés autochtones. Dans le premier espace, consacré aux traditions et aux modes de vie antérieurs à la colonisation, les murs sont recouverts d’une image de forêt verte, lumineuse et luxuriante. Le contraste saisit le visiteur quand il pénètre dans la deuxième partie, consacrée aux conséquences de l’arrivée occidentale, et notamment aux pensionnats. Le mur du fond est recouvert d’une image de forêt carbonisée. Les textes ne sont plus écrits en vert sur fond blanc mais en rouge sur fond noir. La luminosité est abaissée et le sol recouvert d’une moquette plus épaisse. Symboliquement, la lumière revient dans la dernière salle, consacrée à l’espoir d’une réconciliation.

Musée McCord Stewart, exposition Voix autochtones d’aujourd’hui : savoir, trauma, résilience – Photographies : RV
Si l’effet scénographique est particulièrement saisissant dans l’exposition du Musée McCord Stewart, on remarque des similitudes dans celle du Musée canadien de l’histoire. La hauteur sous plafond est abaissée au moyen d’un voilage noir, donnant la même impression d’un espace resserré et confiné. Est-ce une façon d’évoquer l’enfermement des élèves ou une manière de créer une atmosphère propice à une rencontre intime et émotionnelle avec des témoignages puissants ?
Troisième parti-pris : positionner le discours muséal par un ton entre neutralité et engagement
C’est peut-être dans les textes que le musée s’expose le plus : c’est lui - à travers la plume des commissaires, conservateurs ou muséographes - qui s’exprime, et qui prend le risque de choquer, d’heurter. Le ton du discours muséal est donc particulièrement révélateur du positionnement de l’institution. A ce titre, comparons deux partis-pris de rédaction différents, autour de la même thématique des pensionnats.
Au Musée McCord Stewart, le visiteur peut lire un texte intitulé « Enfants dévastés, parents dévastés » dont voici un extrait :
« De toutes les pertes incessantes que nous avons subies à la suite de la colonisation, celle de nos enfants fut la plus dévastatrice. […] Avec l’esprit colonialiste, religion, éducation et services gouvernementaux sont devenus de puissants outils d’assimilation alors que leur vocation première aurait dû être d’assurer l’épanouissement de nos communautés comme pour le reste de la population. »
Le musée de la Civilisation à Québec, dans son exposition permanente intitulée C’est notre histoire, tient, lui, ce discours :
« L’instruction comme solution au « problème indien ». C’est dans une optique d’assimilation que sont créés au Canada, à compter des années 1840, des pensionnats autochtones. La politique qui en découle repose sur la prétendue supériorité de la civilisation européenne et de la chrétienté. Pour élever les Autochtones à la « condition civilisée », le gouvernement du Canada compte sur un projet d’éducation en trois étapes : la séparation du milieu familial et culturel, la socialisation de l’enfant dans le pensionnat et l’émancipation par l’assimilation. Ainsi, la séparation est jugée nécessaire pour contrer l’influence de la famille de l’enfant autochtone. Le pensionnat, lui, est vu comme un milieu global de resocialisation. Un cadre « civilisé » où l’enfant fait des apprentissages exempts de toute trace de cultures autochtones. »
La différence de ton est particulièrement notable dans les exemples ci-dessous. Le ton engagé du musée McCord s’explique par le fait que l’exposition donne la parole aux Autochtones, une décision symboliquement forte pour ne pas renouveler la violence de l’appropriation territoriale et culturelle en prenant la parole à la place des personnes concernées. C’est aussi une façon de remettre en cause l’idée d’une nécessaire neutralité du musée : au contraire, il met en avant un point de vue engagé.
Le musée de Québec n’évoque pas la douleur des enfants mais des objectifs et justifications du système. Même si le musée prend des distances, par exemple en mettant certains mots problématiques entre guillemets pour montrer qu’il ne partage pas cette vision, c’est bien le point de vue des colonisateurs qui est donné. Cette critique fait écho à la question plus générale de « qui parle ? » dans l’exposition C’est notre histoire, une question posée notamment par Desmarais et Jérôme dans leur analyse de l’exposition (Desmarais, L. & Jérôme, L. (2018). Voix autochtones au Musée de la civilisation de Québec : les défis de la muséologie collaborative. Recherches amérindiennes au Québec, 48(1-2),121–131. https://doi.org/10.7202/1053709ar)
Quatrième parti-pris : donner la parole aux personnes concernées
Les témoignages – dans ce cas d’anciens élèves des pensionnats – peuvent résoudre la difficulté du ton du discours muséal, tout en apportant de l’humanité et de la sensibilité au contenu de l’exposition. Les personnes concernées ne sont-elles pas les mieux à même de raconter l’histoire des pensionnats ?
La présence de témoignages est un élément récurent dans les expositions visitées. Ils sont parfois écrits, parfois être audio ou vidéo : la voix du témoin est un véhicule efficace pour les émotions, provoquant ainsi l’empathie du visiteur.
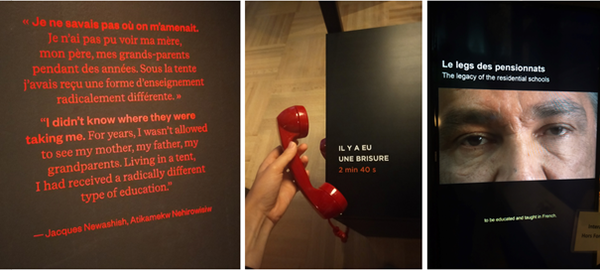
présentation des témoignages : écrits au Musée McCord, audio et vidéo au Musée de la Civilisation de Québec – Photographies : RV
La particularité du musée de Gatineau est de présenter des témoignages de différents acteurs opposés : de nombreux témoignages de survivants, mais aussi une citation de Sir John A. Macdonald, premier ministre canadien (« Les enfants indiens devraient être retirés le plus possible de l’influence de leurs parents. ») ou encore de la juge Beverley McLachlin (« Le Canada a commis un « génocide culturel » envers les populations autochtones avec une politique comme celle des pensionnats indiens, qui avaient pour but premier d’éradiquer les langues et les cultures des nations préexistantes »). Par ce choix, le musée évite de porter lui-même un discours engagé (comme le fait le musée McCord), en préférant offrir un lieu de dialogue imaginaire aux différentes opinions. La question se pose cependant : toutes les voix doivent-elles être portées au musée ? Comment le musée peut-il se dissocier de propos choquants tout en les présentant ?
Cinquième parti-pris : convoquer l’art contemporain
Les musées ont à leur disposition des objets et documents d’époque pour présenter les pensionnats, comme des photographies, des cahiers d’écolier et même des vidéos. Cependant, les trois musées visités ont fait le choix de présenter des œuvres d’art contemporaines pour révéler, d’une manière différente, l’histoire des pensionnats. Dans l’exposition C’est notre histoire est présenté un collage intitulé God Was a Victim Too. L’artiste Glenna Matoush utilise les photographies d’un enfant avant et après son entrée en pensionnat, montrant la violence de l’assimilation. Le titre est une critique de la justification religieuse donnée par le pouvoir colonial. Le choix d’une œuvre engagée pour apporter un contenu critique, sans que le musée ne le porte directement dans son discours, rappelle l’étude menée par Gaëlle Crenn au Musée royal d’Afrique central de Tervuren, en Belgique. Dans « La réforme muséale à l’heure postcoloniale. Stratégies muséographiques et reformulation du discours au Musée royal d’Afrique centrale (2005-2012) », elle évoque cet usage de l’art contemporain qui permet de « prendre en charge la dimension critique du discours et de l’articuler étroitement au discours institutionnel. »

photographie de l’œuvre God Was a Victim Too de Glenna Matoush, exposée au Musée de la Civilisation de Québec – Photographies : RV
Sixième parti-pris : savoir se remettre en question
Après avoir remis en cause l’idée de neutralité du discours muséal, on peut questionner un autre pilier de l’institution : celui d’une prétendue vérité à rechercher au musée. Nous, visiteurs, avons tendance à prendre ce que nous dit le musée pour une « parole d’évangile ». Pourtant les professionnel.le.s des musées, en tant qu’acteurs de recherche et de transmission, peuvent fournir des données erronées ou incomplètes d’un sujet, aussi honnêtes et compétents soient-ils. Ils le sont peut-être même davantage quand ils savent se remettre en question et inviter les visiteurs à faire de même.
Le musée invite alors le visiteur à se rendre dans la Salle de l’histoire canadienne qui présente une vision plus actuelle.
A la suite des travaux menés confirmant l’emplacement de tombes anonymes sur les sites d’anciens pensionnats autochtones, le Musée canadien de l’histoire poursuit son travail avec les survivantes, les survivants et les communautés autochtones afin de mettre à jour cette section. Le nombre de décès indiqué dans le texte de l’exposition est tiré du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation. Celui-ci sera ajusté au fur et à mesure que les recherches se poursuivront. »
Ici, le musée reconnaît son incapacité à décrire avec certitude l’histoire des pensionnats autochtones. Cette précaution est d’autant plus importante dans le cas d’un passé traumatique.
Conclusion :
Ces quelques partis-pris muséographiques montrent comment les trois musées québécois visités s’emparent du sujet sensible des pensionnats autochtones. Cet exemple révèle la complexité inhérente à la muséologie décoloniale : il est loin d’être évident pour le musée, qui porte en lui bon nombre des héritages de nos sociétés coloniales, de se confronter aux épisodes les plus sombres du passé pour participer au travail de réconciliation. Cela nécessite pour le musée de s’engager dans un processus large de décolonisation, qui passe par exemple par la déclaration de reconnaissance territoriale – le fait de préciser que le territoire du musée n’a jamais été cédé par voie de traité par ses occupants d’origine-, par l’intégration de professionnel.le.s issu.e.s des communautés autochtones – Jonathan Lainey est, depuis 2020, le premier conservateur autochtone en charge de la collection d’art autochtone du Musée McCord - ou encore par l’intégration des communautés dans la conception des expositions. Cette démarche est applicable à toutes les étapes de la vie de l’exposition, de la conception – à titre d’exemple, la Boîte Rouge Vif, spécialisée dans la transmission de la culture autochtone, aide les musées à mettre en place des processus de co-conception d’exposition – à la médiation auprès des publics – voir à ce sujet la conférence du Musée de la civilisation « Sujets sensibles : préparer une visite commentée » accessible sur Youtube.
Tout cela peut sembler bien compliqué. Ce défi est pour le musée à l’image d’un champ de rose dont il serait le jardinier. Il peut s’y piquer et même s’égratigner, mais aussi, à force d’efforts et d’habileté, faire éclore de belles réalisations, justifiant ainsi son rôle majeur « au service de la société » donné dans la nouvelle définition de l’ICOM.
Raphaëlle Vernet
Pour découvrir les trois expositions analysées :
- Voix Autochtones d’aujourd’hui au Musée McCord Stewart
- La Salle de l’Histoire canadienne du Musée Canadien de l’Histoire
- C’est notre histoire au Musée de la Civilisation de Québec
Pour aller plus loin dans la réflexion décoloniale autour du musée et des expositions, voir l’article de Gaëlle Crenn sur le Musée royal d’Afrique centrale de Tervuren dans la revue Culture et Musées en 2016 : https://doi.org/10.4000/culturemusees.866
#AnalyseMuséographique #MuséologieDécoloniale #Québec

DES ŒUVRES EN BOÎTE
Les dépôts d’œuvres d’art en France durant la Seconde Guerre Mondiale : le cas du château de Chambord.
Cet été 2023, au détour d’une visite au château de Chambord, je découvre une nouvelle exposition temporaire située en terrasse. En entrant dans une pièce sombre et froide, j’ai l’impression de m’immerger dans des réserves anciennes de château, avec des boîtes pleines d’œuvres. Au détour de quelques cartels et de vidéos, j’appréhende le propos : le sort des œuvres d’art durant la Seconde Guerre Mondiale.
Une organisation préventive
Tout commence durant les années 1930, comme tout un chacun le sait, l’Europe est une terre de conflits sous-jacents. La guerre gronde, et des plans d’évacuation des œuvres sont établis. En 1936 est ainsi créé le service des Monuments historiques ayant pour but d’évacuer et de protéger les objets d’arts. Des listes d’œuvres nécessitant une mise à l’abri sont établis en cinq jours par les responsables des départements des monuments. Cette organisation colossale se conjugue avec la recherche du lieu principal pouvant accueillir toutes ces caisses d’œuvres. Plusieurs critères sont considérés : des endroits à l’écart des villes, permettant d’être éloignés des zones de conflit, mais aussi, des lieux « bien bâtis, […] à proximité de points d’eau pour les pompes à incendie, [et] capables de loger un personnel nombreux et disposer de conditions de conservations décentes »[1].
Chambord, un lieu d’accueil possible ?
C’est ainsi que le château de Chambord est désigné le 19 mai 1938 comme principal lieu de dépôt d’œuvres. Malgré les défauts du territoire, le choix est réfléchi. En effet, le château ne peut stocker que très peu de grands formats, a un plancher peu solide par rapport au poids des caisses et une cour qui ne facilite pas la circulation de camions de transport.
Après la répétition générale du 27 septembre 1938, Chambord est reconsidéré comme gare de triage, plutôt que lieu de dépôt. En plus de ses défauts premiers, il est vu comme « trop visible, trop repéré déjà par le public »[2] et ne permettant pas la bonne conservation des œuvres sans un travail conséquent de l’administration des Beaux-Arts. Il s’en suit le choix de 27 châteaux et abbayes pour abriter les œuvres.

© Archives nationales
Un déplacement précipité
Le 27 août 1939, trois jours après la publication du pacte de non-agression germano-soviétique, la direction des Musées de France ordonne d’évacuer les collections nationales des grands musées français. Parmi eux se trouvent ; les musées du Louvre, de la Marine, des Arts décoratifs ou encore le château de Versailles. Cette disposition concerne également les biens confiés à la garde des musées nationaux, notamment ceux de 94 collectionneurs juifs. Des milliers d’œuvres partent ainsi en camion vers le centre et l’ouest de la France, dont le domaine de Chambord. En tout, une cinquantaine de convois quittent le Louvre dans la précipitation entre août et décembre 1939, et plus d’un « tiers des collections publiques françaises sont évacuées en quelques jours »[3]. Certaines œuvres arrivent à Chambord et sont rapidement dispersées vers d’autres lieux de stockage.
Avec les aléas de la guerre, les impossibilités de transport, et la violation de la ligne Maginot, le domaine de François Ier devient le plus grand dépôt du pays. Les caisses de stockage (environ 4 000 m3) sont réparties dans les quelques 400 pièces du château. Parmi ces caisses se trouvent des chefs-d’œuvre de collections publiques et privées, comme Le Radeau de la Méduse, La Dame à la licorne ou encore La Joconde.
C’est cette scène que le château a souhaité illustrer dans la première salle de l’exposition : des caisses, des draps et un fac-similé de La Joconde à moitié emballée, comme laissée pour compte. Les murs affichent des photos d’époques, et expliquent le voyage de ces œuvres dans une France occupée. Trois autres salles prolongent l’histoire via l’audiovisuel, et permettent, pour les réticents à la lecture, d’en apprendre davantage et de manière ludique sur ce dépôt de la Seconde Guerre Mondiale.

La vie dans les dépôts © Archives nationales
Une surveillance accrue
Ces œuvres ne sont pas laissées à la décrépitude, des conservateurs et fonctionnaires s’en occupent régulièrement. Elles sont inventoriées et récollées ; chaque année, les caisses sont ouvertes pour inspection et la paille changée. De plus, les gardiens, des vétérans de la Grande Guerre, sont entrainés à n’importe quel cas de force majeur, notamment à savoir gérer les incendies.
Toutes ces dispositions n’évitent pas l’encerclement du domaine par les nazis à partir de 1940, la saisie de biens juifs par l’ERR[4] en 1941, ainsi que des bombardements ou crash d’avion proche des lieux de dépôts tout au long du conflit.
À partir de 1944, des œuvres d’arts des collections publiques et privées sont récupérées par le service américain Monuments, Fine Arts, and Archives program, en collaboration avec Jacques Jaujard, directeur des Musées nationaux. Cela permet de retrouver 60 000 œuvres volées. Encore aujourd’hui, certaines pièces appartenant à des familles juives attendent leurs propriétaires dans les réserves et salles des musées, et d’autres n’ont toujours pas été retrouvées.
Quant à celles appartenant aux collections publiques, chacune retrouvent leurs places, entre juin 1945 et fin 1949. Le Louvre rouvre partiellement durant la saison estivale de 1945 et Chambord suit en 1946.
Ainsi, cette exposition permet d’appréhender facilement l’histoire de notre patrimoine artistique durant la Seconde Guerre Mondiale, et ses conséquences encore actuelles. Elle met en lumière l’importance de la protection des œuvres en période de conflit, la perpétuation de celles-ci comme symboles d’un temps révolu, mais toujours inspirant. En détruire, ou en favoriser certaines comme le souhaitait le projet du Fuhrermuseum invisibilise une partie de l’Histoire et ne permet pas à la société de garder une trace des erreurs de son passé.

Retour de la Victoire de Samothrace © Archives nationales
L’exposition honore les gardiens de ces œuvres d’art. Elle montre le réel dévouement à une cause commune, parfois au péril d’une vie. Encore aujourd’hui hommes et femmes œuvrent à travers le monde pour protéger, déplacer ou encore restituer des objets d’arts provenant de zones de conflits.
Klein Elise
#Chambord #Histoire #WWII
Pour en savoir plus :
- Pour découvrir l’exposition permanente du château de Chambord : Domaine ouvert tous les jours de l’année sauf le 1er janvier, le 27 novembre et le 25 décembre :
Du 2 janvier au 24 mars : 9h – 17h
Du 25 mars au 29 octobre : 9h – 18h
Du 30 octobre au 22 décembre : 9h – 17h
Du 23 décembre au 30 décembre : 9h – 18h - En apprendre plus sur cette exposition via une vidéo créée par le domaine : https://www.youtube.com/watch?v=8IBeUHxbnaQ
- Ou via une vidéo de l’INA : https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/afe86003230/l-art-retrouve-de-chambord-au-musee-du-louvre
[1] Ibid.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Commission chargée de la confiscation des biens juifs de l’Europe occupée.

Dialogues photographiques en Asie
L'atelier "Concordances et jeux visuels" invite les visiteurs du musée Guimet de Paris, à aiguiser leur regard sur les oeuvres de la collection permanente du musée national des arts asiatiques (MNAAG).
La photographe Nadia Prete accompagne les participant(e)s de cet atelier grand public dans cette balade photographique. En binôme, chacun(e) parcourt le musée, découvre les formes et les détails : une démarche favorisant un nouveau dialogue visuel.
En savoir plus :
- Photos sur le compte Instagram du musée Guimet
- Collections en ligne du musée national des arts asiatiques
- Conférence le 1er avril sur Margaret Bourke-White, par la photographe Nadia Prete
- Prochains ateliers animés par Nadia Prete les samedis 25 juin et 9 juillet 2017 à 14h.
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.
Jérôme Politi (réalisation vidéo)
Hélène Prigent (article)
29 mars 2017
#jeux
#Asie
#baladeartistique

En route pour Tatihou ! "Flottes et fracas", une exposition en immersion
Tatihou est une île. Une petite île de moins d'un km² au large de Saint-Vaast-la-Hougue, sur la presqu'île du Cotentin. Sur cette île, un petit musée. Comment y aller ? En roulant ou en flottant, tout dépend de la marée. Et oui, le bateau a des roues !
© Musée maritime de l'île Tatihou, J. Petremann
©Office de tourisme Cherbourg - Cotentin
 Après un périple à travers les parcs à huîtres, nous arrivons sur la cale du petit port de l'île. Nous déposons nos affaires dans notre petite chambre et partons à l'aventure...
Après un périple à travers les parcs à huîtres, nous arrivons sur la cale du petit port de l'île. Nous déposons nos affaires dans notre petite chambre et partons à l'aventure...
Deuxpossibilités : commencer par le tour de l'île, verte et sable, turquoise quand le soleil arrive, ou se diriger vers les bâtiments protégés par l'enceinte de l'ancien lazaret, le musée, caché au fond d'un jardin d'acclimatation luxuriant. Le soleil est de sortie, ce sera le tour de l'île ! Personne malgré le beau temps de septembre, la seule population est constituée des moutons qui entretiennent l'île et de quelques oiseaux de la réserve.
La pluie nous rattrape et nous entrons dans le musée. Flottes et fracas, les épaves de La Hougue, 1692est un circuit permanent exposant les résultats des fouilles menées par le DRASSM de 1990 à 1995 sur les épaves de douze vaisseaux français coulés en 1692 par les Anglais.
Un parcours d'exposition chronologique et immersif
Retraçant les raisons historiques, économiques et politiques qui ont amené à cette bataille, l'exposition démarre par une galerie de portraits rouge vif, peut-être pour montrer que ça commence à chauffer...Les portraits sont en majeure partie des fac-similés, mais leur majesté montre bien les forces en présence, les personnalités engagées, Jacques II, Louis XIV, l'amiral Tourville...
Ensuite, place à la préparation ! Fini le carrelage ; le sol se retrouve tout de bois vêtu, l'ambiance change. Nous voilà dans un autre univers... Le choix du bois, les outils et les différentes étapes de construction des vaisseaux du roi sont expliqués à l'aide de maquettes et d'objets très parlants. Quarante-quatre vaisseaux vont appareiller de Brest le 12 mai 1692. Mais avant de partir, il faut bien les armer et faire le plein de vivres et d'armes. Poulies et caps de mouton, matériel de voilerie, barriques et pièces de gréement sont présentés comme des trésors, choisis parmi les nombreux objets retrouvés sur les épaves de La Hougue.
©Musée maritime de l'île Tatihou
 Plus loin, l'atmosphère change encore : à bord du bateau, les voiles sont à poste, le bois craque au gré de la houle, on sentirait presque le sol bouger. « Hissez les voiles ! », c'est l'occasion de tester nos forces en manipulant un modèle réduit de palan de grand-voile (la poulie centrale mesure tout de même 60cm de haut !) pour comprendre la démultiplication permise par les poulies. À bord, la vie s'organise selon des rythmes précis, des affectations pour chacun, des moments inévitables. Les instruments de navigation côtoient les objets de la vie quotidienne, les uns n'allant pas sans les autres. Matelots, officiers ou surnuméraires, tous sont évoqués par des objets personnels, allant de la pipe rudimentaire en os aux travaux d'art populaire fins et ouvragés.
Plus loin, l'atmosphère change encore : à bord du bateau, les voiles sont à poste, le bois craque au gré de la houle, on sentirait presque le sol bouger. « Hissez les voiles ! », c'est l'occasion de tester nos forces en manipulant un modèle réduit de palan de grand-voile (la poulie centrale mesure tout de même 60cm de haut !) pour comprendre la démultiplication permise par les poulies. À bord, la vie s'organise selon des rythmes précis, des affectations pour chacun, des moments inévitables. Les instruments de navigation côtoient les objets de la vie quotidienne, les uns n'allant pas sans les autres. Matelots, officiers ou surnuméraires, tous sont évoqués par des objets personnels, allant de la pipe rudimentaire en os aux travaux d'art populaire fins et ouvragés.
Exposer les batailles
©Musée maritime de l'île Tatihou

©Musée maritime de l'île Tatihou
 Redécouvertes en 1985, les épaves des vaisseaux français sont alors étudiées par une équipe d'archéologues sous-marins, dirigée par Michel L'Hour et Elisabeth Veyrat. « Retour vers le futur » avec la cloche de plongée, utilisée juste après les naufrages pour récupérer les pièces de bois intéressantes et les canons sur les épaves. Aujourd'hui les fonds sous-marins de la Manche sont plutôt calmes, la houle s'entend encore, mais elle nous porte, elle ondoie,et elle dévoile les épaves et leurs secrets... Sitôt sortis de l'eau il faut s'en occuper, les traiter pour qu'ils ne se désagrègent pas, les étudier pour pouvoir les valoriser et reconstituer l'histoire.
Redécouvertes en 1985, les épaves des vaisseaux français sont alors étudiées par une équipe d'archéologues sous-marins, dirigée par Michel L'Hour et Elisabeth Veyrat. « Retour vers le futur » avec la cloche de plongée, utilisée juste après les naufrages pour récupérer les pièces de bois intéressantes et les canons sur les épaves. Aujourd'hui les fonds sous-marins de la Manche sont plutôt calmes, la houle s'entend encore, mais elle nous porte, elle ondoie,et elle dévoile les épaves et leurs secrets... Sitôt sortis de l'eau il faut s'en occuper, les traiter pour qu'ils ne se désagrègent pas, les étudier pour pouvoir les valoriser et reconstituer l'histoire.
L'exposition est finie, le reste du musée est à explorer, l'île n'a pas encore livré tous ses secrets...
Flottes et fracas, les épaves de La Hougue, 1692 est une exposition remarquable, et surtout très surprenante dans un endroit comme Tatihou. Le parcours chronologique choisi semble tout à fait logique et se déroule de manière très fluide, notamment grâce aux différentes ambiances créées par la scénographie. Sans surenchère, celle-ci nous emmène au cœur du sujet, de la construction des vaisseaux du Roi à la bataille, puis à leur naufrage et leur dernière demeure, sous l'eau. Nombreux pour une exposition de cette taille, les différents outils de médiation sont toujours bienvenus, faciles à comprendre et à utiliser. Les textes ne sont pas rébarbatifs et permettent une très bonne compréhension des facteurs qui ont amené au naufrage des douze vaisseaux du Roi, et des problématiques de l'archéologie sous-marine en Manche.
Le Musée maritime de l'île Tatihou
Le Musée maritime de l'île Tatihou ouvre au public en 1992. Son programme scientifique et culturel a pour vocation de présenter le mobilier archéologique des fouilles sous-marines des épaves de La Hougue, l'occupation de l'île depuis l'âge de Bronze jusqu'à aujourd'hui, l'histoire et l'ethnographie maritimes des côtes de Basse-Normandie, (histoire technique, économique et sociale de la pêche et des aménagements portuaires). Sous la responsabilité du Conservatoire du Littoral, elle présente aussi un volet histoire naturelle du littoral. Avec une gestion au niveau départemental, le musée de Tatihou présente des expositions de qualité malgré son accessibilité difficile, son manque de personnel et de moyens. Îlot culturel, îlot historique, il attire pas moins de 60 000 visiteurs par an, grâce à ses différentes installations touristiques (hébergement, restaurant, ateliers, festivals...).
Muséographie : Com&Graph
Juliette Lagny
#ethnologiemaritime
#tatihou
#muséographie

Espèces d'Ours !
« Espèces d’Ours » est l’exposition actuelle du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, ouverte jusqu’en juin 2017. Elle est adaptée de l’exposition « Ours, mythes et réalités » réalisée par le Muséum de Toulouse en 2013 et 2014. De par son thème et sa muséographie elle est susceptible d’attirer un vaste public. Cette exposition plonge le visiteur dans le monde des ours et permet d’en apprendre plus sur eux et sur leurs relations avec les hommes à travers les différentes époques. Elle sensibilise également les publics sur le danger d’extinction de certaines de ces espèces.
Vue du plateau central © Océane Caby
La première information qu’obtient rapidement le visiteur c’est qu’il existe huit espèces différentes d’ours, ce qui décloisonnent les représentations populaires dès le début du parcours en nous présentant des spécimens bien moins connus que l’ours brun ou l’ours blanc. Une rotonde accueille ainsi le public avec les huit espèces d’ours existantes naturalisées devant des images de leurs habitats naturels.
Le parcours de l’exposition est composé de cinq espaces portant chacun sur une thématique précise. Le premier présente les ours, leurs habitats naturels et leurscaractéristiques physiques à l’aide de manipulations. Le visiteur poursuit ensuite en découvrant les origines des ours modernes et leurs ancêtres. Le troisième espace, plus sociologique, évoque les rapports entre les hommes et les ours selon les époques. Vient ensuite la question de l’avenir des ours. Enfin l’exposition se termine sur un espace plus restreint que les précédents où le muséum dévoile à travers des photos, des œuvres et des spécimens naturalisés, des célèbres ours des collections du musée datant du XIXème et du XXème siècle. A la sortie de cette exposition temporaire, des plans « Parc’Ours » sont mis à la disposition des publics, les invitant ainsi à prolonger la visite à travers le Jardin des Plantes pour découvrir d’autres représentations d’ours.
La force de cette exposition est son aspect ludique. A travers le parcours beaucoup de manipulations, d’audiovisuels et de numériques sont à la disposition des visiteurs. De nombreux enfants se trouvent parmi eux et leur curiosité est assouvie grâce à tous ces dispositifs qui permettent de vivre l’expérience de visite autrement. Cependant pour un public plus averti, la question du contenu scientifique se pose. En effet, au vu de visiteurs de plus en plus en demande d’expériences au travers des expositions, les textes ne sont-ils pas trop simplifiés au profit des dispositifs multimédias ? Ce parti pris de rendre l’exposition la plus ludique possible a sans doute pour but d’attirer un jeune public et un public familial, et le pari est très certainement réussi, mais on peut alors se demander si cette volonté de divertir ne prend pas l’ascendant sur la dimension cognitive originelle d’une exposition.
De nombreuses vidéos jalonnent le parcours et offrent au visiteur un support différent que celui des textes pour obtenir des connaissances. Le documentaire « Le dessous des cartes - Des ours et des hommes » permet de faire une parenthèse pour réfléchir aux problèmes que rencontrent les ours au contact de notre espèce. Cette vidéo est d’ailleurs présentée dans un espace spécifique pour séparer les publics de l’exposition, le temps du visionnage.
Les dispositifs interactifs illustrent le discours de l’exposition en mettant à contribution le visiteur. Ainsi lorsque le phénomène d’hibernation est expliqué dans la première partie du parcours, le visiteur a la possibilité de ressentir la chaleur produite par le corps de la marmotte et de l’ours avant et pendant l’hibernation. Il n’y a qu’à poser sa main sur les empreintes pour sentir la variation de chaleur de ces animaux.
Dans la partie consacrée aux relations entre les hommes et les ours, deux dispositifs retiennent l’attentions des publics. La première est un écran tactile représentant une zone de fouilles. Le visiteur est invité à frotter l’écran avec son doigt pour trouver dans le sol fictif des ossements d’ours. Une fois la fouille terminée, il est possible d’avoir plus d’informations sur ces « découvertes » avec ce même écran tactile. La seconde manipulation est en interaction avec le mur d’art pariétal. Des représentations d’ours sont visibles sur certains panneaux mais pour d’autres il faut utiliser une lampe mise à disposition afin d’éclairer des zones où les traits des gravures ont été usés par le temps. Grâce à l’éclairage de la lampe l’image de l’ours réapparait.
Exemple de manipulation sur le mur pariétal © Océane Caby
L’exposition « Espèce d’Ours ! » est finalement très complète. Le visiteur peut interagir à la fois avec des objets, des multimédias, des manipulations, des textes ou encore des schémas tout en observant des animaux naturalisés.
Le caractère ludique se décline à travers des dispositifs de manipulations, l’utilisation de l’audiovisuel, la scénographie et le parcours de l’exposition, la hiérarchie claire des textes ou encore l’éclairage. Tous ces éléments font de la visite une expérience dynamique qui interpelle les publics.
#Ours
#Muséumd'HistoireNaturelle
#Ludique
Pour en savoir plus :
http://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/exposition/especes-ours
Exposition itinérante du Museum de Toulouse :

Et de la mort je vis les visages. In Flanders Fields, Ypres.
Le Musée In Flanders Fields de Ypres (Belgique) a délibérément choisi de montrer l'impact de la guerre sur les vies humaines et le paysage. Parti pris courageux qui a nécessité un important travail muséographique et scénographique. L'exposition permanente se décline en quatre parcours complémentaires et entremêlés proposant au visiteur une vue d'ensemble sur le sujet. Les axes chronologique, thématique et personnel (témoignages) sont complétés par un parcours réflectif. C'est ce dernier que je vais tenter d'analyser ici. Prenant la forme de quatre immenses tipis de béton, ces espaces sont disséminés à la croisée des parcours tout au long de la visite.
Nommés, faute de mieux, balises-totems par le musée, ces îlots m'ont plus fait penser à des béances provoqué par la guerre. Je rapprocherai ces espaces singuliers du travail artistique de Jochen Gertz sur les monuments aux morts de 14-18 et sur la Shoah. Je pense aussi aux deux "voids" du musée Juif de Berlin. Si l'on choisit d'entrer, dans la première balise, on peut voir des photographies en noir et blanc ainsi que les négatifs. Celles-ci présentées dans de petites vitrines éclairées insérées un peu partout dans les murs. Ces photographies nous montrent des cadavres de soldats allemands exécutés à Ypres. La force de ces images réside dans la posture des cadavres maintenus artificiellement assis à l'aide de mains d'hommes bien vivantes.
Le visiteur assiste, malgré lui, à une mise en scène d'un corps exécuté comme trophée. Au contact de l'image l'espace devient oppressant. L'impression d'étouffement s'accentue par les effets conjugués de la petitesse des vitrines, de l'artificialité de leurs lumières et de l'action de voir à laquelle nous sommes conviés de réfléchir. Cette réflexion sur le regard sera posée dans chaque balise, déclinée et déclenchée par une action différente.
Balise une et trois, Flanders Fields (c) Anne Hauguel
Dans la troisième balise, le visiteur doit lever la tête. Par ce mouvement, il peut voir, suspendus, tel des visages flottants, des portraits en noir et blanc. Une nuée d'oiseaux immobile et silencieuse : les gueules cassées nous regardent d'en haut. Comme si leurs stigmates, infligés par la guerre, révélaient la puissance fascinante de celle-ci. Comme si, prenant la place de Dieu, la guerre faisait de ces hommes marqués, ses anges monstrueux. Tout en ne pouvant détacher son regard, le visiteur est amené, par le geste et par l'espace, à interroger cette fascination.
Dans la quatrième et dernière balise, le visiteur cherche où regarder et ce qu'il doit voir. Soudain un reflet, le regard plonge et découvre au sol, comme s'il se penchait au dessus d'une tombe ouverte, un squelette étendu sur un lit terreux. Cette photographie en noir et blanc est reflétée par une vitre au dessus d'elle ; la mort se regarde dans un miroir. Et nous, humains, nous regardons la mort se regarder, mais celle-ci, ne nous regarde pas.
Void, bâtiment Libeskind, Musée Juif, Berlin, (c) Anne Hauguel
 Ces quatre balises fonctionnent par des moyens conjugués pour déclencher la réflexion chez le visiteur. Celui-ci doit mouvoir son corps et chercher l'image. Image qui lui montre la mort et la défiguration. L'espace de monstration est pensé comme un lieu de confrontation avec l'image et sa nature horrifique. Ce face à face nous demande d'interroger notre humanité et la mortalité de notre condition. Ces lieux nous appellent à une réflexion dont l'objet est la sacralité de cette humanité que la guerre met littéralement à mort. Cette réflexion, si elle peut être discursive peut aussi se faire sans langage, par le corps et les sensations qu'il subit dans ces espaces singuliers. Ces quatre balises empruntent au même registre que les deux salles vides, les "voids" du bâtiment Libeskind au Musée Juif de Berlin. Etnotamment de cet espace triangulaire et sombre, dans lequel on est amené à entrer avec des gens que l'on ne connait pas, et qui vous dépossède un instant de votre humanité pour vous plonger dans un monde sans langage, vide de sens.Pour penser l'impensable le Flanders Fields fait le choix de la frontalité et de l'action. Ainsi, confronté à la mort, en se déplaçant, le visiteur fait l'expérience de l'horreur indicible. Ici, l'acte de voir est si bien pensé par la muséographie et la scénographie, que le parcours échappe au débat stérile qu’entraîne toujours avec lui un espace strictement voyeuriste.
Ces quatre balises fonctionnent par des moyens conjugués pour déclencher la réflexion chez le visiteur. Celui-ci doit mouvoir son corps et chercher l'image. Image qui lui montre la mort et la défiguration. L'espace de monstration est pensé comme un lieu de confrontation avec l'image et sa nature horrifique. Ce face à face nous demande d'interroger notre humanité et la mortalité de notre condition. Ces lieux nous appellent à une réflexion dont l'objet est la sacralité de cette humanité que la guerre met littéralement à mort. Cette réflexion, si elle peut être discursive peut aussi se faire sans langage, par le corps et les sensations qu'il subit dans ces espaces singuliers. Ces quatre balises empruntent au même registre que les deux salles vides, les "voids" du bâtiment Libeskind au Musée Juif de Berlin. Etnotamment de cet espace triangulaire et sombre, dans lequel on est amené à entrer avec des gens que l'on ne connait pas, et qui vous dépossède un instant de votre humanité pour vous plonger dans un monde sans langage, vide de sens.Pour penser l'impensable le Flanders Fields fait le choix de la frontalité et de l'action. Ainsi, confronté à la mort, en se déplaçant, le visiteur fait l'expérience de l'horreur indicible. Ici, l'acte de voir est si bien pensé par la muséographie et la scénographie, que le parcours échappe au débat stérile qu’entraîne toujours avec lui un espace strictement voyeuriste.
Ophélie Laloy
Merci à Anne Hauguel pour ses photographies
Si vous souhaitez poursuivre la réflexion sur les conditions de monstration de l'indicible : In Flanders Fields Museum - Site web du musée
DIDI HUBERMAN Georges, L'image malgré tout, Les Editions de Minuit, Paris, 2004.
GERZ Jochem, La question secrète. Le monument vivant de Biron, Acte Sud, Paris, 1999.# "Grande Guerre"# Morts#In Flanders Fields Museum

Et l'armement on en fait quoi ?
Le 13 juin dernier, le réseau des musées et mémoriaux des conflits contemporains organisait une formation technique sur les collections d’armements au Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux.
Les armes à feu soulèvent de nombreuses questions au quotidien pour les professionnels des musées. La formation tentait de répondre à ces interrogations qui gravitent autour des modalités de conservation, d’exposition et de médiation autour de l’armement.
Car tout le monde n’est pas Jamie Foxx dans Django Unchained © The Weinstein Company
 La neutralisation d’une arme est une problématique en pleine reconsidération dans les institutions muséales ces dernières années. En effet, même si auparavant la démilitarisation de l’armement était systématique, aujourd’hui les musées s’interrogent. Les modifications qu’elle entraîne sur les objets sont irréversibles, ce qui ne permet pas de conserver l’objet dans son état original et va donc à l’encontre de la mission déontologique principale de la conservation. De nombreux musées ont fait le choix de ne plus neutraliser les armes et les équipements des collections (sauf obligation légale) ce qui induit automatiquement, pour le chargé des collections, une maîtrise parfaite des règles à respecter à la fois dans les réserves et dans l’espace d’exposition.
La neutralisation d’une arme est une problématique en pleine reconsidération dans les institutions muséales ces dernières années. En effet, même si auparavant la démilitarisation de l’armement était systématique, aujourd’hui les musées s’interrogent. Les modifications qu’elle entraîne sur les objets sont irréversibles, ce qui ne permet pas de conserver l’objet dans son état original et va donc à l’encontre de la mission déontologique principale de la conservation. De nombreux musées ont fait le choix de ne plus neutraliser les armes et les équipements des collections (sauf obligation légale) ce qui induit automatiquement, pour le chargé des collections, une maîtrise parfaite des règles à respecter à la fois dans les réserves et dans l’espace d’exposition.
Collections d’armement © Musée d’Art et d’Industrie de la ville de Saint Etienne, 2012
Comment savoir si une arme est neutralisée ou non ?
Les armes démilitarisées possèdent au moins un poinçon, généralement gravé sur les parties métalliques. Ce poinçon va permettre de savoir quelle entreprise a procédé à la neutralisation. Lors de la démonstration, sera pris l’exemple le plus connu : celui du Banc National d’Epreuve de Saint-Etienne. Il est désormais possible de demander un duplicata de certificat de neutralisation si l’arme n’est pas délivrée avec son certificat lors de l’acquisition. Il est important de pouvoir retracer l’histoire de l’arme surtout dans les circonstances actuelles où une arme pourrait avoir servi lors d’événements. La plupart des musées refusent des donations d’armes pour lesquelles ils ne peuvent connaître l’ancien propriétaire ou pour laquelle la neutralisation aurait été « faite maison » par un tiers.
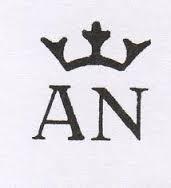

Poinçon avant le 8 avril 2016, poinçon après le 8 avril 2016
Comment acquérir dans les règles ?
La réglementation est stricte en ce qui concerne la possession, la conservation et l’exposition d’armement face à un public et si vaste qu’il est aisé de s’y perdre. Après un retour sur l’origine des armes à feu et leur évolution jusqu’à aujourd’hui en France, la première partie de la formation proposait de faire le tour des points essentiels des réglementations française et européenne. Cette mise à jour, faite par le Major Van Hove et l’Adjudant-chef Laurent du Musée de l’Armée, était nécessaire à tous les professionnels présents dans la salle puisque la nouvelle directive à rayonnement européen date du 17 mai 2017 et prend fonction petit à petit pour les institutions muséales françaises.
La réglementation, valable pour les institutions comme pour les civils, classe les armes à feu et l’armement en 4 catégories en France : la catégorie A qui sont les armes interdites, la catégorie B qui requiert une autorisation de la préfecture, la catégorie C qui requiert une déclaration à la préfecture du département et la catégorie D où un enregistrement est soit nécessaire pour la catégorie D1 et soit libre pour la catégorie D2. La réglementation européenne classe l’armement en seulement trois catégories, la catégorie D étant ajustable pour chaque pays. Il faut savoir que chaque catégorie possède des exceptions pour certains modèles d’armes ou d’équipements et qu’il est utile de se renseigner au cas par cas.
Une fois qu’on connait la catégorie d’une arme, comment l’utiliser ?
Ce classement est intéressant premièrement pour l’inventaire car cela va permettre de s’interroger sur les différents attributs d’une arme (modèle, année de fabrication, taille et qualité du canon, munitions, etc.) qui vont par la suite définir son affiliation à une catégorie. Mais plus important encore, connaître la catégorie de chaque arme détenue permet de tenir le cahier de police, document rempli par le chargé des collections, qui permet de faire état des lieux des différentes armes conservées et exposées en cas de contrôle. Si lors d’un contrôle, le musée n’est pas en mesure de présenter les catégories d’armes et des équipements ainsi que les documents qui y sont liés, la préfecture peut décider de saisir les objets mais également de les détruire. Lors de cette formation on apprendra que les musées peuvent se protéger d’une manière simple. En effet, même s’il est décrété qu’un musée peut acquérir et conserver de l’armement de catégories A, B, C et D, l’institution peut demander une autorisation de détention au préfet pour l’ensemble de l’armement présent dans les collections. On apprendra également qu’en fonction des relations que la structure détient avec son préfet les choses peuvent prendre des tournures bien différentes ! Il en va de même pour les relations avec les démineurs lors de vérification sur des explosifs, à qui il est possible de demander un P.V pour autorisation de détention et d’exposition, mais qu’ils ne sont pas dans l’obligation de fournir.
Comment traiter l’acquisition d’une arme non neutralisée ?
Il est important en premier lieu de vérifier que l’arme n’est pas chargée, ni dans le magasin d’approvisionnement ni dans le canon, par un contrôle visuel des chambres. Un atelier de manipulation et démontage des armes à feu, animé par Yannick Marques du Musée de la Grande Guerre, durant l’après-midi permettait de voir les gestes à adopter et de les reproduire.
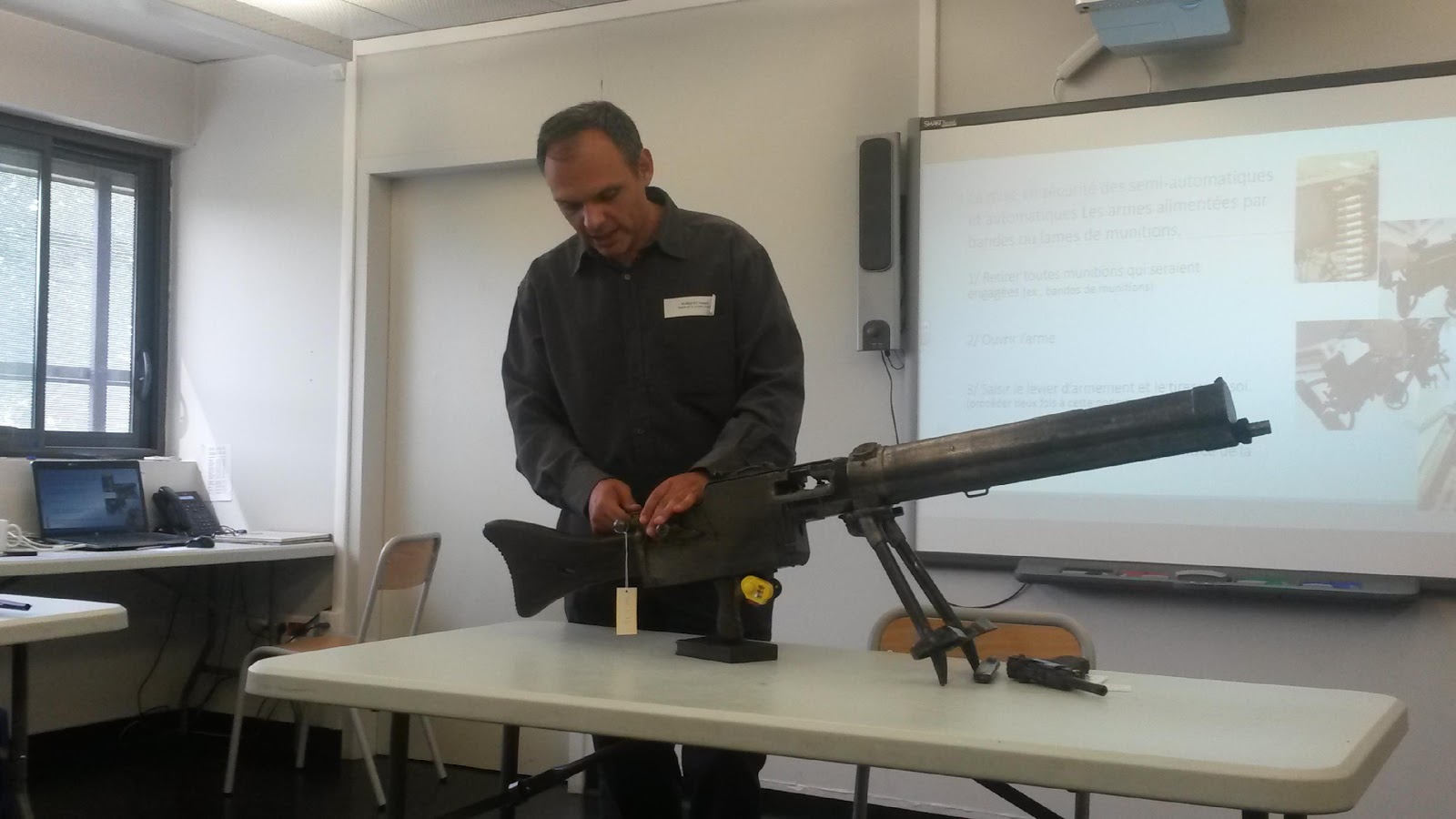

Atelier mise en sécurité des armes et neutralisation par le retrait d’un élément © Samantha Graas
Si un transport doit avoir lieu, l’arme doit être divisée en deux parties qui seront soit transportées dans deux véhicules différents et sous mallettes scellées, soit dans le même véhicule avec un verrou pontet sur la détente et sous mallettes scellées. Le convoyeur doit pouvoir justifier d’un motif légitime lors d’un contrôle.
Une fois arrivé au musée et traité, il est obligatoire de retirer une pièce du mécanisme de mise à feu avant sa mise en réserve. Une fois la pièce retirée et l’objet hors d’état de nuire, la pièce doit être mise dans un sachet et placée dans un coffre avec la référence de l’arme à laquelle elle appartient. L’arme quant à elle doit être placée idéalement couchée et enchaînée et cadenassée à son support.
L’absence de neutralisation complique une des missions essentielles d’un musée qui est le prêt et le dépôt des pièces de collections. Johanne Berlemont du Musée de la Grande Guerre, confiera aux participants qu’ils ont décidé de ne plus prêter les armes à moins qu’il s’agisse de structures françaises réputées qui peuvent donner une garantie concernant la sécurité ainsi qu’une autorisation de détention. Justifier le déplacement sur le territoire d’une arme non neutralisée n’est déjà pas aisé, ainsi le prêt et le dépôt à l’étranger est exclu.
Comment exposer une arme ?
Depuis deux ou trois ans existe une sensibilisation à l’armement dans les institutions muséales. Le retrait d’une pièce du mécanisme de mise à feu est devenu la première condition à la mise en exposition devant un public d’une arme non neutralisée. Dans l’idéal, les armes doivent également être fixées soit à leur socle soit directement au sol pour les armes présentées debout sur des mannequins par exemple.
En dehors des conditions de sécurité il existe aussi des interrogations sur les meilleures manières de présenter des armes à feu face à un public. Montrer ses plus belles pièces risquerait de susciter de la fascination pour un bel objet plus que de diriger un visiteur vers un discours. Johanne Berlemont nous explique qu’avant l’ouverture du Musée de la Grande Guerre, la question de la présentation de l’armement était essentielle car il était un point d’ancrage d’une grande partie du discours. Le musée a donc choisi trois moyens de présentation différents en fonction du rapport que le public peut avoir avec l’arme à feu. La première méthode a été le mannequinage très réaliste, avec des corps à l’échelle 1 et des visages moulés sur des personnes existantes. Cette présentation permet non seulement de montrer un ensemble complet d’uniforme, matériel et armement d’un soldat mais également de donner une attitude, un mouvement. Les armes n’ont alors pas été fixées pour qu’elles puissent être tenues dans les mains ou rangées sur l’épaule dans un souci de réalisme. Présente en grande partie dans le musée, elle est un atout majeur dans le parcours de visite de l’espace d’exposition permanente. Les visiteurs peuvent alors s’identifier plus aisément à l’humain, se comparer en taille et en carrure et ainsi se rapprocher du côté sensible de la Grande Guerre.


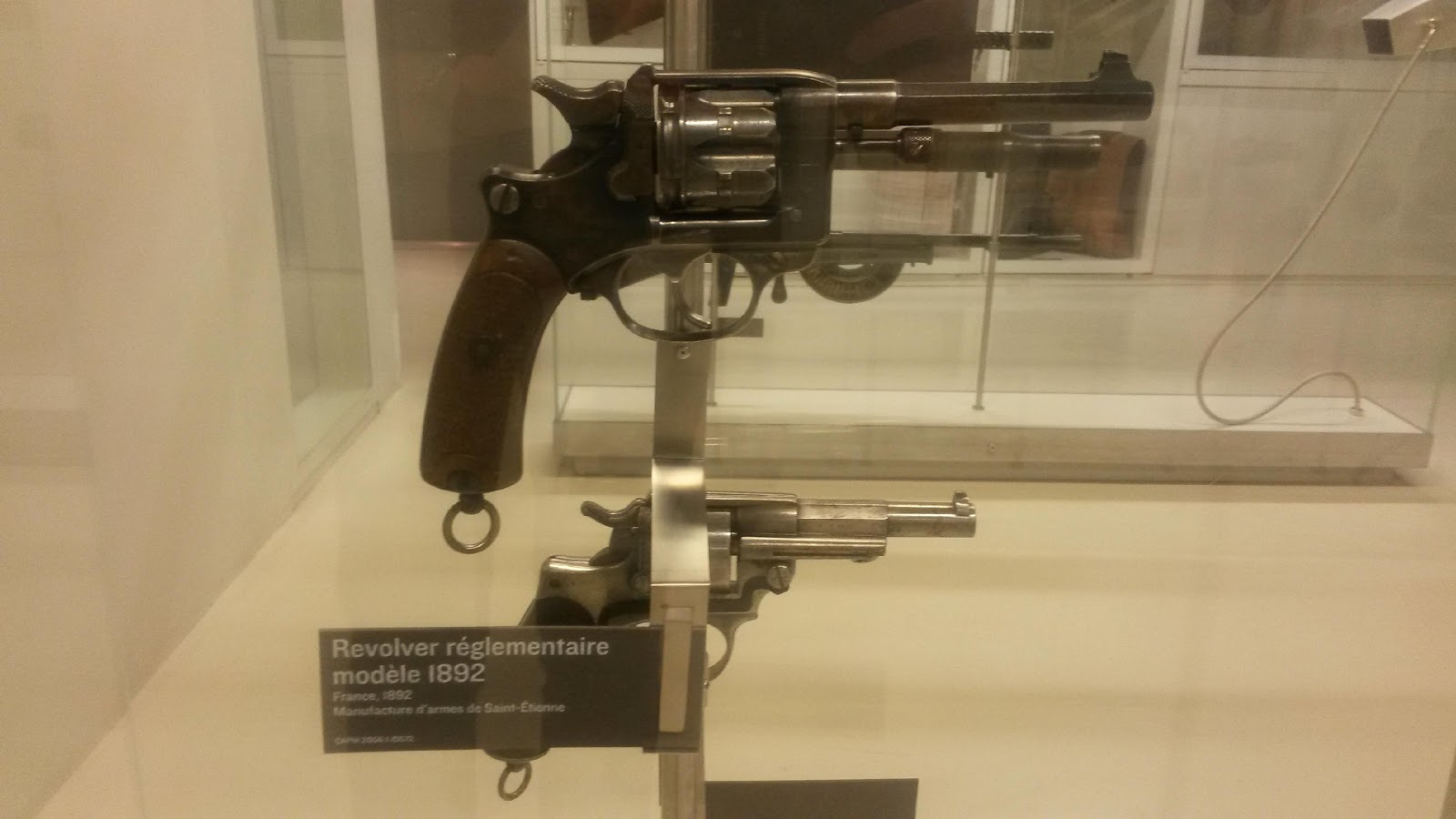
De gauche à droite : mannequinage réaliste, abstrait et présentation arme seule © Samantha Graas
Le mannequinage abstrait est quant à lui un moyen de montrer un ensemble mais qui ne suggère l’humain que par l’assemblage des pièces. L’arme est souvent exposée debout, dans la continuité avec le bras, et elle est fixée dans le sol. Enfin l’arme peut être exposée seule, sans contexte d’appartenance à une unité afin de se concentrer sur l’objet en lui-même et de pouvoir l’approcher de plus près. Elle est alors fixée à son support ou son socle.
Comment se passe la médiation autour d’une arme ?
Atelier médiation autour de l’armement © Samantha Graas
 Au Musée de la Grande Guerre, 40% des visites annuelles sont représentés par les scolaires. Pour les médiateurs en charge des groupes il est essentiel d’avoir un discours teinté en matière d’armement. En effet, il est difficile pour un médiateur d’évincer la fascination des enfants pour les armes à feu ou encore les chars qu’ils ont l’habitude de voir dans les jeux vidéo ou les films. Mélanie et Charlotte du Musée de la Grande Guerre expliquent l’attrait des enfants pour certaines vitrines en particulier, par exemple celles des armes de poing qui sont plus accessibles en taille et plus présentes dans l’imaginaire collectif. Elles parlent également du côté humain qui est totalement exclu dans les questions des enfants qui sont plus portés sur l’authenticité des objets ou l’aspect scientifique de fonctionnement. C’est pourquoi elles décident d’utiliser le corps dans l’espace d’exposition comme outil de compréhension. Par exemple, placer deux adolescents de tailles différentes à côté des vitrines et leur demander de tendre le bras afin de voir les différences d’échelle face aux armes. Plusieurs manipulations permettent de soulever des poids afin de se rendre compte du poids des différentes armes et de se mettre à la place du soldat. Elles expliquent également qu’après la visite de « la salle des armes » (nommée ainsi par les enfants qui reviennent régulièrement) elles dirigent généralement le groupe vers la salle « corps et souffrance » afin d’aborder le sujet des impacts physiques et psychologiques. La liaison entre les deux se fait avec la plus grande subtilité et les enfants sont prévenus avant l’entrée dans chaque salle de ce qu’ils vont voir, les sujets qui vont être abordés afin qu’un enfant puisse signaler s’il ne souhaite pas visiter une salle. Le vocabulaire utilisé en fonction des âges est choisi pour décomplexifier le discours qui peut leur sembler parfois trop distancé ou tout simplement trop violent.
Au Musée de la Grande Guerre, 40% des visites annuelles sont représentés par les scolaires. Pour les médiateurs en charge des groupes il est essentiel d’avoir un discours teinté en matière d’armement. En effet, il est difficile pour un médiateur d’évincer la fascination des enfants pour les armes à feu ou encore les chars qu’ils ont l’habitude de voir dans les jeux vidéo ou les films. Mélanie et Charlotte du Musée de la Grande Guerre expliquent l’attrait des enfants pour certaines vitrines en particulier, par exemple celles des armes de poing qui sont plus accessibles en taille et plus présentes dans l’imaginaire collectif. Elles parlent également du côté humain qui est totalement exclu dans les questions des enfants qui sont plus portés sur l’authenticité des objets ou l’aspect scientifique de fonctionnement. C’est pourquoi elles décident d’utiliser le corps dans l’espace d’exposition comme outil de compréhension. Par exemple, placer deux adolescents de tailles différentes à côté des vitrines et leur demander de tendre le bras afin de voir les différences d’échelle face aux armes. Plusieurs manipulations permettent de soulever des poids afin de se rendre compte du poids des différentes armes et de se mettre à la place du soldat. Elles expliquent également qu’après la visite de « la salle des armes » (nommée ainsi par les enfants qui reviennent régulièrement) elles dirigent généralement le groupe vers la salle « corps et souffrance » afin d’aborder le sujet des impacts physiques et psychologiques. La liaison entre les deux se fait avec la plus grande subtilité et les enfants sont prévenus avant l’entrée dans chaque salle de ce qu’ils vont voir, les sujets qui vont être abordés afin qu’un enfant puisse signaler s’il ne souhaite pas visiter une salle. Le vocabulaire utilisé en fonction des âges est choisi pour décomplexifier le discours qui peut leur sembler parfois trop distancé ou tout simplement trop violent.
Ces réflexions, en pleine expansion, ont permis lors de ce temps de formation aux différents professionnels du monde muséal d’échanger sur les différentes expériences et solutions apportées par chacun. L’adaptation est à chaque fois différente en fonction des responsables, de l’espace muséal, du budget mais aussi du public. Il est important pour le personnel muséal de se mettre à jour dans ces questionnements en participant notamment à ce type de rencontre enrichissante qui donne des perspectives. Pour cela vous pouvez vous abonner à différents réseaux qui proposent un large panel de rencontres professionnelles aux thématiques contemporaines.
Samantha Graas
#armement
#M2GMeaux
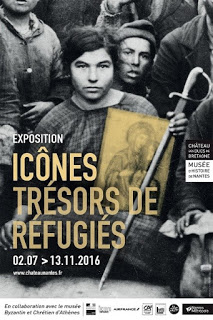
Exposer les icônes ; objets de culte ou de musée ?
L’exposition « Icônes, trésors de réfugiés »au château des ducs de Bretagne jusqu’au 13 novembre 2016
Affiche de l’exposition « Icônes, trésors de réfugiés ». Source : nantes.maville.com
L’exil grec
L’icône comme porte d’entrée dans l’Histoire grecque
Cette exposition place les icônes orthodoxes (une petite peinture sur bois d’un saint ou d’une sainte, vénérée dans la religion orthodoxe) au centre de la problématique de l’exil des grecs d’Asie Mineure au début du XXème siècle.
 Dès l’introduction, des photos évoquent le départ des grecs de l’empire ottoman. L’histoire est complexe et peu connue du grand public, c’est pourquoi à chaque début de séquence une vidéo présente l’évolution du contexte politique et des flux migratoires entre les différents territoires.
Dès l’introduction, des photos évoquent le départ des grecs de l’empire ottoman. L’histoire est complexe et peu connue du grand public, c’est pourquoi à chaque début de séquence une vidéo présente l’évolution du contexte politique et des flux migratoires entre les différents territoires.
Un bref récapitulatif replace la situation des grecs en méditerranée orientale, principalement en Turquie. Une succession de conflits (guerre des Balkans, Première Guerre mondiale et guerre gréco-turque) vont redéfinir la carte des Etats et conduire à des déplacements de populations importants.
Carte des expulsions et déplacement des populations entre la Grèce et la Turquie de1830 à 1924. Source : cybergeo.revues.org
Au plus près des icônes
Recréer les iconostases
La scénographie très réussie accueille le visiteur par une vierge episkepsis (c’est une vierge à l’enfant qui est synonyme de protection et de refuge : une thématique qui fait écho dans l’exposition) en mosaïque et des photographies de départs demigrants. Le lien est ainsi posé entre l’icône et le départ.
 Au plan esthétique, les icônes sont mises en valeur dans toute leur richesse avec un espace sur fond rouge et une lumière ciblée. Des cartels à mi-hauteur (qui ont la capacité de s’effacer suivant la perspective) nous présentent la particularité de chaque saint et sainte représenté. Au centre, une bulle scénographique place le visiteur dans une relation intime avec l’objet placé dans des alcôves dorées. Le but est de recréer les iconostases ; ces murs d’icônes qui ornent les maisons et églises des chrétiens orthodoxes. Le lien avec la religion et leculte de l’icône est très important à comprendre au début de cette exposition.
Au plan esthétique, les icônes sont mises en valeur dans toute leur richesse avec un espace sur fond rouge et une lumière ciblée. Des cartels à mi-hauteur (qui ont la capacité de s’effacer suivant la perspective) nous présentent la particularité de chaque saint et sainte représenté. Au centre, une bulle scénographique place le visiteur dans une relation intime avec l’objet placé dans des alcôves dorées. Le but est de recréer les iconostases ; ces murs d’icônes qui ornent les maisons et églises des chrétiens orthodoxes. Le lien avec la religion et leculte de l’icône est très important à comprendre au début de cette exposition.
Première salle sur les icônes. Source :nantes.maville.com
Les icônes traversent les conflits
Du conflit à l’intégration : l’icône pour rebâtir
Puis, c’est la « Grande Catastrophe », le traité de Lausanne en 1923 est clair, les ressortissants grecs et turcs doivent regagner leur pays d’origine. Des flux de migrations importants commencent de manière plus ou moins violente. L’épisode est raconté par des lettres mises en relation avec une carte de Smyrne (ville stratégique au bord de la mer Egée qui comptait plus de grecs que de turcs). Ce conflit est aussi raconté du point du vue des grandes puissances occidentales à travers des extraits et des journaux originaux, comme le célèbre Excelsior.
Titres des journaux internationaux à propos du conflit gréco-turc. Source : C.Daban
 Est ensuite abordée l’arrivée en Grèce des nouveaux immigrés, ce qui n’a pas été simple. Certains ne parlent pas la langue, on ne leur laisse pas le choix de leur nouveau lieu d’intégration, et cela cause des tensions avec les populations juives et musulmanes anciennement majoritaires sur une partie du territoire. Quelques reproductions de photographies permettent d’expliquer ces évènements.
Est ensuite abordée l’arrivée en Grèce des nouveaux immigrés, ce qui n’a pas été simple. Certains ne parlent pas la langue, on ne leur laisse pas le choix de leur nouveau lieu d’intégration, et cela cause des tensions avec les populations juives et musulmanes anciennement majoritaires sur une partie du territoire. Quelques reproductions de photographies permettent d’expliquer ces évènements.
L’espace suivant évoque l’intégration de migrants grecs en France, où le visiteur saisit l’importance de l’icône avec laquelle ils étaient partis et qui ont servi pour rebâtir des églises. La scénographie le plonge une nouvelle fois dans une très belle évocation de ces lieux de culte.
Beaucoup plus que des objets de culte
L’icône un symbole « à part »
 L’exposition se termine en tirant le fil de la place de l’objet aujourd’hui, et en montrant son changement de signification. Entre objets de culte et objets d’art, les icônes, admirées par des fidèles, obéissent à des règles théologiques, mais elles ont aussi une valeur historique, artistique et sentimentale. Tout cela en fait un objet « à part ».
L’exposition se termine en tirant le fil de la place de l’objet aujourd’hui, et en montrant son changement de signification. Entre objets de culte et objets d’art, les icônes, admirées par des fidèles, obéissent à des règles théologiques, mais elles ont aussi une valeur historique, artistique et sentimentale. Tout cela en fait un objet « à part ».
Trois histoires à emporter sont disponibles au sein du parcours. Ces extraits nous permettent de garder unetrace du symbole que représentent les icônes, et de le transmettre à notre tour.
Espace sur la reconstruction et la transmission des générations futures de grecs orthodoxes. Source : C. Daban
Des icônes qui résonnent dans notre actualité
« Dans un monde où tout circule librement, le droit à la mobilité des êtres humains ne va pas de soi »
Pour finir sur une note d’espérance ? ou interculturelle, une musique de Maria Farantouri et Zülfü Livaneli, San to Metanosti, Comme l’Emigrant (une chanteuse grecque et un compositeur turc qui travaille pour le rapprochement de leurs deux peuples) résonne à la fin du parcours, ainsi qu’une belle citation qui conclut notre découverte des icônes et de leurs rôles dans la fuite des grecs d’Asie mineure : « Dans un monde où tout circule librement, le droit à la mobilité des êtres humains ne va pas de soi. Il y a urgence à définir un droit international des migrants. C’est à ce prix que les mouvements migratoires ne seront plus considérés comme une menace par les uns et une utopie par les autres, mais enfin comme la clé d’un développement plus équitable. »[1]
Cette exposition présente non seulement une très belle collection d’objets d’art, mais tient aussi un propos historique très pertinent. Elle pose les questions encore actuelles du déplacement forcé de populations, de l’intégration des migrants, et de la reconstruction d’une identité grâce à des objets conservés pendant la fuite.
Charlotte DABAN
Pour plus d’informations : http://www.chateaunantes.fr/fr/evenement/icones
[1] Catherine Wihtol de Wenden. Le droit d’émigrer, CNRS Editions, 2013

Exposition Amazonie : l’immersif au service de l’engagement
Amazonie, le chamane et la pensée de la forêt
L’exposition présentée au Château des Ducs de Bretagne de Nantes offre au public une partie de collections inédites. Le Musée d’ethnographie de Genève conserve l’une des plus importantes collections amazoniennes d’Europe. Il s’associe au Château des Ducs, parmi d’autres musées, pour cette exposition itinérante en constante évolution.
Structurée en deux parties, l’exposition propose une première approche factuelle des travaux européens, et tout particulièrement suisses, menés sur le sujet de l’Amazonie et des peuples amazoniens.
Des parures, des armes, des instruments de musique et des objets usuels illustrent les présentations avec une quinzaine de populations, parmi lesquelles les Wayana, les Yanomami, les Kayapó ou encore les Shuar. Expressions de la symbiose avec le monde de la forêt et des esprits, ces témoins de la culture matérielle permettent d’aborder la pratique du chamanisme, commune à toutes les populations du bassin amazonien.
Le parcours de l’exposition
Certainement par une contrainte d’espace, l’exposition se situe sur deux étages. Cette contrainte est cependant tournée à l’avantage du musée qui sait parfaitement utiliser son espace afin de servir son propos.
L’introduction et la première partie de l’exposition se font ainsi sur tout le rez-de-chaussée. La visite débute avec l’histoire précolombienne de l’Amazonie, des origines à la conquête, ainsi qu’à celle des collections qui lui font écho, jusqu’à l’époque actuelle. Les témoignages des populations amazoniennes permettent d’aborder les questions de leur sauvegarde et de la disparition de la forêt. Cette section permet de contextualiser les découvertes, mais également d’aborder, de manière factuelle, certaines des nombreuses civilisations présentes sur ces territoires.

Xabono © Château des Ducs de Bretagne
Dès cette première salle, la lumière est tamisée. Le public est prévenu : cette faible luminosité est dans un but de conservation préventive, dû à la sensibilité des costumes traditionnels souvent confectionnés de plumages. Le public est ensuite invité à entrer dans un Xabono, construction en bois (photographie ci-dessus) érigée à la lisière de la forêt. Seules quelques parures sont présentées : ce qui interpelle dès l’entrée, ce sont ces nombreuses photos de scènes de vie quotidienne de la fin du XXe siècle aux années 2010, témoins de mode de vie en constante évolution dû à l’occidentalisation des villes environnantes. Une tablette et deux écouteurs sont mis à disposition pour regarder et écouter des témoignages d’acteurs autochtones, qu’ils et elles soient leaders de communauté ou étudiant.e.s.

Intérieur du Xabono © David Gallard_LVAN
Un bémol : les textes des salles sont inondés de vocabulaire complexe. Du mot « paupérisation » à « inéluctablement », le vocabulaire emprunté est loin d’être accessible à un public large, alors que les médias locaux annoncent une exposition familiale aux nombreuses activités pour enfants.
Avant d’emprunter les escaliers pour passer à la suite, un fond (à l’image de la communication de l’exposition et des panneaux portant des slogans écologistes) nous invite à prendre une photo afin de la poster sur les réseaux avec un hashtag précisé. Ce dispositif, très certainement pensé pour la fin de la visite, comme espace de conclusion au parcours forçant les visiteur.e.s à revenir sur leurs pas (obligation dûe à l’architecture du bâtiment), il peut être également envisagé comme une pause à la fois ludique et responsabilisante, avant d’entrer dans le vif du sujet.
Une fois les escaliers montés, le public est tout de suite plongé dans une atmosphère immersive. Guidé.e.s par une lumière encore plus tamisée, les visiteur.e.s déambulent aux rythmes des instruments des chamanes. Un jeu multimédia permet de faire directement connaissance avec ces instruments méconnus voire inconnus en occident, pour ensuite procéder au reste de la visite en reconnaissant les sons et les voix.
Les peuples amazoniens sont présentés, localisés, rappelés à l’aide d’une carte sous chaque cartel. La déambulation continue son cours, sous les couleurs vives et attirantes des costumes et des objets, quand soudain…

Exposition Amazonie. Le Chamane et la Pensée de la forêt © David Gallard_LVAN
La douce musique berçante jusqu’ici est interrompue par un bruit. Bruit terrible, haut volume : on reconnaît très nettement le bruit d’une tronçonneuse. Désagréable, il dure une dizaine de secondes, jusqu’à ce qu’on entende la chute d’un arbre… Puis, silence… Les bruits de la forêts reprennent, ainsi que les chants et musiques des chamanes.
L’immersif au service de l’engagement
Cette intervention sonore est bien plus prenante qu’on ne pourrait l’imaginer. Le son stoppe la visite, les conversations, ou au contraire la voix monte car on ne s’entend plus.
Le son de l’arbre qui tombe et le silence qui le suit deviennent subitement très lourds de sens. Personne n’est aujourd’hui sans savoir ou avoir du moins une idée vague de la situation catastrophique de l’Amazonie. Qu’il s’agisse des incendies récents produits cet été, de sa surexploitation par les nord-américains et les occidentaux depuis ces trente dernières années, mais également de l’écosystème complet remis en question au nom du « progrès », ce simple bruit de tronçonneuse presque assourdissant en vaut mille mots d’explications. Une volonté de sensibiliser, indispensable aujourd’hui.
À la fin du parcours, le Château des Ducs va plus loin : il propose à ces visiteur.e.s de devenir acteurs et actrices du changement.
Pour le peuple Ashaninka, vivant au Pérou et au Brésil, les puits sont à sec pendant la saison sèche. Et boire l’eau de la rivière, polluée par l’exploitation minière, est dangereux. L’association genevoise Aquaverde a été associée à cette exposition pour lancer un appel aux dons afin de financer des « safe water cube », fontaines qui permettent de filtrer 1 000 litres d’eau par heure. Pendant les six mois de l’exposition Amazonie, l’équipe du musée et Aquaverde espèrent récolter les 5 500 € nécessaires à l’achat, l’installation et la formation à l’utilisation d’une de ces fontaines.
« Nous voulons que cette exposition soit utile : on veut donc offrir la possibilité aux visiteurs de devenir acteurs en faisant un don pour financer ces fontaines », explique Krystel Gualdé, directrice scientifique du musée.
Julia Parisel
#Immersionsonore
#scénographie
#urgenceécologie
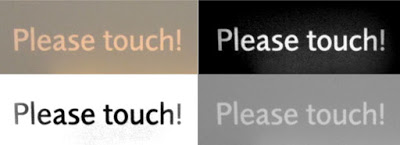
Faire l’expérience de la conservation-restauration à l’Ashmolean Museum d’Oxford
Lors de notre visite à l’Ashmolean Museum nous avons découvert, dans les sous-sols du musée, un espace d’exposition dédié à la présentation des collections et à l’explicitation de la pratique de la conservation-restauration. En plus de donner de la visibilité à une action généralement méconnue du grand public, tout ce qui fait l’attractivité de ce parcours est qu’il est également doté de plusieurs dispositifs interactifs et de manipulations.
© A.G.
L’Ashmolean Museum d’Oxford
L’actuel Ashmolean Museum d’Oxford a été fondé au tout début du XXe siècle sur la fusion des anciennes collections du musée éponyme et des collections d’art de l’Université de la ville, jusqu’alors présentées dans la Bodleian Library. Le musée compte une grande variété de départements : d’antiquités, d’art oriental, d’art occidental (du Moyen-âge à nos jours), de numismatique ou encore de moulages. Toutefois, nous nous intéresserons ici plus spécifiquement à la façon dont le musée évoque au sein même de ses espaces d’expositions deux de ses missions essentielles : la conservation et la restauration.
Sensibiliser les publics
« Merci de ne pas toucher », « Flashinterdit »…sont autant de recommandations auxquelles sont confrontés les visiteurs. Une fois sortis des réserves les objets sont en effet exposés à un certain nombre de risques, autant liés aux visiteurs qu’à l’atmosphère ou encore à la température de la pièce. D’une certaine manière les réserves restent encore les lieux les plus sûrs pour assurer leur bonne conservation, mais cela est loin d’être une solution à long terme. Ainsi, il est légitime de se demander si dicter de simples consignes aux visiteurs est vraiment la seule solution pour garantir à la fois la bonne préservation des objets et leur exposition au public ?
Grâce à ces différents dispositifs, le parti pris de l’Ashmolean Museum est plutôt de donner des clefs de compréhension aux visiteurs afin de les sensibiliser aux enjeux de la conservation-restauration.
« Objects are fragile »
© A.G.
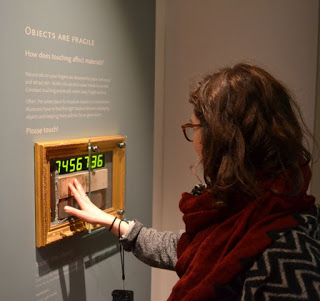
Faire entrer les publics dans les coulisses du musée
En pénétrant dans les « coulisses » du musée, les visiteurs expérimentent par eux-mêmes les techniques et les méthodes de la conservation-restauration.
« Exploringwith light »
© A.G.
Face aux visiteurs se présentent trois objets, placés dans des vitrines. En dessous de chacune d’elles sont disposés des capteurs devant lesquels les visiteurs sont invités à passer leur main. Par cette action, ils activent différents types de lumière sur l’objet. Leur est aussi explicitée par de courts textes, la fonctionnalité de chacune. Pour exemple la lumière UV qui révèle les différences de matériaux, permet potentiellement de découvrir des restaurations antérieures. Les visiteurs sont sollicités pour trouver par eux-mêmes si la sculpture a été réparée ou non par plusieurs questions : « Do you think this piece might have been repaired ? ».
« Conservation Lab »
© A.G.

À l’aide d’un petit carnet et de deux loupes les visiteurs sont conviés à examiner les objets sous vitrine. Pour chaque objet ils sont guidés dans leur expertise grâce à plusieurs questions qui leurs sont posées : « What other colours do you see ?What materiel do you think this knife is madeof ? ». Cesdispositifs permettent aux visiteurs de comprendre les gestes qu’implique la conservation-restauration. Ils ne font cependant pas qu’expérimenter. En effet, par différents questionnements qui leurs sont directement adressés, ils sont également amenés à établir leur propre réflexion sur les enjeux de la conservation-restauration et à prendre conscience de son rôle crucial dans la transmission du patrimoine.
Certaines institutions vont même plus loin dans la démarche notamment en réalisant des restaurations face aux visiteurs. Comme en 2009-2010, au Musée des Beaux-Arts de Tourcoing (MUba Eugène Leroy) où des restaurateurs effectuaient leur travail directement dans les espaces d’exposition, confrontant ainsi les visiteurs à la réalité de ce type d’intervention.
D’autre part, que cela soit à l’Artothèque de Mons ou encore au Louvre-Lens, les institutions tendent de plus en plus à ouvrir leurs réserves ou simplement à les rendre visibles au public. Un argument d’attrait qui est indéniable pour les visiteurs, toujours désireux de voir ce qui est habituellement gardé secret.Le choixde ce parcours réalisé par l’Ashmolean Museum s’apparente également à une tentative de dévoiler l’invisible au visiteur et à lui faire littéralement toucher du doigt les problématiques de conservation et de restauration auxquelles l’institution fait face. D’une certaine façon aussi, un tel parcours au sein du musée est une sorte de préambule à la visite et contribue à donner aux publics un autre regard sur les collections du musée. Acteur pendant sa visite, il prend autant conscience de la fragilité des pièces conservées que de la manière dont il faut les préserver.
Mais au-delà de la fonction pédagogique première, ces initiatives permettent également de proposer une nouvelle expérience de visite, pour toujours plus d’interactions entre les publics et les œuvres.
#Ashmolean
#Oxford
#Restauration
#Conservation
#Interaction

Faites vos Jeux ! Le Musée Olympique de Lausanne
De passage à Lausanne, je ne pouvais manquer le musée le plus connu et le plus visité de la ville. Après deux ans de travaux, le Musée Olympique a rouvert ses portes le 23 décembre 2013 avec trois niveaux consacrés à l'exposition permanente et un niveau pour les expositions temporaires.
Crédits photographiques : CIO
Situé dans un environnement exceptionnel, surplombant le lac Léman, le musée et son parc attire irrésistiblement le visiteur ; de plus le site internet du musée promet une expérience inédite dans un musée totalement ancré dans le XXIe siècle.
Le Musée Olympique de Lausanne n'est pas le seul musée consacré aux valeurs de l'olympisme : il existe même un réseau d'une vingtaine d'établissements à travers le monde. Cependant, celui-ci reste le plus important : en effet, Lausanne a été choisie par le Baron Pierre de Coubertin pour représenter les valeurs de l'olympisme et pour héberger le CIO (Comité International Olympique).

Le parc du Musée Olympique : Les footballeurs, Niki de Saint Phalle – Crédits photographiques : LT
L’exposition permanente : 3 thématiques
Aprèsavoir payé un droit d'entrée plutôt salé (14 euros), je découvre le parcours proposé : trois niveaux, trois thématiques : le monde olympique, les jeux olympiques et l'esprit olympique.
Le premier niveau propose un panorama sur l'incarnation de l'olympisme dans notre société ; l'évolution des jeux, de la Grèce antique à Pierre de Coubertin puis de la création des comités nationaux olympiques à l'engagement des villes hôtes au niveau de l'architecture, des produits dérivés, et des cérémonies d'ouverture. En entrant dans le premier parcours, je suis saisie par la présence d'écrans dans toutes les pièces : les projections, les vidéos explicatives et les bornes numériques sont omniprésentes. Puis je comprends rapidement que le musée a peu de contenu matériel à exposer dans cette partie du musée et qu'ils doivent donc compenser avec beaucoup de contenu multimédia. Malgré cela, ce premier niveau est très chargé : aucun pan de mur n'est laissé vierge et l’information est partout.
Après avoir apprécié une belle collection de toutes les affiches des Jeux Olympiquesqui montrent l'évolution du graphisme selon les pays, j'accède au deuxième niveau qui, selon les dires du musée, est le cœur de l'expérience olympique. Cette partie présente les grands champions olympiques, l'évolution des disciplines et des programmes des Jeux Olympiques d'hiver et d'été. Cette fois-ci, les écrans de toutes tailles côtoient les tenues sportives des grands champions. Le visiteur peut également toucher différents types de revêtements de sol, de semelles et d’équipements selon les sports. Plusieurs bornes numériques sont également à disposition pour rechercher des vidéos d’archives : la base de données contient plus de 1000 séquences pour permettre au visiteur de chercher et de visionner ses moments olympiques préférés. Après un rapide tour d’horizon des Jeux Paralympiques et des Jeux Olympiques de la Jeunesse, je me dirige vers le dernier niveau ; l’esprit olympique.
Ce dernier parcours propose une découverte des entraînements, des régimes alimentaires des sportifs olympiques et de la vie au village olympique. Le quotidien des athlètes est présenté à l’aide d’une vingtaine de bornes numériques qui proposent des témoignages de champions sur leur vie sportive.Les repas des jeux olympiques sont présentés en vitrine sous forme de reproduction en plastique et exposés à la manière des sampuru japonais. Le parcours de l’esprit olympique se termine par un spectacle audiovisuel à 180° sur les valeurs du sport et par une très belle collection de toutes les médailles des Jeux. Un espace est aussi consacré à des exercices d’équilibre, de concentration mentale ou encore de réactivité pour semettre dans la peau des sportifs, espace très ludique et pris d’assaut par les familles. Par ailleurs, des jeux ponctuent tout le parcours de l’exposition permanente ; des quizz sur des bornes numériques ou encore des boîtes noires où l’on peut enfoncer sa main pour deviner quelle torche ou quelle médaille olympique se cachent. L’exposition permanente se termine par un réel podium des Jeux de Sydney 2000 où chaque visiteur peut se faire prendre en photo sur la plus haute marche : le musée a vraiment su répondre à la fois aux attentes des enfants et des adultes.
En sortant de l’exposition permanente et avant de me diriger vers l’exposition temporaire, je réfléchis à tout ce que je viens de voir, et à l’expérience d’un « musée du XXIe siècle » que l’on me proposait. Pendant ces deux heures passées dans les trois parcours, je me suis beaucoup amusée, mais cela ne m’a pas donné matière à réfléchir ; avec tous les jeux et les expériences du parcours, je me suis parfois plus sentie dans un parc d’attractions que dans un musée. Cependant, le musée fourmille de bonnes idées en matière de scénographie et d’outils numériques, malgré une trop forte omniprésence du multimédia de mon point de vue. De plus, la grande hétérogénéité des publics pose une difficulté au musée ; quel discours adopter pour parler tant aux passionnés de sport qu’aux simples curieux ? L’établissement relève ce défi haut la main avec des contenus ni trop basiques ni trop techniques et assez intéressants pour capter l’attention de tous.
Enfin, ce qui m’a le plus dérangé dans l’exposition permanente, c’est l’aspect prosélyte du discours du musée ; les valeurs olympiques sont érigées en paroles saintes et aucun des drames qui se sont déroulés lors des Jeux Olympiques ne sont évoqués ne serait-ce que pour rendre un hommage (décès de certains athlètes, massacre de Munich au JO de 1972, attentat des JO d’Atlanta 1996). Pourtant ces événements font bel et bien partie de l’histoire des Jeux Olympiques.
L’exposition temporaire : Courir après le temps
(du 05 juin2014 au 18 janvier 2015)
Affiche "Courir après le Temps" - Crédits photographiques : CIO
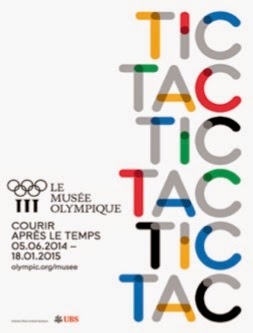 Je décide de terminer ma visite par l’exposition temporaire « Courir après le temps ». L’espace d’exposition est plus calme et moins bondé que le parcours permanent. L’exposition est organisée en neuf thématiques autour de l’évolution de la notion du temps dans le sport à travers les âges, tant au niveau social, artistique et technologique. Le parcours de l’exposition m’a semblé très bien pensé : à la place de choisir un parcours chronologique sur l’évolution de la notion de temps, les concepteurs ont préféré découper en neuf différents types de temps. Au fil des espaces, j’ai donc pu découvrir entre autres le temps cyclique, le temps linéaire mais également le temps de l’athlète et le temps sportif.
Je décide de terminer ma visite par l’exposition temporaire « Courir après le temps ». L’espace d’exposition est plus calme et moins bondé que le parcours permanent. L’exposition est organisée en neuf thématiques autour de l’évolution de la notion du temps dans le sport à travers les âges, tant au niveau social, artistique et technologique. Le parcours de l’exposition m’a semblé très bien pensé : à la place de choisir un parcours chronologique sur l’évolution de la notion de temps, les concepteurs ont préféré découper en neuf différents types de temps. Au fil des espaces, j’ai donc pu découvrir entre autres le temps cyclique, le temps linéaire mais également le temps de l’athlète et le temps sportif.
Par rapport aux espaces de l’exposition permanente, le contenu multimédia ne prend pas le pas sur le discours de l’exposition et les explications sont rigoureusement scientifiques et compréhensibles malgré la difficulté d’expliquer la notion de temps. Des objets exposés illustrent très bien les propos tenus : une copie conforme en 3D du Mécanisme d’Anticythère pour illustrer la notion de temps pendant les Jeux Antiques, de très belles chronophotographies de Marey pour découper le mouvement des athlètes, ou encore différentes machines qui ont chronométré les épreuves durant les Jeux Olympiques modernes. L’exposition est également ponctuée de photographies évoquant la performance des sportifs, la notion de record mais également des photofinish (photographie de lignes d’arrivée où il est impossible de déterminer à l’œil nu quel athlète l’a franchie en premier). Le contenu multimédia est moins ludique avec des bornes numériques diffusant des interviews d’artistes, de philosophes et de scientifiques sur la notion de temps, et avec des projections de très belles vidéos : « le temps de l’attente » et « le temps du départ » entre autres.
L’exposition se termine sur une œuvre de l’artiste Michelangelo Pistoletto, L’Etrusque. Cette sculpture placée face à un miroir est censée représenter le temps linéaire ; le passé, le présent et le futur.
Malgré un discours de propagande qui érige les valeurs olympiques sur un piédestal qui m’a quelques fois un peu dérangée, je vous conseille de ne pas manquer ce musée si vous êtes de passage à Lausanne ne serait-ce que pour la scénographie soignée et la multiplicité des outils numériques. De plus, vous vous amuserez très certainement dans l’exposition permanente et vous apprendrez beaucoup dans l’exposition temporaire qui est très bien conçue. Cependant, si l’aspect commercial de ce musée et les Jeux Olympiques vous rebutent, profitez du magnifique parc et dirigez-vous vers le Musée de l’Elysée (Musée de la Photographie) qui est situé juste au-dessus du Musée Olympique !
LT.
#olympisme
#sport
#multimédia
Pouraller plus loin :
http://www.olympic.org/fr/musee : Site internet du Musée Olympique
http://www.olympic.org/fr/content/le-musee-olympique1/decouvrir/presse/dossiers-de-presse/dossier-de-presse-courir-apres-le-temps/ : Dossierde presse de l’exposition Courir après le Temps

Fouilles archéologiques au collège : de l'archéologie au bahut!
Après avoir épuisé les livres, séries et films à ma disposition lors du confinement, j’ai regardé l’offre en ligne des musées français. Mon choix s’est rapidement tourné vers l’exposition « Pompéi chez vous » du Grand Palais et en consultant les diverses rubriques proposées j’ai découvert la série de photos « L’archéologie préventive : des experts à l’action » de l’Inrap, l’institut national de recherches archéologiques préventives. Une des photos m’a alors étonné : des fouilles avec des collégiens du collège Victor Hugo de Narbonne dans l’Aude, dans la cour même de leur établissement !

© Myr Muratet, Inrap
Le collège a été construit en 1895 à l’emplacement du Capitole, le temple antique de Narbonne. Lors de la construction du collège, des fouilles avaient été réalisées mais en 2012 une équipe de scientifiques constituée de chercheurs du CNRS et d’universitaires décident de reprendre l’étude du monument. En 2016, sous l’impulsion du conservateur du musée antique de Narbonne, l’Inrap se rapproche du collège pour effectuer des fouilles archéologiques dans la cour du collège. Le principal Jean-Michel Malvis accepte à condition que les collégiens soient associés au projet et c’est donc dans le cadre d’un Parcours d’éducation artistique et culturelle, qu’est né le projet « Des archéologues en résidences ».
Pour la directrice des fouilles, le but n’est pas seulement de leur faire découvrir le métier d’archéologue ni de susciter des vocations mais aussi de sensibiliser les futurs citoyens au patrimoine auquel ils pourront être confrontés plus tard dans leur vie professionnelle en travaillant dans le bâtiment ou dans des administrations par exemple.
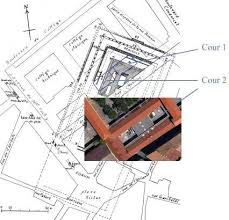
© Collège Victor Hugo, Narbonne
Le projet débuté en 2016 a été proposé à l’intégralité des 6ème et suivi tout au long de l’année par les caméras pour la réalisation d’un reportage intitulé « Des fouilles au collège ». Les apprentis archéologues ont suivi plusieurs heures de sensibilisation aux sciences et techniques de l’archéologie avec des professionnels qui se sont déplacés dans l’établissement pour parler des différents aspects de leur métier. Ils ont aussi bénéficié d’interventions sur la Narbonne antique par le conservateur du musée et des visites de site archéologique pour se préparer à la deuxième phase, sûrement la plus attendue.
Pendant les vacances d'avril, les travaux de dégagement ont commencé dans une des cours du collège et à leur retour, les 160 élèves ont eu la chance de fouiller le site. Certains équipés de pelles, truelles, sceaux travaillent à même le sol, d'autres lavent les objets découverts à l'aide de brosses à dents, le tout encadré par des archéologues et l'équipe pédagogique du collège. Même le proviseur met la main à la pâte. Dans le reportage, on découvre alors la fierté de Wassim qui fait une découverte et qui grâce au programme de sensibilisation en amont, conclut lui-même que c'est un morceau de chapiteau, ce que valide fièrement la directrice des fouilles.
Seuls les archéologues continueront les fouilles après ces deux semaines mais l'expérience pour les collégiens ne s'arrête pas là. Pour valoriser leur travail, une série de photos est exposée sur la façade du collège et ils deviennent ensuite médiateurs lors des Journées nationales de l'archéologie (JNA) au mois de juin lors de l’ouverture du chantier au public. Ils peuvent ainsi mettre à profit leur connaissance et montrer leurs découvertes aux Narbonnais.

© Myr Muratet, Inrap
Dans le reportage, la directrice des fouilles plaisante et suggère à l’équipe : « L’année prochaine, on fouille dans la cour principale ? » et suite au succès de la première édition l'expérience a été reconduite dans les autres cours du collège. Ainsi en 2018 ce sont deux classes de 5eme qui ont fouillé et l'ensemble des 6eme ont pu visiter le chantier et en 2019 deux classes de 4eme. Chaque année la participation au JNA est devenue un rituel et en 2019 ce sont les 750 élèves du lycée ainsi que les autres lycées de la ville de Narbonne qui étaient sensibilisés aux objectifs de la recherche archéologique lors d'une restitution des trois années de fouilles sous la forme d'ateliers animés par les archéologues (présentation du contexte de la ville et du capitole romain, exposition de photos et d'objets trouvés durant la fouille et visite du chantier). Avant l’enfouissement définitif des vestiges en juillet 2019, une capsule temporelle a été ensevelie avec en son sein des écrits, des questions des collégiens pour le futur, un ballon de rugby, des clefs USB et une bouteille de vin du terroir bien-sûr !

© Myr Muratet, Inrap
En définitive, cette expérience est extrêmement intéressante et émouvante à plusieurs niveaux. Les élèves ont eu la chance de découvrir un métier et d'être sensibilisés à l'histoire de leur ville au sein même de leur établissement scolaire. L'Inrap a eu l’opportunité de faire des fouilles sur un lieu qui semblait difficilement accessible, de faire découvrir leurs missions et de faire avancer la recherche sur un site antique majeur de Narbonne et les plus belles pièces trouvées vont rejoindre les collections du musée NarboVia qui devrait ouvrir courant 2020.

© Myr Muratet, Inrap
Pour ce programme innovant au sein duquel l’archéologie s’inscrit comme vecteur d'apprentissage de la citoyenneté, le collège Victor-Hugo de Narbonne a reçu le trophée 2019 de l'Inrap dans la catégorie « Éducation artistique et culturelle ». Pour l'instant aucune nouvelle fouille prévue au collège Victor Hugo mais cette initiative prouve que pour intéresser et toucher les adolescents, il n’y a rien de plus efficace que l'immersion et la pratique !
Cloé Alriquet
#Archeologie
#Fouille
#EducationCulturelle
Pour aller plus loin :

Gaulois, une expo renversante, adieu Astérix et Obélix!
L'affiche et le titre séduisant : "Gaulois une expo renversante" laisse à penser que c'est une exposition à fort caractère divertissant. Nous sommes allés à la cité des sciences pour en avoir le cœur net. Scindée en cinq séquences, l'exposition nous questionne sur nos représentations des Gaulois et la véracité historique grâce aux chantiers de fouilles menés ces 30 dernières années.
Crédits : Rachel Létang
La première partie, 2000 ans d'imaginaire gaulois, et l'ultime, adieu les mythes, se répondent par système d'écho. Le visiteur découvre comment s'est construit l'imaginaire collectif autour des gaulois. Tableaux, affiches publicitaires, chansons,jalonnent le parcours du visiteur. Contrairement à une exposition de type "beaux arts" où l'œuvre est sacralisée, les tableaux sont des reproductions sur tissu, accessibles au visiteur par leur grande proximité. Il n'y a aucune barrière entre le tableau et le visiteur, mais plutôt une grande accessibilité notamment pour les enfants et les personnes à mobilités réduite. L'exposition rend compte de la réappropriation de l'image de cet ancêtre soit disant valeureux à des fins artistiques ou politiques. Courageux, hirsute, buveurs, l'expo renversante balaye ces clichés sur les Gaulois. S'en est donc fini de l'image du mangeur de sangliers ? Pas sûr ! Les mythes persistent nous explique-t-on en fin de parcours. Si l'image du Gaulois que nous nous sommes forgés est un pur produit de l'histoire, qui sont-ils réellement ?
Nous le découvrons en endossant le rôle d'archéologue au sein d'une fouille. Il y a ici une volonté de changement d'ambiance d'un point de vue scénographique. De la fouille au laboratoire est composé de sept modules et de deux chantiers de fouille. Nous étudions, enquêtons sur le quotidien des gaulois : animaux, cultures, habitations, poteries... A titre d'exemple, s'agissant de l'atelier traitant des animaux, une courte vidéo présente en quoi consiste le travail de l'archéozoologue. Chaque module présente une vidéo et le travail d'un spécialiste, en corrélation avec le sujet de l'atelier. Hormis la découverte du métier pour les enfants mais aussi pour les parents, l'exposition insiste sur la démarche scientifique et pluridisciplinaire. Manips, jeux, tablettes tactiles permettent de découvrir un propos scientifique de façon ludique. Grâce à l'observation des visiteurs, nous avons constaté que les NTIC sont rarement utilisées de façon individualiste mais plutôt en concertation entre les personnes d'un même groupe. Elles permettent donc d'échanger, de confronter ses idées sur le sujet. La présence d'un adulte selon les tranches d'âges est tout de même parfois nécessaire. Certains enfants essayent toutes les combinaisons jusqu'à ce que la manip affiche une lumière verte, signe de bonne réponse. Ils n'ont cependant pas saisi la démarche, obnubilés uniquement par la bonne ou la mauvaise réponse. Parallèlement, deux chantiers de fouille permettent de faire découvrir concrètement aux équipes d'enfants fouilleurs, métiers, outils et fonctions de l'archéologie. Plus qu'un accès à la connaissance, c'est une manière d'impliquer intellectuellement et physiquement l'enfant dans l'exposition en créant un temps fort. Après le chantier de fouille, place au musée !
Plus classique mais incontournable, des objets authentiques ou fac-similés nous présentent les productions gauloises. Dans une scénographie sombre, les objets sont mis en valeur par des éclairages ponctuels, révélant ainsi l'impression de richesse des matériaux employés ou la finesse du travail exécuté. La projection dynamique d'objets sur des tissus flottants sanctifient l'espace. Les objets font écho aux rites funéraires gaulois. Quelques tombes sont reconstituées pour le plus grand plaisir du visiteur. Une fois notre présence détectée au dessus d'une tombe, l'explication sonore commence. Ainsi, nous faisons le lien entre les objets présentés sous vitrine et ceux que l'on retrouve dans les tombes. Ils n'apparaissent plus comme de simples objets exhibés pour leurs qualités esthétiques mais comme des révélateurs d'un genre, d'une classe sociale et d'une société avec ses propres codes. Nous avons apprécié la présence d'une maquette animée venant illustrer des données scientifiques. Bien qu'il y ait une volonté de vulgarisation, la maquette ne simplifie pas le discours. Elle présente de manière dynamique une scène dans le sanctuaire gaulois. On y retrouve les objets qui sont exposés à proximité et mêle astucieusement 2D et 3D grâce à l'écran face au visiteur et aux projections sur la maquette en légère plongée. Enfin, légère perturbation en centre Gaule est une fiction où l'un des personnages souhaite sortir du film. Farfelu, inhabituel, c'est un moyen de faire une synthèse sur l'état de la connaissance actuelle à propos des gaulois et de quitter l'exposition de manière amusée.
Inaccoutumée des expositions de culture scientifique, nous avons approuvé la diversité des objets et leur désacralisation. Nous avons savouré le mélange de "culture légitime", l'archéologie, et "illégitime", cet emballage de cordon bleu de la marque Le Gaulois ! Belle exposition où le visiteur oscille entre mythes et réalités. Il ne croule pas sous les chronologies, les cartes et les noms des peuples, bien que le thème soit consacré aux gaulois. A voir impérativement !
Rachel Létang

Héritage provençal
C’est en parcourant les ruelles de Grasse, que je suis tombée sur un petit musée, qui pourrait passer complètement inaperçu, mais révèle un profond héritage historique que je ne soupçonnais pas. Grasse est souvent qualifiée de capitale mondiale du parfum. Il faut dire que la renommée de la ville repose avant tout sur le Musée International de la Parfumerie, de quoi voler la vedette aux autres musées gérés par la Communauté d’agglomération de Grasse. Quant à l’héritage vestimentaire de la ville, le Musée Provençal du Costume et du Bijou, propriété de la ville de Grasse, retrace l’histoire des femmes provençales en préservant une collection de costumes et de bijoux des XVIIIème et XIXème siècles. Sa collection privée a été assemblée par Hélène Costa.
Gravure de mode, Musée Provençal du Costume et du Bijou © A.E
Le musée est situé dans l’Hôtel particulier de Clapier-Cabris, ancienne demeure de la Marquise de Cabris, sœur de Mirabeau. Un emplacement d’une grande valeur qui devrait donc attirer les visiteurs. Mais à ma grande surprise, personne. Personne dans le musée si ce n’est une gardienne faisant office d’hôtesse d’accueil, ravie de nous accueillir en ce lieu visiblement déserté. Deux euros, seulement deux euros pour accéder à ce patrimoine qui n’a sûrement pas plus de valeur aux yeux des Grassois.
C’est donc en terrain inconnu que je monte le grand escalier central du musée, un lustre éclaire cet espace sombre. En entrant dans la première salle, je découvre sur une estrade une scène de vie : deux femmes provençales, dans une cuisine, habillées de leur robe, coiffe et tablier en dentelle. A la manière d’un musée de Folklore, les deux personnages sont mis en scène de façon à illustrer et conserver l’image de coutumes provençales. Un écriteau explique l’histoire des dentelles, de la fabrication manuelle à celle mécanique. Il s’agit d’un long texte, que je ne lis qu’en diagonale tant mes yeux sont rivés sur la minutie des détails apportés à la dentelle des costumes.
 Je poursuis ma visite dans une pièce, dont la scénographie m’intrigue. Des mannequins sont disposés de manière aléatoire, ces femmes elles-mêmes placées sous de grandes cloches cylindriques en verre. L’idée me paraît intéressante en ce qu’elle m’évoque la mise en flacon d’un parfum. Une scène du film « Le Parfum » me vient également à l’esprit, lorsque la femme est enfermée par Grenouille dans un cylindre de verre pour en distiller son odeur. Je m’interroge néanmoins sur la vocation de ce dispositif, le propos du musée n’ayant pas de rapport direct avec le thème du parfum. Vous me direz que je vois un lien là où il n’y en pas, que l’esprit de Grasse agit sur moi, distille dans mon inconscient sa trace et me pousse à faire cette relation directe alors que le scénographe n’y avait pas pensé.
Je poursuis ma visite dans une pièce, dont la scénographie m’intrigue. Des mannequins sont disposés de manière aléatoire, ces femmes elles-mêmes placées sous de grandes cloches cylindriques en verre. L’idée me paraît intéressante en ce qu’elle m’évoque la mise en flacon d’un parfum. Une scène du film « Le Parfum » me vient également à l’esprit, lorsque la femme est enfermée par Grenouille dans un cylindre de verre pour en distiller son odeur. Je m’interroge néanmoins sur la vocation de ce dispositif, le propos du musée n’ayant pas de rapport direct avec le thème du parfum. Vous me direz que je vois un lien là où il n’y en pas, que l’esprit de Grasse agit sur moi, distille dans mon inconscient sa trace et me pousse à faire cette relation directe alors que le scénographe n’y avait pas pensé.
Décor du film Le Parfum de Tom Tykwer © A.E


Mannequins sous « cloches » © A.E
La conservation des costumes est certainement à l’origine de ces dispositifs, ils sont préservés de tout contact avec les visiteurs. En cela, j’y vois une nouvelle ressemblance aux cloches de mariées qui visaient à préserver le bouquet de la mariée. Si cela provoque par conséquent une distance entre le contenu de ce musée et le visiteur, ce dernier peut cependant apprécier le vêtement sous toutes ses coutures en tournant autour de ces cylindres et ainsi observer tous les détails de la dentelle. Un jeu de lumière donne lieu à l’appréciation des mouvements du textile, les plis, bien que ces mannequins soient figés. Chacun représente l’habit typique d’une région à un moment donné. Toulon, Grasse, le Gard, Marseille, le Var … la collection illustre une richesse tant dans le nombre de costumes conservés que dans la diversité des villes représentées. Des gravures de mode accompagnent chacun des cartels et situent le costume dans son époque. Cela m’évoque immédiatement les gravures de Paul Iribe dans l’ouvrage Les robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe, par le dessin de femmes de la bourgeoisie posant dans leurs riches tenues.

Gravure de mode, Musée Provençal du Costume et du Bijou © A.E
Je poursuis ma visite en déambulant dans ces pièces qui parfois présentent des scènes de vie préservant les vêtements portés derrière des paravents de verre, suggérant l’intimité de ces dames ainsi que la préciosité de leurs vêtements. Sur les murs sont inscrits des proverbes comme une voix narrative invitant à poursuivre la visite.
 Le décor change dans la salle dédiée à la présentation des bijoux provençaux : salle carrée sans source de lumière naturelle, où l’éclairage joue un rôle primordial. Un imposant lustre vient éclairer la vitrine centrale qui présente tout en longueur des parures et boucles de ceintures en argent. Sur chacun des murs sont alignées des vitrines encastrées. Il s’agit en quelque sorte de petites boîtes profondes où la lumière n’éclaire que le bijou. Ce procédé accentue ici encore la préciosité et une forme d’inaccessibilité pour les visiteurs. Paradoxalement, des cartels sont disposés sous ces vitrines de façon à révéler les techniques de fabrication de ces bijoux, ou bien leurs usages, leurs valeurs, leurs symboliques etc…
Le décor change dans la salle dédiée à la présentation des bijoux provençaux : salle carrée sans source de lumière naturelle, où l’éclairage joue un rôle primordial. Un imposant lustre vient éclairer la vitrine centrale qui présente tout en longueur des parures et boucles de ceintures en argent. Sur chacun des murs sont alignées des vitrines encastrées. Il s’agit en quelque sorte de petites boîtes profondes où la lumière n’éclaire que le bijou. Ce procédé accentue ici encore la préciosité et une forme d’inaccessibilité pour les visiteurs. Paradoxalement, des cartels sont disposés sous ces vitrines de façon à révéler les techniques de fabrication de ces bijoux, ou bien leurs usages, leurs valeurs, leurs symboliques etc…
Salle des bijoux et vitrine murale © A.E
 La visite se termine sur une touche graphique discrète où l’on perçoit les silhouettes de Provençales peintes au mur du dernier couloir, lui-même percé de fenêtres offrant un dernier regard sur les mannequins de la salle « des cloches en verre ».
La visite se termine sur une touche graphique discrète où l’on perçoit les silhouettes de Provençales peintes au mur du dernier couloir, lui-même percé de fenêtres offrant un dernier regard sur les mannequins de la salle « des cloches en verre ».
Un sentiment me traverse : la distance établie entre le visiteur et le contenu de cette collection mise sous verre est-elle à l’image de la méconnaissance du public vis-à-vis de ce musée ? En effet, les dispositifs de présentation ne permettent pas au visiteur de s’approprier le contenu du musée, tant les objets semblent préservés de tout contact. De la même façon l’absence de communication autour de la structure ainsi que son emplacement peu connu créent une réelle distance entre les visiteurs et le musée. Quelles techniques pourraient être mises en œuvre, par le biais d’une médiation par exemple, pour attirer davantage de visiteurs ? Quel est l’intérêt d’installer un musée d'artisanat dans une ville qui en possède déjà un autre très connu, pourquoi ne pas l'installer dans une autre commune ou voisinant celui du parfum pour inciter les gens à le visiter ?
Anna Erard
#grasse
#muséeprovençalducostumeetdubijou
#costume
Histoire et Mémoire (1) : Le déboulonnage des statues
Depuis mon expérience professionnelle au Mémorial Alsace-Moselle (Schirmeck), je me questionne sur le lien étroit entre histoire et mémoire. Que ce soit pour des évènements sociaux ou politiques de notre siècle ou des faits plus anciens, la mémoire collective ou individuelle s’est souvent heurtée aux faits relatés par les historien·ne·s.
Monument à la gloire de l'expansion coloniale français, allégorie des Antilles par Jean-Baptiste Belloc, 1913.
Cachées dans le jardin tropical de Paris, se trouve à même le sol plusieurs sculptures de l’artiste ariégeois, Jean-Baptiste Belloc. Ce groupe statuaire appelé Monument à la gloire de l'expansion coloniale française, a été inauguré en 1922 puis déplacé à la Porte Doré lors de l’exposition coloniale de 1931. Aujourd’hui démontées en cinq pièces, les statues ont retrouvé leur place d’origine en 1962 dans ce qui était autrefois le jardin colonial. Même si le caractère affligeant et déshumanisant des zoos humains présents lors de l’exposition coloniale de 1931 n’est plus discuté, pourquoi les statues de Belloc rendant gloire à l’Empire français coloniale sont-elles toujours présentes dans l’espace public ? Pour comprendre ce qui a motivé le choix de laisser ces statues en dépit du caractère amer du passé colonial, il est nécessaire de définir les termes. Histoire et mémoire et de situer le cadre spatiotemporel dont seront extraits les exemples à suivre.
La notion d’histoire fait référence aux « connaissances du passé de l'humanité et des sociétés humaines, il s’agit d’une discipline qui étudie ce passé et cherche à le reconstituer »[1]. Ce qui revient à étudier des traces écrites du passé, créer des liens entre les faits et les contextualiser. Ce travail consent à donner un enchaînement avéré aux faits, suggérant l’idée d’une évolution. Il se peut également que l’historien·ne se base sur des témoignages oraux. Ces derniers tout comme les écrits peuvent être sujets à des interprétations, qui éloignent d’une prétendue objectivité. Les témoignages oraux s’inscrivent dans un contexte socioculturel qui n’est pas le même que l’historien·ne. Leurs auteur·e·s peuvent être soumis inconsciemment ou non à leur vision subjective des faits.
Ainsi les témoignages relèvent de la mémoire, ce qui renvoie à un « ensemble des faits passés qui reste dans le souvenir des individus, d'un groupe »[2]. Il n’existe pas seulement une mémoire mais un ensemble de mémoires qui font référence à un ou plusieurs faits historiques vécus individuellement ou collectivement. Autrement dit, à partir d’un même fait historique, deux individus peuvent avoir vécu l’expérience historique de manière diamétralement opposée. Pour résumer, selon l’historien franco-bulgare Tzvetan Todorov dans Les abus de la mémoire publié en 1995 aux éditions Arléa, « l'histoire privilégie l'abstraction et la généralisation ; la mémoire, le détail et l'exemple ».
Au vu de certaines manifestations, la frontière entre histoire et mémoire devient floue, allant même quelques fois à disparaître. Cet article a pour intention de comprendre en quoi des événements récents font ressortir dans l’espace public des tensions cristallisées où l’histoire et la mémoire se retrouvent au cœur des débats ? Les exemples choisis témoignent d’une histoire française complexe et les blessures ne sont pas encore totalement guéries. Nos exemples portent sur le déboulonnage des statues exposées dans l’espace public, celles qui reflètent le passé colonial français.
Depuis l’apparition du mouvement politique Black Lives Matter en juillet 2013, amplifié par la mort de l’afro-américain George Floyd, des citoyen·ne·s de plusieurs nations aux quatre coins du globe sont sorti·e·s dans les rues pour déboulonner des statues incarnant le passé colonial de leur pays. Ce fut le cas outre-manche où les Anglais·e·s ont fait tomber la statue en bronze d’Edward Colston érigée depuis 1895 dans la ville de Bristol, connue pour être un port important dans le commerce d’esclaves. Coté France, le débat s’est porté autour de l’investigateur du Code Noir, Jean-Baptiste Colbert dont la statue de plain-pied trône devant l’Assemblée Nationale. La statue a été aspergée de peinture rouge vif et son piédestal tagué de la mention « Négrophobie d’Etat ».
Des gestes qui ne sont pas récents
Ces gestes ne sont pas symptomatiques du XXIème siècle. Selon l’historien Bertrand Tillier, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les déboulonnages sont des actes anciens remontant à la période révolutionnaire qu’a connue la nation française. Détruire des représentations s’inscrit également dans les mouvements contestataires comme celui des huguenots au XVIe, quand ces derniers ont détruit des représentations du christ et autres iconographies catholiques. En Irak en 2003, les opposants au régime irakiens ont fait tomber les statues incarnant le pouvoir en place. Ne pouvant s’en prendre directement aux responsables politiques, le déboulonnage des statues est symbolique. Le déboulonnage renvoie à un protocole d’actions : les statues sont arrachées de leur socle et s’écroulent au sol, ou les têtes des statues sont décapitées ou elles sont recouvertes de peinture. Enfin quelques statues connaissent le supplice de la noyade comme celle du marchand d’esclaves, Edward Colston.
Des arguments qui questionnent
Nos exemples concernent essentiellement une statuaire coloniale figurée par des hommes blancs. Ici, la question est de savoir si l’on « supprime » les traces du passé colonial française dans l’espace public. Les arguments qui vont suivre n’ont pas pour but d’aborder le problème sous un angle manichéen, mais plutôt de comprendre efficacement deux argumentaires distincts.
Pour les historien·ne·s, déboulonner les statues revient à effectuer une relecture de l’histoire. C’est faire table rase d’une partie de l’histoire d’une personnalité ou d’une personne. Dans le cas du déboulonnage de la statue de Jules Ferry, l’action ne permet pas seulement de faire abstraction des antécédents colonialistes. C’est également tout l’héritage du travail de Ferry en tant que réformateur de l’éducation qui est effacé. Or l’histoire étant plurielle, elle doit représenter toutes les facettes de la vie d’un personnage, même si ses actions reflètent les heures les plus sombres du passé français. Si la statue prend place dans l’espace public, elle résulte d’un consensus des commanditaires établi en connaissance de causes. Si le consensus est rompu et que les statues contestées sont ôtées, cela signifie que les blessures du passé n’ont pas été pensées.
Pour les défendeur·e·s de l’histoire, faire enlever les statues symbolisant le passé colonial français revient à censurer une vérité dérangeante de l’histoire. Selon l’historien Dimitri Casali, « déboulonner les statues de nos Grands Hommes c’est ouvrir la boîte de Pandore du révisionnisme historique »[3].
Retirer des statues représentant des personnalités aux pensées colonialistes ne signifie pas pour autant que le passé colonial français sera oublié, il s’agit encore moins de réécrire l’histoire. Selon Françoise Vergès, le déboulonnage des statues n’a rien à voir avec l’effacement de l’histoire, mais davantage d’une question de justice mémorielle : un acte symbolique contribuant à la reconnaissance du passé colonial français plutôt qu’une volonté de réécrire l’histoire. Les statues sont le reflet de l’histoire française et une interprétation esthétique de l’histoire résultant de choix politiques, à titre de gloire. Ces choix politiques sont idéologiques reflétant la moralité et l’état d’esprit de la société qui a vu ériger ces statues. Cette morale et les valeurs qu’elles reflètent ne sont plus celles de notre société actuelle.
Les laisser ou non ?
Plusieurs options sont envisagées par l’ensemble des protagonistes. Pour Karfa Diallo président de l’association Mémoire et Partages, les statues ne doivent pas être déboulonnées mais contextualisées avec le recours de panneaux explicatifs qui permet de définir davantage les actions d’une personne. Il peut en être de même avec les noms de rues ou bien des places publiques. Cette solution contribuerait à la sauvegarde physique de la mémoire en laissant la statue ou le nom de rue sur son emplacement initial, tout en comprenant historiquement les faits, qui relèvent ici de crimes contre l’humanité.
Selon Ghyslain Vedeux, président du CRAN (Conseil représentatif des associations noires), le déboulonnage des statues n’est peut-être pas la solution à envisager. Cet acte n’étant pas officialisé par les autorités compétentes, le retrait des statues réalisé légalement aurait un impact symbolique plus fort. Une reconnaissance de l’Etat enverrait un message non négligeable de soutien dans la lutte contre les discriminations.
D’autres penchent plutôt pour la mise en place dans l’espace public de contres-monuments rétablissant la mémoire. C’est notamment le cas pour Bordeaux, ancienne place forte du commerce d’esclaves au XVIIIème siècle. Les services de la ville ont ainsi érigé une statue représentant Modeste Testas, esclave Africaine achetée par des négociants bordelais. Dans le même sens, Edouard Philippe suggère de faire renaître des cendres la statue du général Dumas alors fondue par les nazis.
Un nouveau rôle pour les musées ?
Que faire alors des statues déboulonnées ou qui vont peut-être retirées pour laisser la place à d’autres statues ? Certains pensent aux musées, comme le musée de la Citadelle situé dans un quartier berlinois à Spandau. La directrice de l’institution révèle qu’une partie du musée renferme des statues déboulonnées ou des têtes décapitées. Certaines de ces statues ne sont plus admissibles dans l’espace public. Derrière les murs du musée se trouve la tête décapitée de la statue de Lénine, résultat de la chute du mur de Berlin. Ici, les statues sont contextualisées et servent de supports pédagogiques. Tout comme le souligne Urte Evert, « le musée est considéré comme un espace sûr où l’on peut voir ces monuments toxiques et où l’on peut en parler ensemble »[4].
L’anthropologiste Octave Debary, pense quant à lui qu’il existe plusieurs façons de gérer ce qu’il appelle « les restes de l’histoire ». Employant la métaphore d’un festin terminé, Debary met en exergue trois moyens de faire « le tri ». Première option, certains individus éprouvant un fort attachement au présent ne se concentrant que sur celui-ci, font table rase du passé et ne gardent aucune trace de ce repas. Deuxième option, d’autres plus attachés au passé expriment le besoin de faire un tri : se pose alors la question de ce qui va être gardé ou bien jeté. Dernière option, une conservation totale, toutes les traces devant être gardées sans mesure, dans une volonté de protéger le passé. Les deux dernières options renvoient aux conceptions mutuelles des historiens et des pro-déboulonnages dans la question des statues à caractères coloniales. L’anthropologue définit aussi le musée comme un espace-temps de l’oubli où les choses que l’on ne veut plus voir sont reléguées dans un espace clos, neutre. Autrement dit, le musée prend le relais de ce que l’espace public ne veut plus en son sein.
A-t-on besoin de voir pour se remémorer les choses du passé ? Voir est-il synonyme de savoir ? Si nous passons devant un mémorial de guerre, est-ce que cela convoque en nous systématiquement des connaissances ? Ce n’est pas parce que nous posons le regard sur la statue de Gallieni que nous sommes au fait de l’histoire du personnage et de ses actions. Que l’on déboulonne les statues ou que l’on les laisse en place, l’essentiel est de contextualiser ces œuvres, dans l’espace public ou dans un musée et cela doit passer par un travail de sensibilisation et d’éducation.
Edith Grillas
#Histoire #Mémoire #Décolonialisme
[1]Définition Larousse : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/histoire/40070 ↩
[2]Définition Larousse : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9moire/50401 ↩
[3]https://www.huffingtonpost.fr/dimitri-casali/faut-il-deboulonner-les-statues-de-colbert_a_23219160/ ↩
[4]https://fr.euronews.com/2020/06/20/que-faut-il-faire-des-statues-de-personnages-historiques-qui-sont-contestees-et-vandalisee ↩
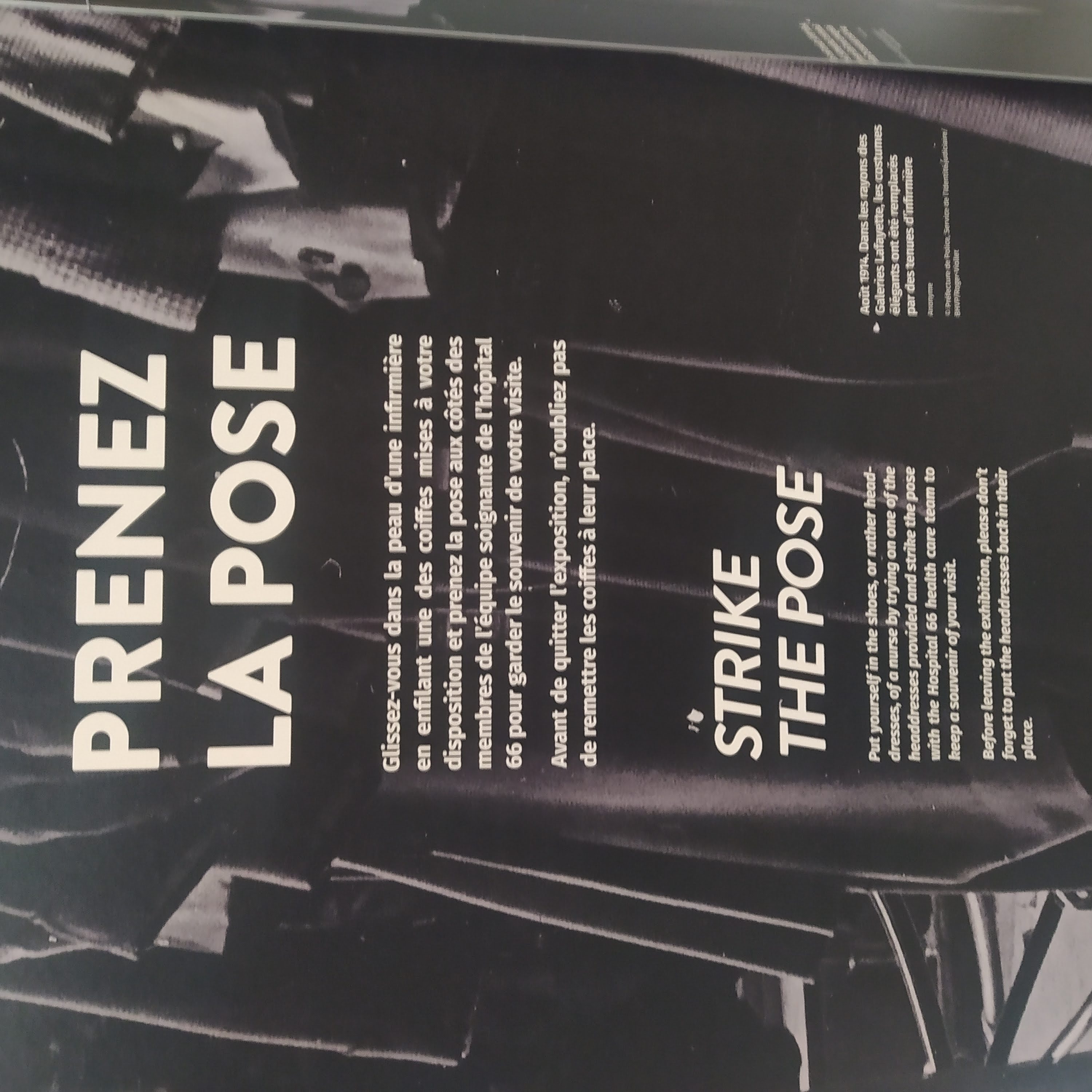
Il était une fois les enfants dans les musées d’histoire
Les musées développent de plus en plus leurs médiations. Quelles sont celles des Musées d’histoire ?
Le jeune public est l’avenir des musées, puisque ce sont eux qui sont les futurs visiteurs et qu’ils reviendront bien plus tard, peut-être avec leurs enfants. Pour cela, les équipes des musées mettent en place différents moyens afin de les inciter à revenir. Le rôle du médiateur devient alors un enjeu important, et cela ne fait pas exception dans les musées d’histoire. Ainsi, différents moyens, dans des activités du parcours muséographique ou en dehors de celui-ci peuvent être attractifs.
Des médiations durant la visite du musée
Les musées pouvant être grands et le parcours long, les jeunes enfants de 6 à 12 ans peuvent vite s’ennuyer et donner de la voix. Durant la visite, des espaces peuvent être préparés afin de plonger l’enfant dans un nouvel univers en lien avec la période historique voulue. Ainsi, au Musée de la Grande Guerre de Meaux, a été mis en place un coin famille avec des activités pour amuser les enfants et leur permettre de se détendre, tout en restant dans le musée. Dans cet espace, au milieu du musée, les enfants sont invités à écrire des lettres aux poilus, ou encore à se déguiser avec des uniformes et tenues typiques de la Première Guerre Mondiale. Il ne s’agit pas de susciter des vocations militaires, il s’agit surtout de faire comprendre aux enfants que les uniformes n’étaient pas forcément tous adaptés aux combats. En effet, au tout début de la Première Guerre Mondiale, les uniformes étaient de couleurs vives et donc manquaient de discrétion, ou encore ils étaient en laine et en été, cela tenait bien chaud. Ils peuvent ainsi remarquer les évolutions dans les uniformes de manière ludique.
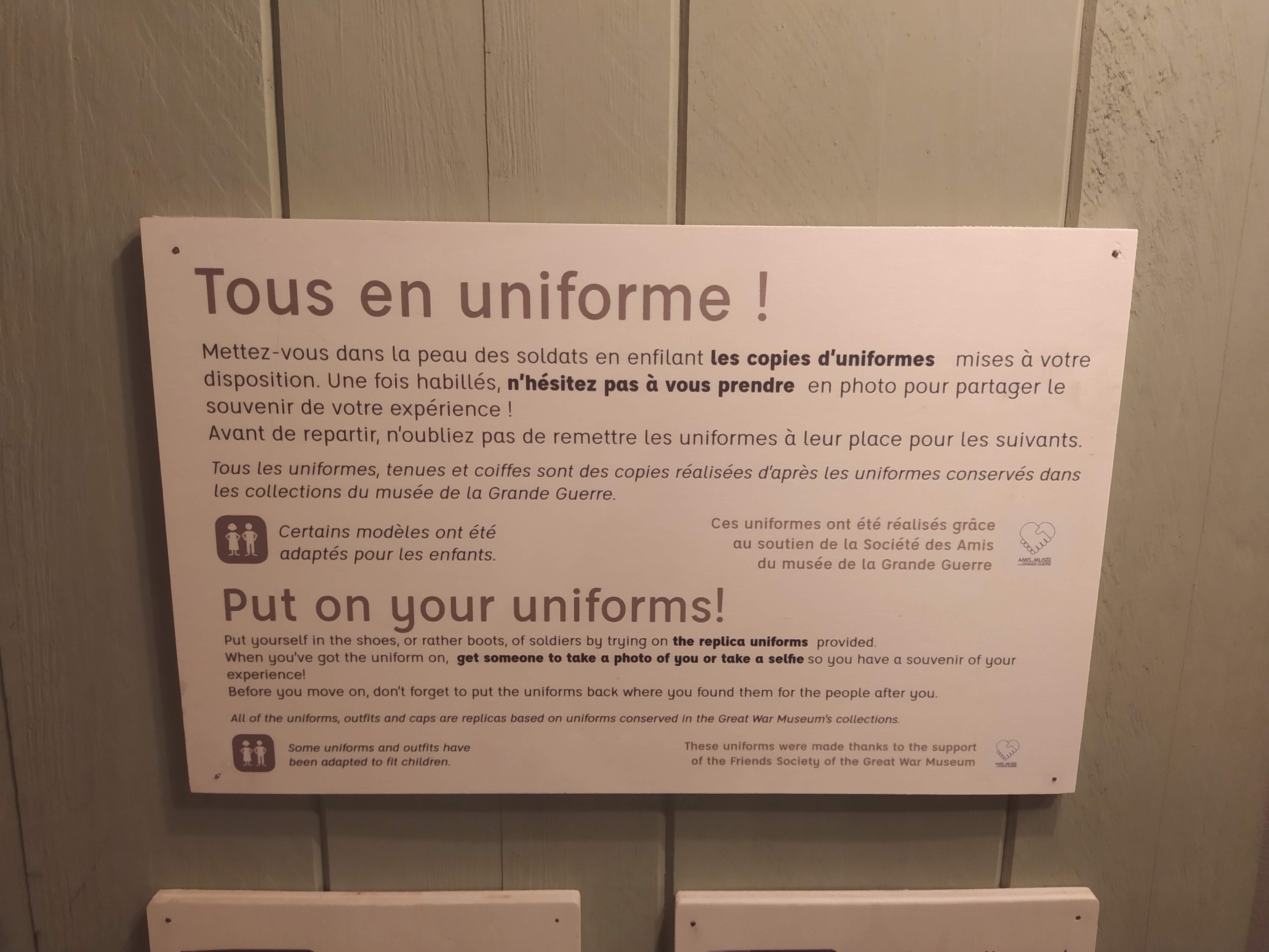
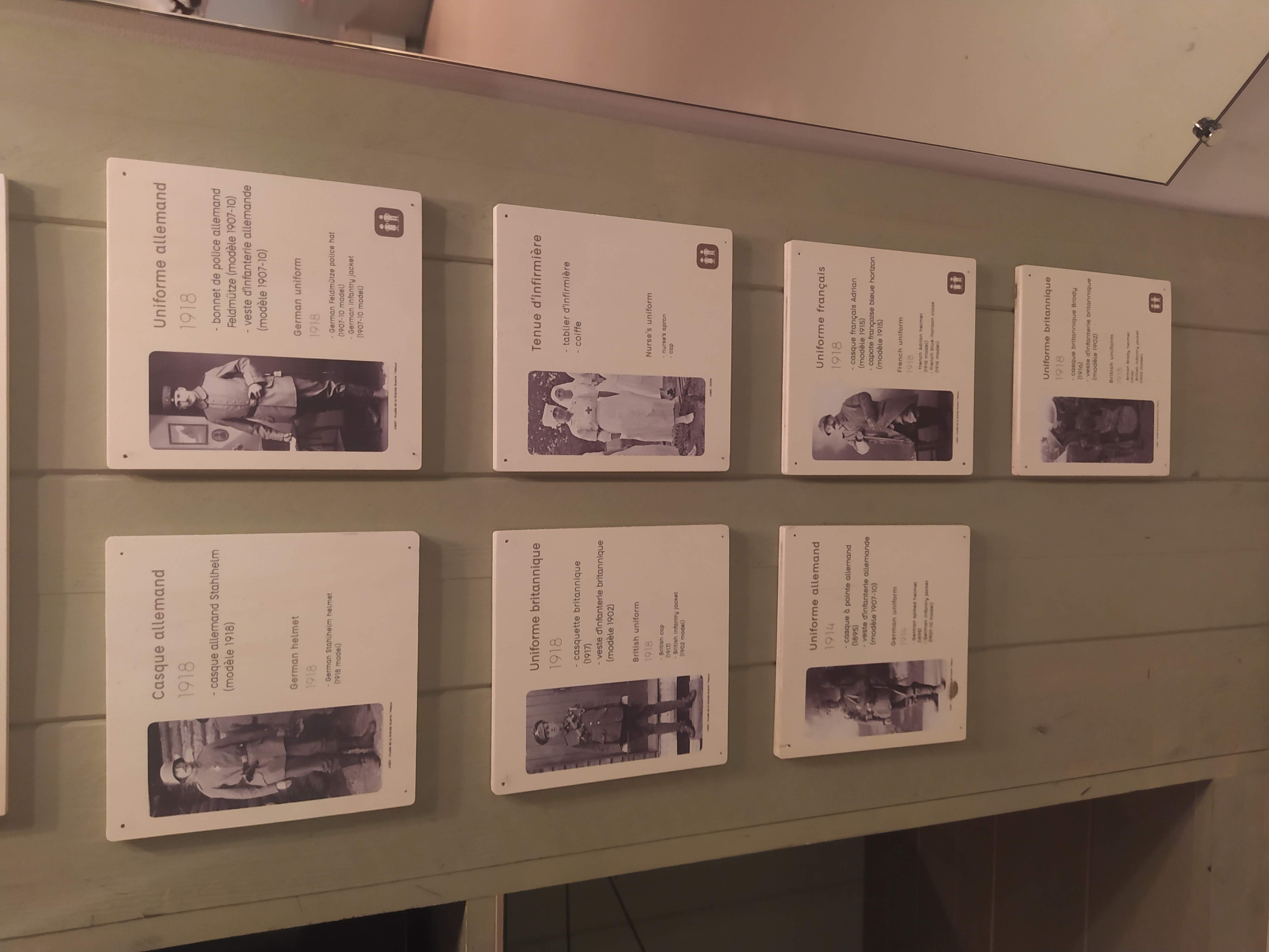
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux- J.P.
Tout au long de la visite, les enfants peuvent se vêtir d’un voile d’infirmière pendant la Première Guerre Mondiale. Des objets peuvent être manipulés sur le parcours comme une fausse bombe, des morceaux de métal, des reproductions d’uniformes etc…
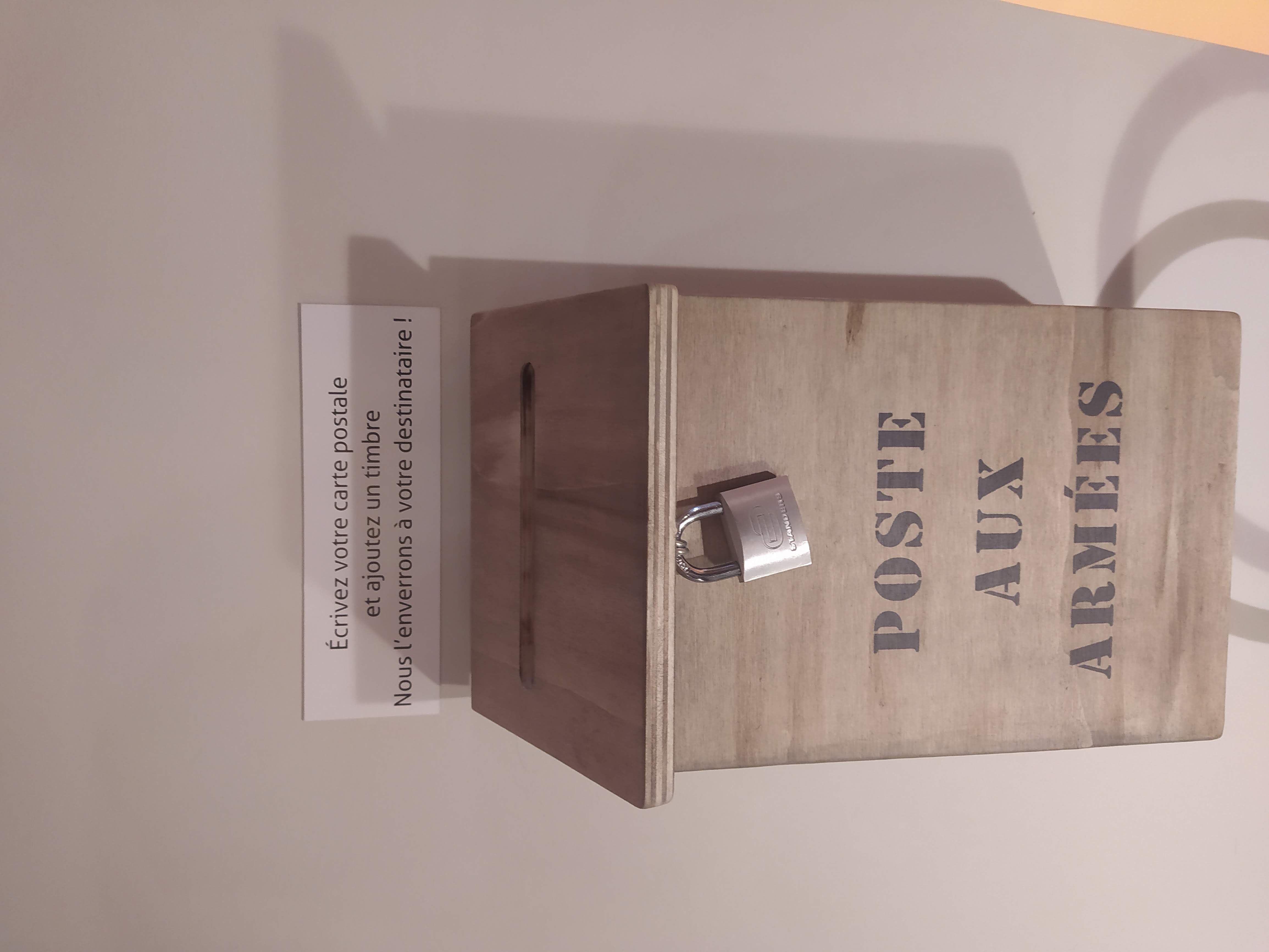
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux-J.P
De plus, la scénographie du lieu est adaptée au public des enfants. La représentation des tranchées avec des ouvertures à la hauteur des yeux des adultes est également reproduit pour la hauteur des yeux des enfants, et ainsi de la même manière dans différents endroits du musée. S’ajoutent des vitrines à la hauteur des enfants ou animations tout au long du parcours avec des pancartes adaptées au vocabulaire simplifié afin de comprendre certains points importants.
Au musée de la Légion étrangère à Aubagne, lorsque des classes de primaire viennent visiter le musée, le médiateur leur fait une visite adaptée, au vocabulaire simplifié, l’explication de mots compliqués et un développement accru sur les périodes historiques qui sont vues en classe. Des militaires peuvent également présents lors de la visite et ainsi faire prendre conscience aux enfants de ce qu’est l’uniforme, l’armée et la vision de l’histoire par un militaire.
Cette visite est également plus courte, certains moments historiques un peu complexes ou trop violents pour l’enfant sont peu développés. Et tout au long de la visite, les enfants peuvent s’asseoir pour écouter les différentes explications du médiateur, qui leur fait une visite interactive, les interrogeant afin d’attiser leur curiosité et d’éveiller leur attention en les faisant participer. Il leur est également plus explicité la couleur des uniformes, ou donner certaines choses à faire, comme leur faire « former le carré » lors des batailles, l’utilisation de maquettes de différentes tailles, comme la maquette d’une « hacienda » en petit format ou à échelle 1/1 d’un VAB (Véhicule de l’Avant Blindé), l’utilisation de supports vidéo pour expliquer certaines batailles ou encore différents aspects de la vie militaire. La visite passe ainsi plus vite et permet d’enchaîner avec la deuxième partie sur un moment avec différents ateliers menés par les médiateurs, après une courte récréation.
Des médiations à la suite de la visite
Pour les classes visitant les musées d’histoire, des interventions peuvent avoir lieu après une visite du musée afin d’approfondir certains sujets.
Ainsi, au Musée de la Légion étrangère, des interventions sont proposées aux classes avec des ateliers animés par des médiateurs. Ces ateliers sont adaptables en fonction du niveau des élèves. Les différents ateliers sont les suivants : dans le premier, il est demandé aux élèves de refaire la chronologie de l’histoire de la Légion étrangère sur une frise à l’aide d’images et des mots-clés qu’ils auront entendu pendant la visite : tenue camouflée, Impératrice Eugénie, 1831 etc… On peut ainsi insister de manière ludique sur les grandes évolutions ayant eu lieu au cours du temps.
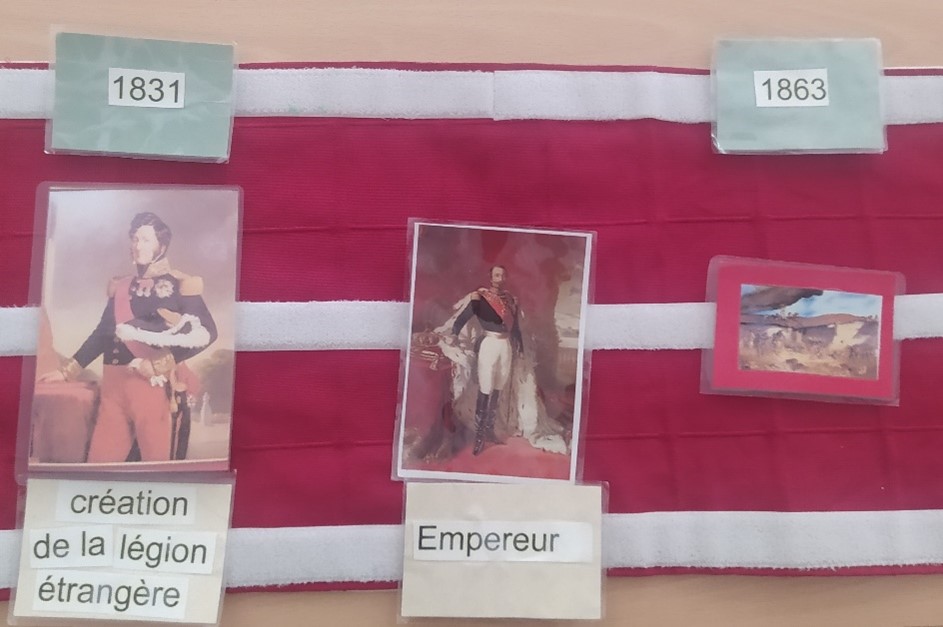
Atelier « frise chronologique » du Musée de la Légion étrangère-J.P
Est également proposé un atelier art plastique, qui permet aux enfants d’exprimer leur créativité avec des activités manuelles variables, comme de la peinture, la reproduction du Monument aux morts de la Légion, des empreintes de pas dans de l’argile pour représenter les traces de pas des soldats dans la boue, des portraits à faire avec des cadres dorés comme ceux que l’on peut trouver dans les musées etc…
Et, enfin, dans un atelier de manipulation d’objets réels, dont les enfants devront retrouver les copies dans le musée, ils pourront manipuler certains objets et les porter, comme les casques, les épaulettes etc...

Objets manipulables au Musée de la Légion étrangère- J.P
Evidemment, les armes ne sont pas manipulables. La visite peut également être complétée par un atelier « découverte de la vie militaire » où les enfants peuvent avoir l’explication d’un bivouac militaire en lien avec le Bureau des Sports de la Légion étrangère. Et enfin, dans un dernier atelier, les enfants vont avoir l’explication du parachute par un spécialiste qui raconte sa propre expérience et ensuite apprennent à le plier.
Tout ceci a donc pour objectif d’intéresser l’enfant et de le mettre en éveil à ce qui a été dit au cours de la visite. Ainsi, les musées d’histoire ont un rôle primordial à jouer dans la mise en place de nouveaux modes de médiations afin de permettre au jeune public de connaître l’histoire.
Jeanne Pagès
#histoire #médiations #musée

Immersion dans les archives ménagères
Les Archives Nationales (AN) ont présenté du 5 février au 30 juillet 2022 une exposition temporaire, intitulée Au Salon des arts ménagers (1923-1983)sur le site de Pierre-sur-Seine (93). L’exposition présente un évènement emblématique du XXe dédié aux innovations techniques et technologiques destinés à la sphère domestique. Ce rassemblement, désormais disparu, avec l’apparition des boutiques, marque durablement les souvenirs. Aujourd’hui chaque marque gère son image et sa présentation au public sans passer par l’organisation d’un salon institutionnel. L’affiche présente un environnement très masculin malgré le thème de la vie domestique traditionnellement dévolu au monde féminin. L’exposition interroge une histoire de la consommation et permet de réunir ménagères et militantes pour l’égalité au détour des stands scénographiés.
Image d'intro : © Photographies - Farida Bréchamier
Dialogue entre archivistique et muséographie
Le premier salon organisé à Paris s’est tenu en 1923 aux Champs de Mars puis a été déplacé au Grand Palais en 1928. Il a été organisé par Jules-Louis Breton, personnage politique et homme de sciences qui souhaitait mettre en avant les progrès techniques, l’utilisation de l’électricité au foyer et faciliter l’usage de l’espace domestique. L’évènement accueille en son temps des milliers de visiteurs et s’étend sur plus de 5 000 mètres d’exposition, de stands et de réclames publicitaires.
Le commissariat scientifique de l’exposition à Pierrefitte-sur-Seine est assuré par le personnel des Archives Nationales : Sandrine Bula, conservatrice en chef du patrimoine aux AN, Marie-Eve bouillon, historienne, chargée d’étude aux AN et Luce Lebart, historienne de la photographie, commissaire d’exposition. Elles ont pu compter sur un fonds conséquent transmis en 1985. Martine Segalen, sociologue spécialiste de la famille, décédée en juin 2022, a également participé au catalogue de l’exposition.
Le salon a été porté par Jules Louis Breton, créateur et premier directeur de l’Office national de recherches scientifiques et industrielles, l’ancêtre du CNRS. L’exposition a donc largement puisé dans le fonds versé par le CNRS. L’organisation du Salon a pris fin en 1983 et ce fonds a été versé aux Archives Nationales en 1985 à la suite de la dissolution du commissariat général du Salon. Le fonds comporte aujourd’hui environ 40 000 tirages photographiques soit 350 mètres linéaires, mais aussi des vidéos, affiches, brochures et a beaucoup influencé les choix scénographiques proposés par l’atelier Deltaèdre : « La scénographie rend un clin d’œil ludique à l’univers visuel saturé et chatoyant du salon en mettant en scène une série de stands correspondant chacun à l’une des thématiques avec de nombreuses évocations d’enseignes, de logos, de publicités servant à la fois de décors et de supports de médiation. »1
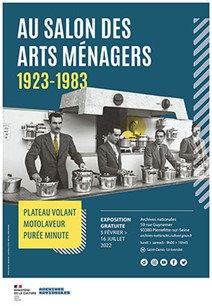
© affiche de l’exposition / Archives Nationales
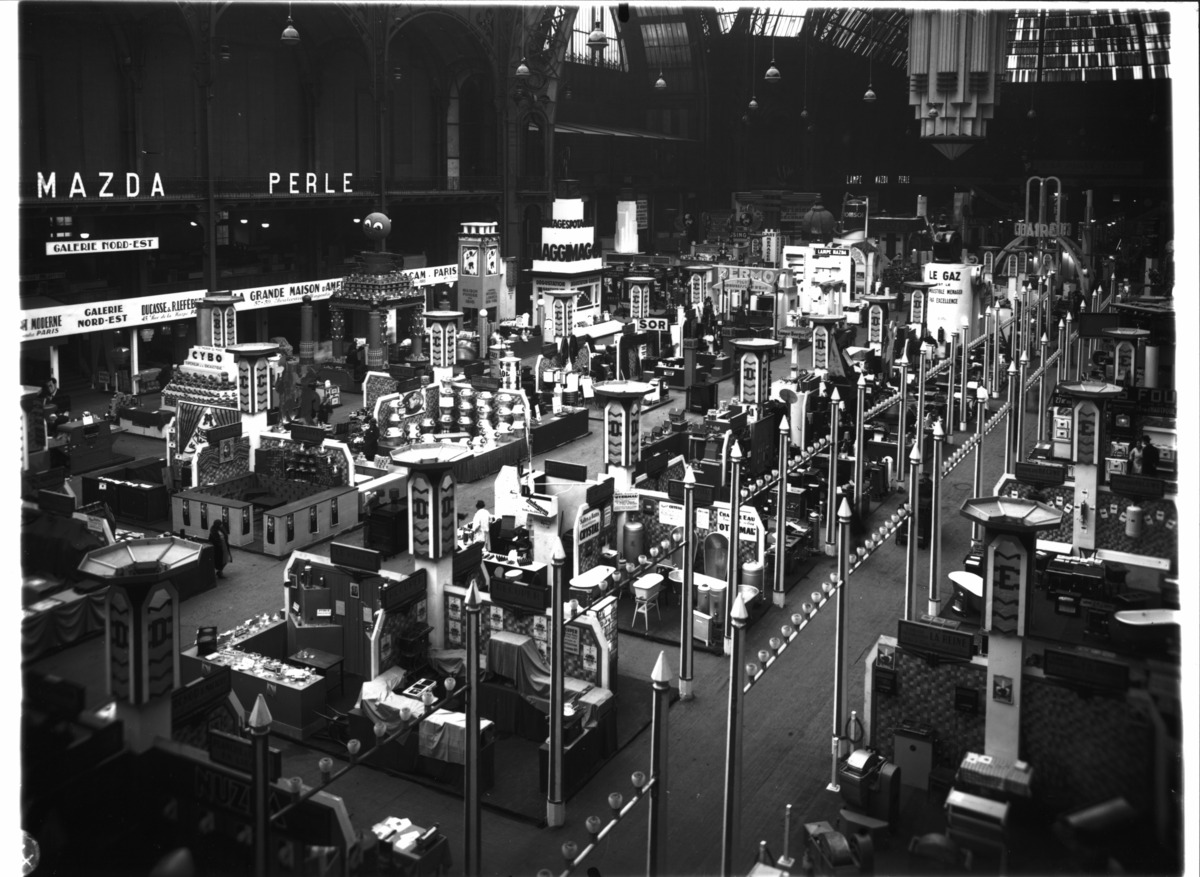
© Fonds historique / CNRS Photothèque
Une exposition immersive et ludique aux archives
La circulation n’est pas linéaire, l’espace présente un rondpoint central et donne sur des allées transversales. Les supports de médiations audiovisuels fourmillent sans faire l’économie d’encarts présentant des éléments de contextualisation apportent un éclairage bienvenu sur l’ensemble des visuels mis à disposition. Comme le parcours n’est pas linéaire, chaque ilot peut être abordé indépendamment, ce qui accentue la sensation de déambulation, le visiteur ne s’arrête alors à un titre qui nous alpague ou une couleur qui accroche notre regard.
Chaque îlot encartonné présente un thème tel que la fabrique du salon (architecture), les concours des appareils ménagers (pratiques commerciales), les employés de salons (travail), la mythification du salon (communication et publicité). Il est possible d’entrer dans chaque îlot ou d’en faire le tour puisque l’extérieur présente également des expôts. Chaque thème est divisé en 5 à 10 sous-thématiques accompagnés d’archives.
Des espaces indiquent également des focus qui précisent une thématique en dehors des ilots comme le taylorisme appliqué aux ménages. Ils reprennent pour cela la charte graphique de la réclame publicitaire. Le rendu est saisissant, la sensation de foule, le bruit, la perte de repère au milieu des stands. Pourtant ce n’est pas un frein à la compréhension de l’ensemble et rend parfaitement l’effervescence de ces évènements. Une grande frise chronologique permet de voir l’évolution du Salon mais aussi son insertion dans un contexte plus large. De nombreuses statistiques apportent des chiffres sur la fréquentation de l’événement.
De l’archive à la muséographie
Les expositions temporaires aux archives ont pour objectif de valoriser les fonds à disposition dans le centre. Cette typologie d’exposition implique l’archiviste en tant que vulgarisateur d’un fonds et commissaire. Tous les archivistes n’ont pas la possibilité d’exercer au sein d’une institution telle que les AN. Un archiviste en poste en entreprise ou dans une institution publique malgré une formation similaire n’aborde pas forcément la question de la médiation et de la valorisation des archives dans ses missions. C’est donc une possibilité gratifiante de voir prendre une forme muséographique à des fonds détenus et étudiés.
Cependant, l’aspect immersif aurait gagné à présenter des objets d’époque du Salon et à s’affranchir des archives. Plus de traces matérielles des salons auraient pu être prêtés par les entreprises qui conservent souvent des objets dans leur propre démarche d’archivage, par des musées plus axés sur la technique et la science, ou par des particuliers sur un appel des Archives nationales. Cela a été fait par le musée de l’Immigration qui présente dans sa galerie des objets obtenus par collecte.
En outre nous disposons finalement de peu d’informations socio-économiques sur les visiteurs du Salon et les utilisateurs de ce type d’objets. Le regard des entreprises manque également, notamment concernant leurs stratégies et leur choix de passer du Salon aux supermarchés à partir des années 1980.
La conception d’une exposition gagne en qualité grâce aux caractère transdisciplinaire du commissariat scientifique, entre professionnelles des archives et un commissaire d’exposition spécialiste de photographie. De façon générale, l’exposition est donc une réussite sur le plan de sa simplicité, et gagnerait à être présentée dans divers endroits. L’exposition s’étend sur 380 m2 aux Archives Nationales, a été réalisée avec un budget de 50 000 euros HT. C’est un excellent exemple d’une bonne exposition demandant peu de moyens, ce qui est une préoccupation récurrente pour les personnels des archives.
Hélène Raboteur
1 Source : Atelier Deltaedre, consulté le 27, octobre 2022, [en ligne], URL : https://atelier-deltaedre.com/references/au-salon-des-arts-menagers-1923-1983. ↩
Pour en savoir plus :
- https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/au-salon-des-arts-menagers
- https://www.grandpalais.fr/fr/article/dossier-pedagogique-un-grand-palais-pour-les-arts-menagers
- Pour plus d’images sur le salon des arts ménagers, consultez le dossier sur CNRS Images : https://images.cnrs.fr/archives/le-salon-des-arts-menagers.
#Exposition #Histoiresociale #Arts ménagers

In Flanders fields...
Crédits : MTDF
"In Flanders fields the poppies blow / Between thecrosses, row on row...» 1 ainsi commence le poème du lieutenant-colonel canadien John McCrae, écrit après la deuxième bataille d'Ypres le 3 mai 1915. Poème qui est devenu, au Canada et en Grande-Bretagne, l'emblème des morts de la Première Guerre Mondiale et qui est à l'origine du choix du poppy/coquelicot comme symbole des soldats. Poème, enfin, qui donne son nom au musée commémoratif d’Ypres. La ville rend tous les soirs hommage aux 54 896 soldats disparus sur son sol, lors de la cérémonie du Lastpotsous les voûtes du mémorial de la Porte de Menin.
In Flanders fields museum est à l'origine un musée associatif qui se professionnalisera en 1998. Quinze ans plus tard, la muséographie vient d'être complètement revue. A deux ans du centenaire de la Grande Guerre, ce n'est pas anodin, à l'heure où ses derniers témoins ont disparu, le rapport à l’événement se modifie. Il y a lieu de réfléchir sur la transmission de cette mémoire, et du rôle des musées de guerre aujourd'hui, comme l'ont rappelé les journées d'études organisées par le master les 11 et 12 décembre à Ypres : «Comment construire collectivement un patrimoine commun ? »
Comme à Péronne, l'historiographie, sans cesse plus riche sur cette période, a porté ses fruits, tous les belligérants sont représentés dans le musée d'Ypres, mais l'histoire commémorée est locale et donne à voir la guerre vécue en Flandre Occidentale, In flanders fields...
La scénographie dernier cri, s'accompagne d'une bande-son parfois oppressante. Les concepteurs ont choisi une ambiance grave un tantinet sensationnelle, sans toujours éviter la mise en scène macabre. Entre deux cimaises grises, une série de clichés, à l'accrochage esthétisant, représente des soldats morts, photographiés afin d'être ultérieurement reconnus.
Crédits : MTDF

Crédits : MTDF
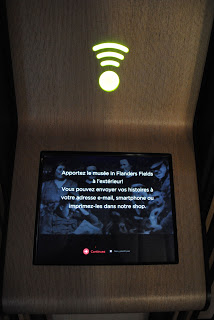
En résumé, le visiteur vivra une expérience forte qui l'interpellera dans son vécu (une borne permet de rechercher ses ancêtres morts sur le front) et cherchera àl'impliquer dans la construction de cette mémoire. A l'aube de 2014, c'est un site à ne pas manquer !
Noémie Boudet
Site internet du musée In Flanders Fields Museum
1 : "au champ d'honneur lescoquelicots,entre les croix de lot en lot"
2 : " RFID : radioidentification, permet de mémoriser et repérer à distance des informationscontenues sur les marqueurs
Jules à Amiens, Verne à Nantes
Née à Amiens et résidant à Nantes, on peut dire que je foule les pas de Jules Verne !
Dans chacune de ces villes qui lui ont été chères, se trouve aujourd’hui un musée qui valorise à sa façon l’écrivain,l’inventeur, comme l’homme politique.
Jules Verne est issu d’une famille nantaise de navigateurs et d'armateurs. Il nait sur une des îles de Nantes en 1828 et grandira dans l’effervescence des allers et venues des navires de marchandises. Il ne passera que ces 20 premières années à Nantes, pour partir ensuite à Paris faire ses études de droit. La vie de couple l’emmène ensuite à Amiens, d’où est originaire sa femme. Il y vivra 34 ans jusqu’à sa mort en 1905.
Ces deux villes qui ont fortement marqué l’écrivain, s’imposent donc dans la réception de son héritage et la création de lieux patrimoniaux.
Naissance du musée nantais
A Nantes les premières célébrations de Jules Verne commencent dès 1955 pour le 50e anniversaire de sa mort. Une association nantaise (La Société Académique de Nantes) lui consacre une exposition. C’est au cours de cet événement que l’idée commence à germer d’un « musée Jules Verne ».
La bibliothèque municipale prend la suite. Ayant déjà plusieurs ouvrages de l’écrivain, dont certains offerts et dédicacés par l’auteur lui-même, l’institution se penche sur la « star » locale. En 1963, elle lui consacre également une exposition pour célébrer le centenaire des « Voyages Extraordinaires ». La famille de l’écrivain touché par cet intérêt offre à la ville une cinquantaine de lettres autographes de l’écrivain. C’est alors le point de départ de la spécialisation de la bibliothèque nantaise qui va orienter ses recherches et sa politique d’acquisition sur l’auteur.
La création du centre d’étude vernien est officialisée au sein de la bibliothèque en 1969. Le musée deviendra ensuite une sorte d’annexe de la bibliothèque, un lieu de présentation et de médiation autour du fond vernien.
Le musée Jules Verne naît le 8 avril 1978, annéedu 150ème anniversaire de la naissance de Jules Verne à Nantes. L’évènement est largement fêté dans la ville, l’année 1978 est même déclarée année Jules Verne. Pour les 100 ans de sa mort en 2005, le musée est rénové. Aujourd’hui la bibliothèque est à nouveau en train de réfléchir à l’évolution du projet d’établissement du musée Jules Verne.
Un voyage thématique plus que temporel
Le musée nantais propose d’explorer Jules Verne à travers plusieurs thématiques : la terre, le ciel, l’espace. Les premières salles, plongent tout d’abord le public dans le contexte historique de la jeunesse de Jules Verne : la ville de Nantes en pleine effervescence maritime et industrielle. Persuadé que cela a profondément inspiré le jeune auteur, le lien avec le port de Nantes et la passion de Jules Verne pour les bateaux et les voyages sont très marqués. En témoignent plusieurs citations présentes dans le musée.
Les salles thématiques exposent au public tour à tour les inventions sous-marines et spatiales de l’inventeur avec de nombreuses maquettes. Puis une place importante est donnée à l’écrivain, notamment à sa collaboration avec son éditeur Hetzel, mais aussi ses nombreuses pièces de théâtre.
Enfin certaines pièces présentent l’interprétation de l’œuvre de l’auteur par des artistes contemporains. Les salles semi-permanentes, s’adaptent aux expositions temporaires. On y trouve notamment beaucoup d’illustrateurs, ou encore d’extraits cinématographiques.
La scénographie est assez épurée et propose plutôt de plonger dans les univers verniens, et dans sa réinterprétation actuelle. L’exposition est assez didactique et décrypte bien les passions de l’écrivain. L’idée ici n’est pas de réécrire l’histoire de Jules Verne, mais d’en présenter les grandes étapes, les grandes idées, et d’en perpétuer le souvenir.
Vue du musée Jules Verne avec la citation suivante : « Il y a cette circonstance que je suis né à Nantes, où mon enfance s’est tout entière écoulée (…) dans le mouvement maritime d’une grande ville de commerce » © CdA.
Une des salles de musée Jules Verne avec la citation suivante « Je n’ai jamais pu voir partir un vaisseau, navire de guerre ou simple bateau de pêche sans que mon être tout entier s’embarque à son bord. » © CdA.
La naissance du musée amiénois
Sur ses 34 ans de vie à Amiens Jules Verne habita plusieurs maisons, mais c’est dans celle du 2 rue Charles-Dubois qu’il y restera le plus longtemps. Dans cette très belle demeure du milieu du 19esiècle, typique du nord de la France en brique rouge, il mènera la grande vie avec de nombreuses réceptions.
Dès 1971, se rassemblent plusieurs passionnés et collectionneurs de Jules Verne pour se constituer en association au sein de la maison de l’auteur. Ils commencent alors à constituer une collection d’objets, ayant appartenu ou en lien avec l’homme. En 1980, la ville d’Amiens achète la maison. Pour éviter qu’elle ne tombe en ruine, des travaux sont réalisés l’année suivante pour que le Centre International de Jules Verne s’y installe. Plusieurs projets de réhabilitation du site se mettent en place comme une maison des sciences avec une partie consacrée à l’écrivain.
En 1990, 10 ans plus tard, la maison commence à s’ouvrir au public. Des travaux sont à nouveau réalisés au rez-de-chaussée pour restituer le salon de musique et la salle à manger de l’écrivain. A nouveau presque 10 ans plus tard, la ville laisse le CIJV (Centre International de Jules Verne) gérer la maison officiellement. C’est alors que le bâtiment est classé au sein de la Fédération des Maisons d’Écrivain et des Patrimoines Littéraires. Le fond vernien s’agrandit considérablement quand en 2000, le collectionneur Piero Gondolo della Riva, cède 30 000 objets à la ville.
La Maison de Jules Verne fait peau neuve en 2006, grâce entre autres au scénographe François Schuiten (qui a réalisé la scénographie du Train world à Bruxelles). Il ajoute à la tour de la maison un globe en métal tout à fait dans l’esprit de l’écrivain.
Une immersion dans la vie quotidienne de l’auteur
La maison a pris le parti de retranscrire une ambiance d’époque, créer une maison intime. On plonge dans une habitation bourgeoise du 19e avec quelques inspirations néogothiques comme la Maison de Victor Hugo à Paris. Le visiteur foule les pas de l’écrivain dans sa salle à manger, son fumoir, sa bibliothèque, etc. On découvre que l’homme, d’une manière très prosaïque, écrivait dans un tout petit cabinet avec juste de quoi écrire, dormir et observer les allers et venues des trains à travers une petite fenêtre.
Est évoqué également l’homme politique, ce qui n’est pas le cas à Nantes, à juste titre car c’est à Amiens qu’il s’engagera dans le conseil municipal de la ville. Y figure donc des distinctions qui lui ont été remises et des reproductions d’un de ses grands projets qui lui a tenu à cœur : la création d’un cirque à Amiens (aujourd’hui renommé cirque Jules Verne) pour promouvoir la création artistique.
 Puis, plus on monte dans les étage plus on s’évade dans des univers oniriques. Au 3e étage sont évoqués les bateaux et les voyages avec la reconstitution d’une cabine de bateau qui nous immerge dans une bulle spatio-temporelle. Le dernier étage joue sur l’effet « grenier » dans un bric-à-brac d’objets évoquant la postérité de l’œuvre de Jules Verne avec des objets de cinéma, théâtre, des marionnettes, etc.
Puis, plus on monte dans les étage plus on s’évade dans des univers oniriques. Au 3e étage sont évoqués les bateaux et les voyages avec la reconstitution d’une cabine de bateau qui nous immerge dans une bulle spatio-temporelle. Le dernier étage joue sur l’effet « grenier » dans un bric-à-brac d’objets évoquant la postérité de l’œuvre de Jules Verne avec des objets de cinéma, théâtre, des marionnettes, etc.
Globalement dans cette maison, l’ambiance est assez chargée, il y a beaucoup de collections, parfois un peu trop. Cependant l’objectif n’est pas le même qu’à Nantes, le public vient ici d’abord pour visiter un bâtiment « historique », et s’imprégner de la vie et de l’esprit de Jules Verne et ensuite butiner vers certains objets qui auront piqué sa curiosité.
Vue extérieure de la Maison Jules Verne, Amiens. © CdA.
Vue intérieure d’une salle de la Maison Jules Verne, Amiens. © CdA.
Jules à Amiens, Verne à Nantes
Malgré des dates assez communes, les deux sites verniens n’ont pas eu la même évolution. A Nantes, les choses se sontfaites assez rapidement, le premier musée nait à la fin des années 1980, alors qu’à Amiens la ville rachète tout juste la maison. La force des deux associations à l’origine du musée diffère également. A Amiens, le CIJV s’est constitué comme une association très puissante, puis le musée a été géré par les bibliothèques de la ville. Il y a eu un transfert de compétences et de gestion. A Nantes, le lien avec la bibliothèque municipale est marqué dès l’origine et installe une belle continuité dans le temps, même si aujourd’hui le musée mériterait de prendre son envol.
Chaque musée a choisi en bonne intelligence de valoriser une facette de Jules Verne. A Nantes nous est présenté les rêves de l’homme, ses inventions, ses passions, son univers si inspirant. Tandis qu’à Amiens, est recherché l’intimité avec l’écrivain, son lieu de vie, ses ouvrages, et le contexte politique dans lequel il vécut.
Bien sûr ces deux villes n’ont pas le monopole de la valorisation de Jules Verne . Tout comme les musées, les passionnés du monde entier se font un plaisir de réinterpréter l’œuvre qui touche aussi bien le domaine de la littérature, de l’histoire, des sciences, de la politique, du cinéma, etc.
Charlotte Daban
#JulesVerne
#Amiens
#Nantes
#Littérature
#Voyage
Pour en savoir plus :
Musée de Jules Verne Nantes : http://www.julesverne.nantesmetropole.fr/home.html
Maison de Jules Verne Amiens : http://www.somme-tourisme.com/amiens-et-autres-histoires/jules-verne-dans-la-somme
Centre International de Jules Verne : http://www.jules-verne.net/index.php/le-centre

Jusqu'au bout du monde, regards missionnaires : voyage au cœur des Missions
Jusqu'au 8 mai 2022 se tiendra, au musée des Confluences, l'exposition Jusqu'au bout du monde, regards missionnaires qui choisit d'évoquer l'un des épisodes de la constitution de ses collections. L'exposition présente des objets ramenés du monde entier en les associant aux parcours de vie des missionnaires qui les ont collectés.
À l'origine, un dépôt des Œuvres Pontificales Missionnaires. Dépôt participant à la constitution et à l'enrichissement des collections du musée des Confluences. En son sein, une multitude d'objets divers rapportés par des missionnaires catholiques français partis évangéliser le monde à la fin du 19ème siècle. Avec l'exposition Jusqu'au bout du monde, regards missionnaires, le musée des Confluences choisit d'aborder la question des Missions à travers plusieurs prismes. Tout d'abord c'est là l'occasion d'interroger le rôle du musée, démarche déjà à l'origine de l'exposition Les trésors d’Émile Guimet sur la création d'un musée des religions à Lyon en 1879 par le voyageur et collectionneur du même nom, et de Dans la chambre des merveilles réinterprétant les cabinets de curiosités lyonnais.
L'introduction du parcours d'exposition revient sur la création, à Lyon, de l’Œuvre de la Propagation de la Foi en 1822, qui soutient le départ de milliers de jeunes hommes et femmes religieux vers l'Océanie, l'Asie, l'Afrique, ou les Amériques, afin d'évangéliser les populations. Celle-ci fut créée sous l'impulsion de Pauline Jaricot, qui dès l'âge de 20 ans, en 1819, imagine une collecte afin de recueillir des fonds matériels et financiers pour les Missions. Cette idée mènera trois ans plus tard à la création de l’Œuvre.

Pauline Jaricot, initiatrice de la fondation de l’Œuvre de la Propagation de la Foi
© Jean-Loup Charmet / O.P.M.
Dans le but de contribuer à attirer des soutiens mais aussi de susciter de nouvelles vocations, sont diffusés périodiquement les récits de vie des missionnaires dans un journal, les Annales de la Propagation de la Foi, rédigées et imprimées à Lyon dès 1822. Une entreprise réussie au vu du nombre de tirages important, qui témoigne d'une curiosité et d'une soif d'aventure bien réelle chez un public pour qui les Annales sont bien souvent la seule source de connaissances des cultures étrangères. Cette publication continuera en 1868 sous le nom de Les Missions Catholiques et se tournera davantage vers les aspects les plus pittoresques des pays de mission.
L'envoi à l'Œuvre de la Propagation de la Foi des objets collectés sur le terrain par les missionnaires, constitue la preuve de leur présence sur place. Ces objets étaient maladroitement exposés (en ce sens qu'ils ne bénéficiaient d'aucune mise en lumière pour être appréciés) dans le musée de l'Œuvre, dont l'une des photos de la salle est visible dans l'introduction de l'exposition, imprimée en grand format sur une cimaise. Cette photographie a d'ailleurs permis aux conservatrices de reconstituer un objet dispersé à plusieurs endroits.
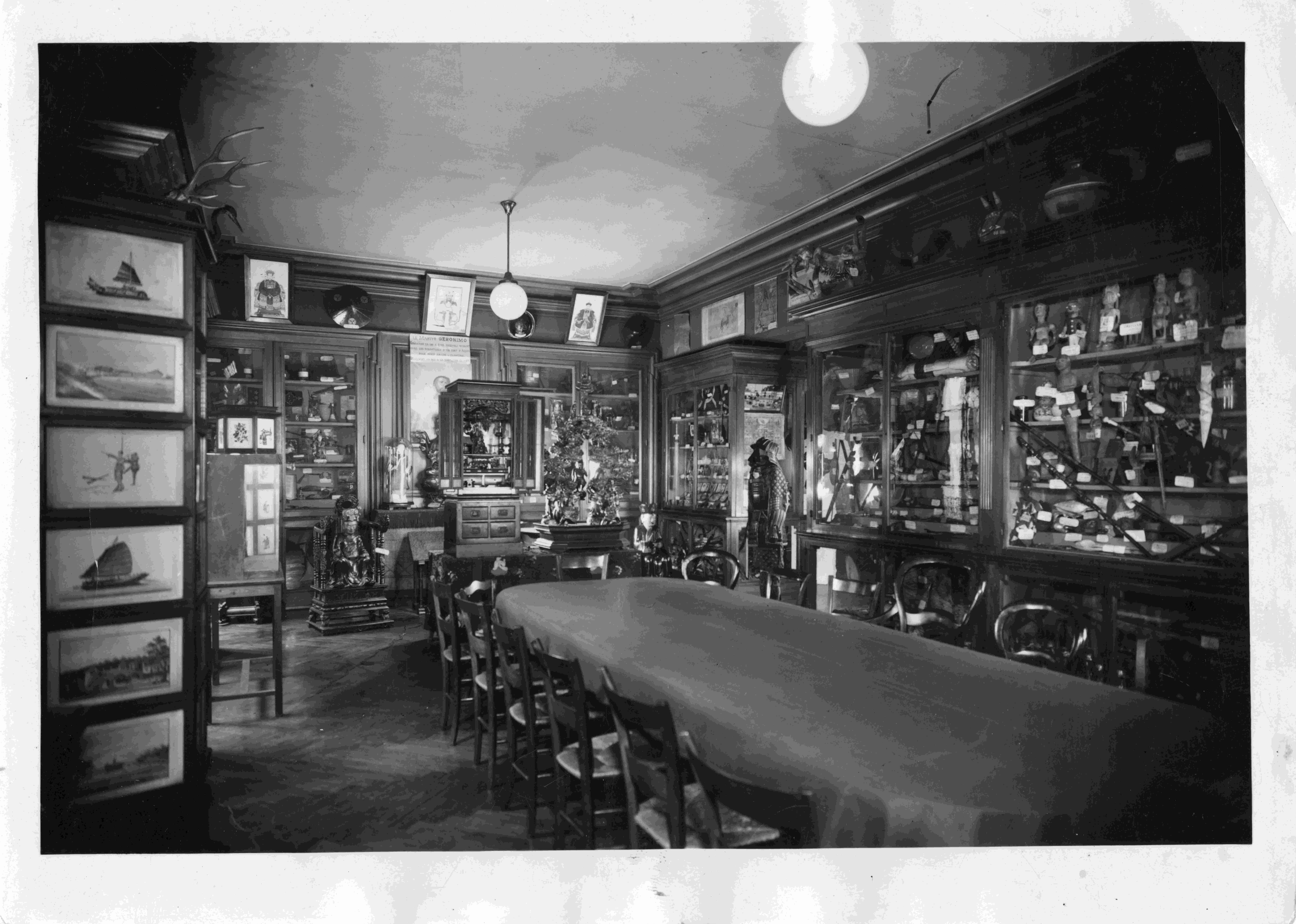
Salle du Conseil et du musée de l’Œuvre de la Propagation de la Foi, 1943
© O.P.M.

Autel funéraire familial reconstitué, butsudan
© musée des Confluences – Olivier Garcin
Une exposition riche
Une fois l'introduction passée, notre voyage expographique peut commencer. Sur le plan visuel le visiteur n'est pas déçu : le contenu est riche sans trop l'être et les objets sont attractifs. Leur variété, justifiée par la diversité des lieux de collecte et par les préoccupations des missionnaires lorsqu'ils en ont : démontrer l'état de misère religieuse dans lesquelles se trouvent les peuples autochtones, valoriser un savoir-faire, illustrer un trait culturel, ou simplement explorer un centre d’intérêt, empêchent une lassitude de s'installer.

Exposition "Jusqu'au bout du monde, regards missionnaires" au musée des Confluences
© musée des Confluences – Bertrand Stofleth
Les objets exposés sont regroupés en cinq grandes parties : quatre d'entre elles restituent simplement l'origine géographique continentale de ces derniers (dans l'ordre de visite : Océanie, Asie, Afrique et Amériques). La dernière partie réunit quant à elle des objets dont le lien entre eux est directement lisible par le visiteur : instruments de musique d'une part et maquettes de bateaux d'autre part.
La scénographie est semblable à ce à quoi le musée des Confluences nous a habitués : le tout est épuré, l'espace est sombre mais les lumières bien dirigées et assez fortes (une intensité faisant parfois défaut dans d'autres expositions du musée). L'espace entre les différents plateaux est bien calculé et les couleurs, sobres et complémentaires, mettent en valeur les expôts. Notons ici le fait que plusieurs des objets ethnographiques exposés ne sont pas sous vitrine, chose rare mais appréciable lorsqu'on peut se le permettre.

Exposition "Jusqu'au bout du monde, regards missionnaires" au musée des Confluences
© musée des Confluences – Bertrand Stofleth
Enfin, le mobilier central contenant différents audiovisuels qui restituent la parole de missionnaires, se fond dans l'espace et permet une accessibilité confortable pour une personne en fauteuil.
Plongée sonore au cœur de récits missionnaires
Si la collecte d'objets fait partie des Missions, celle-ci n'occupe cependant qu'une place secondaire dans ses objectifs. L'enjeu de l'exposition apparaît alors clairement indiqué : derrière les objets présentés, faire état du parcours de vie de certains missionnaires les ayant collectés. Ces récits sont peu connus du grand public, encore moins des plus jeunes, et participent à la restitution d'une histoire riche, même si le manque de sources pour restituer la vision des différents peuples autochtones rend le regard unilatéral (exception faite de Jean-Baptiste Pompallier, missionnaire mariste parti en Nouvelle-Zélande auquel une vidéo est consacrée). En plus des présentations de chaque missionnaire et de citations à proximité des objets présentés, l'exposition fait le choix d'incarner certains récits en les faisant interpréter par des comédiens. La sélection s'avère révélatrice d'un ensemble de faits : partir en Mission est une entreprise périlleuse, les voyages sont longs et difficiles, le missionnaire est bien souvent livré à lui-même sur un territoire qu'il ne connaît pas, aux conditions climatiques parfois très rudes (évoquons notamment Joseph Bernard parti en Alaska), parlant une langue qu'il ne pratique pas, et ayant en tête l'idée d'y finir sa vie. Si les Missions peuvent être souvent vues, dans l'imaginaire commun, comme liées à une entreprise coloniale, l'exposition permet de restituer la réalité de l'engagement missionnaire. Nous sont rapportés plusieurs témoignages de missionnaires mobilisés dans différentes parties du monde. Ainsi, Joseph Gabet et Évariste Huc, partis ensemble en 1844, nous content leur périple de 18 mois, à dos de cheval, de mulet ou de chameau, de la Mongolie jusqu'à Lhassa, capitale du Tibet. Alexandre Le Roy, premier français à gravir le Kilimandjaro, fut un défenseur du rôle scientifique du missionnaire : ses dessins, qui témoignent de cultures rencontrées et de la faune et flore observées en Tanzanie et au Gabon, sont remarquables.
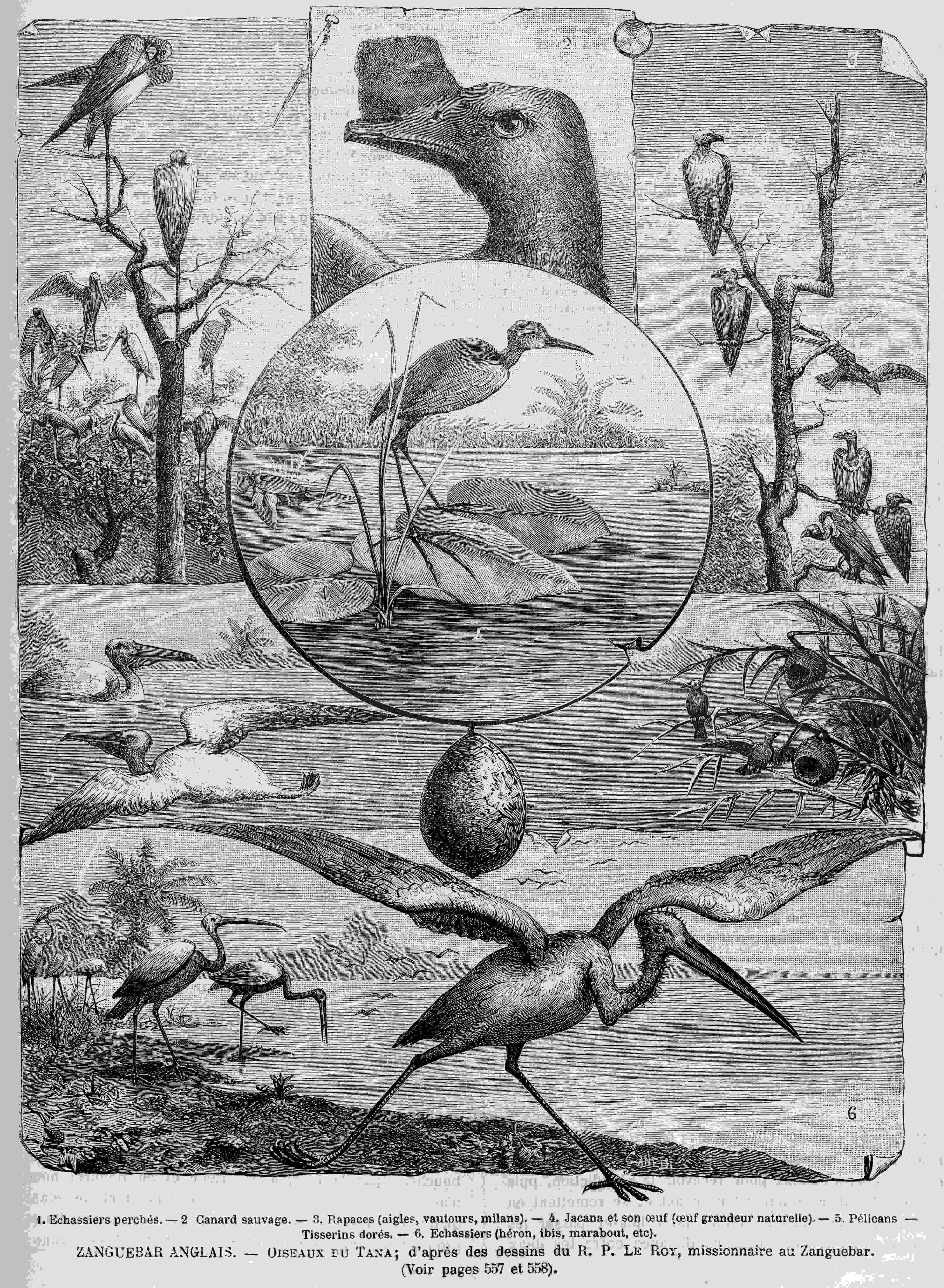
Oiseaux du Tana d’après les dessins d’Alexandre Le Roy
© Archives générales du Saint-Esprit
Enfin, Joseph Bernard, surnommé « le curé le plus proche du pôle Nord », nous parle de sa mission en Alaska, où il vécut la plupart du temps seul avec son attelage de chiens, au rythme des autochtones. L'ensemble des récits audio est illustré par des photographies d'époque ou des dessins.

Joseph Bernard avec ses chiens, St Mary's Igloo, 1910
© O.P.M.
La diversité des témoignages nous permet surtout de comprendre ce qui nous apparaît finalement si logique : le regard posé sur l'autre dépend, une fois sur le terrain, en majeure partie de la personnalité du missionnaire, bien que celui-ci soit forcément convaincu d'apporter la civilisation salvatrice à ces peuples. Missionnaires qui ont pu contribuer à la connaissance de cultures méconnues, non seulement grâce aux objets envoyés ou rapportés, mais aussi au travers de lexiques ou dictionnaires cherchant, par nécessité de compréhension et d'intégration dans une culture, à retranscrire phonétiquement des langues jusque là seulement héritées d'une tradition orale. Notons par ailleurs l'effort fait par l'exposition pour rendre compte de l'implication des femmes parties en Missions. Plus nombreuses encore que les hommes et pourtant restées peu visibles, elles partent souvent dans le but d'échapper à leur condition et leur perspective d'évolution dans leur société d'origine. Ces dernières ayant la possibilité d'accéder plus facilement à la sphère intime du noyau familial, leur mission est centrée sur le soin, l'éducation des femmes et des enfants, et la diffusion des valeurs chrétiennes.

Timbre représentant Françoise Perroton, première femme missionnaire à Wallis et Futuna
© Samuel Hense / Hans Lucas
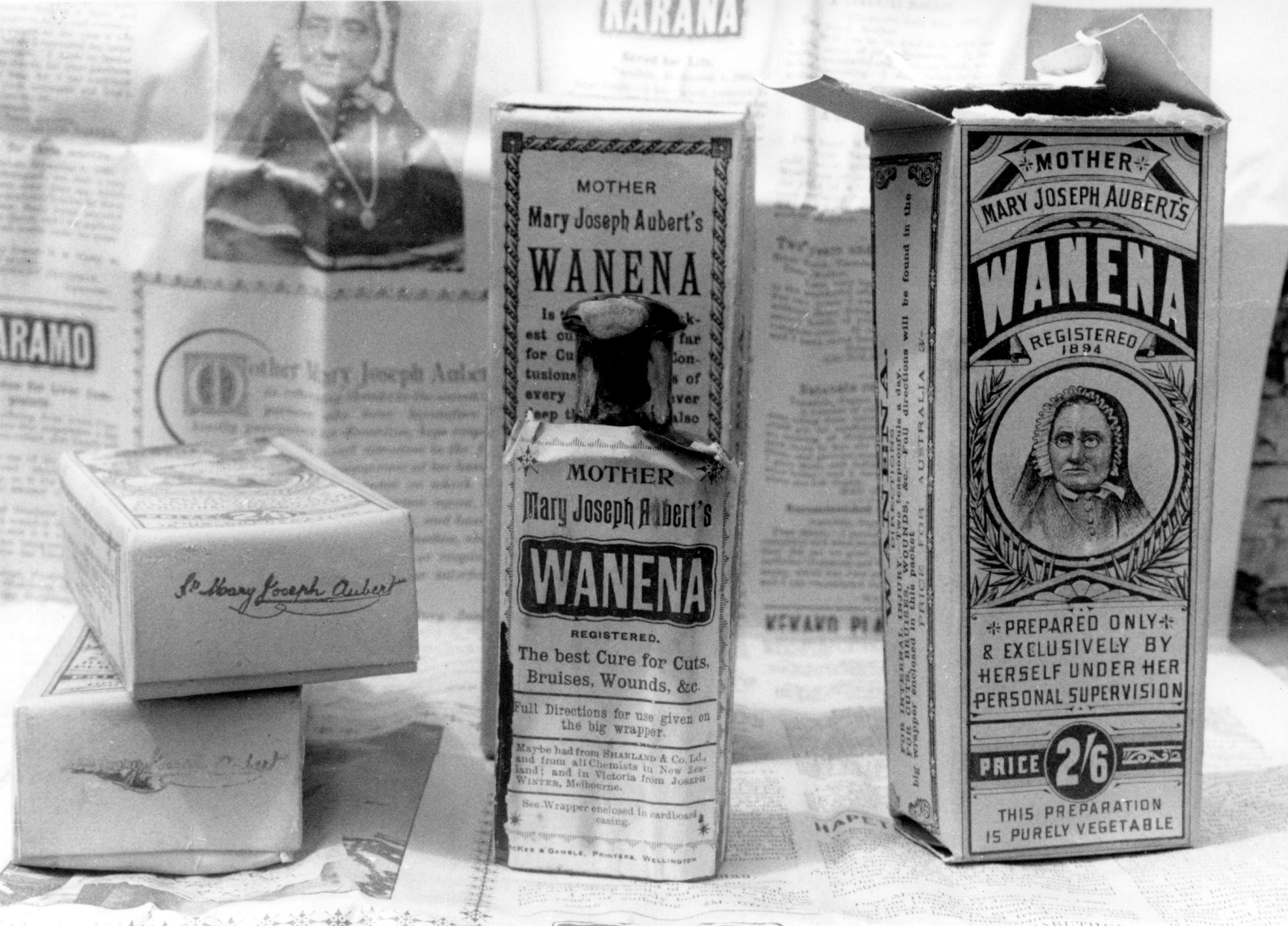
Médicaments préparés par Suzanne Aubert
© Sisters of Compassion
Une contextualisation bienvenue
Un entretien avec Claude Prudhomme, ancien professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Lumière Lyon 2, constitue le véritable cœur de la compréhension globale. Son intervention contextualise les Missions, leurs objectifs, leur fonctionnement, les difficultés rencontrées, leur lien avec la colonisation, l'évolution de leur perception dans le temps, ainsi que le changement d'axe d'observation opéré par les musées missionnaires pour s'adapter au regard de l'époque. Il nous permet ainsi d'apprendre que la mission d'évangélisation était conçue comme dépendante d'une mission civilisatrice, que l'école était au centre de ce dispositif, et que l'objectif était avant tout de former un clergé local. La question de la prise en considération de la culture locale est par ailleurs approfondie, nous permettant de comprendre qu'elle était une directive essentielle formulée par le pouvoir catholique. Le missionnaire devait être à même de pouvoir distinguer les pratiques païennes contraires à la foi chrétienne, de celles qui ne la gênaient pas, et de celles qui pouvaient y être rattachées. Un jugement qui variait bien entendu selon le missionnaire en question. Enfin, nous apprenons que la christianisation s'est diffusée et développée avec la décolonisation et non la colonisation, et parfois même dans des pays non-colonisés (la Chine par exemple). Si l'on aurait aimé voir ces informations mises plus en avant, d'autant plus lorsqu'on apprend à travers cet entretien que la collecte d'objets reste finalement très secondaire dans l'objectif missionnaire, elles restent une bonne conclusion à l'exposition.
Une exposition intéressante pour ce qu'elle est, mais aussi pour ce qu'elle pourrait ouvrir comme horizon. Un premier pas dans une histoire mal connue du grand public, et qui pourtant aurait sûrement des avantages à l'être, permettant une prise de recul bienvenue dans notre époque. En effet, si les musées sont des lieux de conservation, de recherche, et d'expositions, ils n'en restent pas moins des lieux d'ouverture vers le débat, tant ils peuvent laisser à penser. Ils ne devraient donc pas faire l'impasse, par crainte de réactions, sur des sujets dont l'influence, les répercussions, sont encore d'actualité, et qu'ils sont les rares à pouvoir aborder au détour d'un divertissement culturel pensé et non d'une flambée médiatique.
Lucas Perrus
|
Exposition : Jusqu'au bout du monde, regard missionnaires – du 18 juin 2021 au 8 mai 2022 Superficie : 250 m² Cheffe de projet : Marianne Rigaud-Roy Référentes des collections : Deirdre Emmons, Marie-Paule Imberti & Marie Perrier Scénographie : Emmanuelle Garcia & Étienne Lefrançois Graphisme : Emmanuelle Garcia |
Pour aller plus loin :
-
Claude Prudhomme, Missions chrétiennes et colonisation : XVIe-XXe siècle, Éditions du Cerf, 2004.
-
Claude Prudhomme (dir.), Une appropriation du monde : mission et missions, XIXe-XXe siècles, Éditions Publisud, 200.
-
Lien vers l'événement et podcast sur le sujet

L'après 07/01/15 : Dire, écrire, exposer contre la pesanteur
Superbe édito publié par Laurent Joffrin dans Libération le vendredi 9 janvier :
« […] La République vivra, enfin, parce que les démocraties sont des régimes de faible apparence et d’une force insoupçonnée. En général, elles gagnent les guerres. La soumission, contrairement à ce qu’on voudrait faire croire, n’est pas leur fort. L’air du temps intellectuel et politique voudrait qu’elles soient sur le déclin, en décadence, que l’individu des droits de l’homme, déraciné, sans principes ni traditions, se détourne du bien commun et se laisse perde dans l’angoisse d’une liberté laissée à elle-même. Il n’y arien de plus faux. Certes, la société marchande fait souvent perdre de vue les valeurs fondatrices. Mais les épreuves les font ressurgir. La liberté est comme l’air, on la respire sans y penser. Mais si elle vient à manquer, chacun étouffe et se débat aussitôt pour la retrouver […] ».
Nous sommes tous bouleversés par ce qui est arrivé à la rédaction de Charlie Hebdo. La brutalité des faits n’est pas le seul élément à l’origine de notre émotion. La cible de l’attentat a éveillé en nous un sentiment indicible. De toute part, en France, les témoignages se sont multipliés, et le besoin de verbaliser non seulement le soutien mais aussi la perte éprouvée par chacun s’est manifesté.
Et pour cause, notre sens du symbolique nous murmure « là c’est sûr, il y a quelque chose ».
Mon père psychanalyste me disait que depuis deux jours, tous ses patients avaient consacré leur séance aux évènements. Tous, sans exception, ont témoigné de leur saisissement et certains ont tenté d’identifier les raisons pour lesquelles ils étaient aussi intimement affectés par l’assaut du 7 janvier. Le psychanalyste, amoureux de la parole libre, « de la parole incongrue, insoumise à la force de l’habitude » semblait sans doute l’interlocuteur idéal pour aborder la trace laissée par la tentative, terrifiante, de mettre un terme à l’expression.
 Les institutions culturelles ont elles aussi tenu à dire leur ébranlement. Les collectivités, les musées et les bibliothèques ont réagi prestement, ressortant les archives de l’hebdomadaire qu’elles possédaient parfois. Beaucoup de ces structures se sont mises au travail, et ont commencé à concevoir des expositions autour des dessins du journal satirique.
Les institutions culturelles ont elles aussi tenu à dire leur ébranlement. Les collectivités, les musées et les bibliothèques ont réagi prestement, ressortant les archives de l’hebdomadaire qu’elles possédaient parfois. Beaucoup de ces structures se sont mises au travail, et ont commencé à concevoir des expositions autour des dessins du journal satirique.
© BNF
La bibliothèque Kandinsky, située au niveau 3 du Centre Pompidou a notamment décidé d’organiser une exposition sur les débuts du journal, de 1969 à 1986. La BNF, qui avait consacré en 2012 une rétrospective à Wolinski, a quant à elle projeté sur la façade de l’un de ses bâtiments un autoportrait du caricaturiste intitulé « Adieu ». Issue de l’album Vive la France (éditions du Seuil, 2013), l’image, monumentale, illumine depuis jeudi les nuits qui nous séparent de la fin de la période de deuil national.
Il est fort probable que les projets d’exposition en hommage aux dessinateurs, ou plus généralement consacrés à la liberté d’expression essaiment dans les prochaines semaines en France, pour notre plus grande satisfaction.
Mercredi 14 janvier, le prochain numéro du journal satirique sera publié à un million d’exemplaires. Admiratifs de la détermination avec laquelle l’équipe de rédaction s’est remise au travail, nous sommes nombreux à attendre de découvrir les textes et les dessins que les journalistes composent en ce moment. Ces documents sont les témoins que la parole libre continuera à s’élever, explorant tous les horizons qu’elle désire pour le faire, sans restriction.
N.D.
#charlie hebdo
#liberté de lapresse
L'exposition Samouraï. De la guerre à la voie des arts : Regards croisés, entre l'âme et le fer
À la cour du shogun Tokugawa, en ce début de 1701, ce fût la parole de trop pour Asano Naganori, seigneur d’Akô de la province d’Harima. Kira Yoshinaka, maître de cérémonies, venait encore une fois de le provoquer ! Quel ne fût alors pas son geste lorsque fou de rage, Asano dégaina son sabre et blessa Kira Yoshinaka. Outrage ultime1, Asano est condamné au seppuku, suicide rituel par hara-kiri. Refusant la sentence injustement appliquée à Asano, 47 de ses vassaux vengèrent la mort de leur maître en assassinant à leur tour Kira, dont la tête fût déposée sur la tombe d’Asano. Ce fait historique, connu sous le nom de légende des 47 rônins2 est l’une des nombreuses histoires que l’exposition temporaire « Samouraï. De la guerre à la voie des arts » nous fait découvrir. Et pour cause, qui n’a jamais souhaité trouver en ces contes et légendes une part de vérité ?
Faisant appel à notre imaginaire, le musée départemental des Arts Asiatiques de Nice retrace l’histoire de ces guerriers du Japon et leur insuffle une nouvelle dynamique. Car si les samouraïs portent en nous l’image de ces guerriers emplis d’honneur à la coiffure si caractéristique, l’exposition s’évertue à confronter mythe et réalité, opérant par la même occasion une remise en contexte de la figure du samouraï - aujourd’hui encore considéré comme l’un des emblèmes historiques de l’Archipel. À travers près de 250 pièces, le musée nous présente les vestiges de ces guerriers - tant dans leur mission première d’homme de guerre que dans leur vie quotidienne.
Affiche de l'exposition "Samouraï, De la guerre à la voie des arts" © Musée départemental des Arts asiatiques
Armures de samouraïs exposées lors de l'exposition "Samouraï, De la guerre à la voie des arts" © Département des Alpes-Maritimes
À mesure que l’on descend les escaliers pour atteindre l’exposition, les yeux s’ouvrent, l’esprit s’éveille. Du rouge criard aux couleurs les plus sombres, ce sont une demi-douzaine d’armures face auxquelles le visiteur se retrouve confronté. Toutes différentes et rivalisant d’originalité, certaines possèdent des motifs en accord avec l’inspiration spirituelle de leur maître, d’autres des casques grimaçants et des barbes hirsutes. Placées en position assises et légèrement surélevées, certaines ont connu des batailles, tandis que d’autres n’étaient revêtues que lors des cérémonies3. Assemblées de manière complexe et en totale opposition face aux armures européennes (faites d’un même bloc), des schémas explicatifs nous permettent de comprendre l’agencement de l’armure du samouraï, dont les minuscules lamelles métalliques et de cuir sont reliées les unes aux autres par des cordons de soie4. Placés face à ces dernières, des écrans tactiles permettent aux enfants de reconstituer l’armure des samouraïs telles que portées jadis, tout en apprenant l’art de la fabrication du sabre de samouraï. Si tout bushi5 se doit de pratiquer les armes, le sabre, mais aussi le tir à l’arc et - si ses moyens le permettent – l’équitation ; l’armure, plus légère et résistante, est aussi plus chère. Appelée l’ô-yoroi6 et revêtue durant les guerres féodales, seuls les daimyos et samouraïs les plus riches pouvaient s’en fabriquer une. En temps de paix, elle perdait toute valeur guerrière, devenant objet de richesse et de monstration avec force de décors, symboles religieux et matériaux précieux. Les casques et masques en métal, outre leur rôle protecteur, avaient également pour but de renseigner sur le statut du samouraï tout en effrayant les ennemis sur le champ de bataille. Exposées à leurs côtés, certaines des armes emblématiques des samouraïs comme la lame à lance courbe, le naginata - très utilisé par les moines et femmes samouraïs – ou encore le daisho – association du katana et du wakizashi – popularisé à l’époque de Momoyama et durant toute l’époque d’Edo. Les samouraïs sont alors les seuls japonais autorisés à les porter, ils ont le droit de vie ou de mort sur leurs concitoyens.
Passant d’un espace circulaire à une salle aux proportions plus intimistes, la deuxième partie de l’exposition aborde le rapport des guerriers à la religion et plus généralement à la spiritualité. Fondés sur des emprunts à différents courants de pensées, le Bushidô – code des principes régissant la classe guerrière des samouraïs7 – tire ses principes du bouddhisme, du shintoïsme et du confucianisme. L’utilisation de photographies, d’objets et de tissus sont alors autant d’éléments permettant de comprendre la dévotion des samouraïs à ce code strict exigeant loyauté et honneur jusqu’à la mort. Respectant les sept vertus du guerrier - la droiture, la bienveillance, la politesse, la sincérité, l’honneur, la loyauté - le symbole de la libellule, présent de nombreuses fois au sein de l’exposition, est également là pour nous rappeler la dernière vertu du samouraï, le courage. Cette vertu, le samouraï doit en être empreint de tout son être ; car une fois son honneur sali, il doit se donner la mort afin de libérer son âme.
Photo de l'exposition © Département des Alpes-Maritimes
Cette ouverture sur la vie des samouraïs permet au visiteur de voir les costumes du quotidien, les activités et les objets particulièrement utilisés et appréciés des samouraïs. Dans la continuité de l’exposition, le visiteur découvre ainsi plusieurs « vitrines » au travers desquelles ont été reconstituées les scènes de vie de ces guerriers. Si le trop grand nombre d’objets de ces scènes empêche une lecture fluide de leur fonction, leur placement et leur rareté palie à cette gêne. Qu’il s’agisse des kimonos portés en dehors du champ de bataille (kashimonos), des ustensiles utilisés lors de la chasse à l’aigle ou encore du théâtre Nô, l’exposition nous ouvre également une porte vers les femmes de samouraïs plus que bienvenue, bien qu’encore insuffisante. S’accompagnant d’un certain nombre d’écrans à l’attention des enfants, le contenu muséographique permet de compléter ces « scénettes » au travers de grands faits historiques ayant marqué le règne de ces guerriers de l’Archipel. Malheureusement, si l’exposition retrace avec intérêt le parcours des samouraïs, la place attribuée aux écrans reste à retravailler. Possédant presque tous un contenu de médiation destinée aux enfants, le public plus âgé se retrouve face à beaucoup de textes, et n’ose participer aux activités ludiques proposées par les différents dispositifs numériques. Ponctués de questions numérotées auxquelles les enfants doivent répondre dans un carnet, cette médiation éloigne d’autant plus les visiteurs avertis que certains supports demandent à ce dernier de se mettre à genoux face aux écrans - position qui, outre les enfants, peut possiblement rebuter. Une grosse partie du contenu informatif, comme le rituel de fabrication du sabre de samouraï, n’est alors pas traité par une partie du public. À contrario, si les écrans sont plus accessibles à un public scolaire, le contenu historique de l’exposition leur est moins compréhensible. L’exposition se retrouve alors comme « tranchée » en deux parcours distincts, qu’il serait intéressant de rassembler afin de donner une meilleure vision du contenu informatif global. Se déroulant du 8 juillet au 7 janvier 2018, l’exposition du Musée des Arts Asiatiques permet de confronter notre regard et notre imaginaire à cette civilisation à la fois si connue, et pourtant si éloignée – tant géographiquement que culturellement – de nos contrées occidentales. Un retour dans le passé nous permettant de prendre conscience de l’articulation intrinsèque entre ces deux notions, qui sont l’art et la guerre.
E. C.
#samouraïs #Nice#expositiontemporaire#muséeartsasiatiques
1 Il est interdit de dégainer son sabre au sein du palais du shogun.
2 Rônins : guerriers qui n’ont plus de maître.
3 Information tirée de l’exposition.
4 Ibid.
5 Cavaliers chargés de la protection de leur clan.
6 Style d’armure correspondant au rang de Samouraï, richement décorée.
7 Ibid.

L'utopie réalisée
C'est naturellement par la rue André Godin que l'on accède au Familistère de Guise. André Godin était un industriel philanthrope qui dirigea l'entreprise de poêles en fonte du même nom, de 1840 jusqu'à sa mort en 1888. Largement influencé par les théories fouriéristes, il prend très tôt conscience des mauvaises conditions de vie des ouvriers et décide d'y remédier en repensant le modèle du phalanstère – cité utopique communautaire imaginée par Fourier et qui serait le socle d'un nouvel État – pour créer le Familistère de Guise, en 1858. Son but premier est de proposer aux ouvriers qui le veulent un mode de vie communautaire, doté de ce qu'il appelle les « équivalents de la richesse » : eau potable, luminosité des appartements, bonne aération, accès à la culture (par l'enseignement, la bibliothèque et le théâtre), bonne forme physique, etc. Le Familistère représente un lieu hautement symbolique puisqu'il est considéré comme la seule réalisation du socialisme utopique ayant réussi en France.
Cet ensemble de bâtiments, classé monument historique, abrite depuis 2010 un établissement labellisé Musée de France. C'est sous la forme d'un circuit que le visiteur est invité à découvrir les lieux du Familistère, comme pour retracer la vie d'un habitant. Deux temps distincts rythment cette visite.
Tout d'abord, et assez étonnamment, c'est dans les bâtiments annexes que le visiteur est accueilli, et plus particulièrement dans les économats. S'en suivront le théâtre, la bibliothèque, la piscine, séchoir/laverie, etc. Ces bâtiments sont comme des îlots entourant le bâtiment principal, qui proposent d'aborder chacun une thématique propre : l'éducation pour le théâtre ou l'hygiène pour la piscine. A chaque fois, l'histoire des lieux, le contenu purement historique, est présenté en vis-à-vis d'idées plus globales et qui touchent à plusieurs disciplines. Ainsi, dans la piscine, on trouve bien entendu la volonté de présenter l'usage des lieux, mais également une mise en lien de celle-ci avec les théories hygiénistes de l'époque. C'est également dans la piscine que l'on trouve une lecture chronologique de l'architecture utopique, de Charles Fourier à Tony Garnier.
Même constat dans le théâtre, où cette salle de spectacle est prétexte à aborder le sujet de l'éducation et de confronter Victor Hugo à Charles Fourier, le temps d'une projection. Cette mise en perspective constante est intéressante et permet de se départir d'une scénographie un peu trop « académique » que représente la mise en vitrine d'objets. La muséographie, d'ailleurs, arrive à trouver un équilibre en alliant exposition classique d'objets et nouvelles technologies. En plus du visio-guide qui est proposé au visiteur, les différents espaces d'expositions sont systématiquement accompagnés de vidéos explicatives qui permettent de replacer les bâtiments dans leur contexte d'origine. Même si cette pratique est aujourd'hui répandue dans la plupart des musées, elle apporte un réel intérêt à ces grands bâtiments qui, de prime abord, paraissent mornes et sans vie. D'autant que les supports sont variés : films, reconstitutions d'interviews, écrans tactiles, ambiances sonores, etc. D'une certaine manière, l'utilisation des technologies qui est faite au Familistère redonne vie au lieu.
Crédits : T.L
 Ensuite vient la visite du bâtiment central, le « Palais social ». C'est le bâtiment que l'on associe le plus facilement au Familistère, par sa position centrale dans l'espace mais aussi par sa taille. Il renferme également une particularité architecturale qui le rend, à première vue, plus attractif que les autres bâtiments : une verrière centrale de plus de 11 000 carreaux. L'espace qu'elle recouvre était utilisé comme un lieu de rassemblement et de commémoration, comme lors de la Fête du Travail. Dans le Palais social se trouvent plusieurs lieux d'expositions, répartis sur trois niveaux. Ainsi on y découvre l'histoire du socialisme utopique et de ses expérimentations. C'est également l'occasion de faire connaitre la vie de Jean-Baptiste André Godin à travers son appartement. L'histoire de la construction du Familistère est abordée, couplée à de nombreuses précisions techniques et architecturales. Le visiteur pourra également découvrir les techniques de fabrication des poêles Godin et les principaux concurrents de la marque. Notons qu'un appartement d'époque est reconstitué, prélude pour aborder ensuite les loisirs au Familistère ou encore son organisation administrative.
Ensuite vient la visite du bâtiment central, le « Palais social ». C'est le bâtiment que l'on associe le plus facilement au Familistère, par sa position centrale dans l'espace mais aussi par sa taille. Il renferme également une particularité architecturale qui le rend, à première vue, plus attractif que les autres bâtiments : une verrière centrale de plus de 11 000 carreaux. L'espace qu'elle recouvre était utilisé comme un lieu de rassemblement et de commémoration, comme lors de la Fête du Travail. Dans le Palais social se trouvent plusieurs lieux d'expositions, répartis sur trois niveaux. Ainsi on y découvre l'histoire du socialisme utopique et de ses expérimentations. C'est également l'occasion de faire connaitre la vie de Jean-Baptiste André Godin à travers son appartement. L'histoire de la construction du Familistère est abordée, couplée à de nombreuses précisions techniques et architecturales. Le visiteur pourra également découvrir les techniques de fabrication des poêles Godin et les principaux concurrents de la marque. Notons qu'un appartement d'époque est reconstitué, prélude pour aborder ensuite les loisirs au Familistère ou encore son organisation administrative. A première vue, la richesse et la précision des informations permettent de cerner ce qu'était le Familistère et son fonctionnement jusque dans les moindres détails. En réalité, il s'avère que le trop-plein d'informations rend la visite quelque peu « indigeste ». Cette démarche d'exhaustivité est louable dans le sens ou elle peut apporter un savoir précis, mais elle peut étouffer le visiteur qui se retrouve submergé d'informations. Fort heureusement la scénographie relativement « aérée » contre-balance ce sentiment. A noter également que si les différentes thématiques se répondent tout au long de la visite, il est possible d'en écarter certaines de son propre parcours, sans pour autant que cela nuise à la compréhension globale du musée.
Actuellement le Familistère de Guise est entré dans la deuxième phase du projet Utopia, grand projet visant à faire de ce lieu un espace de culture et de tourisme, et surtout un espace de vie partagée.
Thibault Leonardis

L’Alimentarium de Vevey, un musée vivant pour explorer notre alimentation
Lors de son épopée suisse, la caravane arrageoise s’est arrêtée le temps d’une matinée à L’Alimentariumde Vevey. Monsieur Denis Roher, conservateur du musée, nous a accueillis et guidés au sein de cette institution entièrement dédiée à l’alimentation. Cette rencontre nous a permis de comprendre l’évolution du musée, ses partis pris mais également ses projets, car le musée prépare sa troisième version et fermera ses portes en 2014 pour deux ans de rénovation.
Muséographier l'alimentation
Crédits : Camille Savoye
 Le caractère éphémère de l’aliment nécessite d’engager une réflexion sur l’objet à exposer. Celui-ci est en effet valorisé pour le sens qu’il permet d’apporter à l’exposition et non pas pour parler de la collection du musée. Dans cette muséographie du discours « l’objet est utilisé comme moyen de mise en scène permettant une visualisation explicative des faits absents »(Shärer, 2003). L’exposition permanente présente ainsi des objets qui gravitent autour de l’aliment et le parcours de la visite se décompose en quatre espaces thématiques : acheter, cuisiner,mangeret digérer. Le restaurant du musée s’inscrit au sein même de la démarche de l’institution et se présente comme un dispositif d’exposition vivant. Cet espace est accessible par l’entrée générale du musée, les cuisines sont ouvertes et proposent des menus en adéquation avec les expositions, les saisons et les thématiques déterminées par la direction.
Le caractère éphémère de l’aliment nécessite d’engager une réflexion sur l’objet à exposer. Celui-ci est en effet valorisé pour le sens qu’il permet d’apporter à l’exposition et non pas pour parler de la collection du musée. Dans cette muséographie du discours « l’objet est utilisé comme moyen de mise en scène permettant une visualisation explicative des faits absents »(Shärer, 2003). L’exposition permanente présente ainsi des objets qui gravitent autour de l’aliment et le parcours de la visite se décompose en quatre espaces thématiques : acheter, cuisiner,mangeret digérer. Le restaurant du musée s’inscrit au sein même de la démarche de l’institution et se présente comme un dispositif d’exposition vivant. Cet espace est accessible par l’entrée générale du musée, les cuisines sont ouvertes et proposent des menus en adéquation avec les expositions, les saisons et les thématiques déterminées par la direction.
L’alimentation est un objet d’études complexe et passionnant qui s’insère au sein de nombreux domaines : des implications liées au corps à un aspect sociologique, d’une approche anthropologique à celle économique ou encore écologique. Ces différentes approches sont exploitées tout au long du parcours et intègrent l’ensemble des espaces muséographiques par le biais de dispositifs qui questionnent et interpellent. En arrivant dans l’espace acheter, deux grandes tables sont accrochées à la verticale le long du mur, sur celles-ci sont disposés les différents produits de consommation courante au XIXème siècle pour l’une et au XXIème siècle pour l’autre. Ce dispositif permet non seulement de comparer les différents modes de consommationmais également de penser à l’évolution des manières de tables et de questionner nos propres habitudes de consommation. La médiation orale, qui sera privilégiédans la troisième version du musée, permet d’exploiter toute la richesse de ce dispositif.
Médiation de la cuisine
Crédits : Camille Savoye
Valoriser une médiation orale semble en effet opportun pour un musée vivant ou le visiteur expérimente tout au long de sa visite. N’est-ce pas, par ailleurs, la meilleure façon d’aborder l’alimentation, par le biais du partage et d’une démarche conviviale ? Ce caractère inhérent à l’alimentation est par ailleurs très bien exploité dans la partie cuisine du musée où de nombreux ateliers sont animés par les médiateurs-cuisiniers. Les ateliers permettent d’explorer l’aliment selon des thématiques, déterminées géographiquement ou historiquement. Ces ateliers ne sont pas conçus pour apprendre à manger équilibré mais pour expérimenter, découvrir des cultures à travers leur alimentation et interpeler notre palais. Chaque participant repart avec sa préparation, une belle occasion de partager chez soi l’expérience vécue au musée et de prolonger sa visite.
La cuisine semble avoir pris beaucoup de place au sein de la structure au fil des années, ce qui ne semble pas être au déplaisir du public : le musée enregistre en moyenne 65 000 entrées par an, composé d’autant d’adultes que d’enfants. Afin de rééquilibrer le musée et d’insérer une approche plus scientifique Monsieur Denis Rohrer, conservateur du musée, souhaite mettre en place une politique d’acquisition afin d’enrichir la collection. Bien qu’il s’agisse d’une fondation Nestlé celle-ci ne se constitue non pas autour de l’entreprise mais bien sur l’alimentation en général.
Crédits : Camille Savoye
 On note une recrudescence d’expositions temporaires sur le thème de l’alimentation, qu’il s’agisse de parler d’une culture (Les séductions du palais présenté au Quai Branly) ou d’engager une réflexion sur ce que nous mangeons par le biais de dispositif interactif et pédagogique, souvent à l’intention d’un jeune public (A tous les goûts, Maison Folie de Lambersart, Qu’est ce qu’on mange ?PLUS de Capelle la Grande). Des institutions explorent également cette thématique de façon permanente en France, tel que le centre d’art La cuisine dans le Tarn et Garonne et bientôt la Cité de la Gastronomie. Quelque soit le statut de l’institution culturelle, l’attractivité de cet objet d’étude, en ce qu’il fait parti intégrante du quotidien, par plaisir et nécessité, de façon naturelle et culturelle, permet d’attirer et de fidéliser un public et de l’emmener au cœur de problématiques sociétales.
On note une recrudescence d’expositions temporaires sur le thème de l’alimentation, qu’il s’agisse de parler d’une culture (Les séductions du palais présenté au Quai Branly) ou d’engager une réflexion sur ce que nous mangeons par le biais de dispositif interactif et pédagogique, souvent à l’intention d’un jeune public (A tous les goûts, Maison Folie de Lambersart, Qu’est ce qu’on mange ?PLUS de Capelle la Grande). Des institutions explorent également cette thématique de façon permanente en France, tel que le centre d’art La cuisine dans le Tarn et Garonne et bientôt la Cité de la Gastronomie. Quelque soit le statut de l’institution culturelle, l’attractivité de cet objet d’étude, en ce qu’il fait parti intégrante du quotidien, par plaisir et nécessité, de façon naturelle et culturelle, permet d’attirer et de fidéliser un public et de l’emmener au cœur de problématiques sociétales.Camille Savoye
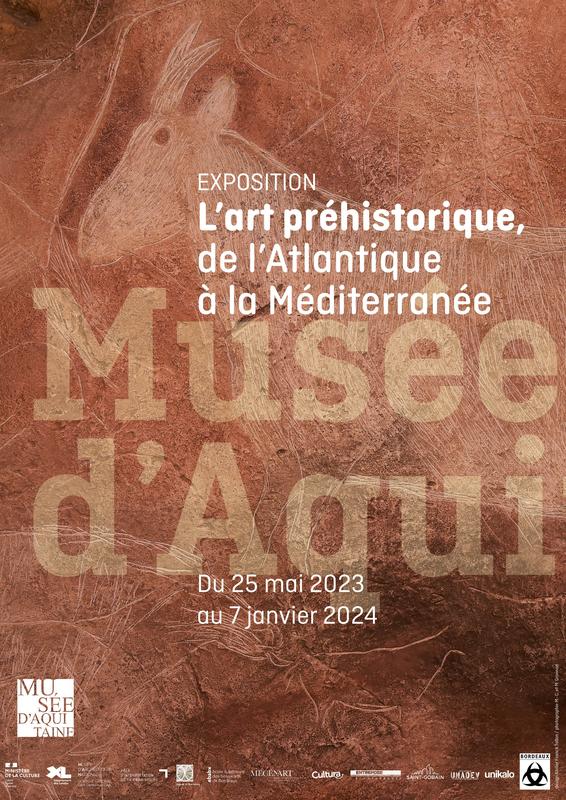
L’art préhistorique, de l’Atlantique à la Méditerranée
Une exposition (pré)historique
L’Art préhistorique, de l’Atlantique à la Méditerranée est une exposition produite par le musée d’Aquitaine, en collaboration avec un comité scientifique international. Cette exposition a pour ambition de tenter de répondre à des questions telles que : « A quoi sert cet art ? Qui l’a fait ? Est-ce seulement de l’art ? » grâce aux nouvelles méthodes d’étude et de restitution, comme les fac-similés ou encore la 3D, mais aussi à partir d’un nombre exceptionnel d’artefacts préhistoriques inédits ou rarement montrés au public. A travers le prisme géographique de la chaîne pyrénéenne, l’exposition présente l’art préhistorique sous toutes les formes connues. Le but n’est pas tant de fasciner le visiteur mais de le faire s’interroger sur le rôle de l’art, sur ces artistes, voire même sur la définition de l’art.
Si les questions autour de l’art préhistorique agitent les esprits depuis qu’on a découvert les premières pièces du genre au XIXe siècle, le musée d’Aquitaine, installé dans l’ancien palais des Facultés et inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, apporte aujourd’hui des éléments de réponse. De la parure aux instruments de musique en passant par les grottes ornées, le musée d’Aquitaine propose une thématique qui n’avait pas été traitée depuis près de 30 ans et passe les arts préhistoriques pyrénéens au crible.
Une exposition internationale
Si l’événement est transfrontalier par la trentaine de prêteurs privés et institutionnels français, espagnols et portugais, il l’est aussi dans sa conception avec un comité scientifique venant des mêmes horizons. Grâce à ces collaborations, ce sont près de 600 pièces qui sont réparties sur 800m² au musée d’Aquitaine. Un tiers d’entre elles sont en réalité des moulages ou des reproductions. C’est une caractéristique courante dans les expositions préhistoriques pour plusieurs raisons. D’une part, ces pièces sont aussi exceptionnelles que fragiles au vu de leur ancienneté, elles ne peuvent donc pas toutes voyager. D’autre part, bien que certaines pièces soient conservées en réserves, voire, pour certaines, jamais montrées au public, d’autres sont dans les vitrines des parcours permanents des musées préteurs, et l’on ne peut pas se permettre de vider leurs vitrines ! Enfin, certaines conditions de donations aux musées ne leur permettent pas de sortir les artefacts de leur enceinte. C’est le cas de l’exceptionnelle collection Piette, donnée au Musée national d’archéologie. Elle a été mise en scène par E. Piette, et la scénographie n’a plus le droit d’être modifiée, et ce, sans prescription.
L’art paléolithique est présenté dans l’exposition dans sa réalité géographique : l’écrasante majorité de la production artistique européenne qui nous est parvenue se situe dans l’extrême sud-ouest du continent, soit entre la France et la péninsule Ibérique.
Cette exposition est aussi conçue pour être itinérante. Sa présentation à Bordeaux jusqu’au 7 janvier 2024 n’en est que le premier acte, elle partira ensuite à la rencontre des visiteurs espagnols, à Saint-Sébastien du 1er mars au 2 juin 2024, avant de se partager durant l’été entre le musée archéologique de Santander et le musée national d’Altamira. Puis elle se déplacera au musée de Foz Côa au Portugal à l’automne 2024, avant de revenir en France entre avril et septembre 2025 à l’Abbaye d'Arthous dans les Landes. Elle fera un passage en 2026 aux Eyzies, en Dordogne, avant de finir son périple en 2027 à Bilbao, de nouveau en Espagne.

Vue de l’exposition ©L.Gauthier
Des thématiques variées et complémentaires
Le parcours aborde le sujet de manière à ce que le visiteur ait une vision d’ensemble du phénomène. Il se développe en plusieurs thématiques, en commençant par la difficile reconnaissance de l’existence de l’art préhistorique par les scientifiques de la fin du XIXe siècle. Mais c’est aussi l’actualité de la recherche qui est développée : des méthodes d’études du siècle passé jusqu’aux dernières avancées techniques (fac-similé, photogrammétrie, impression 3D).
L’exposition s’interroge sur le cadre climatique et environnemental dans lequel vivaient les artistes et sur la place qu’ils ou elles avaient dans la société. Malgré la barrière géographique que sont les Pyrénées, il existe des points de passage et l’on voit bien des circulations, des échanges, des influences très nettes sur plusieurs centaines de kilomètres du nord de la chaîne, jusqu’au nord du Portugal. Cet espace dépassait d’ailleurs largement les limites actuelles, puisqu’au Paléolithique récent, le niveau de la mer était jusqu’à 120 mètres plus bas qu’aujourd’hui. A présent, toute la frange littorale est submergée et des sites exceptionnels sont engloutis, comme l’a été par exemple la grotte Cosquer.
Qu’il se développe sur du petit mobilier ou sur de vastes parois dans les grottes, cet art préhistorique fait la part belle aux animaux. Les pièces exposées sont réparties par biotopes, avec les cerfs, biches, ours et carnivores dans le biotope forêt, ou encore les phoques, poissons et grues dans un biotope aquatique. Les représentations humaines, bien que moins connues, sont toutes aussi remarquables. Mais dans l’art paléolithique, ce sont aussi les signes abstraits et codifiés qui sont omniprésents, sans que leur sens nous soit accessible.
De par la grande variété de techniques, de supports, de pigments et d’outils, l’art préhistorique c’est aussi la parure et la musique. Les nouvelles technologies permettent de voir à quel point le geste est maîtrisé. On sait actuellement restituer l’ordre des traits de gravure - de la tête de l’animal, qui est toujours première, jusqu’à l’intérieur du corps -, dire si le graveur était droitier ou gaucher, et si plusieurs mains sont intervenues. L’exposition questionne aussi l’art du jeu grâce à des reconstitutions d’empreintes de main d’enfants dans l’argile à côté desquelles ont été retrouvées des boulettes d’argile projetées contre les parois de la grotte de Fontanet (Ariège).
L’exposition donne l’occasion au visiteur de comprendre le « comment ? » de l’art préhistorique. Cependant, en ce qui concerne le « pourquoi ? », depuis la reconnaissance de l’art pariétal, toutes les interprétations avancées ont donné lieu à autant d’arguments les invalidant, et il existe désormais un certain consensus sur le fait qu’il faut renoncer à interpréter ! Aujourd’hui, on peut simplement dire que cet art était certainement un marqueur social et territorial, et qu’il n'était pas toujours fait pour être vu, comme l’indiquent certaines représentations placées à des endroits qui n’offrent aucun recul, à très grande hauteur ou dans des espaces très difficiles d’accès, réduisant à un nombre assez limité les personnes pouvant les voir.

Vue de l’exposition ©L.Gauthier
Chacun y trouve son compte
Chaque espace de l’exposition comporte un module multisensoriel qui permet à tous les visiteurs de découvrir l’exposition, non pas seulement avec la vue, mais aussi grâce au toucher, à l’ouïe ou encore à l’odorat.
Le sens du toucher est particulièrement sollicité, grâce à la reproduction en relief d’un cerf de la grotte de Las Chimineas (Cantabrie) permettant l’accès de l’art pariétal aux non-voyants, mais aussi de reproductions en taille agrandie de mobilier remarquable tels qu’une statuette d’ours en position assise, la dame de Brassempouy, ou encore, deux bouquetins sculptés sur une dent de cachalot. La plupart des matières premières que pouvaient utiliser les groupes paléolithiques peuvent aussi être vues et touchées grâce à un module dédié. De plus, tous les textes de ce parcours sont traduits en braille. Le visiteur peut aussi familiariser son oreille aux sons que peuvent produire la baleine, le cerf, l’ours ou encore le renard, tout comme aux sons des premiers instruments de musique paléolithiques : sifflet de la grotte de Bize, flûte d’Isturitz, rhombe de la Laine, et conque de Marsoulas. Enfin, le visiteur a l’occasion de se plonger dans une grotte, une steppe, ou bien une forêt grâce à son odorat et aux boites à odeurs du module de contextualisation environnementale.
Ce parcours multisensoriel est aussi composé d’une maquette topographique, en bois, de la zone géographique mise à l’honneur par l’exposition. Les visiteurs peuvent toucher les reliefs pyrénéens.
Une imprimante 3D, outil incontournable d’une exposition composée d’artefacts aussi fragiles et rare, est exposée et imprime avec un filament biosourcé fait d’amidon de maïs et de coquilles d'huîtres, pendant toute la durée de l’exposition des pendeloques en ivoire imitant la forme d’une cyprée (coquillage) de la grotte de Pair-non-Pair. Ces impressions sont distribuées sous forme de goodies lors de visites guidées ou d’ateliers.
Afin de préserver au mieux la surstimulation sensorielle de certaines personnes, deux périodes par semaine sont identifiées comme « temps calme ». Le son et la lumière de l’exposition sont abaissés, et les visiteurs ont pour consigne de s’exprimer à voix basse.
Par ailleurs, un parcours famille est accessible tout au long de l’exposition. Il s’adresse au public libre, en premier lieu aux enfants et accompagnants de tout âge, mais aussi à tout visiteur friand d’une visite ludique de l’exposition. Le fil rouge de ce parcours correspond à l’aventure d’un archéologue qui va d’abord découvrir une grotte préhistorique fictive, puis en étudier les artefacts et manifestations symboliques qui s’y trouvent grâce à des quizz, des manipulations de reproductions 3D ou encore des jeux d’association.
Ce parcours a pour but de proposer une visite complémentaire ou alternative aux visiteurs, selon leurs besoins ou envies. Il se veut avant tout ludique, mais aussi pédagogique, afin de faire passer des concepts clés de l’art préhistorique et de son étude. Cela se fait au travers d’une quête au cours de laquelle les visiteurs remplissent de tampons un passeport d’archéologue avec lequel ils pourront repartir. Ces derniers peuvent aussi choisir de profiter du parcours sporadiquement, les contenus et l’amusement n’en sont pas moins au rendez-vous.
Pour ces raisons, et bien d’autres, l’exposition L’art préhistorique, de l’Atlantique à la Méditerranée s’adresse à la fois au public familial et individuel, aux érudits, aux amateurs ou aux curieux, aux personnes valides autant qu’aux personnes porteuses de handicap.
Alors n’attendez pas et revenez 40 000 ans en arrière, découvrir toute la complexité et la variété des arts de la préhistoire !

Vue de l’exposition ©L.Gauthier
Coline Favreau
Pour en savoir plus :
- Site de l’exposition – Musée d’Aquitaine : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/exposition-lart-prehistorique-de-latlantique-la-mediterranee
#exposition #préhistoire #médiation #tout public
L’expérience visiteur dans une église devenue musée : le cas du musée archéologique Saint-Laurent de Grenoble.
Vue sur une œuvre de Rébecca (!) et la nef de l’église Saint-Laurent de Grenoble © GM.
Un musée dans une église ?
Rencontre entre ces fouilles et les visiteurs
Avancée surplombant la nef de l’église Saint-Laurent à Grenoble © GM.
 |
 |
Exemple de fiche d’identité (1) et plusieurs présentations de métiers (2) © GM.
Un lieu toujours aussi actif

Coexistence entre la nef de l’église et les fouilles archéologiques © GM
Pour en savoir plus :
- Article de Laurence Louis, “Quand l'art contemporain s'invite dans les églises : entre opportunités et polémiques” : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2116-quand-l-art-contemporain-s-invite-dans-les-eglises-entre-opportunites-et-polemiques
- Site du musée archéologique de Saint-Laurent de Grenoble : https://musees.isere.fr/musee/musee-archeologique-saint-laurent?musee=12
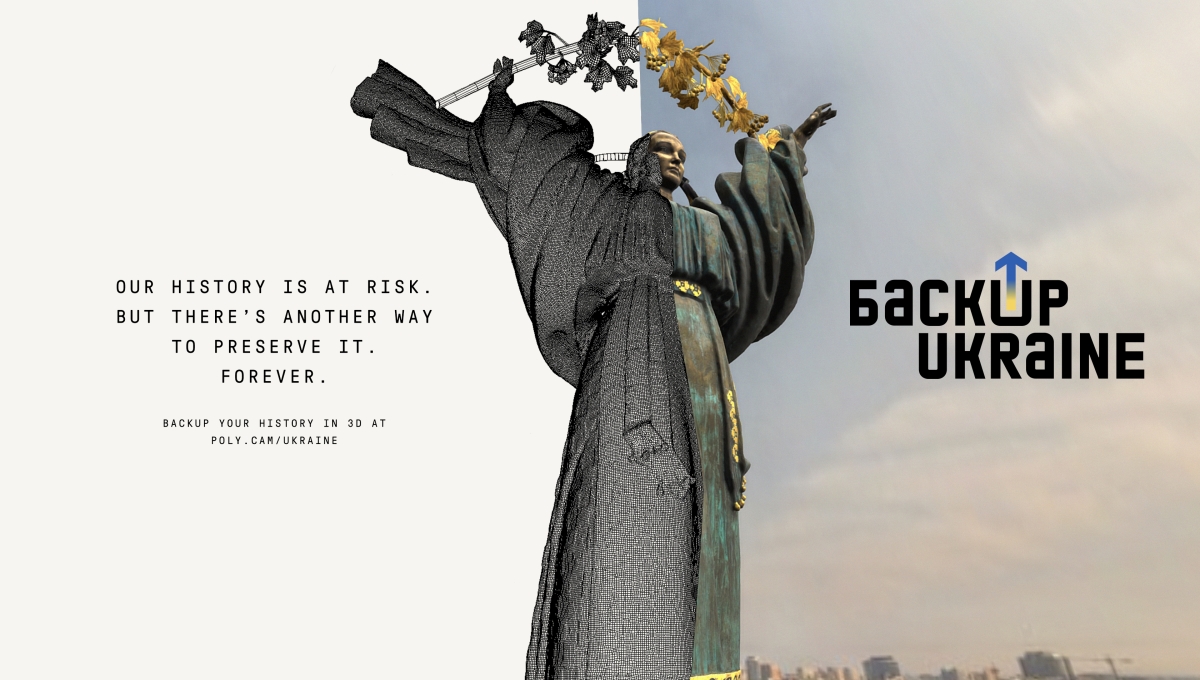
La 3D, à la rescousse du patrimoine ukrainien
Patrimoine. Culture. Victime, elle aussi des conflits. "Le moyen le plus rapide d'effacer l'identité nationale d'un peuple est de détruire son patrimoine culturel » disait Tao Thomsen, directeur créatif de Virtue Worldwide et co-créateur de Backup Ukraine.
Image de la campagne Backup Ukraine © Polycam and the BackUp Ukraine project
Éviter que son patrimoine ne parte en fumée, disparaisse sous les bombardements russes et pouvoir le transmettre aux générations futures, voilà ce qui a motivé le projet Backup Ukraine, traduit par la sauvegarde de l’Ukraine. Le projet a dû se mettre en route rapidement pour garder la mémoire des lieux car au 27 mai 2022, c’était déjà selon le ministère Ukrainien : « 367 crimes de guerre contre le patrimoine culturel du pays […], dont la destruction de 29 musées, 133 églises, 66 théâtres et bibliothèques et un cimetière juif centenaire ».
Une initiative participative
Backup Ukraine initié par l’agence VICE, Virtue Worldwide en avril 2022 s’est associée à Blue Shield Danemark, un organisme visant à protéger les sites culturels, et à la Commission nationale danoise pour l’UNESCO. Ce projet est mené en étroite collaboration avec l'initiative de sauvetage d'urgence du patrimoine ukrainien et le Musée national de l'histoire de l'Ukraine. Il s’agit d’une archive numérique qui a pour but de recenser le patrimoine matériel ukrainien grâce à des modélisations 3D.
Le temps pressant, l’outil a été développé de manière à ce que tous les Ukrainiens volontaires ayant un smartphone puisse apporter leur pierre à l’édifice via une application nommée Polycam.Celle-ci est mise à disposition pour le projet par ses développeurs qui sont également partenaires. Pour prendre part à cet appel à participation, les volontaires remplissent un formulaire pour recevoir une autorisation des autorités ukrainiennes. L’usage de la technologie ne s’est pas encore répandu, la plateforme compte entre 30 à 50 participants actifs en août 2022, soit 6000 contributions, ce qui est compréhensible au vu de la situation : en avril 2022, un ukrainien sur six a dû fuir son foyer et cinq millions ont quitté leur pays selon les Nations Unies.
Cet outil repose sur la photogrammétrie, ou technologie LiDAR consistant à créer des modèles 3D détaillés à partir de plusieurs photographies, prises sous différents angles. Cette technologie prend en compte un calcul de distance et de taille de l’objet pour assembler les images et former un modèle. 100 à 250 images, voilà le prérequis pour concevoir une représentation 3D réaliste. Le surplus contribue à améliorer la qualité et la précision des conceptions. Pour aider les volontaires à réaliser ces captures, l’application propose un tutoriel, tout en invitant les usagers à ne pas se mettre en danger.
Les numérisations sont liées à un emplacement qui est automatiquement retranscrit dans la base de données de l’archive, à l’abri des bombardements. Les numérisations sont sous licence Creative Commons 4.0 et seront partagées avec l’UNESCO et les musées partenaires du Blue Shield. Le site Polycam recense les scans, ainsi qu’une carte permettant de situer les lieux numérisés, contribuant ainsi à l’efficacité du projet et limitant les doublons.
Le projet a pris de l’ampleur grâce à l’accessibilité de l’application, ce qui a favorisé, en parallèle de la numérisation des objets de musées et du patrimoine matériel ukrainien, la préservation d’objets moins monumentaux, des objets du quotidien, ordinaires mais importants dans la vie des habitants et leur histoire. Le choix des objets numérisés pose donc la question de ce qui est important culturellement pour la population.
Au-delà de documenter les objets culturels, Polycam est également utilisé pour rendre compte de la destruction des monuments, et des objets culturels pendant la guerre.
Une sauvegarde difficile de sites
Les bâtiments d’envergure sont plus difficiles à reconstituer, et leur numérisation est donc moins réalisable par la population civile puisqu’il faut se munir d’un drone, ceux-ci n’étant pas toujours autorisés, surtout en temps de guerre.

Scan 3D de l’Église de Pyrohochtcha, à Kiev, construite à l’origine en 1132 © Polycam, the BackUp Ukraine project, Courtesy Maxim Kamynin / Licence : Creative Commons 4.0
Il s’avère que la modélisation des surfaces brillantes et transparentes est également compliquée, puisque ces textures sont difficilement interprétables par l’algorithme de l’application.
Au-delà du côté technique, la photogrammétrie en lieu de confit est dangereuse et donc peu praticable dans les points centraux comme Kiev qui regroupe un certain nombre de lieux culturels majeurs du pays comme la cathédrale Sainte-Sophie classée à l’UNESCO.
A terme, en fonction de la qualité des modélisations, celles-ci pourront être utilisées à des fins de reconstruction, notamment celles des sept sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO pour leur importance culturelle et donc en théorie protégés par la loi. Les modèles peuvent également donner matière à des projections dans un espace physique ou fictif notamment via la réalité virtuelle et la réalité augmentée permettant d’explorer le lieu, à défaut de pouvoir le reconstruire.
Des initiatives qui se multiplient
L’Ukraine n’est pas la seule à avoir lancé des initiatives dans ce sens, celles-ci se développent dans les territoires en conflit comme la Syrie où une quinzaine de chercheurs syriens accompagnés de la start-up française Iconemont été formés à la photogrammétrie. En février 2015, en Irak, l’artiste iranienne Morehshin Allahyari s’est engagée dans la reproduction en impression 3D des sculptures détruites à Mossoul par les djihadistes de Daech. La 3D permet ainsi d’envisager une autre voie contre la destruction et l’oubli engendrés par la guerre.
Loona
Pour en savoir plus :
- https://poly.cam/ukraine
- https://www.instagram.com/backup_ukraine/?hl=fr
- https://edition.cnn.com/style/article/ukraine-uses-3d-technology-to-preserve-cultural-heritage/index.html
#GUERRE UKRAINE
#SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
#NUMÉRISATION 3D

La dame du château
Lorsque je l’aperçus pour la première fois, je notai en premier ses grands yeux noirs. Bordés de longs cils, empreints d’une tristesse qui contrastait avec le soleil d’automne qui illuminait les pierres blanches du donjon de Vincennes.
La forteresse avait à peine ouvert ses portes aux visiteurs. Je me souviens avoir pris mon temps pour ouvrir la grande porte de la Sainte-Chapelle. J’aimais ces moments de solitude absolue qu’elle seule m’offrait.
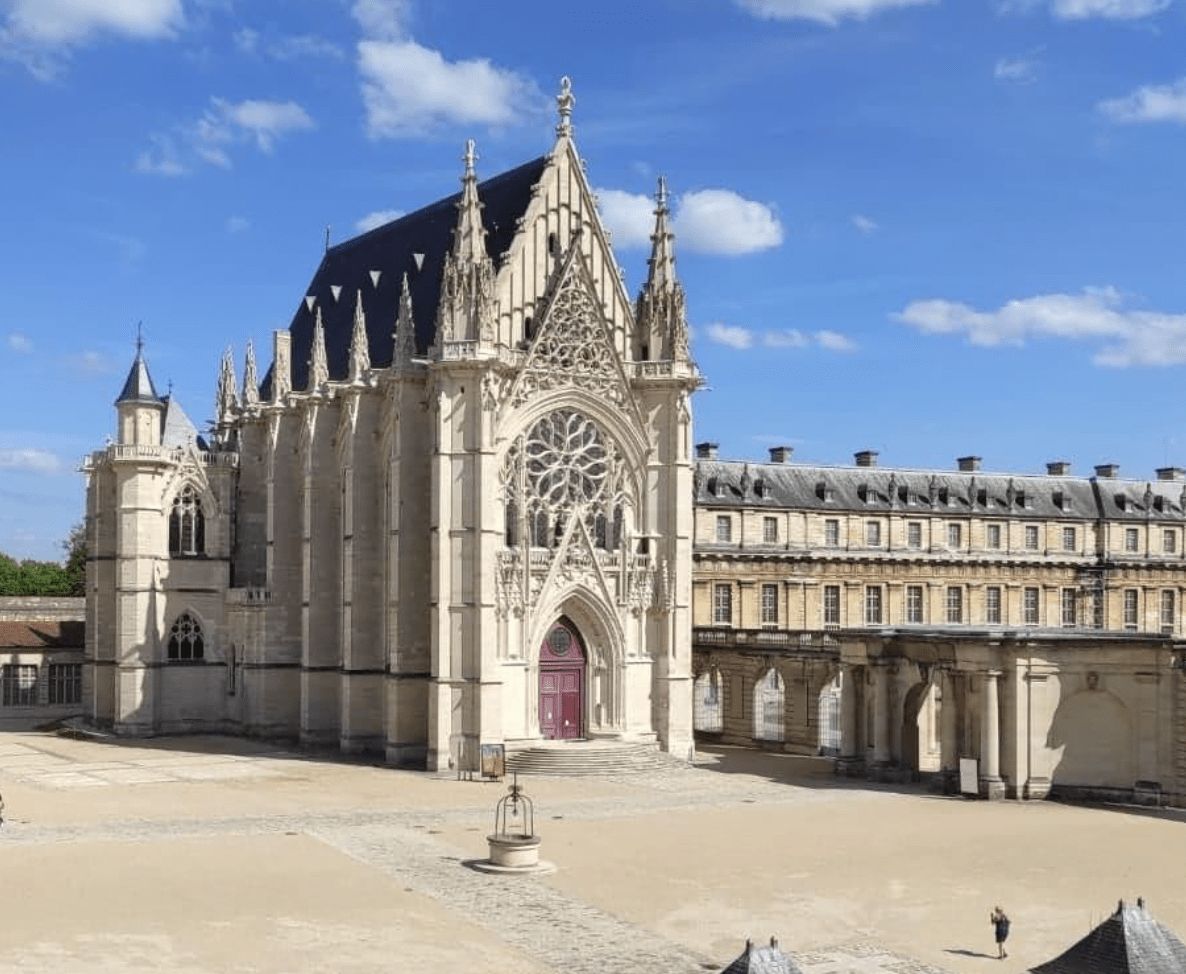
La Sainte-Chapelle, ©Sylvain Gaïo
Seule au milieu de la chapelle, je pouvais à mon aise et pendant quelques minutes profiter de sa quiétude, du silence et des vitraux. Comme à mon habitude, j’avais commencé par saluer Henri II, tranquillement agenouillé au bas du vitrail central. Dans le matin ensoleillé, illuminé, il m’éblouissait. Passant devant le tombeau du Duc d’Enghien, je fus, comme chaque fois, saisie d’un frisson. Pauvre duc enstatué, tué si misérablement et sans aucun panache…
En m’installant à la petite table où l’on contrôlait les tickets d’entrée des visiteurs, après avoir ouvert grandes les portes du bâtiment, je laissais vagabonder mes pensées. Il était aisé d’inventer une existence à tous ces gens de passage, que je ne reverrai jamais plus. Aisé d’imaginer que cet homme avec un enfant qui tenait à la main un ballon était un père célibataire à qui l’on avait brisé le cœur. Que ces jeunes gens, si studieux pendant la visite, ne songeaient en réalité qu’à la fête qu’ils rêvaient d’infiltrer le soir même. Ou que ces deux visiteurs, qui échangeaient au travers des questions qu’ils me posaient lors de la visite guidée, des regards brûlants, finiraient par vivre une grande histoire d’amour aux Maldives.
Et puis, en sortant de la Sainte-Chapelle, je l’avais vue, debout sur le pont-levis, statue si fragile qu’un coup de vent aurait pu la briser. Je m’approchai, sans trop savoir pourquoi, au lieu de l’attendre sagement dans ma guérite.
- Tout va bien ?
Elle fixa sur moi ses grands yeux de charbon. Et puis elle me coupa le souffle.
- J’ai perdu mon époux, Mademoiselle, il faut m’aider.
Sous le ton calme et posé, des émotions qui, rageusement, bouillonnaient sous la surface. Et sa voix…. Grave, profonde, une voix chaude d’outre-tombe.
- Comment…Perdu ?
Elle avait la grâce de ceux qui n’ont aucun défaut, de ces êtres parfaits qui n’existent que dans les légendes, ou dans les romans..
- J’ai perdu mon époux, Mademoiselle, il faut m’aider !
La supplique, cette fois, était bien audible, et me fit sortir de ma torpeur.
- Ici ? Dans le donjon ?
Il n’était aucun monument au monde que j’aimais plus que le château de Vincennes. J’étais depuis toujours hypnotisée par sa majesté. Haut de 52 mètres de hauteur, construit par Philippe IV de Valois et achevé par Charles V, son petit-fils, au XIVème siècle, le donjon de Vincennes n’avait rien perdu de sa splendeur passée de résidence royale.
La femme devant moi avait hoché la tête. Je décidai de l’accompagner dans le donjon à la recherche de son mari.
- Suivez-moi, Madame, je vais vous aider.
Alors elle me sourit, et je fus étrangement convaincue d’avoir pris la bonne décision. Je la menai dans la cour intérieure, depuis laquelle nous montâmes l’escalier qui menait à l’étude de Charles V. Première pièce à s’offrir à nous lorsque l’on montait l’escalier de service qui se trouvait à l’intérieur du châtelet, l’étude du roi devait avoir été un endroit somptueux en son temps. Il me plaisait assez d’y imaginer Christine de Pisan en pleine conversation avec Charles le Sage, devisant avec animation des dernières découvertes de l’époque. Malheureusement, le décor magnifique de la pièce avait été saccagé par les révolutionnaires français lors de leur arrivée dans la forteresse. L’ancien statut de résidence royale du lieu n’avait certes pas joué en sa faveur.
Je me tournai à nouveau vers la femme. Nous étions seules dans la pièce et elle se tenait derrière moi, des larmes nacrées dans ses yeux d’onyx.
- Tout va bien ?
Son « oui » du bout des lèvres m’effraya. Elle était fascinante autant qu’inquiétante. Nous traversâmes la passerelle qui menait à l’intérieur du donjon pour arriver au premier étage, dans la salle centrale qui avait servi de salle de bal et de salle du conseil du temps de Charles V. Le donjon était une construction carrée, flanquée aux angles de tourelles circulaires. Dans chacune de ces tourelles se trouvait une petite pièce.
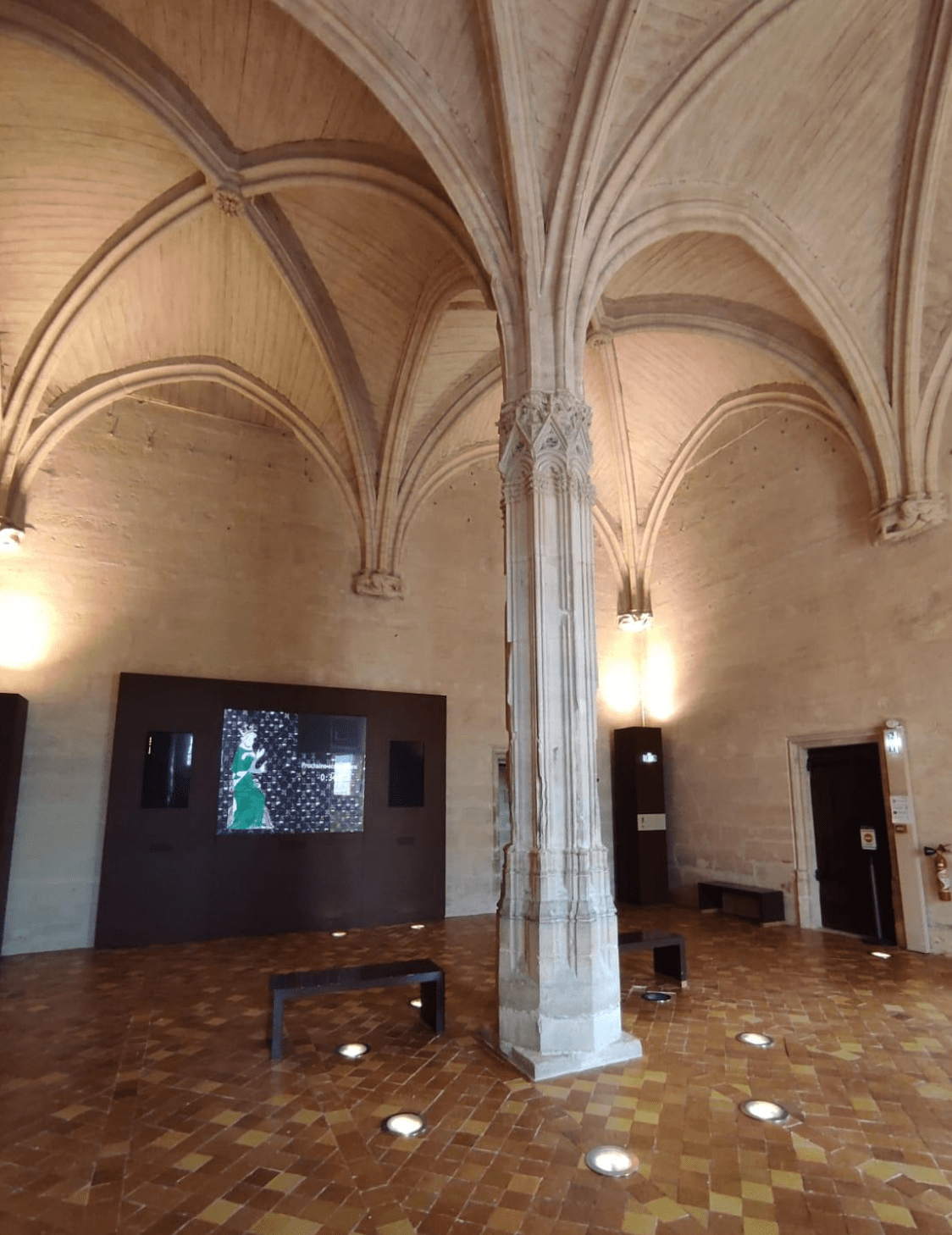
La Salle du Conseil, ©Sylvain Gaïo
J’eus, l’espace d’un instant, alors qu’elle marchait derrière moi, une impression très désagréable que je serais bien incapable de qualifier, et fus saisie d’un frisson.
Ma pièce préférée, au premier étage, était indéniablement la petite pièce circulaire qui avait servi, au XVIIIème siècle, à enfermer Mirabeau. Il régnait toujours à cet endroit du donjon une ambiance très particulière, au parfum d’aventure et de railleries, sur fond de Révolution. Depuis cette petite cellule dans laquelle il fut enfermé par lettre de cachet, Mirabeau avait maille à partir avec le marquis de Sade, enfermé au même moment dans une cellule voisine. Leurs échanges d’insultes en tous genre étaient devenus légendaires au château. Lorsque Charles V avait installé sa résidence favorite dans le Donjon de Vincennes en son temps, il était sans doute loin d’imaginer que ce dernier serait transformé en prison à La Renaissance, et que moult prisonniers célèbres dormiraient sur des paillasses dans ce qui fut un jour chapelles royales et garde-robes.
Mais au premier étage comme ailleurs, pas de trace du mari de ma visiteuse. Juste une vieille dame et sa petite-fille, admiratives des peintures du XVIIIème siècle, posées là par des prisonniers en proie à l’ennui, et sans doute, au froid terrible de l’hiver dans la prison de Vincennes.
Alors je l’emmenai à l’étage supérieur, dans ce qui fut un jour la chambre royale. Charles V y recevait ses invités les plus prestigieux, et j’étais chaque fois que j’y posais le pied, séduite par la beauté des peintures d’époque, qui subsistaient au plafond, conservées par les siècles de feux de cheminées, qui avaient déposé sur les pigments une couche de suie qui les avaient protégés. Rouge vif, bleu roi et fleurs de lys or accueillaient le visiteur dans une parade luxueuse et témoignaient à eux seuls de la splendeur passée de la pièce. Dans les tourelles d’angles, ou s’étaient un jour trouvées les latrines de Charles V et le trésor royal, pas de traces non plus d’un quelconque époux. Mon inconnue était toujours derrière moi, vêtue de noir jusqu’aux gants. Je me souviens avoir pensé qu’il était étrange de porter des gants un jour de grand soleil.
Je regardai alors en détail sa tenue. Elle semblait tout droit sortir d’un autre temps, avec sa robe noire et droite qui s’arrêtait au-dessus du genou et ses petites chaussures à talons bas. Elle portait un chapeau et des gants, noirs, qui me firent penser à ces photographies des années 30 ou 40 que l’on voyait parfois dans les livres d’histoire. Elle était déroutante, enchanteresse, et un peu effrayante. Je me demandais ce que j’étais en train de fabriquer, à chercher partout dans le donjon le mari de cette femme inconnue.
- Je suis désolée, Madame, mais je ne vois personne… Êtes-vous bien certaine que votre mari se trouve dans le donjon.
- J’ai perdu mon époux, Mademoiselle, il faut m’aider.
Je ne savais ni quoi faire ni quoi lui dire. Il me revint alors que l’un de mes collègues donnait une visite dans les parties hautes du donjon. Les trois derniers étages de la tour ; sans compter la terrasse qui accordait aux grimpeurs émérites des 250 marches qui y conduisaient, une vue imprenable sur la capitale qui s’étendait au pied de la forteresse ; n’étaient accessibles qu’à un petit nombre de personnes, certains jours de la semaine et avec un guide seulement. Désireuse de ne pas rester seule plus longtemps avec mon inconnue, et songeant que cet époux qu’elle cherchait se trouvait peut-être dans le groupe qui visitait les étages supérieurs, j’ouvris la grille et l’invitai à me suivre dans l’étroit escalier en colimaçon aux marches hautes. Comme aucun son ne nous parvenait des étages supérieurs, j’en déduisis que mon collègue devait déjà se trouver sur la terrasse.
Pour rompre le silence, je lui expliquais qu’au troisième étage du donjon se trouvait au Moyen-Age la chambre destinée au Dauphin de France, fils du roi. Mais le fils de Charles V, Charles IV, n’y avait jamais dormi. Lorsque sa chambre fut enfin prête à l’accueillir, il avait déjà obtenu ses 13 ans révolus, âge de la majorité, et succédé à son père. La chambre était restée vide. Elle avait retrouvé un usage quand Vincennes était devenu prison, et qu’on y avait enfermé jésuites et autres trouble-fêtes du temps des rois. Elle demeura sans rien dire, imperméable à mes explications.
Je passai l’étage, sachant pertinemment qu’aucun des visiteurs n’aurait pu s’y trouver isolé. Nous faisions toujours extrêmement attention à ne laisser personne en arrière dans cette partie du donjon.
Nous arrivâmes au quatrième étage. Je comptai me rendre directement sur la terrasse, mais j’entendis derrière moi la respiration de mon inconnue s’accélérer et la porte qui permettait d’accéder à la pièce centrale grincer.
- Paul !
Je me retournai, elle était déjà dans la pièce. Elle se tenait au pied du pilier central, seule. Pas de trace de son mari, contrairement à ce que semblait suggérer le prénom qu’elle venait de crier. Si l’on pouvait appeler cela un cri. Sa voix grave, presque caverneuse avait résonné dans la pièce. Je sentis s’accélérer les battements de mon cœur. Cette fois, j’avais peur, vraiment peur. J’aurais été bien incapable de dire si elle avait parlé, hurlé ou chuchoté.
J’entrai à mon tour dans la pièce. Et pour rompre mon malaise, je lui débitais l’histoire du lieu : la particularité du donjon de Vincennes, c’est que toutes les pièces centrales, bien que très hautes sous plafond, n’étaient soutenues que par un seul pilier central qui dégageait le reste de l’espace. Mais le pilier du quatrième étage était, de tous, le plus spécial. La pièce avait une histoire différente des autres. Il y régnait toujours une atmosphère particulière, presque solennelle. Elle était nue, les murs sans aucune trace de peinture, même substantielle, et des fenêtres partout. Au Moyen-Age, elle servait aux gardes pour leurs tours de ronde. Au XXème siècle, elle avait vu des soldats nazis s’installer entre ses murs pendant l’occupation. Des SS, mais pas seulement. Une unité de l’armée allemande, le NSKK, avait élu domicile à cet endroit du château. Cette unité était composée de soldats aux nombreuses nationalités, enrôlés par l’armée allemande dans les pays conquis. Ces soldats avaient laissé sur le pilier central leurs noms, graphités sur la pierre, fragile témoignage de leur présence à cet endroit du château, avant qu’ils ne soient délogés par l’armée américaine à la Libération. Au-dessus des noms allemands, triomphalement entouré au crayon pour signaler la victoire, un nom américain.
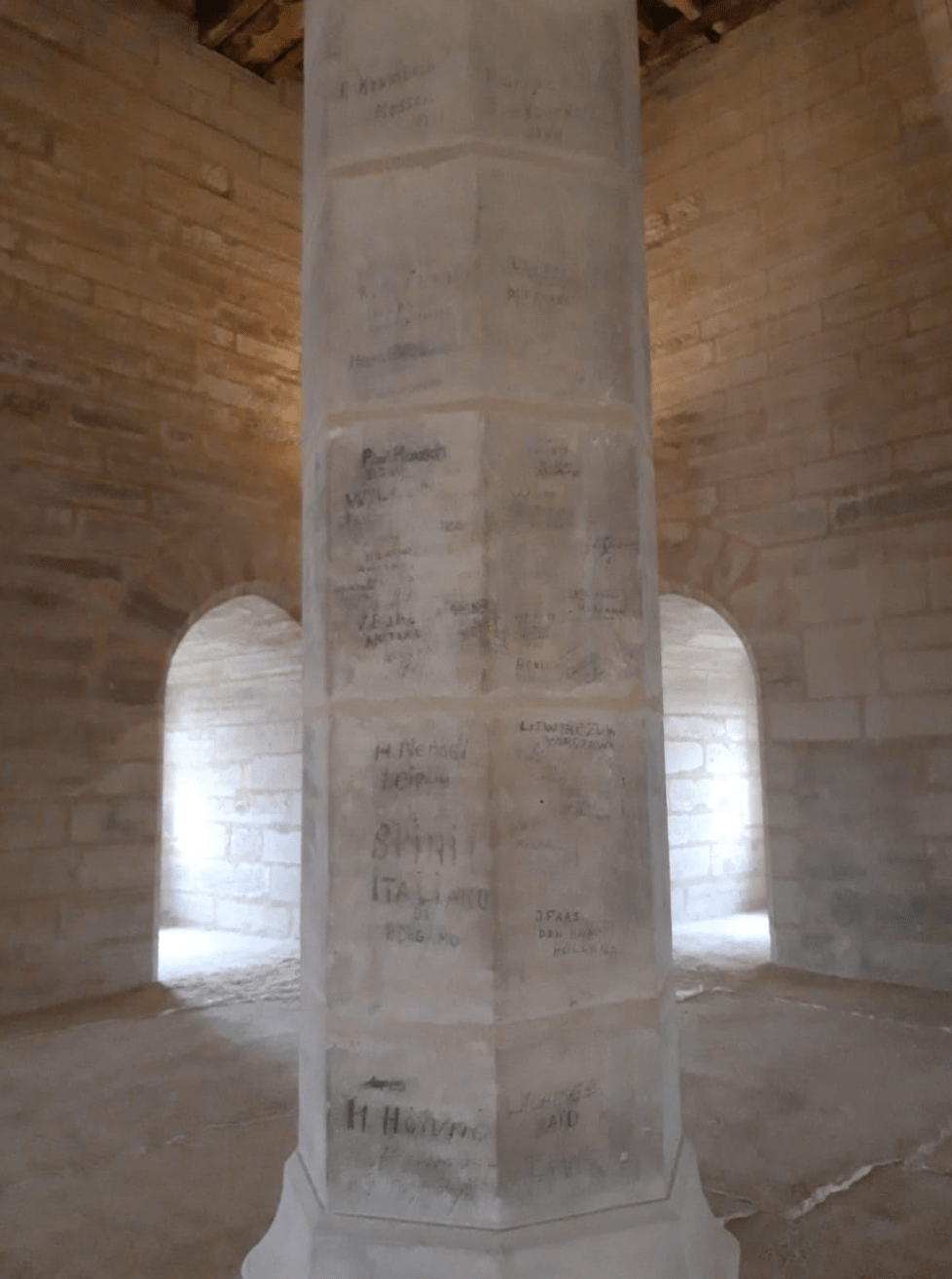
Le pilier du quatrième étage, ©Virginia Rossi
Mon inconnue s’était figée, tremblante, au pied du pilier. Je m’approchais d’elle. Dans ses yeux les mêmes tourments que dans sa voix. Ses grands yeux noirs étaient pleins de fureur et d’un chagrin que les mots ne sauraient exprimer. Espérant y voir ce qu’elle y voyait, je levai les yeux sur la colonne, qui portait pour toujours les stigmates de la guerre et de l’horreur graphités en même temps que les noms il y a plus de 70 années..
Qui étaient-ils ? Des nazis ? Ou bien des désignés volontaires, enrôlés de force par une armée dont ils ne partageaient ni la langue, ni les convictions ? Qui avaient-ils laissés au pays, quand ils étaient partis ? Des femmes ? Des enfants peut-être ? Des familles, qui attendaient leur retour ou leurs nouvelles avec une fiévreuse impatience, priant chaque soir pour les revoir en vie ? Il était arrivé, bien que rarement qu’un visiteur reconnaisse un nom sur la colonne, retrouve un aïeul ou un cousin. Nous avions reçu au château des lettres et des arbres généalogiques retraçant l’histoire d’un de ces noms laissés là par un soldat polonais ou néerlandais loin de chez lui. Je me demandai si mon inconnue avait elle-aussi retrouvé un nom qui lui semblait familier, qui aurait provoqué son émotion. Je détachai mes yeux du pilier central et tournai la tête pour lui demander.
Je sursautai.
Il n’y avait personne dans la pièce. J’étais seule devant la colonne. J’étais certaine pourtant, qu’elle n’aurait pu sortir sans que je ne l’entende. J’avais repoussé la vieille porte d’époque derrière nous, je l’aurais entendue grincer. Pourtant, je devais bien me rendre à l’évidence, elle n’était pas là.
Sans vraiment savoir pourquoi, je portai à nouveau le regard sur l’un des noms de la colonne. Un dénommé Paul Hoffmann des Pays Bas. Prise de panique, je sortis en courant de la pièce et fermai la porte derrière moi. Sur le pilier, en dessous du nom de Paul Hoffmann, deux grands yeux noirs comme le charbon avaient brillé, comme soulagés d’être enfin là où ils devaient être.
Essoufflée, mais terrifiée, je descendis quatre à quatre les marches de l’escalier en colimaçon, empoignai la grille qui séparait le troisième étage du deuxième, accessible à la visite et la fermai derrière moi
Reprenant ma respiration, je regardai autour de moi. J’étais seule dans la chambre royale et je me demandais si cette inconnue avait vraiment existé. Le château de Vincennes était un endroit propice à la rêverie, je pouvais très bien l’avoir imaginée…
Juliette REGNAULT
#architecture #châteaudevincennes #mystère

La Mora, un bateau du passé tourné vers l’avenir
À l’image de l’Hermione à Rochefort, la Mora à Honfleur transporte les visiteurs au XIe siècle, dans les préparatifs de la conquête de l’Angleterre grâce à un chantier de reconstitution naval et à un parcours scénographique immersif. Le projet d’archéologie expérimentale s’appuie sur l’iconographie de la Tapisserie de Bayeux et l’apport d’un comité scientifique pour agrémenter la visite. À travers ce chantier spectacle qui met à l’honneur la transmission orale tout en alliant des dispositifs audiovisuels, le lieu offre un aperçu de l’histoire de la Normandie sous Guillaume le Conquérant.
L’association normande éponyme – La Mora, crée en 2018, a lancé ce projet dans l’objectif de faire renaître la Mora, navire amiral du duc normand qui a servi lors de sa traversée de la Manche en 1066. Ce chantier spectacle ouvert au public en mars dernier fait revivre le site de la Jetée de l’Est de Honfleur tout en favorisant la formation et l’insertion. Décryptage de la renaissance d’un espace jusqu’ici oublié.
Le chantier naval, élément clef de visite

Nef protégeant le chantier naval © L.C
La visite libre du chantier permet d’observer la construction de la coque sous un hangar en forme de grande nef, laissant supposer la taille finale du bateau. Le visiteur est amené à suivre un parcours longeant le navire en construction, avec à l’appui des panneaux fournissant plans et chiffres, sans jamais perdre du regard le chantier en cours. De la coupe du tronc à la mise à l’eau du bateau, toutes les étapes de construction sont présentées de manière diverse : plan d’architecte naval, schémas des mesures au Moyen-âge à destination d’enfants. Un dispositif vidéo appuie la projection du visiteur en proposant une reproduction numérique en trois dimensions des étapes de constructions futures jusqu’à l’achèvement du chantier. La forge est également un plus avec une démonstration des méthodes de travail par les forgerons eux-mêmes. La force du lieu réside indéniablement dans cette interactivité renforcée par la présence continue de médiateur. L’apport d’informations précises tout en visualisant des professionnels en plein exercice est particulièrement appréciable.
Quel effet ça fait de faire partie de l’équipage de Guillaume le Conquérant ?
Tout au long de la visite du chantier, le visiteur se projette, imagine les sensations d’une telle entreprise. Le parcours scénographique offre une réponse en proposant un parcours immersif numérique de 35 minutes le plongeant dans les préparatifs mêmes de la conquête.
Composé de quatre salles, le parcours vient pallier la juvénilité du chantier en apportant un visuel du bateau et une meilleure compréhension de la planification de la conquête. Les portes du parcours s’ouvrent sur un décor évoquant les racines de l’arbre monde nordique Yggdrasil. Des dispositifs audiovisuels permettent de retranscrire des éléments comme le bois qui craque ou encore le vent qui se lève. Les racines en cordage invitent à s’asseoir et écouter une narration fictive qui met en lumière les origines de la Normandie et de la construction navale normande, hérité des vikings.

Yggdrasil, arbre monde de la mythologie scandinave
© Photoclub Honfleur – Association la Mora Guillaume le Conquérant
La rencontre avec Hardouin, charpentier de marine dans la salle suivante vient poursuivre la plongée dans l’élaboration de la conquête. Cette salle explore l’atmosphère d’un scriptorium, atelier d’une abbaye où sont confectionnés les manuscrits. L’utilisation d’écrans-tablettes pour créer l’illusion de manuscrits ouverts fonctionne bien et intègre un visuel précis de scènes provenant de la Tapisserie de Bayeux. Cependant, le parti-pris d’accorder un temps limité par salle, ne laisse pas au visiteur le temps de profiter de l’ambiance de la salle ni de jeter un œil aux bibliothèques murales, pourtant pleines à craquer.

Rencontre avec Hardouin, charpentier de marine dans le scriptorium
© Photoclub Honfleur – Association la Mora Guillaume le Conquérant
Enfin le moment tant attendu : l’embarcation dans la Mora. Une embarcation qui se veut physique puisque le visiteur prend véritablement place dans une reproduction contemporaine du bateau du duc normand. Cette salle à 360 degrés fait monter d’un cran la dimension immersive du parcours et met à l’honneur la Mora comme l’on pourrait s’y attendre. Le choix de cantonner l’expérience à une projection audiovisuelle sans passer par des dispositifs sensoriels autres que l’ouïe et la vue rend le parcours accessible au plus grand nombre.

Embarquement dans la Mora
© Photoclub Honfleur – Association la Mora Guillaume le Conquérant
La transition avec la dernière salle est abrupte ; le visiteur débarque et accède à une tout autre thématique : les navigateurs normands des Temps modernes. Une décision qui casse la présentation du sujet principal mis en place tout au long du parcours, la Mora. Bien que surprenant, ce choix a le mérite d’amener une ouverture bienvenue, mais qui aurait peut-être nécessité un espace à part entière, en dehors du parcours immersif.

Salles navigateurs normands modernes
© Photoclub Honfleur – Association la Mora Guillaume le Conquérant
La Mora mise sur la valorisation des savoir-faire et l’utilisation de dispositifs immersifs pour mettre en lumière l’histoire de la Normandie. Une alliance entre tradition et modernité réussie. À noter que la mise à l’eau est prévue pour 2027 !
Louise Chérel
Pour aller plus loin :
Le site de La Mora : https://www.la-mora.org/
Les acteurs de la Mora en parlent sur France Bleue :https://www.francebleu.fr/emissions/visite-privee
#Viking #Normandie #Archéologie

La Tour Abbatiale : un musée de territoire témoin d'une historie locale
Situé à une quinzaine de kilomètres de Valenciennes, le musée municipal de Saint-Amand-les-Eaux est abrité dans la tour de l’ancienne église abbatiale. Cet édifice du XVIIème siècle, classé Monument Historique depuis 1846, a subi d’importantes rénovations de 2004 à 2012. Le musée bénéficie d’un cadre remarquable, et tient à conserver cette vocation intellectuelle et créative qui a fait la renommée de cet ancien édifice religieux influent.
Musée de la Tour Abbatiale © Idhem Mehdi
Des expositions temporaires qui traitent de l’histoire de la commune :
La visite débute dans la salle Lannoy, attenante à la boutique, et abritée sous une voûte sculptée en pierre. C’est ici que sont présentées les expositions temporaires tout au long de l’année, en rapport avec les collections permanentes, ou dans la continuité de la programmation culturelle municipale. Ces expositions abordent des thèmes particulièrement variés : art moderne et contemporain, faïences, histoire de l’édifice entre autres.
Celle qui s’y déroule actuellement depuis le 8 octobre 2016, et qui s’achèvera le 31 décembre 2016 s’intitule : « Par les Villes et les Champs, Regards d’artistes sur la vie quotidienne dans le Nord (1890-1950). » Le second volet de cette exposition est présenté au Musée d’Archéologie et d’Histoire Locale de Denain depuis le 19 octobre 2016, et jusqu’au 8 janvier 2017. Cette exposition temporaire traite des évolutions économiques et sociales ayant marqué la région au cours des XIXème, et XXème siècle.
« Par les Villes et les Champs » © Ville de Saint-Amand-les-Eaux
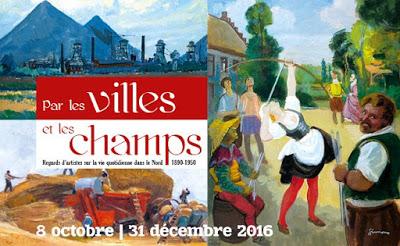 En particulier la révolution humaine et paysagère propres à l’industrialisation, et son impact auprès de l’artisanat et de l’agriculture. Le parcours, qui ne propose pas de sens de visite spécifique, expose essentiellement des peintures à travers des parties thématiques. Quelques sculptures et objets sont aussi à découvrir, notamment un jeu de logique ancien. Les peintures présentent des scènes de genre de l’époque, et relatent des instants essentiels de la vie quotidienne.
En particulier la révolution humaine et paysagère propres à l’industrialisation, et son impact auprès de l’artisanat et de l’agriculture. Le parcours, qui ne propose pas de sens de visite spécifique, expose essentiellement des peintures à travers des parties thématiques. Quelques sculptures et objets sont aussi à découvrir, notamment un jeu de logique ancien. Les peintures présentent des scènes de genre de l’époque, et relatent des instants essentiels de la vie quotidienne.
L’exposition tient à refléter cette sensation de « bon vieux temps » auprès du visiteur contemporain, à travers une reconstitution qui placent ces œuvres dans leur contexte historique. La scénographie est sobre, et tient à mettre naturellement en valeur le style architectural de l’édifice. La couleur rouge des cimaises valorise les œuvres exposées, et renforce le message chaleureux véhiculé au travers des tableaux. Les choix en matière de lumière privilégient un éclairage doux, ce qui rehausse l’architecture du bâtiment.
Salle d’exposition temporaire © Lucie Taverne
 Parmi les peintures exposées, la plupart proviennent de collections de musées de la région, parmi lesquelles : le Musée diocésain d’art sacré de Cambrai, le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, le Palais des Beaux-Arts de Lille, ou encore la Piscine de Roubaix. Ces prêts participent au succès de cette exposition, qui est sans doute l’une des plus importantes parmi celles présentées à la Tour Abbatiale.
Parmi les peintures exposées, la plupart proviennent de collections de musées de la région, parmi lesquelles : le Musée diocésain d’art sacré de Cambrai, le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, le Palais des Beaux-Arts de Lille, ou encore la Piscine de Roubaix. Ces prêts participent au succès de cette exposition, qui est sans doute l’une des plus importantes parmi celles présentées à la Tour Abbatiale.
Une collection permanente qui révèle un savoir-faire traditionnel :
La suite de la visite se poursuit à l’étage de la tour, où sont présentées les collections permanentes du musée municipal. Elles se sont constituées au début des années 1950 autour de la céramique amandinoise, avec plus de trois cent pièces de faïences du XVIIIème siècle. Une première salle expose des faïences anciennes et contemporaines, de même que leur technique de fabrication. Ces pièces témoignent de la renommée de la tradition céramique à Saint-Amand-les-Eaux, marquée par l’implantation de manufactures de porcelaine au sein de la ville à partir de 1705.
En effet, la commune disposait d’un environnement adéquat à l’installation d’une usine de faïence : un réseau routier qui facilitait le transport de la porcelaine, et la présence d’une forêt à proximité, permettait de disposer facilement de bois pour les fours. Une seconde salle, située sous une voûte à arcs brisés, présente des œuvres consacrées à l’histoire de l’abbaye. Sont aussi exposées des peintures et sculptures religieuses du XVIème au XVIIIème siècle des anciens Pays-Bas du Sud ; ainsi que des objets en lien avec l’art campanaire (claviers, cloches).
Salle d’exposition permanente © Tripadvisor
 Les restaurations récentes sont relativement visibles, puisqu’aucune trace de dégradations biologiques, humaines ou de sinistres sont à constater. Ce qui prouve à quel point l’édifice est bien entretenu en termes de conservation préventive. De même que pour la salle d’exposition temporaire au rez-de-chaussée, les choix scénographiques misent sur la sobriété, de sorte à ne pas dénaturer les décors sculptés de la tour abbatiale. Les céramiques sont exposées dans des salles aux murs blancs, à l’intérieur de vitrines quasi neuves, et sont mises en valeur grâce à la lumière naturelle qui pénètre l’intérieur des pièces, à travers de grandes fenêtres.
Les restaurations récentes sont relativement visibles, puisqu’aucune trace de dégradations biologiques, humaines ou de sinistres sont à constater. Ce qui prouve à quel point l’édifice est bien entretenu en termes de conservation préventive. De même que pour la salle d’exposition temporaire au rez-de-chaussée, les choix scénographiques misent sur la sobriété, de sorte à ne pas dénaturer les décors sculptés de la tour abbatiale. Les céramiques sont exposées dans des salles aux murs blancs, à l’intérieur de vitrines quasi neuves, et sont mises en valeur grâce à la lumière naturelle qui pénètre l’intérieur des pièces, à travers de grandes fenêtres.
Un édifice municipal classé qui s’efforce de rester accessible :
La question de l’accessibilité se pose dès l’arrivée au musée puisque l’entrée s’effectue par une porte située sur la façade est de la tour ; porte qui est trop étroite pour permettre à des personnes en fauteuil roulant de pouvoir y accéder. Tout comme l’accès au premier étage, qui s’effectue par un escalier à vis situé près de l’entrée. Sachant que l’édifice n’est pas équipé d’un ascenseur, le musée demeure donc difficilement accessible pour certains types de publics. La mise en accès de l’édifice pour les personnes à mobilité réduite semble difficilement envisageable du fait que le monument soit classé, et compte-tenu aussi du manque de moyens en termes financiers et humains dont dispose le musée.
En matière de signalétique, seul un panneau dans la salle d’accueil indique la direction à suivre pour accéder à l’exposition temporaire et les collections permanentes. Panneau qui n’est pas forcément visible de prime abord. D’autant que certaines œuvres de la collection permanente qui sont présentées en vitrines ne possèdent pas de cartels. Malgré tout, certains éléments portent à croire que le Musée de la Tour Abbatiale s’applique à élargir son accès au plus grand nombre. Tout d’abord, le fait que le musée soit ouvert toute l’année, et tous les jours de la semaine (excepté le mardi).
La visite est gratuite, il suffit simplement d’indiquer son code postal à son arrivée. Bien qu’il n’existe pas d’outils d’aide de compréhension à la visite, l’accueil du musée qui fait également office de boutique, propose en libre-service divers documents : catalogues d’exposition, documents informatifs sur l’édifice, programmes d’activités, etc. Des cartels et panneaux explicatifs clair et illustrés aident à la compréhension du visiteur, aussi bien dans la salle d’exposition temporaire que permanente. Les informations mentionnées sont aisément compréhensibles, et s’adressent de ce fait à un large public.
Des activités de médiation de qualité adaptées à tous sont organisées tout le long de l’année. D’autres sont proposées de manière ponctuelle dans le cadre des expositions temporaires. La plupart sont gratuites, et s’adressent à un public familial, ou demeurent à un prix relativement accessible. La Tour Abbatiale assume ainsi pleinement son identité de musée municipal ancré dans son territoire. Un musée municipal prometteur, qui s’évertue à se réinventer, et à demeurer ouvert au public le plus large.
Joanna Labussière
#Architecture
#Céramique
#Monument Historique
Pour plus d’informations : http://www.saint-amand-les-eaux.fr/fr/culture/musee-expositions/musee.htm

La vraie-fausse nature des dioramas
En 2017, le Palais de Tokyo inaugure Dioramas, une exposition faisant la part belle à ce dispositif muséographique. Mêlant œuvres anciennes et contemporaines, l’exposition s’attachait à présenter les différentes facettes des dioramas. Objets de fantasme, les dioramas incarnent dans l’imaginaire collectif le charme un peu désuet des musées du XIXè siècle. Ces compositions en trois dimensions et généralement grandeur nature mêlent à la fois sculpture, peinture, objets et parfois vitrine. Ils illustrent un écosystème, un événement historique ou le mode de vie de populations proches ou éloignées. Ces reconstitutions tridimensionnelles sont souvent conçues comme les miroirs du monde dans lequel ils ont été créés : ils permettent de comprendre ainsi l’état des connaissances scientifiques lors de leur création et témoignent aussi du mode de pensée d’une époque. Très appréciés par le public familial, les dioramas sont néanmoins souvent vieillissants, et plus forcément représentatifs des modes d’expositions actuels. Retraçons son histoire pour en comprendre les évolutions, son intérêt dans les représentations de notre environnement et ses renouvellements.
Image de couverture : ©S.C – « Bête noire », Kent Monkman, Palais de Tokyo
Aux origines du diorama
Ce mode d’exposition prend racine en 1822 avec la création par Louis Daguerre, peintre en décors de théâtre, de ce qu’on appellera le daguerréotype. A cette période, le diorama se résume à une toile tendue légèrement translucide, qui s’anime grâce à des jeux de lumière. Au fil des années, il s’enrichit avec l’apparition d’objets en trois dimensions.
La fin du XIXè siècle marque un tournant dans la muséographie moderne : le public constitué d’élites laisse peu à peu place aux scolaires, et les musées doivent s’adapter. Les objets amassés dans les vitrines disparaissent pour laisser place à des espaces plus aérés. L’objectif est alors de démocratiser l’accès au musée, et la médiation en devient un instrument majeur. Le diorama, mettant en scène la nature, devient très rapidement une norme moderne et novatrice pour accueillir ses nouveaux publics, notamment en Amérique du Nord. Les modèles de cires et les animaux naturalisés figent un moment, un lieu, que de nombreux visiteurs ne pourraient voir en temps normal. A l’American Museum of Natural History de New-York (AMNH), des dioramas représentant des animaux d’Afrique en pleine chasse ou l’arrivée des colons en Amérique sont installés au sein du musée. Ce changement pour des espaces plus aérés et des connaissances scientifiques actualisées interviendra en France bien plus tard, dans les années 1920-1930.
Les muséums ne sont pas les seules institutions à intégrer des dioramas dans leurs nouvelles présentations. A la fin du XIXè siècle, la présentation des folklores traditionnels inspire : pour l’exposition universelle de Paris en 1878, les Pays-Bas présentent dans leur pavillon l’intérieur Hindenloopen, un habitat hollandais traditionnel, qui passionne les visiteurs. L’intérieur comporte des objets traditionnels donnés par les locaux, et la possibilité d’entrer dans la pièce apportait un caractère immersif très apprécié à l’époque. L’intérieur remporte le diplôme d’honneur du jury et un vif succès critique. Ce type de présentation influence grandement les musées d’ethnographie : de nombreux musées s’emparent du concept pour l’intégrer dans leurs muséographies, à l’image du Museon Arlaten qui ouvre en 1899.

Une représentation de l’intérieur d’Hindeloopen, lors de l’Exposition Universelle de 1878 à Paris ©Worldfairsinfo
Paradoxalement, bien que le diorama cherche à rendre compte de la réalité la plus pure, celui-ci n’est bien souvent qu’une nature arrangée, normalisée et il joue sur le caractère spectaculaire pour attirer les foules.
Le diorama, à la fois spectaculaire et normalisateur
Pour intéresser le public, le musée peut s’appuyer sur ses collections, en présentant des pièces qui attirent la curiosité des visiteurs. Le diorama, grâce à son aspect théâtral et immersif, joue sur ces codes pour toucher un plus large public.
A de nombreux égards, le diorama peut être comparé à une scène de théâtre. En effet, la création de ces espaces nécessite l’intervention de nombreux corps de métiers ayant traits au théâtre, comme les décorateurs et les peintres en décors. En intégrant des animaux naturalisés, le diorama apporte cette touche étrange qui fait entrer la scène dans une nouvelle dimension, plus spectaculaire. L’objectif est de donner au visiteur le sentiment d’être à l’intérieur de la scène, d’oublier le monde moderne. Ce dispositif avant tout muséographique devient un véritable objet culturel, fascinant. Dans un entretien réalisé par Noémie Etienne pour évoquer son travail en tant que commissaire de l’exposition « Dioramas » présenté au Palais de Tokyo en 2017, Laurent Le Bon évoque cette fascination : « Je crois qu’il y a une fascination pour ce dispositif. C’est aussi un retour dans le monde de l’enfance. Le temps d’un parcours, on peut avoir la sensation de dominer le monde, mais aussi d’être comme Alice au pays des merveilles. »1.
Toutefois, cette recherche de spectaculaire et d’immersion a pu avoir un effet néfaste sur la rigueur scientifique de ces présentations. En 1884, le Musée d’Ethnographie du Trocadéro présente la Salle de France, regroupant des intérieurs typiques de différentes régions de France. Parmi eux, la vitrine « Bretagne » est très appréciée. Ainsi, Eugène Oscar Lami écrira « Dans une grande salle bien éclairée, quelques femmes bretonnes et frisonnes, et un intérieur breton de grandeur naturelle, frappant de vérité. Tout y est, pots, lits en forme d’armoires de bois ouvragé, et le vieux grand-père, toujours gelé, assis dans l’âtre même du foyer. Ce décor, très bien réglé, a le don d’attirer la foule »2. Ici, c’est le patrimoine, le visuel qui a été mis en avant, comme un discours pour la conservation des traditions. L’aspect scientifique n’est pas la motivation principale de ces vitrines. *
En ce qui concerne les dioramas naturalistes, un biais anthropocentriste affecte également la rigueur scientifique de certaines présentations. Loin de vouloir présenter une vérité scientifique, les naturalistes cherchent parfois à montrer leur supériorité face à la nature en la maîtrisant à travers le diorama. Cette maîtrise s’exprime de plusieurs manières. Les animaux naturalisés sont tout d’abord souvent issus de chasses effectués dans l’optique de trouver le spécimen le plus beau, le plus fort, le plus esthétiquement représentatif de son espèce. Une fois les spécimens rapportés en Occident, les animaux sont naturalisés pour les rendre le plus vivant possible. On nettoie les peaux en les débarrassant de la poussière et des puces, on masque les coutures, on fait disparaître les possibles cicatrices visibles sur la peau… L’être humain maîtrise alors la nature, en la rendant plus esthétique.
La mise en scène choisie théâtralise également la nature. En 1936, l’AMNH accueille l’African Hall, créé par le naturaliste Carl Akeley. Le naturaliste est parti lui-même en expédition pour capturer les animaux et s’imprégner des lieux afin de le reproduire au mieux dans ses dioramas. A son retour, Carl Akeley crée des scènes prises sur le vif, où l’animal prend une pose parfois dramatisée. Loin de la réalité, le fond du diorama représente le plus souvent une nature paisible, fantasmée, loin de la réalité. Le diorama des gorilles en est un exemple marquant. La scène, construite telle un tableau, présente un gorille mâle triomphant face à deux femelles accroupies en contrebas. La toile de fond, digne du jardin d’Eden, rend la scène hors du temps et onirique, sans aucun rapport avec la réalité. En parlant du diorama des gorilles, la chercheuse Anne Haraway écrit : « Bouleversant la logique muséale classique, Akeley expose des tranches de vie dans le jardin vierge d’une Nature aseptisée, parfaite et morale, expurgée d’animaux malades, difformes, âgés ou lâches » 3.

Le diorama des gorilles, dans l’African Hall du Muséum d’Histoire Naturelle de New-York (années 1930) ©maaachuuun sur Flickr
Un art au service des idéologies
Objet culturel par excellence, le diorama reste une création humaine, et par conséquent est à son image. Ainsi, dans le même temps que leur popularité grandissante, les dioramas vont séduire et distraire les masses. Véritable outil éducatif dans le monde occidental de la fin du XIXè siècle, le diorama propose alors un discours qui n’a pas toujours de lien avec la réalité. Pour certains, il s’agit même de faire passer une idéologie représentant la pensée de l’époque, eugéniste et patriarcale.
Un exemple frappant se trouve (encore !) à l’AMNH. Le diorama des lions présente un groupe de lions avec un mâle debout et regardant au loin, tandis que les femelles sont allongées pour la plupart. Bien qu’ayant été sur le terrain, Carl Akeley propose ici un discours à l’image de son temps en transposant une idéologie humaine à un groupe animal. Ainsi le lion, représentant la force, la noblesse, est droit, debout, tandis que les femelles adoptent une position bien plus passive, à l’image de ce qui est attendu du statut de femme à la fin du XIXè siècle. Il aurait été bien plus rigoureux scientifiquement de présenter une scène de chasse où les femelles sont en action.

Le diorama des lions du Muséum d’Histoire Naturelle de New-York (années 1930) ©AMNH
Ce discours est également rattaché à la pensée eugéniste de cette période. Les animaux, capturés comme étant les plus beaux spécimens de leur espèce, sont une recherche d’un idéal. Noémie Etienne résume le contexte idéologique de cette période dans un entretien pour France Culture : « il s’agissait de trouver le spécimen le plus représentatif de sa 'race', quitte à en abattre plusieurs jusqu’à obtenir celui qui serait naturalisé pour être transporté à New York. On construisait ainsi une image de l’espèce conformément à des critères relativement abstraits et qui ne reflétaient pas la diversité des animaux. La même ambition sous-tendait les représentations humaines sous forme de mannequins : elles sont ainsi problématiques car elles prétendent montrer une vision scientifique de types 'raciaux' - construisant ainsi une image factice et préconçue de l’altérité. » 4
Bien évidemment, les dioramas ethnographiques sont également touchés par les préjugés de cette période. Proposant une image biaisée de la réalité sur fond de roman national, les dioramas ethnographiques sont souvent directement rattachés aux zoos humains présentées dans les Expositions Universelles de la fin du XIXè siècle. Ces représentations sont de véritables outils de propagande à l’attention des scolaires. Ainsi, l’AMNH présente en 1939 le Old New York Diorama, une scène montrant l’arrivée des colons néerlandais sur le sol américain. Représentatif des clichés et de la volonté de créer un roman national fort sur la création du pays, le diorama présente des incohérences historiques importantes. Par exemple, la tribu Lenappe fait les frais des clichés sur les populations autochtones tandis que les colons blancs sont présentés comme arrivants pacifiques.

Le Old New-York Diorama, de l’AMNH, lors de sa création en 1939 ©Capture d’écran de la vidéo « Behind the Updates to Old New-York Diorama » de l’AMNH
Un exemple plus récent nous vient de l’Australian War Memorial de Cambera. Durement touché lors des combats de la Première Guerre Mondiale, l’Australie reste néanmoins loin des champs de batailles. Une partie des dioramas présentés ont été créés par Charles E. W. Bean, historien et correspondant de guerre durant le premier conflit mondial. Les dioramas de cette période manquent de recul sur la situation. Le diorama de Lone Pine présente par exemple une offensive australienne. La scène est centrée sur un soldat fauché par une balle, tandis que ses camarades reconquièrent des positions ennemies. Cette représentation, entre la scène de théâtre et celle de cinéma, sert le discours populaire présentant l’Angleterre indifférente au sort des Australiens, menant à terme à l’indépendance de l’Australie.
Le diorama Lone Pine de l’Australian War Memoria (1924) ©AWM
Et aujourd’hui ?
Un peu oubliés dans la seconde partie du XXè siècle car considérés comme désuets, les dioramas n’en restent pas moins très présents dans les musées, à travers des présentations d’époque ou plus récentes. A l’aune du XXIè siècle, les critiques ont été entendues, et de nombreux changements s’effectuent autour de ces dispositifs.
Les anciennes représentations ont pour la plupart été retirées des parcours permanents dans les musées de grande envergure, mais il arrive que certains aient été amendés, pour porter un nouveau discours. C’est notamment le cas du Old New-York Diorama, cité plus haut. En 2018, l’AMNH a fait le choix de présenter le diorama en ajoutant sur la vitrine de nombreuses informations. Cet ajout permet de recontextualiser la scène et d’évoquer les erreurs historiques portées par le diorama, en précisant par exemple le rôle des femmes chez le peuple Lenappe ou en évoquant la violence dont ont pu faire preuve les colons à leur arrivée.
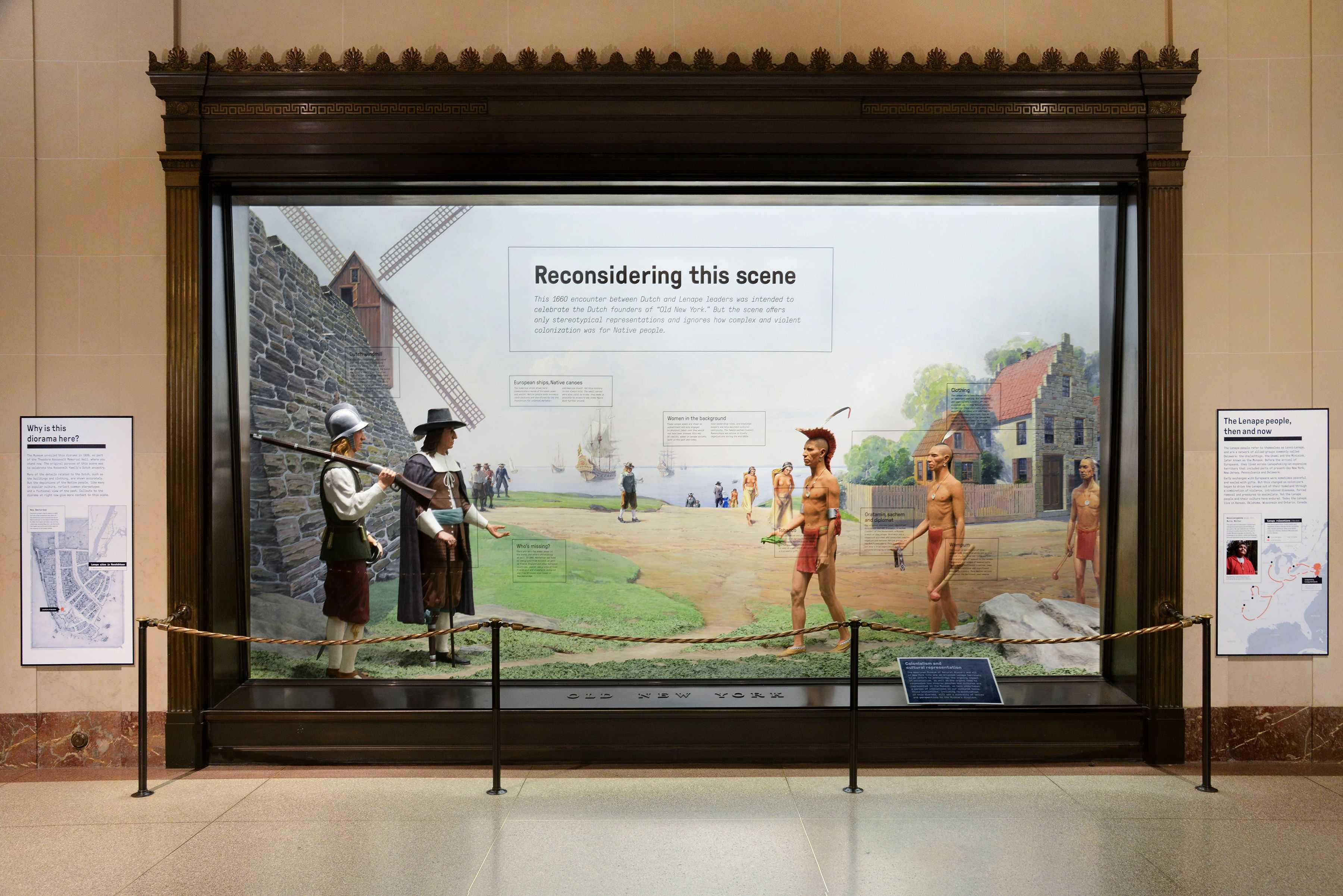
Le diorama Old New-York accompagné de ses cartels explicatifs depuis 2018 ©Hermes Creative Awards
Loin des visions caricaturales de l’époque, les dioramas produits aujourd’hui sont toujours conçus dans un objectif pédagogique, tout en portant sur des sujets différents. Les dioramas animaliers sont le plus souvent tournés vers la biodiversité, la dégradation des espaces. Cela permet d’apporter un contenu visuel pour les publics jeunes et scolaires, pour inviter à la prise de conscience sur ces thématiques. Plus qu’un simple dispositif pédagogique, le diorama devient alors un véritable support à la médiation. Dans le cadre de la refonte de son parcours permanent, le Musée d’Histoire de Lyon a fait le choix d’introduire un diorama dans la partie « Les pieds dans l’eau ». L’équipe de scénographie a recréé un lône, un espace retravaillé en bordure du Rhône pour réintroduire des espèces. La scène présente les espèces typiques des lônes (martin-pêcheur, castor…) cohabitant avec les déchets. Le diorama abrite plusieurs outils de médiation, comme une « hutte », dans laquelle les plus jeunes peuvent s’installer pour écouter des récits sur le sujet.

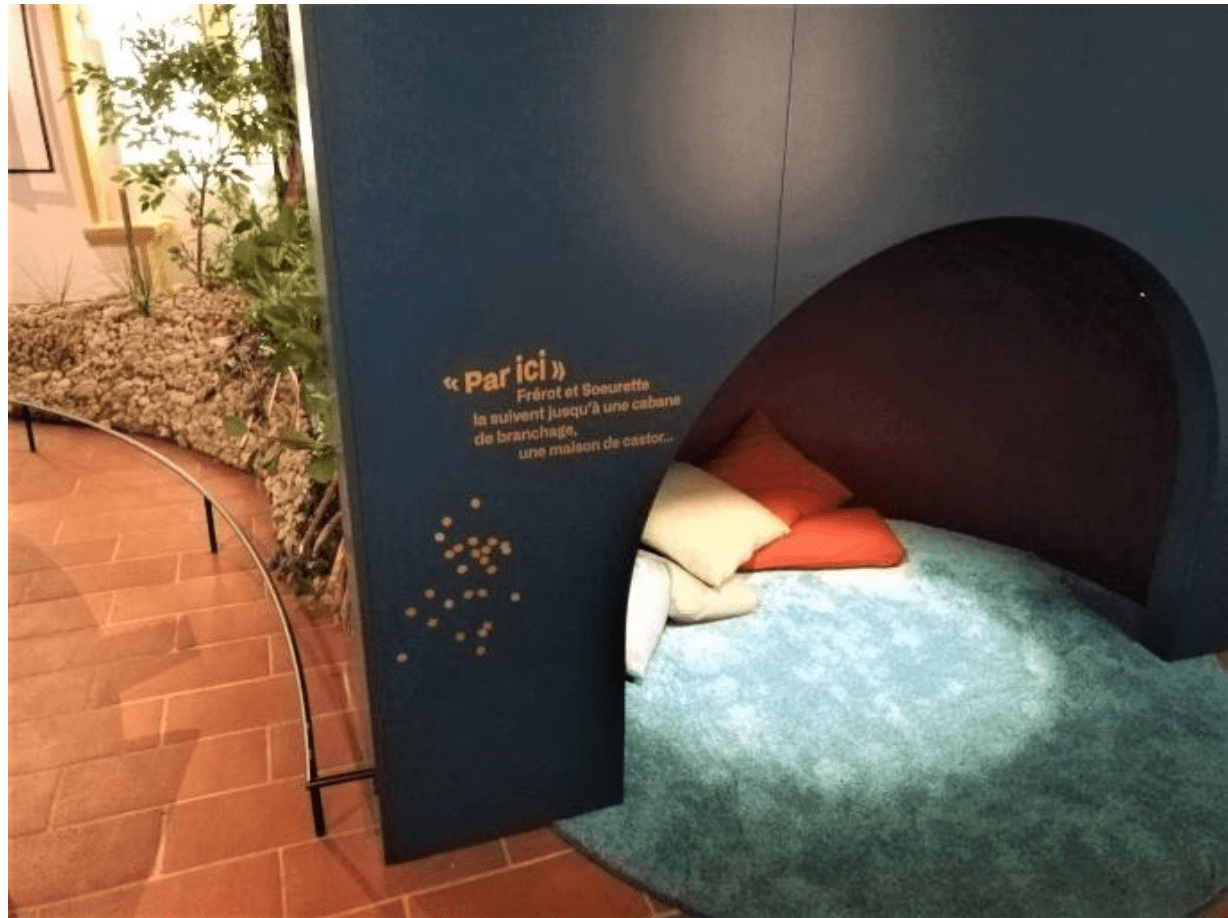
Le diorama du Musée d’Histoire de Lyon, conçu par Scénorama en 2020 ©J.G
Depuis sa création objet de fantasme et du spectaculaire, le diorama est représentant de sa période de faste, en présentant souvent une image biaisée de l’Histoire. Pourtant, il est toujours aussi plébiscité, principalement par le jeune public, car son caractère théâtral et immersif n’a de cesse d’émerveiller petits et grands. Désormais, le diorama n’est plus l’outil de médiation, mais simplement le support, sur lequel les médiateurs et/ou les dispositifs associés apportent un nouveau discours plus en accord avec son temps.
Image vignette : ©C.dC – Diorama « Un village néolithique en Haute-Provence » au musée de la Préhistoire de Quinson
Clémence de CARVALHO
1 Laurent Le Bon et Noémie Étienne, « Entretien avec Laurent Le Bon », Culture & Musées [En ligne], 32 | 2018, mis en ligne le 16 janvier 2019, consulté le 9 mars 2021. URL : http://journals.openedition.org/culturemusees/2651 ; DOI : https://doi.org/10.4000/culturemusees.2651
2 Dictionnaire encyclopédique et biographique de l’industrie et des arts industriels, publié par Eugène Oscar Lami, tome VI, Paris, 1886
*L’image de la vitrine Bretagne n’étant pas libre de droit, je vous invite à la visionner ici : https://www.photo.rmn.fr/archive/07-534152-2C6NU0JLYIBS.html
3 Modest Witness@ Second Millennium. Femaleman Meets Oncomouse : Feminism and Technoscience, Donna Haraway,1997
4 Maxime Tellier, « Le Musée d’Histoire naturelle de New-York, temple mondial du diorama » [En ligne], France Culture, 31 juillet 2020, consulté le 9 mars 2021.
Pour en savoir plus :
-
Publics et Musées, n°9, 1996. Les dioramas (sous la direction de Bernard Schiele), accessible ici : https://www.persee.fr/issue/pumus_1164-5385_1996_num_9_1
-
Culture et Musées, n° 32, 2018, L’art du diorama (1700-2000) (sous la direction de Noémie Etienne et Nadia Radwan), accessible ici : https://journals.openedition.org/culturemusees/2197
-
Maxime Tellier, « Le Musée d’Histoire naturelle de New-York, temple mondial du diorama » [En ligne], France Culture, 31 juillet 2020, accessible ici : https://www.franceculture.fr/histoire/le-musee-dhistoire-naturelle-de-new-york-temple-mondial-du-diorama
-
L’AMNH présente le diorama Old New-York amendé : https://www.youtube.com/watch?v=ndj59hGuSSY
-
Sur la fascination pour les intérieurs : https://brill.com/flyer/title/36506?print=pdf&pdfGenerator=headless_chrome
#diorama #mediation #museographie

Le MRAC : un espace hors du temps, récit d’un parcours de visite atypique
Si vous aussi vous voulez voir à quoi ressemble un rat-taupe, si vous ignorez ce qu’est un cob de Thomas et si les petites bébêtes et autres parasites tels que le célèbre ténia ne sont pas pour vous synonymes d’effroi, alors le Musée Royal de l’Afrique Centrale de Tervuren vous tend les bras ! Les passionnés de sciences naturelles et d’objets ethnographiques vont se régaler en déambulant dans ce musée, situé à environ 15kms de Bruxelles. Excentré, l’environnement champêtre immédiat du musée vous dépaysera, vous éloignant des quartiers bruyants de la ville. En effet, de vastes jardins à la française représentent le cadre principal du musée. Une fois gravies les marches centrales pour accéder au musée, tournez le dos, regardez face à vous : la profondeur de champ et le tracé rectiligne des jardins pourront vous faire penser à Versailles. A l’entrée, loin des portes automatiques modernes, vous devez pousser le tourniquet manuel. Acte insignifiant certes, mais qui implique déjà le visiteur dans son parcours quand traditionnellement les portes s’ouvrent d’elles-mêmes. Pendant que vous avancez, vous pouvez observer le hall d’entrée aux décors luxueux où se côtoient marbre et statues dorées à l’or fin.
© L.V., 2012
Un musée en mutation
Une visite atypique, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ce musée, érigé en son espace actuel en 1910 sous l’impulsion de Leopold II (deuxième roi des Belges), est en travaux depuis 2010. Privilège au public qui d’ordinaire pendant ces moments cruciaux de transformation aurait trouvé porte close en ce privant de cette expérience unique : côtoyer le musée dans son intimité. Le parcours de visite est logiquement impacté, la déambulation modifiée. Des moments de vie interne au musée habituellement effectués à l’abri des regards, peuvent alors être visibles. Le personnel peut par exemple installer des signalétiques amovibles sous vos yeux, alors que vous regardez un diorama de la faune africaine. Outre cet aspect, les curieux du monde muséal et de son histoire y trouveront leur compte. La muséographie est ancienne et certains outils de médiation sont à son image « les dernières grandes adaptations remontent à l’Expo 58, soit il y a plus de 50 ans » annonce le MRAC sur son site internet. Dans certaines salles, des schémas annotés ou animaux sont dessinés et dans d’autres (première salle de l’exposition permanente), la disposition des expôts dans les vitrines latérales est sommaire et classique. Une dizaine d’objets y sont disposés, espacés et référencés par des numéros. D’anciens cartels « vintage » recto-verso (bilingues) sont disposés sur un côté des vitrines ; y figurent numéros et explications respectives. En dessous du texte est reproduite sous forme de dessin la disposition exacte et numérotée des objets dans la vitrine.
Ces outils de médiation peuvent révéler la construction de la pensée et la conception muséographique au cours du temps. Ils mettent en évidence l’évolution des considérations intellectuelles ou morales successives, chaque médiation étant révélatrice de son époque.
Une médiation irrégulière
Dans la première salle, la cohabitation de plusieurs «générations de médiation apparaît anachronique. Des installations multimédia sont installées autour d’une vitrine centrale plus moderne que les autres. Des casques sont à votre disposition et plusieurs interprétations musicales traditionnelles vous sont disponibles au choix. Simultanément au son, l’appréciation de l’espace s’en voit modifié, avec les objets ethnographiques des populations indigènes dans le champ de vision : entre immersion dans la culture africaine et mise à distance liée au malaise propre à l’histoire coloniale. Au cours de la visite, le fait que l’amateur puisse visualiser la prise de recul du musée sur sa propre histoire est positif. Par exemple, dans la « galerie des mammifères » une photographie de l’ancienne muséographie de la pièce est présente et l’évolution de la disposition antérieure vers l’actuelle est expliquée. Il est de nouveau possible de retracer le cheminement intellectuel de la pensée. Aussi, à la fin de la visite, une vitrine de sensibilisation à la maltraitance des animaux est intitulée « Pour éviter ceci». On peut y voir un bébé singe en cage habillé d’un tee-shirt (comme écho certains cirques) un sac en peau de crocodile ou un tissu en peau de léopard. La présence de cette vitrine sous-tend la prise de conscience des plausibles conditions de capture de la faune à l’époque et toujours présentée dans le musée. Mais cet élan de médiation paraît succinct : vitrine étroite comparativement aux dioramas, multiplication de cartels à la typographie réduite et scénographie plutôt basique.
D’autre part, initiative intéressante, un espace destiné aux enfants de 7 à 12 ans, assimilable à un « mini-musée » condensé intitulé FleuveCongoa été construit en 2009. Celui-ci, désormais intégré à l’exposition permanente, est adapté à ce jeune public et rend accessible les informations sur le fleuve grâce à une présentation ludique et interactive. Plusieurs jeux didactiques sont mis à disposition sous des formes attractives : puzzles géants, marelle sur la thématique du courant ou encore « À chaque poisson sa pêche », labyrinthe où un bon agencement des pièces permet de faire correspondre une technique de pêche à un poisson. De plus, une zone axée sur la lecture met à disposition des romans. Inutile de préciser que plusieurs zones de repos ou assises sont proposées dans cet espace.
Des collections variées
Les collections du musée, ressources comme témoignage historique et outil scientifique, sont constituées à la fois à partir des objets récoltés par les administrateurs coloniaux, les militaires, les missionnaires, les commerçants et les scientifiques (avant 1960) et de ceux apportés par les scientifiques en collaboration avec les instituts africains –achats, dons, etc.- (après 1960). Celles-ci concernent l’Afrique centrale et proviennent principalement de la République démocratique du Congo. De nombreux dioramas présentent la faune en taxidermie et un important insectarium est donné à voir. Poissons et autres espèces aux milieux naturels divers sont quant à eux montrés et conservés dans du formol ou de l’alcool.
Enfin le bémol de ce musée, à d’autres égards fécond, c’est un aspect trop peu dynamique et une pauvre interaction avec le public. Mais c’est sans doute ce caractère figé, comme arrêté dans le temps, qui en fait tout son charme. Néanmoins, le visiteur peut être heurté car certaines salles mettant en avant le point de vue belge sur les bénéfices de la colonisation du Congo. Il semble d’ailleurs que la désuétude de ces propos ne soit pas suffisamment mise en exergue par une note explicative in situ. Cependant, de cette manière, le public peut s’immiscer dans une muséographie datée et comprendre ainsi l’enjeu des propos énoncés qu’il est utile de mettre en comparaison avec le discours actuel sur la colonisation. A voir ce que la rénovation proposera en termes de réactualisation de ces discours. En revanche, si la superposition de l’ambiance des travaux et de celle d’un musée, communément plus serein, ne vous dérange pas ou vous intrigue, n’hésitez pas à vous y rendre rapidement, il fermera ses portes mi 2013.
Lucie Vallade

Le Musée des familles
« Expédition » dans le grenier de mes grands-parents
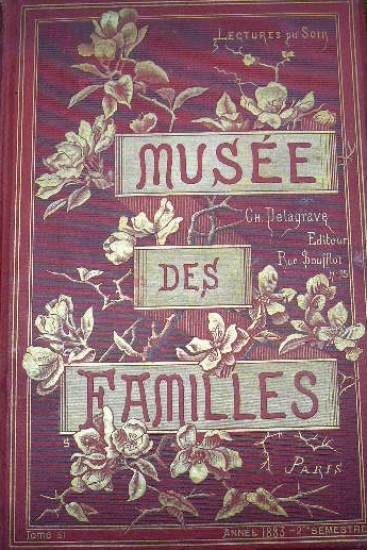 Qui n’est jamais allé à une brocante ou un vide-grenier, pour chiner des objets du passé : objets démodés devenus vintage, souvenirs d’enfance, objets de collection ? Et qui n’a jamais eu envie d’aller fouiner dans le grenier de ses ancêtres pour dénicher de petits trésors et tenter d’imaginer leur vie ? Maintes fois, j’ai exploré le grenier de mes grands-parents. J‘y ai trouvé les traces d’intrus : rats, souris, araignées, mites, passés avant moi et qui ont marqué leur passage. Parmi les nombreux témoignages du passé que j’ai pu trouver, j’y ai découvert :
Qui n’est jamais allé à une brocante ou un vide-grenier, pour chiner des objets du passé : objets démodés devenus vintage, souvenirs d’enfance, objets de collection ? Et qui n’a jamais eu envie d’aller fouiner dans le grenier de ses ancêtres pour dénicher de petits trésors et tenter d’imaginer leur vie ? Maintes fois, j’ai exploré le grenier de mes grands-parents. J‘y ai trouvé les traces d’intrus : rats, souris, araignées, mites, passés avant moi et qui ont marqué leur passage. Parmi les nombreux témoignages du passé que j’ai pu trouver, j’y ai découvert :
Le musée des familles : Lectures du Soir.
Le musée des familles : de quoi s’agit-il ?
Vous vous doutez que cette revue ou plutôt, ce gros livre épais, jauni et abimé m’a intriguée. Petite recherche et j’apprends qu’il s’agit de l'un des tout premiers périodiques illustrés à bas prix du XIXe siècle en France. L’abonnement annuel est fixé à 5 francs à Paris et 7 francs pour la Province quand le salaire journalier d’un ouvrier est compris entre 1,25 à 3 francs dans les régions du Nord (Paul Paillat, La vie et la condition ouvrière en France de 1815 à 1830). Cette revue hebdomadaire voit le jour en1833 puis devient mensuelle et enfin, bi-mensuelle. Entre 1845 et 1880, elle devient très populaire et est même promue par le ministère de l’instruction publique. La revue cesse de paraître en 1900 après une vente du journal et un désengagement de son nouvel éditeur. Intéressant, mais pourquoi une revue appelé « musée » ?
Le passé dépoussiéré
J’ai parcouru les deux tomes de cette revue que j’avais retrouvés, pour en comprendre le contenu. Au cours de ce voyage temporel, j’ai rencontré plusieurs rubriques : « chroniques du mois » accompagnée d’un rébus, « études religieuses », « science en famille »,« légendes et chroniques populaires », des anecdotes historiques, des poèmes, des partitions et également des « contes en famille ». Ces derniers sont rédigés par de grands écrivains du XIXe tels Balzac, Dumas, Théophile Gautier, Victor Hugo, Jules Verne, etc. Ils sont conçus comme des feuilletons, et leurs auteurs semblent pouvoir s’exprimer librement.
Le musée retrouvé ?
Par son titre, cette revue se rêve en musée accessible à toutes les familles, à l'époque où s'invente la protection du patrimoine et alors que la première liste de monuments classés est publiée en 1842. La revue se rêve en musée qui vient à ceux qui ne vont pas au musée, et qu'on se raconte le soir, en famille. Ce qui rapproche la revue d’un musée, ce sont les gravures représentant des artéfacts. En effet, les objets représentés sont exposés dans des musées comme le musée des Souverainsau Louvre. Ces gravures rappellent par ailleurs les planches illustratives de l’Encyclopédie d’Alembert et Diderot.
Ces représentations d’objets sont légendées et accompagnées de textes, on peut lire : « la salle des Bourbons contient, dans des armoires vitrées, adossées aux murs, une foule d’objets ayant appartenu aux rois de France ». Les explications données sur les objets exposés dans cette salle et la description des parcours permettent de comprendre la muséographie de l’époque au musée du Louvre. Toutefois, la simple représentation de ces objets ne fait pas de cette revue une exposition ou un musée. En effet, ces objets sont sortis de leur contexte d’exposition. Néanmoins, la forme de la « revue », avec ses multiples contenus, donne au lecteur la liberté de choisir ses lectures et de parcourir les pages, comme il déambulerait dans une exposition, si on relit le Traité d’expologie dans lequel Serge Chaumier décrit brièvement la distance existant entre un livre et une exposition : « l’exposition correspond moins à une histoire qu’à un enchevêtrement de sens, elle est composée de multiples histoires qui pour finir permettent de produire une histoire, celle que le visiteur se construit par interaction avec les propositions ».
Le musée à domicile ?
Cette revue est la première à donner un meilleur accès à la culture aux classes populaires, notamment par des illustrations qui facilitent la compréhension des contenus. Les grandes institutions muséales réussissent ainsi à ouvrir leurs contenus aux personnes éloignées de la capitale, comme le prouve ma découverte de ce périodique dans un village rural de Franche-Comté. Aujourd’hui, même si les structures muséales sont plus nombreuses sur l’ensemble du territoire, elles s’évertuent encore à rendre accessibles leurs collections en-dehors de leurs murs par l’intermédiaire des catalogues d’exposition, des musées virtuels, d’outils de médiation. Mais rien ne remplace une visite au musée ! D’ailleurs, l’accueil des familles est désormais au cœur des préoccupations des musées, comme l’atteste l’offre diversifiée de parcours adaptés et les études menées sur ce sujet.
Anaïs Dondez
# livres anciens
# musée hors-les-murs# 19e siècle

Le musée Rautenstrauch-Joest à Cologne : comment visiter un musée d'ethnologie allemand sans en parler un mot ?
Le musée Rautenstrauch-Joest, fraichement ré-ouvert en 2010, a été crée en 1901, suite aux collectes menées par Wilhelm Joest et Eugen Rautenstrauch, deux ethnologues allemands passionnés de voyages et de cultures. Sillonnant un monde marqué par les grandes conquêtes coloniales – et profitant aussi de celles-ci pour leurs recherches anthropologiques - ils rassemblent très rapidement près de 33 400 objets (en 1918). Ces fonds à la porté historique et sociale extraordinaire sont issus à 30% des colonies allemandes : la place qu’occupe le colonialisme européen dans notre connaissance des peuples et modes de vie « exotiques » y est clairement affirmée.
Situé au cœur de Cologne, une ville cosmopolite à 3 heures des Pays Bas, de la Belgique et de la France, ce musée parvient-il à ouvrir son contenu à un public étranger? Quel niveau de lecture est offert au visiteur non-allemand ? Partons à la découverte des salles du musée !
Dire "Bonjour" autour du monde©PW
10h15 : arrivée au musée. Réception agréable à l’accueil, où le personnel – bilingue - offre au visiteur le guide de l’exposition en anglais, et lui propose également l’utilisation gratuite de l’audioguide.
10h20 : bienvenue au musée ! Grâce à un prologue intelligent, lemusée accueille ses visiteurs avec une vidéo nous montrant les multiples façonsde se dire « bonjour » dans le monde. Le public est donc prévenu : nous sommes bien dans un musée d’ethnologie qui se veut ludique et moderne !
 10h40 : Après avoir traversé la culture javanaise et découvert les hypnotisantes marionnettes WayangKulit, le musée propose une petite contextualisation du travail ethnologique de l’époque au travers des grands anthropologues européens. Un lien fort est fait entre cette vague d’intérêt pour l’ethnologie et le désir d’éduquer et d’ouvrir les horizons de la société européenne aux cultures d’ailleurs. Les cartels et animations interactives existent en deux langues, allemand et anglais, la seconde parfois bien difficile à découvrir dans les manipulations…
10h40 : Après avoir traversé la culture javanaise et découvert les hypnotisantes marionnettes WayangKulit, le musée propose une petite contextualisation du travail ethnologique de l’époque au travers des grands anthropologues européens. Un lien fort est fait entre cette vague d’intérêt pour l’ethnologie et le désir d’éduquer et d’ouvrir les horizons de la société européenne aux cultures d’ailleurs. Les cartels et animations interactives existent en deux langues, allemand et anglais, la seconde parfois bien difficile à découvrir dans les manipulations…
Couper court aux stéréotypes de l’Afrique ©Rautenstrauch-Joest Museum
11h00 : Déconstruire les clichés. Dans une salle blanche immersive, des photographies et des vidéos sont projetées sur de petites portes, blanches elles aussi. Cette iconographie pleine de préjugés sur les peuples africains est alors déconstruire : le visiteur a la possibilitéd’ouvrir ces portes et de découvrir la réalité de la situation en Afrique et de la place – coupable - du monde occidental dans la situation des pays émergeant. Excellent moyen de couper court à nos préjugés les plus« innocents », ces animations se passent souvent de langage pour être comprises et assimilées, grâce à une iconographie pertinente et des titres très parlants. Néanmoins, rien ne remplace le texte et les informations essentielles à la compréhension de cette situation politique et économique complexe.
Carte de la provenance des collections ©PW

Extrait d’un cartel explicatif :
« Les expositions sont les fenêtres à travers lesquelles un musée est perçu par un public, et en même temps, elles constituent un filtre qui transmet la vie et le monde d’autres cultures dans des musées d’anthropologie visitables. Les expositions sont une interprétation plutôt qu’une représentation de la réalité. Le choix des objets, la façon dont ils sont présentés, et l’interaction qui est faite, les différents médias, et la scénographie déterminent la perceptionet la compréhension des visiteurs. Les lectures, les films, et les événements divers complètent la vocation éducative du musée. »
Les processus de mondialisation et l’émancipation politique posent à présent de nouveaux défis pour ces musées. Cela questionne sur un retour à des objets anciens, au problème de la présentation contemporaine des cultures, et la quête de nouveaux champs de collectes, pertinentes pour le monde d’aujourd’hui. »
Le visiteur aura ensuite la chance de découvrir de nombreuses salles aux superbes décors (dont on évitera de vous dévoiler tous les détails) : les portes dans le monde et leur signification, les espaces de vie et l’analyse des cultures sédentaires, et une fabuleuse salle sur l’habillement et le langage du corps.
Muséographie logique ? Le parcours se clôt avec les rites funèbres des sociétés… L’accès à « l’au-delà » est concrètement représenté ! Le passage des visiteurs par un espace de longs rideaux blancs à frange, accompagné d’une musique apaisante et de fauteuils de repos, a de quoi surprendre !
Alors, quid du visiteur étranger ?
La place forte du visuel parvient à faire comprendre le discours à un public non-germanophone. Les photographies, graphiques, cartes, supports audiovisuels et multimédias constituent un relai parfaitement maitrisé du texte dans ce musée.
La qualité de la scénographie et de la mise en espace permettent une « immersion » complète du visiteur, le positionnant dans une situation propice à la compréhension du contenu. Les cartels assez courts ponctuant chaque entrée de salle sont agréables à lire, et rédigés dans un anglais assez compréhensible ! Quelques frustrations apparaissent cependant quand les cartels ne sont pas bilingues et que l’utilisation de l’audioguide s’impose alors. Évidemment, les difficultés d’un musée à traduire l’ensemble des textes sont compréhensibles, notamment pour des questions de place et d’équilibre visuel.
En conclusion, la visite de ce musée au regard original est vivement conseillée ! Si votre niveau d’anglais est assez bon, foncez à Cologne ! La possibilité de louer un audioguide complète les traductions manquantes des objets exposés, mais elle vous coupera un peu des sympathiques Allemands qui vous accompagneront alors…
Pauline Wittmann
Pour en savoir plus : Lien vers la page web du musée
#ethnologie
#public étranger
#Cologne

Le pôle patrimonial de la 27e BIM : son Hôtel de Commandement et son Musée, un ensemble unique
Qui sont les Troupes de Montagne ?
Créées en 1888 pour défendre l’Arc Alpin, les Troupes de Montagne sont dès l’origine une force interarmes spécialisée dans le combat en montagne. Elles apportent une contribution considérable du ski en France et de pratique collective de la Montagne grâce à l’esprit de cordée. Elles acquièrent le statut de Troupes d’élites lors de la Première Guerre mondiale. Les chasseurs de l’unité sont alors surnommés les “diables bleus” par l’adversaire. Cette Armée des Alpes invaincue, confirme sa renommée lors de la Seconde Guerre mondiale à Narvik. Elles sont présentes en 1945 en Autriche et en Kabylie entre 1955 et 1962. La division élargit son cadre d’emploi habituel en 1983 avec la force d’action rapide déployée au Liban et en ex-Yougoslavie. En 1999, la 27e BIM, dépositaire des traditions des Troupes de Montagne, se professionnalise. En 2007, est dévoilé l’existence d’un groupement de commando montagne. L’année 2018 marque les 130 ans de la création des Troupes de Montagne. Aujourd’hui, la qualité première de la 27e BIM est de s’adapter à son environnement afin de pouvoir réaliser toutes ses missions dans un relief escarpé et/ou montagneux dans ses conditions climatiques extrêmes tout en gardant sa “spécificité montagne” dans ses aptitudes morales, physiques, techniques et tactiques, individuellement et collectivement .
Le patrimoine de l’Hôtel des Troupes de Montagnes : chantier de rénovation et de valorisation
Un travail considérable de conservation de l’Hôtel des Troupes de Montagne, est en cours. Les façades en pierre ont été rénovées en 2016-2017, des actions de restaurations du décor intérieur ont été faites, les huisseries et volets sont en train d’être terminés. D’autres opérations continuent d’être menées pour la décoration intérieure - à savoir la restauration du mobilier et des marbres par Monsieur Frédéric Marcos de l’Atelier Pierre et Décoration. Les horloges font également l’objet d’une restauration par un artisan horloger de France d’une maison locale, Monsieur Constant Benoni. La bibliothèque patrimoniale est actuellement remise en place avec des ouvrages datant parfois du XVIIe siècle. Un plan de réaménagement des jardins est actuellement à l’étude afin de retrouver l’esprit des lieux avec l’aide experte du jardinier du Château de Sassenage. Les rénovations permettent ainsi de garder l’Hôtel de Commandement des Troupes de Montagne, exemple unique de notre patrimoine national datant de l’époque Napoléon III (construit entre 1863 et 1868) exceptionnellement proche de son état d’origine. Parallèlement aux chantiers, un écrit d’état des lieux du patrimoine est à venir, afin de répertorier la genèse des lieux ainsi que son état actuel afin que sa mémoire puisse être protégée.
Hôtel des Troupes de Montagne, Horloge et salon Néo-Pompéien © Musée des Troupes de Montagne
Le Musée des Troupes de Montagnes et ses collections
Récemment, le Musée a pu mettre en place ses collections dans des conditions plus optimum en dédiant dans ses réserves des salles par unités d’objets : peinture et documents graphiques, équipements techniques de montagne, uniformes, armements. Il répond ainsi aux normes des Musées de France. Actuellement, il continue à mettre en place ses espaces de stockages adéquats pour la suite des collections comme le département skis et raquettes. Corrélativement à cette mise en place, les équipes effectuent le récolement numérique. Tout ce travail œuvre dans le dessein du programme de l’ICOMAM(le Comité international pour les Musées et les Collections d’armes et d’histoire militaire) en offrant une approche historique, scientifique et objective liée à un contexte social. À ce titre, le Salon des Artistes des Troupes de Montagnes est un événement de solidarité entre les la 27e BIM et des artistes contemporains.
Réserves du Musée des Troupes de Montagne 2021 © Musée des Troupes de Montagne
Pourquoi protéger ce patrimoine militaire ?
Si l’Histoire nous laisse des traces, ses supports de mémoire se font parfois rares. Pourtant, prendre soin de notre héritage, constitue un rempart de nos vies. L’architecture des bâtiments militaires est peu connue, à part quelques illustres exemples tels que les citadelles de Vauban ou bien l’Hôtel national des Invalides qui abrite le Musée de l’Armée. Ces dernières années, ils ont souvent été récupérés pour d’autres usages. Un exemple contemporain culturel d’envergure de reconversion est l’ancienne base sous-marine de Bordeaux devenue “Bassins de Lumières”centre d’art numérique. D’autres exemples renaissent de leurs cendres ; c’est le cas du collège Royal et Militaire de Thiron-Gardais à l’initiative de son dépositaire passionné, Stéphane Bern. Avec ces différents exemples aux programmes variés, force est de constater, combien le patrimoine militaire est fédérateur.
Le patrimoine bâti militaire et les spécificités de l’Hôtel des Troupes de Montagne
Par leur fonction, l’époque, les édifices militaires se sont distingués des constructions civiles par des traits caractéristiques : un plan-masse articulé avec une place d’armes, des volumes et des formes sobres, une façade à la trame répétitive rythmée par des ornements symboliques, des seuils d’entrées de sites particulièrement soignés, un pavoisement toujours présent. La qualification des espaces a toujours été pensée de pair avec l’identification des usages, et dans un esprit de rigueur.
L'Hôtel des Troupes de Montagne a pour spécificité forte d’avoir toujours gardé ses activités opérationnelles dans son site militaire urbain à forte valeur patrimoniale, lui assurant ainsi une protection contre les affres du temps tel que l’abandon, là où d’autres ont eu une parenthèse d'oubli dans le temps. Cette visibilité ne peut se satisfaire d’une simple présence comme protection. En effet, le travail de conservation, de restauration, de publications scientifiques et d’activités muséales est indispensable à sa pérennisation. D’autres leviers restent encore à explorer : l’Armée occupe moins la cité/ville de Grenoble en terme d’étendue facilement identifiable, même si ses ensembles imprègnent profondément l’espace urbain et l'imaginaire collectif de ses habitants, ne serait-ce qu’en terme de repères spatiaux, parcellaires et esthétiques. Présent depuis le XIXe siècle, son existence témoigne de la relation ancrée qui unit la ville à l’institution militaire.
Pour Hannah Arendt, la culture c’est ce qui dure. Ainsi, l’Hôtel des Troupes de Montagne n’a jamais perdu son identité militaire. Aujourd'hui, il affiche clairement ses spécificités en étant force d’actions conjointement avec le Musée des Troupes de Montagnes. Lors des journées du patrimoine, en 2020, le Général de la 27e BIM a ouvert son bureau officiel au public pour la première fois, actant le lien militaire civil et rappelant que ce patrimoine appartient à la Nation française. Ce patrimoine vivant, ne cesse de mener une politique de remise en valeur interne et externe avec l’exigence de la représentation militaire. Ce patrimoine architectural et muséal militaire est doté de multiples fonctions : l’héritage de l’histoire des Troupes de Montagne, une reconnaissance au service des familles qui dédient leurs vies à la Nation, une identification et une pérennisation de sa présence. Et, surtout un vecteur de transmission de la culture militaire qui incarne l’esprit de Défense auprès du monde civil comme du monde militaire qui n’en a pas toujours justement conscience.

Hôtel des Troupes de Montagne, 37ème édition des Journées du Patrimoine © Musée des Troupes de Montagne
Charlène Paris
#architecture #patrimoine #conservation #gestioncollection #museesdefrance #journéesdupatrimoine
Le tourisme noir : une désolation ?
L'approfondissement d'un sujet provient parfois d'une lecture, d'un ouvrage marquant. L'ouvrage du photographe Ambroise Tézenas, Le tourisme de la désolation, en fait partie. Son travail s'est articulé autour des sites emblématiques du « tourisme noir » et de la fascination des visiteurs pour ces endroits.
Cependant, qu'englobe cette notion de « tourisme noir », ou celle de « tourisme sombre » ou encore de « tourisme de mémoire » ? Ces appellations, qui devraient englober le même phénomène, sont pourtant floues et recouvrent des réalités bien différentes. Un facteur les lie cependant tous : ce tourisme est associé aux plus grandes tragédies de l’histoire de l’humanité ou plus largement à des sites associés à la mort historique, accidentelle et/ou massive. Il est souvent en lien avec l’histoire locale du pays et associé à une catastrophe naturelle, un mémorial ou un camp de concentration. Un fait divers peut aussi entrainer le développement d’un tourisme noir plus immédiat. Ainsi, la frontière entre le tourisme voyeuriste et réel travail de mémoire est parfois fragile, aboutissant à des pratiques toujours plus extrêmes. Les raisons ? Des propositions toujours plus variées de la part des tour-opérateurs face à l’attraction des touristes amateurs de « sensations fortes ». Un véritable marché s’est construit autour de cette question du tourisme noir : les sites de catastrophes industrielles, écologiques, des génocides sont autant de lieux qui attirent. Les sources scientifiques sur le tourisme noir sont rares mais se multiplient néanmoins à travers l’actualité et les médias, qui saisissent les tendances actuelles de ce tourisme, massif mais singulier. L'année 2014 était ainsi l'année du tourisme de mémoire en lien avec le Centenaire de la Première Guerre Mondiale.
Qu'est-ce que le tourisme noir ?
La terminologie de « tourisme noir » (dark tourism) n’est apparue qu’en 1996 avec les travaux de John Lennon et Malcom Folley qui le définissent comme « l’acte de voyager vers des sites qui sont associés à la mort, à la souffrance et au macabre ». L’étude d’un tel phénomène est donc très récente et les recherches réalisées ne permettent pas une vision exhaustive de la question du tourisme noir, tant elle englobe des réalités larges et des formes prises diversifiées. Les formes les plus courantes et les plus pratiquées se tournent davantage vers les lieux où des structures mémorielles ou muséales ont été installées suite aux évènements qui s’y sont produits. Cela concerne les lieux de catastrophes écologiques et humaines comme Hiroshima, Tchernobyl ; les lieux de génocide comme les camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale, les lieux du génocide du Rwanda ; les champs de batailles historiques (lieux de bombardement), et les lieux d’attentat ou d’assassinat. John Lennon et Malcom Foley soulignent aussi l’émergence d’un tourisme noir concernant des évènements actuels vers des zones de conflits ou des zones à risques (on parle alors de risk tourism).
Il est pourtant possible de se demander : Pourquoi conserver de tels lieux ? Quelle place ces sites ont-ils dans le paysage culturel ? Comment les conserver et élaborer des dispositifs de médiation auprès du public ?
Pourquoi conserver ?
Les questions relatives à la conservation des sites liés à la mort et/ou à des évènements historiques dévastateurs s’avèrent souvent complexe. Pourquoi conserver des lieux symbolisant la barbarie de l’homme à son paroxysme ou des lieux de mort massive ? Tout d’abord car la conservation de ce « patrimoine sombre » assurerait untravail de mémoire : la présence de ces sites attestent des évènements et évite la négation du passé pour les générations futures. Avant d’être touristiques, ces sites sont avant tout des témoignages de l’Histoire de l’Humanité. Ils appartiennent à une notion de patrimoine élargi dont la portée historique et mémorielle est fondamentale. Leur conservation semble donc primordiale pour garder des témoignages matériels des évènements passés. Cette présence physique des sites constitue une mise en garde sur les conséquences tragiques des gouvernements totalitaires. C’est certainement dans cette perspective que le souci d’authenticité de ces sites a été si important en Europe.
Ainsi, des institutions mondiales comme l’UNESCO prennent en compte, depuis le début du XXèmesiècle, ce patrimoine lié à la mort. En 1979, le camp d’Auschwitz est par exemple inscrit au patrimonial mondial de l’UNESCO rappelant que l’idée de « culture » de l’UNESCO n’est pas réservée aux témoignages positifs de l’Histoire de l’humanité. Concernant le camp de concentration d’Auschwitz, l’UNESCO spécifie l’aspect authentique du site : « Le site et son paysage représentent un haut niveau d'authenticité et d'intégrité d'autant que les preuves originelles ont été soigneusement conservées, sans aucune restauration superflue ». Mais ce souci de conserver l’état originel du lieu est assez récent. Birkenau, jusque dans les années 90, est laissé en friche, la végétation envahit tout l’espace. Ce n’est qu’après qu’un entretien systématique de la végétation a été organisé afin de garder l’aspect du camp tel qu’il était lors de son fonctionnement.
Le problème qui se pose aujourd’hui pour le camp est celui de la conservation des objets exposés en raison de leur valeur mémorielle forte. Les chaussures, les cheveux, les valises doivent bénéficier d’un entretien spécifique comme d’autres collections de musée car ils subissent les effets du temps : les cheveux blanchissent et les couleurs des objets se délavent. Depuis 1993, toutefois, des étudiants s’occupent de la conservation préventive de ces « objets » singuliers, de façon toujours plus scientifique. Le nettoyage est privilégié plutôt que la véritable restauration, rendant un état presque originel aux objets. Les problématiques de conservation abordées à travers cet exemple sont valables pour un grand nombre de sites liés au tourisme de mémoire. Mais la question de la conservation est souvent liée aux politiques et considérations patrimoniales locales.
Quelle médiation pour dire l'innomable ?
Ensuite se pose la question de la médiation au public : comment la politique des publics de ces sites est-elle gérée ? Quel message de tels lieux peuvent / doivent transmettre ? La visite d’un lieu de mémoire est une expérience particulière qui mêle le rapport au lieu, à l'Histoire, à la mémoire et dans laquelle les dispositifs de communication et de médiation jouent leur rôle. Aujourd’hui, en France et majoritairement en Europe, le but affiché de la plupart des lieux de mémoire est de permettre au public de comprendre le plus objectivement possible l’histoire à travers celle du site. L’effort est donc mis sur la qualitépédagogique du propos historique, et sur la mise en œuvre des outils de médiation (expositions, ateliers, audioguides, livrets de visite, applications multimédia, etc.).
La documentation visuelle (photographie, visites guidées ou explications données aux visiteurs) demeure capitale en tant que rappel historique, remémoration et archive documentaire. En effet, les structures se retrouvent confrontées aux limites du langage face à la description des drames qu’ont connus certains lieux. Cette impuissance àdécrire ces évènements se retrouve dans l’ouvrage d’Ambroise Tézenas qui réutilise les brochures touristiques pour accompagner ses photographies. Un visuel reste toujours plus authentique et parlant que le discours. L’image est importante puisqu’elle permet d’approcher une réalité historique. En revanche, l’utilisation répétitive d’images crues et violentes (victimes, fosses communes, trains de déportés) peut à la longue produire un effet d’accumulation obsessionnelle et de fascination morbide qui estompe le sujet jusqu’à lui ôter sa réalité (Lanzmann, 1995). De fait la constante remémoration du passé présente en elle-même un danger, en particulier dans le cas d’une tentative de manipulation ou d’une tendance à la schématisation, qui risque de rabaisser ou de banaliser la somme immense de questions que pose ce passé.
Les sites eux-mêmes semblent représenter la réalité, et la tâche du commentateur est alors d’une importance essentielle. En effet, c’est lui qui va permettre ou non au public de faire la différence entre le vrai et le faux, la réalité et la reconstitution. Ambroize Tézenas met d’ailleurs en garde sur la subjectivité du discours tenu. Selon George Steiner (2010), il vaut mieux « ne pas ajouter la futilité du débat littéraire ou sociologique à l’indicible ». Toutefois se taire, ne pas porter témoignage ni décrypter ces données pose aussi la question d’un éventuel décalage, qui pourrait inciter les générations futures à ignorer ou a oublier ce qu’ont produit ces tragiques évènements ou ces terribles périodes de l’histoire de l’humanité. La médiation dans les lieux représentatifs du tourisme noir est donc complexe : elle relève du sensible, de la conscience collective mais aussi de l'Histoire et de la mémoire. Il n'y a pas de solution idéale, les réflexions sur la transmission et l'ouverture au public de ces lieux doivent être constantes pour ne pas enfermer ces endroits sous la chape du tourisme.
Les dérives du tourisme noir
Une dernière réflexion s'oriente davantage sur les dérives possibles de ce tourisme noir. Les touristes sont toujours plus nombreux à visiter les camps de concentration, les lieux de génocide ou de guerre. Le tourisme de mémoire relève-t-il aujourd’hui de l’industrie du tourisme de masse ? Se posent alors des questions d’ordre éthique et moral : quel équilibre trouver entre l’exploitation d’un site touristique et le respect dû à un lieu sensible ? Dans certaines régions, le tourisme de mémoire constitue un « complément » de l'offre touristique traditionnelle, contrairement à d’autres comme la Normandie ou la Lorraine, où ce type de tourisme va être le seul élément structurant pour le territoire, avec un nombre de visiteurs important. Les chiffres de fréquentation des lieux de mémoire ne cessent d’augmenter, tandis que s’éloigne l’événement historique dont il témoigne. Mais au delà de cet afflux de tourisme quelles sont les dérives possibles ? L'exemple d'Auschwitz-Birkenau est surce point très révélateur. En raison de sa taille importante (le plus vaste des ensembles de camps de concentration), Auschwitz est devenu le symbole des camps de concentration, de la « solution finale ».
Le visiteur qui vient au camp arrive souvent avec un bagage de connaissances important sur la question des camps de concentration et une mémoire visuelle commune diffusée par tous les médias. Les images des camps ne « surprennent » plus, c’est le fait de venir au véritable endroit qui compte. Inéluctablement, au fil des années, un tourisme de masse s’est développé pour ce site, ayant accueilli vingt-cinq millions de visiteurs depuis son ouverture, posant de nombreuses problématiques. Cela change notamment le rapport à ce site et sa signification : il s'agit aujourd'hui d'un "produit d'appel", tous les tours-opérateurs proposant un tour en Cracovie incluent la visite d’Auschwitz. C’est même la première destination des tour-opérateurs organisés par la Cracovie, comme Cracow City Tour. La visite est organisée, depuis le transport, le « repas juif typique », jusqu’à la visite dans les camps, le tout étant payant. Cette multiplication du tourisme vers le site d’Auschwitz suscite de nombreux débats. Comment empêcher le camp de concentration de devenir un lieu hautement touristique, perdant presque toute sa force mémorielle ? Il ne s’agit en aucun cas de fermer les lieux, mais de repenser le discours et la visite du camp.
Les organismes de tourisme transmettent parfois un discours historique biaisé, à la limite de la caricature. En effet, les clichés sont entretenus dans certaines boutiques touristiques : sur la place centrale de Varsovie, le visiteur peut acheter une représentation d’un Juif du ghetto avec un nez crochu et même un sac rempli de monnaie à la main. Est-ce entretenir la mémoire juive que de marchander de telles représentations ? Des compagnies de bus utilisent même de façon ironique l’Histoire pour lutter contre la concurrence en arborant des slogans comme : « Auschwitz ? Avec un ticket retour ? Depuis le centre ville ? Oui c'est possible ». La concurrence touristique aboutit ainsi à des absurdités, loin de toute perspective commémorative. Mais le plus alarmant réside dans le discours historique proposé lors des visites, qui ne respecte pas l’histoire précise du camp. Certains blocs ne sont pas montrés, tous les déportés sont présentés de la même manière (Juifs, Polonais, Russes,Tsiganes) au point de faire l’amalgame entre déportation et extermination : aucune nuance n’est présentée.
L'entretien des sites
Parallèlement, le tourisme massif ne suffit pas pour entretenir le camp, menaçant la disparition de ce témoin de l’Histoire de l’humanité. Une fondation a été crée en 2010 afin de récolter des fonds importants, soit environ 120 millions d’euros. Par ailleurs, certaines voix se font entendre pour que Birkenau redevienne une friche, ce qui semble presque impensable face à la muséification toujours croissante du lieu et le nombre grandissant de visiteurs. Peut-être la solution est-elle autre, dans le renouvellement de l'expérience de visite. George Didi-Huberman, dans son ouvrage Ecorces, développe son ressenti de la visite du lieu et ses questionnements par rapport à son travail photographique. Il parle de l'impact du lieu, de sa force et de sa symbolique. Le camp de concentration a été presque entièrement détruit dont les fours crématoires et l'identité du lieu réside aujourd'hui dans les vestiges. Pour ces raisons, comme le dit George Didi-Huberman : « c'est pourquoi le sol revêt une importance pour le visiteur de ces lieux. Il faut regarder comme regarde un archéologue : dans cette végétation repose une immense désolation humaine ; dans ces fondations rectangulaires et cet amas de briques repose toute l'horreur des gazages de masse ». Ainsi, ne faudrait-il pas voir ce site comme un musée mais comme un lieu témoin et un lieu de mémoire ? Le camp en lui-même a une force qualifiée par George Didi-Huberman comme étant une force «inouïe», une force de «désolation, de terreur». Ce genre de problématiques se retrouve dans d'autres sites liés au tourisme noir. Ainsi l’exemple d’Auschwitz est-il particulièrement révélateur des enjeux que soulève le développement du tourisme noir qui sont aussi bien sociétaux, éthiques et patrimoniaux.
Ce tourisme noir ou tourisme de mémoire s’est imposé progressivement après la Seconde Guerre mondiale afin de ne pas reproduire les erreurs du passé. Ce but a été atteint en partie grâce à la reconnaissance et la conservation des sites. Dans cette volonté de transmission, ces espaces ont été ouverts au public et enrichis d’une médiation, parfois insuffisante. Dans ce même mouvement, des lieux de mémoire ont été créés de toute pièce, pour pallier l’immatérialité des évènements comme le musée de l’Apartheid et le musée juif de Berlin. Il s’agit, pour ces lieux si différents, d’encourager le devoir de mémoire, de mettre en garde face aux dérives idéologiques, d’avoir un discours historique juste et exhaustif pour ne pas tomber dans la curiosité malsaine ou le sensationnel. Comme le dit George Didi-Huberman sur le camp d'Auschwitz-Birkenau, « un lieu comme celui-ci exige de son visiteur qu'il s'interroge », le visiteur doit être encouragé dans sa réflexion, déconstruire les clichés.
T. Rin
Crédit photo : Télérama, décembre 2011
#tourismenoir #mémoire #auschwitz
Pour aller plus loin :
- J. Lennon et M. Foley, Dark Tourism, the attraction of death and disaster, 2000, éditions Continuum
- G. Bensoussan, Auschwitz en héritage, d’un bon usage de la mémoire, 1998, Paris, éditions Mille et une nuits
- J. Assayag (sous ladirection de), La sismographie des terreurs, Ghradiva n°5, 2007, Musée du Quai Branly
- A. Wieviorka, Auschwitz, la mémoire d’un lieu, 2012,Paris, éditions Fayard
- H. Prolongeau, « Auschwitz, la mémoire étouffée par le tourisme de masse », décembre 2011, Télérama
- G. Didi-Huberman, Ecorces, 2011, Les éditions de minuit

Les « Tableaux Fantômes » du musée Benoît-de-Puydt
Il est coutumier pour les musées d’exposer un évènement passé, une tradition oubliée, des techniques ou savoirs faires anciens, une période révolue ou méconnue… En revanche, matérialiser des œuvres d’art disparues est bien moins fréquent. Le musée Benoît-De-Puydt a pourtant choisi de consacrer une partie de son parcours permanent aux « Tableaux Fantômes », détruits lors de la Première Guerre mondiale…
Image d'introduction : Des tableaux fantômes ? © Doriane Blin
Un bref historique du musée
Benoît-De-Puydt naît en 1782 et décède à Bailleul en 1859. Riche collectionneur, il détient une importante collection d’art, de cabinets de curiosités et de céramiques. N’ayant aucun héritier, il lègue l’entièreté de sa collection ainsi que sa maison à la ville de Bailleul. Et ce, sous deux conditions, la première : créer une académie de dessin, de peinture et d’architecture, la seconde : que l’on donne une messe en son honneur tous les ans. Ses prescriptions seront respectées : l’académie et le musée ouvrent en 1861. Grâce au legs de Louis- Henri Hans, de nouvelles œuvres intègrent les collections du musée. Edward Swynghedauw, conservateur du musée de 1881 à 1912, effectue un travail d’inventaire particulièrement précis. Il décrit avec minutie les 133 œuvres de ce legs et référence leurs dimensions exactes.
Mais en 1914, la Première Guerre mondiale éclate. La ville de Bailleul, non loin du front, est géographiquement inquiétée par les offensives allemandes. Cependant, durant les trois premières années de conflit, le musée continue d’accueillir des visiteurs. Ce n’est qu’en 1918 que la population fuit Bailleul et laisse la ville uniquement peuplée de soldats. Le musée est alors contraint de fermer ses portes. En février 1918, le lieutenant Fernand Sabbaté est dépêché par le Service de protection des œuvres d’arts du front Nord pour faire état de la situation. Il décide d’évacuer la collection. Fernand Sabbaté revient avec seulement deux camions pour évacuer les œuvres. A l’époque, le bois manque pour réaliser les caisses de transport. Il est impossible de sauver l’entièreté de la collection. Priorité est donnée notamment aux cabinets flamands, tandis que d’autres œuvres restent sur place et connaitront leur perte le 22 mars 1918 lors du bombardement de la ville. Le musée est intégralement détruit. Outre les œuvres pillées, celles restées sur place ne sont plus que décombres parmi les ruines du bâti. Après une évaluation des dommages de guerre, il est question de trouver un nouveau lieu pour accueillir les œuvres sauvées, évaluées entre 10 et 20% du total de la collection initiale.
Le musée Benoît-De-Puydt est aujourd’hui installé dans un bâtiment reconstruit par Maurice Dupire, au même emplacement que l’ancien musée.

La façade du musée aujourd’hui © Justine Thorez, musée Benoît-De-Puydt
Exposer des « Tableaux Fantômes » ou redonner vie à des œuvres disparues
L’histoire du musée Benoît-De-Puydt ne s’arrête pas là. A partir de l’inventaire d’Edward Swynghedauw retrouvé en 1990, Laurent Guillaut propose d’exposer les œuvres disparues : il fait écrire sur des panneaux de mêmes dimensions que les œuvres originelles, leur description, telle une incarnation de leur disparition. Ces « Tableaux Fantômes » prennent alors place aux côtés d’autres ayant pu être conservés.

Salle des « Tableaux Fantômes » © Justine Thorez, musée Benoît-De-Puydt
Comment expliquer ce choix d’exposer le disparu ? Nous avons interviewé Chloé Jacqmart, chargée de développement et des publics au musée Benoît-De-Puydt.
Pouvez-vous commenter l’initiative d’exposer les « Tableaux Fantômes » dans le musée ? Quel message y-a-t-il derrière cet accrochage ? Quel parti-pris muséographique ?
Chloé Jacqmart : L'initiative est celle de Laurent Guillaut, conservateur des musées Benoît-De-Puydt et de Cassel entre 1991 et 2000.
Cette démarche avait notamment pour volonté de marquer l'histoire de la Grande-Guerre dans un musée reconstitué à l'image d'une maison de collectionneur. Au sein d'un musée dont les espaces de présentation des collections rappellent celui d'un intérieur bourgeois du XIXe, les « Tableaux Fantômes » rappellent l'histoire plus contemporaine et l'impact non seulement sur les collections, mais sur la ville et le territoire. Le parti-pris muséographique est celui d'un intérieur de maison de collectionneur reconstitué, mais également réinventé. Les descriptions des œuvres disparues ne sont pas seulement visibles du public, elles sont présentées comme pourraient l'être les œuvres si elles faisaient encore partie du fonds. Elles n'accompagnent pas les collections, elles incarnent les collections.
C'est également, de manière peut-être plus indirecte, une manière de mettre en lumière le travail exceptionnel de description réalisé par Edward Swynghedauw, second conservateur du musée et directeur de l'Académie de peinture, dessin et architecture Benoît-De-Puydt, qui maîtrisait aussi bien la plume que le crayon. Il décrit les objets du musée tel un naturaliste, et c'est une approche scientifique et méthodique des collections à un instant T dont les « Tableaux Fantômes » sont aujourd'hui le témoin.
« Sur une pelouse, devant un épais massif de verdure, près d’un piédestal surmonté d’un grand vase de fleurs et qui occupe le premier plan de droite parmi des fleurs variées, tout un groupe de petits garçons, au nombre de neuf, s’amusent à faire monter un ballon que l’un d’entre eux tient par la ficelle. Devant celui-ci un petit chien blanc taché de brun aboie après le joujou qui est de diverses couleurs et qui a le don d’amuser singulièrement ces enfants. »
Description de l’une des œuvres aujourd’hui disparue par Edward Swynghedauw
Comment se nomme la salle dans laquelle se trouvent les « Tableaux Fantômes » ?
C. J. : Cette salle n'a pas de nom en particulier, si ce n'est salle B, mais il s'agit d'un repère pour le parcours de visite. En revanche la situation du mur qui présente les « Tableaux Fantômes » au rez-de-chaussée fait partie intégrante du parti pris muséographique de l'ensemble de ce niveau, à savoir une immersion au cœur d’un musée de la fin du XIXe siècle-début du XXe siècle. La naissance du concept des « Tableaux Fantômes » est certes postérieure à ce type de muséographie mais la collection concernée fait partie du fonds antérieur au conflit de 14-18, et de fait l'incarnation de la disparition fait sens dans cet espace musée-maison de collectionneur réinventé.
Le nombre de tableaux disparus est considérable. Savez-vous pourquoi ceux exposés ont été choisis ?
C. J. : Pour ce qui est des œuvres exposées sur le mur présentant les « Tableaux Fantômes », le choix s'explique dès l'origine du projet. Le choix de Laurent Guillaut se porte sur le Legs Louis-Henri Hans (1879), constitué d'une centaine d'objets et dont il reste après la guerre seulement 5 tableaux et 1 bénitier en ivoire. Les notices incarnant les « Tableaux Fantômes » sont une partie des œuvres de ce legs.
Je ne pourrais malheureusement pas me prononcer sur le choix de M. Guillaut, mais à mon sens cet ensemble renforce le propos et le message en ce qu'il représente l'importance de la disparition en s'appuyant sur une partie de la collection : les 6 objets sauvés face à la centaine initialement léguée et présentée au sein du musée avant 1918 illustrent particulièrement bien l'ampleur des pertes subies.
Que vous évoque, personnellement, ce choix d’exposer « matériellement » le disparu, la perte ?
C. J. : Au même titre que de nombreux ensembles, monuments, commémorations, etc. qui découlent de la Grande-Guerre, les « Tableaux Fantômes » contribuent au travail de mémoire, leur existence directement due à cet événement. Ce choix d'exposer est également à mon sens une forme de représentation de ce qu'est un musée, de son rôle : au-delà de la fonction de conservation, il interroge la place et la trace des objets. Lieu de délectation le musée est aussi un lieu de réflexion qui se doit d'interroger l'évolution des sociétés dont il conserve les vestiges.
Les « Tableaux Fantômes » font prendre une toute autre dimension aux œuvres disparues et en modifient le statut, et de fait le rapport qu'elles ont avec le spectateur. Mais bien qu'elles ne soient plus visibles, ces œuvres disparues conservent un rapport avec l'esthétisme, créé par l'ensemble des impressions graphiques présentées comme des œuvres, et à travers l'imagination suscitée par les descriptions. Le rapport à l'image est différent mais toujours présent.
Les « Tableaux Fantômes » sont aujourd'hui une étape incontournable de la visite et font partie intégrante du parcours permanent du musée. Outre les témoins et marqueurs de l'histoire du musée, ces « Tableaux Fantômes » font aujourd'hui partie de son identité, et de l'expérience qu'il fait vivre à ses publics.
Ce choix muséographique provoque-t-il des réactions de la part des visiteurs ? Si oui, quelles sont-elles ?
C. J. : Les visiteurs sont très souvent intrigués par cette présentation et, curieux d'en savoir plus, ils apprécient d'échanger avec la personne assurant l'accueil ou les médiateurs présents. Éclairés sur l'histoire du musée, ils appréhendent différemment les lieux et les collections.
Une réinterprétation par des artistes contemporains
Non seulement les « Tableaux Fantômes » deviennent eux-mêmes des objets de collection en ce qu’ils sont exposés ainsi au sein du musée, mais ils deviennent support à l’écriture d’une nouvelle page de l’histoire. Sur l’initiative de Luc Hossepied, en 2018 – centenaire de la Grande Guerre - des artistes contemporains réinterprètent les tableaux et donnent naissance à de nouvelles œuvres d’art. Valorisées à l’occasion de l’exposition itinérante intitulée « Les Tableaux Fantômes » à travers les Hauts-de- France, les œuvres ont été accueillies dans 8 institutions, parmi elles : la médiathèque de Bailleul, le Muba, la Bibliothèque du Fort-de-Mons ou encore la Piscine de Roubaix… Les visiteurs ont pu admirer 91 créations contemporaines toutes inspirées des précieuses descriptions d’Edward Swynghedauw et respectant le format des œuvres initiales. Le commissariat de cette exposition a été assuré par Luc Hossepied, Eric Rigollaud, Nicolas Tourte et Sylvette Botella-Gaudichon.
Comment est né le projet de réinterprétation de ces œuvres par des artistes contemporains ? Que cela signifie-t-il pour le musée et pour la ville de Bailleul ?
C. J. : Le projet a été imaginé et initié par des acteurs extérieurs au musée, preuve non seulement que le concept et l'histoire des « Tableaux Fantômes » laissent difficilement indifférent mais qu'il inspire et invite à réfléchir, réagir, et créer.
C'est aussi une forme de manifestation de l'appropriation de notre Histoire contemporaine sous forme de création artistique, via les différentes empreintes qu'elle laisse et qu'elle invite à explorer. La création, l'interprétation et la réinterprétation se mêlent et contribuent à écrire l'histoire du musée et de la création artistique.
Se rencontrent ici des écoles artistiques, des pratiques artistiques, des contextes de créations, des inspirations, etc. L'art est constamment en mouvement et rarement (voire jamais) en rupture totale avec le passé, et une histoire comme celle des « Tableaux Fantômes » écrit une histoire de l'art à travers le temps.
Il ne s'agissait pas de combler un manque mais bien d'écrire une nouvelle histoire en s'inspirant de ce qui a été. Pour le musée, ces œuvres contemporaines symbolisent le lien entre création artistique et patrimoine. Elles sont également une nouvelle page de l'histoire des œuvres disparues et de l'histoire du musée.
Nous remercions Chloé Jacqmart pour son éclairage sur l’histoire des collections du Musée Benoît-De-Puydt qui continue de s’écrire.
Pour aller plus loin :
- Le site internet du musée : https://www.musee-bailleul.fr/
- Cloé Alriquet, plateforme des médiations muséales : http://www.plateforme-mediation-museale.fr/mediations/salle-des-tableaux-fantomes
- Reportage de France 3 : les tableaux fantômes, exposés à la Piscine de Roubaix : https://www.youtube.com/watch?v=JicI_9qypnI&ab_channel=France3Hauts-de-France
#TableauxFantômes #Benoît-De-Puydt #Bailleul

Les lieux de Mémoire de la Shoah
Le Dictionnaire de la Shoah publié chez Larousse en 2015 soulève que «les mémoriaux et les musées de la Shoah sont d'excellents révélateurs de la difficulté de constituer l'histoire de l'extermination et de sa mémoire» (p. 350). Bien des espaces sont dédiés à la mémoire de l’Holocauste : d’une part, les plaques commémoratives apposées sur la façade d’établissements scolaires et les Monuments aux Morts (monument aux Martyrs de la Résistance d’Épernay, monument aux Héros du Ghetto de Varsovie), d’autre part, les mémoriaux accompagnés d’un centre d’informations (Berlin), les mémoriaux de la Shoah qui organisent des expositions permanentes ou temporaires (Paris, Jérusalem…), les lieux de l’horreur devenus musées (Auschwitz-Birkenau, Maison Anne Franck), et les nouveaux musées du Judaïsme (Paris, Berlin, Amsterdam…) qui abordent logiquement le sujet. Par rapport à tous ces lieux, comment un Mémorial de la Shoah se positionne-t-il entre hommage et devoir de mémoire, avec quelles fonctions et surtout avec quels procédés muséographiques, scénographiques et architecturaux pour rendre compte à la fois de l’Histoire passée et du futur à éviter, tout en s’adressant au Présent ?
Image d'introduction : Monument en l'honneur des soldats et partisans juifs qui combattirent contre l'Allemagne nazie à Yad Vashem, Jérusalem (Avishai Teicher, Creative Commons)
Les fonctions d’un Mémorial de la Shoah : le cas d’Auschwitz
Après 1945, certains lieux de l’horreur sont devenus des musées plus ou moins rapidement. Le Musée national Auschwitz-Birkenau a ainsi ouvert dès juillet 1947 suite à l’investissement des lieux par un groupe d’anciens détenus polonais souhaitant « sauvegarder la mémoire des victimes d’Auschwitz [et] protéger les vestiges des installations. Ce groupe parvint à organiser ce qui s’appelait à l’époque la Préservation Permanente du Camp d’Auschwitz et à accueillir les milliers de pèlerins qui affluaient massivement, à la recherche de traces de leurs proches, pour prier et rendre hommage aux victimes. »
«Déjà à l’époque de la création du musée [d’Auschwitz-Birkenau] on se demandait s’il fallait uniquement décrire le passé ou bien expliquer et étudier les principaux mécanismes du système criminel concentrationnaire. Avaient été alors avancées des propositions extrêmes, qui allaient du labourage du site à la sauvegarde et à la préservation de tout ce qu’il serait possible de conserver.
Autre sujet de débat, toujours actuel : l’appellation du musée. Tout le monde n’accepte pas le terme de «Musée d’Etat d’Auschwitz-Birkenau». Les uns estiment que le camp est d’abord un cimetière ; les autres, qu’il s’agit d’un lieu de mémoire, d’un monument ; d’autres encore pensent que ce lieu devrait être un institut de mémoire, un centre d’éducation et de recherche sur le destin des personnes qui y trouvèrent la mort. En fait, le musée remplit toutes ces fonctions, qui ne s’excluent pas mais, au contraire, se complètent.» Auschwitz-Birkenau : Histoire et Présent (2008)
Les Mémoriaux de la Shoah ont la particularité d’être entièrement gratuits là où d’autres, comme les Mémoriaux des Guerres mondiales (Caen, Verdun…) proposent des grilles tarifaires. Généralement, seules les visites guidées pour les groupes sont payantes.
Des récurrences iconographiques : les Monuments aux morts

Monument aux héros du ghetto, Varsovie, Pologne (Creative Commons)
Un Monument aux morts est une construction (sculpture, statue, voire plaque…) visant à commémorer le souvenir des victimes d’un conflit ou des soldats morts pour la Nation. L’édifice reprend souvent les noms des martyrs et est généralement situé à proximité du lieu de l’événement (un champ de bataille par exemple), d’un cimetière, d’une mairie ou sur une place publique. En France, cette forme d’hommage se généralise après la Première Guerre mondiale.
Les Monuments érigés en mémoire des Juifs victimes du régime nazi reprennent souvent les mêmes éléments iconographiques. Le chandelier (Ménorah) est une référence à la fête de Hanouccah, littéralement « Fête des Lumières », qui commémore la révolte des Maccabées en Judée (175 à 140 av. J.-C.) et le « miracle de la fiole d’huile » qui métaphorise l’idée d’une lumière éternelle dans un monde où le peuple juif est menacé. Le lion est quant à lui l’emblème traditionnel de la tribu de Judah (Yehouda), quatrième fils de Jacob selon la Bible, destinée à régner sur la Terre Promise. Étymologiquement, le terme « juif » (Yehoudi) vient donc du nom de cette lignée royale. Enfin, les textes présents sur les Monuments de l’Holocauste sont généralement rédigés en hébreu moderne et en yiddish, langue des juifs d’Europe de l’Est.
Des récurrences muséographiques et scénographiques : le Mémorial qui se dénomme comme tel
Le Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe de Berlin (2005) a la particularité de proposer un « centre d’information » qui se rapproche finalement beaucoup des Mémoriaux de la Shoah de Paris, Milan ou Jérusalem dans le sens où celui-ci propose une exposition permanente et des expositions temporaires. La différence entre eux réside dans leurs fonctions et dans la construction de leur parcours.
Le Dictionnaire de la Shoah explique que « la nouvelle génération de musées […] sont en même temps des centres de recherche et de documentation sur la Shoah, à Jérusalem et Paris (2005), Budapest (2006), Sydney, (2004), à la suite du précurseur United States Holocaust Memorial Museum de Washington (1993) ». Ainsi, le Mémorial de la Shoah de Paris remplit les missions suivantes : recherche-documentation, édition, expositions et activités culturelles, activités pédagogiques et actions de formation, activités hors-les-murs… et organise aussi des groupes de parole et des voyages sur les lieux de mémoire.
Ces « mémoriaux-musées » possèdent aussi des collections qui leur sont propres : documents d’archives, ressources audio et/ou visuelle (fonds photographique, témoignages recueillis après-guerre…), et objets à forte valeur historique, symbolique et émotionnelle (étoile jaune, uniforme de déporté…).
Certains éléments muséographiques et scénographiques se retrouvent dans la majorité des Mémoriaux de la Shoah à travers le monde. Les Murs des Noms reprennent les (longues) listes des personnes déportées en Pologne depuis la ville du mémorial et sont parfois accompagnées de leurs années de naissance.

À gauche : "Mur des noms" du Mémorial de la Shoah, Paris © Dario Crespi, Creative Commons
À droite : "Mur de noms" du Mémorial de la Shoah, Paris © Ninaraas, Creative Commons
Certains mémoriaux mettent en scène les photographies des hommes, femmes et enfants assassinés sur de grands murs qui dépassent largement le visiteur. Des milliers d’yeux le regarde et les sourires figés glacent le sang.

À gauche : "Salle des noms" de Yad Vashem, Jerusalem © Berthold Werner, Creative Commons
À droite : "Mémorial des Enfants" clôturant l'exposition permamente du Mémorial de la Shoah, Paris ©BrnGrby, Creative Commons
Les Mémoriaux de la Shoah prennent aussi à cœur leur devoir d’hommage aux « Justes parmi les nations ». Ce titre est décerné par Yad Vashem (Institut International pour la mémoire de la Shoah, Jérusalem, 1953) au nom de l’Etat d’Israël et répond à « l'obligation éthique [d’Israël] de reconnaître, d’honorer et de saluer, au nom du peuple juif, les non-juifs qui, malgré les grands risques encourus pour eux-mêmes, ont aidé des juifs à un moment où ils en avaient le plus besoin. » (loi relative à la commémoration des martyrs et des héros, dite loi Yad Vashem de 1953). Pour cela, chaque Mémorial utilise un ou plusieurs systèmes honorifiques : Mur des Justes, Allée des Justes, Jardin des Justes… Une partie du Jardin des Justes de Yad Vashem est ainsi dédiée aux habitants de la commune de Chambon-sur-Lignon qui ont collectivement accueilli des centaines de Juifs fuyant les persécutions entre 1940 et 1944.

À gauche : "Crypte du souvenir" de Yad Vashem, Jerusalem © Berthold Werner, Creative Commons
À droite : "La crypte" du Mémorial de la Shoah, Paris ©BrnGrby, Creative Commons
Enfin, les Cryptes accueillent les cendres de victimes de la Shoah pour permettre le recueillement solennel, voire la prière.
Pour aller plus loin :
- Bensoussan, G., Dreyfus, J. M., Husson, E., & Kotek, J. (2015). Dictionnaire de la Shoah. Larousse. « A Présent ». 656 p.
- #mémoire #mémorial #secondeguerremondiale

Les musées au Cambodge, une situation précaire
Sorti de son isolement géopolitique, le Cambodge s’engage dans un développement économique et humain dont le tourisme est l’une des pierres angulaires. Quelle place peuvent avoir les musées dans cet espace en pleine évolution ?
Cour du Musée national du Cambodge © Julien Tea
La crise sanitaire du COVID-19 a profondément marqué la société cambodgienne, dont l’économie est principalement axée sur ses exportations textiles, la construction et le tourisme. Ce dernier secteur représentait 18,7% du PIB national en 2019. Les institutions muséales sont un maillon essentiel de cette « chaîne de valeur » qui, contrairement au cas français, n’a pas fait l’objet d’une politique de soutien d’urgence de la part du gouvernement cambodgien. Dans cette période précaire de chute de la demande touristique, seules les institutions ayant les « reins solides » ou étant adossées à d’autres activités économiques et culturelles ont pu survivre. Les patrimoines angkoriens et mémoriaux bipolarisent le champ culturel et définissent l’identité du Cambodge à l’étranger rendant difficile les tentatives de diversification de l’offre culturelle.
Des musées d’Angkor …
La muséologie cambodgienne est une héritière directe de la muséologie française du début du XXe siècle, époque où sont créées les premières institutions patrimoniales au Cambodge. La toute nouvelle Ecole française d’Extrême-Orient concentre ses activités sur l’immense complexe de temples ruinés de l’ancien empire angkorien, dont il faut dégager l’architecture de la jungle envahissante, et mettre à l’abri la statutaire livrée aux pilleurs (dont l’exemple le plus médiatique est un certain André Malraux…). Le Musée national, inauguré en 1920, répond à la fois à cette nécessité et à la volonté de remettre à l’honneur les arts khmers en construisant conjointement une Ecole des Beaux-Arts dans la plus pure tradition khmère. La muséographie du musée est alors très représentative d’une histoire cambodgienne presque entièrement portée vers la période angkorienne (IXe-XIIIe siècle) qui oblitère la réalité contemporaine du pays. L’aile ethnographique, assez sommaire, n’est mise en place qu’après l’indépendance.
Outre Phnom Penh, plusieurs musées archéologiques de taille très variable ont été ouverts au rythme des découvertes archéologiques, comme le Musée Preah Norodom Sihanouk inauguré en 2015 grâce à l’aide d’entreprises et universités japonaises et présentant les résultats des fouilles du temple de Banteay Kdey. Le musée provincial de Battambang, deuxième musée plus ancien du pays, accueille une exposition sur les fouilles françaises dans les grottes de Laang Spean. Malgré leur discours très hermétique et à visée scientifique, ces musées rencontrent un public nombreux venus expressément visiter les temples d’Angkor.

Musée provincial de Battambang, la statuaire et les colonnades donnent l’impression de rentrer dans un temple angkorien © Julien Tea
… aux musées d’Angkar

Entrée du Musée du génocide – Tuol Sleng © Julien Tea

Premier étage du bâtiment de la prison Tuol Sleng © Julien Tea
A ce pôle muséal célébrant la grandeur passée de l’empire khmer, répond un second pôle axé sur l’histoire du génocide et des atrocités perpétrés par les Khmers rouges et les efforts humanitaires menés dans le pays depuis 1992. A Phnom Penh, un musée du Génocide est créé dès 1979 dans l’ancienne école primaire de Tuol Sleng, rebaptisée prison S-21, où étaient torturés les prisonniers politiques de l’Angkar (de angkar padevat, l’organisation révolutionnaire). Adossée à une visite des Killing fiels, champs où les prisonniers étaient exécutés, la muséographie visait en premier lieu à rendre compte des crimes commis par les Khmers rouges par le biais de chocs émotionnels. Les lieux de mémoire, présents aux alentours des nombreux lieux d’exécution de masse sur le territoire, sont autant de rappels permanents de cette histoire douloureuse et d’éléments d’attraction touristique.
Développement culturel et promotion du développement

Entrée du musée des mines anti personnelles, en dessous de laquelle se trouve une affiche touristique de tir à l’arme automatique © Julien Tea
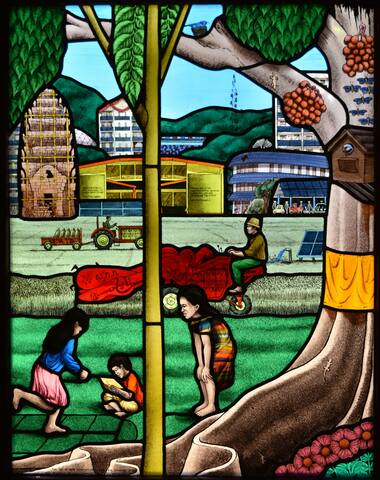
Vitrail du parcours du Cambodian Peace Museum © Julien Tea
Les ONG et organisations internationales se sont également emparées de l’outil muséal pour promouvoir leur action de réconciliation et de développement du pays. Dès 1992, l’ONG franco-cambodgienne Krousar Thmey (Nouvelle Famille) crée des expositions itinérantes touchant tour-à-tour les thématiques de la culture khmère, de la réconciliation nationale et de la préservation de la biodiversité. Les grandes campagnes de déminages sont un sujet privilégié des actions de médiation éducative. Aki Ra, un ancien enfant-soldat reconverti en démineur, décide en 1999 d’ouvrir le Cambodia Landmine Museum qui lui sert autant de source de revenu que d’outil de communication. Un second musée, à la muséographie bien plus immersive et instructive, a été créé par le Cambodian Mine Action Center, organisme étatique chargé du déminage du pays. Enfin, un grand centre d’interprétation, la Cambodia Peace Gallery, fait la promotion du processus de paix au Cambodge et de l’action des peace builders dans le monde. A l’exception du musée d’Aki Ra, présent dans les circuits touristiques, ces musées visent un public local et scolaire dans une optique d’empowerment.
La rentabilité, une boussole prédominante
Extrêmement fragile au sortir du XXe siècle, l’Etat cambodgien n’a pas les moyens de financer la construction ou l’entretien de musées, il fait donc appel à des entreprises privées dont les présidents sont souvent proches du pouvoir. Ainsi, le conglomérat vietnamien Sokimex obtient dans les années 2000 les visas d’exploitation des sites touristiques de la région d’Angkor, avant d’obtenir dans les années 2010 un permis pour le parc national du Bokor. Les efforts sont principalement dirigés vers Siem Reap où se concentre la manne touristique internationale. La recherche de rentabilité pousse les entreprises étrangères à créer des musées toujours plus spectaculaires et axés sur les tempes d’Angkor, comme le Angkor National Museum financé par les frères Vilailuck, actionnaires principaux d’une grande firme de télécommunication thaïlandaise, et qui a fait l’objet de nombreuses critiques pour sa muséographie à la fois spectaculaire et scientifiquement simpliste, ainsi que son aspect de centre commercial. Le Angkor Panorama Museum, sorte de musée panoramique similaire au Musée Panorama 1453 d’Istanbul, est lui symptomatique du mélange entre intérêts privés et géopolitiques : construit et géré par les Studios Mansuade, principale agence artistique d’Etat de la Corée du Nord, le musée a cessé ses activités suite aux sanction onusiennes de 2017. En règle générale, ces créations muséales sont des échecs financiers, les touristes étrangers se satisfaisant déjà largement du Pass hebdomadaire à plus de 100 dollars américains.

Salle des Mille Bouddha du Musée national d’Angkor © Julien Tea
Une légitimation par l’action culturelle
Certaines institutions ou organisation internationales tentent également d’utiliser les musées pour promouvoir leur action, avec plus ou moins de succès. A Siem Reap, la Mekong Ganga Cooperation (association de coopération culturelle regroupant l’Inde, La Birmanie, le Bangladesh, la Thaïlande, le Laos, Le Cambodge et le Vietnam) a créé un musée présentant les pratiques vestimentaires des populations de ses pays membres, avec une visibilité variable des minorités ethniques. Sans véritable soutien scientifique et politique, ce musée fait pour la forme affronte de grandes difficultés dans la constitution de son parcours muséographique. A contrario, le musée Sosoro, construit par la Banque Nationale du Cambodge (BNC) en 2012 et présentant l’histoire de la monnaie et les principes économiques, dénote du paysage muséal par la qualité de son propos scientifique et des espaces interactifs, spécialement dans les séquences liées à la compréhension des outils économiques. Le succès critique de ce musée, a encouragé la BNC à imaginer la création d’un second musée à Battambang (toujours en construction) sur l’histoire de cette région frontalière.

Musée en construction de Battambang dans le quartier historique de la ville © Julien Tea
Les musées cambodgiens revêtent de multiples facettes qui reflètent les enjeux contemporains du pays, entre capitalisme rapace doublé d’un paternalisme culturel, aspiration de la jeunesse au consumérisme, et difficulté à trouver des espaces de libre expression dans un climat de dérive autoritaire. La crise du COVID-19 a révélé la fragilité du modèle économique cambodgien dans le domaine de la culture, première victime de la crise. Personne n’a été épargné, des petits musées provinciaux de Kampot et de Kep au grand parc d’attraction folklorique du Cambodian Cultural Village, sorte de Puy du Fou à la cambodgienne fermé en 2020. Alors que le tourisme chinois n’en est encore qu’à son redémarrage, on peut s’interroger sur la viabilité des grandes institutions survivantes. Qu’arrivera-t-il quand la province de Siem Reap, qui supervise la région d’Angkor, se verra transférer ces nombreux musées pour touristes dont la rentabilité est en berne ?
JT
Pour en savoir plus :
#Cambodge #Tourisme #Muséologie

Libérez les Graphzines !
Deux crayons posés sur la table de l’exposition «Graphzines», depuis le vernissage, racontent le déroulement de l’exposition et de tout ce qu’ils ont vu et vécu, de leurs mines aiguisées.
© photos personnelles
 L’exposition Graphzines fait partie du thema proposé par le LaM, introduite à la fin du parcours de l’exposition principale « L’Autre de l’Art ». Elle s’est poursuivie à la bibliothèque universitaire de Lille 3 et présente, du 14 octobre au 17 décembre 2014, une exposition sur l’univers des graphzines. Le collectif Cagibi, qui a mis en scène cette exposition, a installé une œuvre interactive « Cubi » réalisée en Août 2014 afin de laisser libre expression au visiteur. Ce cube inspiré de celui de Yoshimoto inventé en 1971 est constitué de 8 petits cubes dont les faces peuvent s’assembler et se désassembler selon de multiples combinaisons,pour faire naître des dessins coordonnés. Pour cette installation, des stylos ont été déposés sur la table et mis à disposition des visiteurs ; parmi eux deux stylos célèbres, «Mondrian de Carré d’Arche » et « Charlie Pro Marker ». Nous avons pu enregistrer une de leur conversation datant du 7 décembre 2014aux environs de 14h ; quelques semaines après l’exposition, nous vous proposons une retranscription.
L’exposition Graphzines fait partie du thema proposé par le LaM, introduite à la fin du parcours de l’exposition principale « L’Autre de l’Art ». Elle s’est poursuivie à la bibliothèque universitaire de Lille 3 et présente, du 14 octobre au 17 décembre 2014, une exposition sur l’univers des graphzines. Le collectif Cagibi, qui a mis en scène cette exposition, a installé une œuvre interactive « Cubi » réalisée en Août 2014 afin de laisser libre expression au visiteur. Ce cube inspiré de celui de Yoshimoto inventé en 1971 est constitué de 8 petits cubes dont les faces peuvent s’assembler et se désassembler selon de multiples combinaisons,pour faire naître des dessins coordonnés. Pour cette installation, des stylos ont été déposés sur la table et mis à disposition des visiteurs ; parmi eux deux stylos célèbres, «Mondrian de Carré d’Arche » et « Charlie Pro Marker ». Nous avons pu enregistrer une de leur conversation datant du 7 décembre 2014aux environs de 14h ; quelques semaines après l’exposition, nous vous proposons une retranscription.
Ces deux crayons discutent de l’exposition et des dessins dont ils ont été les acteurs :
Leur conversation a débuté depuis un moment ; « Mondrian de Carré d’Arche » de sa voix suave et inquiète, explique son incompréhension face à l’exposition :
- …non seulement nous ne sommes pas dans une institution muséale reconnue et le peu de moyen mis en œuvre nous confine dans ce petit espace exiguë, mais, en plus, nous sommes relayés dans ce coin sombre. Je souffre.
© photos personnelles

Charlie Pro Marker tente d’apaiser les inquiétudes de son ami)
- Arrête de te plaindre et ouvre les yeux ; on ne voit que nous dans ce hall pâle et lisse, les étudiants s’arrêtent dans cette exposition, s’interrogent et s’attardent. Oui, l’espace est petit et, pour tout t’avouer ce tapis noir au sol me frustre un peu, mais ici, une vraie atmosphère a été créée. La mise en scène est originale, une réelle immersion est proposée dans l’univers, peu connu et décalé, des graphzines.
- Les graphzines parlons–en ! Qu‘est ce que c’est que ces gribouillages saturés ? Impossible de distinguer les œuvres de leurs supports. Il n’y a pas de parcours, pas de flèches, pas de séquences, les gens sont perdus ici, perdus !
- Mais, mon ami, c’est justement ça les graphzines. Les artistes eux même ne veulent pas définir leur travail, ils dessinent sans normes, sans règles ni contraintes, mais avec un seul mot d’ordre : une liberté d’expression totale. Polémique ou poétique, toujours un peu satirique, leurs auteurs apportent un regard nouveau sur nos quotidiens, le monde qui nous entoure et nos sociétés.
- Mais comment veux-tu que je comprenne tout cela ? Rien n’est indiqué, les œuvres, si nous pouvons les nommer ainsi, ne sont pas toutes référencées. Par exemple, celles suspendues par une ficelle colorée, palpables par toutes ces mains moites, et exposées au danger de tous ces microbes humains, d’où viennent-elles ? Tu sais bien toi Charlie Pro Marker, lorsqu’une main étale notre encre encore fraiche anéantissant ainsi la ligne parfaite, le tracé subjectif du dessinateur… Haaaaaa j’en frissonne encore…
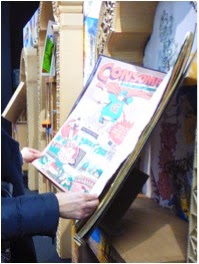 - Mais justement ! C’est ça l’esprit des graphzines : une création spontanée et sans limites. Ils sont issus de bandes dessinées alternatives, qui ne sont pas éditées par des maisons d’édition. D’ailleurs certaines œuvres exposées seront même vendues à des prix très accessibles à la fin de cette exposition ! Photocopiée ou sérigraphiée, c’est ce qui fait l’originalité de chacune, quant aux traces, tant pis, rien ne vaut un libre accès à l’art !
- Mais justement ! C’est ça l’esprit des graphzines : une création spontanée et sans limites. Ils sont issus de bandes dessinées alternatives, qui ne sont pas éditées par des maisons d’édition. D’ailleurs certaines œuvres exposées seront même vendues à des prix très accessibles à la fin de cette exposition ! Photocopiée ou sérigraphiée, c’est ce qui fait l’originalité de chacune, quant aux traces, tant pis, rien ne vaut un libre accès à l’art !
- T’appelles ça de l’art toi ? Personnellement vu les dessins que j’ai vécu ces derniers jours, sur ce maudit cube, je suis loin d’y accéder ou même d’y participer…(Mondrian, éprouvé et ému cherche alors ses mots) …Je pense que je développe le «complexe du blanco», c’est ce qu’on dit dans lemilieu des beaux arts, en parlant de nos confrères sacrifiés au nom de la liberté d’expression et condamnés à dessiner des ignominies sur les tables des lycées.
 - Qu’entends-tu par « ignominies » ? On m’a utilisé pour faire un dessin engagé hier et énormément de messages étudiants ont pu être inscrits au cours de cette exposition. Par nous et sur ce cube s’inscrit l’humour, l’amour, la révolte, des revendications politiques. L’absurde et la pertinence d’un message ne sont pas toujours antinomiques. Laisse-moi te raconter mes expériences passées. (La mine souriante et espiègle Pro Charlie commence son récit). J’en ai dessiné des conneries d’ados révoltés et insouciants. Avant d’être ici, j’ai été longuement utilisé par la main d’un dessinateur de journal satirique. C’est là la force du dessin et de notre travail, faire émerger des messages profonds à travers une liberté totale. Je me souviens de ces réunions en salle de rédaction desquelles je sortais épuisé et vidé d’avoir noirci des pages pour mettre en lumière des idées. Ils ne censuraient aucun symbole et la force émanant du dessin achevé était parfois imprévisible. C’est dans ce sens, que j’apprécie d’être ici, de prôner la liberté d’expression et la non-censure dans un lieu institutionnel et universitaire. L’étudiant qui dessinait, à travers toi, hier, sera peut – être un de ces agitateurs de demain. Laissons les dessiner partout, tout le temps, sur les murs, les tables, les chaises, au stylo et à la craie, de façon absurde, bête, féroce, révoltée : de ces bites naîtront des discours.
- Qu’entends-tu par « ignominies » ? On m’a utilisé pour faire un dessin engagé hier et énormément de messages étudiants ont pu être inscrits au cours de cette exposition. Par nous et sur ce cube s’inscrit l’humour, l’amour, la révolte, des revendications politiques. L’absurde et la pertinence d’un message ne sont pas toujours antinomiques. Laisse-moi te raconter mes expériences passées. (La mine souriante et espiègle Pro Charlie commence son récit). J’en ai dessiné des conneries d’ados révoltés et insouciants. Avant d’être ici, j’ai été longuement utilisé par la main d’un dessinateur de journal satirique. C’est là la force du dessin et de notre travail, faire émerger des messages profonds à travers une liberté totale. Je me souviens de ces réunions en salle de rédaction desquelles je sortais épuisé et vidé d’avoir noirci des pages pour mettre en lumière des idées. Ils ne censuraient aucun symbole et la force émanant du dessin achevé était parfois imprévisible. C’est dans ce sens, que j’apprécie d’être ici, de prôner la liberté d’expression et la non-censure dans un lieu institutionnel et universitaire. L’étudiant qui dessinait, à travers toi, hier, sera peut – être un de ces agitateurs de demain. Laissons les dessiner partout, tout le temps, sur les murs, les tables, les chaises, au stylo et à la craie, de façon absurde, bête, féroce, révoltée : de ces bites naîtront des discours.
- Alors, allons-y, je te suis Charlie. »
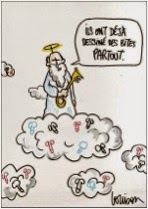
Dessin fait par Louison le 8 janvier 2015 suite aux attentats contre « Charlie Hebdo »
©lanouvelleedition.fr
Cléa Raousset et Margot Delobelle
#graphzine #liberté #expression
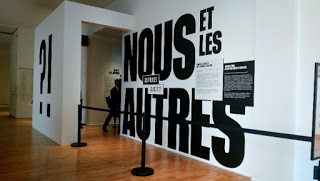
Liberté, Egalité, Préjugés
Lors de sa réouverture en octobre 2015, le Musée de l’Homme annonçait se positionner comme musée agora, le musée au cœur des débats de sociétés. Un an et demi plus tard, le 7 avril 2017, il ouvre sa première grande exposition, Nous et les autres, des préjugés au racisme. Nous sommes à la veille des élections présidentielles, et le musée du Trocadéro inaugure une exposition on ne peut plus ancrée dans l’actualité ! Pari osé ! Pari réussi ? Qu’en est-il ?
Entrée de l’exposition Nous et les Autres au Musée de l’Homme © Juliette Gouesnard
Vous avez-dit une exposition sur le racisme en 2017 ?
Ce n’est pas la première fois que le Musée de l’Homme traite ce sujet. Nous et les autres, est en quelque sorte la mise à jour de l’exposition Tous parents tous différents, qui ouvrait en 1992. A quoi sert une exposition sur le racisme en 2017 ?
Pour les scientifiques, du côté de la génétique, il n’y a plus rien à apprendre – les races humaines n’existent pas – d’un point de vue sociologique, il nous reste à comprendre d’où vient le racisme. C’est ce que ce propose de faire le Musée de l’Homme avec cette nouvelle exposition.
L’exposition propose donc une lecture sociologique du racisme tout en rappelant les données biologiques, génétiques et historiques qui participent à démontrer l’irrationalité des fondements du racisme. L’exposition décrypte ainsi les trois étapes menant au racisme : la catégorisation, l’essentialisation et la hiérarchisation. Une exposition de société, engagée, mais pas moralisatrice ; c’était tout de même le risque avec pareil sujet ! Le Musée de l’Homme ne se positionne pas en donneur de leçons, il propose une lecture strictement scientifique et factuelle. L’exposition est une démonstration toute en élégance, qui titillera les esprits.
Beaucoup d’idées, peu d’objets. Comment rendre attractif une exposition dossier ? Le défi n’était pas évident, mais il est relevé ici avec brio. L’expérience de visite par l’immersion, c’est le parti pris de l’exposition, grâce à une scénographie signée par l’atelier Confino. Des mises en scènes tantôt classiques mais souvent surprenantes favorisent l’aspect ludique, ce qui n’était pas gagné d’avance. La scénographie s’empare des lieux de la vie de tous les jours (la salle d’attente d’un aéroport, le salon d’un appartement, la terrasse d’un café, ou une rue…) et l’exposition s’amuse avec le visiteur en le confrontant à lui-même et aux autres.
L’expérience de visite, la carte gagnante !
Curieuse, je me suis prêtée au jeu, voici mon expérience de visite : L’exposition débute par une première partie, « Moi et les autres, de la catégorisation à l’essentialisation ». Une projection à 260° scanne des passants dans des scènes quotidiennes (aéroport, métro, terrasse de café, etc.), introduisant, l’air de rien, les espaces scénographiques à venir. Toutes les typologies de catégorisations y passent : femme/homme ; origine culturelle, nationalité, milieu social etc. Cet espace introductif me met d’entrée de jeu dans le sujet ! Nous sommes plusieurs dans l’espace, les gens se regardent, le malaise est un peu palpable tout de même ! Le sujet n’est vraiment pas facile !
Exposition Nous et les Autres – Salle introductive © Juliette Gouesnard
 Je poursuis ma visite et entre dans le premier espace immersif, une salle d’attente d’aéroport. Je m’interroge. Pourquoi un aéroport ? Je me revois, attendant mon vol, et pour patienter, observer les voyageurs et imaginer ce qu’est leur vie…tout ça dans ma tête bien sûr ! Mais, dans ces moments-là, sur quoi se fonde mon imagination, des préjugés peut-être ?
Je poursuis ma visite et entre dans le premier espace immersif, une salle d’attente d’aéroport. Je m’interroge. Pourquoi un aéroport ? Je me revois, attendant mon vol, et pour patienter, observer les voyageurs et imaginer ce qu’est leur vie…tout ça dans ma tête bien sûr ! Mais, dans ces moments-là, sur quoi se fonde mon imagination, des préjugés peut-être ?
Avant de m’installer sur un banc pour tester les bornes, je m’arme des définitions nécessaires pour appréhender la suite (Altérité, Assignation identitaire, Catégorisation, Discrimination, Essentialisation, Ethnocentrisme, Préjugé et Racisme). Une fois sur les bornes tactiles, je suis plus sceptique, je m’attends à des jeux, mais ce sont des tests où les réponses sont déjà orientées… je nevois pas forcément le sens de l’exercice, n’ayant pas la main sur les réponses, je reste un peu sur ma faim.
Je quitte l’espace en traversant les portiques d’aéroport, à mon passage, une voix me lâche un petit préjugé : « Tu ne sais pas danser c’est clair ! ».
Exposition Nous et les Autres – L’aéroport des préjugés ©Juliette Gouesnard
Amusée, néanmoins un peu vexée (ha ha), j’entre dans la seconde partie de l’exposition, « Race et histoire ». La scénographie est plus conventionnelle. Je me concentre sur les deux chronologies illustrées d’objets rappelant les grandes dates de l’histoire de l’esclavagisme à la racialisation, tout est plutôt clair. J’entame la suite du parcours, il s’agit de trois exemples de racisme institutionnalisé. La scénographie systématisée, sobre et épurée, voir même austère, m’invite presque au recueillement. La ségrégation aux Etats Unis, le nationalisme des nazis et le cas du génocide au Rwanda sont relatés avec beaucoup de sobriété et de simplicité. Un film très synthétique et très fort, un ou deux objets symboliques et une citation au mur, la juste mesure, point trop n’en faut, le contenu étant déjà très chargé émotionnellement.
Exposition Nous et les Autres – Races et Histoires © Juliette Gouesnard
Après ce rappel historique, l’exposition propose un « Etat des lieux » très complet d’aujourd’hui où toutes les questions sont permises :
« Si les races existent chez les chiens, pourquoi pas chez les humains ? Si les races n’existent pas, pourquoi les gens sont-ils de couleur différente ? Le racisme, c’est seulement contre les noirs et les arabes ? … »
Si ces questions nous paraissent choquantes, le Musée de l’Homme sans aucune crainte, les pose en grand et en gras ! Elles introduisent, semble-t-il, la dernière partie qui nous donnera sûrement des éléments de réponses. En continuant mon chemin, j’arrive devant un rideau de rubans d’ADN. Le ton est donné, les premiers éléments seront scientifiques, et c’est la génétique qui en répondra. Derrière le rideau coloré, je découvre un mur très graphique au vocabulaire des codes de la génétique. J’expérimente un petit jeu interactif très instructif « Ce que l’ADN dit de nous… ». Puis je m’installe devant les deux films d’animations très didactiques sur les données apportées par la génétique. J’y apprends par exemple, qu’entre tous les êtres humains, 99.9 % du génome est identique, ainsi les différences sont trop faibles pour parler de « races ».
Exposition Nous et les Autres – Mur de questions (gauche) et Génétique et populations humaine (droite) © JulietteGouesnard
Continuons la visite. J’entre dans la salle suivante, là encore le ton est donné dès le premier regard, me voilà arrivée dans une véritable DataBase ! Un mur jaune vif, rempli de données : des chiffres, des graphiques, des textes, des illustrations, des cartographies... Un peu rebutant au premier abord au vu de la densité d’informations ! Mais en prenant les choses une par une, on s’y retrouve. Ces données nous renseignent sur la situation en France : quelles formes de racisme ? Qu’en est-il de l’intégration ou du communautarisme et de la discrimination ? Malgré le nombre d’informations, certaines données retiennent mon attention comme ces chiffres plutôt encourageants : « 93 % des enfants d’immigrés se sentent français ».
Exposition Nous et les Autres – Etat des lieux en France © Juliette Gouesnard
C’est en cogitant sur toutes ces données que j’entre dans la pièce suivante, un salon d’appartement, télé allumée. Lascénographie est amusante, l’allusion est réussie ! Je m’installe sur les assises du salon et je comprends assez vite que l’exposition fait un arrêt sur images et décrypte les logiques médiatiques et politiques. L’ambiance dans l’espace est assez conviviale, on échange des sourires ou des regards atterrés avec d’autres visiteurs, quelques minutes de plus et on se serait mis à débattre !
Exposition Nous et les Autres – Décryptages © Juliette Gouesnard
Je sors du salon télé et voilà que je me retrouve à la terrasse d’un café ! L’illusion est parfaite ! Je m’installe à une table, j’ai presque l’impression qu’on va me servir un expresso ! Mais non… mon espoir retombe et mon attention se recentre sur la petite vidéo intégrée subtilement au décor. Elle présente des entretiens entre un journaliste et des scientifiques à une terrasse de café. Le son n’étant pas au top (mais excusé par les aléas du premier jour d’ouverture de l’exposition), je ne m’attarde pas.
Exposition Nous et les Autres – Controverses © Juliette Gouesnard
Je passe alors entre les lettres géantes lumineuses bleues, formant le mot EGALITE et je me crois dans la rue. Au mur, une œuvre urbaine de Patrick Pinon, issue de sa série Vivre Ensemble[1], et en face de moi, une projection de foules marchant à l’unisson pour la paix. Une jolie fin pour l’exposition, qui me laisse un sentiment d’espoir et de confiance en l’humanité !
Exposition Nous et les Autres – La ville-monde © Juliette Gouesnard
Conclusion de cette expérience de visite : je suis véritablement passée par toutes sortes de stades émotionnels ! D’abord la remise en question personnelle qui s’ensuit par l’émotion face aux témoignages de l’histoire, puis des interrogations des plus sensées aux plus idiotes, laissant place à des réponses plus terre à terre et scientifiques, puis je me suis interrogée sur notre société, je me suis laissée surprendre par des données dont je n’avais pas idée, et après avoir laissé mon esprit critique s’exprimer, c’est avec l’espoir et l’envie de combattre que je quitte cette exposition, l’envie d’y croire et d’en parler autour de moi et d’écrire cet article sur l’exposition pour L’Art de Muser !
Je tire mon chapeau au Musée del’Homme !
Si le Rapport de la Mission Musées du XXIème siècle[2] rendu en février 2017, était une charte, le Musée de l’Homme pourrait en être l’un des premiers signataires !
Rappelons le chapitre positionnant le musée du XXIe siècle comme un musée éthique et citoyen, et l’évocation d’un « Manifeste pour un musée humaniste » qui d’abord, « ouvrira largement l’univers des musées à la société contemporaine, en donnera les clés d’interprétations et permettra des ponts entre les cultures ».Puis, « formalisera que chacune des actions du musée, chacun des services s’inscrit dans un cadre plus vaste reposant sur des valeurs (liberté, tolérance, humanisme, ouverture au débat…) qui dépassent les critères strictement matériels et représentent les idéaux de la République et du vivre ensemble. » Avec Nous et les autres, le Musée de l’Homme signe une exposition citoyenne, « une exposition engagée, pas militante …des faits, rien d’autres. » [3]
Voilà un exemple d’exposition qui donne du sens aux musées ! Une exposition dossier, sur un sujet brûlant de société, qui soulève aussi des tas d’interrogations… Comment le public recevra cette exposition ? Quels publics viendront la visiter ? Le risque est que ne vienne qu’un public déjà acquis au sujet. Le défi n’est pas évident ! Il faut peut-être espérer que les institutions scolaires s’emparent de l’exposition pour sensibiliser les plus jeunes. Enfin, en pleine campagne présidentielle, quels risques pour l’exposition de devenir un outil politique ? Le Musée de l’Homme saura-t-il s’en prémunir ?
Juliette Gouesnard
#expositionengagée#expériencedevisite#Muséedel'Homme
Le site de l’exposition :
http://nousetlesautres.museedelhomme.fr/
L’expérience Chrome : https://www.youtube.com/watch?v=VjFfJGBZMV4
[1] http://www.festivaldupeu.org/all/artistesdupeu/pinon.html
[2] http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000177.pdf
[3] EvelyneHeyer, anthropologue au Musée de l’Homme et commissaire scientifique del’exposition.
Magnet Basel : exposer des dossiers d'archives, comment et pourquoi ?
Le thème universel de la migration appliqué au territoire des trois frontières.
En abordant les migrations, les musées s’approprient un thème très présent dans l’actualité. Ceux de Bâle et ses alentours (y compris transfrontaliers) ont fait le choix de montrer comment la thématique a été et est présente sur leur territoire grâce aux archives de la police bâloise des étrangers.
La série d’expositions Magnet Baseltraitait de la zone frontalière des trois pays (Suisse, Allemagne, France). Les différentes expositions ont pris place entre avril et octobre 2017 dans quatre lieux suisses et un allemand. Leur lien avec leurs territoires se retrouve dans leurs thèmes : celle sur les jeunes allemandes qui allaient être employées de maison à Bâle était au Musée des trois-frontière à Lörrach (Allemagne). Magnet Baselétait donc bien reliée à son territoire, ce qui permettait au public de se sentir plus concerné. Malheureusement elle ne pouvait être comprise que par des germanophones, écartant le public francophone de la zone, faute de traduction.
La carte surle site internet de Magnet Basel montre les lieuxd’expositions par des numéros et les histoires par des triangles noirs. (Source : http://www.magnetbasel.ch/)
L’élaboration des expositions
Le projet a été lancé par les archives du canton de Bâle-ville qui ont choisi des dossiers. La sélection s’est faite au sein du fonds de la police des étrangers de Bâle (1917-1970), sur des critères d’intérêt et de légalité, les expositions montrent la très grande diversité des trajectoires de vie de ce fonds. Légalement pour que les dossiers puissent être présentés toutes les personnes mentionnées doivent avoir donné leur accord ou être mortes depuis plus de 10 ans. Dans certains dossiers des zones ont été noircies puisqu’elles ne tombent dans aucunes des deux catégories suivantes. Des éléments plus actuels ne faisant pas partie du fonds d’archive ont également été incorporés dans certaines expositions.
À partir de cette volonté et de ces recherches l’exposition a été conçue entièrement en externe (muséographie, scénographie, graphisme) et en collaboration avec des illustrateurs.
Une source, plusieurs approches
Tout l’enjeu est d’exposer les dossiers choisis de manière compréhensible et cohérente. L’articulation des différents dossiers fait sens à deux niveaux, à l’intérieur de chaque exposition thématique, et les expositions ensemble.
Plusieurs procédés sont utilisés pour exposer les données, avec entrées et des degrés d’implications divers. Deux manières de faire se distinguent : rassembler pour proposer une vision globale, et explorer les différentes histoires de vie en voyant chaque dossier séparément.
Au Museum für Wohnkultur(Musée de l’habitat) dans l’exposition« Bewilligt. geduldet. Abgewiesen » (« Accordé. Toléré. Renvoyé »), une manière de faire correspond une salle. Cette exposition englobe toutes les thématiques de MagnetBasel et montre la très grande diversité des histoires présentes dans le fonds d’archive de la police des étrangers, en s’intéressant à comment et pourquoi les étrangers à Bâle ont pu rester ou au contraire du partir.
La première salle présente chaque dossier et son histoire individuellement. Celles-ci sont illustrées sur des panneaux, disposés tout autour de la salle, qui constituent le premier niveau d’entrée dans l’exposition. Ils accrochent l’œil du visiteur dès son entrée et l’entrainent dans l’histoire grâce à l’illustration. Pour inviter à s’approcher les panneaux commencent avec une accroche, telle que :
« Pourquoi la fuite à Bâle de l’apprenti boulanger Arnold Wochenmark et de Johanna Braunschweig, une domestique, malgré tous les soucis mène en 1945 à une fin heureuse »
La première salle © S.G.
On peut vraiment prendre plaisir à lire ces récits mis en lumière par le dessin. La diversité des illustrateurs enrichis beaucoup ce médium en proposant plusieurs visions et sensibilités artistiques. Les objets liés rendent palpables ces histoires, et on peut facilement imaginer qu’ils permettent au jeune public de s’intéresser à l’exposition. Les visiteurs sont libres d’approfondir, ou non, grâce à la reproduction des dossiers sur une table centrale, et à un rétroprojecteur en libre service pour projeter certains documents des dossiers.
La deuxième salle au contraire rassemble les informations des dossiers, présentées de manière graphique.
Un premier panneau avant d’entrer véritablement dans la salle, remet l’exposition dans ses contextes historiques, avec pour chaque type d’événement une couleur. Il met en regard les événements historiques, internationaux, nationaux, locaux et économiques ayanteu un impact sur les migrations entre 1900 et 1970. Pour l’année1968 par exemple sont marqués : en gris pour Bâle les premières femmes au parlement cantonal, et en rose pour l’international le Printemps de Prague.
Un procédé similaire sert à faire apparaître des typologies de documents ou mentions dans les dossiers, triées par organisme ayant fourni ledocument. Cela fait apparaître des îlots colorés sur les murs de la salle et éclaire sur le rôle de chaque acteur, tels que l’agence pour le travail, les employeurs, la sécurité sociale, les consulats, la police etc.
Au milieu se trouve une table avec des informations complémentaires et une machine à écrire évoquant les bureaux sur lesquels les dossiers ont été constitués.
La deuxième salle © S.G.
Exposer les archives
L’exposition porte sur l’histoire et les histoires de migrations dans la région, mais à travers ce thème c’est aussi l’institution et le fonctionnement des archives qui sont montrées aux publics.
La scénographie évoque les archives dans l’exposition par le mobilier en en reprenant les codes pour la grande table de consultation de la première salle notamment. Leur matérialité est au centre de l’exposition grâce à la vitrine remplie de cartons d’archives qui sert de cloison entre les deux salles d’exposition.
Plus que de simplement voir le visiteur peut expérimenter les archives, les dossiers reproduits sur la grande table de consultation l’invitentà les consulter et à devenir « chercheur ». Cette pratique lui permet de se familiariser avec l’institution, et en tant que citoyen d’en comprendre mieux l’utilité.
Pour les germanophones qui souhaiteraient creuser le sujet, le blog des archives de la ville de Bâle a publié une série d’articles su rles recherches autour de l’exposition. http://blog.staatsarchiv-bs.ch/forscherinseln-magnet-basel/
Bethsabée Goudal

#Archives
#Migrations
#3frontières

Mais que font donc les muséographes ?
Vous avez dit muséographie ? © CR
En fait, je pense que très peu de gens imaginent qu’un.e muséographe conçoit des contenus d’exposition et la manière de les médiatiser auprès du public. Et encore le terme de conception est-il trompeur car les muséographes ne fabriquent rien, du moins rien de physique. Mais alors que font-illes ? C’est simple : illes lisent, illes écrivent, illes coordonnent, illes improvisent. Pour rendre tout cela plus concret, partons d’un cas concret : l’exposition Rose Valland. En quête de l’art spolié qui se tient actuellement au Musée dauphinois. Son commissariat a été assuré par Olivier Cogne et sa muséographie par trois masterantes – Clara Pinhède, Suzy Louvet et moi-même - dans le cadre d’un stage long au Musée dauphinois.
Les muséographes lisent
Suzy Louvet à son bureau, équipée des indispensables du muséographe : des livres, un téléphone portable et un ordinateur © Denis Vinçon
Dans sa première phase, le travail des muséographes se rapproche de celui des chercheur/euses : pour s’approprier un sujet, les muséographes commencent par compiler de la documentation. Il s’agit souvent de littérature grise, produite par des spécialistes du sujet mais aussi de catalogues d’expositions traitant de thématiques proches, d’articles de presse mais aussi, d’ouvrages de fiction, etc. Dans le cas de Rose Valland et de l’art spolié, la littérature disponible était abondante. Elle se composait aussi bien d’ouvrages scientifiques que fiction. L’intérêt (re)naissant pour ce sujet depuis le mi-temps des années 1990 s’est également traduit par la production de documentaires et d’expositions sur le sujet.
Les muséographes s’intéressent aussi à des sources de première main – les archives – avec des objectifs un peu différents de ceux des chercheur/euses en sciences humaines. La consultation des archives peut bien entendu simplement compléter la veille documentaire. Mais le recours aux archives permet aussi de documenter un objet ou des objets à exposer, voir même de trouver des pièces à exposer. Pour préparer l’exposition Rose Valland. En Quête de l’art spolié, nous avons abondement consulté les fonds des Archives nationales et des Archives diplomatiques. Rose Valland a elle-même produit (et conservé) une documentation considérable. Sa consultation s’avérait indispensable pour comprendre en profondeur le travail de cette fonctionnaire déterminée mais discrète sur ces activités professionnelles. Nous avons été accompagné.es dans cette tâche par le comité scientifique de l’exposition regroupant des spécialistes de différentes institutions : Ophélie Jouan (Archives nationales), Sébastien Chauffour (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères), Alain Prévet (Direction des Musées de France), David Zivie et Thierry Bajou (Ministère de la culture), Didier Schulmann (Centre Pompidou), Olivier Renodeau (Musée de l’Armée). Jacqueline Barthay, présidente de l’Association La Mémoire de Rose Valland a également largement contribué à cette phase du projet en nous accompagnant dans le dépouillement du fond documentaire inédit rassemblé par l’association.
Quelle que soit la qualité des sources consultées, la lecture du muséographe n’est jamais désintéressée ; lire ce n’est pas seulement gagner des connaissances, c’est construire sa connaissance d’un sujet, l’apprivoiser, le circonscrire. La forme de synthèse opérée par muséographe est relativement spécifique. Il s’agit tout autant d’un tri de l’essentiel et de l’inessentiel, du simple et du complexe que de l’attrayant et de l’inattrayant, du curieux et du convenu. Son objectif est moins de résumer un champ de connaissance que d’y trouver une porte d’entrée originale par laquelle pourra se frayer le plus grand nombre. Ce ou ces biais de lectures sont souvent appelés des « partis pris muséographiques ».
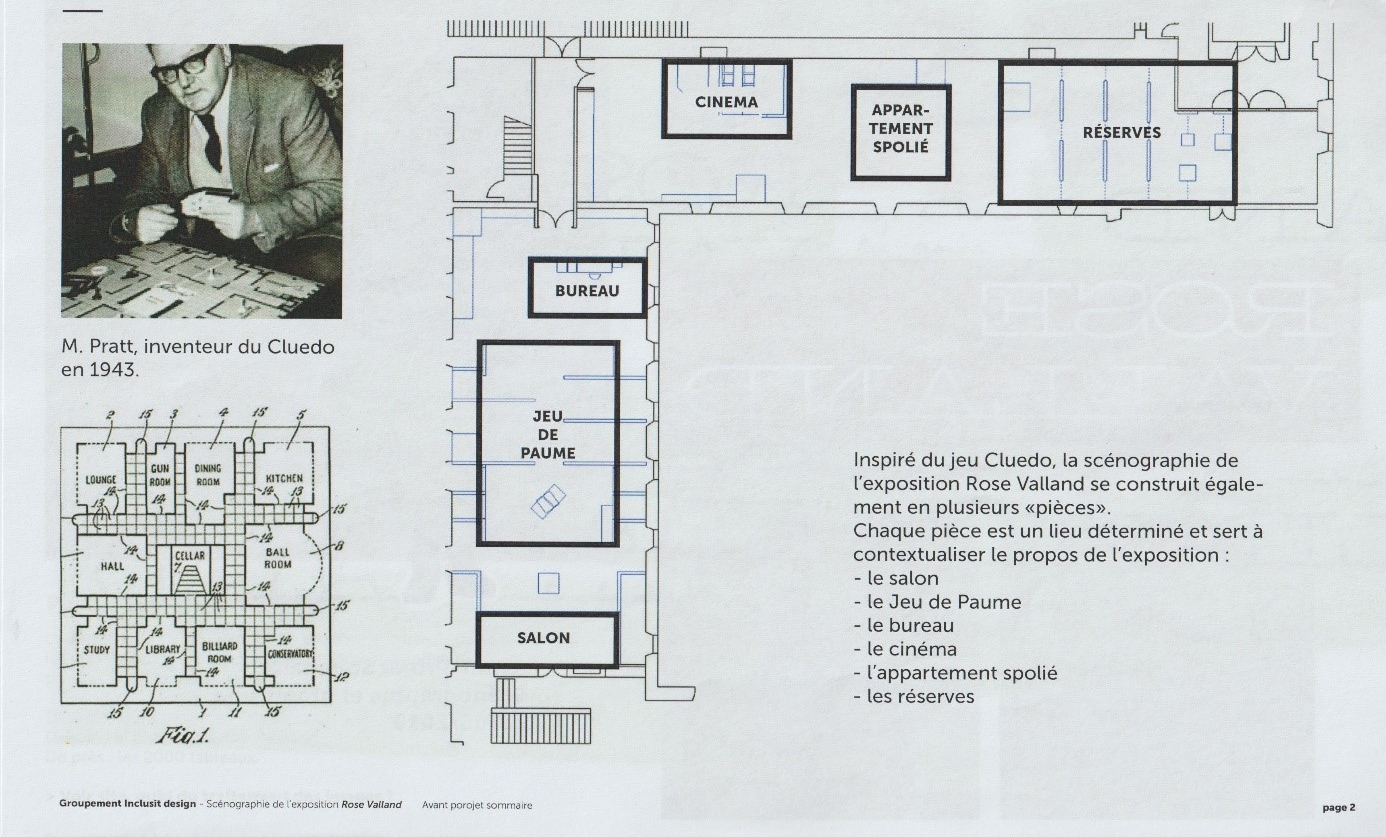
Les scénographes d’Inclusit Design se sont emparé du parti-pris de l’enquête en construisant l’espace comme un jeu de Cluedo © CR d’après une création originale d’Inclusit Design
Deux partis-pris muséographiques ont donné sa coloration à l’exposition du musée dauphinois. D’abord, l’insistance sur la période post 1945 de la vie de Rose Valland, soit sur son travail de recherche et de restitution de l’art spolié. Ce premier choix en a orienté un second, plus formel, celui de l’enquête.
Les muséographes écrivent
Assez logiquement une fois ce travail d’appropriation documentaire terminé – ou du moins bien entamé – les muséographes peuvent commencer à produire du contenu ou plutôt des contenus.
Classiquement, illes commencent par une note d’intention, document qui rappelle le contexte de production de l’exposition et précise ses premières intentions de contenu. Cette note d’intention devient au fil des mois un synopsis d’exposition, de plus en plus développé et précis. Le synopsis d’exposition détaille le parcours d’exposition. Il met en rapport un contenu organisé, hiérarchisé et les espaces d’exposition disponible. Chaque chapitre de l’exposition est ainsi déjà plus ou moins pensé dans et en fonction de l’espace.
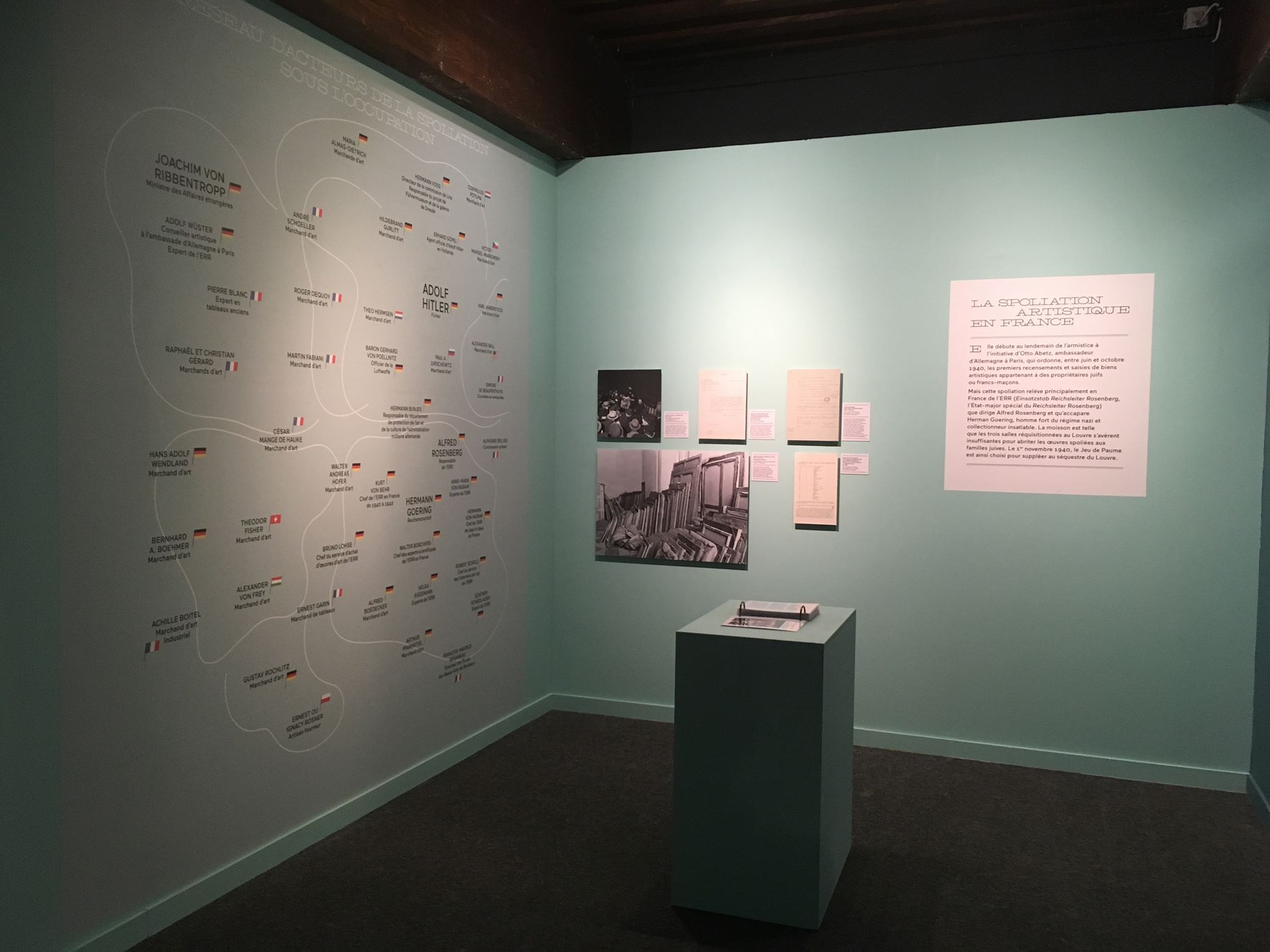
Des formes de productions écrites diverses dans l’espace évoquant la spoliation artistique et le marché de l’art parisien sous l’occupation : mur d’acteur/trices et fiches biographiques, texte de salle, cartels © C.R
Dans une des dernières phases du projet d’exposition, les muséographes peuvent être amené.es à rédiger des textes d’exposition. S’il n’est pas rare que les textes principaux de l’exposition soient rédigés par le commissaire de l’exposition, le muséographe échappe plus rarement à l’écriture des cartels.
Les textes de l’exposition Rose Valland, ont ainsi été produit.es à six mains : Olivier Cogne, le commissaire d’exposition se chargeant des textes de séquences, Suzy Louvet et moi-même nous répartissant l’écriture des cartels et de tous les autres éléments textuels de l’exposition (cartels, biographies d’acteur/trices, scénario et dialogue d’un jeu numérique, etc.). Le travail d’écriture muséographique est un travail d’équipe et donc un travail itératif. Selon les configurations, les textes sont relus au sein de l’équipe de projet et/ou par le comité scientifique de l’exposition. Ceux de l’exposition du Musée dauphinois ont fait l’objet d’une double relecture, en interne et en externe. Deux membres du comité scientifique se sont particulièrement investis dans cette vérification : dans un premier temps, la chercheuse Ophélie Jouan - par ailleurs autrice de Rose Valland. Une vie à l'œuvre la publication qui accompagne l’exposition – puis David Zivie, chargé du patrimoine au ministère de la culture.
Comme tous les travailleur/euses de bureau du 21e siècle, les muséographes écrivent aussi des mails, beaucoup de mails et d’autant plus de mails que leurs interlocuteur/trices sont nombreux/euses.
Les muséographes coordonnent
Qu’illes soient indépendant.es ou embauché.es par une structure muséale, les muséographes sont des interlocuteurs privilégié.es. Illes sont en contact permanent à la fois avec tout le personnel interne à la structure dans ou pour laquelle illes exercent mais aussi avec tous les prestataires qui interviennent sur le projet.
Les muséographes occupent un rôle pivot à l’intérieur comme à l’extérieur du musée. Pour ce projet, nous travaillions étroitement avec le service des collections, avec la chargées d’action culturelle et l’équipe technique mais aussi plus ponctuellement avec le photographe, la chargée de communication, la gestionnaire et plus globalement l’ensemble des personnels du musée.
En externe, nous assurions les relations avec les musées et particuliers prêteurs. Le nombre de prêteurs et leur dispersion géographique a rendu cette tâche particulièrement chronophage – mais aussi réellement passionnante puisqu’il s’agissait de collaborer avec des structures très diverses, tant régionales que nationales. Nous avons également sollicité des prêts d’œuvres restituées auprès de particuliers. Le repérage des prêteur/euses potentiel.les et la prise de contact avec elle/eux n’a pas été chose facile. Néanmoins, le dialogue instauré avec ces particuliers c’est avéré particulièrement riche et nous a permis de ne pas perdre de vue les conséquences de ce double mouvement de spoliation/restitution pour les familles impliquées.
Last but not least, nous étions le contact des prestataires extérieurs intervenant sur le projet : l’agence de scénographie Inclusit design, les graphiste Jeanne Bovier Lapierre et Jérôme Foubert, mais aussi l’agence de création numérique PixelsMill, le concepteur de jeu Escape Game Bastille, l’illustratrice Cécile Becq et le cartographe Thomas Lemot. Il s’agissait très concrètement de fournir à ces différents prestataires la matière dont ils avaient besoin pour leurs créations respectives. Nous avions aussi à charge d’établir un rétroplanning cohérent permettant de coordonner au mieux l’avancement et la remise des productions de chacun.e.

Comment présenter le verso des tableaux MNR exposés tout en sécurisant les œuvres, en permettant aux pompiers de les dégager facilement en cas d’incendie et en respectant les exigences de conservations imposées par les musées prêteurs ? Ce problème complexe a demandé plusieurs mois de réflexion collective. La solution mise en œuvre est un système sur mesure respectant les différents systèmes d’accrochages des tableaux © Denis Vinçon
A partir d’un certain stade, ce travail de coordination devient beaucoup plus concret. Lorsque la construction de l’exposition débute, le muséographe peut être amené à assurer le suivi de chantier. Dans cette configuration, notre rôle consistait essentiellement à faire l’interface entre l’équipe de chantier et la scénographe, basée à Saint-Etienne. Cela signifie, en pratique, recueillir les questions et demandes techniques de chacune des parties et y répondre au mieux pour faciliter le bon avancement du chantier. Cela suppose une connaissance solide du projet de scénographie et une grande disponibilité. Le muséographe n’est bien entendu pas un spécialiste de tous les métiers à qui il s’adresse : les solutions aux problèmes techniques soulevés sont donc le plus souvent trouvées collectivement. L’équipe de muséographie du projet "Rose Valland" était d’ailleurs chargée, en coordination avec le commissaire d’exposition, d’organiser et d’animer les réunions de chantier réunissant les équipes de conception et de réalisation.
Les muséographes improvisent
De par son double rôle de conception et de coordination, le muséographe est le roi des plans B (puis C puis D…). Dans toutes les phases de son travail, le muséographe doit tenir compte de contraintes plus ou moins nombreuses imposées à la fois par le commanditaire de l’exposition et par les musées prêteurs. Ces contraintes sont liées à la qualité des espaces d’exposition, aux exigences de conservation préventives, au budget alloué à l’exposition, etc.

Les vitrines récupérées pour m’exposition Rose Valland, rassemblée dans le chantier d’exposition en vue de leur aménagement par l’équipe technique du musée © Denis Vinçon
En sus des exigences évoquées ci-dessus, le musée dauphinois a à cœur de favoriser le réemploi du matériel d’exposition, dans une démarche de développement durable. Pour l’exposition Rose Valland, seules quelques vitrages aux dimensions très spécifiques ont dû être commandées. L’intégralité des vitrines tables présentes dans l’exposition a déjà servi dans une ou plusieurs expositions. Ce recyclage a d’abord nécessité plusieurs heures de repérage des éléments les plus adaptés dans les locaux de stockage du musée. L’utilisation de vitrines un peu plus grandes ou plus petites que celles prévues dans les plans de scénographie implique nécessairement des ajustements et donc un dialogue entre muséographes, scénographes et équipes techniques. Enfin, la plupart des vitrines utilisées n’étaient pas des vitrines climatiques, il a fallu prévoir les aménagements nécessaires pour pouvoir stabiliser leur climat et ainsi répondre aux exigences de conservations des centres d’archives prêteurs. La solution trouvée consiste à insérer des cassettes de gel de silice dans des doubles-fonds spécialement aménagé par les menuisiers du musée. Cette démarche de réemploi concerne tous les éléments de scénographie, y compris le matériel numérique : tous les écrans présent.es dans l’exposition sont des réemplois. Une fois encore, cela a supposé des ajustements de format, discutés en amont avec la vidéaste Bénédicte Delfaux qui a produit les six pastilles qui ponctuent le parcours d’exposition.
Les exemples de ce type pourraient être multipliés à l’infini. A tel point que si l’on devait ne retenir qu’une qualité requise du/de la muséographe, ce serait bien l’adaptabilité. Les muséographes sont aussi désireux/euses de partager le fruit de leurs aventures collectives ; je ne fais pas exception : rendez-vous au Musée dauphinois, jusqu’au 27 avril prochain.
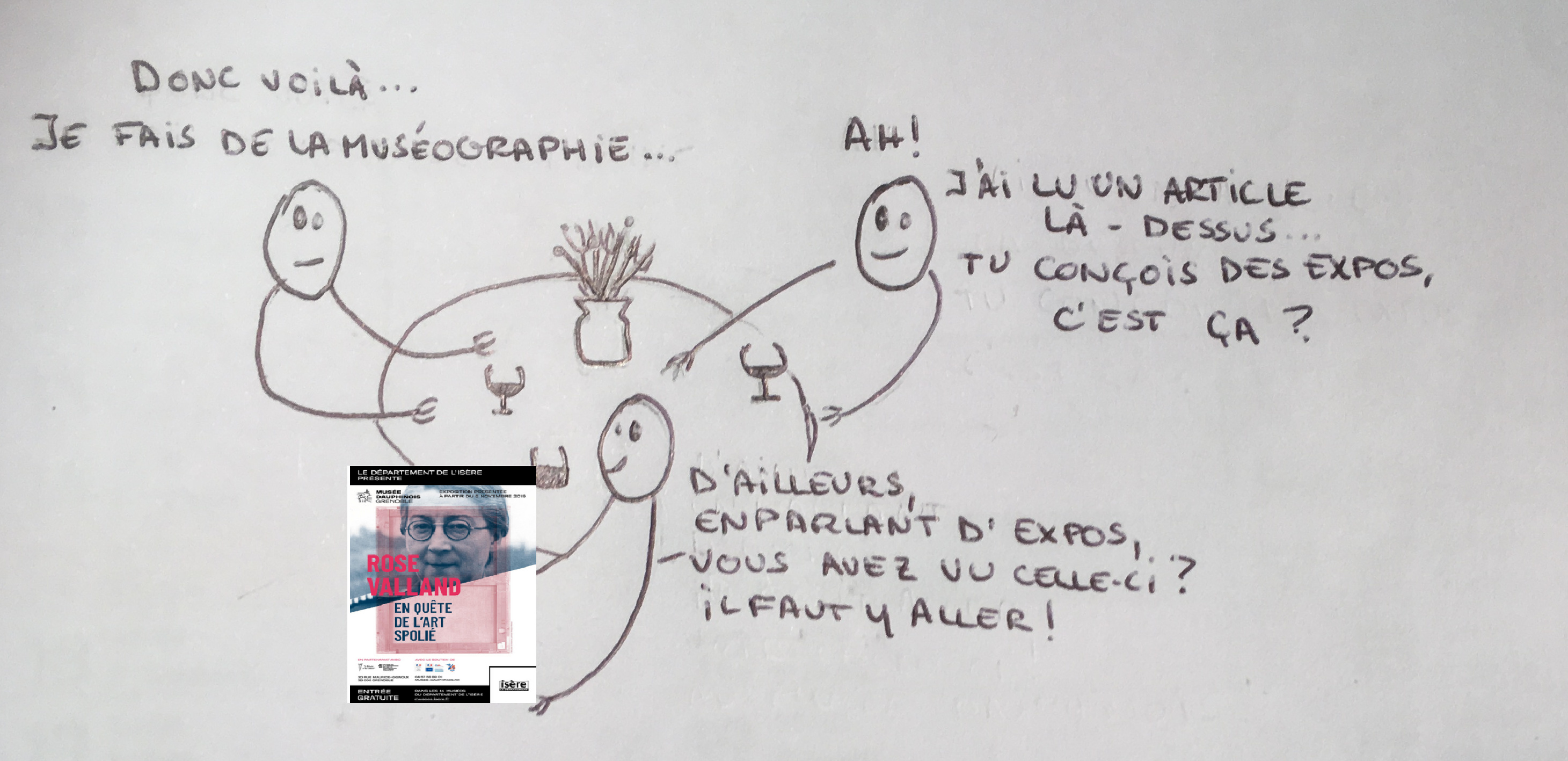
Vous avez re-dit muséographie ? © CR
C.R
#Muséographie
#RoseValland
#Muséedauphinois
Pour aller plus loin :
Le site du collectif professionnel Les Muséographes : http://les-museographes.org/museographie/les-missions-de-la-museographie/
L’exposition Rose Valland. En Quête de l’art spolié et la programmation associée : https://musees.isere.fr/expo/musee-dauphinois-rose-valland-en-quete-de-lart-spolie
…Et un excellent article que l’Art de Muser a consacré à Rose Valland, aux spoliations nazies et aux recherches de provenance.

Mais qui sont les wisigoths ?
Des barbares exposés pas si barbares !
Le mythe des invasions barbares à travers l’histoire et l’archéologie
En histoire française, ce sujet est longtemps resté lié au mythe des invasions barbares. Étaient considérés comme barbares, les peuples ne parlant pas le latin, en opposition à Rome alors perçue comme le centre de la civilisation. Dans le champ historiographique, les invasions – c’est-à-dire des déferlements de populations guerrières et violentes sur les terres d’Europe de l’Ouest – auraient causé la chute de l’Empire romain. Pourtant, aujourd’hui, il faut se défaire de l’idée des « grandes invasions barbares » pour lui préférer celle des migrations de populations qui ont eu lieu entre le IIIè et le VIè siècle1. Cette deuxième approche revêt en effet l’intérêt de mettre en avant les causes de ces déplacements qui ne sont pas uniquement celles de la conquête guerrière. Au contraire, ces déplacements relèvent plus souvent d’une question de ressources, d’accès à la terre et de recherches de moyens de survivance ou de survie en fuyant une menace extérieure. La preuve en est l’entrée des Goths dans l’Empire romain, présentée ici dans l’exposition du Musée Saint Raymond.
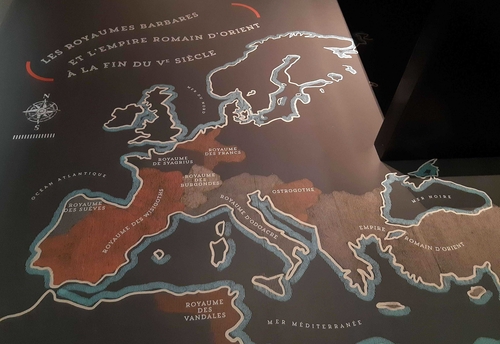
Carte des peuples « barbares » en Europe au Ve siècle © C.L.
L’archéologie et les progrès faits dans la recherche nous montrent aujourd’hui que ces peuples appelés barbares ne sont pas sans civilisation, loin de là. En France, il a fallu attendre le tournant des années 2000 et le développement de l’archéologie préventive pour que la recherche en histoire et en archéologie se tourne réellement vers ces cultures. Les nouvelles recherches nous montrent le degré de civilisation que ces peuples avaient atteint et la richesse des objets découverts témoignent de leur mode de vie. De plus, les migrations de ces peuples impliquent de nombreux phénomènes d’acculturation ou de brassages culturels, développant un peu plus leur savoir-faire. La présentation de leurs modes de vie, traditions et de leur culture dans les expositions actuelles met en avant leur système et permet de mieux comprendre une partie de l’histoire souvent passée sous silence, tout en déconstruisant les images collectives et préjugés encore présents dans l’imaginaire. Ce renouvellement de la connaissance a permis une bien meilleure connaissance qu’auparavant de ces cultures et civilisations, ainsi qu’une mise en lumière pour le public visiteur de musées.
Quand les musées s’emparent du sujet des barbares
Les expositions tentent alors de sortir du mythe du barbare brutal et sanguinaire afin de mettre en avant la richesse de sa culture et de sa civilisation. Depuis une quinzaine d’années, nous assistons à un renouvellement des expositions temporaires sur ce sujet en lien avec les évolutions historiographiques, historiques et les découvertes archéologiques. Elles permettent notamment de revenir sur cet imaginaire du barbare longtemps malmené. Comme le dit Laure Barthet – conservatrice du musée toulousain et commissaire de l’exposition –, « le public aujourd'hui, peut redécouvrir complètement ces cultures matérielles et ces peuples »2.
On note cependant qu’une majorité des expositions récentes sur le sujet est tournée vers des peuples considérés comme fondateurs pour la nation française, et donc très présents dans la construction du récit national et l’histoire enseignée. En effet, nous pouvons penser à l’exposition sur les Francs à Saint-Dizier en 2008, « Nos ancêtres les Barbares » ; à celles sur les Gaulois à la Cité des Sciences en 2011, « Gaulois, une expo renversante » et au musée d’Aquitaine l’année suivante, « Au temps des Gaulois, l’Aquitaine avant César » ; ou encore les Mérovingiens présentés au Musée de Normandie en 2018, « Vous avez dit barbares ? ».
Bien qu’elles offrent une réflexion sur ce que sont les barbares et ce en quoi le nom n’a de sens que par rapport à un schéma bien précis de civilisation qu’il faut revoir, elles restent des présentations de peuples largement connus dans l’histoire française, quand beaucoup d’autres sont quasiment inconnus du grand public. C’est en cela que l’exposition sur les Wisigoths à Toulouse apporte un regard nouveau sur la recherche en archéologie et la connaissance des peuples qui ont traversé l’Europe. L’objectif du Musée Saint Raymond est de combler cette absence dans les expositions, grâce à la présentation de résultats de fouilles encore inédits sur les Wisigoths installés dans le Sud de la France du Vè au VIIè siècle. Le site internet du musée précise d’ailleurs : « Parce qu’ils ne sont pas les Francs, héros du récit national, les Wisigoths ont été longtemps ignorés par l’archéologie dite "mérovingienne" (de Mérovée, ancêtre mythique de Clovis) ». Cela montre bien le décalage qu’il y a entre le roman national basé sur les Francs et les Mérovingiens, et l’oubli des autres peuples barbares pourtant nombreux sur le territoire français : Alains, Vandales, Burgondes, Wisigoths pour n’en citer que quelques-uns.
L’exposition « Wisigoths, Rois de Toulouse », une nouvelle approche du sujet
L’exposition du Musée Saint Raymond retrace donc l’histoire des Wisigoths, peuple qui a traversé l’Europe depuis l’est, passant par l’Empire romain d’Orient et d’Occident avant de s’installer à Toulouse sur le territoire français puis enfin à Tolède sur le territoire espagnol. A l’occasion du 1600ème anniversaire de leur installation à Toulouse, le musée d’archéologie de la ville retrace leur parcours à travers l’Europe et l’instauration d’un nouveau royaume dans la région toulousaine. Rappelons que le Royaume des Wisigoths a été le plus grand des royaumes barbares en Occident à la suite de la chute de l’Empire romain, et qu’il a, par conséquent, une richesse indéniable qui nous est montrée dans cette exposition.
Particulièrement intéressante, elle présente dans une première partie ce peuple goth, et ce, sous un angle peu connu : celui de sa très grande migration depuis l’Europe de l’Est. La scénographie de l’exposition propose un parcours à sens unique qui permet d’avancer dans la chronologie et de suivre les pérégrinations des Goths en Europe, avant la distinction en deux branches : Ostrogoths (Goths de l’Est) et Wisigoths (Goths de l’Ouest). En débutant par le bassin de la Vistule (actuelle Pologne) où ils sont installés, la visite se poursuit par leur arrivée au bord de la mer Noire puis enfin l’entrée dans l’Empire romain d’Orient. En parallèle des panneaux d’explication, de nombreux objets archéologiques sont présentés sous vitrine, provenant d’Europe de l’Est. Ils mettent ainsi en avant les cultures de Wielbark (dans le bassin de la Vistule) et de Tcherniakhov (sur les bords de la mer Noire) avec de nombreuses poteries et objets d’apparat. Une maquette reprenant la bataille d’Andrinople opposant les Romains aux Wisigoths fait la transition entre cette période de pérégrination en Europe et leur entrée dans l’Empire, accompagnée de la reproduction d’un équipement militaire mettant en lumière les échanges culturels entre les Wisigoths et les Romains. La visite continue en présentant les migrations des Wisigoths au sein de l’Empire romain d’Occident : en Italie du Nord, en Gaule et finalement dans la péninsule ibérique.
A mi-parcours de l’exposition, la scénographie offre aux visiteurs la possibilité de fouler une carte présentant les différents peuples barbares installés en Europe, avant de passer à la deuxième partie de l’exposition dédiée au Royaume de Toulouse.

Fibules et objets d’apparat de type germanique oriental ©
Celle-ci, intitulée « Langue, culture et droit dans le Royaume de Toulouse », est davantage dédiée à la présentation des modes de vie des Wisigoths et à leur installation dans la région où ils fondent leur royaume. De nombreux objets découverts lors de fouilles archéologiques y sont présentés et mettent en avant la richesse de ce peuple. Ils proviennent majoritairement du Sud-Ouest, sur les traces de l’ancien royaume – notamment dans les centres de pouvoir – et sont les témoins de leur culture, mais aussi de leur adaptation à la vie romaine déjà implantée en Gaule. Le Bréviaire d’Alaric par exemple est un texte de lois qui témoigne de la richesse du système de droit wisigothique, le plus ancien barbare connu aujourd’hui. Il met en avant un trait caractéristique des Wisigoths : celui de leur adaptation au territoire et aux populations locales de ce même territoire. En effet, une fois installés à Toulouse, ils ont conservé l’administration déjà en place, donc romaine, mise à jour au fil du temps par leur système rendant possible ainsi une cohabitation des peuples dans leur Royaume.
Leur implantation dans Toulouse est signifiée par une maquette du quartier goth et de leur palais. Ces deux sites étaient implantés entre la ville antique et l’espace hors les murs de la ville. Elle permet de se rendre compte de l’appropriation de la ville et de l’espace urbain par les Wisigoths. Les visiteurs découvrent ensuite des objets d’apparat tels que des fibules et des boucles de ceinture aux figures d’aigle, symbole très présent dans les cultures germaniques. Ces objets sont qualifiés de type germanique oriental. Encore une fois, ils sont le signe des migrations de ce peuple et du brassage culturel qu’il a connu. Les Wisigoths ont gardé dans leur tradition ce motif de l’aigle germanique, que l’on retrouve encore sur des bijoux lors de fouilles archéologiques dans le Sud-Ouest de la France. La visite s’achève par la présentation des sépultures wisigothiques et notamment un outil de médiation numérique qui présente le plan d’un chantier de fouilles, et qui permet de découvrir les tombes en 3D et de voir ce que chacune contenait ainsi que les particularités des squelettes découverts.
L’exposition toulousaine sur les Wisigoths complète une nouvelle approche historiographique qui questionne les barbares et leur rapport à la civilisation en même temps qu’elle met en lumière une culture peu connue de l’histoire française.
Clémence Lucotte
1 Dumézil, Bruno, « Les « invasions barbares » : sources, méthodes, idéologies », Dominique Garcia éd., Archéologie des migrations. La Découverte, 2017, pp. 243-254.
2 « Les Wisigoths, barbares comme les autres », France Culture, Émission Carbone 14, le magazine de l’archéologie présentée par Vincent Charpentier, avec Laure Barthet, 29/08/2020, 30’ : https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/les-wisigoths-barbares-comme-les-autres
Lien de l’exposition : https://saintraymond.toulouse.fr/Wisigoths-Rois-de-Toulouse_a1193.html
#histoire #archeologie #wisigoths
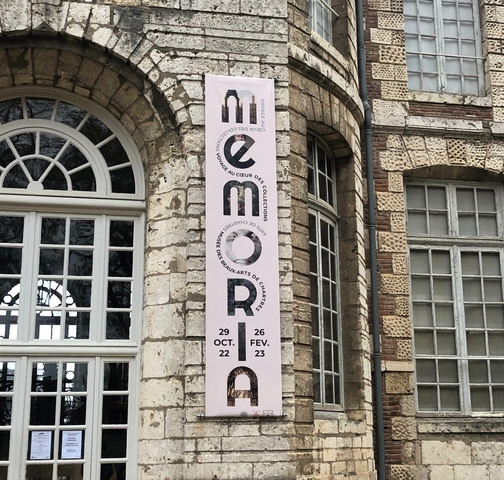
Memoria : le musée de A à Z
Le musée des beaux-arts de Chartres accueille jusqu’en février l’exposition « Memoria. Voyage au cœur des collections ». Cette « exposition-école », réalisée par des étudiant.es en master 2 de l’Ecole du Louvre, décortique les liens entre musées, objets et patrimoines.
image d'introduction : Entrée de l’exposition © M.B
A… un Abécédaire pour (re)découvrir le rôle des musées
Memoria. Voyage au cœur des collections est une invitation à réfléchir sur le rôle d’institutions bien implantées dans le paysage culturel depuis le 19e siècle : les musées. A la croisée de questionnements sur le patrimoine, la mémoire, la transmission, l’héritage mais aussi l’éducation et le loisir, les musées ont de multiples missions, qu’il est difficile parfois de définir. En témoigne les années de discussion de l’ICOM pour arriver à une définition satisfaisante.
L’exposition a été conçue comme un abécédaire, où chaque lettre permet d’évoquer une notion. Un choix qui présente plusieurs avantages : aborder beaucoup de thématiques sans se contraindre à un discours continu et donner une conscience au visiteur de où il est dans l’exposition, qu’il sait finir à Z. Mais surtout, chaque lettre et notion est accompagnée d’œuvres ou d’objets. Ils ne sont pas là pour simplement illustrer le propos. Bien au contraire, ces objets sont la base de la réflexion. Le propos part du cas précis de l’objet pour l’élargir aux questions de patrimoine, mémoire ou musée déjà évoquées. Toutes les œuvres exposées ont été sorties des réserves pour l’occasion, un bon moyen pour le musée de montrer de nouvelles pièces de ses collections.

Vues de l’exposition © M.B
I… une Introduction à la muséologie
Memoria offre un large panorama de thématiques pour découvrir la muséologie au sens large. Les sujets très concrets comme l’inventaire ou l’encadrement des œuvres présentent les missions de conservation, documentation et présentation : les tâches quotidiennes de la vie du musée, en somme.

La lettre E : Encadrement © M.B
A une échelle plus large, des sujets plus généraux questionnent l’essence même des musées. Les cartels sur les chef d’œuvre et l’histoire du goût interrogent sur la neutralité des musées et leur responsabilité dans la construction d’histoire(s) de l’art. En présentant des objets du quotidien, l’exposition interroge également la muséalisation des objets de demain.

La lettre J : Jalon, sur l’évolution du goût et l’œuvre Tuerie de Auguste Préault © M.B
Nous pouvons cependant déplorer que la question des restitutions ne soit pas creusée. Des œuvres kanak (Nouvelle-Calédonie) sont exposées et le cartel Tabou pose clairement la question du regard occidental posé sur ces œuvres déracinées de leur contexte originel. La question, pourtant cruciale, des restitutions et du statut des œuvres extra-européennes dans les collections françaises n’y est pas discutée.
P… vous reprendrez bien un autre Parcours ?
La forme de l’abécédaire invite à un parcours linéaire, dans l’ordre alphabétique. Chaque lettre, de A à X, est associée à une ou plusieurs œuvres et à un cartel qui fait découvrir aux visiteurs une notion issue de la muséologie. Tous les cartels sont conçus de façon identique : une (ou plusieurs) définitions très concrètes du mot concerné, suivies d’un court texte sur la notion en question.
Exemple de cartel : Spoliation © M.B
Si le parcours alphabétique en visite libre se suffit à lui-même, un livret de visite propose 4 mini-parcours supplémentaires, présentés comme des prolongements de l'exposition. Ils ne concernent que quelques lettres du parcours et approfondissent 4 angles plus spécifiques. Le parcours 1 « histoire locale » met en valeur des œuvres liées à l’histoire de la ville de Chartres. La diversité de nature des œuvres exposées permet de proposer un 2ème parcours intitulé « ethnologie ». Le parcours 3 « rôle et fonctionnement du musée » rappelle quelques missions principales des musées, tandis que le parcours 4 « goûts et curiosités » soulève la question de la responsabilité des musées dans la formation du goût.
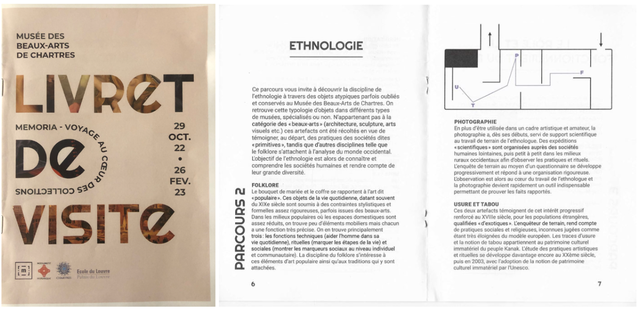
Le livret de visite et le parcours « ethnologie » © M.B
Les 4 parcours ciblés étoffent le propos mais demandent une petite gymnastique du cerveau pendant la visite. Il faut jongler entre les lettres dans la scénographie et son livret de visite pour s’assurer de ne pas rater une étape du parcours tout en ne se perdant pas entre les 4 thèmes. Le plus simple et le plus clair est sans doute de revenir sur les parcours après avoir fait l’intégralité de la visite.
P… un coup d’œil sur la Programmation ?
Pour accompagner l’exposition, les étudiant.es - commissaires ont mis en place une programmation de plusieurs événements, réalisés avec des partenaires locaux. Des visites guidées seront assurées par des lycéen.nes et des podcasts enregistrés avec des collégien.nes sont à écouter dans l’exposition (via un QR code sur les cartels). En février, un spectacle de danse est à découvrir. Enfin, pour les professionnel.les, deux journées d’étude sont organisées. La première sur la mémoire a eu lieu en décembre, la deuxième se tiendra le 21 janvier et abordera le rôle du musée.
E… et le public Enfant ?
Les enfants ne sont pas oubliés, grâce à un petit livret-jeux disponible à l’entrée. Il s’adresse au 7-12 ans. Les notions évoquées dans l’exposition y sont reprises, de façon courte et simplifiée. Des jeux (rébus, points à relier, labyrinthe) basés sur les œuvres de l’exposition accompagnent chaque texte. Ces jeux complètent simplement le texte, ce n’est pas par le jeu que les enfants en apprennent plus sur le musée et ses collections.
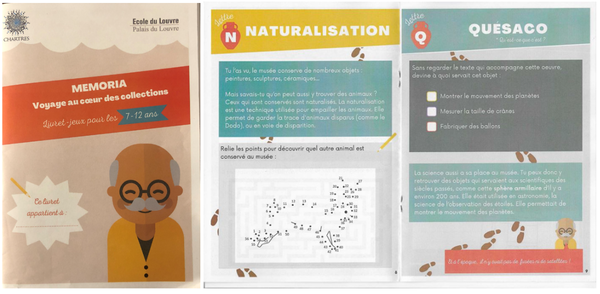
Le livret de visite enfant © M.B
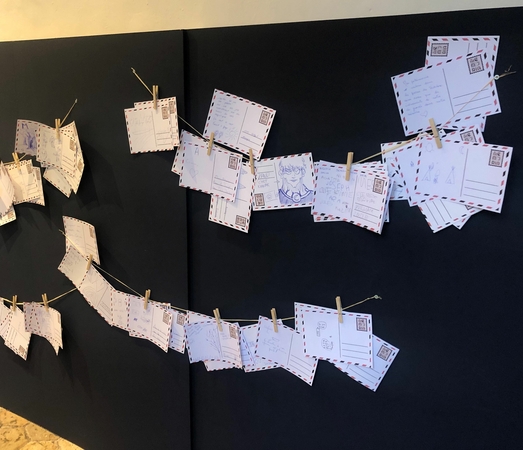
La dernière partie de l’exposition : Allez-y ! © M.B
Myrrha Bouly
Pour aller plus loin
Memoria. Voyage au cœur des collections est accueillie du 29 octobre 2022 au 26 février 2023 au musée des Beaux-Arts de Chartres.
La présentation de l’exposition :
-
https://www.chartres.fr/musee-beaux-arts/expositions-temporaires/memoria
- https://www.ecoledulouvre.fr/es/node/1105
Les coulisses et la programmation culturelle sont à retrouver sur Instagram :
#exposition #muséologie #projetétudiant

Musées, écomusées et territoire
Géographie et cultures est une revue qui aborde la géographie d’un point de vue culturel. Depuis 1992, elle met en avant l’état de la recherche de ces deux domaines en France comme à l’étranger. Le numéro 16 de cette revue, parue en 1996 proposait une étude thématique sur les musées, les écomusées et les territoires. Cette édition analyse et étudie les prémisses et les premières apparitions des musées d’Arts et Traditions populaires jusqu’au premier écomusée de La Grande Lande en passant par le musée d’ethnographie du Trocadéro. Cet ouvrage, facile à lire et clairement structuré, aborde successivement : études de cas des différents musées, analyse et étude d’une communauté et de son territoire puis interventions de professionnels.
Un bref résumé nous est présenté au début de chaque partie, il sert de guide référentiel à travers la lecture et permet un rapide repérage. Des mots-clés ainsi qu’un résumé en français et en anglais nous sont proposés. Chaque fin de chapitre est accompagnée d’une bibliographie ainsi que lessources et les annexes de chaque partie. Des exemples, des citations, des images et des schémas illustrent l’ouvrage.
Les premiers écomusées vont apparaître en région, le musée s’efface pour laisser place à une nouvelle forme de musées valorisant le folklore régional. Cette revue géographique aborde et découpe quelques territoires européens, la France, la Belgique et la Grèce. Géographie et Cultures présente les idées et les décisions prises avec une approche analytique des phénomènes engendrés sur le territoire par ces nouvelles apparitions muséales.
De George Henri Rivière à aujourd'hui
Dans une première partie, la revue analyse les musées, les écomusées et le territoire avec précision, de leur apparition jusqu’à ce qui fait la particularité des différents lieux choisis. Par exemple, l’écomusée d’Alsace est étudié, en présentant un historique du lieu en abordant différents points, toujours en lien avec le territoire comme par exemple l’identité alsacienne, la naissance de l’écomusée puis l’histoire de la région et ses enjeux. La revue met en avant la démarche de l’écomusée face à la sauvegarde du patrimoine local ainsi qu’à l’aménagement possible entre les différentes infrastructures culturelles déjà présentes. Ces actions sont présentées par séquences à la fois géographique et historique. La revue expose les études de cas en les accompagnant de référence bibliographique tel que George-Henri Rivière ou encore Jean-Robert Pitte. Des études géographiques sur l’urbanisation et la place de certaines coutumes religieuses occidentales comme la présence de cimetières dans le paysage à la fois urbain et rural vont être remises en cause par les changements sociétaux. On remarque que l’ouvrage propose des moyens de comparaison pour cerner et remettre en contexte les différentes étapes de construction de ces évolutions.
Après ces séquences, une partie est consacrée aux témoignages de professionnels. Plusieurs thématiques sont abordées en lien avec le sujet, par exemple la diversité culturelle géographique ou la divergence de formes en matière de paysage. Plus on avance vers la fin du livre moins le sujet aborde la muséographie et se dirige vers des questions géographiques. Il est intéressant d’étudier ces sujets car cela permet d’appréhender comment les structures muséales s’implantent dans l’espace et se confrontent à ces problématiques de paysage.
Cette revue est une bonne manière de comprendre le sujet des premiers écomusées, musées de plein air et des musées en région. Cette thématique croise deux domaines d’activité distincts, la culture et la géographie, enrichissant la muséographie d’un autre angle de vue. Géographie et Cultures ouvre la réflexion sur la place de ces musées et leur évolution au sein du territoire, une question toujours d’actualité.
Marie Despres
Disponible à la bibliothèque universitaire d'Arras

Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Un musée archéologique qui n'a rien de poussiéreux
Façade du Musée archéologique de Naples Crédits : BE
Étape essentielle du voyage dans l'antiquité gréco-romaine, commencé il y a plus de six siècles et qui nous passionne encore aujourd'hui, ce musée nous aide à comprendre cette culture à travers des collections impressionnantes, les histoires séculaires de ces objets et de leurs propriétaires ainsi que par l'histoire du site du musée et des lieux d'exception d'où proviennent ces collections archéologiques.
L'édifice qu'occupe aujourd'hui le Musée National Archéologique de Naples, Il Palazzo degli Studi, était une caserne de cavalerie du XVIème siècle avant d'abriter, lieu de savoir et de transmission par excellence, l'Université de la ville. C'est Ferdinand IV, qui à la fin du XVIIIème siècle, décide de créer un museum pour rassembler les importantes collections des fouilles archéologiques des sites d'Herculanum et de Pompéi, et la collection de la famille Farnèse.
Une mise en place didactique qui donne toute la lumière aux antiquités
Grâce à une scénographie thématique traditionnelle mais efficace, le visiteur se plonge dans toute la richesse et la culture de cette civilisation mère de l'art de notre société. Il traverse l'Antiquité Égyptienne, les galeries de statues monumentales représentant héros et dieux antiques, passe par les mosaïques et fresques des cités vésuviennes, célébrant les grands héros et la vie quotidienne, ou découvre dans un recoin de l'étage le Cabinet Secret révélant la sexualité débridée de l'époque (déconseillé aux moins de 16 ans !). Une grande partie des espaces du musée sont consacrés à l'exposition permanente, néanmoins les expositions temporaires y ont aussi leur place. Régulièrement des artistes installent de nouvelles œuvres ou les muséographes de l'institution mettent en place de nouveaux outils de médiation qui empêchent les œuvres antiques de s'empoussiérer et de tomber dans l'oubli !
Galerie des statues Crédits : BE
 Ces collections remarquables sont réparties selon différents espaces présentant la variété des collections, pour une meilleure compréhension de l'accumulation créée notamment par la famille Farnèse, ou celle de Caroline Murat. Mais aussi pour créer des thèmes, autour desquels le visiteur organise son parcours, en fonction des matériaux mais aussi des lieux de provenance. Le Musée s'inscrit dans une volonté didactique, permettant de rapprocher œuvres et sujets. Malgré un manque de mise en relation entre les sites archéologiques alentours et les collections in situ, des efforts sont fait notamment avec une maquette en vois au 1/100ème qui restitue le site archéologique de Pompéi. La présence des vestiges antiques pose tout de même la question de savoir s’ils ne seraient pas plus intelligibles dans leurs sites d'origines que dans le musée, comme c'est souvent le cas dans le domaine archéologique.
Ces collections remarquables sont réparties selon différents espaces présentant la variété des collections, pour une meilleure compréhension de l'accumulation créée notamment par la famille Farnèse, ou celle de Caroline Murat. Mais aussi pour créer des thèmes, autour desquels le visiteur organise son parcours, en fonction des matériaux mais aussi des lieux de provenance. Le Musée s'inscrit dans une volonté didactique, permettant de rapprocher œuvres et sujets. Malgré un manque de mise en relation entre les sites archéologiques alentours et les collections in situ, des efforts sont fait notamment avec une maquette en vois au 1/100ème qui restitue le site archéologique de Pompéi. La présence des vestiges antiques pose tout de même la question de savoir s’ils ne seraient pas plus intelligibles dans leurs sites d'origines que dans le musée, comme c'est souvent le cas dans le domaine archéologique.
Un détour incontournable
Si vous êtes dans le sud de l'Italie, ne manquez pas cette étape incontournable de l'histoire gréco-romaine. Vous en aurez plein les yeux et pour tous les goûts ! Familles, scolaires ou individuels y trouveront forcément quelque chose à apprendre ou apprécier. De plus les manières, si italiennes des gardiens ou agent d'accueil, ne vous laisseront pas indifférents. Je ne peux que vous conseiller ce musée, véritable palais de beauté renfermant tant de trésors, qui nous invite tout de suite en franchissant la porte, dans un monde de merveilles.
BE
Museu Nacional Vive
Le musée est mort, vive le musée.
Alors qu’il fête ses 200 ans d’existence, le Musée National de Rio de Janeiro s’embrase soudainement. Tandis que les nuages de fumée s’élèvent vers le ciel, les collections s’éteignent peu à peu sur le bûcher de la négligence. Nombreux sont les articles qui décrivent toute l’horreur de la catastrophe qui a frappé le Brésil la nuit du 2 au 3 septembre 2018. Il ne s’agit donc pas ici de faire une énième énumération des pertes aussi colossales qu’inestimables, mais plutôt de faire l’archéologie de cette inhumation et d’entrevoir le phœnix renaitre de ses cendres. Pour ce faire, j’ai interviewé Manuelina Duarte, professeure de muséologie à l’Université de Liège et professeure du programme en anthropologie sociale de l’Université fédérale de Goiás au Brésil (équivalent Master et Doctorat), mais aussi directrice du Département des processus muséaux de l’Institut Brésilien des musées (IBRAM) entre 2015 et 2016.

Manuelina Duarte © Markus Garscha
Emeline Larroudé : De quoi cet incident est-il symptomatique ?
Manuelina Duarte : Cet incident est symptomatique d’une situation de total abandon de la culture et des musées au Brésil, par les politiques publiques. Il y a, depuis le coup d’Etat qui a eu lieu en 2016, tout un ensemble d’actions du gouvernement de Temer, notre actuel président, et d’autres actions déjà annoncées par le prochain président Bolsonaro, qui vont vers la suppression de la culture et de l’éducation publique au Brésil. Dès les premiers jours de sa prise de fonction, Temer a commencé par supprimer le Ministère de la Culture. Après beaucoup de lutte, le Ministère a été rétabli, mais même si le problème n’est pas nouveau, il y a eu de moins en moins de ressources financières pour le Ministère tout au long de l’année. On a eu un accroissement de l’investissement au Ministère de la Culture pendant les gouvernances de Lula da Silva, puis pendant la première de Rousseff, qui était la continuation de celles du Parti des travailleurs. Mais durant son deuxième mandat, les questions de coupes budgétaires pour la culture étaient là, et les réunions et négociations entre le Ministère de la Culture et le Ministère de la Planification et des Finances étaient de plus en plus dures. La décision de Temer de supprimer le Ministère de la Culture le premier jour de sa prise de fonction en dit long sur la façon de voir la culture. La question se posait déjà avec la politique de Rousseff : on avait ces coupes mais toujours l’espoir que la situation financière du pays s’améliore et que l’investissement serait alors plus important. En 2017, le gouvernement de Temer a quant à lui adopté une loi limitant les investissements dans la santé, l’éducation, la culture et les infrastructures du pays : ils ne peuvent dépasser ceux de 2016, et ce pendant 20 ans. Les investissements de 2016 définissent donc les limites maximales des investissements pour les prochaines 20 années. Ce manque d’investissement est la cause de ce qui est arrivé au Musée National, malheureusement. Je peux déjà affirmer que cela va se reproduire dans d’autres musées mais aussi dans des hôpitaux, des écoles et des universités. Ce qui est bien, nouveau aujourd’hui, sera vieux, obsolète et désuet après 20 années sans investissements, et il est à prévoir de grandes tragédies pour les biens et les institutions qui sont déjà à risques.
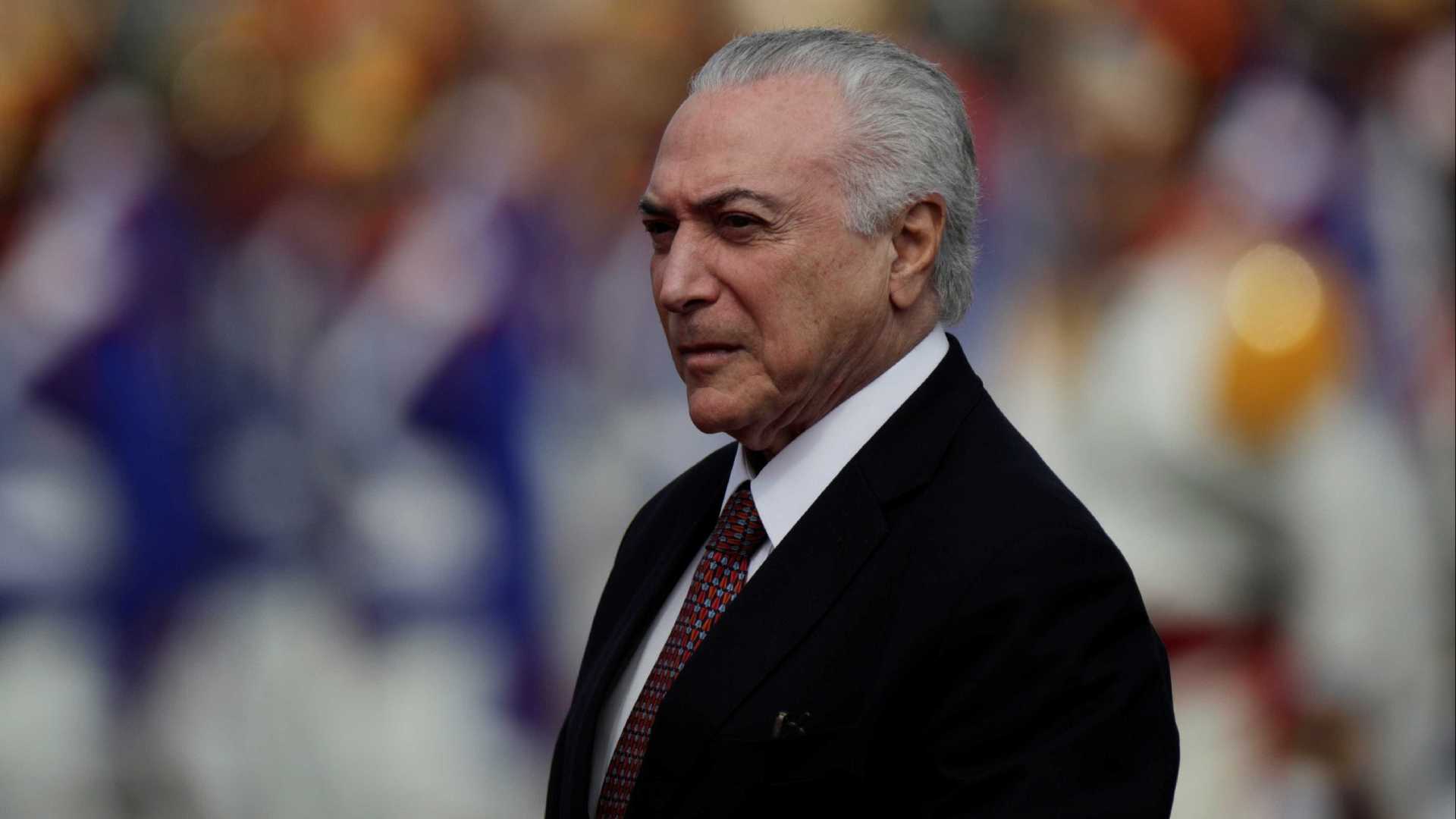
Michel Temer © REUTERS / Ueslei Marcelino
E. L. : Quelles mesures politiques sont prises ? Sont-elles significatives ?
M. D. : Les mesures qui ont été prises juste après l’incendie sont des mesures destinées à « sauver les apparences ». Le gouvernement et les politiciens ont très rapidement annoncé qu’ils allaient reconstruire le musée, et je pense que l’annonce immédiate de cette reconstruction trahit la volonté du gouvernement de contourner le problème et d’éviter toutes les discussions et débats qui devraient se tenir concernant les conditions, non seulement du musée incendié, mais plus globalement de l’ensemble des musées brésiliens. On pourrait apprendre de cette situation tragique pour décider d’investir davantage en amont pour d’autres musées et ainsi faire de la prévention. Que nenni, puisque le gouvernement préfère fuir la discussion. Mais ces mesures prises très vite n’ont pas maintenu cet élan face à la lenteur de notre bureaucratie. Même avec quelques aides internationales, le temps est nécessaire. Une chose importante est cependant en cours, bien qu’elle demande également du temps. Il s’agit d’une archéologie de sauvetage dans les ruines du musée pour essayer de trouver tous les vestiges des collections et les documents qui peuvent aider à reconstruire sa mémoire.
Une mesure politique désastreuse a été engagée par le ministre de la Culture les jours suivants l’incendie. Celui-ci a profité de cet épisode pour dire que le manque de ressources des musées brésiliens est dû à la complexité administrative, pour eux, de recevoir l’investissement privé. Il a donc annoncé la suppression de l’Institut Brésilien des musées qui est l’organe principal du Ministère de la Culture, présidant les 3700 musées brésiliens et responsable direct de 30 d’entre eux. Le musée National de Rio de Janeiro appartient à un autre ministère, non pas l’IBRAM mais le Ministère de l’Education, responsable des universités nationales dont fait partie l’Université Fédérale de Rio de Janeiro. Le Brésil comptant 68 universités fédérales, chacune ayant plusieurs campus et parfois 3 ou 4 musées, on peut estimer que le Ministère de l’Education possède environ 200-300 musées. D’autres musées dépendent de ministères différents, comme le Ministère des Transports ou le Ministère de la Justice. Cependant, sans le vouloir, le ministre de la Culture a laissé échapper que cet incendie était pour lui une « fenêtre d’opportunité ». C’est l’expression exacte qu’il a utilisée, une « fenêtre d’opportunité » pour effectuer les changements auxquels il songeait déjà auparavant : supprimer l’Institut et créer une agence brésilienne des musées. La différence entre l’agence et l’Institut est que l’agence ne va pas vraiment être un organe public gérant directement les musées avec l’argent du gouvernement, mais elle sera moins contrainte par les lois. C’est une institution à la gestion différente puisqu’elle peut recevoir des investissements privés avec plus de facilité. Mais ceux-ci ne sont pas pour autant monnaie courante. En effet, même en étant un musée public, le musée National de Rio de Janeiro pouvait recevoir des investissements. Comme presque tous les grands musées du Brésil, il a une association des Amis du musée qui peut lancer des projets et établir des partenariats avec les sponsors privés. Il y avait à ce titre un projet de renouvellement de 10 millions de réal (monnaie brésilienne, ce qui équivaut à 225 680 euros). Ce projet existait depuis longtemps mais n’a pas réussi à susciter l’intérêt des investisseurs privés. Comme le ministre l’a laissé entendre, l’incendie a donc été utilisé comme une opportunité pour déresponsabiliser le Ministère de la gestion des musées en créant une agence pour remplacer l’Institut. Rien ne dit cependant qu’il y aura plus d’investissements qu’avant car ils étaient déjà très rares. Lorsqu’ils existaient, ils étaient uniquement destinés aux grands musées, donc les petits musées ou musées de tailles moyennes vont être encore plus délaissés qu’ils ne le sont aujourd’hui. C’est un problème vraiment préoccupant, car le ministre de la Culture a réussi à faire signer la suppression de l’IBRAM et la création de la nouvelle agence par le président Temer. C’est exactement pour cette raison que l’incendie a été considéré comme une opportunité, puisqu’il a permis de créer une loi sans concertation du parlement, dans l’urgence. La loi autorise en effet le président, en cas d’urgence, à signer une loi comme celle-ci, bien qu’elle ne soit vraiment valide que si, dans un délai de trois mois, le congrès l’approuve. Pour le moment, cette discussion a étonnement eu pour résultat le maintien de l’IBRAM et, en parallèle, à la création d’une fondation privée qu’il gèrerait afin de pouvoir recevoir plus facilement les dons privés pour la sauvegarde des musées. Mais cela reste une discussion difficile car notre parlement est très peu préoccupé par les questions culturelles. Aucun des politiciens ne veut revoir ou supprimer le coût des pouvoirs publics relatif aux salaires des parlementaires, des juges, des agents publics, mais ils s’accordent à vouloir supprimer ce qui pour eux relève du luxe, comme la culture.

Vue aérienne du musée après l’incendie © AFP / Mauro Pimentel
E. L. : À quels retentissements internationaux peut-on s’attendre ? Des démarches sont-elles déjà mises en place ?
M. D. : On a reçu beaucoup de soutien de tous les pays, du Conseil International des Musées (ICOM), des grands musées internationaux... Quelques-uns comme la France ou l’Allemagne ont annoncé leur appui et même proposé quelques aides financières (à hauteur d’1 million d’euros pour ce qui est des Allemands). En ce moment ont lieu les travaux d’archéologie de sauvetage dans les ruines, de fortifications des ruines pour ne pas avoir davantage de destruction concernant les murs qui sont encore debout aujourd’hui. Plus de 2000 objets ont déjà été retrouvés. La prochaine étape concerne les travaux pour les préparations de projet. Mais le soutien international le plus significatif concerne la question de l’information. Je pense que, plus que d’obtenir de l’argent, on a réussi à informer. Il y a beaucoup de partage des informations liées aux collections détruites du musée National de Rio de Janeiro qui sont dans les bases de données des musées internationaux. Ils nous aident à, d’une certaine façon, regrouper au moins digitalement une partie des données conservées sur les collections perdues. Donc, les musées qui ont sauvegardé des informations, données, qui ont photographié les collections brésiliennes, sont en train de contacter le musée National pour collaborer avec lui. Il y a également une offre internationale du point de vue de l’expertise, pour ce qui est de la restauration, de la reconstruction du bâtiment, etc.

Bannière de la campagne Museu Nacional Vive © UFRJ
E. L. : Comment appréhender cet incident à l’échelle du musée ? Qu’en faire ?
M. D. : Le musée a fait preuve d’une grande réactivité. Rapidement, les équipes se sont réunies pour essayer de sauver tout ce qui pouvait encore l’être, et ce dès l’annonce de l’incendie. Les gens se sont précipités, ce dimanche-là. Les scientifiques, les chercheurs, ont couru au musée pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l’être et qui était moins pris par les flammes. Pour ce faire, ils se sont mis en danger eux-mêmes. Dans les jours suivants, ils ont tous vivement soutenu l’idée que le musée vit encore. Oui, les pertes sont énormes et quasi totales, mais toute la connaissance est là. Les recherches étaient parfois copiées sur des ordinateurs personnels, tout est fait pour que les données puissent être réunies. Je pense qu’à ce moment-là, l’action du service éducatif du musée a été vraiment très forte, importante, symbolique. Il a lancé une campagne : « Museu Nacional Vive » (le musée National vit). Ils ont sensibilisé quelques artistes, beaucoup de Brésiliens ont fait des campagnes volontaires pour demander aux gens qui ont des photos du musée de les partager, ou de faire des dons financiers. Pendant l’incendie, les collections, en brûlant, se sont parfois envolées. Il était donc possible de trouver de petits morceaux de collections d’insectes ou de feuilles de papiers semi-brûlées dans les appartements, les rues, les maisons, les jardins jusqu’à 2km autour du musée, ce qui a également permis de sauver quelques informations. Le service éducatif du musée a donc fait une grande campagne pour retrouver ces morceaux ainsi que toutes les photos, informations et témoignages que les gens pouvaient conserver à propos du musée. Grâce à ce travail colossal, un google street view du musée a pu être réalisé. L’action éducative du musée est particulièrement impliquée, c’est une des parties les plus actives dans ce processus de recomposition du musée qui n’est pas seulement un processus de reconstruction de bâtiment mais bien de reconstruction des liens entre le personnel du musée et la population, autant qu’en interne. Tout le monde a beaucoup souffert émotionnellement, face à cette situation. Tous les événements et actions qui ont eu cours les jours suivants dans les jardins du musée ont été initiés pour prouver, à la population mais aussi à eux-mêmes, que le musée vit encore et qu’il n’est pas mort.
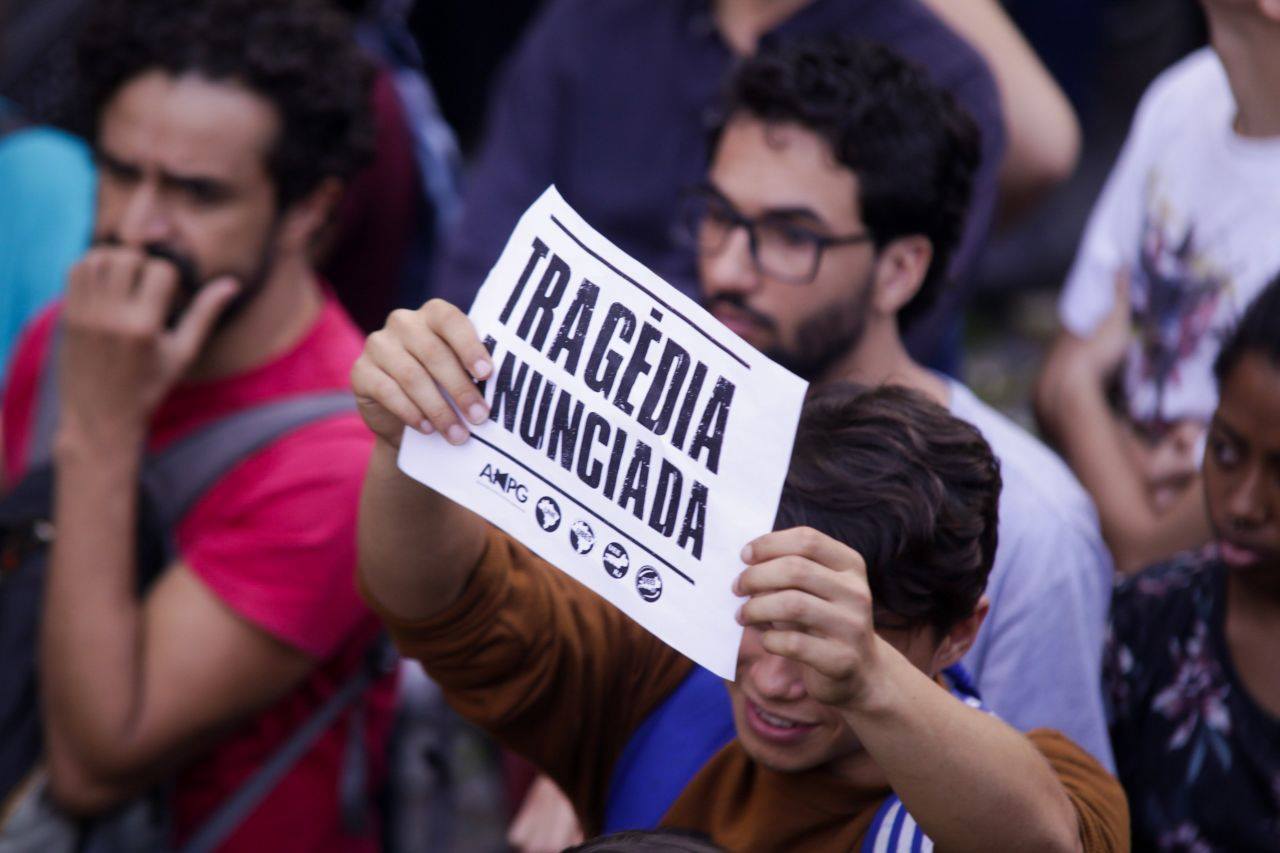
Population mobilisée devant le musée à la suite de l’incendie © Annelize Tozetto
E. L. : Cet événement a-t-il permis l’éveil d’un plus vif intérêt ou d’une sensibilisation plus grande par les brésiliens ? Quelle réaction du public, des visiteurs ?
M. D. : Cet événement a vraiment touché les Brésiliens. Malheureusement, je ne sais pas si l’effet va s’estomper ou au contraire perdurer. Sur le moment en tout cas, la population a été très touchée, très solidaire, particulièrement la population de Rio mais aussi celles des autres villes brésiliennes. Tout le monde a suivi l’événement sur la télévision, c’était un choc. Ils y ont tous été sensibles. La première réaction, notamment des habitants de Rio, a été de visiter non pas le lieu ni les ruines, qui sont protégés par la police pour les investigations, mais le jardin qui les entoure. Le personnel du musée y a organisé des événements les jours qui suivirent l’incident. La population s’y est rendue. Je pense qu’en général, on a constaté une vague d’articles, de réactions dans tous les médias : presse, télé... Tout le monde était préoccupé, par le musée National mais également par les autres musées. Je pense que le plus important est que cela a mis en lumière le fait que le musée National ne serait pas forcément un cas particulier, puisque beaucoup d’autres musées sont également en danger. En effet, le Brésil n’a ni les moyens suffisants ni une politique de prévention qui permettent de dire que les autres musées sont dans un meilleur état et sans risques.

Crâne de « Luzia », plus ancien fossile humain retrouvé au Brésil, dont une partie a été perdue dans l’incendie © Acervo Coordcom
E. L. : Quel musée de demain pour le Brésil ?
M. D. : Le Brésil est un grand pays, pauvre du point de vue économique mais très riche du point de vue de la culture, de la diversité, de la vivacité du peuple etc… Il a beaucoup à gagner avec des processus de muséalisation moins traditionnels, davantage liés à la culture populaire, à la culture vivante, aux savoir-faire, au patrimoine immatériel, tout ce qui se trouve dans le peuple en général et non derrière des vitrines. On a d’importantes collections, mais contrairement à l’Europe, je pense qu’on s’accorde beaucoup plus de libertés pour explorer ces autres modèles de muséalisation. Un événement comme celui-ci montre que concentrer les collections sous une seule institution, dans une seule structure parfois, c’est aussi créer une situation plus à risques qu’opter pour une sorte de décentralisation. Le plus important est la récolte des informations, la collecte, la réalisation des inventaires, des dossiers, des photographies … Mais parfois, ne vaut-il pas mieux ne pas réunir physiquement les collections ? On mène beaucoup d’expériences, au Brésil, d’inventaires participatifs. Ces expériences participatives ne décontextualisent pas les objets dans la mesure où ceux-ci restent chez les propriétaires originels, dans leurs maisons. Ils en sont responsables et vont les transmettre aux futures générations. C’est un véritable modèle, surtout si l’on tient compte du fait que le gouvernement ne semble pas vraiment intéressé à faire les investissements nécessaires pour les institutions. Ce partage de responsabilité mais aussi de propriété avec les communautés, pourrait aussi être particulièrement utile pour les Brésiliens qui n’habitent pas dans les capitales, car les grands musées comme celui-là sont toujours situés dans de grandes villes brésiliennes auxquels tous n’ont pas accès. 80% des quelques 5000 villes brésiliennes n’ont aucun musée. Les musées sont surtout concentrés dans le Sud et le Sud-Ouest du Brésil, régions les plus riches, dans les capitales et sur les littoraux. On a donc un grand désert muséal au Nord, au Nord-Ouest et au Centre du Brésil. Je pense qu’on ne peut occuper ces espaces vides qu’avec la multiplication des initiatives communautaires, des initiatives plus petites et diffusées de manière décentralisée. C’est préférable au fait de créer de grands musées avec des architectes connus dans les capitales du pays. La reproduction du modèle européen, basée sur une perspective courte, ne peut pas réussir à occuper tous ces grands espaces de 8 millions de km² dans un pays qui a toujours dit que la culture ne fait pas partie de ses priorités.
Emeline Larroudé
#museunacionalvive
#lutomuseunacional
#museunacional
Pour en savoir plus :
http://www.museunacional.ufrj.br/

OSIRIS ET SES MYSTERES SAUVÉS DES EAUX
Depuis le 8 septembre 2015 se tient à l’Institut du Monde Arabe l’un des rendez-vous culturels les plus attendus de cette rentrée ; « Osiris : Mystères engloutis d’Egypte ». Cette exposition propose un voyage passionnant à travers les cités antiques égyptiennes englouties ainsi qu’un regard neuf sur les rituels fondateurs de cette civilisation. Dans une atmosphère aquatique, le visiteur plonge à la découverte des vestiges et des objets de culte sauvés des eaux, des prêts extraordinaires, inédits à Paris.
« Osiris : les Mystères Engloutis d’Egypte » est le résultat d’un rêve, celui de Franck Goddio, archéologue sous-marin. En 2006, il expose pour la première fois en France avec « Trésors engloutis d'Egypte » qui rassemblait au Grand Palais des pièces issues des fouilles sous-marines dans les eaux proches d'Alexandrie. L’exposition à l’Institut du Monde Arabe est quant à elle une mise en scène de ses multiples découvertes faites lors de ces dix dernières années dans le delta du Nil. Sept années supplémentaires depuis la première exposition française ont permis de sonder l'ouest de la baie d'Aboukir, avec l'équipe de l'IEASM (Institut Européen d'Archéologie Sous-Marine) regroupant près de soixante plongeurs et égyptologues. De quoi découvrir la ville de Canope (à 1,8 km du littoral actuel) et la cité portuaire de Thônis-Héracléion (à 6,5 km), immergées depuis le VIIIe siècle. Ces années de fouilles permettent aujourd’hui d’exposer au regard du plus grand nombre 250 objets plongés dans les eaux depuis l’Antiquité mais également une quarantaine d'œuvres provenant des musées du Caire et d'Alexandrie.
Des découvertes à la signification historique hors du commun qui illustrent la légende d’Osiris, un des mythes fondateurs de la civilisation égyptienne : Osiris, fils de la Terre et du Ciel, qui fut tué par son frère Seth. Ce dernier démembra le corps d’Osiris en 14 morceaux avant de le jeter dans le Nil. Isis, soeur-épouse d’Osiris, grâce à ses pouvoirs divins, remembra son corps, avant de lui rendre la vie et de concevoir leurs fils : Horus. Osiris devint alors le Maître de l’Au-delà et Horus, victorieux de Seth, eût l’Égypte en héritage. L'histoire racontée au fil de cette exposition est celle des « Mystères d'Osiris », une cérémonie qui évoquait, dans tous les grands temples de l'Egypte antique, la mort et la régénération du dieu légendaire. Depuis la découverte d'une stèle en1881, on savait que les « Mystères » étaient célébrés au temple d'Héracléion, avant une procession nautique jusqu'au sanctuaire de Canope. Sur les deux sites et au long du canal les reliant, ce sont des statues et des centaines d'instruments rituels et offrandes cultuelles que les fouilles ont permis de mettre en lumière. Aujourd'hui mis en scène, les trésors historiques occupent tous les espaces de l'Institut du Monde Arabe (salles d'exposition niveaux +1/+2). Aufil d’un parcours incroyablement bien pensé de 1100 m², le visiteur est sensiblement initié aux histoires de ces célébrations ainsi qu’aux rituels qui étaient réalisés dans les temps dans le plus grand secret. Il déambule au travers les salles sur les sites maintenant immergés des deux villes et suit les processions nautiques qui avaient lieu chaque année sur ce site archéologique marin.
© Christophe Gerikg – Franck Goddio/Hilti Foundation
Dès l’entrée dans la première salle, l’audioguide sur les oreilles, le ton est donné. C’est une véritable immersion, l’ambiance est sombre et élégante. L'exposition s'ouvre par une cimaise en transparence sur une salle consacrée au mythe, avec deux statues célèbres d'Osiris et Isis du musée du Caire. Domine alors dans la pièce une statue monumentale en granite rose de plus de cinq mètres de haut, remontée du fond des eaux. Elle représente Hâpy, père des dieux, qui incarne l'abondance et la crue du Nil et vient rappeler l'importance du fleuve dans la vie de l'Egypte. Des hiéroglyphes projetés sur les murs au travers de lasers lumineux permettent une immersion linguistique et visuelle auprès du peuple égyptien mais aussi d’occuper intelligemment le haut des murs de cette salle particulièrement haute. Dès cette première salle on réalise l’importante présence qu’aura le texte tout au long du parcours. Ce qui est un atout pour le public non ou peu initié à l’antiquité Égyptienne mais qui peut vite devenir une saturation d’informations pour le public connaisseur, pour qui l’information sera doublement alourdie par l’audioguide. De nombreuses frises chronologiques ou encore cartes géographiques des sites de fouilles permettront quant à elles au visiteur de situer le sujet de l’exposition dans un cadre spatio-temporel très facile de compréhension, quand il est possible d’accéder à leur lecture dans les espaces exigus malgré la foule.
© Franck Goddio /Hilti Foundation
Le spectateur monte ensuite à l’étage, où un système de code couleur lui permet de différencier aisément les objets issus des fouilles marines représentés sur un fond bleu, de ceux provenant des musées du Caire et d’Alexandrie représentés sur un fond rouge. Différents panneaux imprimés dans une gamme chromatique d’un mélange de bleu et de vert, serviront de source lumineuse durant le reste du parcours. L’impression floue rappelant ainsi l’élément aquatique organique duquel les œuvres ont été séparées afin de ravir les yeux d’un plus grand nombre. La visite se poursuit au milieu des trésors spectaculaires tels que des statues, des stèles, des pièces de monnaie ou encore des bijoux parfois gros comme une tête d’épingle et dont des loupes placées devant ceux-ci permettent d’entrevoir toute leur splendeur. C’est à partir de cet étage que débute l’utilisation de la vidéo, qui servira à montrer des séquences filmées des plongées et différentes fouilles, permettant ainsi au spectateur de sentir l’excitation de la chasse au trésor mais également de découvrir les différentes étapes qui ont précédées celles de la mise en vitrine. Les écrans sont souvent placés dans les coins des différentes salles, rendant l’accès difficile lorsque le public est très nombreux dans une même salle. Même constat pour la plupart des textes imprimés proches des objets exposés. Plus l’exposition avance et moins les personnes lisent les textes ou détiennent encore l’audioguide sur leurs oreilles. Cet effet est sans nul doute dû à la grande vague de visiteurs. Les conséquences inévitables d’un immense succès.
© Franck Goddio/Hilti Foundation
©Samantha Graas
A l’élément aquatique se combine la représentation de la voûte céleste au moyen de différents procédés. En effet, à l’intérieur de plusieurs vitrines, des panneaux percés de centaine de petits trous permettent à la lumière de s’y infiltrer et d’éclairer, tel un ciel étoilé, les stèles exposées. Le procédé se répète vers la fin du parcours avec un système de projection laser dessinant au sol des milliers de points lumineux, rappelant les origines primaires d’Osiris, fils du Ciel et de la Terre. La muséographie de l’exposition réalisée par MartineThomas-Bourgneuf, est sans nul doute d’une grande ingéniosité et dans un discours très poétique au service de la légende et de l’Histoire.
L’exposition se tiendra à l’Institut du Monde Arabe jusqu’au 31 janvier 2016 et promet d’accueillir encore un grand nombre de visiteurs ravis de cette expérience presque subaquatique.
Samantha Graas
En savoir plus : www.exposition-osiris.com
#Archéologie
#Osiris
#Institut du Monde Arabe
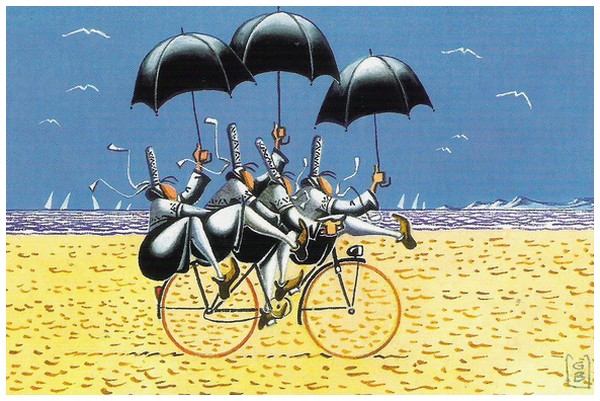
Par une matinée pluvieuse...
De retour dans ma ville natale en Bretagne où il pleut, quoi de plus naturel pour une étudiante en muséographie qui s’ennuie que de se rendre au musée le plus proche ! Le musée en question est un petit musée d’histoire locale et maritime, le Musée Maritime du Cap-Sizun. Il me semble y avoir été une seule fois, il y a très longtemps, à une époque où les musées ne devaient pas beaucoup m’intéresser.
Dans mon souvenir il était rempli d’un bric à brac non identifiable et vraiment vieillot, comme la boutique d’un antiquaire. C’est avec cette image en tête que j’y suis retourné.

© TripAdivsor
Le prix est plus que raisonnable (3€). Après avoir donné mon code postal (le même que celui du musée !), je pénètre enfin dans la première salle.

© J. L.
Bienvenue au Musée Maritime du Cap-Sizun
Eh bien… il s’avère que ce n’est pas très différent de mes souvenirs. Les objets sont exposés absolument partout, à même le sol, sous une table, dans un coin, au plafond… Au fil des salles (17 sur 3 étages !) je me rends compte qu’on peut distinguer au moins 3 périodes de réalisation du musée grâce aux panneaux explicatifs. Certains sont plus lisibles que d’autres, même si dans l’ensemble il y a énormément de texte. Je peine à tout lire, alors je sélectionne selon les sujets qui m’intéressent le plus : la vie à terre, les phares, les ports abris, le sauvetage…
https://www.youtube.com/watch?time_continue=183&v=LrYFC2VW_uQ
© Cinémathèque de Bretagne
Même s’il ne paye pas de mine, ce petit musée me prend dans ses filets. Je découvre une photo que je ne connaissais pas de mon arrière-grand-père, membre de l’équipage du canot de sauvetage d’Audierne dans les années 1960. Plus loin, dans la salle sur la construction navale, des images des anciens chantiers navals du coin, y compris celui que mes parents ont racheté. J’ai déjà vu ces images, mais les voir ici, dans un musée, leur donne une dimension historique que je ne saisissais pas avant. Parmi les photos exposées, je repère des figures familières de mon enfance, un patron de chantier, ses charpentiers et un patron pêcheur.
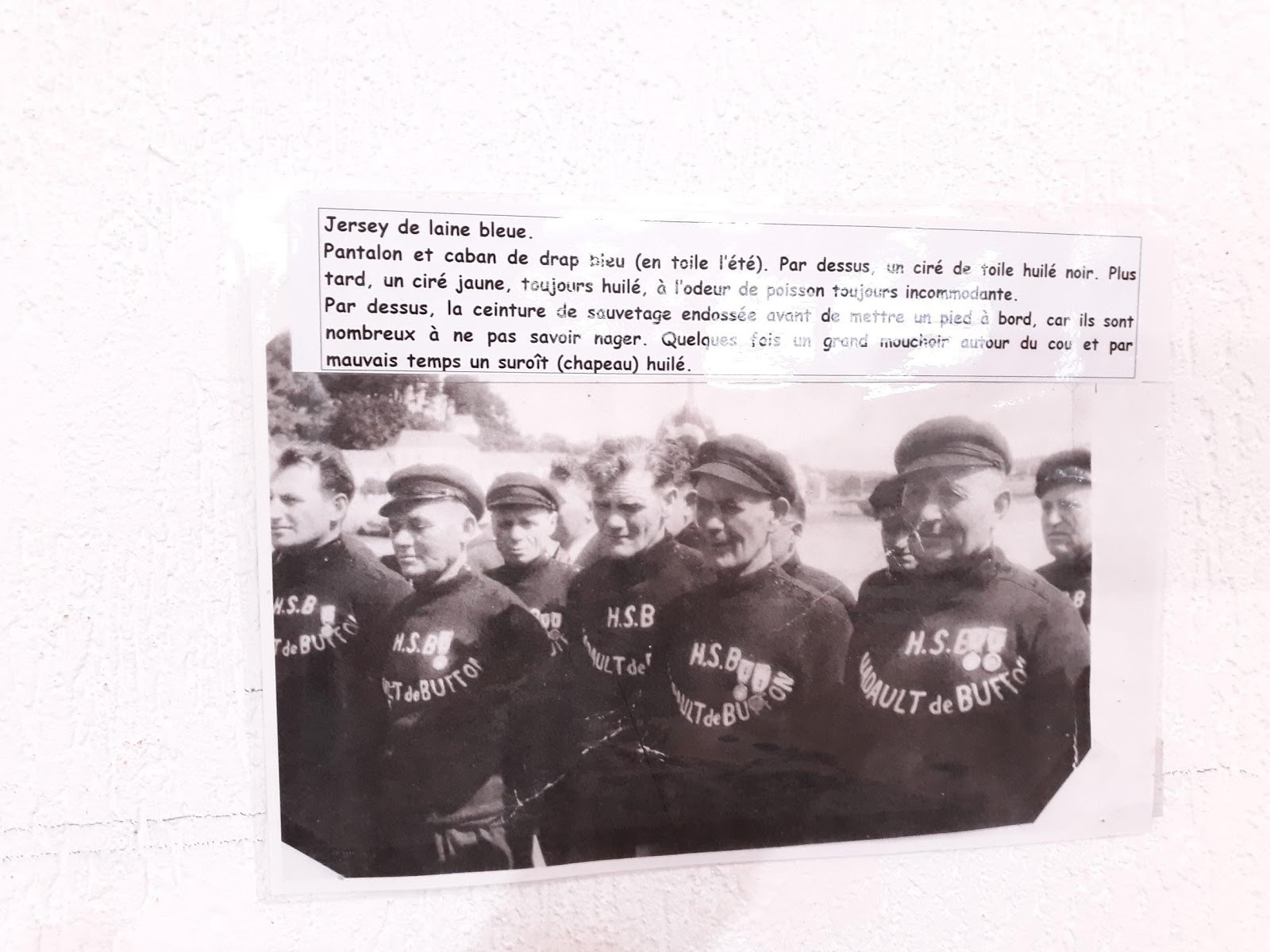
Mon arrière-grand-père Pierre Kervévan, le deuxième à partir de la gauche © J.L.
Au détour d’un panneau sur le phare de la Vieille, j’apprends que les grands blessés pendant 14-18 avaient des emplois réservés, supposés moins pénibles que d’autres. Gardien de phare en était étonnamment un, ainsi que… gardien de musée !
Sans prétention, le Musée Maritime du Cap-Sizun présente des centaines d’objets issus de collectes, de prêts de membres de l’association qui le porte, ainsi que de prêts d’institutions telles que le DRASSM (Département de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines), le service des Phares et Balises… L’association bénéficie du soutien de quelques maquettistes qui donnent régulièrement leurs créations au musée, ce qui enrichit énormément la visite. Naïves ou détaillées, professionnelles ou exécutées avec les moyens du bord, les maquettes réjouissent l’œil du visiteur.

© J.L.
La scénographie hétéroclite fait sourire : ici il s’agit de quelques coraux et coquillages dans une vitrine, puis d’une pièce entière dédiée à un diorama, un lit qui fait office de “vitrine”...


Dioramas © J.L.
Sans en être véritablement, quelques éléments peuvent être qualifiés de “manipulations” : quelques outils paléolithiques disposés dans la première salle sur l’histoire des premiers peuplements du Cap-Sizun, une coupe “tactile” montrant les matériaux utilisés pour la coque d’un canot de sauvetage…
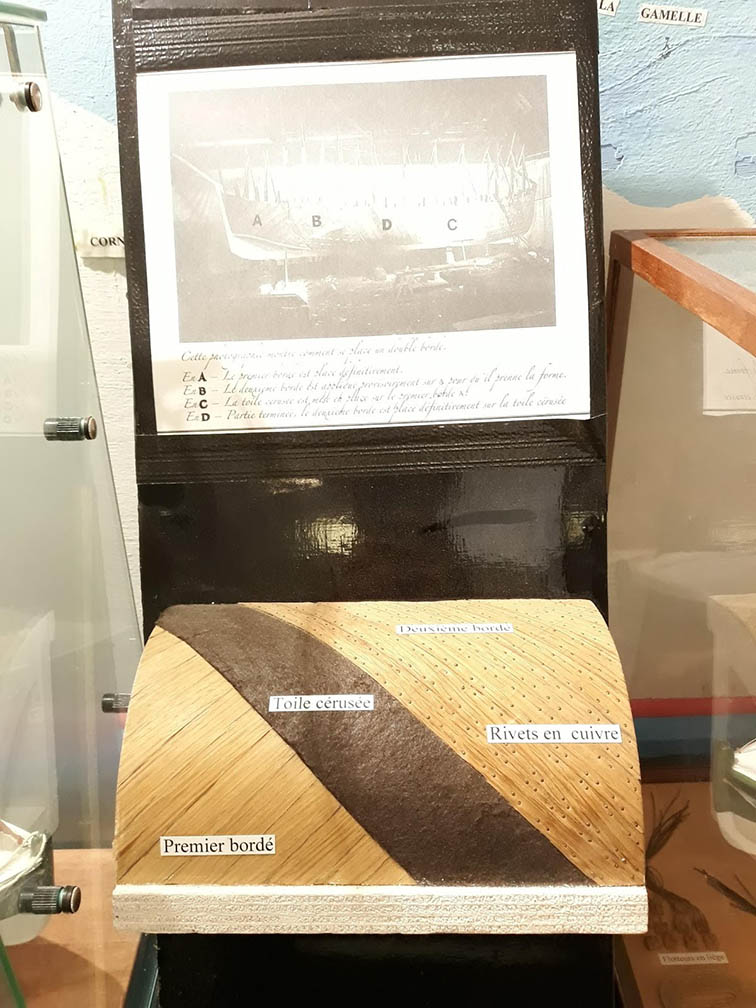
© J.L.
Sans prétention aucune, ce petit musée distille d’innombrables connaissances sur un grand nombre de sujets. Le visiteur découvrira avec plaisir l’histoire du Cap-Sizun, s’amusera devant certaines anecdotes, et s’il est du coin, il risque de retrouver de la famille, des amis ou voisins dans les nombreux portraits des hommes et des femmes du Cap-Sizun présentés tout au long du parcours. Loin d’être délaissé par les touristes (une dizaine de personnes un lundi matin d’août à 10h30 !), il réussit à transmettre à son public l’essence du Cap.
Ce musée ne serait pas grand-chose sans ses bénévoles, qui le font véritablement vivre depuis sa création. Initiateurs des collectes, guides, commissaires d’exposition, ils endossent tous les rôles. C’est aussi grâce à eux que le musée bénéficie de nombreux partenariats, comme c’est le cas pour l’exposition temporaire actuelle sur Les marins de l’offshore.
Toutefois l’apparence hétéroclite du musée et son peu de moyens se répercutent sur la cohésion générale du propos, qui gagnerait à se recentrer véritablement sur le local. La création en 2017 d’un comité de pilotage chargé de l’étude des pistes de refonte laisse présager un avenir prometteur pour le Musée Maritime du Cap-Sizun, s’il aboutit à des pistes concrètes et réalistes.
Sur la route du retour, mon œil est attiré par une affiche jaune et bleue avec un nom bien connu : la Maison Hénaff, à quelques kilomètres d’Audierne. La prochaine fois peut-être ?
Pour en savoir plus :
Rue Lesné
29770 Audierne

Paris libéré
Le feu Mémorial du Maréchal Leclerc de Hautecloque et de la Libération de Paris – Musée Jean Moulin, puis Musée du général Leclerc et de la Libération de Paris – Musée Jean Moulin, a fermé ses portes au public le 1e juillet 2018. Mais ce n’était que pour mieux rouvrir le 25 août 2019, à l’occasion du 75e anniversaire de la Libération de Paris ! Plus qu’une réouverture, il s’agit véritablement d’un déménagement du musée qui en profite par la même occasion pour changer de nom en se muant en Musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin. Une dénomination qui rend hommage aux deux hommes de manière égalitaire, leur donnant le même statut. Il quitte alors sa dalle au-dessus de la gare Montparnasse pour se rapprocher de ses compères du réseau Paris Musées, les Catacombes de Paris, place Denfert-Rochereau.

Vue du square Nicolas Ledoux sur le musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc - musée Jean Moulin © Ch. Batard, Agence Artene
Un nouveau lieu
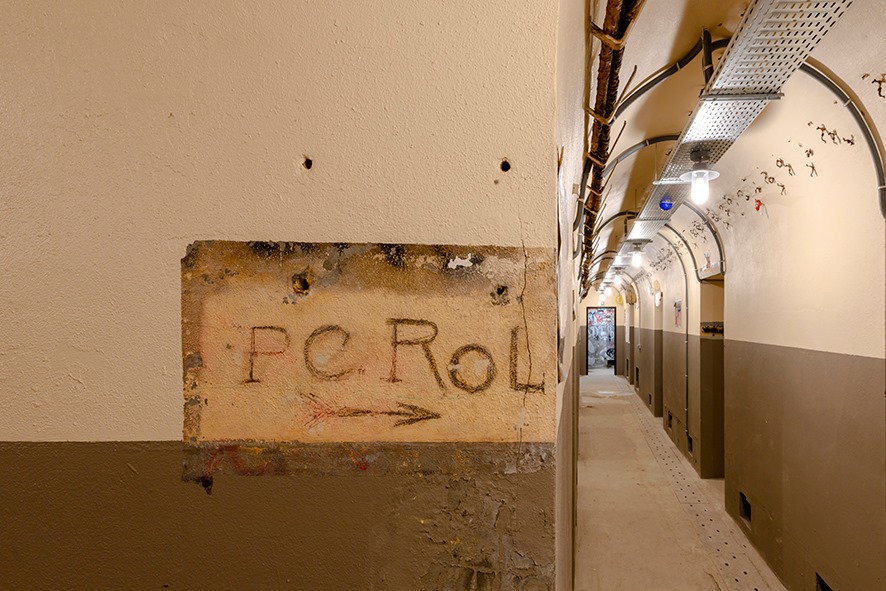
Le poste de commandement du Colonel Rol © Pierre Antoine
Une histoire
Un lieu qui fait d’autant plus sens qu’il permet de proposer la visite de l’abri de défense passive du colonel Henri Rol-Tanguy, membre dirigeant de la Résistance durant la Seconde Guerre Mondiale. Ce niveau -2, accessible par un long escalier de plus de 100 marches, permet d’en percevoir le poste de commandement, avec son bureau, son secrétariat, son central téléphonique, son système de ventilation … Et d’appréhender l’organisation de la défense et les bombardements qu’a connu Paris. Il devient emblématique puisque tout le propos du musée est de questionner « l’engagement au cœur d’un monde en guerre », et de proposer « un regard renouvelé sur l’histoire de Paris et des Parisiens pendant la Seconde Guerre Mondiale ». Il s’agit là d’une histoire incarnée, humanisée, qui s’écrit à travers des portraits, des récits, des objets. C’est un véritable hommage aux résistants de tout ordre. Pour ce faire, quoi de plus évident que de s’intéresser particulièrement aux deux figures mises à l’honneur de par les dons et legs dont le musée a pu faire l’objet : Philippe Leclerc de Hautecloque et Jean Moulin.

Canne du général Leclerc de Hauteclocque. Entre 1931 – 1945 © Stéphane Piera / musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc - musée Jean Moulin (Paris Musées) / Roger Viollet
Deux hommes
Ils semblent ne jamais s’être rencontrés, et pourtant, leur combat était le même. Nés tous deux avant la Première Guerre Mondiale, ils refusent de se résoudre à l’occupation une fois la Seconde Guerre Mondiale venue. Chacun, sans jamais croiser le chemin de l’autre, se bat pour que la France et les Français puissent retrouver un jour leur Liberté.
Philippe de Hautecloque, futur général Leclerc, s’engage dans l’armée tôt, où il excelle de sorte à finir major à l’école de cavalerie de Saumur, puis premier à l’Ecole de Guerre après une mission au Maroc. Il termine seulement sa première année lorsque la guerre est déclarée. Jeune capitaine, il n’accepte pas le repli de ses trouves de la 4e division d’infanterie, il refuse deux fois la captivité et la défaite même blessé. Happé par les appels du général de Gaulle, il le rejoint et tente pour lui de rallier les pays d’Afrique équatoriale à leur cause. Avec un parcours remarquable, il participe à la Libération du pays en commandant la 2e Division Blindée.
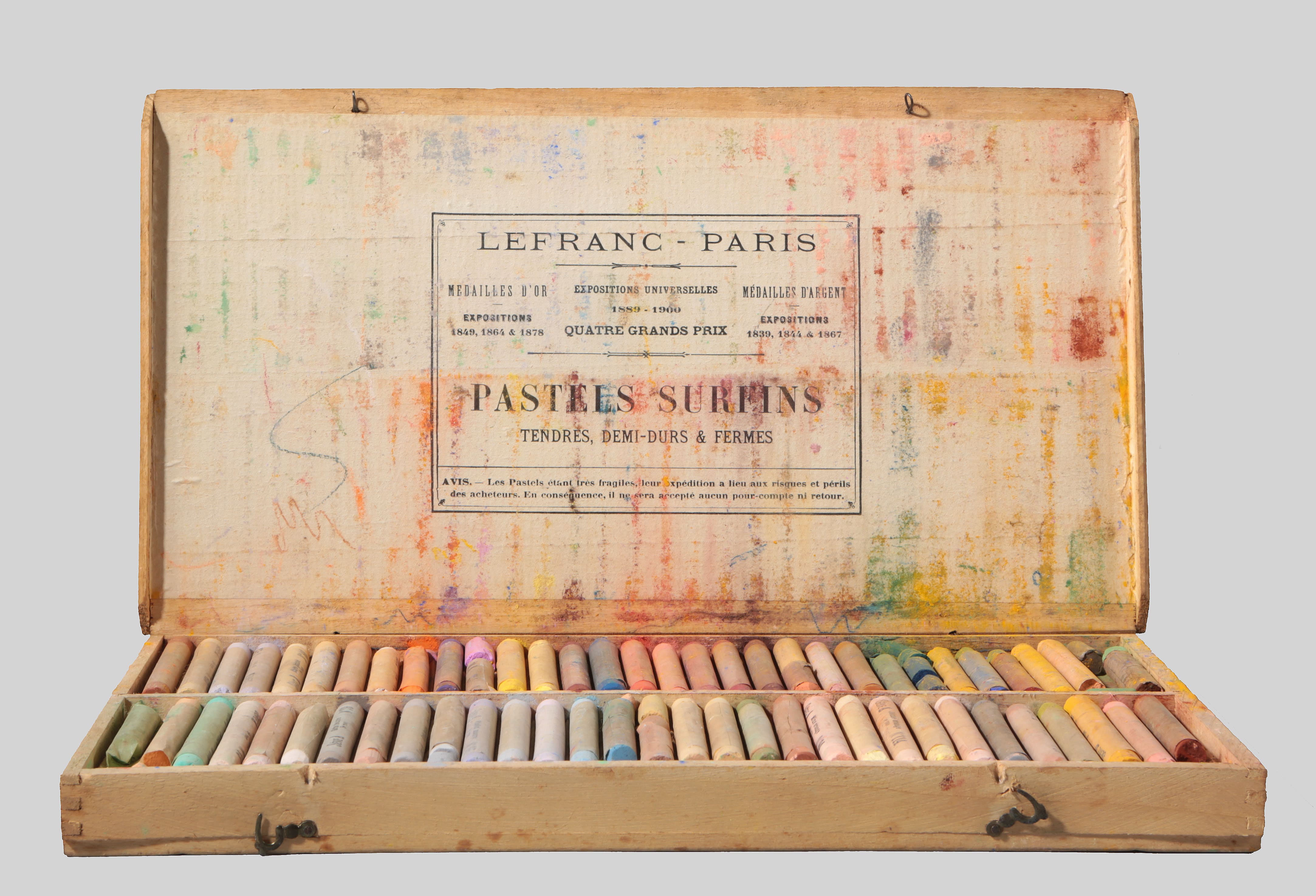
Boîte de pastels de Jean Moulin, don Escoffier-Dubois © Lyliane Degrâces-Khoshpanjeh / musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc - musée Jean Moulin (Paris Musées)
De son côté, Jean Moulin est un habitué des cabinets ministériels, menant une carrière dans l’administration préfectorale avant la guerre. Alors que les Allemands tentent d’avoir sa signature en le torturant, il privilégie le suicide au déshonneur mais est finalement soigné à temps. Il noue alors des contacts avec les « rebelles » jusqu’à, lui aussi, se présenter au général de Gaulle en tant qu’émissaire de la Résistance intérieure. Véritable coordinateur, il essaye malgré les difficultés de structurer les liens avec Londres. C’est aussi un amateur de dessin, ce qui explique ses liens avec Antoinette Sasse, artiste peintre et résistante française dont le legs est à l’origine du musée Jean Moulin inauguré en 1994. Ce goût lui permet d’avoir une couverture officielle : galeriste d’art à Nice où il ouvre un local en 1943. Tout comme Leclerc, il est fait compagnon de la Libération par le chef de la France Libre, Charles de Gaulle, et réussit à réunir le premier Conseil de la Résistance en plein Paris occupé. Ses entreprises sont pour le moins périlleuses et il finit par être arrêté, torturé par différentes Gestapo avant de mourir dans un train l’emmenant en Allemagne.

La 2e Division Blindée place Denfert Rochereau, le 25 août 1944 © Don Franco-Rogelio / musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc - musée Jean Moulin (Paris Musées)
À travers ces différents parcours de vie, le nouveau musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin invite le visiteur à se plonger au cœur de la guerre, où il s’agissait de faire face à des situations exceptionnelles. Loin d’appréhender des faits historiques déconnectés, c’est par le biais de l’individu que l’Histoire est explorée, afin que chacun puisse se projeter dans des tranches de vie tant riches que difficiles. C’est une Histoire humaine, qui permet de prendre une autre mesure de l’écart qui nous en sépare et des liens qui nous y lient. Il ne nous reste donc plus qu’à rendre hommage à ces résistants en se rendant place Denfert-Rochereau pour fêter le 75e anniversaire de la Libération le 25 août prochain ! Une réouverture qui ne pourrait pas faire davantage sens.
Emeline Larroudé
https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr
https://www.parismusees.paris.fr
#MuseeLeclercMoulinLiberationdeParis
#resistance
#secondeguerremondiale
Partez à l'aventure dans les mers du sud avec Jack London, aventurier et écrivain
Je ne vais pas mentir, je n'avais jamais lu aucun ouvrage de London avant d'entendre parler de l'exposition. Enthousiaste à l'idée d'aller découvrir l'exceptionnel voyage de l'aventurier dans le Pacifique sud, je me suis empressée d'aller à la bibliothèque de l'Alcazar pour emprunter un de ses livres. Je suis repartie avec Le peuple d'en bas, récit ethnographique sur … les habitants de l'East end de Londres. Pour l'immersion dans les mers du sud, c'est raté, mais cela me permet de me familiariser avec l'auteur et son écriture. Cette descente dans les quartiers miséreux de la capitale anglaise est d'ailleurs abordée comme une étude ethnographique dans une contrée lointaine. Je l'ai dévoré et au moment où j'écris, je m'apprête à embarquer de nouveau aux côtés de Jack London, cette fois dans le grand nord, grâce au célèbre Croc-Blanc.
Mais revenons à l'exposition. L'aventure commence par un trajet sur la ligne 2 jusqu'à l'arrêt Joliette, puis quelques minutes de marche jusqu'au quartier du Panier où se trouve la Vieille Charité.
Quelques mots sur le lieu d'exposition. La construction de la Vieille Charité a débuté en 1670 dans le but d'accueillir (enfermer, soyons honnêtes) les pauvres. Durant les siècles suivant, le bâtiment sert d'hospice puis est utilisé par l'armée. Au milieu du XXe siècle, la ville de Marseille décide de la rénover, les travaux se terminent en 1986.
La Veille Charité est aujourd'hui un lieu de culture, on y trouve le Musée d'Archéologie Méditerranéenne, le Musée des Arts Africains, Océaniens, Amérindiens (M.A.A.O.A), un cinéma et des expositions temporaires. De son usage premier, le bâtiment a conservé des petites cellules étroites (du moins au rez-de-chaussée).
À bord du Snark, leur voilier, Jack London et son équipage visiteront Hawaï, les Îles Marquises, les Îles de la société (dont Tahiti), les Îles Samoa, les Îles Fidji, les Nouvelles Hébrides et enfin les Îles Salomon, entre avril 1907 et décembre 1908.
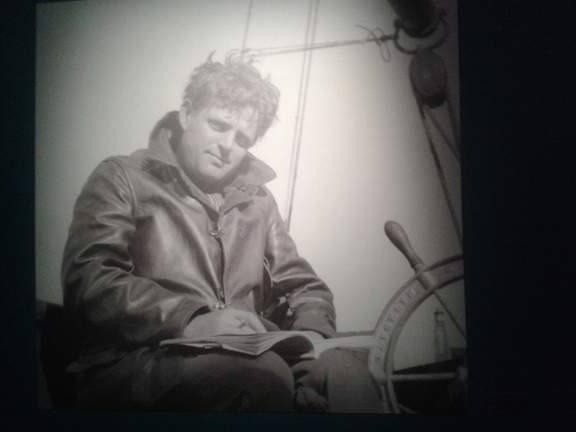
© C. L.
Lorsque l'on pénètre dans l'espace d'exposition, le premier objet exposé est une photo grand format de Jack London. Une première rencontre avec l'aventurier. Juste en face, une grande carte retrace le trajet des London dans les îles du Pacifique, depuis San Francisco jusqu'à la Mélanésie.
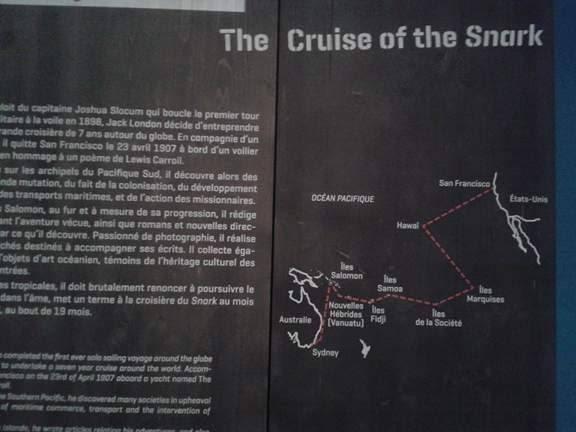
© C. L.
Le parcours est relativement classique mais cohérent et facile à appréhender. Il reprend le trajet effectué par London et son équipage à bord du Snark, son emblématique voilier. Chaque séquence représente une escale et une carte est présente à chaque nouvel espace pour situer géographiquement où l'on se trouve, ainsi que les dates de séjour de nos aventuriers.
L'exposition nous entraîne à la rencontre des peuples autochtones, à travers la présentation d'objets, de photos et de textes écrits par Jack London. À cela s'ajoute des anecdotes sur les conditions de voyage à bord du Snark, notamment les difficultés rencontrées par l'équipage qui manque d'expérience.
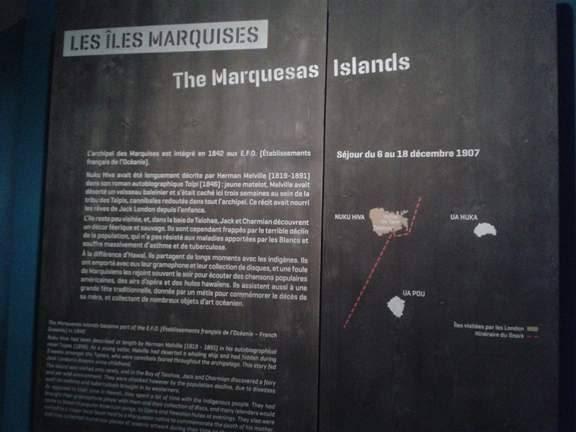
© C. L
D'un point de vue scénographique, la couleur dominante est un vert-bleu rappelant le Pacifique assez réussi. À cela s'ajoute l'utilisation d'un bois foncé qui sert de support aux textes, aux photographies et aux divers objets exposés. Cette teinte met particulièrement en valeur les photographies noir et blanc. L'ensemble est équilibré, la scénographie est assez épurée et au vu du nombre d'objets exposés assez important c'est un bon choix. Dans cet ancien hospice, l'espace d'exposition est divisé en petites cellules qui paraissent vite surchargées. L'exposition se termine dans la chapelle, au centre de la cour intérieure.
© C. L.
Un seul dispositif interactif est proposé dans l'exposition. Il s'agit d'un phonographe, qui s'inspire de celui emmené par notre couple d'aventuriers lors de leur périple, et d'une tablette tactile. À l'aide de cette dernière, les visiteurs peuvent choisir parmi une sélection de chansons, les mêmes que les London avaient choisi pour les accompagner pendant leur voyage. Ce dispositif est intéressant car il permet de découvrir la musique du début du XXe siècle mais également de partager un moment de vie avec les London.

© C. L.
Je regrette qu'une exposition traitant d'un périple aussi exceptionnel ne propose pas une visite plus immersive, alors que le thème s'y prête totalement. Les deux vidéos présentées ne paraissent pas complètement exploitées. Non seulement il n'y a pas de sièges pour les regarder confortablement mais l'une d'elles est sur petit écran (peut-être à cause de sa qualité médiocre). La deuxième, montrant un paysage paradisiaque, donne envie de s'attarder, de se perdre quelques minutes dans les îles du Pacifique, de se laisser gagner par l'ambiance, mais difficile de le faire quand on gêne le passage …
L'exposition dans la forme comme dans le fond manque un peu d'audace, alors qu'elle traite d'un intrépide aventurier. Les récits de Jack London sont de ceux qui font rêver, frissonner, donnent le goût du voyage, une envie d'explorer le monde, de se frotter à l'inconnu, de connaître le danger … Je n'ai pas ressenti cette passion dans l'exposition, qui apparaît alors bien timorée à côté des romans de London. D'autre part, le traitement des collections ethnographiques est très classique. En effet, il me semble essentiel de se questionner sur la mise en exposition de peuples non occidentaux. La représentation de ces cultures et des objets qui s'y rapportent traduit la vision que nous portons sur elles, à aucun la moment la parole n'est donnée aux autochtones que Jack London rencontre dans son expédition.
Cependant, on peut apprécier la transversalité de l'exposition : portrait d'homme célèbre, récit de voyage et ethnographie. Et même si la scénographie est un peu classique, elle m'a beaucoup plu et je l'ai trouvé pertinente au regard de la thématique.
Clémence L.
#marseille
#ethnographie
#voyage
#jacklondon
Pour en savoir plus :
Exposition temporaire au centre de la Vieille Charité à Marseille du 8 septembre 2017 au 7 janvier 2018
https://vieille-charite-marseille.com/expositions/jack-london-dans-les-mers-du-sud
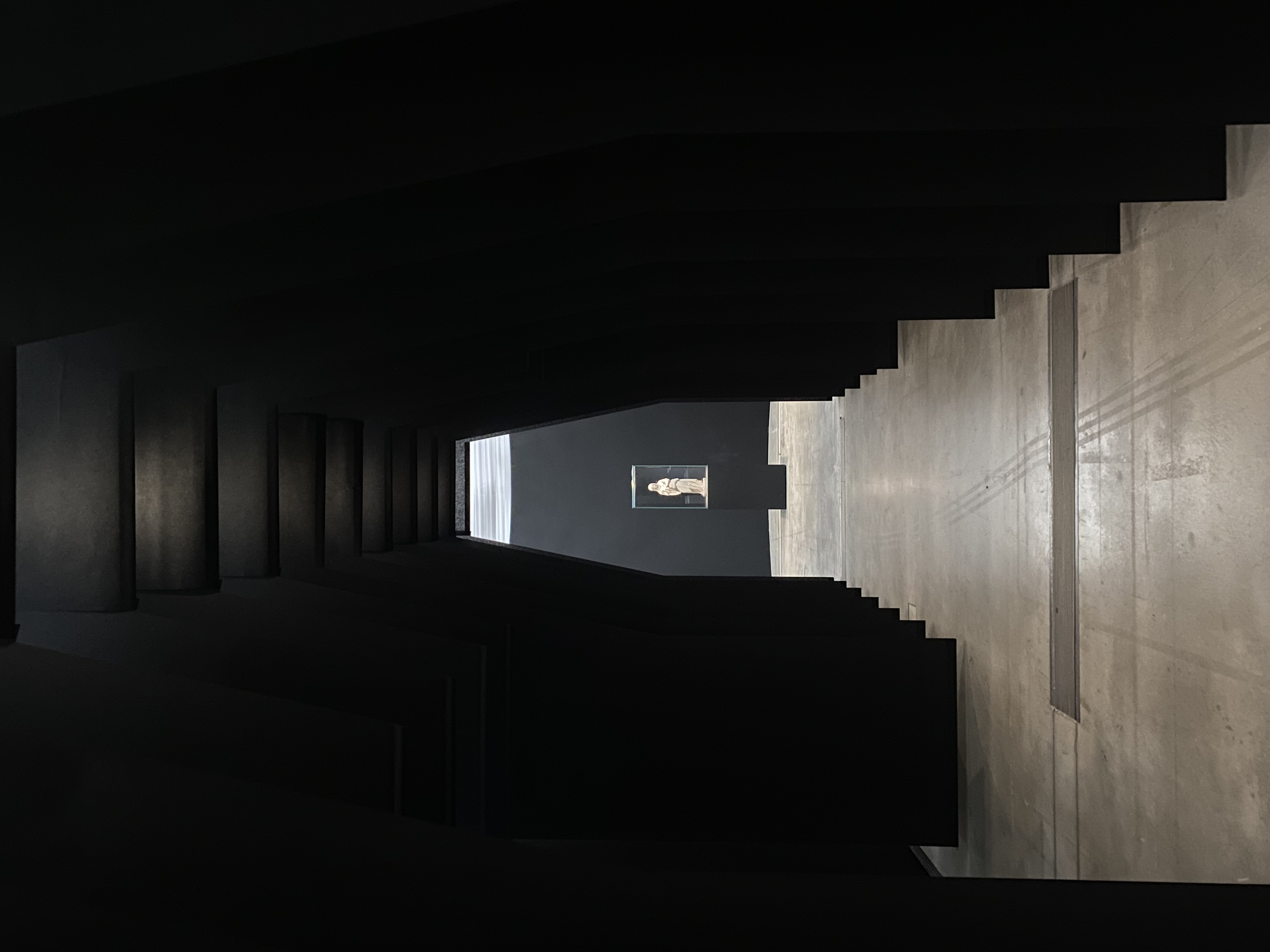
Plongez au fond du gouffre
« Quand on lutte contre des monstres, il faut prendre garde de ne pas devenir monstre soi-même. Si tu regardes longtemps dans l’abîme, l’abîme regarde aussi en toi. » Friedrich Nietzsche, Par-delà le bien et le mal,1886.
Exposition « Mondes Souterrains » au Louvre Lens, mars 2024 © EK
C’est au Louvre Lens, au cœur du bassin minier, que se déroule du 27 mars au 22 juillet 2024 l’exposition « Mondes souterrains. 20 000 lieux sous la terre ».
Imaginé par Alexandre Estaquet-Legrand (conservateur) et Jean-Jacques Terrin (architecte), le parcours commence par les tréfonds de la terre, il immerge dès l’entrée le visiteur dans le plus lugubre et sombre qu'il puisse connaître. Accueilli par la Sybille d’Érithrée de Jean-Jacques Caffieri, le message divin est clair : laissez-vous emportez dans les entrailles d’un monde redouté et inconnu. De par l’immensité du sujet, l’exposition explore par ses quelques 200 œuvres des mythes de différents temps, tout en les reliant à notre époque et au territoire minier.
Un monde énigmatique permettant la création

A gauche : Nathanaël Schaeffer et Julien Aubert, Visualisations issues de simulations numériques du processus de convection et champs magnétiques dans le noyau terrestre, CNRS, 2016-2023 © EK
A droite : Nathanaël Schaeffer et Julien Aubert, Visualisations issues de simulations numériques de la température du noyau terrestre dans le plan de l’équateur, CNRS, 2016-2023 © EK
Le monde souterrain est source de questionnements depuis l’Antiquité. L’exposition retrace l’évolution des perceptions de ces territoires par des œuvres représentant cette géographie hostile, insolite et inconnue. Ainsi, le visiteur peut voir aussi bien la Vue d’une grotte de Jean-Augustin Franquelin que de véritables images de la température du noyau terrestre effectuées par deux chercheurs du CNRS Nathanaël Schaeffer et Julien Aubert.
Tous les orifices de la terre sont exposés : grottes, volcans, cratères... Cet espace est source d’imagination, il incarne la peur, la curiosité et s’immisce dans nos plus lointains cauchemars. Qui n’a jamais eu peur d’entrer dans une grotte étant enfant ? L’exposition permet d’invoquer doutes et souvenirs, d’appeler une imagination débordante, et celle que manifeste aussi une littérature illustrée de Germinal d’Emile Zola à Alice aux pays des merveilles de Lewis Carroll. Plus proche de nous, les grottes deviennent les abris de dessins, de contes enchanteurs, elles s’invitent dans les villas romaines et deviennent le genre grottesche de décors.
Aux tréfonds de la Terre

Gardien de tombeau, Chine.
Que se passe-t-il sous terre ? Telle est la question que soumet l’exposition. Au détour d’un gardien de tombeau de la dynastie des Han de l’est, le visiteur découvre ce monde souterrain investi par les humains, les monstres ou toute autre créature mythologique.

Maurizio Catalan, Mother, 1999 © EK
L’Au-delà est à portée de main par une photographie de Catalan, illustratrice de la crainte viscérale d’être enterré vivant. Nos corps investissent ces terres depuis des siècles. Après cette mort, imposée ou naturelle, la descente aux enfers est irrévocable ; peu importe les croyances ou l’époque, l’enfer a toujours existé, comme le montre l’exposition. Créatures informes, protectrices ou cruelles, les statues, peintures ou objets de cultes permettent d’observer que de tout temps et en toutes civilisations, l’humain pense à l’après vie et souhaite honorer ses défunts afin de, peut-être, avoir une mort plus douce.
Une terre nourricière
L’exposition permet au visiteur de prendre conscience de la richesse de nos profondeurs, de sa fertilité. En effet, cette terre créatrice est mise en valeur par un cabinet de curiosités regroupant des fossiles, pierres précieuses, métaux ou encore ossements. Ces trésors participent à la beauté de ce que l’homme peut créer mais aussi à l’innovation de notre société. Le choix de dévoiler des gemmes, des minéraux, au sein d’une exposition principalement picturale interpelle, permet une pause dans la contemplation et ravive l’éblouissement.
Cueillir les fruits de nos entrailles est le labeur des mineurs, cette mise en valeur rappelle l’implantation du musée. Le mineur brave les dangers, et remonte une source d’énergie de nos sous-sols, au péril de sa vie. Moins profond, les constructeurs de métro du XIXè siècle ponctuent la fin du voyage sous terre dans cette exposition. L’innovation et la modernité reviennent, les mythes sont laissés au temps du passé, l’humain investit les profondeurs pour exploiter la terre selon ses exigences.
L’exposition n’analyse pas les dérives liées au travail des mines de charbon, ou plus récemment de métaux et de sables. Son seul angle est l’héroïsation du mineur. De simples faits historiques sont relatés, ils ne sont pas transposés aux déboires du monde actuel. Il est vrai d’écrire « Aujourd'hui, d'audacieux projets se déploient dans les sous-sols des villes contemporaines. Certains chercheurs et urbanistes pensent que là se situe l'avenir de la vie urbaine. » Car à l’aube de grands fléaux (guerres, crises environnementales et sociales), les mondes souterrains seront probablement les refuges de demain. Ils le sont en ce moment même, certaines populations du monde telles que les Ukrainiens ou les Australiens ont recours à ces mondes souterrains, les uns pour se protéger des bombardements, les autres pour échapper à la chaleur. A l’heure où des milliardaires investissent dans des bunkers-palaces afin de fuir un monde auquel ils ont participé, les 99,9% restants de la population mondiale s’engouffrent dans des métros insalubres. L’exposition n’évoque pas les conditions de travail déplorables des mineurs du monde contemporain. Pour autant, elle permet d’admirer toutes ces beautés exposées, de faire une pause dans ce monde parfois désespérant.
Le Louvre Lens ravit par tant d’œuvres exposées provenant de toutes disciplines, les sciences, l’archéologie ou les arts visuels. Pour autant, cette multitude d’informations visuelle et mentale peut perdre le visiteur, malgré un parcours très structuré. Des mythes, des dieux, des philosophies évoqués ne sont pas expliqués en profondeur. C’est un visiteur à l’œil aguerri et familiarisé au sujet qui appréciera certainement sa visite. Les œuvres exposées, 200, pour être appréhendées nécessiteraient une seconde visite.
Élise Klein
Pour en savoir plus :
Horaires d’ouvertures :
Du mercredi au lundi : 10h – 18h
Fermeture des caisses à 17h15.
Fermé le mardi et certains jours fériés (1er janvier, 1er mai et 25 décembre)
#Mondes souterrains #LouvreLens #Mythes
Prendre son histoire à bras le cœur
En 2006, au premier étage du musée national de Géorgie, sur la grande avenue Roustaveli, équivalent des Champs Elysées à Tbilissi, a été inauguré un nouveau musée : le musée de l’occupation soviétique.
La Géorgie, au long de son Histoire, a souvent été occupée : par les Romains, les Turcs, l’Iran, l’empire russe… D’ailleurs,la ville cosmopolite et bigarrée qu’est Tbilissi suffit à en témoigner. Elle n’a pas dédié un musée à chacune de ces périodes. Cependant l’occupation soviétique se distingue parce qu’elle est récente, particulièrement meurtrière et fait écho à l’occupation très actuelle de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud.De plus, la Géorgie se remet encore de la guerre civile qui a suivi son indépendance : le pays a besoin d’apaisement et de cohésion interne. Toutes ces raisons ont présidé à la naissance de ce musée plein d’émotions preuve d’une certaine réappropriation (et interprétation ?) par les Géorgiens de leur Histoire.
Situation géopolitique en Géorgie @ Vincent Jauvert. Nouvel Obs
Ce « musée » est davantage une aile du musée national. Il est constitué d’une antichambre suivie d’une grande salle de réception rectangulaire surmontée d’une mezzanine étroite et périphérique. La grande salle est organisée comme le bureau d’apparat d’un dirigeant soviétique en Géorgie : des drapeaux de l’URSS décorent l’allée qui mène à son bureau. Sur la mezzanine ce sont les lettres, en russe, vestiges du pouvoir bureaucratique de Moscou qui s’appliquait implacablement en Géorgie.
Sur les murs de la salle des vitrines, des photos, des films d’archive et des cartels présentent les grandes étapes de cette domination économique et politique : la brève République parlementaire géorgienne indépendante, l’imposition d’un modèle politique révolutionnaire, l’étouffementdes résistances et enfin la libération du pays.
Reconstitution du bureau d'un dirigeant communiste à Tbilissi @ Khees sur Eklablog
En réalité ce musée est avant tout un hommage aux victimes de guerre, au détriment parfois d’informations sur la vie quotidienne sous l’occupation. On pouvait s’attendre à en apprendre sur les difficultés économiques du pays, le rationnement, la réglementation inadaptée et sévère … Les Géorgiens ont plutôt choisi de souligner les déportations et les morts avec la part d’émotions endeuillées que cela implique. La grande salle est couverte de photographies et objets personnels (papiers d’identité, journaux intimes) des victimes politiques de l’occupation soviétique. Il s’agit donc de contestataires du régime et des grandes familles aristocratiques de Tbilissi. Des chiffres, imprimés en gros sur les murs et les cartels, dénombrent les déportés ou les morts.
Enfin l’antichambre est particulièrement suggestive puisque y est reconstitué un wagon de bois criblé de balles où furent fusillées des familles de l’aristocratie. Le wagon est éclairé en rouge et, quand on le regarde, on entend derrière soi des déflagrations venant d’un film diffusé sur un autre mur.
Ce musée n’a pas une vocation d’information exhaustive sur cette période d’occupation. L’implication des Géorgiens dans le système soviétique à Moscou ou à Tbilissi par exemple est passée sous silence. Par contre il est un bel hommage aux résistances et aux victimes, à la manière géorgienne : très expressive, poignante et un peu partiale.
Eglantine Lelong
#Pays d’ex-URSS #Deuil #Géorgie
Site du musée : http://museum.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=53
Pour aller plus loin :
http://www.liberation.fr/monde/2010/06/16/staline-occupe-la-georgie_659320
Sources images :
http://globe.blogs.nouvelobs.com/archive/2008/04/30/russie-georgie-bientot-la-guerre.html
http://credintravel.eklablog.com/musee-national-de-tbilissi-a79981203?noajax&mobile=1

Privilégier le contexte, conversation avec Joanna Lang
Joanna Lang, restauratrice et conservatrice d'œuvres picturales au début de sa carrière, est maintenant curatrice et conservatrice du musée de l'insurrection de Varsovie depuis son ouverture, il y a 13 ans. Elle a été l’invitée du Master MEM pendant une semaine expographique consacrée à l’extension et la rénovation des musées.
Retour sur une histoire. L'insurrection de Varsovie est une histoire marquante de la Pologne qui se déroule à la fin de la Seconde guerre mondiale. Fin juillet l944, le peuple polonais ne pouvait plus se résoudre à vivre sous le joug allié, il décide de prendre les armes et de récupérer le Varsovie occupé. L'insurrection a duré du 1er août au 2 octobre 1944, la résistance s'est élevée avec l'armée et les civils. Tous se sont soulevés. Le 2 octobre, après des pertes humaines immenses et la destruction à 80 % de la vieille ville de Varsovie, l'armée polonaise capitule. Les civils survivants sont transportés dans des camps de travail par les Allemands, les plus chanceux réussissent à fuir la ville.
Les grands parents de Joanna ont fui Varsovie à cette époque. Elle n’a regagné Varsovie que bien plus tard. Si le lien familial à l'insurrection de Varsovie est évident dans l'histoire de Joanna, le grand challenge de son travail était de sortir du carcan « Beaux-Arts » où seules les « belles œuvres » comptent pour rendre aux souvenirs de cet événement toute la précaution de conservation qui leur est due.
Un musée sur l'insurrection de Varsovie
 Le projet muséal sur l'insurrection de Varsovie s'est fait en quatre ans, le bâtiment a été construit en une seule année. Ce temps court s'explique par une volonté politique d'ouvrir le musée pour célébrer les 60 ans de l'insurrection et réunir les survivants ainsi que les nouvelles générations. Un rythme de travail soutenu jusqu'àl'ouverture était de mise. L'appui du maire de la ville a été capital, et toute décision fut prise de manière rapide, quasi expéditive.
Le projet muséal sur l'insurrection de Varsovie s'est fait en quatre ans, le bâtiment a été construit en une seule année. Ce temps court s'explique par une volonté politique d'ouvrir le musée pour célébrer les 60 ans de l'insurrection et réunir les survivants ainsi que les nouvelles générations. Un rythme de travail soutenu jusqu'àl'ouverture était de mise. L'appui du maire de la ville a été capital, et toute décision fut prise de manière rapide, quasi expéditive.
Le temps de réalisation du musée était très court par rapport à la moyenne, il a été facilité par une grande équipe d'historiens, de scénographes, de conservateurs ayant travaillé sur le projets cientifique et culturel du musée, mais également facilité par une collection déjà existante et grandissante.
Cette rapidité dans l’exécution est exceptionnelle en France comme en Pologne. Les musées sont soumis aux mêmes contraintes européennes et les marchés publics, les obligations diverses telles que l'accessibilité sont également les mêmes. Joanna insiste sur l'importance de privilégier un temps long pour la conception d'un musée ou sa réhabilitation. Il est nécessaire que le projet soit mature et soit compris de tous. Cette cohérence ne peut se faire que par un temps de réflexion, de conception et de discussion afin de ne pas passer à côté de son propos.
Les murs abritant le projet muséal tout juste né ont une grande importance. Si le lieu abritant le futur musée a une histoire locale, il semble primordial d'utiliser ce lieu et de garder le contexte du musée pour créer un attachement de la population proche.
Ne pas jurer par le nouveau est un maître mot de Joanna. Un musée d'objets usuels aura tout intérêt à garder ces objets dans leur contexte domestique car, si pour nous leur utilisation semble évidente, la prochaine génération aura du mal à être attentive aux objets dont ils ne connaissent pas l'usage et s’ils sont placés dans un lieu neutre.
Il en est de même pour des musées d'art dont la collection vient de notables locaux. Il est judicieux de montrer dès l'entrée l'apport de ces collectionneurs pour ancrer le visiteur et ainsi le placer face à une chose palpable et immuable à laquelle ils peuvent se raccrocher.
L'importance du contexte muséal
 L'importance du contexte. Selon Joanna Lang, le contexte est la base évidente à la bonne implantation d'un musée sur le territoire. Que ce soit par l'utilisation d'un lieu inscrit dans l'inconscient (ou le conscient) collectif d'une population locale ou par l'utilisation d'une histoire locale à inscrire dans un nouveau lieu, il est essentiel de créer un lien. Le lien est souvent l'histoire commune. Cela permet de rencontrer un public, d'évoluer avec lui, de ne pas être l'alien de sa propre ville. Les musées font parfois peur et souffrent des à priori qu'on leur plaque. Si on rentre plus facilement dans un groupe quand on y a un contact, le contexte est notre allié.
L'importance du contexte. Selon Joanna Lang, le contexte est la base évidente à la bonne implantation d'un musée sur le territoire. Que ce soit par l'utilisation d'un lieu inscrit dans l'inconscient (ou le conscient) collectif d'une population locale ou par l'utilisation d'une histoire locale à inscrire dans un nouveau lieu, il est essentiel de créer un lien. Le lien est souvent l'histoire commune. Cela permet de rencontrer un public, d'évoluer avec lui, de ne pas être l'alien de sa propre ville. Les musées font parfois peur et souffrent des à priori qu'on leur plaque. Si on rentre plus facilement dans un groupe quand on y a un contact, le contexte est notre allié.
© Adrian Grycuk
Plus que pour gagner en popularité, le contexte est également la base du développement du musée. « Pour savoir où tu vas, sais d'où tu viens » en somme. Le contexte du musée, son implantation auprès d'une population locale permet d'évoluer à plusieurs. Si le contexte est ancré, il sera plus simple d'agir vers un but commun, de sortir de divers orgueils intra-musée et d'ainsi travailler en équipe pour une chose plus grande.
Le musée, s'il est bien implanté devient alors une institution scientifique permettant de montrer l'impact d'une exposition sur les individus mais également l'impact des individus sur les projets muséaux à venir. Le musée peut alors s’agrandir et devenir égalementune zone d'actions sociales diverses, d'ateliers variés, un lieu de rencontre etc. L'histoire, l'utilisation d'un ancrage local, la valorisation du contexte de création d'un musée permettent d'animer le lieu et de valoriser les actions qui s'y passent. Ce n'est qu'à ce prix qu'un musée peut être compris et peut s'épanouir avec ses visiteurs.
Donner au musée de l'insurrection de Varsovie ces lettres de noblesses par l'Histoire, c'était la mission belle et bien accomplie de Joanna. Merci à elle,
Do zobaczenia !
( « à bientôt », en polonais).
Alice Majka
#semaineexpographique
#joannalang
#muséedelinsurrection
#pologne
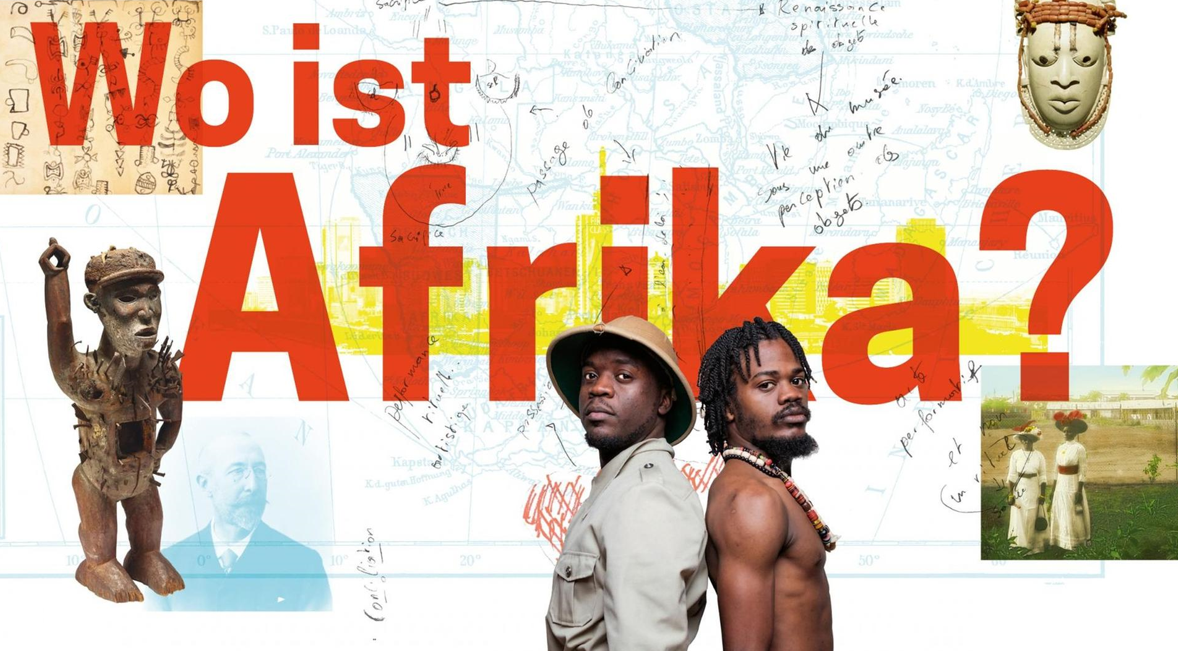
Restitutions de biens culturels au Linden Museum
Les restitutions de biens culturels ont fait l’objet de plusieurs débats ces dernières années, de nombreuses collections publiques européennes ayant été constituées durant la colonisation et le pillage des territoires africains. C’est en 2017, lors du discours d’Emmanuel Macron à Ouagadougou, que la France a réellement entamé une démarche collaborative avec des pays africains, notamment avec le Bénin.[1] D’autres pays européens, dont l’Allemagne, s’étaient déjà engagés dans un dialogue constructif avec les autorités africaines.
En Allemagne, comment cela se passe-t-il ?
Depuis une dizaine d’années déjà, notre voisin s’est engagé avec les structures muséales africaines à restituer des œuvres et objets leur appartenant. En 2022, des œuvres ont été transférées au Nigeria, en Namibie, au Cameroun et en Tanzanie. Le professeur Hermann Parzinger, président de la Fondation du patrimoine culturel prussien, a d’ailleurs déclaré, toujours en 2022, qu’il était important que « les musées allemands aient une attitude très ouverte » sur ces questions, et que l’échange et la coopération étaient les clefs de restitutions réussies.[2] Si cette démarche est bénéfique aux musées africains, qu’advient-il des musées allemands ?
Le cas du Linden Museum
Musée d’ethnographie de Stuttgart, le Linden Museum a été fondé en grande partie durant la période coloniale. Aujourd’hui, l’équipe du musée affiche sa volonté de « prendre des responsabilités face à son passé » et suit les instructions du Deutschen Museumbundes(institution nationale des musées allemands) pour ce qui concerne les restitutions. Ces informations sont consultables sur leur site internet[3], mais dans le musée en lui-même, qu’a-t-il été fait ?
Au début de l’année 2016, le musée s’est réellement penché sur la recherche de la provenance et du contexte de l’acquisition des objets africains. Le musée est organisé de telle sorte que chaque continent a son parcours, dans des salles spécifiques. L’équipe interne a alors choisi de refaçonner les espaces concernant le continent africain afin de relater ses recherches et questionnements. Nommé Wo ist Afrika ? (en français « Où est l’Afrique ? ») ce parcours a été inauguré en 2019.
Wo ist Afrika ?, conçue par qui ?
Ce parcours a évidemment été pensé sur plusieurs années, le sujet étant délicat. Trois ans en amont, l’équipe interne du musée s’est entourée d’habitants de Stuttgart d’origines africaines afin d’ouvrir le dialogue avec ces communautés et ne pas créer de nouvelles erreurs d’appropriation et d’interprétation des collections. La directrice du musée, la Prof. Dr. Inés de Castro, est d’ailleurs particulièrement engagée et alertée sur toutes les questions touchant aux restitutions, c’est elle qui est à l’initiative de ce parcours.
Wo ist Afrika ?, conçue pour quoi ?
Le but de cette exposition n’est donc pas uniquement de présenter les objets mais de redécouvrir les contextes et les récits de ces collections africaines, de les questionner, de découvrir leurs relations avec le musée et avec les peuples africains. L’exposition n’est pas chronologique mais thématique.
La première salle Von Sammlerstücken oder einer ohrenbetaübenden Stille (en français « choses à collecter, ou un silence de plomb »), illustre le décalage entre la frénésie des collectionneurs à l’époque coloniale, et le silence sur la provenance et l’histoire des objets. Nous sommes accueillis par un diorama renommé « Vous êtes là ». Conçue dans les années 1960 à Stuttgart, cette pièce avait pour but de présenter au public un village africain. Le cartel remet en cause son exactitude et alerte sur la différence entre les faits relatés dans l’exposition et la réalité sur place. « Vous êtes là, donc, s’il vous plaît, rappelez-vous : ce n’est pas ‘’l’Afrique’’.»
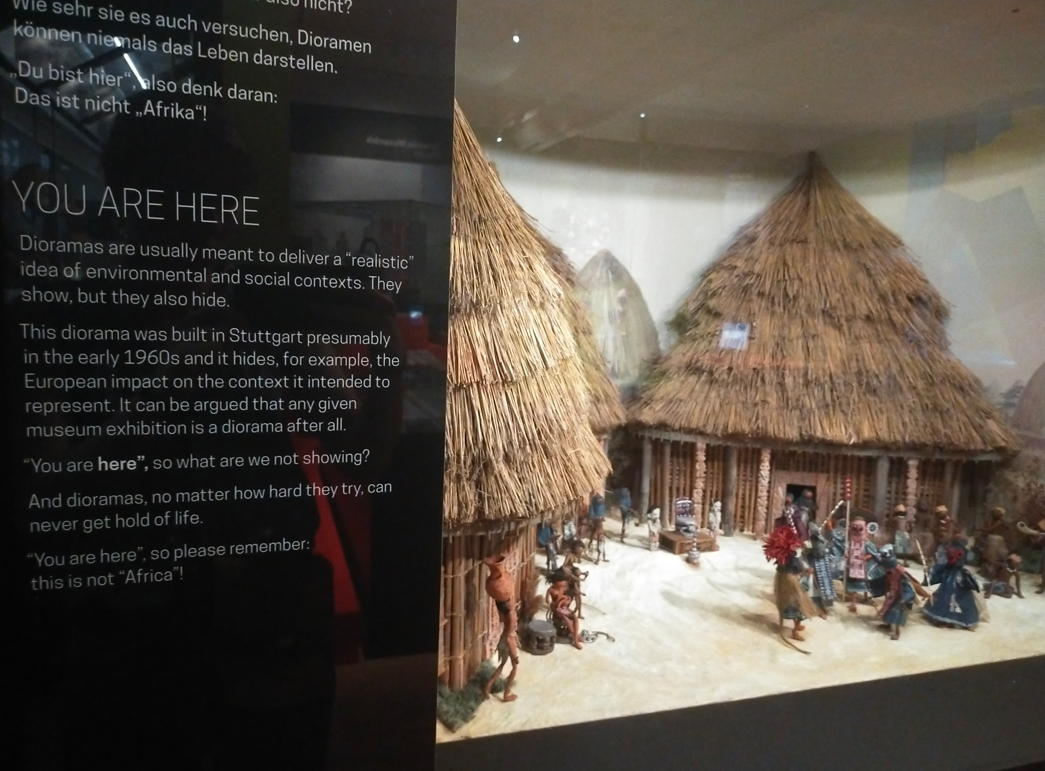
Diorama qui accueille le public, © JD
Dans la deuxième séquence Von S[o]bjekten in Aktion oder kultureller Kreativität(« S[ob]jets performants, ou créativité culturelle »), c’est l’art et l’artisanat de différentes époques qui sont représentés, passant d’une reconstitution d’un atelier de sculpteur de masques à une moto décorée du XXIème siècle.

Deuxième salle de l’exposition © JD
Wo ist Afrika ?, un espace qui évolue ?
Comme les recherches s’effectuent sur le long terme, le musée avait pour volonté de tenir ses visiteurs informés. Une base de données sur un écran, mise à jour régulièrement, permet aux plus curieux de s’informer des dernières découvertes. Certains espaces et dispositifs sont aussi ajoutés au fil du temps.
« Si les objets pouvaient parler » est une installation visible depuis juillet 2023. Un objet des Kikuyu est dans les réserves du musée depuis 1903 mais la base de données interne n’avait aucune information à son sujet. De quoi s’agit-il ? A quoi servait-il ? Y a-t-il encore des gens capables de l’identifier ? Deux cinéastes, Elena Schiling et Saitabao Kaiyare, sont allés au Kenya dans l’espoir de répondre à ces questions. Accompagnés de leur caméra et de l’objet représenté grâce à la réalité augmentée, ils ont interrogé plusieurs personnes. Malgré les différences de générations, les témoignages et réponses sont unanimes : aucun ne comprend pourquoi cet objet, appartenant à leur peuple, leurs ancêtres, se trouve en Allemagne. Cette expédition, présentée par un film, permet au public de faire un pas de côté et de changer de point de vue. Les restitutions ne vident pas les musées, elles enrichissent l’histoire des peuples à qui appartenaient des objets.
Bande annonce "If objects could speak"
Wo ist Afrika ?, et après ?
Dans la troisième et dernière salle Von Bindegliedern oder gemeinsamer Geschichte(« Objets à connecter, ou histoires communes »), les liens entre les Européens et les Africains est au cœur du propos. Par exemple, un espace compare les styles de marché alimentaire, et un autre permet de découvrir un jeu africain très pratiqué. La volonté est de susciter l’interactivité entre les visiteurs.

1ère image : reproduction d’un stand de marché africain comparé à une photo grandeur nature d’un marché européen © JD
2ème image : dispositif pour apprendre à jouer au Mancala © JD
L’exposition se termine sur une vitrine originale : « Qu’est-ce nous allons collecter dans le futur ? ». Un cartel jaune trône au milieu avec un titre : restitué. Une photo d’un objet, son histoire, et c’est tout. Ce masque de chef de tribu, récemment restitué, a tout de même une place importante dans les collections puisqu’il illustre les différents statuts sociaux au sein des tribus. Alors, le musée a décidé d’en garder une trace dans son parcours.

Dernière vitrine du parcours, © JD
Les questionnements autour de la restitution ne se résoudront pas tous en rendant les objets et en exposant uniquement des photos dans les musées européens. Cependant, avec un parcours comme celui du Linden Museum, le visiteur comprend que la restitution n’est pas forcément une perte de valeur pour les musées européens. Ce parcours permet de découvrir une partie du continent africain tout en explicitant les liens du passé, mais aussi le travail qui, aujourd’hui, est conduit autour de ces questions.
Les restitutions n’ont donc pas appauvri les collections, elles ont enrichi le propos, les connexions interculturelles et l’histoire du musée. N’est-ce pas là le rôle d’un musée d’ethnographie ?
Julie Dumontel
Pour en savoir plus :
-
https://www.jeuneafrique.com/1315340/culture/patrimoine-africain-lallemagne-sur-le-chemin-des-restitutions/
-
https://www.deutschlandfunk.de/ausstellung-ueber-kolonialkunst-in-stuttgart-es-geht-um-100.html
#Allemagne #Ethnographie #Restitutions
[1] Article de Carole Assignon, juin 2022 : https://www.dw.com/fr/allemagne-restitution-des-oeuvres-culturelles/a-62293712
[2] Article publié sur le blog concernant la restitution du Trésor d’Abomey au Bénin par la France, par Éva Augustine en 2021 : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2299-restitution-du-tresor-d-abomey-un-acte-symbolique
Sésame, ouvre-toi !
Ou un groupe se prenant pour Ali Baba devant la porte des réserves du MuCEM
Bon, il ne faut pas rêver, dans la réalité, tout le monde n’a pas la même chance qu’Ali Baba. Vous avez beau essayer de prononcer la formule magique devant les portes d’un musée, il est peu probable qu’elles s’ouvrent. Et pourtant ce sont bien des trésors qu’il renferme. Alors, changement de méthode, prenez votre téléphone et inscrivez-vous à une visite des réserves. C’est moins exotique, mais au moins, ça marche.
Le Centre de Conservation et de Ressources du MuCEM © www.mucem.org
Se promener dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille, ce n’est pas comme se promener en Perse. Quoique. Même si le Centre de Conservation et de Ressources du MuCEM est imposant il reste néanmoins bien camouflé. Je n’ai pas compté le nombre de personnes qui passent à côté sans le voir. Et oui, un trésor ça se cache, il faut se donner du mal pour le trouver. J’exagère puisque le nom « MuCEM » est tout de même inscrit sur la façade, mais bon, comme aucune indication n’invite à franchir la grille ça fait un peu coffre-fort. Heureusement, vous qui êtes téméraire, vous allez franchir le pas. Devant la porte, c’est simple : sonnez et il y a des chances pour que la porte s’ouvre. Cen’est pas pour autant que vous aurez accès aux réserves. Il faut réserver sa place (une action qui semble en fait évidente pour accéder aux réserves…), et, en plus, la visite a lieu le premier lundi de chaque mois. Ou alors il faut faire des études et avoir un enseignant super qui vous emmène dans la semaine. Ce n’est pas gagné. Mais bon, si vous avez vraiment beaucoup de chance, le fameux lundi arrive dans trois jours et, ça tombe bien, vous serez encore à Marseille. Et oui, je vous l’ai dit, entrer dans les réserves, ça se mérite.
Le jour J enfinarrivé, un petit groupe se rassemble devant une porte qui semble assez banale (soyez patients la prochaine porte est plus impressionnante). Mais avant d’entrer, il faut déposer ses affaires, y compris et surtout sa bouteille d’eau. Certains craignent la déshydratation et sont réticents à laisser leur précieuse bouteille. Est-ce qu’ils n’en font pas un peu trop ? Je vous le répète, cequi se cache derrière cette porte, ce n’est pas une grotte perdue en plein désert, tout le monde en ressortira. En attendant que chacun retrouve la raison, les plus impatients commencent à toucher à ce qu’ils peuvent. Remarquez mieux vaut se défouler dans le hall qu’une fois dans les réserves, sauf qu’à force de vouloir faire les malins, de vouloir ouvrir des portes, c’est l’alarme qui se déclenche. Au moins, ça calme. C’est vraiment dur d’entrer dans les réserves, pourvu que ça vaille le coup.
Les réserves du MuCEM © www.mucem.org
Pas de grandes formules, juste un badge, un bip, et c’est bon nous voilà entrés. Enfin, pas encore, il y a une autre porte à franchir, pour le coup une grande porte du type porte blindée. Un autre bip et c’est parti pour la visite ! Leplafond est immense, l’horizon paraît lointain et le groupe reste sagement dans l’entrée, émerveillé. Je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas à un tas de pièces d’or et de bijoux, mais plutôt à des instruments de musique, de la vaisselle, des meubles, des skates et autres objets de toute sorte rangés sur 800 m2. Au fond, ça change des trésors habituels et c’est peut-être pour cela que c’est si impressionnant. La visite commence alors et plus le groupe avance entre les étagères, les armoires, les racks et les compactus (oui tout ce vocabulaire s’apprend pendant la visite), plus il semble fasciné. Bien sûr interdiction de toucher les objets, mais si vous êtes sages vous pourrez manœuvrer les compactus et, croyez-moi, ça donne un sentiment de découverte plus important encore. Mais je n’en dis pas plus, si vous voulez satisfaire votre curiosité vous savez ce qu’il vous reste à faire (regarder les informations pratiques à la fin de l’article par exemple ?).
Alors verdict ? Si Ali Baba nous avait vus, il serait certainement vert de jalousie. Les réactions sont unanimes : « Je m’attendais pas du tout à ça ! », « C’est incroyable ! » et même « Mon Dieu que c’est beau ! ». Conclusion, ça valait le coup de se donner du mal car c’est une expérience et quelque chose me dit que les membres du groupe ne verront plus les musées de la même façon. Franchir la porte (un peu magique quand même) des réserves, c’est découvrir un autre visage du musée d’autant que la médiatrice alimente la visite d’informations sur la constitution de la collection, les métiers du musée et bien d’autres sujets encore. Imaginez en plus que la visite ne montre qu’une partie des réserves du MuCEM qui sont réparties sur une surface totale de près de 8000 m2 ! D’autres portes renferment d’autres trésors, mais pour voir le reste, il faut travailler dans le monde des musées. Comme quoi ça a des avantages, comment ne pas se sentir privilégier après ça ? Rassurez-vous tout de même, de plus en plus de musées souhaitent ouvrir leurs réserves au public. Inutile donc d’essayer d’entrer en contact avec Ali Baba, il n’est plus le seul à détenir le secret pour voir un trésor.
C.D.
Pour aller plus loin :
Visite gratuite de « L’appartement témoin » (les réserves) tous les premiers lundi du mois, de 14h à 17h, surréservation. (
Si vous avez aimé votre visite, sachez que tout lemonde peut consulter les archives, les ouvrages, les documents et même les objets des réserves sur demande ! (http://www.mucem.org/fr/node/2823)
#MuCEM
#réserves #coulisses

SIDA : de l’oubli aux entrelacs. Une expérience immersive et intime au cœur de Strasbourg
L’exposition Aux temps du sida. Œuvres, récits et entrelacs est présente dans le Musée d’Art Moderne et Contemporain de la ville de Strasbourg (MAMCS) jusqu’au 04 février 2024 pour les 40 ans de la découverte du VIH. En quoi cette exposition, liée à une question de société, nous montre-t-elle que la recherche va de cœur avec la monstration de « la maladie » par le biais de l’art ?
Vue d’installation de l’exposition « Aux temps du SIDA.Oeuvre, récits et entrelacs » au Musée d’Art Moderne et Contemporain de la ville de Strasbourg © M. Bertola / Musées de la ville de Strasbourg
Le SIDA, une maladie de société
L’exposition actuellement ouverte au MAMCS est un témoignage d’une société transformée à jamais par une maladie, un témoignage qui prend ici la forme d’œuvre d’arts. Elle s’ouvre par « Le Couloir du Temps », un mur qui raconte le SIDA sous tous ses aspects à l’aide de textes, de journaux, d’œuvres et d’objets d’aujourd’hui jusqu’à la découverte du virus. Une ligne du temps directement inspirée de la “aids timeline” du collectif d’artistes Group Materialconçu en 1984. Cette introduction rappelle que « le SIDA n’est pas de l’histoire ancienne, il est encore dans notre temps ».

Vue d’installation de l’exposition « Aux temps du SIDA.Oeuvre, récits et entrelacs » au Musée d’Art Moderne et Contemporain de la ville de Strasbourg © M. Bertola / Musées de la ville de Strasbourg
Le SIDA (Syndrome d'Immuno Déficience Acquise) est une maladie causée par le virus du VIH. Depuis sa découverte par l’institut Pasteur, le SIDA n’est pas qu’une maladie d’individus, c’est une maladie de société responsable de la mort de plus de 40 millions de personnes et du bouleversement de la vie de milliards d’autres. Vite apparue à la fin des années 70, le VIH se propageait comme une gangrène dans nos sociétés. Il effrayait et nombre d’atrocités ont été commises. Incompris pendant peu de temps, le SIDA a pourtant rapidement été désigné comme le « fléau homosexuel ». Finalement, qu’est-ce qui a fait le plus de dégâts, le virus ou la société ?
Chacune des salles de l'exposition aborde une thématique en lien avec le SIDA. Celle qui s’intitule « Je sors ce soir », empruntant son titre au roman éponyme de Guillaume Dustan, aux allures de boite de nuit, enveloppée de musiques et de lumière, représente particulièrement bien les risques qu’a fait naître ce virus. Sortir, c’est s’exposer : exposer son corps aux regards, aux rencontres, aux expériences…aux risques. S’exposer à une maladie incomprise. S’exposer à une société aveuglée par la peur. Dans une telle situation, il est normal de se demander « alors, pourquoi sortir ? ». L’exposition nous offre des réponses : par amour, par peur, pour oublier, pour contester, pour soutenir, etc. Face au virus, l’irrationalité dicte nos actions et nos pensées, c’est normal.
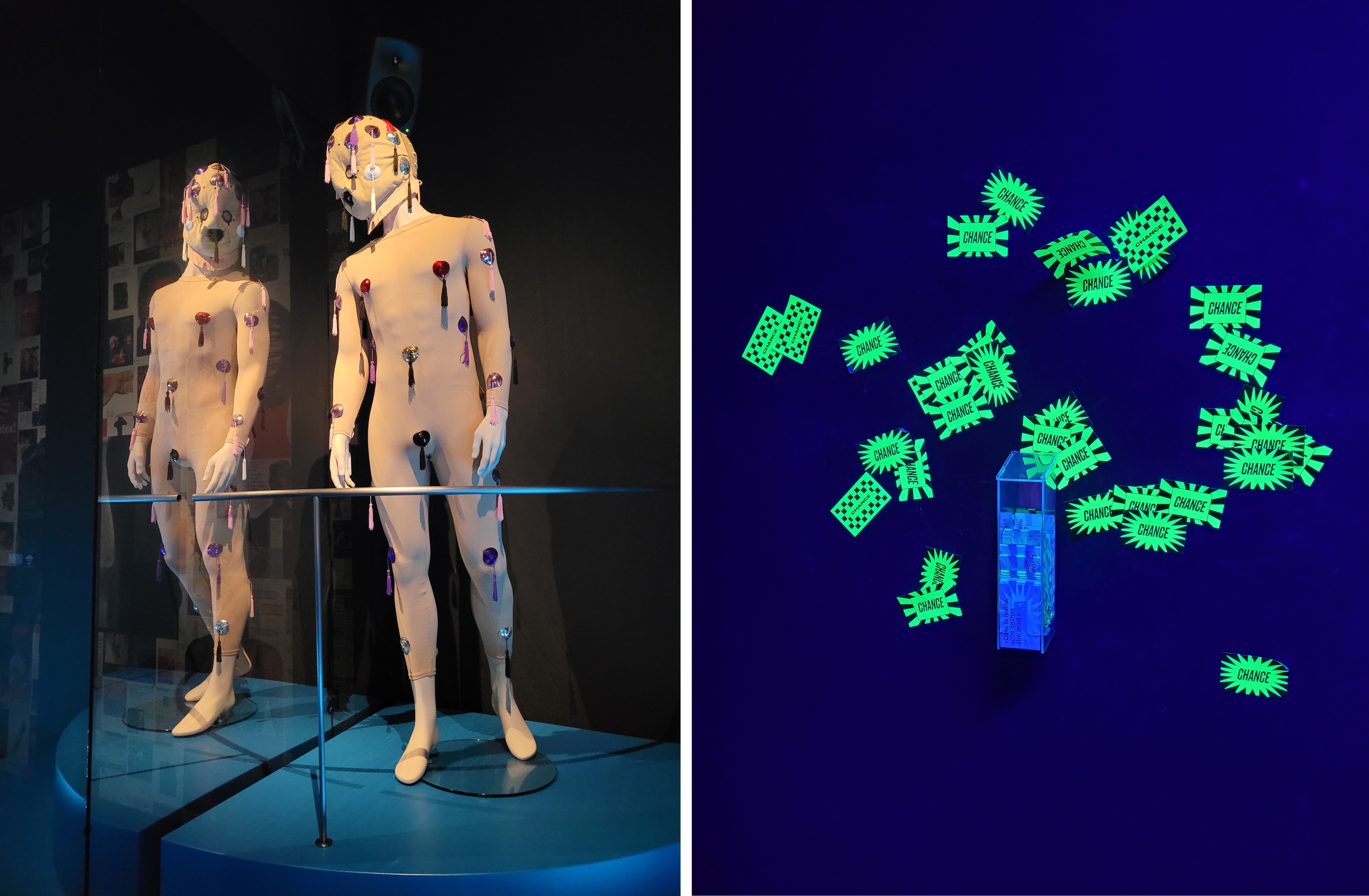
Vue de la salle “Je sors ce soir” de l’exposition « Aux temps du SIDA. Œuvre, récits et entrelacs » au Musée d’Art Moderne et Contemporain de la ville de Strasbourg © Antoine Dabé
Comparée à l’exposition VIH/SIDA du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, l’exposition strasbourgeoises n’aborde pas le sujet suffisamment en profondeur. Les récits et entrelacs annoncés par le titre de l’exposition strasbourgeoise sont relégués au second plan par les œuvres qui dominent. Même exposé dans un musée d’art moderne et contemporain, les questions sociétales de ce sujet d’ampleur doivent rester, à notre sens, une priorité. Nous pouvons néanmoins apprécier la force des œuvres exposées qui choquent et marquent justement, à l’image de cette maladie à la violence inouïe.
Une histoire, globalisée, et globalisante, qui démêle une histoire racisée et pleine de clichés
Le SIDA/VIH est une histoire scientifique, morale, sociétale, mais aussi géographique. Quand l’exposition du MAMCS de Strasbourg nous présente des photographies de Nan Goldin (Photographe Américaine), les œuvres textiles de Fabrice Hyber (Plasticien Français), les grands oubliés sont les pays du “SUD”, les pays où le taux de mortalité de ce virus est le plus élevé, avec plus de 50% des cas d’infection en 2022, et 42% des morts, surtout sur le continent africain.[1]

Vue d’installation de l’exposition « Aux temps du SIDA. Œuvre, récits et entrelacs » au Musée d’Art Moderne et Contemporain de la ville de Strasbourg © M. Bertola / Musées de la ville de Strasbourg
Cet oubli est encore plus net quand ceux de l’hémisphère nord sont très bien représentés. Que ce soit par une photographie de l’artiste Allemand Wolfgang Tillmans représentant une boîte de son traitement contre le virus, aux sculptures de médicament du groupe d’artiste General Idea. La seule œuvre du “SUD” est une toile de l’artiste Chéri Samba, un artiste du Congo qui invite les populations à se rassembler et à protester pour la « Marche de soutien à la campagne sur le SIDA » en 1988.
C’est à ce moment-là que nous réalisons un manque récurrent de contextualisation, que ce soit de la contextualisation de la création de l’œuvre, de l’artiste (nous ne savons pas s’il a décidé de présenter le SIDA en étant séropositif ou non), de sa région, de son pays et de sa génération.
Ce parti pris est aussi marquant du point de vue scénographique. L’agence ROLL, une agence d’architecture new-Yorkaise, a proposé à l'institution un « parcours linéaire ponctué d’ouvertures et de recoupements favorisant la multiplication des points de vue d’une thématique à une autre. »[2] Or, le premier tiers de l’exposition est le plus captivant, entre le mur de présentation et d'accueil (Un signe des temps) à la salle conçue autour d’une moquette rouge et d’une grande tapisserie de Fabrice Hyber, dont nous ne voyons qu’une face. Les deux suivants s’habillent de blanc et nous offre une scénographie “White Cube”, à l’allure d’un hôpital, faite de petite antichambre et de structure en bois. Ce choix traditionnel de présentation des œuvres dessert le propos sociétal et historique, sauf à insister sur un aspect clinique froid.
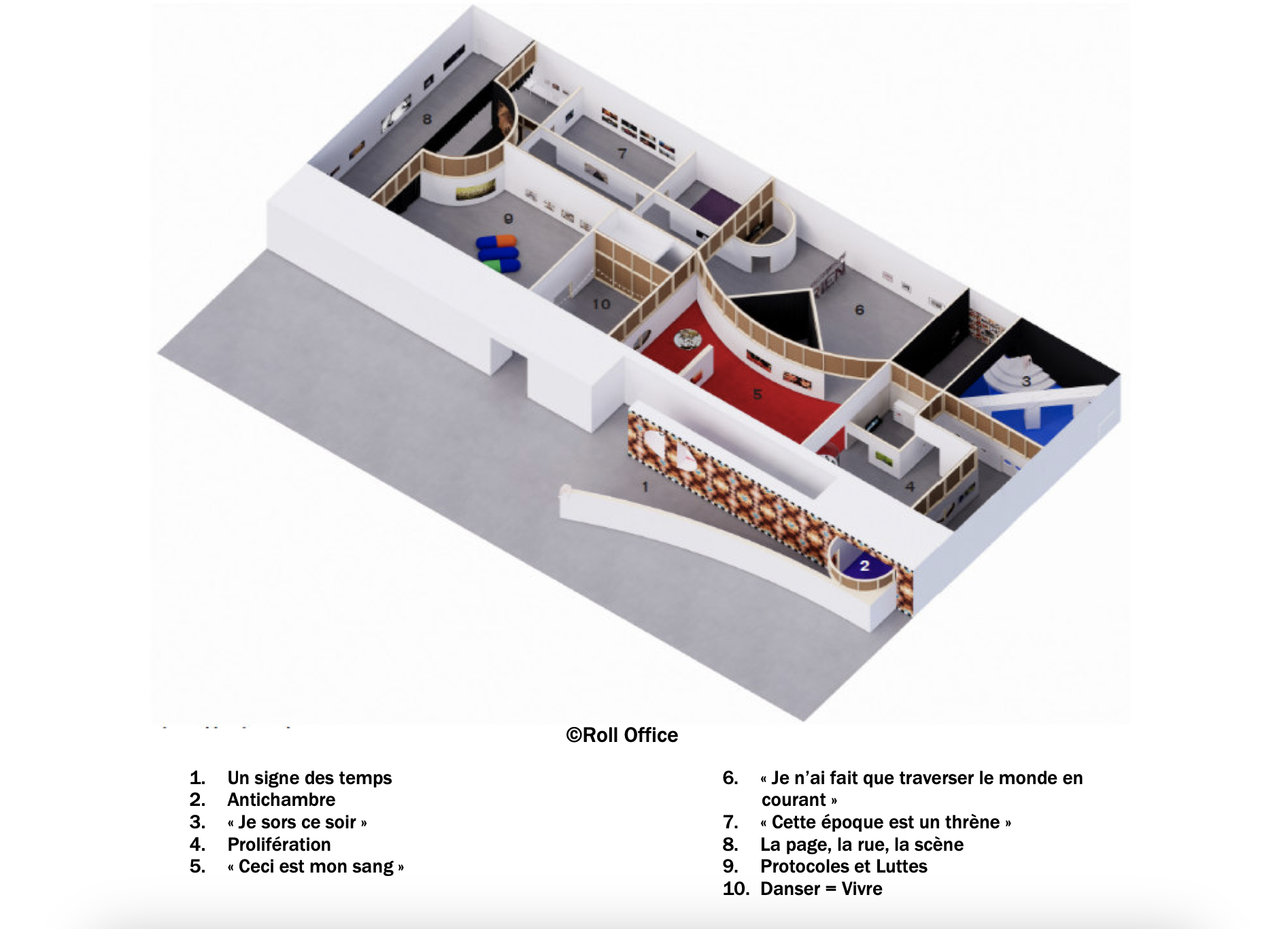
Scénographie de l’exposition « Aux temps du SIDA. Œuvre, récits et entrelacs » par l’agence © Roll Office
Alors, en quoi l’exposition de Strasbourg est-elle innovante sur ce sujet de société ? La valeur artistique des objets et des œuvres prévaut sur le contenu scientifique, ce qui ne nous semble pas pertinent compte tenu de ce qui est abordé.
Mais, dans le hall central du musée, appelé communément la nef, se trouve un espace gratuit avec sa propre programmation : la « Permanence ». Ce “lieu dévolu à la rencontre, à la pause, à l’échange”[3], permet de réunir des médecins, des spécialistes et des associations autour de la lutte contre ce fléau du 21e siècle. Entre conseil, éducation sexuelle et campagne de mécénat pour la recherche scientifique, ce lieu, intimiste, permet à chacun de montrer son intérêt, pour soi comme pour les autres, de se protéger afin de continuer à vivre et à créer. Ainsi, par cette « Permanence », le musée d’art s’ouvre pour devenir un lieu d’échange et d’expression citoyenne, un lieu de société.
Antoine Dabé & Lucas Gasgar
Pour en savoir plus :
- Visite de l'exposition « Aux temps du sida», disponible à l’adresse URL : https://www.youtube.com/watch?v=PIC6mki83eI&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.musees.strasbourg.eu%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo.
#SIDA #ArtContemporain #MuséeArtModerne
[1] Voir sur la page de l’exposition sur le site des musées de Strasbourg. Disponible à l’adresse URL : https://www.musees.strasbourg.eu/aux-temps-du-sida.-%C5%92uvres-r%C3%A9cits-et-entrelacs. Consulté le 29 janvier 2024.
[2] Dossier de presse de l’exposition « Aux temps du SIDA. Récits et entrelacs », disponible à l’adresse URL:https://www.musees.strasbourg.eu/documents/30424/437952888/DP_FR_AUX+TEMPS+DU+SIDA.pdf/a30b06a5-5f6b-a311-21cc-b06c9f93393e?t=1694695008040. Consulté le 29 janvier 2024.
[3] Fiche d'information — Dernières statistiques sur l'état de l'épidémie de sida | ONUSIDA, disponible à l’adresse URL : https://www.unaids.org/fr/resources/fact-sheet. Consulté le 29 janvier 2024.

Signes de la Grande Guerre
Parmi les nombreuses expositions que nous propose le festival Chaumont Design Graphique, en voici une qui nous parle de la Grande Guerre. Cette époque a donné lieu à une production graphique de grande importance. L’affiche, un des principaux médias avec la presse écrite, est au diapason du conflit ; placards officiels annonçant interdits et restrictions ou affiches illustrées appelant à l’emprunt ou au secours aux familles réfugiées.
En effet, ce qui se dégage nettement de cette muséographie, c’est « l’intensité ». Le parti pris de Michel Wlassikoff, commissaire d’exposition, est la présentation massive de documents précis, éclairés et rythmés par la scénographie de manière à dégager un climat, une ambiance visuelle exprimant un sens général et propice à l’attention. La scénographie est conçue selon un dédale labyrinthique, rappelant celui des tranchées.
Les cimaises elle-même sont en relief, présentant une cavité pour symboliquement signifier le fossé, le trou d’obus mais aussi la séparation des vies au Front et à « l’arrière », pour permettre deux niveaux de lecture… Le visiteur est happé dans cette tourmente, son œil est attiré par les couleurs vives des affiches de propagande, par des textes accrocheurs et provocateurs. Dans ce parcours muséographique et scénographique, les documents sont liés et n'auraient eu aucun sens à eux tout seul.
Les documents choisis sont distribués par chapitres et sont tous porteurs d'un sens précis dans l'ensemble ainsi constitué. Il se dégage un sens fort de leur positionnement et de leur association. Chaque chapitre possède des liens évidents avec celui qui le précède et celui qui le suit, et sa cohérence dépend de la cohérence de leur ensemble. Le commissaire veut donc signifier le conflit avec un agencement précis des documents pour en extraire au mieux le sens global.
Crédits: Tt
Crédits: Tt
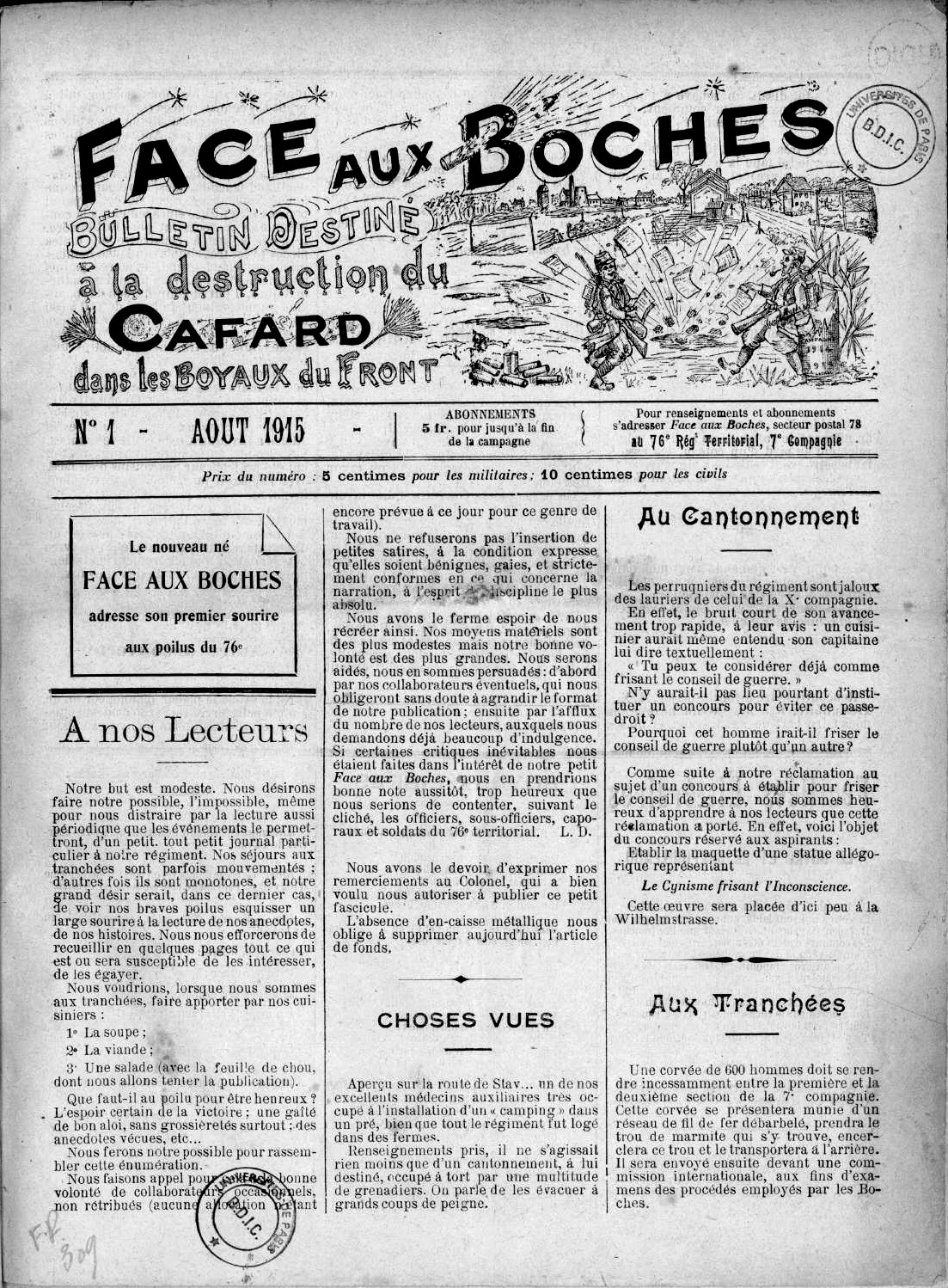
L'exposition s'attache à présenter par ailleurs les publications des avant-gardes pour manifester un contraste avec la communication de masse et déterminer la part de leurs avancées ou de leurs reculs durant la guerre. Cette présentation est axée sur les avant-gardes futuriste, cubo-futuriste, vorticiste, dada, de Stijl. Celle-ci est de portée internationale, à la différence de la communication de masse essentiellement centrée sur la France. On y découvre aussi des documents comme les premières parutions en France des revues Le Mot, de PaulIribe, L'Élan, d'Amédée Ozenfant, Sicd'Albert-Birot ou Nord-Sud de Pierre Reverdy, qui toutes naissent pendant la guerre et accueillent les avant-gardes.
Thi-My Truong
#Grande Guerre# Muséographie
# Affiches
Pour aller plus loin :

Souvenir de stage : Une approche de la conservation préventive
C’était où ?
Mon stage de M1 s’est déroulé au sein des Musées d’Art et d’Histoire de la Rochelle : un ensemble de trois musées regroupant le musée des Beaux-arts, le Musée du Nouveau Monde, et la collection du musée d’Orbigny-Bernon, actuellement fermé au public.
Grâce à mon poste polyvalent, ce stage m’a offert une vision plurielle permettant de découvrir ou d’approfondir un grand nombre de disciplines du musée, notamment en termes de muséographie, de scénographie, d’animation, de public, d’organisation d’évènements, etc. J’aimerais aujourd’hui partager mon incroyable expérience du monde étonnant et fascinant de la conservation préventive, au sens professionnel du terme.
En effet, durant une semaine, une petite vingtaine d’étudiants de l’Institut National du Patrimoine est venu réaliser un chantier d’école dans les collections. Ils ont eu pour mission de mettre en place une action de conservation préventive sur les collections du musée fermé au public. Avec mes deux acolytes stagiaires, nous avons eu la chance de les assister et de participer à leur projet en tournant au sein de leur équipe.
Organisation !
Nous avons été répartis en plusieurs ateliers, qui ont fait l’objet de roulement suivant les journées, pour que tout le monde puisse s’exercer dans les différentes spécialités. La collection Extrême-Orient a été prise en charge par 2 équipes : les bouddhas et les laques (+ collection samouraï). Une grosse équipe s’est chargée des plâtres, une autre des arts graphiques (peintures, posters, cartes, …) puis une équipe en textiles et accessoires d’uniforme (casques, armures, épaulettes,…).
Ce travail m’a fortement fait penser à un texte de Bruno Foucart dans lequel il parle des moyens de conservation du patrimoine comme d’un service de santé[1]. En effet, pendant une semaine j’ai plutôt eu l’impression de travailler dans un bloc opératoire que dans un musée.
D’abord, il faut toujours porter des gants, puisque notre peau n’est pas neutre et que son acidité est une menace pour les objets. Le port du masque est fortement conseillé, car même si l’on ne voit pas la poussière, celle-ci est bien présente et elle provoque rapidement des quintes de toux chez les personnes qui ne sont pas protégées. Enfin la blouse est préconisée dans le traitement des gros objets et des objets infestés.
Qu’est-ce qu’on a fait ?
Ma première mission a été le dépoussiérage d’une multitude de bouddhas. Pour cela, on utilise des brosses en poils de chèvre, des microfibres avec des piques en bois pour aller dans les interstices, des minis aspirateurs, et des brosse à poils plus durs pour les plâtres. Les gestes de dépoussiérages doivent être précis et organisé. On ne le fait pas dans n’importe quel sens, et on ne commence pas n’importe où. Avant de commencer, on doit d’abord vérifier l’éventuelle fragilité de l’objet.
Après le dépoussiérage, chaque objet est ensuite photographié et inventorié. Ainsi, une saisie numérique permet de rapporter un certain nombre d’informations sur l’identité de l’objet et sa localisation précise de l’objet dans les réserves, des informations descriptives sur les matériaux, la taille, la technique…, un descriptif précis de l’état de l’objet (diagnostic général, et précision sur les altérations, les marquages, …)
Puis les objets sont conditionnés. Le conditionnement répond à une technique bien précise, et doit pouvoir s’adapter aux différents objets.
Le cas des bouddhas montre le professionnalisme du conditionnement : les cartons acides ont été protégés par du papier spécial qui est poli d’un côté pour empêcher la réaction électrostatique. Puis les bouddhas sont placés dans des mousses où leur contre-forme est faite sur mesure, puis protégés par du Tyvek©. Le tout est entreposé dans des étagères qui sont venues remplir les anciennes salles d’exposition du musée. Les étages, les salles, les étagères, les rayonnages et les cartons sont numérotés de façon à pouvoir localiser exactement les objets.
En conclusion...
Le travail avec les étudiants était extrêmement riche et important pour le musée. A 20, nous avons traité et conditionné 450 objets en une semaine. Il permet de faire une formation au personnel du musée sur les bonnes pratiques de conservation préventive. Ensuite, il a permis un travail titanesque en un laps de temps très réduit.
Les objets ont été stockés dans des lieux plus adaptés à leur conservation (température, hydrométrie) et une salle de quarantaine a été aménagée pour les objets infestés. Cela permet à la fois de ne pas infester les autres objets qui eux sont sains mais cela va aussi permettre de contrôler les évolutions possibles des infestations ou des moisissures. Cette salle va continuer d’être étudiée par les élèves et restera à leur disposition pour leurs recherches, pour leurs cours, comme un cas pratique. Travailler conjointement entre étudiants est extrêmement bénéfique, tout le monde se retrouve gagnant. Le musée a sauvé une grande partie de sa collection qui était extrêmement menacée, et il a appris des notions importantes en termes de conservation préventive.
Mélanie TOURNAIRE
[1] « Les architectes-chirurgiens chargés d’opérer sur le front des ruines sont assistés d’un véritable service de santé monumentale. » Bruno Foucart, « A l’aube du troisième millénaire », in Des Monuments historiques au Patrimoine du XVIIIe siècle à nos jours, ou les égarements du cœur et de l’esprit, Françoise Bercé, éditions Flammarion, Série Art-Histoire-Société, 2000.
Liens :
Musées d'Art et d'Histoire de la Rochelle

Spoliations nazies : exposer, entre tabous et nécessité
Le 17 avril 2019, ont été rendus publics les statuts de la Mission de recherche et de restitution des biens spoliés entre 1933 et 1945, créée par le ministère de la Culture dans le but d’étudier les biens au passé trouble dans les musées français, étrangers ou présents sur le marché de l’art. Depuis quelques années et à chaque restitution, le sujet des spoliations d’œuvres d’art pendant la Seconde Guerre mondiale passionne le grand public et les expositions sur ce sujet se succèdent depuis l’après-guerre, mais ne se ressemblent pas.
De 1939 au années 1950 : des spoliations aux premières expositions
L’art a occupé une part importante dans la politique et la suprématie voulue par l’Allemagne nazie : rejet de l’art moderne considéré comme dégénéré, création du musée du Führer à Linz et accaparement des biens des Juifs d’Europe. Le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris et dès fin aout, l’ambassadeur d’Allemagne Otto Abetz commence à saisir les biens de collectionneurs et marchands d’art juifs. Les pillages seront ensuite dirigés par l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), aidé des politiques du régime de Vichy comme l’aryanisation des biens. Les objets confisqués transitent d’abord au Louvre puis dès octobre 1940 au Jeu de paume où Rose Valland, attachée de conservation française, note clandestinement les mouvements d’œuvres durant la guerre. Au total, près de 100 000 objets sont envoyés en Allemagne et 60 000 reviennent à la Libération grâce aux Alliés et aux fameux Monuments Men connus du grand public depuis le film homonyme de Georges Clooney en 2014. De ces 60 000 œuvres revenues, 45 000 sont restituées aux familles dans l’immédiate après-guerre grâce au travail de la Commission de la Récupération Artistique (CRA).

« Salle des martyrs » du Jeu de Paume où étaient stockées les œuvres d’art considérées comme dégénérées dans le but de les détruire ou les échanger contre des œuvres plus classiques appréciées des nazis. © 1940. Archives du Ministère des Affaires étrangères.
Entre juin et août 1946, une exposition est organisée à l’Orangerie des Tuileries intitulée Les chefs-d’œuvre des collections privées françaises retrouvées en Allemagne par la Commission de récupération artistique et les services alliés. Cette exposition ne s’intéresse pas vraiment à la provenance des œuvres ni aux « collections privées françaises » mais mentionne plutôt dans le catalogue, le destin des œuvres pendant la guerre comme celles destinées au musée d’Hitler ou celles choisies par Goering pour sa collection particulière. Le but de cette première exposition, quelques mois après la signature de l’armistice, est de montrer idéologiquement, ce que représente le pillage de ces collections privées. L’Etat semble se les approprier dans le texte d’introduction du catalogue, rédigé par Albert S. Henraux, président de la CRA :
« Voilà nos chefs-d’œuvre revenus sur la Place de la Concorde, théâtre de la dernière bataille de la capitale et de sa délivrance. Guérie de ses blessures, elle aussi, l’Orangerie les recueille après leur long exil et les replace, à l’ombre des drapeaux alliés, dans leur atmosphère, celle de Paris et de la France. »
En 1949, une exposition est consacrée aux bibliothèques spoliées à la Bibliothèque de l’Arsenal, les « Manuscrits et livres précieux retrouvés en Allemagne » et la CRA est dissoute cette même année. 15 000 œuvres restent sans propriétaires. Il est décidé d’en vendre 13 000, à travers plusieurs ventes organisées par les Domaines et de sélectionner 2000 œuvres afin de les laisser à la garde des Musées Nationaux dans le but de les restituer, les fameux MNR (Musées Nationaux Récupération). Le décret du 30 septembre 1949, qui décide de la création d’un inventaire provisoire spécial pour ces œuvres indique aussi la nécessité de les exposer en vue de leur identification par leur propriétaire et c’est ce qui se passe entre 1950 et 1954 au musée national du château de Compiègne. Les œuvres MNR non restituées furent ensuite mises en dépôts au Louvre, au musée d’Orsay, au musée national d’art moderne et dans plusieurs musées de régions, en attente de leur éventuelle restitution, où la plupart se trouvent encore aujourd’hui.
Les années 1990 : le temps des éclaircissements
Entre les années 50 et les années 90, on oublie. Beaucoup de personnes ayant vécu l’Holocauste veulent s’affranchir de ce passé difficile, le sujet est tabou dans les familles et certaines, décimées, laissent derrière elles peu, voire aucuns souvenirs de leur possession à leur ayants-droits. Les Français redécouvrent cette question en 1995 avec le discours de Jacques Chirac qui reconnait la part de la France dans la déportation des Juifs puis avec le livre du journaliste portoricain Hector Feliciano, Le musée disparu qui pointe du doigt le peu de préoccupation des musées français sur ces œuvres particulières qu’ils conservent. C’est pourquoi dès 1996 est mise en ligne la base Rose Valland, le site de référence recense les MNR et indique leur historique connu. Un article du Monde datant du 27 janvier 1997 et titrant « Les musées détiennent 1955 œuvres d’art volées aux juifs pendant l’Occupation », remet le feu aux poudres, et cette même année plusieurs expositions présentent les MNR dans cinq grandes institutions françaises : le Louvre, le musée d’Orsay, la Manufacture de Sèvres, le château de Versailles et le musée d’art moderne Georges Pompidou. Ces expositions avaient pour volonté de présenter ces collections et de taire les rumeurs naissantes sur la passivité des musées entre les années 50 et les années 90, où seulement 6 restitutions ont eu lieu. Cette volonté de remettre les pendules à l’heure se retrouve dans le texte d’introduction du catalogue, rédigé par Jean-Jacques Aillagon alors directeur du musée national d’art moderne :
« J'ai la conviction que cette transparence est le seul moyen de couper court à la suspicion, à la rumeur, à la tentation du sensationnel, de mettre un terme à l'oubli et à toute possible complaisance à l'égard de l'iniquité. J'estime qu'il est du devoir de l'établissement public qu'est le Centre Georges Pompidou de permettre à tout un chacun de porter un regard lucide sur ces œuvres auxquelles l'Histoire a conféré un statut particulier, un destin tragique. »
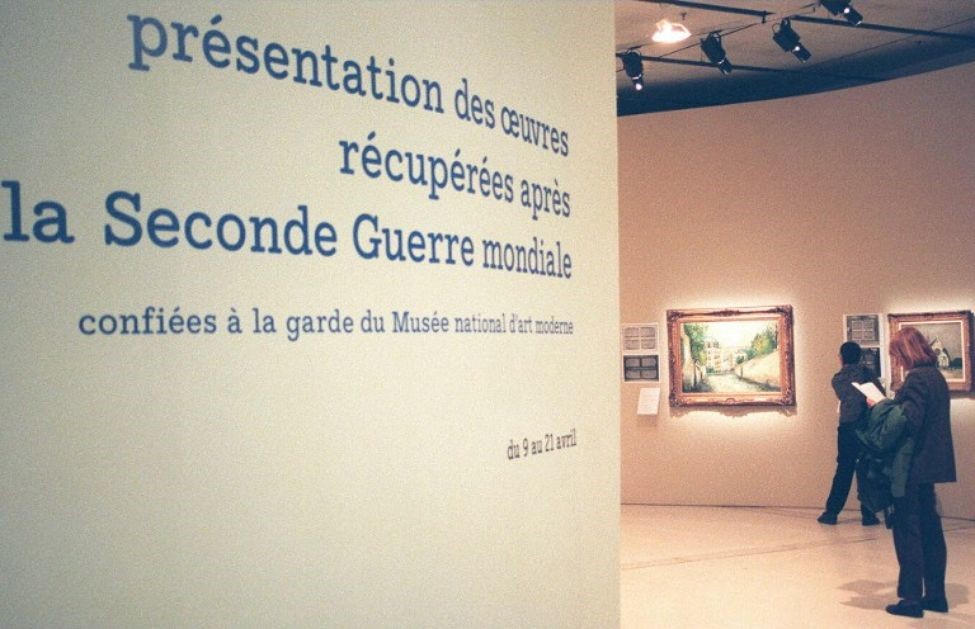
Entrée de l’exposition de 1997 au musée national d’art moderne. Au fond, deux toiles, leurs cartels et des photographies du revers des toiles avec étiquettes, inscriptions qui témoignent parfois du cheminement des œuvres © AFP
Dans un article de Libération, publié lors de l’ouverture de l’exposition au musée d’Orsay, encore disponible en ligne vingt ans après, la raison de ces expositions est la même mais la finalité, étonnamment, n’est pas vraiment celle de la restitution pour le ministre de la Culture de l’époque :
« Ce qui pouvait être restitué l'a été depuis cinquante ans, affirme Philippe Douste-Blazy. Il n'y a rien à cacher. J'espère que des gens, parce que nous les montrons par tous les moyens possibles, pourront récupérer leurs tableaux. Mais on pense qu'il y en aura très peu. Très probablement. Le geste est symbolique. Un demi-siècle après la guerre, il s'agit plutôt de faire de l'histoire que de rendre des objets d'art qui ne sont pas réclamés. »
Et pourtant, toujours en 1997 Alain Juppé, premier ministre, demande un rapport ministériel, publié en 2000, la Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France ou Mission Matéoli qui fera date et particulièrement son volet sur les spoliations « Le pillage de l’art en France pendant l’Occupation et la situation des 2000 œuvres confiées aux musées nationaux » rédigé par Didier Schulmann et Isabelle Le Masne de Chermont. Le sujet redevient central également sur la scène internationale avec en 1998, la Conférence de Washington où 44 pays décident d’ouvrir leur archives et de remettre la recherche de provenance au cœur des préoccupations. Et cela fonctionne, on dénombre 32 restitutions entre 1997 et 2008.
Depuis 2008 : une dynamique de recherche et d’exposition proactive
En 2008, organisé conjointement au musée d’Israël de Jérusalem puis au musée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris, l’exposition A qui appartenaient ces tableaux ? est la dernière grande exposition sur le sujet des spoliations en France. 53 tableaux MNR y sont présentés à travers plusieurs sections parlant précisément de l’histoire de ces œuvres : les saisies des services nazis, les opérations d’échange de l’ERR, les restitutions d’après-guerre, les acquisitions sur marché parisien, les œuvres de provenance inconnue et les restitutions faites à la France en 1994. Dans cette exposition, ce n’est donc plus juste une présentation mais une véritablement exposition présentant l’histoire et l’itinéraire de ces œuvres, également retracé dans le catalogue de l’exposition :
« Le cartel prend une place démesurée et ce ne sont plus les œuvres qui sautent aux yeux, mais leur destin de marchandise et les méandres tragiques de leur circulation. » Alain Dreyfus, Artnet.fr, 09/09/2008
Depuis, les musées de régions s’inspirent de cette démarche et s’ouvrent à ces problématiques en valorisent les MNR déposés dans leurs collections. Les présentations thématiques se multiplient. La plus connue, suite à la publication du livre 21 rue de la Boétie d’Anne Sinclair sur la vie et le destin de son grand-père le galeriste Paul Rosenberg a eu lieu une exposition homonyme au musée Maillol en 2012. Nous pouvons aussi citer L’Art victime de la guerre en 2012 à Bordeaux et dans les musées d’Aquitaine, Face à l’histoire en 2017-2018 au LAAC de Dunkerque mettant en parallèle 6 MNR et des œuvres contemporaines d’artistes ayant connus la guerre, MNR, les tableaux de la guerre au musée des Beaux-Arts de Rennes en 2016-2017 et plus récemment, la mise en place controversée de deux salles dédiées aux MNR en 2017 au Louvre, le texte de ces dernières n’employant pas une fois, dans un premier temps, le mot « juif ». Dernièrement, un espace de médiation dévoilé en février 2019 au musée des beaux-Arts de Poitiers, rend visible l’histoire et le parcours de ces œuvres spéciales au plus grand nombre dans le parcours permanent.

Raphaëlle Martin-Pigalle, responsable des collections devant l’espace de médiation conçu autour des MNR du musée de Poitiers
© Dominique Bordier pour La Nouvelle République, 06/02/19
On observe aussi de plus en plus la mise en ligne de pages internet dédiés sur le site des musées mettant en valeur cette histoire particulière et les conditions de réclamation ainsi que de cartels développés retraçant la provenance connue de ces œuvres comme à l’exposition Pastel du Louvre des XVIIème et XVIIIème siècle en 2018 ou au musée des Beaux-Arts d’Angers, attirant l’attention des visiteurs sur la situation particulière de ces œuvres.
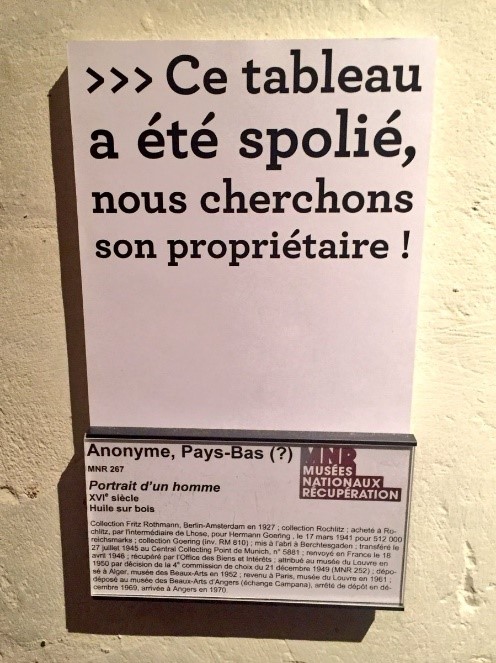
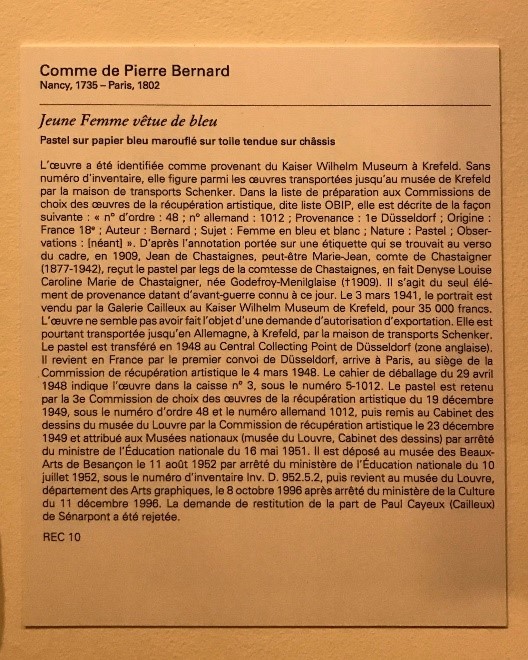
Cartel MNR du musée des Beaux-Arts d’Angers © Pierre Noual, Twitter / Cartel MNR lors de l’exposition
Pastel du Louvre des XVIIème et XVIIIème siècle © Alexandre Curnier-Pregigodsky, Twitter
Il semble absolument nécessaire de mentionner la provenance connue de ces œuvres, mais celle-ci peut toutefois étouffer le visiteur sous une masse d’informations. Aussi, il serait peut-être pertinent de représenter le parcours complexe des œuvres sous la forme de schéma, comme ce fut le cas à l’exposition 21 rue de la Boétie à Libourne avec un compromis intéressant entre nécessité d’informer et pédagogie !
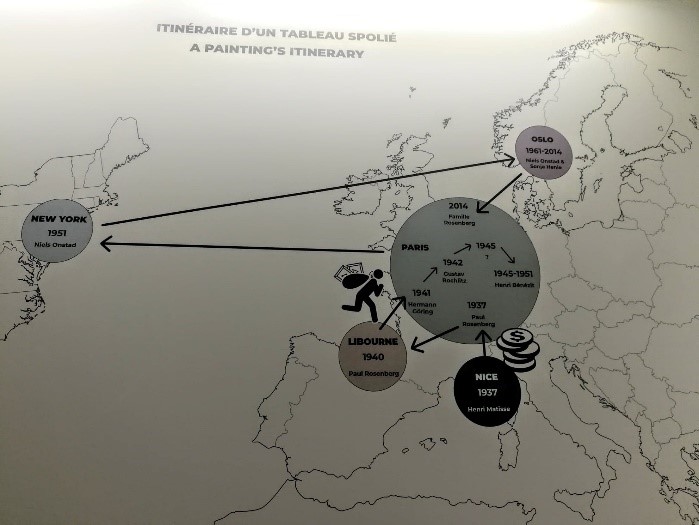
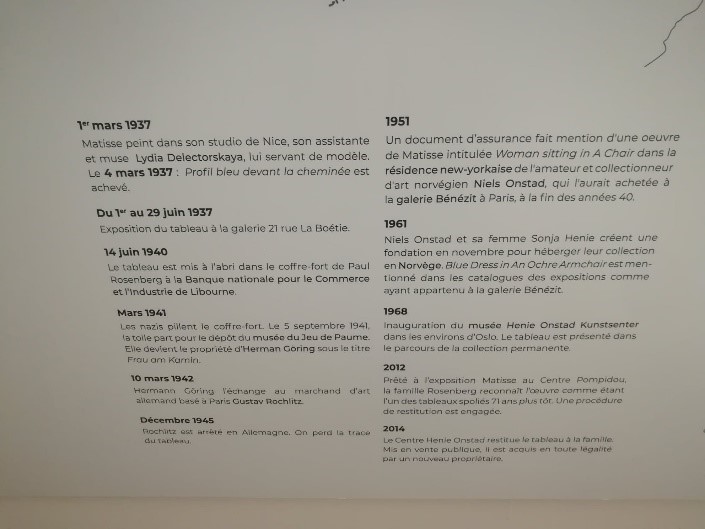
Itinéraire d’un tableau spolié : schéma et dates clés pour comprendre le parcours complexe d’une œuvre de Matisse à l’exposition 21 rue de la Boétie à Libourne © Cloé Alriquet
Enfin, des initiatives innovantes sont également développées ces dernières années comme la bande dessinée numérique disponible en ligne intitulée Le portrait d’Esther où le lecteur se glisse dans la peau d’une famille découvrant son passé et le destin d’une œuvre spoliée, créé par le musée des Beaux-Arts d’Angers en 2016 et débouchant sur une exposition des planches originales en résonnance avec les MNR du musée. Du côté du numérique, une exposition virtuelle Spoils of war du musée numérique UMA, a été inauguré suite à un financement participatif en septembre 2018, où l’on se balade dans une exposition numérique autour des spoliations et plus étonnant, un hackaton, un marathon de développement informatique a même eu lieu en octobre 2018 au musée de Niort dans le but de mettre en valeur les MNR du musée !
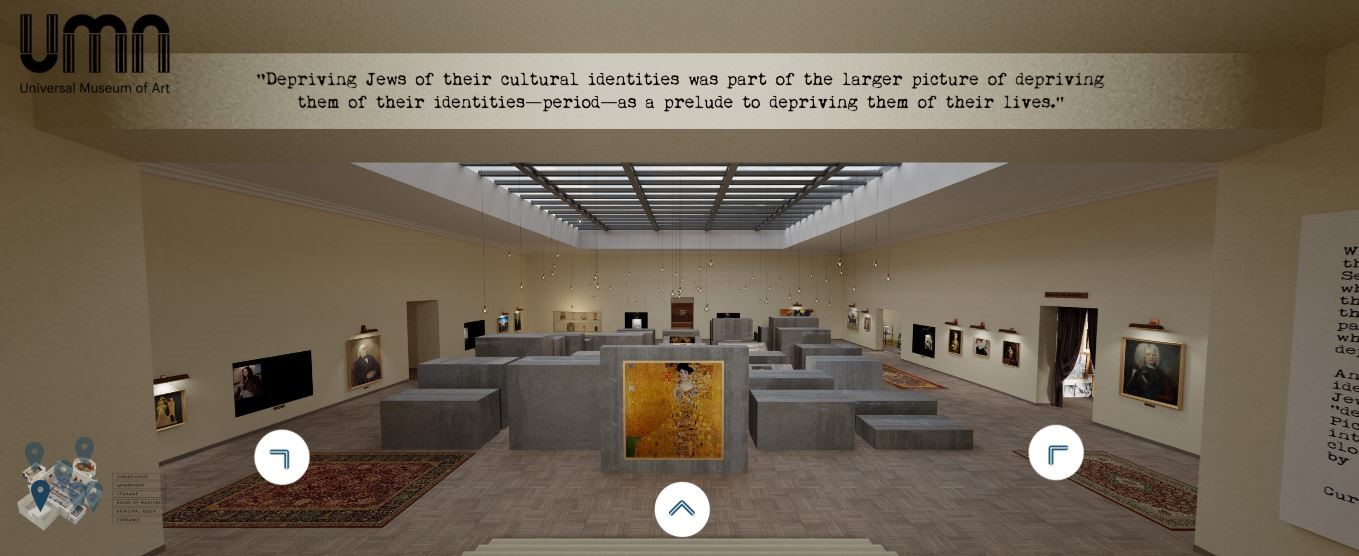
Capture d’écran de l’exposition numérique « Spoil of Wars » de l’UMA avec au premier plan le célèbre tableau de Klimt « Portrait d’Adèle Bloch Bauer », spolié et restitué aux ayants droit en 2006.
Depuis 2014 : L’après Gurlitt et le rôle affirmé du chercheur de provenance
En 2014, était révélé dans la presse allemande la découverte de milliers œuvres dans un appartement munichois, chez Cornelius Gurlitt, fils du marchand d’art allemand controversé Hildebrandt Gurlitt. La donation de ces œuvres au musée des Beaux-Arts de Berne à la mort de Cornelius entrainera un programme de recherche sur la provenance de ces œuvres, et en 2017 à deux expositions conjointes, une première sur l’art dégénéré au musée des Beaux-Arts de Berne et une seconde sur les spoliations nazies au Bundestkunsthalle de Bonn qui relancera l’intérêt mondial sur les recherches de provenance. Fin 2018, l’exposition Gurlitt est présentée au Gropius Bau de Berlin et en parallèle ont lieu les 20 ans de la Conférence de Washington, renouvelant au niveau international l’importance et l’actualité de ces problématiques avec une importance donnée à la formation et au métier du chercheur de provenance. La mise en valeur de ce travail, qui était plutôt invisible avant, se ressent aussi dans l’exposition Gurlitt où le public est accueilli dans la salle finale par un médiateur-chercheur pour répondre à leurs questions et les guider dans la recherche sur ordinateur.

Vue de l’espace final de l’exposition Gurlitt à Berlin, Gropius Bau, novembre 2018 © Cloé Alriquet
La dernière restitution à ce jour de cette collection, date du 8 janvier 2019 où le Portrait de femme de Thomas Couture a été rendu aux ayants droit de l’ancien premier ministre français Georges Mandel. Ce dernier est exposé depuis fin mars au côté d’une œuvre restituée d’Odilon Redon découverte sur une vente aux enchères et Georges Romney ancienne œuvre MNR, et d’une photographie du dos d’un tableau de John Constable restitué en 2017 au Mémorial de la Shoah dans l’exposition Le marché de l’art sous l’Occupation sous le commissariat de l’historienne de l’art Emmanuelle Polack. Ces trois tableaux sont accrochés dans la salle de « L’atelier du chercheur de provenance » où de nombreuses ressources sont présentes et une permanence est organisée le dimanche pour répondre aux interrogations des visiteurs ou de familles spoliées. Plusieurs expositions vont ouvrir en 2019 sur ces problématiques : une salle sur les œuvres spoliées de Paul Rosenberg au Centre Pompidou le 22 mai 2019, une exposition sur Rose Valland au musée Dauphinois de Grenoble à l’automne…
Cet article s’ouvrait sur la création d’une Mission de recherche et de restitution des biens spoliées entre 1933 et 1945 au ministère de la Culture ce printemps. Celle-ci fait suite à un rapport demandé en 2017 par la ministre Audrey Azoulay et remis à Françoise Nyssen par David Zivie sur l’état des lieux de la recherche de provenance en France. Ce rapport redéfinit les priorités autour de la recherche de provenance dont le but principal est évidemment d’étudier, d’une part les MNR et d’autre part les œuvres des musées nationaux acquises sous l’Occupation en vue de leur restitution éventuelle, mais également de valoriser ces questions auprès du grand public comme le montre un paragraphe des statuts officiels : « elle veille à la sensibilisation des publics et des professionnels aux enjeux soulevés par les spoliations de biens culturels intervenues entre 1933 et 1945 et par la présence de biens spoliés dans les institutions publiques».
On ne peut désormais qu’espérer que cette nouvelle dynamique donnera lieu à une future grande exposition française ! A suivre…
Cloé Alriquet
#exposition
#spoliations
#restitution
Pour aller plus loin :

STO LAT ! La Polonia a cent ans
Une convention relative à l’émigration et à l'immigration est signée le 3 Septembre 1919 entre la France et la Pologne. Celle-ci a organisé le déplacement d’un demi-million de travailleurs polonais en France, permettant à cette dernière de répondre à la pénurie de main d’œuvre causée par le Première Guerre mondiale et, pour la Pologne, de résoudre en partie le problème de la misère des populations rurales, dans un pays à la structure agraire et au secteur industriel insuffisamment développé. L’immigration s’est en conséquence implantée dans les régions fortement meurtries par la guerre et, notamment, le Pas-de-Calais (115 300 habitants dans les régions minières, soit 22,7 %, en 1931 mais aussi sur les terres agricoles pour environ 15 %). Cent ans après, le Département du Pas-de-Calais, par le biais de ses Archives départementales, souhaite interroger l’empreinte des Polonais sur son territoire ainsi que la mixité qui a résulté de son insertion à la population locale, en commémorant l’un des événements fondateurs de son histoire récente.
Retracer cent années de la vie d’une communauté est loin d’être aisé. Souvenirs, ressentis, expériences, chacun a sa propre histoire. L’exposition invite le visiteur à (re)découvrir cette communauté polonaise au travers de thèmes au sein desquels sont abordés les points forts de ce siècle. Ces thèmes sont transversaux : certains peuvent couvrir une longue période alors que d’autres sont attachés à un fait ou un moment donné. Le choix des différents thèmes s’est porté sur ce qui existe de commun entre des communautés distinctes ; cela dans le but de parler à l’humain présent en chacun d’entre nous. Travaillés sous le prisme des Polonais du Pas-de-Calais, les thèmes se répartissent entre entre le travail, l'école, la Seconde Guerre mondiale, les coutumes, les expulsions, la vie associatives et bien d'autres encore.

Vue de l'exposition « Sto Lat ! La Polonia a cent ans ». © Serge Chaumier
La scénographie, conçue par l'agence Présence, se prête au concept itinérant de l'exposition. Chaque thème correspond à un module associé et le parcours en comporte douze. Il était primordial que la scénographie soit le miroir des thématiques en valorisant les archives proposées. Celles-ci se déclinent sous plusieurs formes : des reproductions aux fac-similés en passant par des originales, une multitude de supports est proposée aux visiteurs afin qu'ils puissent s'approprier ces archives, leur patrimoine.

Visiteur utilisant un fac-similé. © AD62 – Laï Nam Thai
Les médiations avec le public sont au cœur de l'exposition. Elle se compose d'abord de quatre dispositifs pédagogiques qui proposent principalement aux enfants de découvrir différentes facettes de la culture polonaise. Associées avec le thème du module qui la comporte, elle se répartissent ainsi :
- pour le travail à la mine, le jeu « Trouve Charlowski » permet de découvrir les métiers de la mine reliés aux différentes lampes de mineurs qui se sont succédées au travers des époques ;
- en rapport avec l'émergence du commerce polonais, les enfants doivent deviner quels étaient les produits transportés par un marchand ambulant polonais ;
- afin de faire découvrir les fêtes polonaises, une activité s'appuyant sur les mots amène les joueurs à déchiffrer les différentes coutumes qui ponctuent une année ;
- enfin, en parallèle du thème « cercle familial » qui évoque la musique, les jeunes visiteurs sont invités à recréer un orchestre polonais.

Vue de deux médiations au sein des modules thématiques. © Serge Chaumier
L'exposition est le fruit de nombreux partenariats. Elle fut conçue et réalisée, principalement, en collaboration avec la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin, l'Institut des civilisations et études polonaises (ICEP) de Lens, le master expographie-muséographie (MEM) de l'université d'Artois et l'École supérieure des arts appliqués et du textile (ESAAT) de Roubaix. En effet, un travail en amont avec ses étudiants a permis de réaliser un parcours sonore formé de cinq dispositifs indépendants chacun relié à un témoignage audio et un objet-totem relié à un thème de l'exposition : le travail, l'école, le cercle familial qui évoque la cuisine et la musique ainsi que celui des traces actuelles qui aborde le langage oral mixte communément appelé « chtiski ».
Pour information, l’exposition se déroule du 3 septembre au 24 novembre 2019 à la Maison syndicale des mineurs de Lens. Celle-ci aura ensuite vocation à être itinérante. L’accès à l’exposition est gratuit ainsi que toutes les prestations proposées.
Elise Mathieu
#Exposition
#Pologne
#Centenaire
Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires à votre visite sur le site des Archives départementales du Pas-de-Calais :
http://www.archivespasdecalais.fr/Actualites/Exposition-Sto-Lat
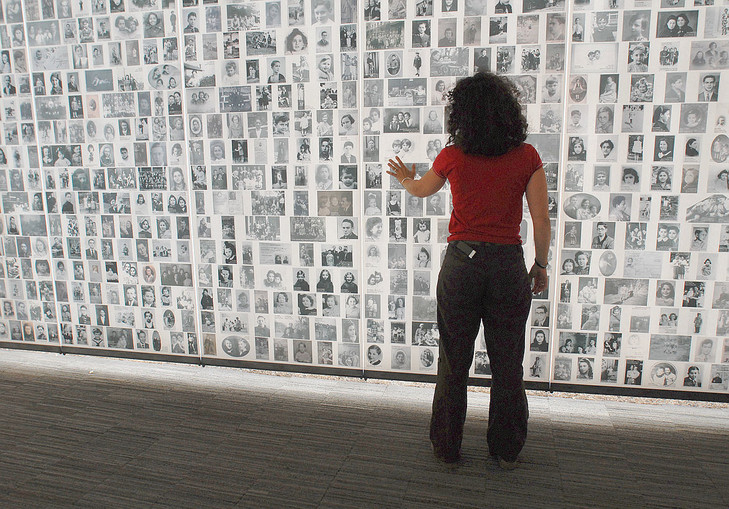
Survivre
© Bordeaux
 Comment exposer la Shoah ? À travers l'exposition Survivre. Génocide et ethnocide en Europe de l’Est le centre Jean Moulin de Bordeaux poursuit la réflexion, menée par Anne Grynberg dans « du mémorial au musée, comment tenter de représenter la Shoah ? » 1. Hormis à l'incontournable mémorial de la Shoah à Paris, les expositions temporaires consacrées à ce thème que l'on croit rebattu, ne sont pas si nombreuses. Le centre Jean Moulin a choisi de présenter un ensemble documentaire inédit, composé de plus de mille photographies d'époque et près de deux cents autres pièces d’archives, documents réunis de longue date par Carole Lemée, anthropologue à l'Université Bordeaux-II, qui a travaillé pendant trois ans sur cette exposition.
Comment exposer la Shoah ? À travers l'exposition Survivre. Génocide et ethnocide en Europe de l’Est le centre Jean Moulin de Bordeaux poursuit la réflexion, menée par Anne Grynberg dans « du mémorial au musée, comment tenter de représenter la Shoah ? » 1. Hormis à l'incontournable mémorial de la Shoah à Paris, les expositions temporaires consacrées à ce thème que l'on croit rebattu, ne sont pas si nombreuses. Le centre Jean Moulin a choisi de présenter un ensemble documentaire inédit, composé de plus de mille photographies d'époque et près de deux cents autres pièces d’archives, documents réunis de longue date par Carole Lemée, anthropologue à l'Université Bordeaux-II, qui a travaillé pendant trois ans sur cette exposition.
La scénographie, nécessairement sobre et grave, se déploie dans un espace fraîchement refait, aux murs rouges sombres. Un ensemble de vitrines constitue le parcours chronologique du processus génocidaire. Deux expôts particulièrement macabres retiennent l'attention au milieu des photographies : des éprouvettes étiquetées, témoignage des expériences nazies visant à la création d'une race « pure », la race Aryenne, plus loin des cartouches de Zyklon-B signifient toute l'horreur de l'extermination. Un avertissement à l'entrée de la salle rappelle la violence de certaines images, âmes sensibles s'abstenir... les cartels sont courts et efficaces. Le parti-pris du centre et de la commissaire, Carole Lemée, est de mettre la lumière sur la notion « d'ethnocide » souvent négligée, confondue avec le terme « génocide ». L'annihilation du peuple juif, de son ethnos passera sous le IIIeReich par la destruction de sa culture, de son identité.
L'objet particulièrement fort de l'exposition se suffit pratiquement à lui-même et pâtirait d'effets théâtraux, d'une mise en scène de l'horreur. La tragédie est dans tous les regards vides qui émanent des photographies, hommes, femmes et enfants photographiés par leurs bourreaux, creusant leurs propres tombes. Ailleurs, l'insoutenable. L'image connue, attendue, inévitable du charnier, du déporté décharné tandis que deux vitrines plus loin des officiers nazis prennent la pose en riant. Le travail universitaire réalisé ici est remarquable et a permis de recenser plus de 1500 ghettos juifs en Europe (principalement orientale). Carole Lemée, qui avait consacré sa thèse à la mémoire de Vichy aujourd'hui, n'avait jamais présenté ce fonds documentaire, fruit d'une collecte ou plutôt d'une traque chez les brocanteurs, les antiquaires... Le centre qui en a désormais l'usufruit prévoit la parution d'un livre, les documents sont en cours de numérisation. Certains albums sont d'ailleurs présentés numériquement dans l'exposition, peut être aurait-il fallu davantage de supports technologiques pour une meilleure visibilité des images (petits formats), certains clichés ont été agrandis ; sans toutefois tomber dans l'extrême de la table tactile déjà éprouvée au musée de la Seconde Guerre Mondiale « La Coupole » où les (jeunes) publics s'amusent avec le Multitouch sans songer qu'ils « zooment » sur des clichés de déportés.
© Guillaume Bonnaud
 La question des publics et de la médiation est cruciale face à un sujet ô combien sensible, source de commémoration et d'historiographie. L'exposition Survivre a attiré un nombreux public et a de fait été prolongée jusque septembre 2012 2 mais il s'agit d'un public averti qui a fait la démarche d'aller au centre, pas de flâneurs ici. Le centre propose en parallèle de l'exposition un programme de rencontres/débats qui voient se succéder historiens et témoins. Hélas, le revers de la médaille est la présence impromptue de perturbateurs qui font le salut nazi devant les vitrines, de négationnistes et autres nazillons qui réécrivent les cartels...
La question des publics et de la médiation est cruciale face à un sujet ô combien sensible, source de commémoration et d'historiographie. L'exposition Survivre a attiré un nombreux public et a de fait été prolongée jusque septembre 2012 2 mais il s'agit d'un public averti qui a fait la démarche d'aller au centre, pas de flâneurs ici. Le centre propose en parallèle de l'exposition un programme de rencontres/débats qui voient se succéder historiens et témoins. Hélas, le revers de la médaille est la présence impromptue de perturbateurs qui font le salut nazi devant les vitrines, de négationnistes et autres nazillons qui réécrivent les cartels...
Le choix de cette exposition aujourd'hui à Bordeaux est tout sauf anodine. Le centre Jean Moulin, consacré à la Résistance avait jusqu'à présent considéré la déportation uniquement à travers le vécu des Résistants, jamais des Juifs. Il fallait remédier à cette absence. D'autant que la question des mémoires de Bordeaux est un terrain encore miné par les tabous, ceux d'une ville esclavagiste au XVIIIème siècle et ville la plus « collabo » de France sous l'Occupation. La municipalité souhaite montrer son engagement à parler des sujets qui fâchent et dont le meilleur medium reste l'exposition. Par ailleurs, le centre efficacement dirigé aujourd'hui par Christian Bloch (conservateur au Musée d'Aquitaine) souffre terriblement d'une muséographie obsolète, élaborée il y a plus de trente ans au mépris de toutes les règles de conservation préventive par des bénévoles plutôt chatouilleux sur le respect de leur mémoire individuelle. Ainsi, la modernisation de la scénographie dans la salle d'expositions temporaires veut faire oublier que jadis ici une maquette d'Auschwitz en allumettes expliquait le fonctionnement du camp... La politique d'expositions temporaires permet de pallier cette faille et d'attirer sur des sujets de fonds un nouveau public.
Noémie Boudet
« Survivre. Génocide et ethnocide en Europe de l’Est », centre Jean Moulin, Bordeaux, du mardi au samedi, de 14h à 18h.
1: Les Cahiers de la Shoah, 2003/1 no 7, p. 111-167.
2: fin initialement prévue le 8 avril

Témoignages du bord de mer
Dans le cadre de notre projet tuteuré entre l'Université d'Artois et le Conseil Général du Pas-de-Calais, nous menons une recherche sur la mémoire des marins d'Étaples. En 2016, le département inaugurera un nouveau musée à Étaples, celui des Peintres de la Côte d'Opale. Ce musée, qui présentera essentiellement des tableaux, intégrera également dans son parcours une mise en contexte de cette colonie artistique, en partie établie à Étaples du début du XIX° siècle jusqu'à la Première Guerre Mondiale. Ces peintres ont abondamment représenté la vie maritime de la ville, les bateaux, les pêcheurs, etc. Pour créer un parallèle entre les sujets évoqués dans les tableaux et la mémoire que les Étaplois en gardent aujourd'hui, nous avons récolté des témoignages de marins et de leurs femmes.
Crédits : Capucine CARDOT Le musée des Peintres de la Côte d'Opale : un lieu de mémoire
Hâtifs préparatifs
Durant plusieurs semaines, nous avons enchaîné coups de fil sur coups de fil afin de prendre rendez-vous avec les habitants d’Étaples. Les allers-retours entre les pages jaunes et l’agenda furent fréquents. Nous avons même passé une journée sur le terrain en décembre pour préparer les quatre journées d’entrevues qui eurent lieu fin janvier. Nous nous sommes également occupées de l'hébergement sur place, du matériel à emporter pour ne pas en perdre une miette : appareils photos et dictaphones.
Le master débarque à Étaples
Après toute cette mise en place de la semaine, nous voilà parties sur les routes sinueuses en direction d’Étaples. Nous ne sommes pas seules, toute la promotion des premières années nous accompagne. Dix-sept filles débarquent donc à Étaples – citéde pécheurscomme nous l’indique un panneau à l’entrée de la ville. Durant toute la semaine, elles nous ont été un support et une aide pour la réalisation des entretiens et leur retranscription. Au total, nous avons interrogé une vingtaine de personnes d’Étaples avec leur aide. Nous avons aussi organisé des visites tout au long de la semaine, après une petite balade sur le port de plaisance nous sommes allées visiter le Musée de la Marine pour voir une mise en contexte et acquérir le vocabulaire du marin : le chalut, le cabrouet, les bateaux à clin sans oublier la coutume du partage ! La visite du dernier atelier de construction de bateaux en bois d’Étaples est venue comme une belle conclusion à cette semaine d’immersion.
Toute l'équipe se réunit autour d'un verre pour fêter la fin de cette semaine
Crédits : Capucine CARDOT
Des rencontres pleines d’humanité
Ces rencontres ont été très riches. Certaines personnes se sontconfiées à nous et nous ont fait partager une partie de leur vie. Parfois même elles nous ont laissé en prêt pour quelques jours les albums de famille et des photos prises à bord des bateaux. Souvent, nous avons partagé des moments forts, des souvenirs d'une vie de marin, pas facile... Nous garderons ces bribes de vie au-delà du cadre de notre projet.
La suite avec impatience
Après la retranscription des entretiens, une importante étape d'analyse nous attend. Celle-ci nous permettra d'émettre des propositions d'intégration des témoignages dans le parcours du futur musée. À suivre donc !
Dans le dernier chantier naval repose le Charles de Foucault
Crédits : Léa PECCOT
Un grand merci...Pour finir, nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous ont accordé un peu de leur temps pour nous rencontrer. À ce titre, nous souhaitons remercier particulièrement Georges BOUCHART, Président des Amis du Musée de la Marine, Jérôme RAMET, du chantier de construction navale traditionnelle, ainsi que Marie-France TETU, pour leur aide et leur disponibilité, avant et pendant notre semaine à Étaples.
Léa PECCOT & Diane WESTPHAL
#projettuteuré
#étaples
#marins

Thiepval, un nouveau musée pour commémorer le centenaire des batailles de la Somme de 1916
Thiepval est une étape essentielle du circuit du souvenir des batailles de la Somme. En 1932, le Mémorial britannique est érigé sur les champs de bataille. Les noms des plus de 70 000 disparus britanniques et sud-africains y sont gravés. Un centre d’interprétation ouvre ses portes en 2004. Sous l’impulsion d’Hervé François, directeur de l’Historial de Péronne, le musée de Thiepval est inauguré en juin 2016 à l’occasion du centenaire. Le musée aborde l’impact de la guerre sur la Somme, à la fois sur le front mais aussi à l’arrière. Situé sur un lieu porteur d’une charge symbolique forte, le musée de Thiepval propose des choix originaux en termes de muséographie, de médiation et de contenu.
« Les batailles de la Somme ne se résument pas à de simples lignes sur une carte »
Le choix d’une approche globale des batailles de la Somme, qui ne se concentre pas uniquement sur le front, est intéressant. L’ensemble des sites du circuit du souvenir évoque essentiellement les stratégies militaires, les faits d’arme, les actes héroïques ou encore les pertes humaines. Les Britanniques sont très représentés alors que les Allemands très peu. A Thiepval, l’idée de parler de l’ensemble des belligérants s’inscrit dans la ligne de l’Historial de Péronne. Les récits des Allemands, des Français et des Britanniques se croisent dans les salles consacrées au deuil et à l’invention des « as » de l’aviation. Parler des hommes avant de parler des soldats, des vainqueurs et des vaincus, est nécessaire. En effet, aussi absurde que cela puisse paraître, les tabous concernant la place accordée aux Allemands dans les lieux de mémoire sont encore présents dans certains esprits.
Dans la continuité, le musée aborde dans une salle très émouvante la question du deuil. Familles et civils sont présentés comme témoins et acteurs de la guerre, ce qui est rarement le cas sur les autres sites du circuit du souvenir. Le deuil permet de croiser plusieurs points de vue, celui des disparus, des familles et des autorités. Les objets deviennent reliques et dévoilent, derrière chaque nom, une histoire collective.
© M. D.
« L’effort consenti par les sociétés dans la guerre continue d’interroger »
La fresque de Joe Sacco pour illustrer l’offensive du 1er juillet 1916 est un choix muséographique plus que judicieux. L’immersion est totale dans cette journée symbolique, la plus meurtrière pour l’armée britannique. Aux murs, l’immense fresque est reproduite sur des parois en verre. Au centre de la salle, dans des fosses, des objets retrouvés à Thiepval ou issus des collections de l’Historial de Péronne sont exposés comme témoins matériels des scènes représentées sur la fresque. C’est véritablement un dialogue qui s’installe entre les objets et les images, entre l’interprétation actuelle de l’offensive à travers l’œuvre d’un contemporain et les objets retrouvés, témoins du passé. Le dialogue entre passé et présent est omniprésent et ouvre plusieurs portes au champ de réflexion.
© M. D.
La fresque de Joe Sacco est aussi un outil médiation. Sous chaque scène, une explication est inscrite sur un panneau. Chacun peut lire, interpréter les images seules ou en lien avec les informations ainsi données. La fresque permet une véritable démocratisation du contenu scientifique et évite ainsi toute reconstitution douteuse avec mannequins en cire et autres inventions inesthétiques.
« Parfois quand il y a trop de textes, trop d’images, trop d’informations données tout de suite, finalement ça devient étouffant et on ne retient plus rien. » Emilie Simon, chargée de muséographie
Le visuel est un élément essentiel de la médiation du musée. Ecrans diffusant images et films d’archives, vidéos montrant les lignes de front ou reconstitutions 3D sont présents dans presque toutes les étapes du parcours. Un dispositif a particulièrement attiré mon intention. Dans la salle consacrée au deuil, une installation interactive projette au sol les photos et l’histoire de dizaines de soldats. Le visiteur est invité à prendre une planche blanche et à la placer sous le projecteur pour suivre les parcours qui défilent des missing. Le dispositif laisse une grande liberté de choix et d’action. Ainsi l’ensemble de l’espace est utilisé sans surcharger les parois murales. Mais dans la pratique, le visiteur utilise peu ce dispositif car les planches et le schéma explicatif, placés dans un recoin, manquent de visibilité.
© M. D.
Le musée a délibérément choisi de ne pas utiliser de dispositifs de médiation tactiles. Le parcours fonctionne très bien sans car la visite est autonome. Il y a énormément de visuels, de vidéos pour démocratiser et développer le propos.
Le musée de Thiepval s’ancre dans les problématiques du musée du XXIème siècle. C’est un musée engagé à travers un parti pris universel, une volonté de confronter les points de vue de l’ensemble des belligérants et de ne pas se limiter à une vision manichéenne de la guerre. Mais le musée pourrait aller encore plus loin et interroger davantage l’engagement des femmes dans les batailles de la Somme. Elles sont présentes en tant que mères, sœurs, filles d’hommes disparus au front. Elles sont présentes en tant que victimes de la guerre dans la cartographie consacrée aux civils. Les femmes ne sont pas ici considérées comme actrices mais comme spectatrices de la guerre. Et pourtant interroger leur engagement, en tant qu’infirmière, en tant qu’ouvrière, serait enfin leur reconnaître une participation active dans les batailles de la Somme. Cette participation, vecteur d’émancipation, est souvent effacée par une approche essentiellement tournée vers les soldats, vers les hommes, vers la ligne de front.
M. D.
#Thiepval
#Somme100
#MuséeduXXIesiècle
http://www.historial.org/Champs-de-bataille-de-la-Somme/Musee-a-Thiepval
Tout ce qui brille ! Les musées de l'Or en Géorgie et en Colombie
La Colombie et la Géorgie ont chacune une légende dorée.
El Dorado
Musée de l’Or, Bogota © EL
« De tous les points du globe partaient maintenant des solitaires, des corporations, des sectes, des bandes vers la terre promise, où il suffisait de se baisser pour ramasser des monceaux d'or, de perles, de diamants ; tous convergeaient vers l'Eldorado. » Cendrars, L'Or,1925, p. 148.
Cet« Eldorado » est un pays légendaire au Nord de l’Amérique du Sud quiregorgerait de pierres précieuses et d’or.
Defait, les indiens Chibcha ont nourri ce mythe par une pratique rituelle annuelle : leur chef recouvert de poudre d’or allait se baigner dans un lac où les villageois lançaient des objets en or. Et même si on trouve aussi, effectivement, en Colombie, des mines d’or et d’émeraude, encore exploitées aujourd’hui, les nombreux aventuriers sont venus chercher, dans les jungles du Nord du pays, cette cité fabuleuse… en vain.
L’or de Colchide
Musée national géorgien, ©Site internet
Depuis l’Antiquité, la Colchide est décrite comme un pays d’abondance où l’or fait scintiller les ruisseaux. Parmi les plus grands mythes, « Jason et les Argonautes » raconte la quête épique de la Toison d’Or … en Colchide.
On trouve effectivement sur les rives de la Mer Noire de l’or, de l’argent et du fer en grande concentration. Et, depuis toujours, les bergers pratiquent l’orpaillage (récolte d’or dans les ruisseaux) en trempant une peau de mouton dans le ruisseau qu’ils faisaient ensuite sécher, toute dorée, sur les branches des arbres proches. C’est amusant de constater que ce sont des ethnologues, en étudiant les bergers du Caucase, qui ont pu prouver à des historiens que le mythe avait un fond de réalité !
L’archéologie considère que le second royaume de Colchide (VIe-Iersiècle av. J-C.) est le premier Etat géorgien (le pays s’est ensuite étendu à l’Est). La Géorgie a abrité de brillantes civilisations pratiquant très tôt l'agriculture et la métallurgie du bronze et du fer, grâce à sa position de carrefour entre l'Orient et l'Occident.
Musée de l’Or, Bogota © EL
Le musée géorgien
En réalité, pas de musée de l’Or en Géorgie mais seulement un étage dédié au sein du musée national à Tbilissi. Le trésor est cependant en bonne place : deux tortues d’or constituent le logo du musée.
L’exposition est présentée sous un angle historique qui souligne le développement précoce de la métallurgie. Les vitrines, sur fond blanc dans une salle sombre, mettent en valeur les chatoiements du métal. Souvent, au fond des vitrines un dessin au trait des sites archéologiques permet de situer où les objets ont été trouvés.
La présentation est très sobre, le texte est très limité mais valorise les fouilles en cours sur des sites archéologiques majeurs comme Vani en Imérétie.
La symbolique de l’or est peu développée mais on sent son attrait dans le choix du logo et la multiplicité des reproductions des objets en or dans tous les marchés de Tbilissi (même s’ils sont rarement rapportés à l’archéologie ni même aux légendes de Colchide et de la toison d’or).
Les musées colombiens
La Colombie peut se targuer de présenter des objets en or dans plusieurs de ses musées. On trouve les collections les plus importantes à Santa Marta (Nord du pays, terre de l’Eldorado) et à Bogota (capitale, où sont rassemblés des objets d’origines géographiques variées).
Volontairement ou non, une forte harmonie se dégage des deux présentations de ses collections.Les vitrines et les couleurs sont similaires, probablement dessinées par le même scénographe.
© Musée de Santa Marta
Musée de Bogota, © EL
Le musée de Santa Marta est plus « local », il raconte l’histoire d’une civilisation qui vivait dans la jungle, à quelques dizaines de kilomètres seulement. Les objets d’or sont protégés par deux gardes et une porte blindées qui détonne dans la maison coloniale où est installé le musée.
Le musée de Bogota est beaucoup plus important (immense bâtiment de 4 étages dans le centre-ville) mais surtout, il place la matière « Or » au cœur de son récit muséographique, avant l’histoire locale. La visite commence par une projection sur les symboliques de l’Or et son utilisation au fil des siècles partout sur le globe. La seconde partie s’attarde sur les techniques de travail de l’or (martèlement, fonderie etc.) avec un travail d’explication des gestes (grâce à l’iconographie et des reconstitutions modernes) et des outils. Ensuite seulement, les objets en or se font les témoins des différentes civilisations indigènes de Colombie, de leurs rites, leurs histoires, leurs gloires et leurs déclins.
Homme chauve-souris – Chaman, Muséede l’or de Santa Marta, © EL
On pourrait se demander si la Colombie, aujourd’hui, ne cherche pas à créer un cercle vertueux qui lierait étroitement son identité nationale et la richesse de ses sols. Le pays exporte toujours de l’or et des émeraudes et développe très fortement les musées qui font dialoguer l’Histoire, la géographie, les mythes et la réalité, l’Eldorado et la Colombie contemporaine. Cette construction d’une identité est légitime mais elle crée parfois des lieux surprenants comme ces nombreux « musées de l’émeraude » à Carthagènes des Indes qui sont en réalité des boutiques d’émeraude avec quelques panneaux sur les mines, la taille et/ou la symbolique des pierres précieuses.
Les objets en or sont des expôts muséographiques passionnants car ils exigent de nombreuses disciplines pour les présenter correctement.
Un objet en or est souvent une richesse actuelle, du fait de sa composition et un témoin archéologique dont la valeur ne peut être chiffrée le devrait-elle ?). Dans ces deux cas il s’agit d’un objet à protéger. Sa matière peut symboliser la pureté ou la convoitise, la gloire des vivants ou celle des morts. Il transcende toutes les explications par son éclat séduisant.
Musée de l’or de Santa Marta © EL
Pour rêver à votre tour devant ces trésORS, dirigez-vous au château de Nantes où, du1er Juillet au 12 Novembre 2017, sont présentées les collections du musée de l’Or de Bogota dans l’exposition « Les esprits, l’or et le Chaman ».
#Or
#Géorgie
#Colombie
L’or et les bijoux : https://www.beauxarts.com/expos/lumiere-sur-6-expos-en-or/
Musée national géorgien : http://museum.ge/?lang_id=ENG
Musée de l’Or de Bogota : http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro
Exposition à Nantes : http://www.chateaunantes.fr/fr/evenement/les-esprits-lor-et-le-chaman

Toutankhamon à Paris : des expositions pharaoniques
Toutânkhamon et son temps : la révolution des expositions temporaires
De plus, l’exposition dure : initialement prévue pour 4 mois, elle fermera finalement ses portes au bout de sept. L’affluence qui en découle est aussi un des facteurs d’innovation. Chacune des 1 200 000 entrées fut payante, afin de sauvegarder les trésors de Nubie. Même les scolaires devaient payer 1 franc pour entrer. La fréquentation est elle-même exceptionnelle : 108436 élèves sont venus admirer le trésor du pharaon. Toutânkhamon et son temps fait partie des premières expositions grand public qui contribue aux réflexions des musées sur les publics. La presse est à la hauteur de l’événement : quelques mois avant le début de l’exposition, un reportage télé présente l’arrivée d’une partie des œuvres à l’aéroport. Le 9 mai suivant, la visite du Général De Gaulle fait sensation en durant plus d’une heure.

Toutânkhamon et son temps : l’exposition du siècle ©Rue des Archives/AGIP
Mais plus encore, l’exposition propose une muséographie qui marque un tournant dans le milieu. L’objectif pour Christiane Desroches-Noblecourt est de mettre les objets en situation. Cette volonté s’inscrit parfaitement dans la mouvance de l’époque, en parallèle de la « muséographie sur fil de nylon » de Georges-Henri Rivière. Les objets sont présentés dans une scénographie sombre, alors que l’usage était de présenter les objets en pleine lumière. Les salles étaient baignées dans l’obscurité, permettant aux expôts de se détacher grâce à un éclairage soigneusement travaillé. Après quelques salles expliquant le pouvoir du pharaon de son temps, le visiteur entre ensuite dans un tunnel, signe de la mort du jeune roi. Après avoir tourné sur sa gauche, il découvre les salles en enfilades présentant le voyage funéraire grâce au trésor du pharaon. La scénographie propose également une salle présentant les tout débuts de l’immersif, concept inédit dans les expositions pour l’époque. Dans la « salle des papyrus », un marécage est suggéré grâce aux plants de papyrus. En son sein, une petite figurine rappelle la renaissance du pharaon après la mort. La visite se termine sur une salle abritant le masque funéraire du pharaon, apportant l’émerveillement aux visiteurs.

Le plan de l’exposition de l’exposition ©Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Une borne culturelle importante
L’exposition Toutankhamon a véritablement provoqué une petite révolution dans le milieu de la muséologie, de par sa muséographie novatrice et les conséquences d’une telle fréquentation. Face au succès grandissant que rencontrent les grosses expositions (Vermeer à l’Orangerie 1966, Picasso au Grand Palais 1966, Toutânkhamon au Petit Palais 1967), la Réunion des Musées Français (RMN) est mise en place plus vite que prévue, pour gérer ces événements. Comme l’explique Pascal Ory, l’exposition s’inscrit dans un contexte inédit de muséographie. Les premiers remous ont eu lieu en 1937, avec l’exposition Van Gogh au Nouveau Musée d’Art Moderne : l’exposition, très novatrice, est même considérée comme « trop pédagogique » pour l’époque. C’est durant cette exposition que la réflexion sur l’audimat débute. En parallèle, le ministère des Affaires Culturelles se développe. Quelques mois avant Toutânkhamon, les trésors du pharaon, André Malraux doit se battre pour obtenir « 25 km d’autoroute ». La culture « à la Malraux » est finalement à son apogée durant l’exposition, qui s’inscrit dans la volonté de la France pour trouver une place dans la culture internationale grâce à ces expositions hors-normes qui présentent des chefs-d’œuvre.
Toutânkhamon influence le milieu de la culture. Ce sont les débuts de la « religion culturelle » (Pascal Ory) : l’art devient la religion des temps nouveaux, dont les expositions sont les pèlerinages et les artistes les nouveaux dieux. Cette exposition et son succès illustrent la spectacularisation progressive des expositions d'art, et l'entrée dans une ère de mise en scène de la culture par l'état. Elle se situe aussi au début de la culture mesurée à l'aide de statistiques sur lesquelles planchent parfois des chercheurs comme Pierre Bourdieu.
Le trésor du pharaon est une mine d’or
Il est impossible de nier que l’exposition de 2019 se base sur des arguments moins nobles que celle de 1967. Tout d’abord, l’exposition n’est pas française mais internationale. En itinérance dans les plus grandes villes du monde entre 2019 et 2022, le « Toutânkhamon tour » est avant tout un véritable tour de force économique. L’Etat égyptien a décidé de sous-traiter l’organisation par la société internationale d’organisation d’évènements IMG. Cette exposition est pour l’Egypte une triple opération commerciale : une manière de faire de la diplomatie culturelle, d'attirer à nouveau des touristes que la crainte d'attentats terroristes avait fait fuir, et de financer la restauration de ses sites archéologiques et du futur "Grand musée égyptien" en cours de construction près des pyramides. De même, l’entreprise ne cache pas sa volonté de dépasser la barre des 10 millions de visiteurs. Le prix des billets est mirobolant : 24€ le tarifs plein et 22€ le tarif réduit. La boutique a elle aussi tout d’une grande : d’une taille outrageuse, elle regroupe babioles et autres tour Eiffel ensablées qui n’ont rien à voir avec le discours scientifique de l’exposition. Ici ce n’est pas une exposition classique, mais une exposition blockbuster, un grand business model américain.
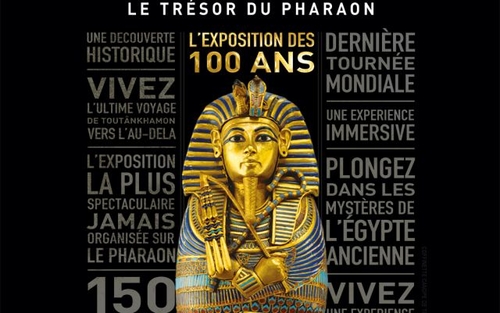
Affiche de l’exposition Toutânkhamon, les trésors du pharaon : tous les ingrédients du marketing sont réunis ©La Villette
La muséographie est quant à elle dans l’ère du temps : sombre, immersive, elle reprend tous les codes des grandes expositions-spectacles. Après une salle d’introduction avec un film qui nous présente le contexte, la foule – répartie par demi-heure – est lâchée dans un dédale de salles présentant les 150 objets réunis pour l’occasion. Les expôts sont joliment mis en valeur grâce à un éclairage bien géré… si seulement le visiteur arrive à les apercevoir devant la foule qui s’amasse. Le grand atout de l’exposition est de présenter les bijoux et autres objets précieux de sorte à voir l’avant et l’arrière de l’œuvre. Cela est d’autant plus agréable que le verso est souvent peu présenté alors qu’il est tout aussi intéressant que le recto.
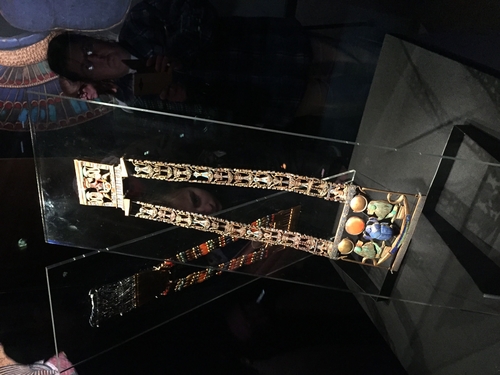

Le pire et le meilleur de Toutânkhamon 2019 : une foule incessante et le recto-verso des expôts ©C.DC
Les conditions de conservation des œuvres, déjà hautement novatrices en 1967, sont encore montées d’un cran. Ici le visiteur ne peut pas admirer les pièces maîtresses de la collection, tel que le masque funéraire, la momie ou encore le trône royal qui n’ont pas fait le voyage.
L’égyptomanie, une passion française
D’aucun ne peut nier la véritable égyptomanie qui secoue la France lorsqu’une exposition ayant trait à l’Egypte a lieu. L’égyptomanie désigne la fascination pour la culture et l’histoire de l’Egypte antique. Les Français, de par le succès des expositions et leur part importante dans le tourisme égyptien, sont connus et reconnus comme friands de cette culture. En 2006, une exposition de répliques de la tombe est programmée, que Paris accueille en 2012 à la porte de Versailles. Le succès est immédiat : environ 250 000 visiteurs ont fait face à ces copies.
Pour l’exposition de 2019, les visiteurs sont bien informés du véritable blockbuster qu’ils ont face à eux. Pourtant, cela ne les fait pas reculer : la volonté de voir une dernière fois les objets du pharaon est plus forte. L’exposition dépasse le statut d’événement pour gagner celui de rite. Aujourd’hui, celle-ci est immersive, en accord avec son temps : tout y est pensé pour vibrer plus que pour voir. Le visiteur vient voir l’éternité, un homme inscrit dans l’histoire pour toujours, qui ne meurt jamais. Tout réside dans le fait que ces trésors ne devaient être vus par personne, dédiés qu’ils sont à l’au-delà. Ici, la culture n’est plus un loisir, mais plutôt « l’ensemble des réponses mystérieuses que peut se faire un homme lorsqu’il regarde dans une glace ce qui sera son visage de mort », (18 avril 1964 Inauguration de la maison de la Culture de Bourges Discours d'André Malraux, ministre des Affaires culturelles).
A l’image de l’exposition de 1967, les visiteurs des expositions effectuent une sorte de rite. Jacques Attali explique que ces expositions, par effet de perspective, permettent au visiteur d’interroger son rapport contemporain au temps. Le rapport à la mort et à ce qui se passe après la mort fascine, et la civilisation égyptienne représente parfaitement cette ambiguïté. « C’est une vision qui nous donne un regard sur les choses que les Egyptiens ne voulaient pas que l’on voit et qui nous fascine parce que cela nous renvoie à la façon dont ce peuple pensait son immortalité, qui est bien différente de la nôtre ». (Jacques Attali).
Clémence de CARVALHO
#Toutankhamon
#blockbuster
#revolution
#1967
#egyptomanie
Pour aller plus loin : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/egyptomanie-24

Transfert versus Le Chronographe : quand le musée s’invite dans un lieu hybride
Alors qu’on voit de plus en plus d’actions culturelles en tous genres s’implanter dans des lieux incongrus, le cas rezéen nous invite à nous plonger dans cette problématique : Bienvenue à Transfert & Co le temps de quelques lignes, aperçu sous l’angle muséal du Chronographe.
Deux lieux, deux dynamiques, deux publics
Transfert&Co, aussi appelé plus généralement Transfert, est un village inspiré d’une cité utopique. Il prend place au cœur d’un désert urbain : la friche immense des anciens abattoirs de Rezé, aux portes de Nantes. C’est une zone libre d’art et de culture, habitée d’architectures fantasques.
Transfert est un projet dédié à l’art, à l’expérimentation et à la rencontre. A la fois expérimental et évolutif, ce projet vise à réactiver cette friche industrielle, de 2018 à 2022, avant la construction du nouveau quartier de la ZAC Pirmil-les-Isles. Projet ouvert et partagé, Transfert souhaite à la fois accompagner les initiatives du territoire et impulser des projets innovants, dans lesquels chacun puisse trouver sa place. En y mêlant programmation artistique, jeux, bars et restaurant, le site souhaite questionner les capacités de la culture à inventer la ville de demain.
Les visiteurs viennent donc à Transfert pour une programmation très éclectique : qu’on ait envie de boire un verre entre ami.e.s, s’essayer à des vieux jeux de société ou d’équipe, manger un morceau street-food en famille, admirer une petite exposition photo ou venir se trémousser sous le chapiteau sur des rythmes de musiques actuelles, Transfert est un lieu idéal.
Le Chronographe
Centre d’interprétation métropolitain, Le Chronographe est situé au cœur du site archéologique de Saint-Lupien, à Rezé. Il propose aux visiteurs d’expérimenter l’archéologie et d'explorer l'histoire de la ville antique de Ratiatum, découverte dans le sous-sol rezéen, et fouillé par les archéologues depuis 150 ans.
Au milieu d'un îlot de verdure de 2 Ha, le Chronographe surplombe la chapelle Saint-Lupien et son millefeuille archéologique, ainsi que les vestiges de l'ancien quartier portuaire gallo-romain. A l'aide des dispositifs numériques, ludiques et interactifs de l'exposition, petits et grands expérimentent les méthodes de l'archeologie et partent a la decouverte de l'histoire de Ratiatum.
Il propose à tous les habitants de la métropole un lieu où l'archéologie révèle une histoire commune et interroge notre perception du territoire. Implanté sur le site archéologique de Saint-Lupien, le Chronographe propose un parcours de découverte de Ratiatum, port de la Gaule romaine, entre le 1er et le 3e siècle. Outil de valorisation, il est également un lieu de découverte, et d'expérimentation autour de l’archéologie, grâce à une programmation ouverte qui favorise le croisement des disciplines. Lieu de diffusion et de sensibilisation, il est le relais de l’actualité archéologique métropolitaine.
Plutôt dans une optique familiale, Le Chronographe est un lieu que l’on fréquente pour découvrir l’histoire antique du site et de la ville, venir profiter de la dernière exposition temporaire ou encore participer activement, en famille ou avec l’école, aux ateliers proposés liés aux métiers de l’archéologie.
Une opposition passé / futur, mais un objectif commun
Si ces deux lieux s’opposent l’un à l’autre par leur ancrage temporel, ils ont néanmoins un objectif de programmation commun : l’expérimentation.
Alors que l’un nous fait expérimenter une discipline, une profession et une réflexion autour du passé des sociétés humaines, l’autre nous fait expérimenter un territoire pour penser l’avenir.
Ces deux lieux se font quasiment face, à vol d’oiseau. Séparés par une route à quatre voie et une zone commerciale, ils partagent un même territoire, exploré sous des horizons opposés. Alors, n’y aurait-il pas quelque chose à jouer ? La réponse est bien évidemment oui, et c’est ainsi qu’est né un atelier fouille retravaillé, entre archéologie et interprétation urbaine.

Atelier Transfert Temporel © PickUp Productions – Transfert&Co
Transfert temporel : l’archéologie du futur entre vos mains !
Commence alors un jeu d’imagination : les visiteurs sont accueillis en 2250, dans la nouvelle ville de Rezo. Dans l’espace d’atelier, deux bacs de fouilles sont disposés, dans lesquels on trouve des objets qui nous sont contemporains. Une mission : trouver un sens à ces divers objets du quotidien, vus par des archéologues du futur.
Mais avant de commencer à creuser, quelques rappels ! Qu’est-ce que l’archéologie ? A quoi ça sert ? Qu’est-ce qu’on peut trouver dans le sol ? Qu’est-ce que la stratigraphie archéologique et sa signification ? Et que dire du territoire ? Toutes ces questions sensibilisent les plus jeunes à l’archéologie.
Au-delà de la sensibilisation, l’exercice se corse, puisqu’il demande un effort d’imagination. Nous savons tou.te.s identifier ces objets, mais dans le futur, comment les interpréter ? Cet exercice conduit à réfléchir sur la place de l’interprétation en archéologie, mais encore sur la légitimité de toute information.
Puis vient le moment de fouiller. Le moment que petit.e.s et grand.e.s attendent avec impatience ! Muni.e.s d’une pelle, d’une truelle et d’un pinceau, le public apprend les techniques de fouille comme de vrai.e.s archéologues. On ne doit pas pousser le sable n’importe comment, au risque de recouvrir les trouvailles des autres participant.e.s.

Fouilles à Transfert © PickUp Productions - Transfert&Co
Et alors, que trouve-t-on ? Parmi des objets en plastique, un drôle de récipient en or… C’est visiblement un contenant, mais pas un contenant permettant d’attraper quelque chose, car on ne peut pas y glisser la main. Visiblement, s’il est doré, c’est qu’il est précieux… Que peut-on en dire ?
En réalité, ce contenant est une cruche faussement dorée, très kitsch, qui aurait servie (selon la légende) au tournage d’un clip de Richard Gotainer…
Puis dans l’autre bac de fouille apparaît une bien étrange forme circulaire cernée de picots, accompagnée d’un instrument en bois et en métal. Cette forme circulaire nous fait penser à une couronne. Et cet instrument, il a un manche en bois, avec au bout un gros bloc de métal. Serait-ce une arme ? Sommes-nous sur la scène du meurtre d’un roi ou d’une reine ?!!
Cette couronne a en réalité été réalisée en pièces d’engrenages de voiture, et l’arme n’est qu’un simple vieux marteau rouillé. Mais en partant de ces éléments, les interprétations et hypothèses fusent, laissant place à la magie des histoires qu’on peut se raconter.
En partant de ces constats, les participant.e.s sont invité.e.s au débat et au questionnement sur les sociétés, qu’elles soient du passé, du présent ou de l’avenir. Ouvrir sur l’écologie est un autre engagement : aujourd’hui, certain.e.s archéologues spécialistes étudient la céramique, et sont appelé.e.s des céramologues. Avec l’apparition du plastique, qu’on sait polluant et très difficilement biodégradable, verra-t-on apparaître des plasticologues d’ici 250 ans ?
Julia Parisel
#archéologie
#médiation
#futur
Tribulations d'une francophone au Canada
Dans le cadre d’un stage effectué entre mars et août 2016 au Canada, j’ai eu la chance d’être invitée à un colloque international sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, organisé à l’Université Laval de Québec. En tant que francophone en visite au sein d’une province très riche artistiquement et historiquement, je tenais à découvrir des institutions culturelles locales. Raison pour laquelle j’ai visité le Musée de la Civilisation à Québec-Ville.
Le Musée de Civilisation de Québec © Musée de la civilisation
Inauguré en 1988 par le gouvernement du Québec, le Musée de la Civilisation fut créé dans un contexte de diversification sociétale, marqué par une importante immigration, et une volonté d’affirmation de l’identité nationale québécoise face au reste du pays. Par-delà l’ambition du gouvernement de développer les politiques culturelles, l’établissement représente la figure même du projet muséal novateur, à l’origine d’une rupture qui va contribuer à l’apparition des musées dits de société. Ce terme qui regroupe les musées d’ethnographie, d’ethnologie, d’histoire, et de la vie locale, désigne des institutions qui favorisent une approche pluri thématique, valorisant les différentes composantes de la vie sociale.
En tant que visiteuse étrangère qui a l’habitude de fréquenter des institutions culturelles françaises, mon premier constat à la suite de cette visite au Musée de la Civilisation, est l’importance de la place accordée à la démocratisation, et l’élargissement des publics. En conciliant son ambition de valoriser la société québécoise, et de s’élargir à d’autres civilisations humaines, cette institution se distingue également par une politique d’exposition innovante, axée sur l’interaction et la participation. Au total, ce ne sont pas moins de cinq expositions basées sur l’identité québécoise, ou d’envergure internationale qui étaient présentées ; parmi lesquelles deux m’ont particulièrement marqué.
Ma visite débuta avec Lignes de vie, la plus importante exposition consacrée à l’art contemporain aborigène au Canada, réalisée en collaboration avec le Kluge-Ruhe Aboriginal Art Collection de l’Université de Virginie. Elle témoigne du processus de création des premiers peuples d’Australie, qui s’inspirent de traditions artistiques existant depuis plus de 60 000 ans, et de la manière dont elles s’inscrivent au sein des grands mouvements artistiques contemporains. A travers un espace ouvert qui joue sur les variations de lumières, ainsi que sur le contraste des couleurs, la visite immersive nous plonge littéralement dans l’ambiance de l’environnement australien (le bleu pour le ciel, le marron pour la terre, et le vert pour la végétation).
Lignes de vie© Musée de la civilisation
Y sont présentées une centaine d’œuvres (artefacts, masques, sculptures et tableaux) qui traite du devoir de mémoire, en rappelant les cruautés impunies et subies par les Aborigènes. Le numérique y possède une place importante puisque trois montages vidéo à vocation documentaire ponctuent la visite, et permettent d’étayer notre regard face à cet art ancestral. Deux bornes interactives sont également à la disposition du visiteur, et complètent les informations apportées par les cartels, permettant ainsi de situer l’œuvre géographiquement et historiquement ; puis d’avoir accès à l’interprétation des histoires racontées à travers les œuvres.
Lignes de vie © Musée de la civilisation
Le parti-pris de l’exposition est d’avoir choisi un parcours non pas géographique mais thématique, divisé en trois zones. Tout d’abord, une zone qui s’intitule « Terres de rêves » rappelle que les premières créations réalisées par ces Autochtones étaient éphémères car conçues à l’aide d’éléments organiques, (tels que la roche, le sable ou encore la terre) et comment au fil du temps, ces œuvres se sont adaptées aux nouveaux médiums. La seconde zone, appelée « Terres de Savoirs » fait ressortir l’influence des éléments de la nature et des légendes ancestrales, ainsi que l’impact qu’a leur identité spirituelle dans leur pratique artistique. Enfin, la troisième et dernière section, « Terres de pouvoirs », témoigne du rôle de leur art, en tant que revendication identitaire, et vecteur des aspirations politiques de ces peuples.
Ma visite se poursuivit par une autre exposition : C’est notre histoire, Premières Nations et Inuit du XXIème siècle, qui traite d’un sujet à travers une approche spatio-temporelle : à la fois revenir sur le passé, évoquer le présent, et envisager l’avenir des 93 000 Autochtones et Inuits qui peuplent la province québécoise à l’heure actuelle. Le terme Premières Nations désigne les Indiens vivant au Canada, qu’ils possèdent le statut d’Indien ou non. L’usage de ce terme s’est répandu au cours des années 1970, afin de remplacer le mot « Indien », considéré alors par certains comme étant choquant. On compte actuellement plus de 600 Premières Nations, et plus de 60 langues autochtones au Canada.
Cette exposition est le résultat d’une collaboration entre le Musée de la Civilisation, et la Boîte Rouge vif, une association sans but lucratif québécoise œuvrant à la valorisation des cultures autochtones. Ensemble, ils ont sollicité onze nations autochtones vivant au Québec, dont ils ont rencontré les représentants à l’occasion d’assemblées consultatives organisées sur deux ans. Au total, ce ne sont pas moins de 800 personnes issues de 18 communautés différentes, qui ont participé à la mise en place de ce projet.
C’est notre histoire, Premières Nations et Inuit du XXIème siècle © Studio du Ruisseau, SMQ
En présentant plus de 450 objets issus des collections du musée (armes, instruments, maquettes et vêtements entre autres), le rôle même de C’est notre histoire, réside dans sa volonté d’amener le visiteur à réfléchir sur ce que signifie être Autochtone au XXIème siècle. Les choix scénographiques ont consisté à partir d’une vaste salle, au design résolument contemporain, dans le but de symboliser le regard neuf à travers lequel le Musée de la Civilisation souhaite aborder les questions relatives aux Premières Nations.
Des archives audiovisuelles, ainsi que des projections sur écran (réalisées grâce à l’appui de l’Office national du film du Canada) sont disséminées au sein du parcours, et illustrent à merveille le propos véhiculé à travers les œuvres présentées. Par ailleurs, six bornes audio ont été installées, permettant ainsi de compléter notre visite par l’écoute d’un récit élaboré par Naomi Fontaine, jeune auteure innue.
De même que pour l’exposition précédente, un parcours thématique divisés en cinq sections différentes fut privilégié. La première, intitulée « Ce que nous sommes aujourd’hui - la réserve, nos communautés », aborde l’héritage, le mode de vie, ainsi que la réalité aujourd’hui à laquelle sont confrontés les Premières Nations. La deuxième section, « Nos racines », évoque la diversité culturelle autochtone, ainsi que la traversée effectuée au Nord de l’Amérique il y’a 12 500 ans.
Quant à la troisième section, « La grande tourmente », elle traite du choc des civilisations dû à 400 ans de colonisation, empreints de changements et de résistances. La quatrième section, « La décolonisation - La guérison », étudie les revendications culturelles et politiques qui ont été menées, en vue d’aboutir à une reconnaissance, et à un rétablissement des faits historiques. Enfin, pour ce qui est de la cinquième section : « De quoi rêve-t-on pour l’avenir ? », cette dernière fait état des ambitions et des craintes actuelles ressenties par ces communautés autochtones.
C’est notre histoire, Premières Nations et Inuit du XXIème siècle © Jean-François Vachon, la Boîte Rouge Vif
L’intérêt de ces deux expositions réside dans le choix des œuvres, qui dans les deux cas, mettent parfaitement en lumière les traditions ancestrales, ainsi que la fierté de ces peuples, qui n’ont jamais cessé de revendiquer leur existence. La documentation y possède également un rôle primordial, avec des outils en libre-accès pour le visiteur, qui complètent de manière juste les informations dont il dispose au sein de ces deux parcours.
Les deux parcours certes, portent sur deux thématiques différentes, mais véhiculent un message revendicateur commun, à savoir : comment réparer les préjudices injustement subies par ces deux civilisations, et de ce fait, transmettre aux futures générations pour ne pas oublier les erreurs commises ? Le visiteur ne peut qu’être touché par la richesse de la création artistique aborigène, par la culture, et le mode de vie hérité de traditions ancestrales chez les Premières Nations, ainsi que les Inuits. Ce qui le conduit à réfléchir à sa propre place au sein de la société actuelle.
Joanna Labussière
#Civilisations
#Héritage
#Traditions
#Québec
Pour plus d’informations : https://www.mcq.org/fr/
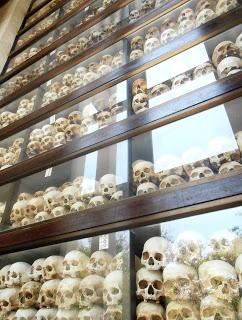
Tuol Sleng, le musée du crime génocidaire
Le lieu incontournable lors d’une visite de la capitale du Cambodge, Phnom Penh est le musée Tuol Sleng. Ce musée, unique, est chargé d’histoire, de souffrance et les visiteurs en ressortent bouleversés.
Une école transformée en prison avant de devenir un musée
Le musée Tuol Sleng a avant tout été le lycée, Tuol Svay Prey, de la ville de Phnom Penh. C’est seulement avec le début de l’époque du « Kampuchéa démocratique », et en particulier la prise de la ville par les khmers rouges en 1975, que le lycée fut transformé en prison par Pol Pot. Plusieurs dispositions furent apportées sur le site, tel que l’ajout d’une clôture électrique mais aussi de légères modifications des bâtiments. La prison fut connue sous le nom de S-21 ou Tuol Sleng.
Sous ce régime chacun risquait de se faire emprisonner. Il suffisait qu’une personne, cambodgienne ou étrangère, ressemble trop à un intellectuel pour qu’elle soit incarcérée avec toute sa famille à Tuol Sleng. Dans certains cas, porter une paire de lunettes était suffisant pour être considéré comme trop cérébral. Les têtes pensantes contre ce régime étaient bien sûr la cible première.
Une fois prisonnières, ces personnes furent photographiées, puis enfermées dans les pires conditions. Les gardiens les torturaient afin de leurs arracher des faux aveux, tel que leur appartenance à la CIA ou à d’autres organisations qui ne suivaient pas les idéologies du Cambodge démocratique. En moyenne une personne était emprisonnée pendant trois mois si elle survivait aux tortures.
C’est en 1979, lors de l’invasion du Cambodge par les armées vietnamiennes que le régime des Khmer Rouges fut interrompu. De tous les prisonniers de Tuol Sleng assassinés lors de l’invasion, seuls sept survécurent.
A peine un an plus tard, en 1980, le site de la prison de Tuol Sleng fut transformé en musée grâce à toutes les archives et photographies qui y ont été retrouvées.

Tuol Sleng © MV
Ce musée possède une atmosphère particulière due à son environnement et à son histoire. En effet, pratiquement aucune construction mise en place par les khmers rouges n’a été modifiée pour le musée, la scénographie est donc d’autant plus impressionnante de par sa simplicité et son atmosphère sombre.
Lorsque le visiteur découvre la prison, il voit en premier des petits monuments commémoratifs en mémoire des dernières personnes décédées entre ces murs. Il découvre aussi un panneau sur lequel sont décrites les règles que devaient suivre les prisonniers. Cette introduction plonge directement le visiteur dans l’atmosphère lourde et douloureuse du lieu.
Sur ce site le visiteur parcourt trois types de salles. Les premières, les petites individuelles très sombres, dans lesquelles le visiteur découvre tout simplement un lit métallique auquel était enchainé le prisonnier. Les secondes sont les anciens bureaux des khmers rouges, dans lesquels sont exposés une grande partie des photographies des anciens détenus, tout comme les habits qu’ils portaient à ces moments. Le visiteur peut même y admirer les tableaux du prisonnier peintre Vann Nath, lequel a pu survivre à son emprisonnement précisément grâce à ces tableaux qu’il était obligé de peindre pour les khmers rouges. Enfin, les grandes salles d’emprisonnement y étaient soit pratiquement vides, soit remplies de petits enclos qui séparaient légèrement les prisonniers. Aujourd’hui ces salles ont toujours cette même structure et donnent l’impression de se retrouver lors de cette époque lorsque le visiteur s’y promène.
Le but du musée est bien de dénoncer les crimes génocidaires accomplis par les khmers rouges, mais très peu d’affiches informatives ou de cartels figurent dans ce lieu. Par contre, des audio guides peuvent être empruntés, lesquels apportent toutes les informations sur la prison et l’histoire du Cambodge. Il est même possible d’écouter les témoignages des quelques survivants.
Choeung Ek : Le camp d’exécution
Suite à la visite du musée, le visiteur peut se rendre au camp d’exécution, aussi connu sous le nom de « Killing Field », lequel se trouve à quelques kilomètres en dehors de la ville. Les prisonniers ayant survécu aux tortures y étaient emmenés pour être tués.
Malgré un soleil éblouissant, les visiteurs y découvrent un lieu sinistre et douloureux. Dès l’entrée ils aperçoivent différentes fosses, dans lesquels des centaines de corps sont enterrés. Elles étaient dédiées aux différentes catégories de prisonniers. Certaines étaient par exemple attribuées aux femmes.
La sobriété est de mise : deux arbres ont une force symbolique : Le « killing tree » (= l’arbre tueur) permettait de tuer les enfants. Le « magic tree » (=l’arbre magique) permettait aux prisonniers de ne pas entendre les cris des mourants, grâce à des haut-parleurs accrochés dans les branches de l’arbre.

Le Killing Tree © SP
Un lieu de mémoire ou une attraction ?
Vous l’aurez compris, Tuol Sleng est un musée bouleversant, qui témoigne de l’histoire et de la souffrance qu’ont vécu des milliers de personnes lors de la période des khmers rouges au Cambodge. Conscients de l’histoire du lieu, nous ne saurions confondre ce lieu de mémoire avec une « attraction ». Malheureusement ce n’est pas le cas de tous. En effet, si vous cherchez sur les sites de conseils touristiques, tel que tripadvisor, les lieux culturels à découvrir à Phnom Penh, le musée et le camp d’exécution sont décrits en tant qu’attractions principales à expérimenter lors d’un voyage en plus des danses traditionnelles, de spas, et même des parcours en quad. A cause de cela, certains touristes peuvent imaginer participer à une « attraction » hors du commun, pour revivre plus ou moins le même parcours que les anciens prisonniers, de l’arrivée à l’exécution.
Nonobstant, ce n’est pas le cas pour la majorité des visiteurs qui comprennent que Tuol Sleng a été transformé en musée afin de dénoncer les crimes génocidaires. Ce lieu de mémoire est destiné dans un premier temps aux Cambodgiens, raison pour laquelle ils bénéficient de la gratuité sur ce site. Pour les touristes, ce lieu de mémoire permet principalement d’apprendre l’histoire du Cambodge et de découvrir les crimes qui ont eu lieu dans ce pays. C’est pour cette raison que les visiteurs peuvent rencontrer sur le site l’un des derniers survivants. Un Cambodgien, vient régulièrement sur le site, malgré les mauvais souvenirs qui le lient à ce lieu, afin de témoigner de tout ce qu’il a vécu. Il se présente aux Cambodgiens mais aussi aux touristes, malgré la barrière de la langue. La force du témoignage fait que cette ancienne prison est sans nul doute un lieu qu’on ne saurait confondre avec des attractions touristiques. C’est du moins ce que ce lieu et son témoin nous font ressentir.
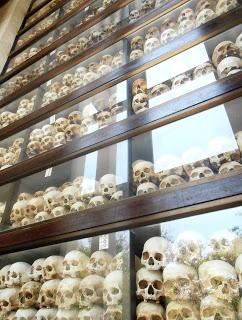
Stupa rempli des ossements des prisonniers décédés © SP
Sarah Pfefferle
#TuolSleng
#Cambodge
#Crime génocidaire
Lien internet :
Photographies des prisonniers
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

Un après-midi dans le Musée de Normandie.
Le musée de Normandie est situé en centre-ville, dans le château de Caen, ce qui constitue déjà une raison d’y aller tant le cadre est agréable. A l’intérieur se situe le Musée des Beaux-Arts et en face, le musée que je vais vous présenter. Le musée évoque plusieurs aspects de la culture normande et croise plusieurs domaines des sciences humaines : ethnographie, archéologie, histoire géographie.

© NP
La scénographie est sobre, mettanten valeur les objets et le parcours vous donne une certaine dose d’informations, sans pour autant vous noyer sous le contenu.
Exposer la culture à travers le patrimoine immatériel
Comment transmettre la culture ? Les musées sont très attachés à (voire même dans certains cas, dépendants de) l’objet de collection. Le musée de Normandie expose aussi ce qui constitue des éléments de patrimoine immatériel, comme des savoir-faire, ou des chants. L’audiovisuel se substitue ainsi à l’objet d’exposition pour présenter le savoir-faire en dentellerie, aussi bien que pour recréer un lien humain dans le musée, entre un agriculteur normand parlant de son métier et le visiteur (plutôt que passer par le discours du concepteur via le cartel d’exposition).
 © NP
© NP
Enfin, à plusieurs endroits du musée, on retrouve ce type de bornes sonores, accompagnées de casques. On peut y écouter des chants traditionnels, des chants populaires liés aux thèmes des salles d’exposition. Certaines chansons sont diffusées en haut-parleur dans les salles, ce qui recrée une ambiance sonore dans le musée. Donner une place « importante » à la musique dans un musée m’a plu, étant donné que les chants et danses font aussi partie de la culture mais ne sont pas aussi facilement exposables. Ici, une solution est proposée pour la musique, et cela enrichit notre découverte de la culture normande.
Les derniers espaces du musée sont dédiés à la notion de folklore et à l’image mythifiée de la Normandie, et la dernière salle présente des expositions liées à l’actualité du musée, comme ses récentes acquisitions. Cette dernière partie permet de tenir le visiteur au courant de la vie du musée, mais aussi d’informer des fonctions du musée auxquelles il n’a pas forcément accès, les acquisitions étant souvent un aspect tenu éloigné des yeux du public.
Et pour les familles ?
Le musée a conçu une application sous forme d’enquête, avec des indices disséminés dans le musée, utilisant les technologies NFC et QR code. L’application propose des jeux intéressants et relativement simples pour les enfants : puzzle, jeu des 7 différences, quizz… De plus, l’utilisation du QR code et du NFC permet de passer au-dessus d’une partie des obstacles technologique. Pour les autres, le musée a édité trois carnets de visite pour enfants, présentant le même genre de jeu.
En conclusion, n’hésitez pas à risquer de vous y aventurer par beau (et mauvais) temps !
NP
Pour plus d’informations, visitez le site : http://www.musee-de-normandie.caen.fr
#musée
#normandie
#ethnographie
[1] Lafonderie de Villedieu a entre autres, été à l’origine des cloches de Notre-Damede Paris.

Un mausolée pour Staline
En 2010, l’immense statue du petit père des peuples qui accueillait les visiteurs devant le musée a été déboulonnée par le gouvernement. Le musée, quant à lui, bâtisse blanche décorée comme un manoir bourgeois, demeure sur une grande place de la ville natale de Joseph Staline.
Hall d'entrée du musée - Photographie : E. Lelong
La visite
A l’entrée, tapis rouge et colonnade dirigent les yeux du visiteur vers une petite statue du dirigeant, trônant en haut de l’escalier. La visite guidée le conduit ensuite à travers des salles variées qui présentent la vie animée de cet homme avec une foule de témoignages. Bulletin de notes de classe primaire, habits, photos, cartes, maquettes mais aussi cadeaux officiels de l’époque où il était grand secrétaire du parti : autant de fétiches qui alimentent un culte de la personnalité.
Une salle se distingue toutefois par l’épuration de sa présentation : un cercle de colonnes blanches, tronquées pour ne pas gêner la vue, entoure le masque funéraire du Staline présenté sur un coussin rouge. Les murs eux–mêmes sont rouges. La traversée de cette salle se fait dans un silence quasi religieux.
Salle du masque funéraire - Photographie : E. Lelong
Il faut ensuite passer au jardin où l’on découvre la maison natale de Staline, occupée par son père artisan. Cette maison est préservée des outrages du temps par une structure néo-antique décorée de faucilles et de marteaux. La visite se termine par un passage dans le wagon du train qui transporta Staline dans toute l’Europe de l’Est.
Wagon du train de Staline - Photographie : E. Lelong
Enfin, une salle cachée sous l’escalier aborde l’emprisonnement de certains hommes et les souffrances de la guerre mais le guide nous explique bien « Cela n’a rien à voir avec l’exercice du pouvoir par Monsieur Staline ».
Pas un mot ?
Pas un mot et pas une image sur la propagande, encore moins sur l’existence du goulag et les souffrances des prisonniers. Sont aussi occultés les assassinats politiques et les autres crimes commis par le dictateur. Le musée va encore plus loin puisqu’il invente des pièces à conviction et donne, parfois à tort, à Staline un rôle prépondérant depuis sa jeunesse. La maquette d’une imprimerie clandestine par exemple le présente comme le chef de file d’un mouvement de journalistes contestataires alors qu’en réalité il ne s’est jamais rendu dans ce lieu !
Malgré de menus efforts (retirer la statue par exemple), Gori et sa population semblent s’accrocher à leur gloire passée. Le musée conserve en grande majorité sa présentation de 1957 qui, il faut le dire, dépeint de façon flagrante le culte de la personnalité instauré par le tyran ! - Même si le musée n’a été fini qu’après sa mort.
Cependant le reste de la Géorgie ne partage pas ce désir de glorification et refuse de maintenir le musée en l’état. Un débat fait donc rage parmi les professionnels des musées en Géorgie : que faut-il faire du musée de Gori ?
- Le raser et tout oublier
- Le raser et construire un musée dédié aux victimes de Staline
- Le conserver et construire un dispositif de « para-musée » qui pointe la dimension de propagande de la présentation, comble ses silences et rend hommage aux victimes
La dernière option, plus novatrice, me semble la plus sensée. Ce musée tel qu’il est, est une richesse historique à étudier. Il reste …
….à s’interroger sur la forme que devrait prendre ce« para-musée » : une visite guidée ? Un ensemble de cartels ? Un autre musée voisin ?
… et à faire accepter l’idée à la ville !
Églantine Lelong
#Géorgie
#Propagande
#Staline
Pour en savoir plus :

Un musée de l'Armée moderne et accessible
Situé dans le 7ème arrondissement de Paris, l’Hôtel des Invalides accueille depuis le XVIIème siècle les vétérans des guerres menées par la France mais pas seulement. Au sein de cet établissement, se trouve le musée de l’Armée que je suis allée découvrir.
Organisé autour de la cour d’honneur, cet équipement déploie, dans les ailes occidentales et orientales de la partie nord de l’édifice, des collections d’une grande richesse. Afin d'accueillir au mieux un public nombreux, il comprend une cafétéria, une librairie-boutique et des ascenseurs pour accéder aux nombreux étages.
Crédits : Emilie Etienne
Conscient de l’atout que représentent ses œuvres, l’institution s’est beaucoup investie à leur conservation et protection à travers une muséographie moderne axée sur l’éclairage.
Les vitrines sont équipées de LED ou d’ampoules à très faible luminosité créant ainsi une atmosphère exceptionnelle tout à fait fascinante dans certaines salles. Mais si la lumière peut être une force par moment, elle représente parfois une faiblesse. Pour limiter les dégradations des objets dues à son exposition, beaucoup de vitrines ne disposent pas de dispositif lumineux. Situés dans des endroits sombres, certains de ces objets deviennent alors invisibles ainsi que leurs cartels. Dans d’autres cas, la mauvaise orientation des lampes provoque des reflets et discerner les oeuvres devient un vrai casse-tête.La signalétique du parcours muséographique peut poser problème. Lors de ma visite, je me suis principalement laissée guider par certains objets phares et le sens de la visite est rapidement devenu incompréhensible.
Non initiée dans le domaine des armes et autres tactiques militaires, je me suis sentie à l'aise grâce aux différents outils de médiation, ludiques et instructifs, présents tout au long du parcours.Les premiers rencontrés sont les cartels qui offrent une information claire et complète. Ces derniers sont accompagnés de panneaux explicatifs, traduits en quatre langues, dont le seul reproche est qu'ils se situent en fin de chaque espace. Puis viennent des plans interactifs, films, vidéos, maquettes et audio-guides. Rendant la visite plus captivante, tous illustrent et enrichissent parfaitement le discours mis en avant.
Crédits : Emilie Etienne
D'un grand dynamisme, le musée propose régulièrement des colloques ainsi que des expositions temporaires dont la dernière présentée est : « Avec Armes et bagages dans un mouchoir de poche ».
De formation archéologique, je ne me serais jamais tournée instinctivement vers ce musée qui ne me semblait pas très attirant. Cependant, je suis sortie du musée de l'Armée sur une très bonne impression avec l'envie d'y revenir et de le faire découvrir. Cette structure vaut d'être visitée ne serait-ce que pour le modernisme dont il fait preuve envers ses collections et son public.
Émilie Etienne
Un muséographe révélé ?
Interview d’Olivier Romain Rouchier
Vélo © Olivier Romain Rouchier
Olivier Romain Rouchier est commissaire de l’exposition « Objets révélés » programmée au musée de la Chartreuse de Douai pour 2018, c’est un homme vif et chaleureux qui me parle avec passion, de sa nouvelle mission dont il se sent pleinement investi. Son parcours est atypique et ne le prédestinait pas à travailler un jour pour un musée. Cette opportunité s’est toutefois présentée à lui presque par hasard et il ne regrette pas du tout cette expérience, bien au contraire !
Quel a été ton parcours avant de devenir commissaire d’exposition au musée de la Chartreuse de Douai ?
Depuis tout petit j’ai la passion des vieux objets. Dès mes 12 ans je commençai à collectionner des objets que je trouvais dans des brocantes ou chez les antiquaires. Très tôt, et de façon autodidacte, je me suis documenté sur ces objets et j’ai acquis une connaissance assez pointue et spécifique sur ce sujet. A 23 ans je deviens antiquaire Nancy, métier que j’ai exercé jusqu’en 2007. J’ai vendu beaucoup de choses identiques à celles qui sont dans les réserves du musée !
A ce propos, comment en es-tu arrivé à travailler au sein du musée ?
C’est Anne Labourdette, la conservatrice, qui m'a contacté. Elle avait besoin d’une expertise pour certains objets (des boucles de chaussure du 18eme siècle). J’ai commencé à travailler comme consultant bénévole en 2015, mon rôle a été de décrire et d'identifier certainsobjets et aussi de corriger des descriptions anciennes erronées.
Identifier un objet, le retrouver àl’inventaire, retrouver son histoire, le comprendre, c'est pour moi une sortede sauvetage et donc une grande joie. Cette première expérience fut un émerveillement.
Vous avez fait des trouvailles excitantes ou bien était-ce du simple étiquetage ?
C’était une chasse au trésor ! Je suis tombé sur des objets dont je ne soupçonnais même pas l’existence comme un objet en fer et en laiton du XIXe siècle qui servait à mesurer les sabots des chevaux. Chasse au trésor mais aussi un voyage puisque nous avons trouvé, parfois au fond d’une grosse caisse ou incognito à proximité de plusieurs objets banals, des objets rares et exotiques. J’ai par exemple reconnu une amulette égyptienne rescapée de l’ancienne collection d’ethnologie du musée perdue pendant les conflits historiques. Celle dont je suis le plus fier reste quand même cet éperon à molette du XIVe qui (après des recherches) s’avérait apparaître dans l’inventaire de 1807 qui le rangeait déjà dans les antiquités de l’Antiquité et du Moyen-âge ! C’est un objet rare. Il faut dire qu’Anne Labourdette est très active pour impulser une recherche d’œuvres disparues en région.
Mais comment a germé l’idée de concevoir une exposition autour de tous ces trésors ?

Sac à tête © Olivier Romain Rouchier
L’exposition semble surtout reposer sur le sensationnalisme, as-tu pensé en amont à un concept muséographique ?
Bien-sûr, j’ai décidé de regrouper les objets autour de thèmes universels et intemporels comme « Naître et mourir », « La Violence », « l’Amour », « l’Exotisme et le Voyage »... Mon but est de parler au plus grand monde. J’assume le parti-pris de jouer avant tout sur l’émotion du visiteur. C’est selon moi le meilleur moyen de relier ce dernier avec ses vieux objets dans leur cœur et dans le temps. Je ne veux pas qu’on reste indifférent à ce que nous allons exposer. En même temps que je dessinais le parcours de visite, je me suis documenté sur les objets sélectionnés ce qui va me permettre de les décrire, de rédiger les cartels, les textes de salle et le catalogue de l’exposition. Je vais à l’essentiel dans un souci de vulgarisation scientifique. Mon exposition sera libre : pas de parcours de visite, seulement des petits îlots à thème autour desquels les visiteurs pourront naviguer à leur guise.
Un véritable travail de muséographe en somme, et la scénographie c’est toi qui t’en occupes ?
 Jusqu’ici pour la muséographie j’ai travaillé seul et j’ai des idées pour la scénographie. Cependant je ne pense pas que j’endosserai un rôle de scénographe en plus de celui de muséographe. Ce sera un travail collectif dans lequel je pense tout de même avoir mon mot à dire. Je n’abandonne pas mon projet une fois que je l’ai écrit, je serai là pour sa mise en place, sachant que des réajustements au niveau du contenu auront peut-être lieu face à certains problèmes que l’équipe scénographique auront pointé. Je souhaite par exemple, à la fin du parcours de visite, organiser un couloir ( ré)créatif de médiation innovante. Je veux que le public soit intéressé, qu’il réagisse à ce qu’il voit.
Jusqu’ici pour la muséographie j’ai travaillé seul et j’ai des idées pour la scénographie. Cependant je ne pense pas que j’endosserai un rôle de scénographe en plus de celui de muséographe. Ce sera un travail collectif dans lequel je pense tout de même avoir mon mot à dire. Je n’abandonne pas mon projet une fois que je l’ai écrit, je serai là pour sa mise en place, sachant que des réajustements au niveau du contenu auront peut-être lieu face à certains problèmes que l’équipe scénographique auront pointé. Je souhaite par exemple, à la fin du parcours de visite, organiser un couloir ( ré)créatif de médiation innovante. Je veux que le public soit intéressé, qu’il réagisse à ce qu’il voit.
Podomètre © Olivier Romain Rouchier
Quel regard portes-tu sur les musées aujourd’hui ?
Souvent dans les musées et les expositions, les cartels sont illisibles ou incompréhensibles, et on peut rarement s'asseoir ! Il n'y a pas assez de jeunes dans les musées d'art ancien, trop de gens se disent " le musée ce n'est pas pour nous, c'est ennuyeux ". Il faut aller à leur devant et renouveler et régénérer le public des musées. Notre exposition est destinée à tous bien sûr, mais j'espère qu'elle attirera les jeunes. Ce serait pour moi un beau compliment qu'un adolescent me dise qu'il ne pensait qu'un musée pouvait être aussi "cool". Donc l’exposition seraludique, libre et pour tous ?
Exactement ! Je rajoute qu’elle sera confortable, il y aura des sièges ! Ce sera une exposition sérieuse qui ne se prendra pas au sérieux.
Etla cohabitation avec des muséographes « du cru », un choc des cultures ?
En réalité j’ai été très étonné par l’accueil et la confiance dont les collègues du musée ont fait preuve. Ils ont fait l’école du Louvre, moi je n’ai aucun bagage muséographique, juste mes connaissances de spécialiste autodidacte. Pourtant, on m’a adopté immédiatementet on a porté une grande attention à mes avis. C’était très confortable comme situation. On m’a même demandé d’organiser une visite des réserves au conseil municipal, c’est là que j’ai remarqué que j’arrivais à intéresser les gens même aux trucs moches et détériorés.
Amaury Vanet
#Objets
#Antiquités
#Réserves
Pour en savoir plus : http://www.
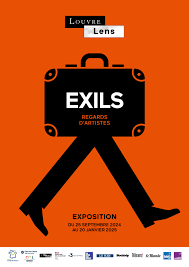
Un projet de conception partagée intégré à l’exposition EXILS-Regards d’artistes
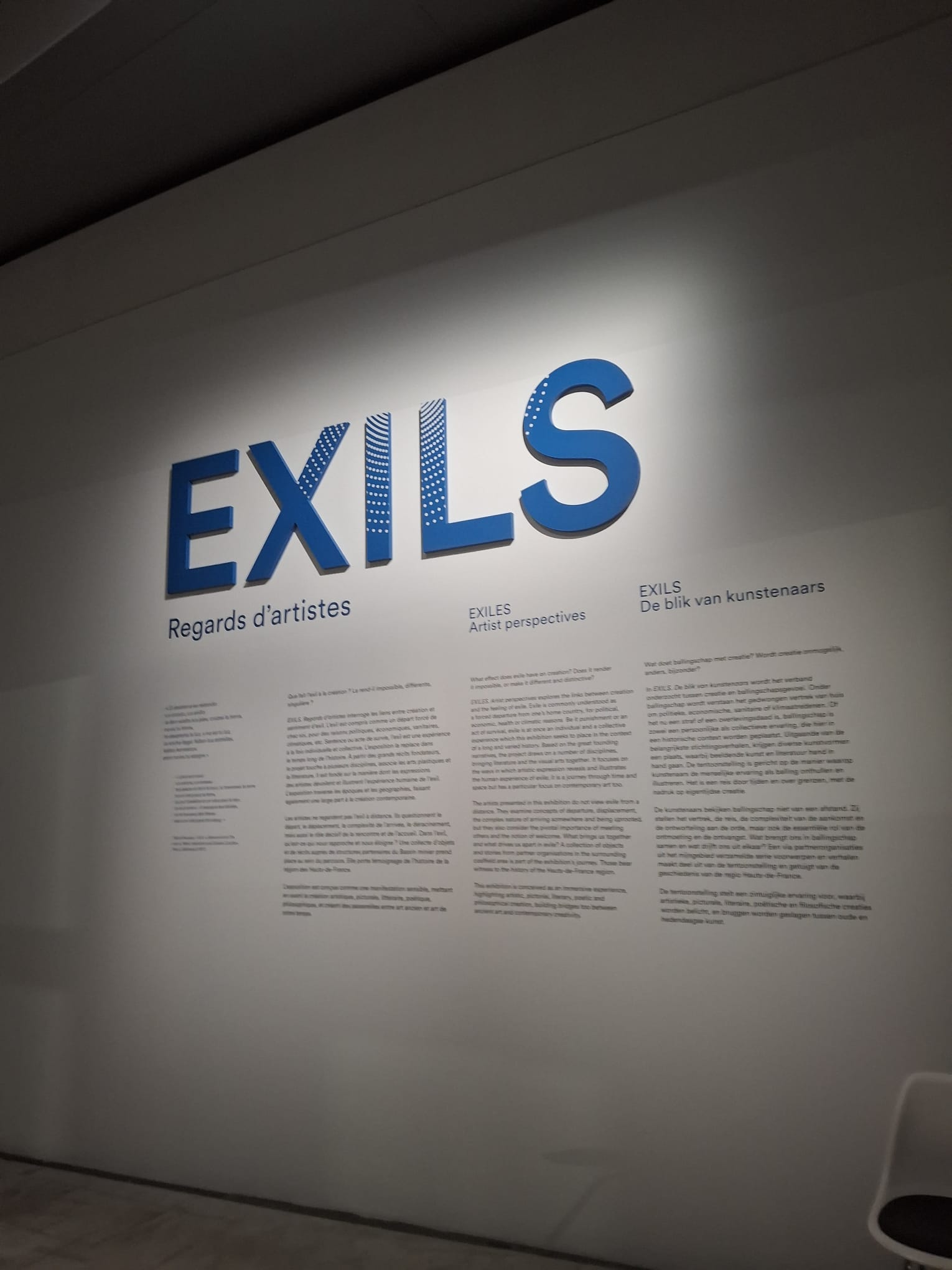
Musée du Louvre-Lens, ©Pauline Mabrut
En position centrale au musée du Louvre-Lens se trouve le public, présent dès la conception d’une exposition. Annabelle Ténèze, directrice du musée, et Dominique de Font-Réaulx, commissaire de l’exposition, ont pensé pour une section de l’exposition Exils, Regards d’artistes un projet participatif et inclusif, mené avec le concours de plusieurs structures partenaires.
Musée du Louvre-Lens, ©Pauline Mabrut
Six associations oeuvrant pour les populations du territoire ont travaillé sur le projet :
- l’APSA-CADA, Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (Liévin)
- l’association Femmes en avant (Liévin)
- le Centre socioculturel Alexandre Dumas (Lens)
- le Centre socioculturel François Vachala (Lens)
- l’association La Cimade (Lens)
- le SAVI, Service d’Accompagnement vers l’Intégration pour les mineurs immigrés (Béthune)
Avec eux, dix étudiants répartis en trois groupes de trois ou quatre, issus des divers parcours du Master 2 de l’École du Louvre.
Une exposition - porte d’entrée d’un dialogue entre art et territoire
L’exposition a trouvé terre d’asile à Lens, où elle a toute sa place. Le musée est ancré dans le bassin minier dont le développement a été rythmé par plusieurs vagues de migrations. De nombreux habitants du territoire, en quête d’un travail, ont vécu l’exil ou sont enfants ou petits-enfants d’immigrants. Aujourd’hui encore, le Pas-de-Calais vit au quotidien la présence et le passage de migrants qui tentent une traversée périlleuse vers le Royaume-Uni sur des canots de fortune.
Une partie de l’exposition a été construite en lien avec treize habitants du territoire lensois à qui fut proposé d’embarquer pour une aventure profondément humaine et à l’image de l’exposition. Port de départ : la présentation du projet par les associations aux potentiels témoins. Les structures partenaires ont retenu ceux dont le récit et les traces d’exils étaient les plus représentatifs et en phase avec l’exposition. Puis ont eu lieu les rencontres entre étudiants et habitants, suivies d’une longue traversée commune : une année riche d’écoute, d’échanges et de partages d’expériences.
Une collecte d’objets
Les habitants « témoins », présélectionnés par les associations, ont été invités à confier au musée le temps de l’exposition un ou des objets qui pour eux symbolise(nt) l’exil. Le Louvre Lens est Musée de France, mais sans collection permanente : pour l’exposition Exils, la notion de prêt, plutôt que de dons comme au Musée National de l’Histoire de l’Immigration, a tout de suite instauré la confiance et rassuré les témoins. Les habitants ont eu tendance à proposer de beaux objets (comme les assiettes de Marguerite de Hongrie) car l’espace du musée leur est d’emblée assimilé au prestige. Cette réaction questionne les codes du musée car elle s’oppose au principe d’Exils : ici ce sont des objets de sens et de mémoire familiale qui ont été prêtés. Ils sont des récepteurs et des traces de l'histoire d’exilés sur trois générations et sont traités au même titre que des œuvres d’art : leur état est étudié avant et après l’exposition et leur manipulation est délicate et professionnelle.
Précieux ou quotidiens, ces objets ont été emportés avec soi, rachetés en France ou encore offerts. Certains sont directement rattachés à Lens comme le collier de cheval (de la mine ou des maillots de football, ce qui permet aux habitants de la ville de s’y identifier. Ils rappellent aussi qu’au plus fort de son activité, le bassin minier rassemblait trente-deux nationalités.

Collier de Flageolet, cheval de fond de l’arrière-grand-père
Collier de cheval en bois, cuir et métal, Flandre-Occidentale, Belgique, 1850-1950
Musée du Louvre Lens © Pauline Mabrut
« Cet objet, je pense que je l’ai prêté pour que le regard des autres sur les personnes qui sont étrangères soit différent. Qu’ils se disent : “Après tout, cet objet, il est là, il a vécu presque toute sa vie dans nos mines, sur Lens, mais il représente autre chose.” […] Et les questions qu’ils vont se poser derrière : “Pourquoi est-il arrivé là ? Pourquoi il est comme ça ? Qu’est-ce qu’il peut nous raconter ? Et nous, dans notre propre histoire ?” Jocelyne D., Cimade, Lens
Un recueil de témoignages
Des paroles ont aussi été recueillies et Exils en mesure la charge émotionnelle. L’objet est pour certains prêteurs la cristallisation d’un récit qu’ils partagent.
L’escale suivante a été l’étude et l’analyse des échanges : les étudiants ont proposé les objets et les séquences audios collectés au commissariat de l’exposition. Ils ont décidé, ensemble, des objets qu’ils souhaitaient exposer (et qui pouvaient l’être). La sélection de 17 objets n’en a finalement laissé que peu de côté, il s’agissait surtout de choisir parmi plusieurs objets proposés par un même témoin.
La rédaction des commentaires, pour les cartels par exemple, a été faite par les étudiants et en lien avec les associations partenaires. Ils ont été validés après relecture par toutes les parties concernées.
« Le souvenir des calebasses, pour moi, c’est tous les jours en fait. Et encore ça me suit, parce que, malgré que je sois en France, elles sont avec moi. Pour moi, c’est un beau souvenir. C’est comme si j’étais toute avec ma famille ici et tout ce que j’avais fait toute petite. Mon souvenir, il me suit. C’est pas grand-chose, mais, pour nous, c’est grand-chose ». Mariam (Maya) D., Femmes en avant, Liévin
Assiettes de Marguerite
Hongrie, vers 1930-1940, céramique
© Musée du Louvre-Lens
« Le but, ce n’est pas de parler de l’assiette. L’assiette, c’est le moyen – c’est le médium, j’allais dire – d’arriver, d’accéder à la mémoire ». Famille Tillman-Farkas, Deboudt – Éric D., Lens-Salome
Une scénographie ouverte
La scénographie ouverte affiche une volonté de ne pas établir de différences entre chefs-d’œuvre historiques, œuvres d’artistes contemporains, et objets de la collecte. L’emplacement de cette dernière avait déjà été plus ou moins défini puisque la commissaire l’avait pensé dès le début du projet comme une partie intégrante de l’exposition. Le mobilier est bien intégré, c’est pourquoi les étudiants sont peu intervenus sur cet aspect même s’ils ont pu participer à plusieurs rendez-vous avec le scénographe Maciej Fiszer. Ils ont présenté la liste des objets retenus et des propositions scénographiques pour leur intégration dans le parcours de l’exposition. C’est un travail qui a permis d’opter pour des bornes d’écoute permettant de découvrir les témoignages audio, de décider des mises à distance, des mises sous vitrine, du choix de la couleur de la section, de la disposition des objets entre eux...
Deux étudiantes ont pris part à l’installation intégrale des œuvres au moment du montage de l’exposition. Pour l’installation plus précisément de la collecte, elles ont été rejointes par ceux qui avaient pu faire le déplacement. Tous ont travaillé ensemble aux côtés de la directrice du Louvre-Lens et de la commissaire de l’exposition.
Cette section de l’exposition montre, en se penchant sur les traces de l’exil, que c’est un vécu toujours actuel. Elle interroge la manière de vivre au quotidien une nouvelle vie, dans un autre territoire. Sa conception partagée rejoint le propos même de l’exposition. Exils, avec un « s », parle de tous les exils dans leur diversité et sous toutes leurs formes qu’ils soient contraints, volontaires ou imaginaires. Elle aborde les multiples motivations qui peuvent pousser à quitter une terre natale. Cette partie traite aussi de diversité, de rencontres, d’écoute et d’échanges. Les récits personnels, comme il en va de tous les exils, se rattachent à une histoire commune. Une dimension historique et universelle se dégage donc de cette section particulière pour rejoindre celle de l’ensemble de l’exposition.
Pauline Mabrut
Merci
Je remercie les étudiants qui ont pris part à ce projet d’avoir accepté de partager leur expérience.
Pour aller plus loin :
- Le Dossier de Presse de l’exposition
https://www.ecoledulouvre.fr/sites/default/files/media/document/Dossier%20de%20presse_Exils_FR_BD%20planche%20%281%29.pdf - Le Dossier Pédagogique
https://www.louvrelens.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dossier-pedagogique_Exils_2_page_BD.pdf - Une présentation vidéo,
par la commissaire de l'exposition, Dominique de Font-Réaulx
https://youtu.be/FLAN8vQ9Ex8?si=CptMQuaR00ZfETxc - Une présentation vidéo, par la directrice du Louvre-Lens, Annabelle Ténèze
https://www.bfmtv.com/grand-lille/replay-emissions/bonsoir-lille/exils-une-nouvelle-exposition-temporaire-au-louvre-lens_VN-202409240740.html
AUTRES EXPOSITIONS EN LIEN AVEC LA THÉMATIQUE
- Biennale de Lyon : Les voies des fleuves – Crossing the water
En cours, 21.09.2024 au 05.01.2025
La Biennale d'art contemporain de Lyon, manifestation créée en 1991, a un ancrage local, basé sur le dialogue et l'échange avec les populations.
« Avec La voix des fleuves - Crossing the water, les artistes sont invités à aller à la rencontre des populations et de savoirs-faire qui deviennent autant de sources d’inspiration, d’expérimentation que d’occasions de co-création » (Dossier de Presse)
https://fisheyeimmersive.com/evenement/biennale-de-lyon-les-voix-des-fleuves-crossing-the-water/ - Exposition installation Monte di Pietà
Terminée (du 29 juin au 21 juillet 2024)
Le Festival d'Avignon, fondé en 1947, est une manifestation du spectacle vivant contemporain.
"Fruit d’une collaboration entre Lorraine de Sagazan et Anouk Maugein,l'installation Monte di Pietà met à nu l’injustice, et la douleur qu’elle provoque. La metteuse en scène et la scénographe ont pour l’occasion collecté quelque deux-cents objets : ces objets sont liés au souvenir traumatique de violences ou de crimes, mais leurs propriétaires n’ont pourtant pu se résoudre à les jeter. Étiquetés et consignés, ces objets s’accumulent dans l’espace pour ériger un sanctuaire de chagrin." - Archives du Festival
https://festival-avignon.com/fr/edition-2024/programmation/monte-di-pieta-348720
#LouvreLens #Exils #Collecte

Une cabine téléphonique au Musée comtois
Nombreux sont les musées de société français qui se sont tournés vers la collecte d’objets et de témoignages contemporains. Même si cette collecte prend des formes différentes d’une institution à une autre, elle reste guidée par la même démarche : c’est avant tout la volonté de conserver des témoignages de notre société actuelle et de les inscrire dans l’histoire d’un territoire.
Les musées de société se doivent aujourd’hui d’intégrer à leurs préoccupations l’émergence d’une trace moderne de la culture et pour cela, ils doivent traiter des mutations, des ruptures et des permanences de notre société. Leur refonte est essentielle, à la fois dans le discours, qui doit être plus proche du contexte politique, social et culturel, mais aussi dans l’enrichissement des collections.
Photo de la cabine téléphonique © Musée comtois
Le Musée comtois, situé au sein de la Citadelle Vauban de Besançon, souhaite réaliser cette transition. Aujourd’hui, les équipes ont la volonté de transformer ce musée figé dans le passé en un véritable musée de société, et donc de proposer entre autres une nouvelle politique d’enrichissement des collections, qui prendrait en compte l’objet contemporain.
Le Musée comtois peut être qualifié de musée classique d’Arts et Traditions Populaires, axé quasi-exclusivement sur la société franc-comtoise traditionnelle du XIXe/XXe siècle et tourné vers le milieu rural et agraire. L’exposition permanente est aujourd’hui obsolète (certaines salles d’exposition n’ont pas été renouvelées depuis près de 50 ans !). Il n’y a pas eu non plus d’acquisitions d’objets contemporains, mis à part des donations de marionnettes.
Affiche d’exposition © Musée Comtois
Dans ce contexte et alors que le nouveau Projet Scientifique et Culturel était encore en cours d’écriture, l’équipe du Musée comtois a réalisé l’exposition « Le Truc d’Avant » en 2016. Cette exposition a permis d’observer les visiteurs et de voir quelles étaient leurs réactions face à l’exposition des objets qui ont marqué des générations entières mais qui ne sont pas communs dans les musées. La patrimonialisation de l’objet était au cœur des problématiques soulevées par l’exposition : quel objet choisir pour illustrer un mode de vie ? Un objet vu, usé, partagé, oublié, remplacé… ? Un « truc » qui aurait provoqué la ferveur populaire, devenu futile, insignifiant ? Comment un objet peut-il modifier nos pratiques sociales ? En quoi sont-ils les témoins de notre présent pour les générations à venir ? Tant de questions qui font de la collecte contemporaine dans les musées de société une entreprise vaste et complexe.
Un dispositif participatif avait été installé dans cette exposition, où les visiteurs étaient invités à « voter » pour un objet qu’ils jugeaient assez pertinent pour rentrer dans les collections du musée.
Photos de quelques objets exposés dans « Le Truc d’avant » (Musée comtois). De gauche à droite : console de jeu Game and Watch (années 1980), sélection disques vinyles, K-Way banane (entre 1965 et 1990), 2CV Citroën (1983).
Cette exposition a préfigurée en quelque sorte le projet d’écriture du PSC et de la politique d’acquisition des collections. Le « Truc d’Avant » a aussi permis d’inventorier la cabine téléphonique qui était exposée. Cet objet, plébiscité par le public grâce au dispositif participatif, a marqué l’espace public, qu’il soit urbain ou rural. La disparition des cabines est inéluctable, puisque leur démantèlement a commencé en 2015 sur l’ensemble du territoire national.
La cabine téléphonique © Musée comtois, don de la société Orange
La cabine, exposée devant l’entrée du musée, accompagnée d’un cartel, n’est pas toujours repérée comme étant un objet de collection. Mais quand c’est le cas, les réactions sont généralement très positives de la part des visiteurs qui comprennent l’intérêt de conserver et exposer ce type d’objets, témoins récents de mutations sociétales.
L’acquisition de cette cabine est, semble-t-il, une toute petite étape de franchie pour le Musée comtois, qui réfléchit encore aux critères de sélection et à la manière de collecter des objets et les témoignages actuels afin de prendre en compte les réalités multiples de notre société et de notre territoire. Dans un premier temps, le musée pourra se baser sur les champs thématiques que la future exposition permanente présentera, comme les migrations, les luttes sociales, la condition des femmes, les mutations urbaines depuis les années 1950 en Franche-Comté.
Claire Linder
#Muséecomtois
#ethnographie
#collectecontemporaine
Lien vers le site de la Citadelle de Besançon : http://www.citadelle.com/fr/accueil.html

Une exposition sans dessus mais avec des dessous
Une exposition culottée au Musée dauphinois de Grenoble ? Vous ne croyez pas si bien dire ! Les dessous de l’Isère – une histoire de la lingerie féminine présente, depuis le début dumois de mars, l’histoire des dessous des Iséroises. Cette exposition raconte l’épopée de l’industrie des sous-vêtements féminins et retrace leur évolution selon les époques et les mœurs.
Vue de l'exposition - Crédits : Musée dauphinois.
Au fil des sous-vêtements, l’histoire de la lingerie féminine
L’exposition permet la découverte de l’histoire industrielle de la lingerie féminine en Isère de son apogée jusqu’à son déclin provoqué par la mondialisation. Confectionnés à la main durant tout le XIXème siècle par lesfemmes, les sous-vêtements ont subi l’ère de la consommation de masse. Les acheteuses se procurent alors leurs dessous dans des boutiques de prêt-à-porter produits dans des usines. Les différentes pièces exposées montrent à quel point les matériaux et les textures ont rapidement changé, suivant les innovations techniques. J’ignorais qu’au cours du XXème siècle, de nombreuses industries textiles se sont implantées dans le département pour confectionner culottes et autres bas parmi lesquelles les très célèbres marques Lou, Valisère ou encore Playtex.
Lors de la fermeture de l’usine Playtex en 2010 -Collec. Particulière - Crédits : Astrid M.
L’Isère était un territoire renommé et reconnu pour le savoir-faire de sesouvrières. Les années 2000 ont sonné le glas de cette industrie frappée par une vague de fermetures d’établissements causée par une concurrence accrue desmarchés internationaux. L’exposition évoque des thématiques difficiles commeles licenciements et la colère des petites-mains qui ont vêtu la nudité.
« La lingerie est une histoire culturelle à fleur de peau » (Chantal Thomas)
L’évolution des sous-vêtements est liée aux évolutions sociétales : voilà ce que j’ai appris de l’exposition Les Dessous de l’Isère. D’abord utilitaire et très couvrante, la toilette féminine du XIXème se transforme en accessoire de mode avec l’avènement du corset qui sculpta en forme de S le corps de la femme pendant de nombreuses années. Véritable instrument de torture, les femmes ont fini par l’abandonner au profit de dessous beaucoup moins contraignants comme la gaine, le soutien-gorge puis la culotte. L’émancipation de la femme, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, s’accompagne d’une transformation de sa lingerie qui devient alors plus libre, moins couvrante et plus en adéquation avec son corps. J’ai beaucoup apprécié le fait que de nombreux aspects sociologiques soient abordés en parallèle du discours sur la lingerie. La réappropriation du corps des femmes est par exemple évoquée en parlant de la contraception. La lingerie donne àvoir l’évolution de la place de la femme dans la société mais aussi du regard porté sur elle.
Accompagnant la vente des sous-vêtements, la publicité propose une image de la femme fantasmée. Pensons au slogan de la marque Wonderbra « Regardez moi dans les yeux… j’ai dis dans les yeux ». Séduisante, glamour ou sexy, la femme est présentée comme un objet de désir souvent façonné par le regard des hommes. Le corps de la femme est complètement érotisé.
Les portraits culottés de C. Prigent - Crédits : Chloé Prigent, 2012.
Cette image ne correspond pas à la réalité et les travaux de l’artiste Chloé Prigent, présentés à la fin de l’exposition font écho, avec beaucoup d’humour, à l’univers absurde de la pub’. L’artiste dresse le portrait intime de femmes montrant leurs sous-vêtements. Le cadrage serré des photographies ne montre pas les visages de ces femmes, seulement leurs culottes.Les corps sont montrés sans retouches, avec les petits défauts qui en font leur beauté.
J’ai regretté qu’il n’y ait pas d’outils de médiation permettant aux visiteurs de laisser son avis car, en tant que femme, cette exposition m’a fait réagir. Le dispositif « La lingerie et vous ? » propose au sein d’une reconstitution d’un boudoir bien trop « girly » à mon goût l’écoute de micros-trottoirs.
Dispositif « La lingerie et vous ? » - Crédits : Astrid M.
Le visiteur, en décrochant des téléphones, peut écouter le témoignage de personnes anonymes, d’âges et de sexe différents, répondant à diverses questions comme «la femme doit-elle porter une lingerie en fonction de son âge, de sa morphologie, de circonstances particulières,... ? » ; « entre confort et séduction, à quelles fonctions la lingerie doit-elle répondre ? » ; «vous souvenez-vous de votre premier soutien-gorge ? » … Le dispositif « La lingerie etvous ? » (et Moi ?!) est amusant mais il me semble qu’il aurait été pertinent de pouvoir récolter la parole des visiteurs.
Les Dessous de l’Isère est une exposition un tantinet érotique et facétieuse qui aborde des thématiques plurielles et pose beaucoup de questions. A la fois historique, sociologique et anthropologique, l’exposition m’a appris beaucoup de choses sur la lingerie féminine qui est un objet d’étude plus riche qu’il n’y paraît.
Astrid Molitor
L’exposition Les Dessous de l’Isère est gratuite et ouverte à tous jusqu’au mois de septembre.
Pour en savoir plus :
- http://www.musee-dauphinois.fr/2752-l-exposition.htm
#Musée dauphinois
#Industrie
#Lingerie
Une Faune de Museomixeurs au musée d’Histoire Naturelle
Mais qui sont ces personnes surnommés « Museomixeurs » qui investissent nos musées? Toute cette agitation peut paraître étrange dans ces lieux habituellement si calmes.
Crédits photographiques : Museomix Nord
Pourtant, ils sont là pour vous divertir et vous surprendre. Le principal acteur de cette aventure est « Museomix ». Cette association s’est donnée pour mission de rassembler, du 7 au 9 novembre 2014 et dans sept musées partout dans le monde, une véritable faune d’acteurs muséale (scientifiques, communicants, muséographes, artistes…) et du numérique (développeurs, codeurs, ingénieurs..) afin de créer, expérimenter et proposer aux visiteurs de nouveaux dispositifs de médiations. Etudiants et professionnels de tous horizons se regroupent, sans se connaître, avec pour objectif de proposer un prototype de médiations aux visiteurs. Durant ces trois jours, les maîtres mots sont : création, innovation et plaisir.
Alors pour vous donner une petite idée de cette arche de Noé de l’expérimentation muséale, je vais vous parler de ma propre expérience au Museomix Nord qui a eu lieu au musée d’Histoire Naturelle de Lille. Ce sont près d’une soixantaine de personnes qui ont été choisies pour redonner vie aux animaux et fossiles de la collection du musée d’Histoire Naturelle de Lille. Tout comme les espèces exposées, nous venons tous d’horizons différents. Selon un critère de classification basé sur la diversité, nous avons été divisées en groupes de 7 personnes : un communicant, un médiateur, un chargé des contenus, une graphiste, un codeur, un fabriquant et une facilitatrice, afin de faire face à l’appétit exigeant de nos prédateurs : les visiteurs. Par acclimatation, le croisement de nos compétences va donner naissance à un projet hybride dont l’accomplissement est un prototype de médiation. La question était de créer une nouvelle meute de musémixeurs capables d’attiser l’appétit du public pour le musée.
Le premier jour est la journée de l’apprivoisement des membres de mon équipe. En créant une tribu éphémère, je repère très vite qui sont les dominants des dominés, des leaders des suiveurs. Moi, étudiant dont la fonction ici est la médiation, je me fonds dans la masse paisiblement. J’écoute, j’observe avant d’agir. Car dans cette nouvelle société il faut apprendre à se connaitre. En cherchant une idée à défendre, chacun se cherche, se teste, se sent. Certains se rebellent tandis que d’autres suivent la meute en silence. Mais malgré les différences, chacun s’adapte et notre meute prend forme sous le nom des Odonautes - Un nom en référence aux odonates, une famille d’insectes qui se caractérise par ses deux paires d’ailes, son corps allongé et ses yeux composés de milliards de capteurs. Cet ordre se compose de la demoiselle et de la libellule dont nous nous sommes inspirées.
Crédit photographique : Persona
En effet, notre projet est de suivre le parcours personnalisé d’une libellule paléolithique au sein du musée. Cette odonate nous y montre ses origines, son environnement, sa chaîne alimentaire, etc. Elle informe sur son identité et son biotope. Pour se faire, nous avons eu recours à un outil innovant : la « cardboard ». Une nouvelle technologie créée par Google qui consiste à créer des lunettes stéréoscopiques. Le principe est d’avoir une réalité augmentée à l’aide de son smartphone et à moindre coût (moins de 10 $). Les dominants de la meute parlent alors de faire apparaître une libellule 3D qui interagirait avec le musée. Le visiteur la suivrait dans sa pérégrination afin d’acquérir des informations. Le reste du groupe est d’accord. J’acquiesce et la journée se termine par un repas bien mérité où chacune des meutes du Muséomix Nord demeure entre elle. L’envie de vivre ensemble est forte mais la chasse à la création est rude et ne laisse que très peu de temps aux camaraderies.
Car le deuxième jour, c’est la désorganisation la plus totale chez les Odonautes. Pour mener à bien la création de notre prototype, nous avons dû faire appel à des étudiants informatiques (Epitech de Lille) calés en programme et codage en tous genres. Malheureusement, intégrer la libellule en réalité augmentée semble plus compliqué que cela n’y parait et nous manquons de temps. Le logiciel appliqué ne correspond pas au système d’exploitation du smartphone utilisé pour la cardboard (le Nexus). Nous ne savons plus quoi faire. Alors que je dois rédiger avec la chargée des contenus pour le livret pédagogique, la confusion nous gagne. Chaque membre de ma meute avance sans savoir clairement où il doit aller. Le stress nous submerge. Les dominants ne savent plus comment agir et les autres s’isolent dans leurs tâches. Pour nous aider à survivre, la facilitatrice essaye tant bien que mal de rétablir le dialogue et l’espoir revient. Le dispositif sera « The Dragonfly Horror Show », une série B d’horreur dont l’héroïne est une terrible libellule du fond des âges, la StenodictyiaLobta. Le tournage peut alors commencer !

Affiche « The Dragonfly Horror Show » - Crédit photographique : Noémie Desard
Pour le troisième ultime jour, toute l’équipe des Odonautes se retrouve et les doutes se sont évaporés durant la courte nuit de sommeil qui a précédé. La fatigue et le stress sont toujours au rendez-vous mais la meute semble y faire face. Les vidéos se montent petit à petit, un trailer et un épisode-pilote de deux minutes vont pouvoir être accessibles au public. Bien que le système de lancement de la vidéo dans la cardboard par NFC ne se soit mis en place qu’à l’heure fatidique, je suis sur le pied de guerre à 16h pour présenter notre dispositif à la horde de visiteurs. Et la magie opère. Le jeune public abonde autour de moi afin de tester l’unique cardboard que nous avions à disposition. Il est comme une bande affamée et impatiente de nouveautés. Il se bouscule, s’impatiente et en perd même sa politesse. Il est le dernier maillon de la « chaine alimentaire » du musée. Intraitable, il n’en demeure pas moins respectueux et gratifiant envers ses congénères du maillon muséal. Dans cette « chaîne alimentaire culturelle », les visiteurs ne nous dévorent pas, non. Ils nous nourrissent et nous les nourrissons en retour. Si chacun est à sa place dans son projet Museomix, de la direction à la médiation en passant par la conception, la transmission peut donc se faire sans jugement, sans à priori et sans limites. Vivre ensemble et à l’écoute, ce n’est que la dure loi de la Culture.
Passer trois jours de travail intensif au musée d’Histoire Naturelle m’a donné le sentiment de faire partie de la collection. Museomix Nord a été finalement une exposition temporaire sur plusieurs groupes d’espèces à la durée de vie éphémère et dont le pic de (re)productionet d’activité se fait chaque année, durant trois jours en automne. Alors si vous avez aimé ou que vous souhaitez découvrir Museomix, attendez-les, ils reviendront l’année prochaine dans de nouveaux lieux, avec de nouvelles personnes et des idées toujours plus innovantes.
Persona
Pour aller plus loin :
http://www.museomix.org/prototypes/the-dragonfly-horror-show/
https://www.tumblr.com/search/odonautes
https://www.youtube.com/channel/UCSUEyKP68WaCFxWRXiNIIhg
Mots clefs :
# Museomix
# Libellule
# Nouvelles technologies
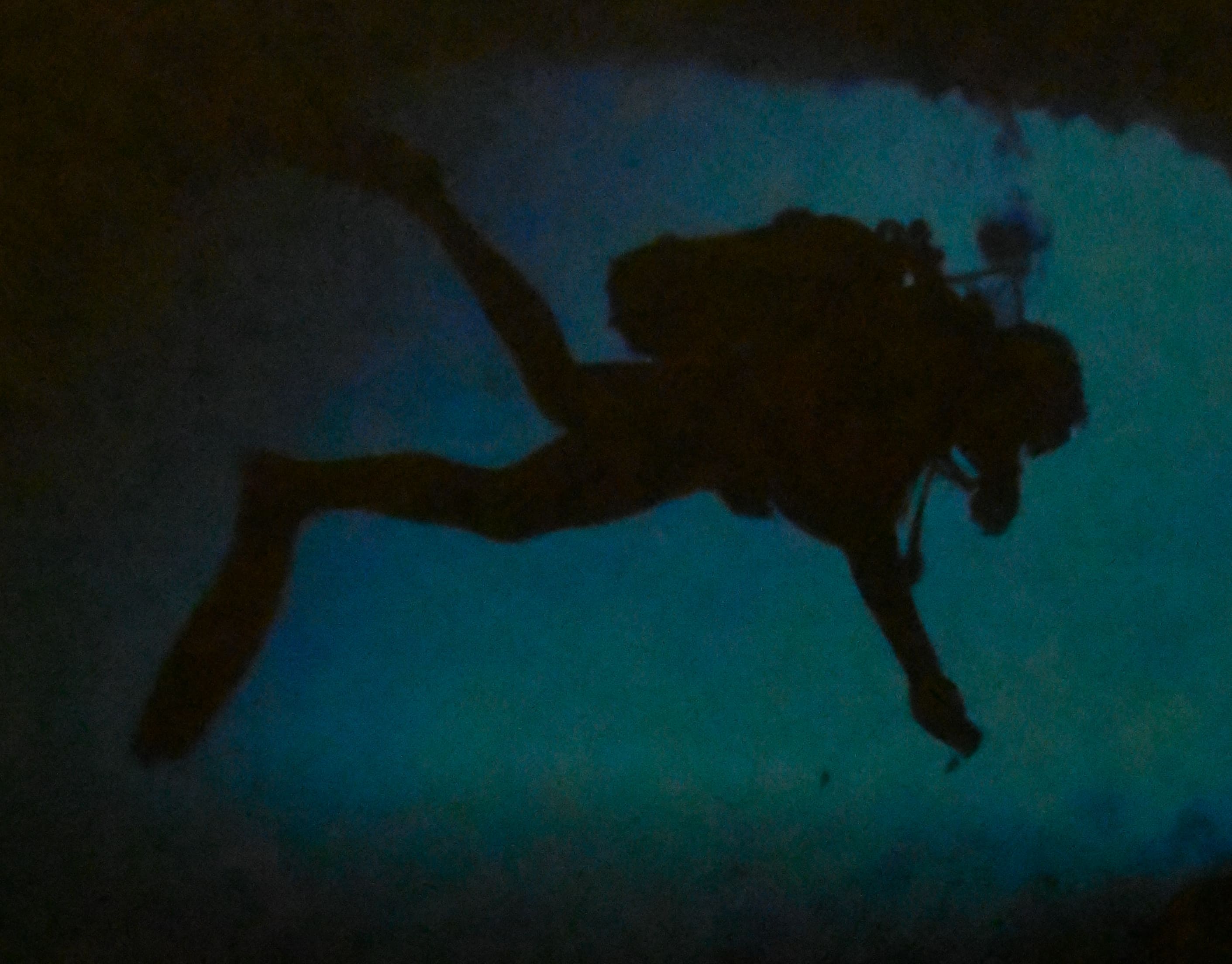
Une grotte préhistorique sous la mer
C’est grâce au plongeur Henri Cosquer que l’entrée d’une des plus mystérieuses grottes sous-marines au monde fut découverte au cœur du parc national des calanques.
C’est en septembre 1985 qu’il franchit un étroit passage de 116m. Mais c’est qu’à partir de 1991 qu’il s’aperçut, muni d’une lampe de plongée, de la présence des animaux préhistoriques dessinés dans cette grotte plongée dans le noir !
Plonger au sein de la Villa Cosquer Méditerranée
C’est en tant que visiteuse de la Villa Cosquer Méditerranée que j’ai découvert son exploit. À l’intérieur se trouve un club de plongée restitué : masque, sac de plongée, lampe, photographies, boussole, carte, montre, bouteilles d’oxygène, tenues de plongée, masques, tubas, gilets de sauvetage…

Restitution d’un club de plongée, © Héloïse Putaud
Audioguide en main, tels des explorateurs nous sommes alors dans un ascenseur, simulant un caisson de plongée pour rejoindre la base sous-marine, qui descend à 37 mètres sous l’eau. La descente dure à peine deux minutes… Cependant, on est passé dans un monde à part ! On a vu à travers les hublots la mer nous envahir. Ecrans et ambiance sonore nous indique que nous avons atteint une station sous-marine.
Nous arrivons alors au quai d’embarquement au sein des modules d’exploration qui s’apparentent à des sièges de manèges dans des châteaux hantés. C’est parti pour 35 minutes d’exploration. Nous sommes alors sous le charme d’une magnifique restitution entièrement modélisée à partir de plans en 3D et ornée par des artistes experts. Des jeux de lumières nous indiquent les endroits où regarder. Ne rêvons pas, aucun ascenseur ne sera creusé pour atteindre la vraie grotte, notre présence humaine participerait à sa destruction. L’expérience immersive n’en vaut pas moins le détour. Plongées dans le noir, nous découvrions le bestiaire représenté sur les parois qui fait de Cosquer une grotte ornée unique : bisons, chevaux, bouquetins, bovidés, cerfs, bisons, antilopes, pingouins, poissons, phoques, félins, ours témoignent d’un épisode glaciaire en Provence il y a 30 000 ans et de la faune de la Provence. Empreintes de mains, gravures, silex sont autant de preuves que des groupes d’Homo sapiens ont fréquenté cette cavité. Dans la reconstitution, seules 11 espèces ont été dessinées et gravées.
A la fin de notre visite, nous pouvons assister grâce à des écrans aux travaux des artistes copistes, mais aussi à un petit film de 10 minutes de la découverte d’Henri Cosquer au sein d’un amphithéâtre. Puis un immense rétro planning avec des cartographies, des schémas géologiques, des plans, la pigmentation de la grotte, etc. Enfin, nous avons la possibilité de voir la Galerie de la Méditerranée.
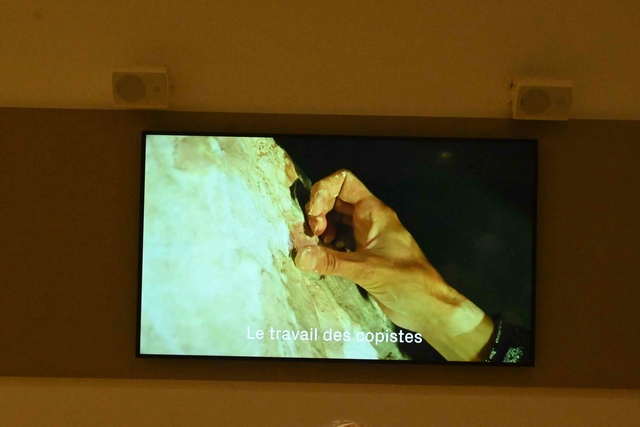
Présentation du travail des copistes, © Héloïse Putaud
Mais avant de l’atteindre, nous devons traverser une petite reconstitution de la Grotte de l’os. La galerie montre des animaux de l’époque. Certains ont disparu, tandis que d’autres ont migré plus au nord de l’Europe. Nous avons donc croisé sur notre chemin des reproductions grandeur nature d’espèces animales composant la faune sauvage des calanques à l’ère glaciaire ainsi que des projections numériques et audiovisuelles sur l’histoire, la montée des eaux et le climat.

La grotte de l’os, © Héloïse Putaud
Nous découvrons mégacéros, espèce disparue. Il est génétiquement proche du daim et du cerf. La bosse sur son dos permet de le reconnaitre sur les représentations. Sur les cartels sont dessinés les éléments présents dans la grotte. Ainsi le lien est fait entre le dessin et la représentation grandeur nature.

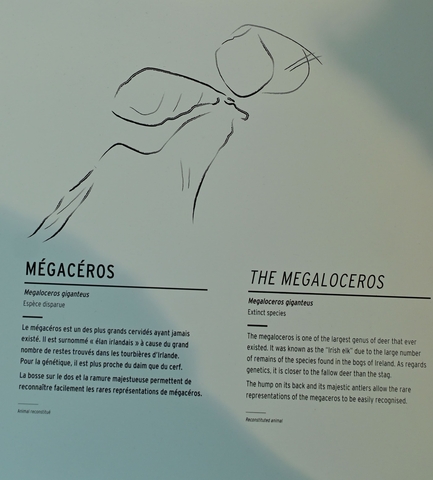
Le mégacéros et non le mégaféroce, © Héloïse Putaud
Plus étonnants encore, des instruments de musique étaient disposés ici. La conque marine Charonia lampas est un instrument à vent. Celui présenté date d’il y a 18 000 ans et a été découvert en Haute Garonne.

Instrument à vent, © Héloïse Putaud
L’humain, responsable du réchauffement climatique
Des explications sur les conséquences et les causes de la montée des eaux dans la grotte sont données. Dans les cent prochaines années, le niveau moyen de la mer sera de près de 80 cm (hypothèse), les œuvres seront noyées et dégradées. A qui la faute ? Aux activités humaines. L’air se réchauffe et la fonte des glaciers continue. Que faire ? L’exposition explique comment empêcher cette montée des eaux, grâce à des digues en surélevant les habitations ou en les déplaçant. Il faudrait lutter contre le réchauffement climatique mais surtout changer sa façon d’agir, réduire son impact environnemental et respecter les équilibres naturels. Même si ces propos sont justes, les visiteurs sont beaucoup plus attirés par le spectacle que donnent les représentations des animaux. De plus, ces propos sont si peu culpabilisants, que peu de visiteurs se sentent réellement concernés. Même si le propos de l’exposition est de nous faire découvrir un trésor de l’humanité, il faudrait donner des clés aux visiteurs qui voudraient agir et devenir acteurs du changement.
Une condamnation imminente, un sauvetage virtuel
C’est en 2016 que Christian Estrosi et Renaud Muselier décident de faire de la Villa Méditerranée l’écrin de la réplique et de la conservation de la Grotte Cosquer.
Comme, la grotte Cosquer est condamnée puisque l’eau monte d’environ 3 mm par an, la seule manière de la sauver, c’est un sauvetage virtuel. Plusieurs étapes ont permis de représenter fidèlement la grotte : d’abord, numérisation de la cavité, modélisation, impression 3D, projection des images. Ces phases de travail ont permis d’aider les artistes (géologues, ingénieux, techniciens) pour la reproduction. Les matériaux comme les ocres ou le charbon ainsi que les techniques de l’époque – dessin, gravure, estompe – ont été repris avec rigueur. Une difficulté réside dans le fait que les artisans ne pouvaient pas voir de leurs propres yeux la grotte. Ils ont dû collaborer étroitement avec les experts chargés de scanner l’ensemble des parties immergées de la grotte.
Gageons que le numérique garde trace de ces patrimoines vouées à être engloutis.
Héloïse Putaud
#henricosquer #grottecosquer #reconstitution
Pour en savoir plus :

Une statue à la gloire impériale
Dans le cadre des recherches menées pour l'ouvrage “L'Hôtel des Troupes de montagne. Un Hôtel de commandement du Second Empire. 160 ans d’histoire militaire à Grenoble.” ,je me suis rendue aux archives de la ville de Grenoble avec la conservatrice du musée des Troupes de montagnes. La lecture des échanges épistolaires entre la Ville de Grenoble et le Ministère de la Guerre à permis de retracer l’histoire de la statue équestre de Napoléon Ier ainsi que le rôle des militaires lors de l’inauguration de la statue à la gloire impériale. Voici son parcours qui nous permet de savoir comment, malgré son malmenage, elle peut encore, elle aussi faire vivre le mythe Napoléonien de nos jours.

La statue équestre de l’Empereur Napoléon Ier La Rencontre, bronze, dépôt en 1920 du Centre National des Arts plastiques, Ministère de la Culture et de la Communication, département de l’Isère, hiver 2020 © Musée des Troupes de montagne
Connaissez-vous la remarquable statue de l’Empereur Napoléon Ier trônant dans les alpages de l’Isère ?
La statue de Napoléon Ier, qui se dresse aujourd'hui à Laffrey, n’a pas toujours eu comme beau panorama les montagnes de la Matheysine et la vue sur le lac. Plusieurs questions se posent légitimement sur les raisons et sa date d’arrivée en ce lieu, sur ses origines, son auteur et son commanditaire. Dans le cadre de la rédaction de l’ouvrage de l’Hôtel des Troupes de montagne : un Hôtel de commandement du Second Empire, 160 ans d'histoire militaire à Grenoble, la découverte de correspondances dans les Archives municipales nous révèle l’envers du décor de son inauguration. C’est grâce aux échanges de lettres écrites entre les autorités militaires et la Ville de Grenoble que nous pouvons savoir aujourd’hui comment et combien cet événement n'aurait jamais pu avoir lieu sans les moyens de l’Armée. Son incroyable périple a pu ainsi être retracé : du projet de sa commande à son exposition actuelle en passant par la mise en place d’envergure qui fut nécessaire à l’événement de son inauguration.
Les origines de la commande de cette statue prestigieuse
La statue actuelle à Laffrey est l'œuvre du sculpteur Emmanuel Frémiet (1824-1910). Célèbre pour ses sculptures équestres, telle que l’iconique Jeanne d’Arc Place des Pyramides à Paris, il fut l’élève de François Rude. La statue de l’Empereur Napoléon Ier fut commandée sous le Second Empire et réalisée en 1867. Son commanditaire, Napoléon III, neveu du Premier empereur des Français, décida de payer cette statue monumentale avec sa propre cassette personnelle. D’un poids de près de quatre tonnes, en bronze, coulée par le fondeur Charnod, elle fut érigée au centre de la Place de Verdun actuelle, nommée jadis Place d’Armes. Impériale, administrative et prestigieuse, cette nouvelle place n’est pas choisie uniquement pour sa bonne taille (160 m X 140 m), mais surtout pour ce qui est alors, durant le Second Empire, un haut lieu de concentration des pouvoirs. Cette place appelée aussi “Place Napoléon” est bordée au nord par l’Hôtel de commandement des Troupes de montagne actuel, ancien Hôtel de commandement de la 22e division.

Maquette de la statue de Napoléon Ier par Emmanuel Frémiet, cartes postales, ed. Martinotto frères, XIXe siècle, Pd.4.206.1 & Pd.4.206.2 © Bibliothèque Municipale de Grenoble
Une statue au service du souvenir impérial
Cette statue de Frémiet commémore la journée décisive qui permit à Napoléon, en route vers Paris, de reprendre le pouvoir. Elle représente la scène de “la Rencontre” du 7 mars 1815, où Napoléon Ier au retour de l'Île d’Elbe, rencontre les troupes royales chargées de l’arrêter aux abords de Grenoble. La scène fait suite au débarquement de l’Empereur, au Golfe-Juan le 1er mars 1815. Napoléon prit alors la route des Alpes, l’actuelle Route Napoléon afin de gagner Paris. La route est jugée plus favorable que celle empruntée par les royalistes de la vallée du Rhône. Il passe par le plateau Matheysin, le 6 mars par Corps, puis La Mure et se dirige vers Grenoble. Le 7 mars, à l’entrée de Laffrey, sur la plaine, un bataillon du 5e de Ligne envoyé par Louis XVIII l’attend pour l'arrêter. Napoléon Ier s’avance, seul sur sa monture caparaçonnée, au-devant des troupes, dans cette plaine désormais nommée la Prairie de la Rencontre. Il prend alors la parole : “Soldats du 5e de Ligne, je suis votre empereur, reconnaissez-moi !”, s’approche à portée de fusil des soldats indécis, entrouvre sa redingote et dit “S’il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur me voici.” Le 5e de Ligne abaisse les armes. Plus tard Napoléon affirme au général Cambronne “C’est fini. Dans huit jours nous serons à Paris.” Le 20 mars, depuis le Palais des Tuileries, il met en place un Empire doté de deux chambres législatives.

Maquette de la statue de Napoléon Ier par Emmanuel Frémiet, bronze et plâtre, avant 1868, 30x34x13 cm, MG 1204 © Musée de Grenoble
Une inauguration hautement symbolique :
Si le choix du thème de la sculpture est hautement symbolique, le choix de la date de son inauguration ne l’est pas moins. Le Maire de la Ville de Grenoble, Jean-Thomas Vendre, la fait ériger autour de trois jours de festivité. La foule est considérable pour l’admirer le 17 août 1868, soit deux jours après une fête religieuse importante, celle de l’Assomption le 15 août, mais surtout le jour de la fête de Napoléon. La cérémonie d’inauguration de la statue du 17 août marque l’apothéose de trois jours de fête nationale débutée à la mi-août. Les festivités sont officiellement lancées par Monsieur le Président le 10 août à midi précise.
Le rôle des Troupes en garnison à Grenoble :
Un mois avant l’événement, le Maire de Grenoble demande au général de la 22e division de pouvoir loger les étrangers pour le concours musical de l’inauguration de la statue. Pour cela, 280 à 300 tentes d’officier doivent être mises à disposition de l’Autorité municipale. Ces tentes doivent être rendues à Grenoble dans les magasins de l’État le 19 au plus tard, soit à peine deux jours après la fin des festivités. Les bons rapports entre l’Armée et la ville, contribuant aux bonnes conditions du rayonnement des arts à l’international, sont rendus possibles par des engagements précis. En effet, le maire se porte entièrement caution pour toutes les éventuelles dégradations pouvant survenir au matériel auprès de l’administration militaire.
La charge de Corvée de mise en place et de désinstallation revient à 150 à 200 militaires moyennant contribution. Le Maire considère qu’il est “préférable de faire faire ce travail par des militaires ayant fait campagne que par des ouvriers civils qui n’en auraient nullement l’expérience”. À la demande du Maire de Grenoble, ce sont les militaires, sous ordre du colonel de Bouxeuille, directeur de l’École d’artillerie, qui ôtent les arbres de la Place d’Armes gênants selon les indications du jardinier en chef. Quelques jours avant l’événement, la ville met en place des orangers en acceptant la suggestion de verdure du colonel. Elle orne la partie du quai Napoléon sur laquelle doivent se placer les autorités et les invités pour assister au feu d’artifice. Ce ne sont pas moins de 450 places qui sont mises à disposition à cet endroit. Le 12 août, deux jours avant l’événement, le Maire s’assure de faire vérifier l’estrade et sa solidité désirable par l’architecte, il serait désastreux que l’estrade n’ait pas une structure assurée.
De pair avec la sécurité, l'enivrement est pensé : le maire, soucieux de l’éclat de la solennité de l’inauguration, fait distribuer par la ville, aux troupes en garnison à Grenoble, des rations supplémentaires d’un litre de vin. Afin de réserver les provisions pour les festivités, les hommes de corvée et leur maréchal-des-logis, pourront se présenter pour prendre livraison chez le marchand local, à cinq heures du matin, Place des Tilleuls, le 17 août. Ces rations extraordinaires de vin sont prévues en comptant l’effectif de corps d’élite de la gendarmerie. Pour le dîner du 17 août, dressé sur la terrasse, le nombre de couverts est fixé à 210. Le restaurateur de la Ville de Grenoble dispose de cinq jours afin de prendre ses dispositions.

La statue équestre de l’Empereur Napoléon Ier, sur la Place de la Constitution ou Place d’Armes, faisant face à l’Hôtel de la Division, 1868, Pd.4 (613) © Bibliothèque Municipale de Grenoble
Qui est invité ?
Le 12 août, les invitations aux personnes importantes de la ville sont annoncées. Le secrétaire en chef de la Mairie, le receveur municipal, l’architecte, le chef d’octroi, le commandant des pompiers, le receveur de l’hospice, le jardinier en chef, le régisseur de l’usine à gaz, le conservateur du Musée, le conservateur du Muséum, le conservateur de la Bibliothèque, le directeur de l’École professionnelle avec M. l'Aumônier, le directeur du Degré Supérieur, le directeur de l’École chrétienne, le directeur de l’École de sculpture, directeur de l’École de Dessin sont conviés. Les membres du conseil municipal sont invités à la cérémonie solennelle du 15 août. Pour le dîner du 17 août à l’Hôtel de Ville, le Colonel de la 3e de ligne, les membres de la Cour et ses Tribunaux sont conviés. Malheureusement, au grand dam du Maire, le commandant du 13e BCA (bataillon de chasseurs alpins), ne peut assister au banquet offert par la Ville.
Un cortège au rythme des feux d’artifice...
Le feu d’artifice de l’année 1867, avait été reporté par le Ministre de la Guerre. Pour ce tir grandiose du 17 août 1868, la ville de Grenoble concourt à la dépense engendrée. Mais ce sont les plus experts en matière de feu, les artilleurs de la 22e division, qui s’occupent des tirs de canons. Afin de convenir d’un endroit approprié, les autorités avec le colonel de Bouxeuille, directeur de l’École d’artillerie, décident des lieux de départ de tirs appropriés pour que l’événement se passe en toute sécurité. Les reflets dans l’eau de l’Isère des tirs depuis le pont suspendu et le pont de pierre, nouveau à l'époque, sont parfaitement spectaculaires. Mais, ces deux endroits ne suffisent pas. On installe d’autres pièces de canon sur les quais de l'Île Verte pour encore plus de tirs ! L’Île Verte, particulièrement illuminée par un entrepreneur spécifique pour l’occasion, nécessitera même 50 hommes de corvée, en plus des ouvriers pour la manutention. L’éclat de cette cérémonie est assuré par un déroulé bien réglé autour des tirs de canons. Ainsi, il est prévu que les troupes de garnison doivent passer dès onze heures et demie du matin sur la Place d’Armes avec les sapeurs-pompiers de la ville et ceux des communes voisines, qui se rendent à Grenoble, à cette occasion.
Après les discours officiels, ces troupes opèrent un défilé au-devant de l’estrade occupée par les autorités, c’est-à-dire entre cette estrade et la statue. La cérémonie est annoncée, en grande pompe, par une salve de 101 coups de canon tirés du Fort de la Bastille et les principales portes de la ville. Le soir, un feu d’artifice est tiré sur le pont suspendu par les soins de l’École d’artillerie avec le concours de la ville. Ce feu est tiré à huit heures et demie précises. Il faut deux divisions afin de prendre position avec le matériel ! L’une encadre la rue de Lionne, l’autre se positionne sur la Place de la Simaise. De nouvelles salves sont tirées sur le quai de l’Île verte. Dans les intervalles du feu d’artifice, un détachement de 300 hommes est disséminé sur les hauteurs du fort. Et comme rien n’est assez grandiose à la gloire de l’Empereur, ses hommes simulent une petite guerre et tirent des fusées à étoile de couleur !
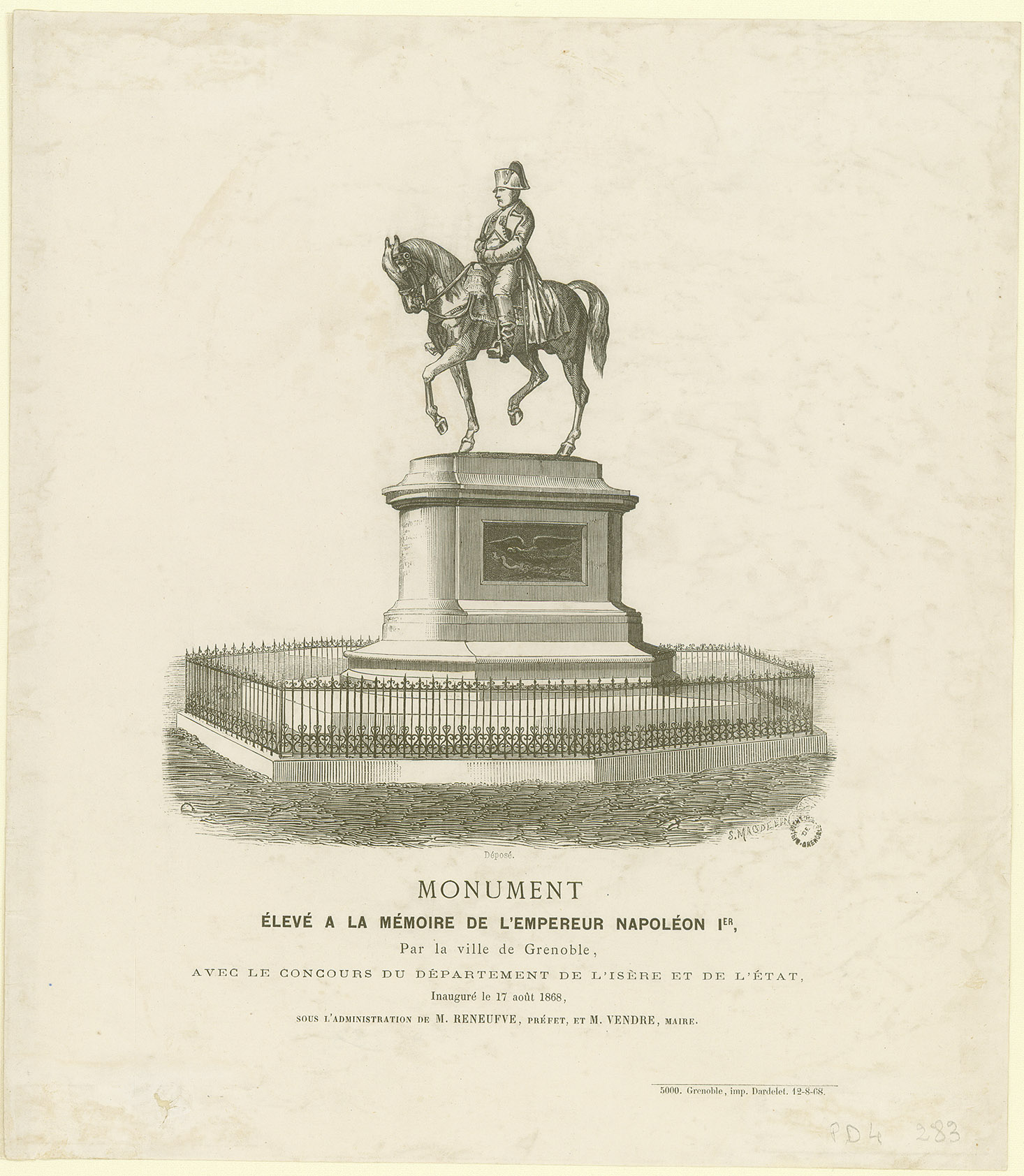
Monument élevé à la mémoire de l'empereur Napoléon Ier, 1868, Pd.4 (283) © Bibliothèque Municipale de Grenoble
et, surtout, de la musique !
La musique a un rôle central dans l'événement. Qu’elle soit, militaire, religieuse ou artistique, sa diversité donne le ton à chaque moment de la cérémonie. Le 15 août, à dix heures trois quart, le corps de sapeurs-pompiers forme une haie d’honneur, adossé au péristyle de l’Hôtel de ville, à droite sur la Place Saint-André. Pendant ce temps, Messieurs les Officiers, non pourvu de commandement, se rendent au salon de réception. À dix heures et demie le corps municipal et ces fonctionnaires prennent place en rangs et se dirigent vers l'Hôtel de la préfecture pour y prendre monsieur le Préfet et les autres fonctionnaires municipaux. Le cortège se rend ensuite à l’Hôtel de la Division, le lieu de pouvoir, des militaires par excellence. Puis, les militaires continuent de donner la marche à suivre au cortège en musique.
À quatre heures du soir, le corps de sapeurs-pompiers forme une haie sur le passage du cortège tout en accompagnant en musique les membres du jury du concours musical jusqu’à la Place Grenette. Le 11 août, le Maire de Grenoble demande à ce que les cours des casernes soient disposées pour les différents concours d’instrumentaux. Pour cela des escaliers sont disposés sur la place. Une médaille est même prévue pour le concours musical, les arts sont reconnus. À cet effet, le Commandant du 13e BCA donne au maire 100 francs pour l’achat de celle-ci. L’exécution de la cantate est assurée par le 47e régiment d’infanterie de Chambéry. Elle est réunie à celle de la musique du 3e de ligne, et à des éléments de localités. Autant de voix et sons martiaux magnifiant l’évènement nécessitent des moyens à la bonne mesure du profit de tous les spectateurs.
Les militaires musiciens sont donc aux bons soins de la ville pour se loger, se nourrir et être indemnisés. Leur transport fait même l’objet d’une demande, le 25 juillet, de gracieuseté à titre de service public spécial selon les appuis favorables et puissants du colonel de la 47e ligne et du général de la 22e division, Adolphe de Monet. La bonté du Ministre de la Guerre accorde cette faveur. Le 12 août, moins d’un mois après la demande, le Lieutenant chef de musique de la 47e de ligne reçoit de la ville, un billet de la banque de 200 francs pour les frais de voyage allers et retours avec une réduction de 40 pourcents pour les militaires qu’il dirige.
La musique militaire est omniprésente durant toutes les festivités. Les membres de la musique du corps de sapeurs-pompiers rejoignent la scène et la musique du 3e régiment de ligne, pour faire entendre alternativement son morceau d’harmonie sur la terrasse du jardin de ville pendant le banquet donné par la ville le 17 août à cinq heures trente du soir. À sept heures trente, le banquet opulent continue au rythme de la musique du 3e de ligne. L’auteur de la musique d’une cantate s’adresse même directement au chef de musique du régiment de la 47e ligne de Chambéry pour l’orchestration de son œuvre, c’est dire la confiance que l’artiste porte aux militaires. Le festival de musique est présidé par le grand compositeur Hector Berlioz. Apprécié pour ses qualités de chef d’orchestre, il est invité par le Maire de Grenoble Jean-Thomas Vendre. L’artiste effectue son dernier voyage à Grenoble, ville de résidence de sa famille, avant son décès six mois plus tard.
Un piquet de quinze hommes est détaché un quart d’heure d’avance pour faire le service religieux à la cathédrale. Le samedi 15 août, à onze heures et demie très précise du matin, à l'issue de l’Office donnée, un hymne latin chrétien, Te Deum, solennel est chanté à l’occasion de la fête de l’Empereur. Afin de bien vouloir assister à la cérémonie, le corps municipal est prié, trois jours avant l’événement, de se réunir à l’Hôtel de ville à dix heures et demie pour se rendre à l’Hôtel de la Préfecture, Place d’Armes. À l'issue du service religieux, le corps municipal est conduit à l‘Hôtel de ville, toujours musique en tête. Immédiatement après le corps de sapeurs-pompiers se rend sur la Place d’Armes où il est passé en revue avec la Troupe de la garnison par M. le général Comte de Monet, commandant de la division Militaire et premier occupant de l’Hôtel de Commandement.
La foule venue acclamer l’Empereur est ravie. Les plus pauvres ne sont pas oubliés : l’administrateur de la Ville leur affecte la somme de 3500 francs conformément à la délibération du Conseil municipal.
Le devenir de la sculpture après l’inauguration de 1868
Pour compléter la sécurité, cette fois en termes d’équipement urbain durable, la confection d’une grille est demandée pour entourer le monument. Dès le 10 juillet, elle est commandée au même architecte choisi pour ce projet de statue. Il avait lui-même choisi les candélabres des socles de pierres posés devant l’entrée principale du monument. Le 20 août, les dernières pierres prennent place, prêtes à recevoir la grille. Elle permet de remplacer la clôture provisoire en planches. Elle est mise en place juste après l’inauguration et une fois le nivellement de la place effectué. Ce dernier exigea dix à douze jours de travail !
Deux ans plus tard, le monument aux grands hommes fut tristement retiré et mutilé lors de la chute du second Empire en 1870, le 4 septembre précisément. Par chance, il est soigneusement conservé dans les réserves du Musée-Bibliothèque. La sculpture, accompagnée de deux bas-reliefs de François Gilbert, fut restaurée à Paris. Depuis 1929, elle a été recontextualisée sur le lieu de passage historique, de Napoléon Ier, nommé “la route napoléonienne" à Laffrey au bord du lac. Elle est installée selon le dessein de l’architecte Louis Fléchère au moment où la Troisième République se réconcilie avec Napoléon Bonaparte incarnant la grandeur de la France pendant et après la Révolution française. Depuis, Napoléon et son cheval surplombent le paysage de la route Napoléonienne en ce lieu fort de sens.

La statue équestre de l’Empereur Napoléon Ier La Rencontre, bronze, dépôt en 1920 du Centre National des Arts plastiques, Ministère de la Culture et de la Communication, département de l’Isère, hiver 2020, hiver 2020 © Musée des Troupes de montagne
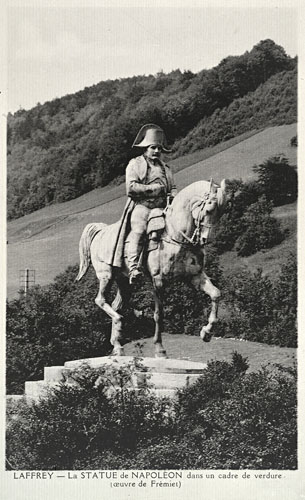
Laffrey - la statue de Napoléon dans un cadre de verdure © Musée d’Orsay, Fonds Devuisson
Charlène Paris
#brève d’apprentissage #sculpture #patrimoine #conservation #gestioncollection #CNAP #histoire-mémoire #patrimoine-société

Vers l'infini et l'au-delà, un regard dans les tombes gallo-romaines à Arkeos
Aspirante thanatopractrice depuis mon plus jeune âge, je me suis toujours intéressée à tout ce qui entourait la mort. Je vous laisse alors imaginer la joie ressentie lorsque j’ai découvert qu’un de mes musées préférés, le Musée ARKEOS de Douai, présentait une exposition sur les pratiques funéraires en Gaule romaine : « Vers l’infini et l’au-delà ». C’est en compagnie de Fabienne Thomas, coordinatrice des expositions temporaires que ma visite s’est déroulée.

Fig 1. Vue du musée ARKEOS © Facebook du musée ARKEOS
Arriver à Arkeos c’est parcourir en un regard 200 000 ans d’histoire du Douaisis. Ce musée archéologique abrite les anciennes collections de la chartreuse de Douai, enrichies de découvertes archéologiques réalisées sur le territoire. C’est donc naturellement que cette exposition s’est construite avec les archéologues du service archéologique de l’agglomération et avec Sophie Vatteroni, anthropologue de Douaisis agglo.
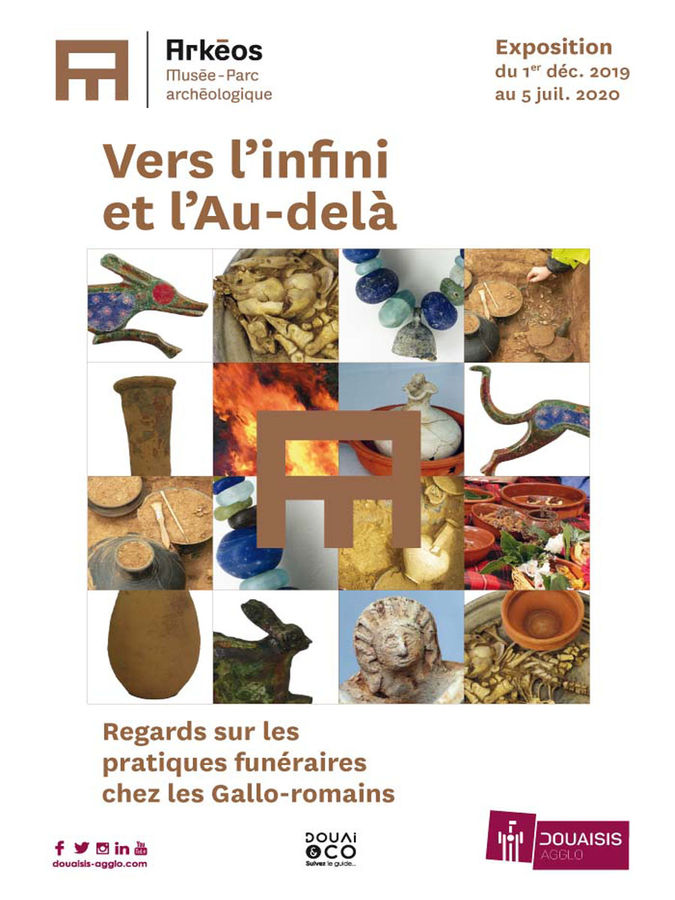
Fig 2. Affiche de l’exposition “Vers l’infini et au delà”, © Musée ARKEOS, Douai
Le sujet des pratiques funéraires est classique en archéologie, mais l’exposition que propose Arkeos depuis le 5 juillet 2019 présente le parti pris audacieux de présenter des reconstitutions de rituels funéraires avant leur crémation et d’offrir aux visiteurs une vision du monde des vivants à travers celui des morts. Ainsi, au détour d’une cimaise, le visiteur se trouve face à un corps enveloppé dans un linceul, avant de découvrir les vestiges archéologiques laissés par ce type de funérailles.
Que se passe-t-il à la mort d’un proche ?
C’est à cette question que répond l’exposition en proposant un parcours suivant chronologiquement les différentes étapes des funérailles chez les Gallo-romains. Si les différentes étapes n’étaient pas faites dans l’ordre ou avec soin, le défunt pouvait être voué à errer dans le monde souterrain des Enfers ou encore se transformer en un esprit malfaisant menaçant la tranquillité du foyer. Alors, quoi de plus logique que de découvrir ces rites dans leur ordre de réalisation !
Fig 3. Photographie générale du parcours de l’exposition © Douaisis Agglo
Le parcours muséographique est conçu comme une immersion progressive dans le monde gallo-romain, jalonné de nombreuses surprises scénographiques qui dynamisent lesujet. Dès l’entrée dans l’exposition, le contexte est posé par une frise chronologique mais surtout par une carte de la région étudiée avec les principales villes d’où proviennent les expots présentés. Cette mise en contexte peut être un poncif, mais elle est bien nécessaire, notamment pour se familiariser avec les grandes régions gallo-romaines entourant le Douaisis. Cette section introductive laisse ensuite place, au détour d’un mur à une belle surprise, la présentation d’un bureau d’archéo-anthropologue. Ce parti-pris est un bel hommage à cette spécialité archéologique, et une ouverture intéressante sur des métiers souvent méconnus. Une partie de cette section s’adresse à un jeune public, peut être révélera-t-elle des vocations !


Fig 4. Vue de la section introductive © CHF
Fig 5. Vue de la section “L’archéo-anthropologue ” © CHF
Après ce module contextuel, une explication de la croyance des romains, “L’homme face à la mort” clarifie la différence entre croyances dans une vie après la mort chez les Egyptiens et les Romains.
Fig 6. Vue de la section ”L’homme face à la mort” © CHF
C’est alors que commence le véritable voyage au sein des funérailles gallo-romaines, qui durent parfois plus d’une semaine. Considérant que pendant la période étudiée par l’exposition, la crémation était majoritaire, elle est la seule traitée. C’est avec le module sur la crémation et le repas funéraire qu’apparaissent en nombre les sources archéologiques et littéraires et les restes sépulcraux. Au centre de chacun de ces modules, trônent deux reconstitutions des rites funéraires présentés : un bûcher et un banquet funéraire. Autour de ces éléments se développe alors le discours, éclairé par des illustrations d’Etienne Louis et des artefacts mais aussi par des photographies de reconstitutions historiques effectuées par Pater Familias (pour la plupart), compagnie de reconstitution spécialisée dans les rites gaulois.
Fig 7. Vue du banquet au premier plan et du bûcher funéraire en second plan © CHF
Fig 8. Vue de la section “Le paysage funéraire” © CHF
Pour conclure ce voyage outre-tombe, le visiteur est ensuite invité à élargir sa vision des sépultures gallo-romaines en découvrant par le biais de la réalité virtuelle, les sépultures à hypogée de Douchy-les-mines ou en étant confronté à l’action des pilleurs de sépultures et aux conséquences archéologiques de tels gestes. Pour finir par une découverte des pratiques funéraires contemporaines extra-nationales en regard avec celles qu’il vient de découvrir.
Des dispositifs pédagogiques coup de cœur
Plusieurs points de l’exposition méritent tout particulièrement qu’on s’y intéresse, à commencer par la station numéro 2, le bureau de l’anthropologue pour mettre en avant le travail de l’archéo-anthropologue. Le choix de présenter un bureau d’anthropologue aux enfants fait d’autant plus sens que Sophie Vatteroni, anthropologue à Douaisis Agglo anime des interventions dans cet espace (notamment un apéro-archéo). L’installation de ce bureau s’est imposée à l’équipe car il fait écho aux animations autour de l’anthropologie déjà conduites par le musée qui connaissent un grand succès auprès des enfants

Fig 9 et 10. Vues du bureau de l’anthropologue © CHF
Chez les enfants, il n’existe pas de tabou autour de la mort, au contraire, ils sont tout à fait curieux du sujet. Fabienne Thomas relate qu’à chaque fois que les enfants découvrent les esquilles (fragments d’os résiduels après une crémation), ils veulent savoir s’il s’agit de vrais os humains et sont fascinés lorsqu’elle leur répond par l’affirmative. L’armoire à tiroir qui accueille des crânes et des cubitus ainsi que le tabouret tournant ont été prêtés pour l’occasion par cette anthropologue. Un livret jeu est dédié aux enfants ainsi que des espaces où ils sont invités à jouer au puzzle avec des squelettes (factices, soyez-rassurés).
Que se cache-t'il sous ce linceul immaculé ?
Corps enveloppé dans un linceul blanc, visage masqué, le mort dissimulé.
Verrerie, bijoux, fruits, fleurs, pains, autant de cadeaux placés sur le linge immaculé.
Lit de bûches entremêlées, brindilles intercalées, bûcher dressé.
Fosse creusée sous le bûcher, une meilleure combustion, du temps de gagné.
Au pied de la tombe fraîchement creusée, la famille partage un repas,
En hommage aux dieux, au disparu, elle mange, elle boit,
Remplit la tombe, fait une libation, avant de tout fermer,
Une dernière fois.
Fig 11. Reconstitution d’une inhumation en linceul funéraire © CHF
C’est cette vision qui m’est venue quand, débout, pantoise, j’ai imaginé la scène contée par la bande-son diffusée dans la salle. Le soin avec lequel a été réalisée cette mise en scène ajoute de la vie et du réel aux propos de l’exposition. Cette scénographie redonne une existence aux fragments osseux que nous y découvrons.
"Une tombe c’est une capsule temporelle..."
-Damien Censier, commissaire de l’exposition
L’exposition s’attache à mettre en lumière ces textes et les pratiques funéraires locales en miroir, mais également, à faire ressortir les particularités régionales qui différencient la Gaule belgique de la Gaule Narbonnaise, par exemple, l’importante présence de fibules dans les dépôts funéraires du Douaisis. Toujours dans le but de mettre en exergue la complexité et la richesse des relations entre les vivants pour perpétuer la mémoire de leurs défunts. Ces rituels, bien que longs et codifiés témoignent d’une véritable attention et d’un souci du détail ainsi que d’une variété de pratiques que nous avons perdues aujourd’hui, nous qui pratiquons des funérailles uniformes et souvent peu personnalisées. Tout au long de la visite, on comprend bien la différence entre la Gaule narbonnaise et la Gaule belgique, deux territoires gaulois bien différents. Les découvertes archéologiques réalisées ces dernières années dans le Douaisis et les Hauts-de-France ont fourni un corpus d’objets qui permettaient de mettre en lumière les rituels funéraires du territoire entre le Ier siècle av.J.-C. et le IIIe siècle ap.J.-C. Ainsi s’achève le voyage outre-tombe entamé quelques heures plus tôt, à la croisée du monde des vivants et des morts à Arkeos.
Claire HAMMOUM--FAUCHEUX
#Arkeos#Exposition#Archéologiefunéraire
Pour aller plus loin
- Sur le site du musée:
https://www.arkeos.fr/musee/expositions/vers-linfini-et-lau-dela
- Présentation de l’exposition par Damien Censier, commissaire de l’exposition :
https://fb.watch/4E8PgeVON9
- Pour en savoir plus sur les reconstitutions de rites gallo-romain de Pater Familias :
https://www.facebook.com/PaterFamiliasbavay/?ref=page_internal
Image d'introduction : Vers l’infini et l’au-delà, jusqu’au 5 juillet 2021 ©CHF
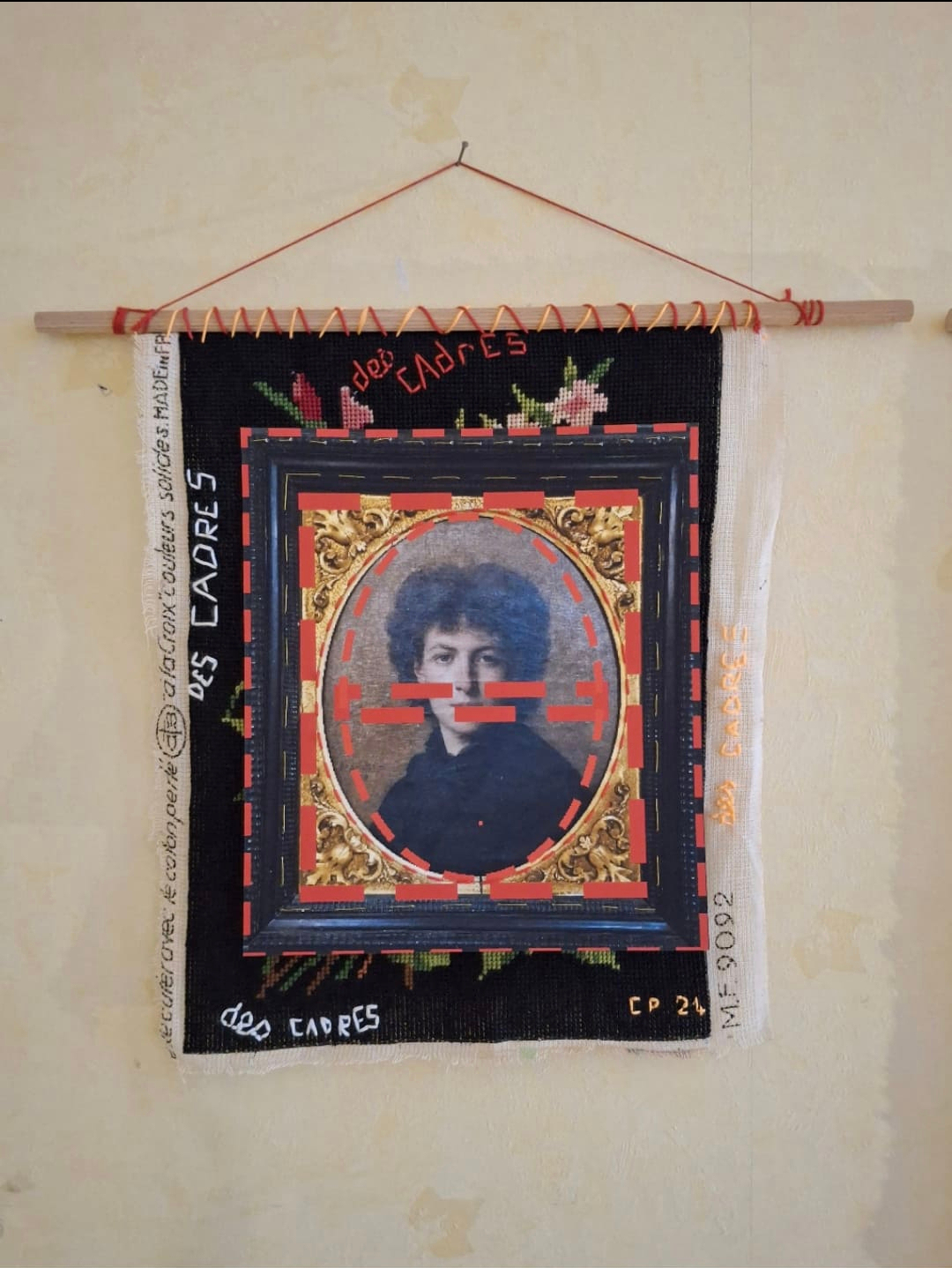
Visite et revisite : des expositions en écho, hommage à l'illustre enfant du pays
Bédarieux : une ville culturelle enracinée dans son histoire
Petite ville de 6 000 habitants nichée en Occitanie, Bédarieux intrigue par son calme et sa discrétion. Au loin, le viaduc reliait au XIXe siècle le bassin minier au réseau ferré vers la Méditerranée. La ville, en plein essor industriel, prospéra pourtant jusqu’au milieu du XXe grâce à l’industrie textile, les tanneries, les fours à chaux, la chimie et la construction mécanique.
«L’endroit n’a rien d’une destination touristique, encore moins d’un bassin d’emploi dynamique. Les rares passants rencontrés le reconnaissent volontiers : la vie a déserté la ville depuis bien longtemps » affirme le rédacteur en chef de Libération, le 21 avril 2021. Bédarieux apparaît même comme une ville de « taiseux » …
Loin des destinations touristiques ou des bassins d’emploi, elle n’en affiche pas moins une belle ambition. Comme rétorque son maire avec humour : « Il faudrait que vous vous penchiez sur les villes comme la nôtre... pour montrer celles et ceux qui se battent pour redresser ces coins de France trop longtemps délaissés, mais pleins d’avenir ! ».
A présent, Bédarieux s’épanouit à travers l’art : ce renouveau passe par une dynamique culturelle forte. Nouveau cinéma, salles de spectacles, médiathèque, festivals… la ville propose une diversité d’activités. La Maison des Arts, située dans l’ancien Hospice Royal Saint-Louis classé Monument Historique, regroupe depuis 2003 un Espace d’Art Contemporain reconnu pour ses expositions d’artistes locaux et internationaux.
Bédarieux est aussi marquée par l’émergence d’espaces de création privés comme « Le 31 ». L’artiste Nicolas Bexon, tombé amoureux de la ville, s’y est établi et s’investit pleinement. Avec une vie associative dynamique et des habitants engagés, Bédarieux prouve qu’elle sait allier discrétion et créativité pour se réinventer.
Le peintre du pays à l’honneur : exposition “Pierre Auguste Cot - La Collection”
Pierre Auguste Cot, né à Bédarieux, a toujours gardé un lien fort avec sa ville natale malgré son succès parisien. Propriétaire du Mas Tantajo, il y passait ses étés à peindre, entouré de sa famille, organisant des soirées conviviales avec ses amis comme Alphonse Daudet. Il offrait également des toiles et réalisait des portraits pour les habitants. Depuis 1947, un buste sur la place qui porte maintenant son nom rappelle l’attachement de la ville à cet artiste emblématique.
En 2024, l’exposition « Pierre Auguste Cot – La Collection » célèbre son œuvre et son héritage en exposant plusieurs de ses toiles. Le vernissage a réuni plus de 500 personnes, et de nombreux élèves et visiteurs ont ensuite découvert ses peintures, enrichies par des prêts d’institutions régionales comme le Musée Fabre de Montpellier. L’exposition est dynamisée par les élèves du Lycée des Métiers de Fernand Léger qui ont participé à la reconstitution d’un salon semblable à celui de Cot. La collecte de dons pour restaurer les œuvres de Cot a été organisée par la Fondation du Patrimoine, représentée par Jean Lavastre, délégué territorial de l’Hérault.
Pour le maire, cet événement permet aux habitants de redécouvrir un artiste qui incarne à la fois l’ouverture et l’ancrage de Bédarieux dans son patrimoine.
Les femmes à l’honneur
L’exposition met en lumière les représentations féminines dans l'œuvre de l'artiste.
La première salle présente six portraits de femmes, soulignant leur place importante dans son travail, qu’il s’agisse de proches ou de Bédariciennes. Le « Portrait de Madame Gervais » témoigne de la délicatesse avec laquelle Cot peignait ses modèles féminins, souvent issus de la bourgeoisie. Le buste de Madame Cot attire également l’attention dans la première salle.
Espace d’Art Contemporain (Bédarieux), © Pauline Mabrut
Ces œuvres témoignent de la formation rigoureuse que Cot a reçue auprès de ses maîtres, tels que Alexandre Cabanel.
Dans la seconde salle est exposée une peinture d’une prestance déroutante : “Mireille faisant l’aumône à la sortie de Saint-Trophime”, dans laquelle est représentée Mireille pleine de grâce et de grandeur, offrant quelques pièces à un mendiant dont le modèle était un jeune bédaricien.
Pierre-Auguste Cot revisité
L'exposition "Cot Revisité" se tient dans l’Atelier d’Art de Nicolas Bexon, où 25 artistes contemporains membres de l’association des 4CM (Créatrices et Créateurs du Caroux au canal du Midi) réinterprètent les œuvres de Pierre Auguste Cot.
Avec le soutien logistique de la mairie, cette exposition pose la question : que penserait Cot, l’artiste académique, des réinterprétations contemporaines de ses œuvres ? À l’époque, l’artiste répondait aux attentes ; aujourd’hui, il suscite réflexion et émotions.
L’exposition offre un parcours surprenant, où les artistes jouent avec humour et profondeur, toujours avec talent. Cette réinvention vivante de l’œuvre de Cot, après plus de 150 ans, réveille son héritage et invite les Bédariciens à découvrir ce grand artiste trop méconnu.
Parmi les œuvres, une jeune Ophélia, tablette tactile en main, observe silencieusement les visiteurs, tandis que sa robe (symbolisée par la robe de mariée de la mère de l’artiste) suspendue au mur ajoute un air mystérieux, nous faisant penser au travail de Sophie Calle.
Atelier d’Art Nicolas Bexon (Bédarieux), © Pauline Mabrut
Les artistes réinterprètent le célèbre "Printemps" avec des touches humoristiques ou provocatrices : des peintures retravaillées, des poupées Barbie mises en scène, une balançoire suspendue au-dessus d'un petit bassin…
Les femmes peintes par Cot sont au cœur de la question de l’émancipation féminine au fil des âges. L’artiste Catherine Philippe symbolise cette réappropriation par des éléments forts : un cintre portant un fœtus dénonçant les souffrances liées à l’avortement, et une autre œuvre, "La Prison Dorée", où une femme est prisonnière de barreaux d’or. “Mon travail créatif consiste à revisiter l’histoire de l’art avec un regard féministe, en utilisant des reproductions d’œuvres connues et reconnues sur lesquelles j’ajoute des éléments afin de rendre compte du vécu des femmes” explique l’artiste sur un cartel de l’exposition. Un hommage puissant à la lutte pour les droits et les libertés des femmes, brodé sur les œuvres.
Atelier d’Art Nicolas Bexon (Bédarieux), © Pauline Mabrut
L’« Orage » de Cot a été réinterprété, avec l’ajout de l'article 213 du Code civil de 1804 : « Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari ». Ainsi, la supposée Virginie devient l’otage de son compagnon, le toit du foyer se tissant peu à peu au-dessus de sa tête.
Atelier d’Art Nicolas Bexon (Bédarieux), © Pauline Mabrut
Revisiter une œuvre, c’est aussi revisiter l’Histoire de l’Art et réfléchir au rôle de l’artiste dans la société de son époque. De nombreux artistes participant à cette initiative ont évolué du figuratif vers l’abstraction ou le conceptuel, tout en abordant l’œuvre de Cot avec respect, et en l’ancrant dans les questions contemporaines mais déjà rencontrées dans le passé. Comme il l’est spécifié, l’art contemporain peut parfois déstabiliser, et certains visiteurs pourraient être surpris par ces interprétations modernes de l’artiste. Mais cette démarche est aussi une manière de s’approprier l’œuvre pour n’en retenir que l’essentiel, ce que chaque artiste a fait avec sa manière de percevoir les tableaux de Cot.
Un petit clin d'œil à David Beckham, qui, en arborant fièrement deux tableaux de Cot tatoués sur ses mollets, a permis à l’artiste bédaricien de conquérir des millions de fans de foot – et d’autres, probablement moins habitués des musées, mais tout aussi impressionnés par ses muscles !
Atelier d’Art Nicolas Bexon (Bédarieux), © Pauline Mabrut
La revitalisation des petites villes rurales est essentielle et à encourager. Bédarieux, avec Pierre Auguste Cot, dispose d’un héritage artistique précieux mais longtemps sous-exploité. Comme le souligne une commerçante qui a participé au jeu de piste “à la recherche des œuvres de Cot” en parallèle de l’exposition, pour beaucoup d’habitants, Cot n’était jusqu’à récemment que le nom de la place ou de l’arrêt de bus. Son œuvre restait largement méconnue car peu mise en avant par la ville. Pourtant, grâce à des expositions et des actions culturelles ambitieuses, Bédarieux exploite davantage ce patrimoine et l’affiche en tant que fierté. Ces initiatives permettent non seulement de reconnecter les habitants à leur histoire, mais aussi de dynamiser la ville, de s’ouvrir à la culture et d’attirer un nouveau public. Chaque commune, lorsqu’elle dispose d’un artiste local ou d’une richesse patrimoniale, peut saisir cette opportunité pour se dynamiser. L’art a ce pouvoir de transformer les territoires en leur redonnant vie et cohésion.
Pauline Mabrut
Pour aller plus loin :
Extrait du journal municipal de décembre 2024, Bédarieux :
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/Journal-Municipal/2024/12/Journal-municipal-Decembre-2024-Webpdf.pdf
Dossier de Presse de l’Exposition :
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/Presse/2024/11/Dossier-de-presse-Exposition-PA-COTpdf.pdf
A propos de Cot, Association Résurgences, Bédarieux :
https://resurgences.weebly.com/pierre-auguste-cot.html
Autres actions culturelles en lien avec la thématique :
Du 21 au 30 novembre : jeu de piste à la recherche des œuvres de Cot à travers les différents commerces de la ville, permettant de gagner des bons d’achat et des places de cinéma.
Le vendredi 27 décembre à 18h30 : Conférence "Pierre Auguste Cot, le bédaricien" par l'association Résurgences, à l'Espace d'Art Contemporain.
Le vendredi 3 janvier à 18h30 : Concert d'orgue par Marc Chiron, à l'église Saint-Louis (hommage et improvisations sur des tableaux de Cot, en écho à l’exposition Pierre Auguste-Cot - La Collection).
Le samedi 11 janvier à 18h30 : Conférence "La restauration du Prométhée Enchaîné" par Roos Campman, à l'Espace d'Art Contemporain.
Autres expositions en lien avec la thématique :
Barbara Chase-Riboud : Quand un nœud est dénoué, un dieu est libéré
“Jusqu'en janvier 2025, huit grands musées parisiens honorent l'artiste américaine Barbara Chase-Riboud. L'exposition présente une quarantaine d'œuvres de bronze et de soie, explorant des thèmes tels que l'histoire culturelle et la représentation des femmes.” - Ville de Paris
Louvre Couture, objets d’art, objets de mode
“Du 24 janvier au 21 juillet 2025, le Musée du Louvre à Paris propose une exposition explorant les liens entre les chefs-d’œuvre de ses collections et des pièces de mode créées par de grands noms du milieu. Cette mise en miroir souligne l'influence des arts sur la création textile, avec une attention particulière aux représentations féminines.” - Toute l’Europe
#PierreAugusteCot #CotRevisité #Bédarieux #Revisit

Vivre la mémoire au musée
« Résister, c’est accepter de vivre dans l’illégalité et apprendre en conséquence à déjouer de multiples dangers. » Extrait du panneau « Contourner le danger » de l’exposition permanente du CHRD de Lyon.

Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation - © Pierre Verrier/Ellipse bois
Un lieu de mémoire
Après cette salle introductive, le visiteur est plongé dans la période d’entre-deux guerres et chemine progressivement jusque vers la seconde guerre mondiale. Des témoignages audiovisuels, des objets de collection et des photographies complètent le récit. La déambulation se veut rythmée par les nombreuses pièces et obstacles visuels dans l’espace. Le champ visuel réduit, hors du temps et sans savoir où il va et pour combien de temps, le visiteur avance comme si l’intention scénographique était de le projeter dans les conditions imprécises dans lesquelles était la population en temps de guerre.
Au cœur de l’exposition, la résistance est abordée sous de multiples facettes comme : l’unification des mouvements de résistance avec la création de la CNR (Conseil National de la Résistance) par l’homme politique et résistant Jean Moulin, les actions menées et les risques encourus, la naissance des journaux clandestins, mais aussi les forces de répression tels que la gestapo et le MNAT (Mouvement national anti-terroriste, officine lyonnaise de la Gestapo), les tentatives pour discréditer la Résistance par l’occupant. S’ensuit l’histoire de la Shoah et les conditions de vie des déportés dans les camps. Des témoignages des victimes et des objets immergent un peu plus le visiteur dans ce tragique épisode de l’Histoire.
Un constat : la densité des textes a tendance à décourager, même si la hiérarchisation et les niveaux de lecture permettent une visite plus ou moins détaillée. Les quelques visuels dans des couloirs étroits sont malheureusement peu visibles. C’est pourquoi, après un espace dédié à l’hommage aux victimes, des salles immersives reposent le visiteur qui se réapproprie plus librement la thématique du lieu, et la vit par les sens. Ces salles aux décors réalistes évoquent les « années noires » de la ville de Lyon pendant l’Occupation. Elles permettent d’appréhender différemment le rapport à l’opinion publique et à la diffusion de l’information durant cette période.

© B. Rieger/hemis.fr
Un musée de vie
C.D.
#CHRDLyon
#mémoire
#transmission
#résistance

Vodou, vous ne croyez pas si bien dire...
Donner la parole aux initiés
Faire tomber les clichés associés au vodou* et révéler cequ'est réellement cette religion, tels sont les objectifs de l'exposition Vodou, présentée du 15 novembre 2012 au 23 février 2014 au musée Canadien de l'Histoire (anciennement musée Canadien des Civilisations)de Gatineau, au Québec). L'exposition a été réalisée en partenariat avec la Fondation pour la préservation, la valorisation et la production d’œuvres culturelles haïtiennes (FPVPOCH). L'exposition Vodou vise donc d'abord à déconstruire la conception européenne et stéréotypée de cette croyance, puis à présenter notre point du vue à nous, adeptes du vodouhaïtien. Car voyez-vous, la « vérité » est principalement rétablie en donnant la parole aux initiés de cette religion. Apprêtez-vous à laisser vos préjugés derrière vous et à découvrir une réalité méconnue du commun des mortels !
Des clichés qui collent à la peau
Vue générale d'une salle de l'exposition (deuxième partie) Crédits :Diane Westphal
La première partie de l'exposition dresse un rapide historique du vodou haïtien et l'origine des préjugés qui lui sont associés. Le vodou est une religion syncrétique, issue des traditions spirituelles des esclaves africains et autochtones (caribéens). Saviez-vous, cher visiteur, que sa pratique a été longtemps interdite, et que les vodouisants ont été persécutés ? Le vodou est officiellement reconnu en Haïti en 2003. Bien entendu, une pratique clandestine existait avant cette reconnaissance. Cette pratique était très mal vue des Européens justement en raison de son caractère secret. C'est ainsi qu'une vision « barbare » et réductrice de notre croyance fut diffusée par les médias de masse, notamment américains, qui contribuèrent largement à forger les stéréotypes du vodou. L'exemple le plus connu est certainement la poupée fichée d'épingles. Or, il est possible que cette image vienne en réalité de certaines pratiques de l'Afrique de l'ouest (notamment du Congo). Dans cette région, des statues de bois à taille variable, à figure humaine ou animale et plantée de clous, servent d'intermédiaires entre le monde des vivants et celui des morts. Par le biais de ces objets appelées Nkisin'Konde, les vivants sollicitent l'aide des ancêtres afin de résoudre les problèmes de la communauté. Chaque clou représente une demande particulière et les statues étaient manipulées par un sorcier. Ça vous en bouche un coin, non ?
Des vertus curatives
Vue d'une salle avec "poupées" vodou grandeur nature (deuxième partie) Crédits : Diane Westphal
Dans la deuxième partie de l'exposition, le vodou vous est présenté par ses adeptes. Vous serez étonnés de découvrir que cette religion a principalement des fonctions thérapeutiques. Voyez-vous, pour nous, les maux physiques et psychiques d'une personne ou d'une communauté sont les signes d'équilibre du monde rompu. Afin de rétablir cet équilibre, nous faisons appel à des puissances surnaturelles, des esprits possédant des pouvoirs particuliers, les lwa,afin de se concilier leur aide.La possession représente le moyen privilégié de communication avec les esprits. L'assistance des lwa est sollicitée lors de rituels, durant lesquels nous leur adressons des offrandes. La pratique collective est importante dans le vodou. Cependant, chaque vodouisant a également un rapport très personnel à sa religion. Vous pouvez vous en rendre compte par les nombreux témoignages d'initiés que nous présentons sur des bornes vidéos. Les adeptes relatent leurs expériences cérémonielles, leur conception du vodou et les raisons qui les ont amenés à cette croyance. Concernant la scénographie, nous avons choisi une ambiance relativement immersive. Nous voulons en effet vous amener à être au plus proche de la religion vodou. Nous avons donc choisi de projeter dans une des deux salles un film montrant un rituel. Nous avons également recherché une certaine proximité entre le visiteur et les objets. De nombreux artefacts cérémoniels, tel des ex-votos, des offrandes et des reconstitutions d'autels sont en effet disposés sur des plates-formes basses, sans vitrine (vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'y a aucune vitrine dans l'exposition). La mise à distance est simplement créée par la présence de piquets entre les objets et l'espace de déambulation.
Alors ?
Autel vodou. Crédits : Diane Westphal
La troisième partie de l'exposition vous est exclusivement dédiée, cher visiteur. Dans cet espace, nous vous invitons en effet à donner votre avis sur l'exposition. Pour cela, vous pouvez vous exprimer oralement et être filmé dans l'espace d'une petite alcôve. Votre témoignage sera par la suite transmis automatiquement sur des postes informatiques, à partir desquels les autres visiteurs pourront voir et écouter les expériences de visite de ceux qui ont laissé un commentaire.
La visite s'arrête ici. Nous espérons que vous ayez passé un agréable moment de découverte. Nous espérons que cette exposition vous auras appris la réalité sur la religion vodou. Qu'elle n'inflige pas le mal, mais au contraire, sert à soigner les maux des personnes et de la société.
*vodou : orthographe créole, qui tend à supplanter l'orthographe européenne « vaudou »
Pour en savoir plus :

Voyage au temps… des Highlanders
Aujourd’hui, nous allons parler du centre d’interprétation de Culloden !... Comment ça vous ne connaissez pas ? Et si je vous dis « Outlander » ? Ah déjà, c’est plus parlant. Commençons donc par là. Outlander est une série américaine, adaptation des romans Le Chardon et le Tartan. L’intrigue prend place dans les Highlands de 1743, en proie au conflit entre le gouvernement britannique et les Jacobites, rebelles écossais des Highlands. Le dénouement ultime de cette confrontation aura lieu sur le champ de bataille de Culloden, le 16 avril 1746…

Jamie Fraser de la série Outlander. Crédit : Outlander © 2017 Starz Entertainment, LLC
En route vers Culloden

Pierre tombale au nom du clan Fraser. Crédit : Diane Nicholson @Outlanderpastlives
Entre émotion et immersion

Reconstitution de la bataille du Culloden. Crédit : Culloden Visitor Centre

Démonstration de l'utilisation d'un mousquet. Crédit : Culloden Visitor Centre

Carte animée de la bataille de Culloden. Crédit : Culloden Visitor Centre
Laurie Crozet
#highlanders
#outlander
#écosse
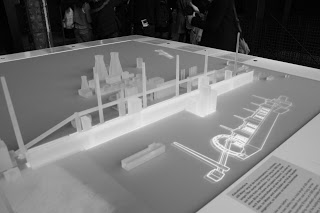
Zollverein, au fil du charbon
A l'Ouest de l'Allemagne, la Ruhr est le plus grand bassin industriel d'Europe de l'Ouest. Depuis la Révolution industrielle qui s'est déroulée à partir du XIXèmesiècle, cette région est devenue une aire de peuplement très importante. Principalement composée d'industries lourdes exploitant le coke ou le charbon elle est le siège de grands groupes industriels. En ces temps de désindustrialisation, nombreux sont les sites aujourd'hui à l'abandon, sinistrés. C'est à Essen que nous nous rendons pour visiter un de ces sites qui a su se reconvertir : le complexe industriel de la mine de Zollverein. La première mine de Zollverein est apparue en 1847. Dès lors, l'exploitation du sol sera incessante. Durant plusieurs décennies le site de Zollverein est le plus important site minier d'Allemagne. Sa politique productiviste et ses lourdes infrastructures lui valent une renommée qui s'étend à l'Europe toute entière. L'activité minière s'arrête définitivement en 1986 et le site ferme en 1993. En 2001 le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Maquette du site Crédits : T.L
C'est donc dans un parcours à la frontière entre visite guidée et parcours d'interprétation que nous nous lançons pour découvrir ce complexe industriel. Le site peut se visiter librement si l'on ne compte pas rentrer dans les bâtiments mais il devient indispensable d'être accompagné pour en voir davantage. Le guide, en plus de proposer une visite classique, permet au visiteur de découvrir le complexe minier de l'intérieur. La visite commence par la découverte du site tout entier via une carte interactive en 3D. Chaque zone clé est détaillée et permet de se rendre compte de l'étendue du complexe. S'en suit, dans la cour de l'usine, d'une rapide chronologie qui situe la mine de Zollverein dans le temps, de sa création à l'arrivée de la mécanisation. Une brève histoire de l'industrie allemande permet de situer l'endroit dans une dynamique qui, à l'époque, entraînera la création de nombreux sites comme celui-ci. Car s'il est exceptionnel, notamment par sa taille et sa productivité, le site de Zollverein n'était pas le seul de la sorte dans la région de la Ruhr; il s'inscrit dans un mouvement intense d'industrialisation. S'il est bien difficile d'embrasser d'un seul coup d’œil l'étendue du site, un passage sur des passerelles à plusieurs mètres du sol permet au moins d'en imaginer les contours.
Vue sur le chevalement Crédits : T.L
Vient ce qui va constituer la majeure partie du parcours : la découverte des différents bâtiments de l'exploitation du charbon. Ce parcours ne fait pas état de l'autre activité de Zollverein qui est la transformation de charbon en coke. Les premiers instants sont impressionnants : les bâtiments sont très sombres, encombrés malgré leurs dimensions et froids. L'immersion est totale. L'aménagement des lieux est minimal, ce qui renforce ce sentiment que l'usine, malgré son air sinistre, va reprendre vie d'une minute à l'autre. Aménagement qui, malheureusement, n'est pas régi par des principes d'accessibilité. Le parcours est jalonné de dispositifs ingénieux qui permettent une recontextualisation fidèle : comme ce son assourdissant des berlines qui déversent le charbon, diffusé dans une partie de l'usine. Plus qu'une dimension spectaculaire cet outil permet de mieux comprendre les conditions de travail des mineurs. Le parcours va suivre naturellement le cheminement du charbon, de sa remontée à la surface jusqu'à la séparation du « bon » et du «mauvais» produit. De ce fait, l'accent est mis sur l'aspect technique de la mine. Chaque étape est clairement expliquée et détaillée par les maquettes, les animations vidéos, le tout complété par des anecdotes du guide. C'est peut être là le principal écueil : en voulant mettre l'accent sur le côté technique de la production, on en vient à complétement occulter un élément pourtant clé, l'humain. Bien entendu les conditions de travail, pénibles, sont abordées. Mais de façon rapide et on ne reviendra que trop peu sur les ouvriers qui sont pourtant le moteur de cette production massive dont pouvait se vanter Zollverein. Il est bien sûr que les dimensions incroyables des bâtiments et des machines amènent naturellement à tenir discours plus technique, mais il est regrettable que cela se fasse au détriment d'un pan entier de l'histoire de l'usine. Car ce n'est pas que les ouvriers qui sont oubliés mais aussi, par extension, leur savoir-faire et leurs conditions de vie.
En définitive, si ce parcours ne peut être exhaustif il permet de prendre la mesure de ce que pouvait être un complexe industriel de la Ruhr. Le portrait se veut juste et sans trop d'artifices, authentique. Soulignons également le renouveau que cela a apporté à un site sinistré comme celui-là. En plus des bâtiments visitables le site de Zollverein propose une offre culturelle très riche : musée de la Ruhr, centre de chorégraphie, école de design, etc.
Thibault Leonardis






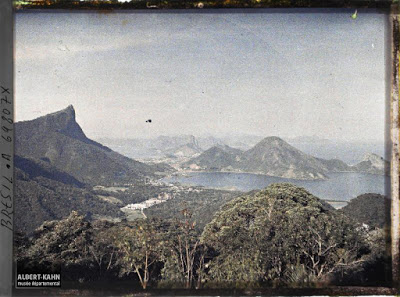
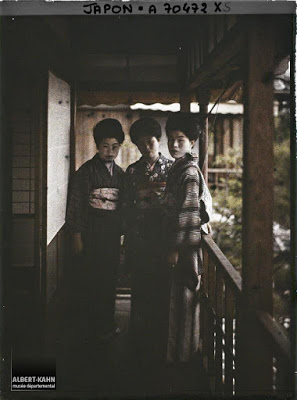
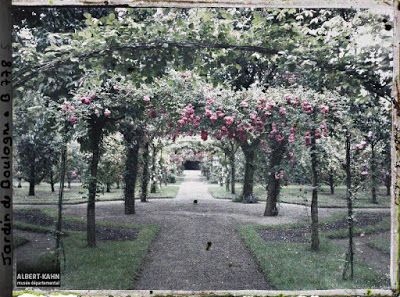














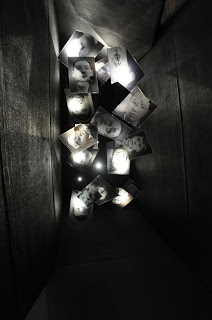
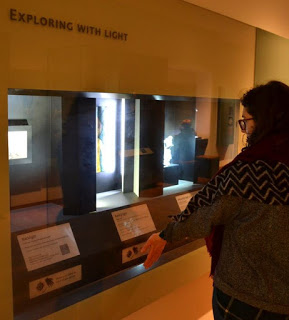

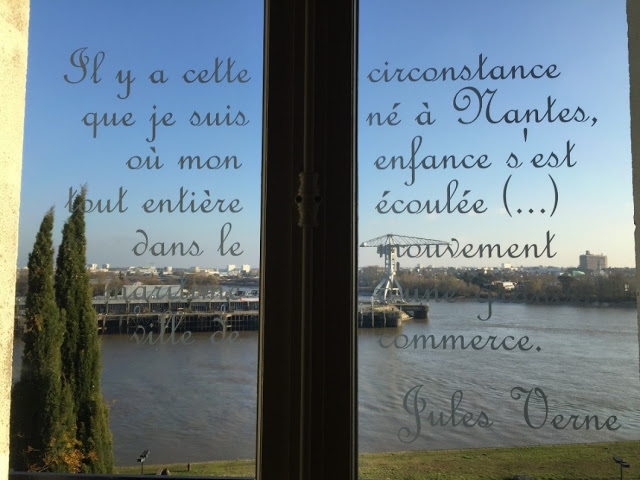
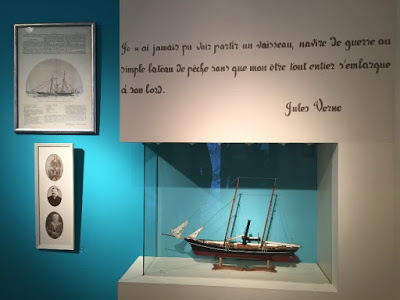





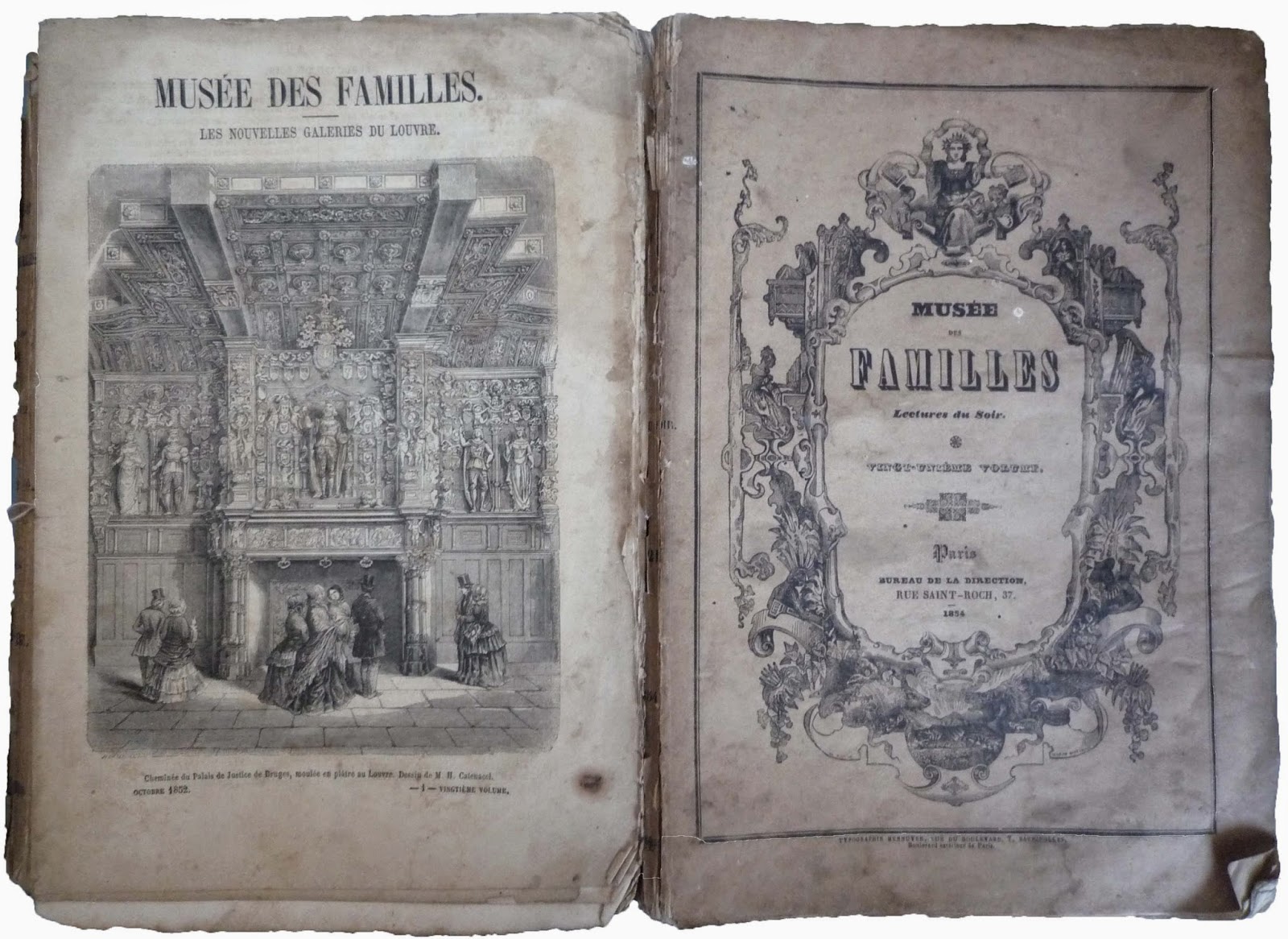
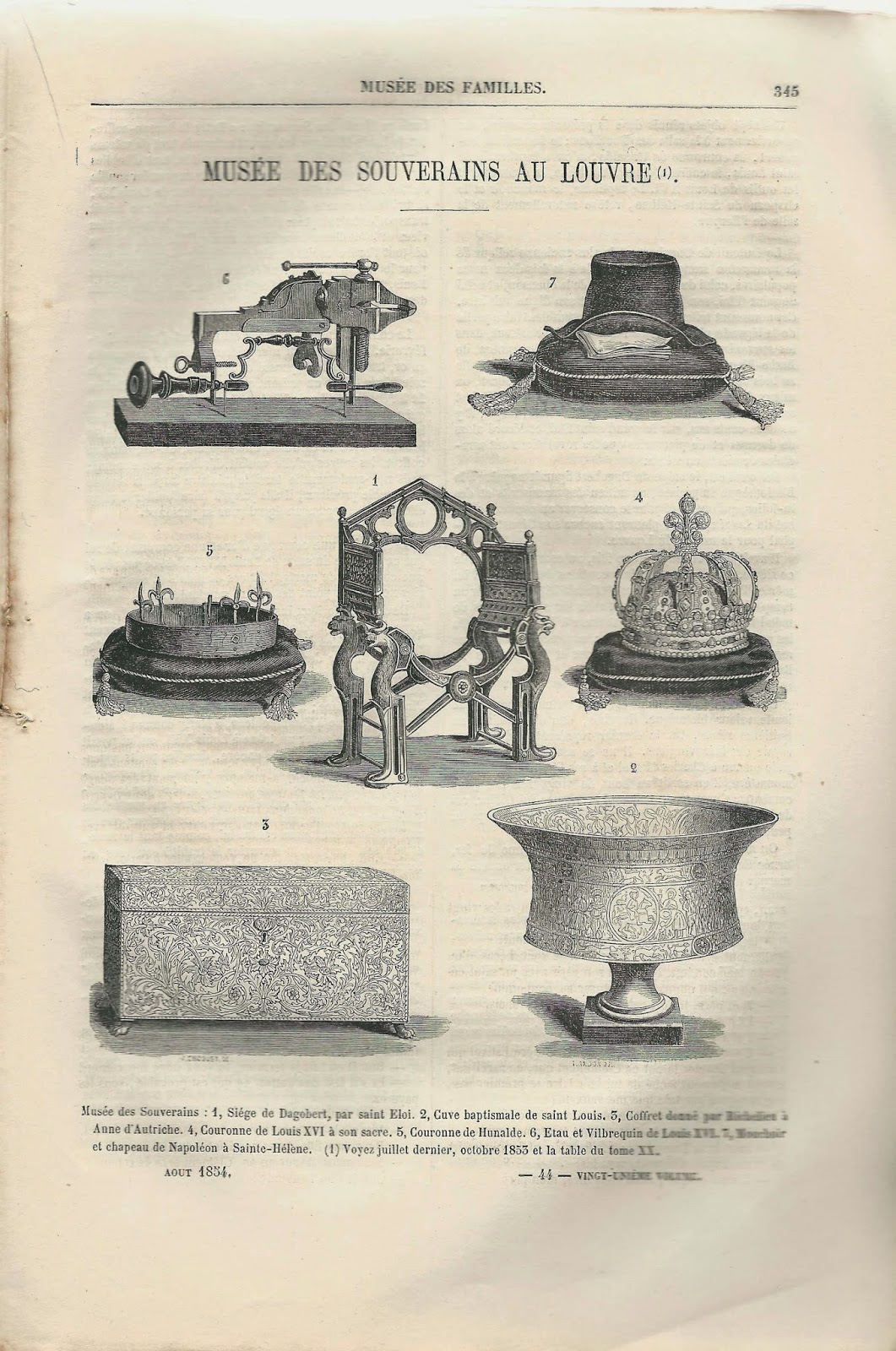







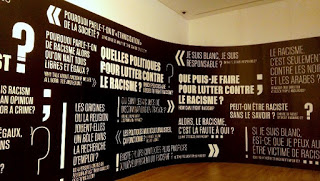






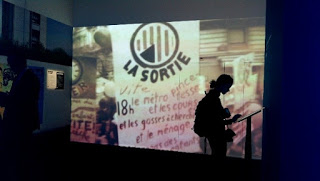

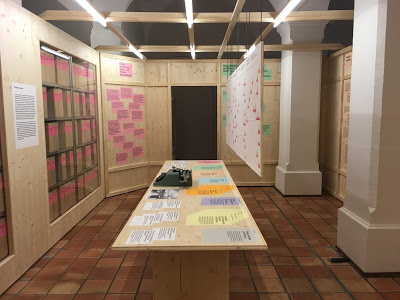
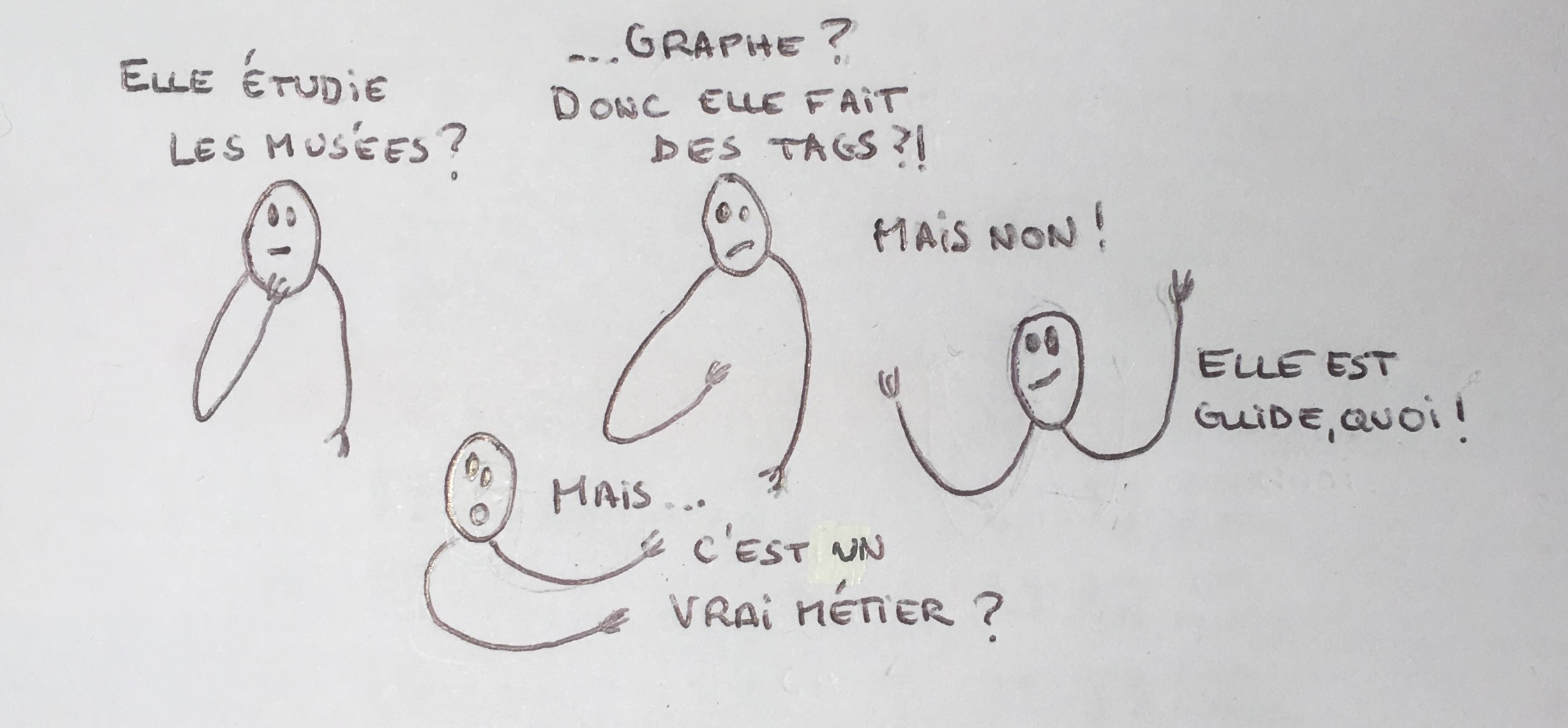

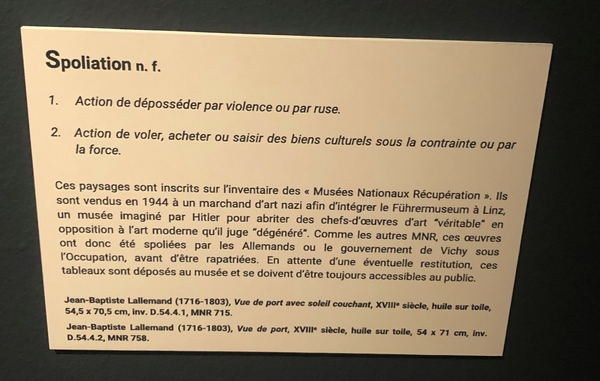
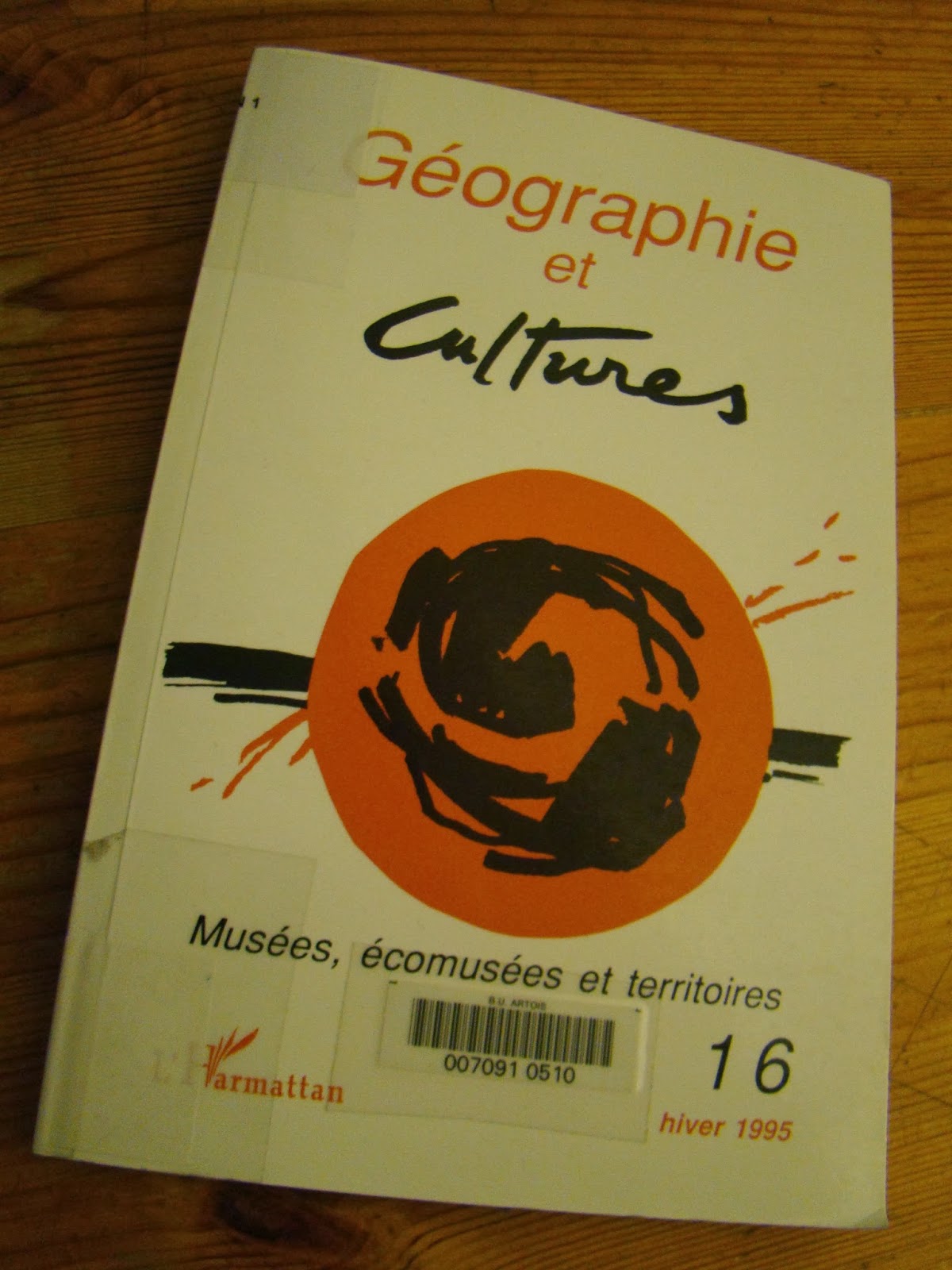
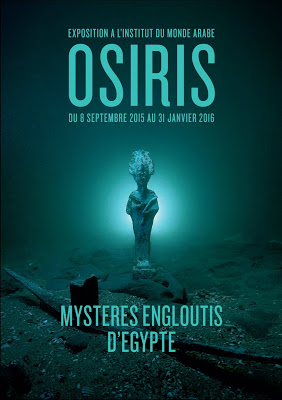
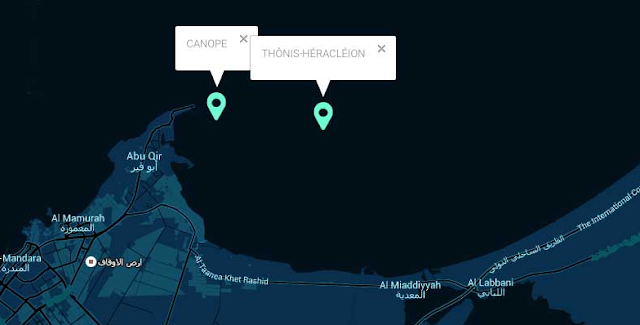






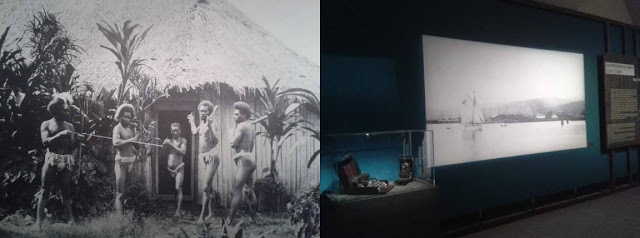


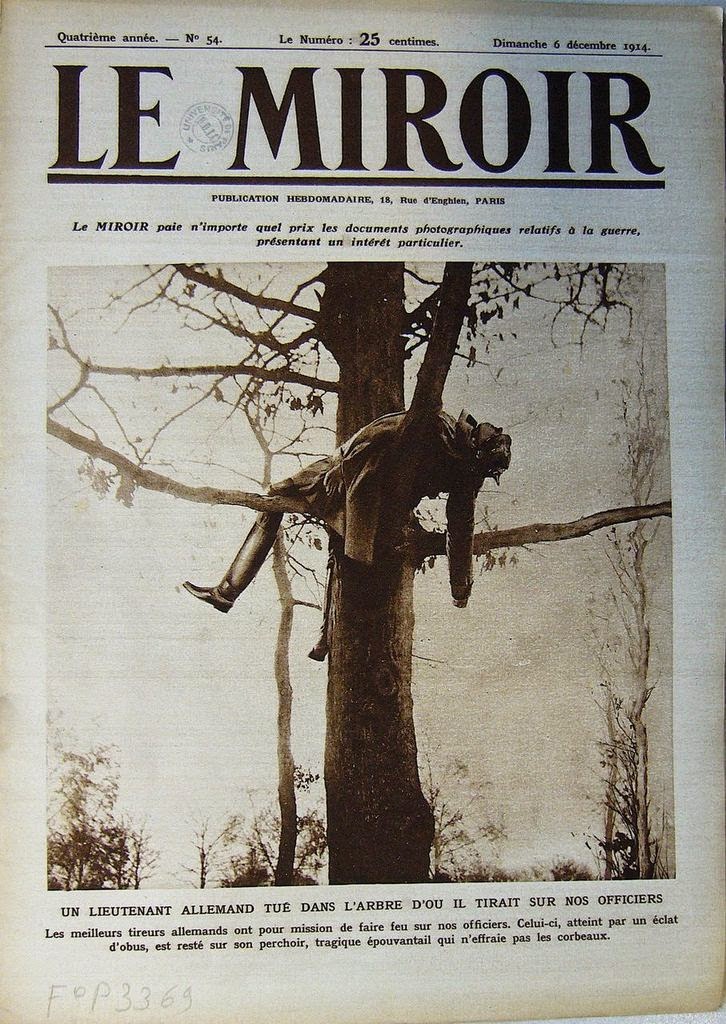




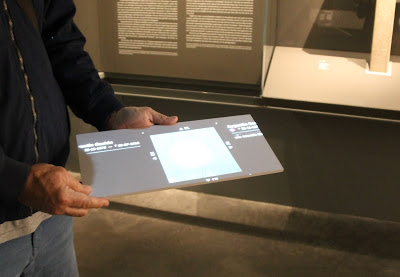

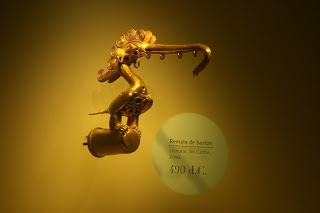

















.jpg)