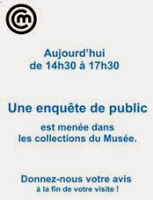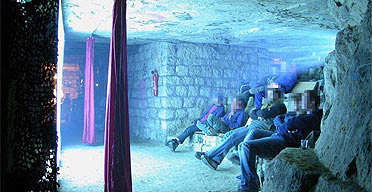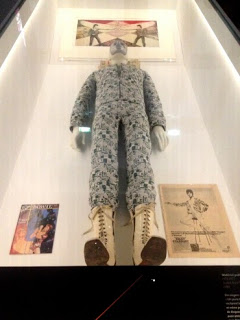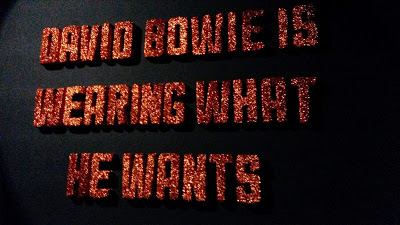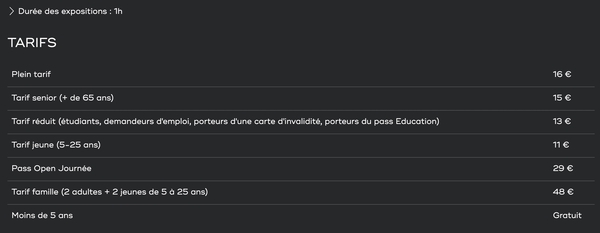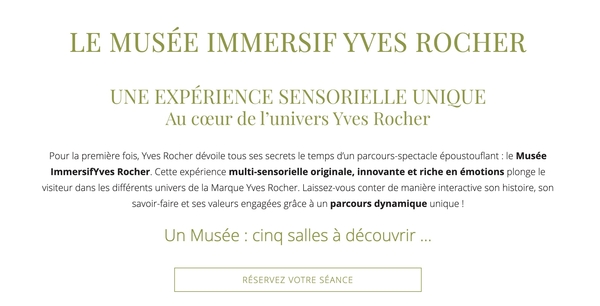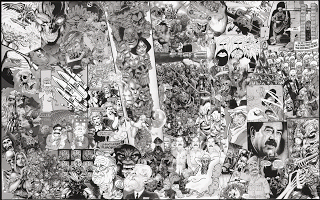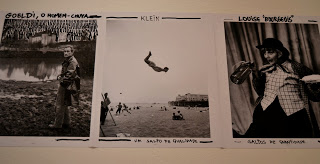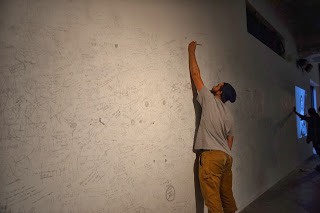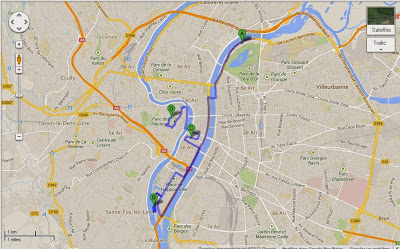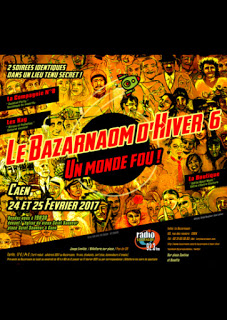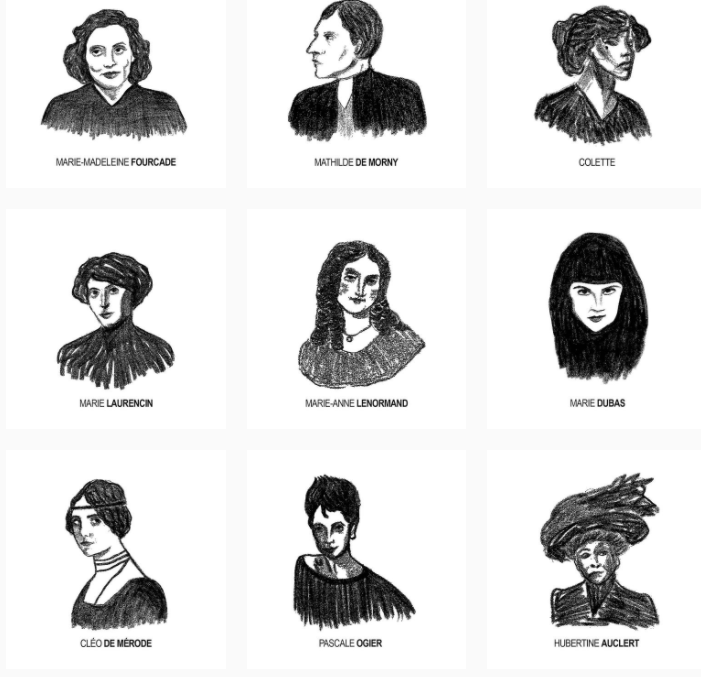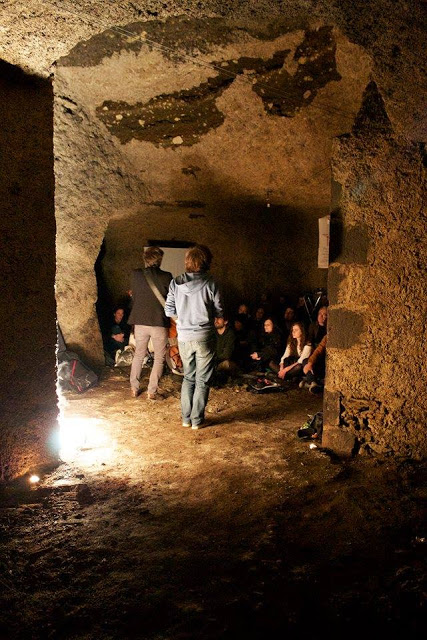Arts vivants - Arts du spectacle - Musique

"Suis moi !", cheminer à l'Historium de Bruges
L’Historium de Bruges guide ses visiteurs pendantune heure dans les dédales de la Bruges médiévale. Cela suit l’histoire d’unjeune apprenti du peintre Van Eyck qui doit aller chercher une jeune femme etun perroquet vert pour le dernier tableau de son maître. L’histoire, pleine depéripéties, est racontée en séquences qui intègrent, chacune, une vidéo et unereconstitution physique des lieux de l’action.
Séquence dans l’atelier de van Eyck @Trip Advisor
L’Historium est un projet qui met en collaborationdes familles nanties de Flandre occidentale, une brasserie, la BNP ParibasFortis et le gouvernement flamand. Il a ouvert en 2012 avec un objectif derentabilité élevée envers ses investisseurs. Cela explique en partie le prix dubillet (12 euros) mais aussi la nécessité d’accueillir toujours plus devisiteurs. Comment, dans ce cas,atténuer l’effet de « foule » ? Comment faire croire au visiteurqu’il est le seul ici, ou presque ?
Cheminer en groupe
La solution est une histoire de flux : l’Historiuma choisi de segmenter les flux de visiteurs en petits groupes qui se suiventmais ne se voient ni ne se croisent ! Chaque groupe vit l’expérienceindépendamment. Pour ce faire, les créateurs de ce système se sont inspirés desattractions touristiques : pensez aux longues files qui sont ensuiteséparés en petits groupes pour rentrer dans la maison hantée ou le petit train.Une fois séparés, les visiteurs sont guidés dans un cheminement précis.
Suivre
Ce cheminement est visible au sol par des traces depas blanches. Ces traces, comme autant de petits cailloux blancs nous indiquentpar où se fera la sortie dans chaque salle. Il n’y a qu’un parcours possibleparmi ces salles. Par contre à l’intérieur des salles les déplacements sonttrès différents. La reconstitution et la vidéo s’accordent de manière variée :
- Dans une salle ronde avec des voutes la reconstitution conduit à tourner autour du pilier central, découvrant la vidéosur plusieurs petits écrans comme autant de fenêtres sur les murs.
- Dans un espace en couloir représentant le marché, la vidéo est le long du mur, comme si le visiteur regardait la scène par la fenêtre d’une maison, depuis la rue.
- A un autre endroit, il faut lever les yeux quand, en haut d’un escalier, une porte s’ouvre qui révèle sur un écran une autre pièce, l’atelier du peintre, où se déroule la scène.
- Enfin, pour une scène de repas, le visiteur entre dans une pièce sombre et l’écran est inséré dans une grande table centrale. La scène est filmée en plongée ce qui donne vraiment l’impression deregarder la vidéo par-dessus l’épaules des personnages.

La pièce reconstituée : Atelier du peintre @Historium
Afin de ne pas perdre le spectateur et de rythmer son parcours, l’audioguide qui diffuse le son de la vidéo intègre des consignes « dissimulées » : l’apprenti nous dit « viens, suis-moi », « allons vers le marché » ou encore « il fauts e dépêcher ! ».
Déambuler dans les coulisses
Après l’histoire de Jacob, l’apprenti de Van Eyck, et sa folle journée à travers Bruges, le visiteur entre dans un espace d’exposition plus classique. Il y trouve des informations scientifiques et historiques sur la Bruges médiévale avec des cartels, des manipulations et des tests sur des écrans interactifs.
Dans cet espace où le temps n’est pas compté, ladéambulation est laissée libre. C’est un espace de « coulisses »après la représentation. C’est aussi là qu’est, d’ailleurs, présenté un making of du film. Les audioguides nepassent plus automatiquement d’une piste à l’autre : il faut taper desnuméros pour déclencher un commentaire.
Visiter sans bouger
Point d’orgue de ce cheminement, l’Historium nous propose un voyage immobile. En effet, après la visite, ceux qui le souhaitent peuvent expérimenter 10 minutes d’immersion totale dans un monde virtuel reconstituant la ville au Moyen Âge. Nos yeux et nos oreilles sont monopoliséspar un masque (l’oculus rift) et un casque. L’expérience est très réussie : nous sommes libres de bouger la tête et découvrons la reconstitution non seulement à 360° mais aussi au-dessus et au-dessous de nous. Pour plus de mouvement, nous sommes placés dans une barque qui avance. L’arrivée aux portes de la ville est spectaculaire !
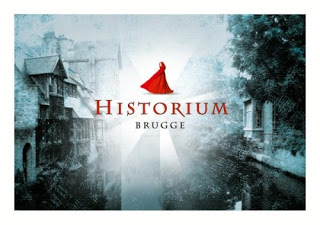
Logo de l’Historium @Historium
En liberté conditionnelle ?
Au terme de ce voyage je m’interroge : ai-je été l’otage consentant du cheminement chuchoté par l’Historium ? Je n’avais la plupart du temps ni le choix de mon parcours ni celui de mon rythme (la petite salle d’exposition mise à part). Pourtant la sensation est plutôt celle d’avoir été une invitée privilégiée de ce voyage où tout s’est accompli pour mes yeux uniquement, ou presque.
Après réflexion, je pense identifier deux ficelles à ce tour de magie : le conte et la nouveauté.
- Personne ne se lasse des histoires qui, depuis notre enfance, nous tiennent en haleine jusqu’à leur résolution. Suivre Jacob est facile quand il nous raconte son histoire : nous retrouvons les repères familiers que sont les différents personnages, l’unité relative de lieu, un début et une fin (de fait « Jacob et Anna vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ».).
- La nouveauté et la découverte renforcent l’estime du visiteur valorisé par la technologie développée pour lui et les surprises qu’elle réserve, de l’oculus rift à la curiosité de savoir où sera l’écran dans la prochaine salle ? Y aura-t-il encore de la neige qui tombe du toit ? etc.
Le gout de l’innovation : on ne se voit pas mouton parce qu’on découvre. Soit découvrir la technologie soit découvrir la salle avec ses sons, ses bruits, ses décors, son film.
PS : Je ne résiste pas à vous dire que, selon le site internet de l’Historium, durant la première journée de tournage les deux bébés acteurs ont fait pipi sur la cape de l’héroïne, Anna, à huit reprises.
#Bruges
#Voyage
#Historium
Pour en savoir plus : https://www.historium.be/fr

« Touchez la musique ! » Lancez vous dans le parcours du Musée de la musique
Depuis juin 2013, le Musée de la musique de Paris propose à tous ses visiteurs en visite libre un nouveau parcours d'exploration des instruments de la collection permanente par une approche multi sensorielle. Le Parcours « Touchez la musique ! » (TLM) s'inscrit dans une démarche de mixité et d'accessibilité en offrant aux personnes valides et à tous les visiteurs en situation de handicap, des moyensde médiation adaptés. Inscrit dans la continuité d'un premier projet mis en place en 2009, le parcours TLM est spécifiquement dédié au public déficient visuel avec des plans et dessins en relief tactiles.
Module de la viole
Crédits : A.D
A vos sens !

Prêts pour l'égal accès de tous à laculture
Extrait du film pédagogique du module de l'orgue
© Citéde la musique
Poursuivez jusqu'à l'étage Le XVIIIe siècle : La musique des Lumières, vous arriverez au module de l'orgue. Ici l'espace interactif implique une activité d'écoute, le visiteur mal entendant peut brancher une bouclemagnétique portativepermettant d'amplifier le son. Le plateau est rétroéclairé en braille et en relief. Par ailleurs, l'écran est particulièrement accessible aux publics sourds et aux personnes en situation de handicap mental, le film est en Langue des Signes Française (LSF), est sous-titré et l'audioguide fournit de l'audiodescription (voix-off).
Module de la trompette
Crédits : A.D
Ensuite, montez quelques marches ou prenez l'ascenseur, vous arriverez à l'étage Le XIXe siècle : l'Europe Romantique. L'occasion de voir et/ou de sentirdes circuits d’air vibrants en fonction des pistons de la trompette exposée que vous aurez activés. Vous remarquerez aussi que tous les modules sont constitués d'une planche rétro-éclairée. Cette innovation permet d’apporter une meilleure diffusion de la lumière essentielle au public déficient visuel.
La découverte de quelques instruments dans un parcours tel que celui-ci correspond à un moyen de répondre à la loi de 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». En effet, celle-ci prévoit, outre que les institutions publiques soient accessibles physiquement à tous, que les contenus des expositions le soient également. Les musées quels qu'ils soient (d'histoire, de sciences, d'archéologie, de Beaux-arts) sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à proposer des plans tactiles, textes en braille, audioguides avec audiodescriptions, etc. ; qui sont autant de dispositifs à utiliser en visite autonome. Cependant il reste du chemin à parcourir, les dispositifs sont encore épars et tous les handicaps ne sont pas pris en compte au sein d'un même espace. En testant le parcours vous pourrez remarquer la spécificité de celui-ci, qui réside dans la combinaison de divers dispositifs faisant appel à vos sens tout en étant adaptés à plusieurs handicaps, pour être accessible à tout un chacun.
Partez explorer la conception concertée et innovante du parcours !
Module du theremin
© Citéde la musique
Poursuivez votre visite jusqu'à l'espace Le XXe siècle : l'accélération de l'histoire et jouez à l'un des plus anciens instruments de musique électronique : le theremin.
En donnant la possibilité à tous de « toucher la musique » par la mise à disposition d'instruments, d'objets à manipuler, le musée engage nécessairement un budget important. Compte-tenu des outils technologiques indispensables à la réussite du parcours, des partenaires financiers se sont associés au projet ; la Fondation Orange, le Fonds Handicap et Société.
Les films sur écrans encastrés dansla table des modules ont été réalisés grâce au mécénat exclusif de la FondationFrance Télévisions.
Par ailleurs la mise en place du parcours a nécessité des compétences variées. En effet, des exigences en termes de contenus(adaptés aux familles) mais aussi d'esthétisme(graphisme confié à Aurélie Pallard) combinées à une ergonomie adaptée aux personnes handicapées ont été prescrites lors de la conception. De plus, des matériaux résistants et durables ont été privilégiés. Une collaboration avec des personnes handicapées a bien évidemment été prévue lors de l'évaluation formative ainsi que pendant celle de remédiation.
C'est gagné ! Comment s'améliorer ?
Pour terminer votre parcours jouez de la sanza - instrument prenant la forme d'une petite boîte rectangulaire servant de caisse de résonance et muni d'un clavier de lamelles métalliques - à l'étage Les musiques du monde, seul ou en famille, avec un ami, puisque deux sanzas sont disposées sur le module. Avez-vous manquéce module comme bon nombre de visiteurs?
Affiche de l'enquête
Crédits : A.D
Une enquête menée entre octobre et décembre 2013 par le service culturel du Musée a permis une évaluation sommativedes dispositifs pour rendre compte de la visibilité des modules et des dysfonctionnements inhérents à leur utilisation (administration de questionnaires et observation « postée »). Les visiteurs se sont prêtés au jeu de questions-réponses, heureux de partager leur expérience de visite. Ainsi pour le module de la sanza, certains visiteurs passent à coté de ce module en raison de son isolement le long d'un mur. Ceux-ci ont été forces de propositions pour améliorer sa visibilité.
Les actions de la Cité de la musique en matière d'accessibilité ne se limitent pas à ce parcours. Elle s'efforce de rendre accessible l'ensemble de ses activités à tous les publics sans faire de distinction tant dans sa programmation que dans ses supports de communication. Le statut juridique de la structure, établissement public à caractère industriel et commercial (ÉPIC), placé sous tutelle du ministère de la Culture, justifie d'autant plus l'exigence d'une offre irréprochable, adaptée à tous.
À la lumière de l'étude de ces dispositifs et de rencontres de professionnels muséaux, nous retenons que s'adresser aux publics handicapés nécessite de travailler sur l’accessibilité à tous. Les parcours doivent être accessibles pour les personnes handicapées ainsi que leurs accompagnateurs ou pour d’autres publics. S'intéresser à l'accessibilité c'est ainsi trouver le juste équilibre pour que le musée soit une institution ouverte à tous.
Anaïs Dondez
Cité de la musique
Musée de la musique
221 Avenue Jean Jaurès, 75019Paris

(Museum) space is the place : L'afrofuturisme au musée
Image d'en-tête : Alisha B. Wormsley, There Are Black People In The Future, The Last Billboard, Pittsburg, PA, 2017. Reproduction. Courtesy of the artist. © Alisha B. Wormsley
En novembre 2021, le Metropolitan Museum dévoile au public sa nouvelle period room, consacrée à l'afrofuturisme. Ce mouvement artistique, littéraire et politique, né dans les années 1950 au sein de la communauté noire américaine, trouve peu à peu sa place dans les musées. Comment exposer cette mouvance pluridisciplinaire, qui entremêle histoire traumatique, présent douloureux et futur utopique.
Passé et présent de l'afrofuturisme
Sous le label El Saturn, le musicien de jazz expérimental Sun Ra et son Arkestra produisent des albums dont les titres font rêver à d'autres galaxies : The Nubians of Plutonia (1958-59), Interstellar Low Ways (1959-60)... Dans son film Space is the place ("C'est dans l'espace que tout se passe", 1974), le chanteur propose d'acheminer la communauté noire américaine vers une nouvelle planète. A sa suite, tous les genres musicaux nés de la culture africaine-américaine (funk, techno, rap...) font germer des imaginaires spatiaux et futuristes. Dans ses récits de science-fiction écrits dans les années 1970 et 1980, l'autrice noire américaine Octavia E. Butler s'attaquent à la "brimade de l'ordre (...) le début d'un comportement hiérarchique pouvant mener au racisme, au sexisme, à l'ethnocentrisme" (A World without Racism, 2001). Dans "Lost Races of Science Fiction" (revue Transmission, 1980), elle déplore la présence marginale de personnages racisés dans les récits de SF.
Les Etats-Unis sortent tout juste de décennies d'esclavage, puis de ségrégation. La communauté noire américaine ne se sent pas chez elle dans ce pays qui l'exploite, l'isole, la violente : elle rêve d'un ailleurs, spatial ou temporel. Par la projection imaginaire, des créateur.ice.s lui dessinent un destin plus heureux. La science-fiction permet également de formaliser par la mise en récit l'expérience de cette communauté, le sentiment d'aliénation (en anglais, le mot "alien" a gardé son sens d'"étranger"), et le trauma collectif de l'exil et de l'esclavage. Les enlèvements commis par des êtres extra-terrestres rappellent le rapt et la réduction en esclavage qu'ont subi des milliers d'Africain.e.s au 18ème siècle.
Ce mouvement, avant même d'être théorisé, se diffuse dans les arts visuels, le cinéma, la mode ou encore le design. Il trouve son nom en 1993 sous la plume du journaliste culturel Mark Dery, dans son anthologie Flame Wars, The Discourse of Cyberculture : "afrofuturisme". Il est, plus que jamais, au cœur de la vie culturelle contemporaine. Il règne sur la pop culture avec des œuvres comme Black Panther (deuxième film au box-office américain en 2018, année de sa sortie) ou la musique de Janelle Monae. Il accompagne le mouvement Black Lives Matter, qui milite contre les violences policières que subissent les Noir.e.s américain.e.s. Il inspire les artistes contemporain.e.s, comme le photographe Samuel Fosso ou l'artiste pluridisciplinaire Jessica Valoris. Et depuis 2015, il trouve sa place dans les salles des musées.

Alton Abraham, Sun Ra sur le tournage de Space is the Place, 1972.
Reproduction Courtesy of John Corbett and Terri Kapsalis © Adam Abraham
Conjuguer le musée au futur
Les musées qui s'emparent du thème de l'afrofuturisme se trouvent confrontés à plusieurs problématiques. Notamment : comment exposer un mouvement né il y a soixante ans, investi par les champs littéraires, musicaux, cinématographiques, picturaux, philosophiques et politiques ? L'afrofuturisme est d'abord utilisé comme thème pour lier le travail de plusieurs artistes. C'est le cas au Museum of Contemporary Photography de Chicago, avec son exposition In their own form (avril-juillet 2018). Le musée expose treize photographes qui explorent de près ou de loin le thème de l'afrofuturisme. Ces artistes sont africain.e.s et noir.e.s américain.e.s. : en effet, l'afrofuturisme se veut un mouvement transnational, investi par les artistes d'Afrique comme celleux issu.e.s de la diaspora. Il permet de créer ou de recréer une culture commune, un horizon partagé. En cela, il s'inscrit dans la lignée du panafricanisme, idéologie qui promeut une solidarité totale entre Africain.e.s et leurs descendant.e.s exilé.e.s.
L'Institute of Contemporary Art de Londres invite en 2019 le collectif américain Black Quantum Futurism et leur projet Temporal deprogramming, composé d'une installation, de concerts et de performances qui mettent en avant la dimension militante, et notamment féministe, de l'afrofuturisme. Le nom du projet annonce la couleur : il s'agit de dé-programmer le musée, de subvertir ses codes et ses traditions. Et de le faire non pas de manière temporaire (temporary) mais temporel (temporal), de repenser la notion même de temps au musée. Ne plus seulement conserver le passé pour l'avenir, mais imaginer le futur, s'y projeter. En cela, l'évènement rappelle l'action Mining the Museum de Fred Wilson, qui en 1992 investit les collections du Maryland History Society pour questionner la place de l'histoire et de la représentation des Noir.e.s dans les institutions muséales. Il dispose des chaînes d'esclave dans une vitrine de vaisselle en métal ouvragé, vide des piédestals de leur statue... En jouant avec le discours expographique, il force les musées à affronter leur passé et leur présent raciste. Les musées ethnographiques, enrichis d'objets spoliés, ont notamment participé à légitimer la colonisation. Exposer le thème de l'afrofuturisme amène à redéfinir qui a sa place au musée, et comment les institutions montrent celleux qui étaient considéré.e.s comme "l'autre". Ou comment elles choisissent de ne pas les montrer, mais de leur offrir un espace pour qu'iels s'expriment avec leur propre voix et leurs propres images.

Olalekan Jeyifous, Shanty Mega-structures: Makoko Canal, 2015. Reproduction.
Courtesy of the artist. © Olalekan Jeyifous
Retracer l'afrofuturisme
Il faut attendre 2021 pour qu'une exposition offre une vue globale de l'afrofuturisme. Mothership : Voyage into afrofuturism, visible à l'Oakland Museum of California jusqu'au 27 février 2022, revient sur les origines du mouvement, en éclaire les figures majeures, et montre la prégnance de ce thème dans le paysage contemporain. Sur le site internet du musée, les premières phrases témoignent d'une volonté de donner une appréciation globale du mouvement, et de le rendre accessible au grand public : "L'afrofuturisme comprend beaucoup de choses. C'est le passé, le présent, le futur réimaginés à travers une perspective culturelle noire." (Afrofuturism is a lot of things. It’s the past, present, and future reimagined through a Black cultural lens.). La formulation est simple, mais elle ouvre des perspectives immenses.
Octavia Butler y est mise à l'honneur : certains de ses manuscrits annotés sont exposés, et deux salles sont nommées par les titres de ses romans. Les visiteur.euse.s peuvent monter dans une réplique du Mothership, vaisseau spatial ayant servi d'accessoire de scène au groupe Parliament-Funkadelic dans les années 1970. Un costume du film Black Panther, crée par Ruth E. Carter, trône dans l'expositon, et montre bien au public que l'afrofuturisme fait partie de son paysage culturel. Oakland, ville à forte population noire et qui a vu naitre le Black Panther Party, parait un contexte plus qu'approprié pour cette exposition.

Alun Be, Potentiality, Edification Series, 2017. Reproduction. Courtesy of the artist. © Alun Be
S'envoler au Metropolitan Museum
Comme nous l'avons mentionné, le Metropolitan Museum de New-York n'a pas attendu longtemps pour monter à bord du vaisseau et installer l'afrofuturisme au sein de ses collections. Le 5 novembre 2021, le musée ouvre au public "Before Yesterday We Could Fly : an afrofuturist period room" ("Avant hier, nous savions voler : une period room afrofuturiste") . Les conservateur.ice.s à l'origine du projet, Sarah Lawrencen et Ian Alteveer, ont avancé l'idée qu'une period room est forcément une construction fictionnelle, et qu'elle peut donner lieu à des récits politiques, supports de dialogues et de changements sociaux. Ainsi, Before Yesterday We Could Fly ne cherche pas à reproduire un intérieur selon le style d'une époque, comme dans les period room traditionnelles, mais propose un futur alternatif. Les commissaires ont invité Hannah Beachler, cheffe décoratrice de Black Panther, et Michelle Commander du Schomburg Center for Research in Black Culture pour imaginer cet espace. Beachler et Commander se sont inspirées de l'histoire de Seneca, village construit à New-York au 19ème siècle par des descendant.e.s d'esclaves, et rasé pour laisser place à Central Park. Pour se poser la question suivante : si le village n'avait pas été détruit, à quoi ressemblerait-il aujourd'hui ?
La salle est donc occupée par une maisonnette réalisée d'après les résultats de fouilles archéologiques, décorée d'œuvres anciennes comme contemporaines, d'artistes africain.e.s et noir.e.s américain.e.s. L'intérieur de la maison ne s'observe d'abord qu'à travers des ouvertures dans les murs, puis par un côté vitré, pour transmettre l'idée que l'accès au passé ne se fait que par bribes, que chacun.e doit en reconstituer son propre récit. En proposant "le passé, le présent, le futur réimaginés à travers une perspective culturelle noire", le Met n'expose pas seulement un morceau d'histoire, mais créé une œuvre afrofuturiste. Before Yesterday We Could Fly est un outil de réflexion et de dialogue sur l'histoire des Etats-Unis, la colonisation, les rapports de domination, et le rôle que le musée peut jouer dans les débats sociaux actuels.
Depuis 2011, une réplique du Mothership est exposée au Smithsonian Museum of African American History and Culture. A l'occasion de son exposition en 2018, le Museum of Contemporary Photography de Chicago a acquis trois œuvres pour sa collection permanente. Contre-culture longtemps négligée, l'afrofuturisme est considéré à présent comme un fil rouge essentiel de l'histoire culturelle des communautés noires américaines, et de l'histoire globale de l'art. Le mouvement s'inscrit dans les collections des grands musées, et ainsi gagne en légitimité. Au détriment de sa dimension subversive ?
Barbara Goblot
Pour aller plus loin :
- L'article de Kodwo Eshun, "Further Considerations on Afrofuturism", publié dans The New Centennial Review (2003)
- Le podcast Afrofuturismes, de Sinatou Saka et Vladimir Cagnolari (2019)
- La visite virtuelle de "Before Yesterday We Could Fly ; an afrofuturistic period room" au Metropolitan Museum (2021)
- Une playlist afrofuturiste
#afrofuturisme #MetropolitanMuseum #artcontemporain
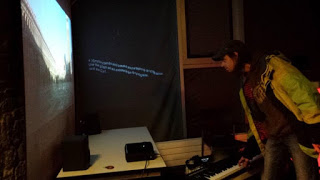
A la rencontre d'ingénieurs créatifs à la Casemate
Une bâtisse historiquement militaire a laissé place à l’ère du numérique, du fablab et de la convivialité. Je viens découvrir à la Casemate de Grenoble des installations pluridisciplinaires, sans idée préconçue ni connaissance des participants. Prêts pour une ascension à la fois technologique, artistique et scientifique ?
L’objectif de ma visite est avant tout d’apprécier et de découvrir les tendances permettant de relier les disciplines croisant l’art, la science et la technologie, autrement dit « AST ». Ce sigle correspond aussi à l’option en Master 2 Sciences cognitives à Grenoble, diplôme co-dirigé par Claude Cadoz et Jérôme Villeneuve. Pendant deux jours, une dizaine d’étudiants ingénieurs présentent le fruit de leur travail réalisé entre 2016 et début 2017.
Récit-fiction basé sur l’exposition « Intersections » à la Casemate.
Je quitte la lumière diurne pour pénétrer dans une galerie voûtée. De jeunes gens se croisent, échangent autour de différents pôles qui semblent ludiques et attractifs. J’entends, que dis-je je ressens les ondes sonores de toutes parts autour de moi. Plus j’avance, moins je comprends.
Un homme s’avance vers moi : « vous voulez essayer ? ». Il me montre du matériel informatique, sonore et visuel disposé sur le côté. Comme je lève les yeux, attirée par un grand écran sur le mur juste derrière moi, il me dit : « Ce sont des glitchs sur l’écran ». Mais enfin, dans quel monde ai-je mis les pieds ? Je tente une réponse : « Euh… tu veux dire Pitch ? »
Création « Le Langage des glitchs » de Jose Luis Puerto © H. Prigent
Entre temps, un jeune homme s’est installé devant le clavier et s’amuse déjà à produire des sons : la photo sur le grand écran change légèrement d’aspect, modifications qui peuvent paraître imperceptibles. L’étudiant-concepteur Jose Luis Puerto m’explique en même temps que je visualise les évolutions de la photo : « En fait, il existe des glitchs audio ou vidéo. Vous pouvez les voir sur l’écran, ce sont des dysfonctionnements informatiques et chacun peut les créer volontairement. Ce que je présente ici pourrait se retrouver ailleurs, pour envisager d’autres manières de communiquer et aller vers de l’inattendu. » A écouter cet étudiant-ingénieur, je me dis que son installation est certainement promise à des applications plus larges que ce que j’imaginais.
Est-ce que j’aime ou non cette proposition intitulée « Le langage des glitchs » ? Il s’agit surtout d’un ressenti, comme parfois face à une œuvre d’art dont je ne connaîtrais ni le contexte ni le courant artistique. Cette installation me paraît surprenante : la photo urbaine, les sons reliés de manière indéterminée au visuel, la médiation sur l’intention créative qui m’ouvre de nouvelles perspectives.
J’essaie quelques notes sur le clavier et je trouve une certaine satisfaction à interagir avec la photo dont certains pixels disparaissent, selon la touche sonore activée. Jusqu’à quel point cette proposition de communication pourrait être modifiée comme je le souhaiterais ? Ajouter une seconde personne et un second clavier ? Proposer une autre photo où l’apparition et la disparition des glitchs aurait une signification particulière ? Finalement « Le langage des glitchs » peut devenir source d’inspiration alors qu’au premier abord, il me paraissait si hermétique !
Je dois me ressaisir car le temps ici est compté. La salle de la Casemate fermera dans moins d’une heure et il me reste une dizaine d’œuvres à découvrir : j’en choisirai quelques-unes pour prendre le temps de les expérimenter. Je reprends ma déambulation guidée par les sons et les mouvements des visiteurs.
Je suis naturellement attirée par un petit groupe qui paraît danser et s’amuser devant des enceintes. Je ne peux m’approcher plus de l’installation sonore car tous restent à quelques mètres de distance, comme devant un spectacle invisible. Je m’arrête donc derrière un homme dont les bras se meuvent en l’air puis de chaque côté. Est-ce qu’il s’agit de chercher comment donner vie à une œuvre musicale plus ou moins perceptible ? Quelle idée enthousiasmante que de dessiner les harmonies et les rythmes dans l’espace !


Création « Musique en mouvement » de Simon Fargeot © H. Prigent
C’est tellement génial que plusieurs visiteurs attendent déjà leur tour pour tester cette proposition de Simon Fargeot : « Musique en mouvement ». Je prends plusieurs minutes à observer et apprécier le tempo. Quelques photos me permettront d’immortaliser les gestes tantôt spontanés du visiteur tantôt guidés par le concepteur amusé. Je continue mon parcours : d’autres bruitages me lancent des appels, sous d’autres voûtes aux éclairages incertains.
Je m’aventure à quelques pas de là, sans bien identifier la suite. Soudain, je me retourne et je me trouve face à un regard perçant dans la pénombre. Ces yeux me fixent et je ne peux les ignorer, tandis que l’image évolue sans cesse et de manière accélérée. « C’est du speed painting ! », m’indique le créateur Florent Calluaud. Face à cet écran disposé sur un chevalet, je découvre ainsi toutes les étapes de conception de son œuvre picturale intitulée « Danse avec les loups ».
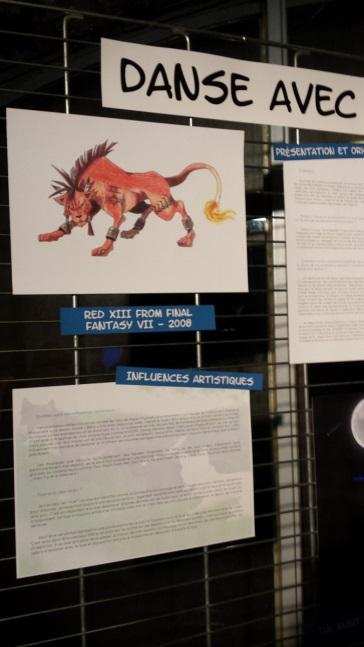
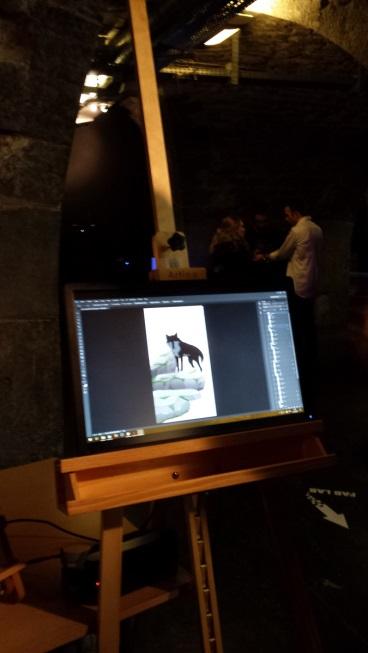
Création « Danse avec les loups » de Florent Calluaud © H. Prigent
Ce dessin est réalisé à partir d’une tablette graphique et s’accompagne d’une musique ainsi que du récit de l’auteur : quels outils ont été utilisés, quelles étapes ont été nécessaires, quelles questions se sont posées au fur et à mesure ? Pour le créateur, « ce qui est important est le lien entre la musique et le dessin qui permettent de raconter une histoire, faire voyager dans un imaginaire et faire ressentir l’émotion qui s’en dégage. » Cette œuvre m’évoque la sérénité et un voyage à travers le temps… réel ou imaginaire ? Je ne sais plus !
Pour la prochaine destination, je me retrouve téléportée sur des rails et j’avance à une allure agréable, me permettant d’apprécier les éléments de paysage de part et d’autre. Je ne crois pas être une passagère, mais plutôt la conductrice d’un train que je ne vois pas. Cette sensation d’avancer au bon rythme va se confirmer par la proposition du créateur et étudiant Adrien Bardet : « Voulez-vous monter à bord ? » Il me désigne un appareil de type console de mixage sonore. Je saisis le casque qu’il me tend pour m’imprégner de l’univers sonore qu’il a créé.
Je m’attendais à pouvoir varier la vitesse de mon voyage ou à changer la direction sur les rails comme dans un jeu vidéo. Là encore, je suis surprise par la finesse de la proposition intitulée « Soundscape ». Il s’agit de faire varier différents paramètres sonores qui influent en même temps sur la colorimétrie, sur les contrastes, bref sur l’ambiance visuelle du paysage et du voyage ferroviaire. [ndlr : je vous prie de m’excuser pour le flou de ma photo ci-dessous !]
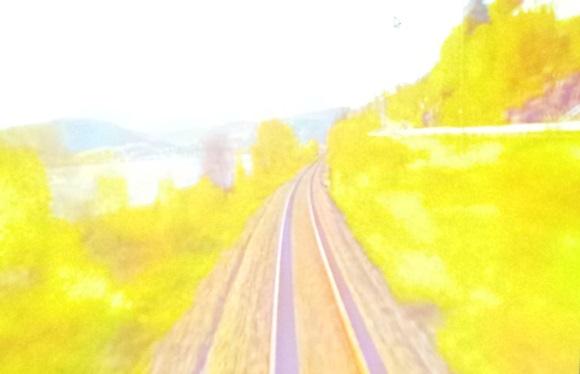
Création « Soundscape » d’Adrien Bardet © H. Prigent
Cette installation me semble aboutie, par la possibilité de vivre entièrement l’expérience en autonomie et par le niveau d’interaction proposé qui génère simplement du plaisir. Il est intéressant de pouvoir utiliser soi-même une palette des possibles visuels et sonores. Je consulte l’heure : il est temps de « descendre » du train pour aller vers une dernière rencontre avec la technologie…
En retirant mon casque, je me sens gênée par le brouhaha des installations autour car presque toutes émettent du son. Le lieu, tout en étant convivial, ne permet pas d’isoler les bruits les uns et des autres, sauf à proposer un casque individuel comme je viens d’en faire l’expérience.
Pour apprécier le quart d’heure restant, je reviens sur mes pas et m’avance vers un autre ingénieur-créateur. Assis, il est entouré de deux écrans : son ordinateur portable devant lui et un plus grand écran de démonstration sur sa gauche. Vais-je réussir à entendre et apprécier sa proposition sensorielle ? Je me concentre pour saisir au plus juste son œuvre.
Au premier abord, je ne suis pas certaine de distinguer l’outil de la création effective et je me renseigne sur le type d’expérience proposée. Antoine Goineau, concepteur de « Temps comme Tempo », me répond qu’il s’agit de générer une musique à partir de cette première photo à l’écran : chaque partie de l’image correspondra à une partie sonore différente. « L’utilisateur pourra par la suite relier le tempo de la musique créée à sa vitesse, à la perception du temps qu’il aurait en étant dans le cadre de la photo », précise-t-il.

Création « Temps comme tempo » d’Antoine Goineau © H. Prigent
Je comprends à peu près l’idée, qui me paraît ambitieuse et inédite. Mais ne pouvant justement pas créer mon propre tempo, cela reste abstrait. Comme pour la majorité de ces étudiants, son travail est en cours. Le créateur de « Temps comme Tempo » est le seul à me l’avoir précisé : à quel stade en sont les autres créations ? Cela est très difficile à déterminer lorsqu’on n’a pas l’habitude de ce type d’installation. Cette dimension « work in progress » me plaît beaucoup bien que cela place les exposants dans une position inconfortable. J’apprendrai par la suite que chaque étudiant est également évalué, pendant cette exposition « Intersections », par les deux enseignants du Master.
Il est un peu difficile d’entendre l’ambiance de « Temps comme Tempo », d’autant plus que les participants s’agitent avant l’heure de fermeture de la Casemate. J’apprécie tout de même la démonstration, en la percevant comme poétique et originale. Devant mon intérêt pour cette installation, il me détaille les logiciels utilisés et les langages informatiques. C’est une bonne idée d’aller au-delà de l’intention artistique pour les relier aux aspects plus techniques, bien que je ne sois pas sûre de retenir ces précisions pointues. A présent, chacun range à présent son installation car le lieu ferme d’ici cinq minutes. Je suis ravie d’avoir rencontré une partie de ce groupe d’étudiants ingénieux autant qu’audacieux.
Hélène Prigent
Pour plus d’informations sur ce master : http://phelma.grenoble-inp.fr/masters/
La Casemate de Grenoble, CCSTI* ouvert sur les évolutions actuelles, propose régulièrement des activités pluridisciplinaires. Cette visite donne réellement envie d’explorer des créations technologiques et scientifiques.
#promenadesonore
#labo
#experimental
*Missions du CCSTI (Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle) de la Casemate à Grenoble :
1. centre de production pluridisciplinaire qui travaille sur les thématiques scientifiques et industrielles fortement ancrées localement (numérique, micro et nanotechnologies, sciences du vivant, neurologie, énergie). Les sujets sont traités sous l’angle des rapports entre les sciences et la société : innovation et développement durable, bioéthique, nouvelles énergies etc…
2. animation au niveau régional, du réseau de culture scientifique et technique
3. centre de ressources (ex : banque d’expositions itinérantes) qui favorise l’émergence et le dynamisme de projets et de structures dans le domaine de la CSTI.

Histoire des fortifications de la Casemate
Au début du XIXe siècle, de grands travaux à caractère défensif sont entrepris pour protéger Grenoble par une enceinte dont les Casemates Saint-Laurent. Mais après les bombardements aériens de la première Guerre Mondiale, ces enceintes de protection sont devenues inutiles. Après l’échec d’une reconversion en projet commercial, l’agence de l’urbanisme de Grenoble investit le lieu, avant de laisser la place au CCSTI en 1979. Aujourd’hui, les locaux occupent l’étage pour le fablab, et le rez-de-chaussée pour l’accueil du jeune public et les bureaux. La Casemate partage le bâtiment fortifié avec la Maison Pour Tous Saint-Laurent et des annexes au Musée archéologique Saint-Laurent.
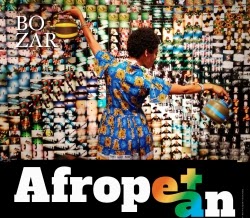
Afropean+ : une expérience polymorphique ?
Quand on fait son stage dans un musée travaillant des questions aussi complexes que « C’est quoi l’Afrique subsaharienne contemporaine ? Qu’est-ce qu’une diaspora ? Quelle mémoire les Belges et les Congolais partagent-ils ? De quelles manières la partager et la transmettre de part et d’autre de la méditerranée ? » L’événement Afropean+ peut apporter des réponses.
Affiche Afropean+ © Bozar
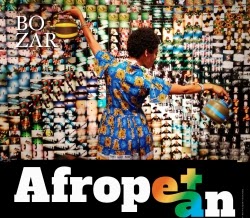 Me voila donc à Bozar, à Bruxelles, par un samedi de janvier particulièrement ensoleillé, prête à m’enfermer pour une journée d’événements culturels autour de la notion d’afropéanité. Le public est au rendez-vous, il est en majorité issu des diasporas subsahariennes et non africaines, j’aimerai voir encore plus de monde, encore plus de métissage. Etpourtant l’ambiance est cordiale, passionnée, aux aguets. C’est la première fois que j’entends, ou plutôt lis le terme afropean inscrit en grosses lettres sur le programme de la journée. Qu’est ce donc que ce néologisme, cette contraction d’africain et d’européen ?
Me voila donc à Bozar, à Bruxelles, par un samedi de janvier particulièrement ensoleillé, prête à m’enfermer pour une journée d’événements culturels autour de la notion d’afropéanité. Le public est au rendez-vous, il est en majorité issu des diasporas subsahariennes et non africaines, j’aimerai voir encore plus de monde, encore plus de métissage. Etpourtant l’ambiance est cordiale, passionnée, aux aguets. C’est la première fois que j’entends, ou plutôt lis le terme afropean inscrit en grosses lettres sur le programme de la journée. Qu’est ce donc que ce néologisme, cette contraction d’africain et d’européen ?

Le premier indice pour tenter d’approcher une définition du terme se trouve dans sa forme même, deux mots tranchés et cousus ensemble.
Bozar, plateforme de rencontres
Le second indice se situe dans la forme même que prend l’événement et dans le lieu où il se déroule. Bozar est une plateforme, une succession de salles où cohabitent une multitude de projets culturels validés par une direction dont la caractéristique principale est de savoir mettre le doigt sur des problématiques sociétales et contemporaines émergentes. La forme que prend Afropean + est pluridisciplinaire. C’est une journée où se succèdent des propositions variés comme un marché créatif, des expositions, des courts et longs métrages, des concerts, des lectures, des débats, des spectacles. L’ensemble venant se télescoper quand le visiteur prend le temps d’assister à plusieurs propositions. Notons au passage que seuls les concerts sont payants.
Continuum of Repair : The light of Jacob’s Ladder, Kader Attia, Bozar, 2015 © O.L
Un lieu d'échanges, de débats et de révélations
Le troisième indice est l’installation de l’artiste Kader Attia. Dans une salle en retrait du majestueux hall Horta où se trouve le marché créatif, l’artiste propose la métaphore d’une situation, celle de l’être traversé par plusieurs cultures, cultures reliées entre elles souvent violemment par la colonisation. L'œuvre est un cabinet de curiosités qui n'utilise pas le principe de l'originalité, du bizarre, de l'extra ordinaire comme historiquement mais est un espace polyphonique où par les objets (essentiellement des livres) les voix scientifique, politique, religieuse trouvent leur place les unes avec les autres. La suture entre les mondes (entre le ciel et la terre reliés par l'échelle de Jacob, entre le pouvoir politique symbolisé par les bustes d'hommes blancs et les textes bibliques et coraniques...) se fait par le regard englobant de l'artiste. C'est une couture entre les différents éléments de l'installation faite avec bienveillance, sans hiérarchisation entre les objets. Leur accumulation forme un constat : le scientifique, le religieux, le politique sont des possibles non hiérarchisés. Ce dispositif offre aux regards la plasticité et la polymorphie d’un monde qui permet une construction des identités.
Continuum of Repair : The light of Jacob’s Ladder, Kader Attia, Bozar, 2015 © O.L

S'exprimer par la scène
Le cinquième et dernier indice est la lecture-spectacle Autrices de « Ecarlate la compagnie » à partir d’extraits choisis du texte Ecrits pour la parole de l’auteure française Léonora Miano. Deux femmes, deux voix accompagnées par une création sonore inédite. Moment fort où la langue de Miano surgit, s’incarne dans le corps blanc des deux actrices. Et c’est cette incarnation du texte interrogeant « le rapport souvent conflictuel qu’entretiennent les afropéens avec les notions d’intégration et de double culture »[1] qui donne sens à l’afropéanité. Afropéanité est un mot dépassant la couleur pour interroger des identités qui restent dynamiques et uniques. En écho j’entends la voix de Léonora Miano dire : « Je sais très bien que je suis le produit de la rencontre entre deux mondes, qui, d’ailleurs, se sont mal rencontrés. Mais, enfin, j’existe. »[2] La voie à tracer pour se reconnaitre, se rencontrer, ne se situerait-elle pas dans ce retour aux conditions de la rencontre entre Afrique et Europe ? Il semble que pour construire les identités contemporaines, il nous faille faire un retour sur notre passé , sur ce que nous avons en commun.
Ophélie Laloy
Pour aller plus loin :
http://www.bozar.com/activity.php?id=15637
#Afropéanité
#Événementiel culturel
#Postcolonialisme
[1] Programme Bozar
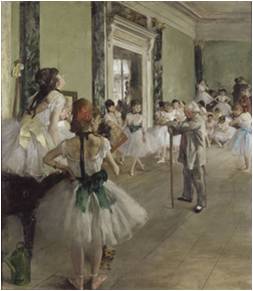
Alors, on danse ?
De l'exposition classique au musée d'Orsay
S’il y a bien un peintre qui aime la danse, c’est Degas. Retournons au XIXème siècle, époque où la bourgeoisie parisienne se veut érudite. Une société accordant de l’importance aux loisirs fréquente aussi bien les théâtres que les opéras. C’est dans ce contexte fertile que Degas grandit et alimente sa fascination pour les arts et surtout l’Opéra. Pour l’anecdote, le père de Degas organisait tous les samedis un récital dans le salon. Pour le 350ème anniversaire du Musée d’Orsay, les toiles du « peintre des danseuses » sont exposées sous un angle inédit. Ici, l’Opéra est abordé dans sa globalité, une première pour le musée. Au regard des œuvres telles que La Loge ou bien La Petite Danseuse de quatorze ans, œuvre qui a scandalisé le public lors de son exposition en 1881, l’artiste nous parle de sa fascination pour le corps humain et le mouvement. Difficile d’évoquer le mouvement avec des collections alors, que par définition, les œuvres sont figées dans le temps. L’exposition présentée au musée d’Orsay nous invite à comprendre le mouvement par la représentation des danseuses dans leurs univers. Pour lui, le mouvement né de l’effort. Effort, qui transparait autant dans ses dessins au pastel que dans ses peintures. D’ailleurs, contrairement à Claude Monet, Degas détestait peindre en dehors de son atelier. Les danseuses posaient donc devant le maitre qui réussissait à peindre les jeunes femmes dans leur intimité de danseuse. Des backstages aux planchers, des musiciens aux habitués des lieux, Degas représente également tous les acteurs de l’Opéra. Avec ses œuvres cadrées à la façon d’un photographe, il témoigne des mœurs de la société bourgeoise.
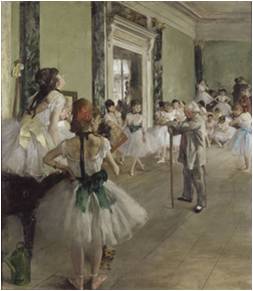
Edgar Degas La classe de danse© RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski
Cette exposition nous invite à découvrir ou à redécouvrir un artiste, qui pendant plus de 50 ans de carrière n’a cessé de peindre des femmes en tutus, n’hésitant pas à expérimenter des palettes de couleurs audacieuses. Deux ans auparavant, en 2017, le Louvre avait présenté son exposition au public, intitulé Corps en mouvement. La danse au musée se veut pédagogique puisque l’exposition donne au public les clés pour comprendre l’art et décortiquer gestes, postures et émotions dégagées par les corps peint. Chose innovante, quoi de mieux qu’un chorégraphe pour parler danse. C’est sur ce parti-pris que le Louvre a décidé de travailler de concert pour cette exposition en conviant le chorégraphe danseur Benjamin Millepied, en tant que co-commissaire de l’exposition.
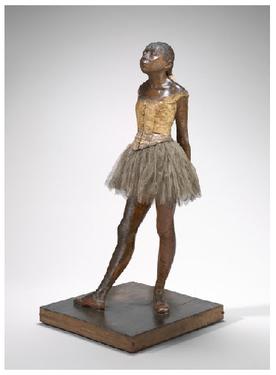
Edgar Degas, La petite danseuse de 14 ans © National Gallery of Art, Washington DC
A l’exposition Corps Rebelles au musée des Confluences
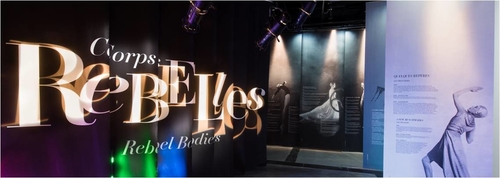
Vue de l'exposition Corps Rebelles © Bertrand Stofleth, Hétéroclite
Danse et musée ne font pas bon ménage ?
Que retenir de ces deux expositions ? Qu’il est difficile de faire cohabiter des artistes danseurs dans les collections des musées. La première raison est sécuritaire. Les musées n’ont pas été conçus comme des lieux de spectacle vivant, hormis les nouvelles structures qui se dotent d’auditorium ou d’espaces dédiés. Boris Charmatz releva le défi en 2016 avec Danse de nuit dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. Il réalisa ainsi sa chorégraphie dans la cour Carrée du musée du Louvre. L’espace n’étant pas aménagé pour recevoir le public venu en masse, l’accessibilité au spectacle fut complexe. Mettant ainsi le public proche de la performance et à la fois éloigné, puisqu’il était difficile pour un grand nombre d’apercevoir l’artiste au cœur de sa pratique. La deuxième raison est financière. Les musées ne produisant pas les spectacles d’art vivant, les enjeux ne sont pas les mêmes. La rémunération des danseurs peut peser, surtout quand le projet est conséquent. C’est le cas de l’exposition Carte blanche à Tino Sehgal où les 13 000m² d’exposition du Palais de Tokyo furent entièrement dédiée à la performance dansée du chorégraphe et de plusieurs de ses compères. La dernière raison s’accorde sur la gestion de l’humain. Il est complexe de faire intervenir des danseurs durant tout le temps que l’exposition est présentée au public.
« Danse de nuit », une chorégraphie de Boris Charmatz. © BORIS BRUSSEY
L'importance de la programmation : ateliers et résidence
Et comme le dit si bien Jean de La Fontaine, « Et bien, dansez maintenant ! »
L’exposition Degas à l’Opéra
Du 24 septembre 2019 du 19 janvier 2020
Musée d’Orsay
#danse
#exposition
#performance
Edith Grillas
AZAY-LE-RIDEAU : ENCHANTEMENTS ET RENAISSANCE
Originaire de la région Centre-Val de Loire, inutile de préciser que je demeure une aficionada des châteaux de la Loire depuis ma plus tendre enfance. Je me souviendrai toujours de ses visites qui ont marqué mon imaginaire d’exploratrice, et qui ont été la porte d’entrée vers cette passion pour le patrimoine culturel. Comment ne pas oublier ce majestueux édifice qu’est le Château de Chambord ? Les somptueux jardins de Villandry qui forment des tableaux colorés de verdure ? Ou encore le Château des Dames,plus connu sous le nom de Chenonceau, qui m’a impressionnée par la richesse de ses collections ?
Mais il en est un plus discret face aux bâtisses les plus renommées dela région, et qui pourtant, demeure de loin mon favori :Azay-le-Rideau. Je ne saurais me rappeler l’âge exact auquel je l’ai découvert pour la première fois, mais je me souviens de la somptueuse vue depuis la façade Sud magnifiée par son miroir d’eau. Une véritable révélation, semblable à la description qu’en a fait Honoré de Balzac dans son roman Le Lys dans la vallée, où il le compare à « un diamant taillé à facettes sertis par l’Indre ».
La façade Sud du château d’Azay-le-Rideau © Joanna Labussière
Il est fort probable qu’une majeure partie d’entre vous ne le connaisse pas, mais si vous suivez l’actualité de près, il se peut que vous en ayez entendu parler récemment. En effet, le Châteaud’Azay-le-Rideau était sous les feux de la rampe, puisqu’il a bénéficié d’un important programme de restauration entrepris parle Centre des Monuments Nationaux durant presque trois ans. Au total : huit millions d’euros ont été investis dans ce chantier de mise en valeur et de restauration.
Autant vous dire que lorsque j’ai appris le jour de mes vingt-six printemps que j’allais prendre mes fonctions au sein de ce monument, je n’en revenais pas. Je crois même qu’à l’heure où j’écris ces lignes, j’ai encore du mal à m’en rendre compte.Mais passons ! Le jour de ma prise de poste, quelle ne fut pas ma surprise de revoir ce château qui m’était si cher restauré àla perfection ; le soleil de ce début d’automne se reflétant dans la blancheur de la pierre de Tuffeau si caractéristique de l’architecture régionale.
C’est un château comme neuf que je (re)découvre : rénovation du parc romantique du milieu du XIXème siècle, façade extérieure entièrement restaurée, intérieur remeublé en son état historique. En tant qu’apprentie chargée de médiation culturelle,j’étais d’autant plus intéressée par la refonte du parcours de visite, et plus particulièrement par ce qui se tramait au premier étage. Je remarque alors avec étonnement que plusieurs pièces sont parsemées d’œuvres contemporaines, faisant du château un palais enchanté où se mêlent mythologie, magie et théâtre. Mais avant de vous en dire davantage, une petite explication s’impose !
Tout est parti du Centre des Monuments Nationaux qui a fait appel aux artistes plasticiens Piet.sO et Peter Keene pour concevoir un parcours d’installations oniriques destinées à être exposées au sein du monument. Le duo collabore ensemble depuis seize ans déjà,et parmi les six créations, cinq ont été spécifiquement conçues pour Azay-le-Rideau. Un an aura été nécessaire à la réalisation des esquisses de chaque installation, puis sept mois de conception.
Intitulé« Les enchantements d’Azay », ce projet a pris place parmi les collections le 6 juillet 2017, date de réouverture du château suite aux trois années de travaux. Influencés par l’imaginaire de la Renaissance, les artistes se sont notamment inspirés des personnages d’Armide et de Psyché, toutes deux représentées dans les tapisseries des chambres situées au premier étage : La Jérusalem Délivrée et l’Histoire de Psyché. Tel un hommage aux artifices des arts du spectacle de l’époque où se côtoient installations féeriques et objets fantastiques, ces enchantements envoûtent à différents niveaux antichambres, chambres et salle de bal du premier étage. La magie opère dès lors que les visiteurs passent à proximité, puisque les installations se déclenchent à leur passage. Certaines œuvres sont accompagnées de fonds sonores. Si vous-même, chers lecteurs et chères lectrices, êtes tentés par cette expérience surprenante,suivez le guide !
Si l’on suit le parcours de visite classique, notre déambulation nous mènera en premier lieu dans la grande salle. Lieu de réception par excellence, c’est dans cette partie publique que le maître de maison recevait pour ses affaires ainsi que pour son plaisir en organisant bals et festins. A notre arrivée, trois installations monumentales font face à la cheminée. Au centre trône un imposant banquet, entouré de part et d’autre par un automate (un officie rsur la gauche et une magicienne sur la droite). Ces installations s’animent au fur et à mesure : la magicienne et l’officier tournent sur eux-mêmes, tels les annonciateurs d’un banquet fantastique qui s’ouvre avec des panneaux se levant sur la table.Inspirés par les festins sorciers, Piet.sO et Peter Keene puisent également leurs influences dans l’art cinématographique.Références entre autres au grand banquet dans La belle et la bête de Jean Cocteau (1946), ou encore aux fêtes données dans les jardins dans Vatel de Roland Joffé (2000). Le festin fait aussi écho au palais d’Eros dans lequel Psyché est servie par des esprits bienveillants. Enfin, la mise en scène volontaire des animaux renvoie à la cuisine de la Renaissance, époque où l’on présentait autant la tête que le corps de l’animal.
Le banquet © Léonard De Serres
La visite se poursuit en pénétrant dans la Chambre de Psyché.Autrefois chambre du maître de maison, elle était sûrement destinée à Gilles Berthelot, commanditaire du château d’Azay-le-Rideau. Cette pièce s’apparentait à un espace multifonctionnel où l’on se reposait autant que l’on travaillait et recevait. Face aux trois tapisseries qui habillent les murs, se dresse un automate tournant sur lui-même, portant une lanterne et vêtu d’une robe décorée de miroirs. Il s’agit d’une mise en scène de Psyché, symbolisée par la robe aux miroirs, référence au miroir du personnage, tel un écho au labyrinthe proposant plusieurs destinations. Elle semble observer les tapisseries murales qui relatent son histoire. Sorte de quête initiatique, les miroirs servent à éclairer une partie de son vécu, tout en lui indiquant le chemin à suivre. La lanterne éclairée lui sert également de guide afin de l’aider à retrouver son chemin.
La robe aux miroirs © Léonard De Serres
Jouxtant la Chambre de Psyché, la garde-robe est métamorphosée en « Cabinet des petits prodiges » au sein duquel automates, miroir et mondes miniatures se transforment grâce à des effets d’illusion.Trois mécanismes y sont disposés et se mettent en mouvement les uns à la suite des autres : tout d’abord, deux mécanismes en horlogerie fine, puis un miroir représentant des papillons. Bien que celui-ci ne soit pas éclairé, il est tout de même possible d’observer les papillons flotter au travers. Ici, Piet.sO et PeterKeene ont choisi Armide comme source d’inspiration, personnage capable de changer les petits projets en palais.
Cabinet des petits prodiges © Léonard De Serres
La déambulation se poursuit dans la chambre Renaissance, qui était probablement la chambre de Philippe Lesbahy, l’épouse de Gilles Berthelot. C’est dans le secrétaire, cabinet de retrait de la chambre qu’est exposé un « Livre aux grotesques »,conférant une apparence féerique à la pièce. Réalisé en papier de jonc, il laisse apparaître des ombres de créatures chimériques de par sa forme et les jeux de lumière. Le jonc fait écho aux murs de la chambre de Philippe Lesbahy restaurée en 2013, qui sont recouverts de nattes de jonc. Cette technique de tressage manuel était d’usage au XVIème siècle, car elle permettait d’isoler la pièce par temps froid, et de conserver la fraîcheur en cas de températures élevées.
Livre aux grotesques © Léonard De Serres
Passons à présent à l’antichambre précédant les appartements du roi,où patientaient les visiteurs avant d’être reçus. Ici, le baroque prend tout son sens, avec un théâtre animé faisant apparaître et disparaître plusieurs animations et décors à l’aide de jeux de ficelles, ou encore de poulies. L’aspect brut véhiculé par la boîte réalisée en bois de frêne renvoie à la Renaissance,où le rideau n’existait pas pour la représentation du petit théâtre. Celui-ci fera son apparition au XVIIème siècle avec des rideaux bleus pour symboliser la couleur royale, puis les rideaux rouges sous Napoléon. L’emploi de la ficelle dans les décors était courant à la Renaissance ainsi qu’au XVIIème siècle, avec une scénographie conçue à partir de décors suspendus. Encore une fois, le duo d’artistes a choisi Armide comme référence principale, à travers ce théâtre animé, où trois à quatre décors suspendus apparaissent au fur et à mesure pour raconter une histoire.
Le petit palais d’Armide © Léonard De Serres
Détail du petit palais d’Armide © Léonard De Serres
Pour conclure, direction la chambre du roi, baptisée ainsi en souvenir des quelques jours passés par le roi Louis XIII à Azay-le-Rideau en juin 1619. On y découvre un cabinet « automate », seule installation qui n’a pas été créée spécifiquement pour Azay-le-Rideau. Intitulée « L’entrée ouverte au palais fermé du roi », ce palais-théâtre motorisé a été conçu dans le cadre de l’exposition « Les Chambres des Merveilles »qui s’est tenu au Château-Maisons de Maisons-Laffitte d’octobre 2015 à juin 2016. Dans l’esprit des meubles à secrets, le visiteur s’approche et découvre un théâtre qui s’ouvre où apparaît la reine d’un côté et le roi de l’autre. Surgit ensuite une forêt envahissant un palais qui prend forme petit à petit, avant de conclure par l’ouverture d’un grand tiroir symbolisant un vide poche qui contient des objets d’époque, voire plus contemporains. L’utilisation de l’ébène pour la réalisation du meuble fait référence à l’impact crée par l’arrivée du mobilier au XVIIème siècle.
L’entrée ouverte au palais fermé du roi © Léonard De Serres
C’est quasiment envoûtée que je ressors de cette déambulation originale qui m’a permis de poser un tout autre regard sur les collections du château. J’ai été littéralement charmée par cette œuvre à quatre mains, qui réunit l’impact de la mémoire et la place du corps chez Piet.sO, ainsi que l’exploration de l’utopie et les installations mécaniques et sonores chères à Peter Keene.Redevenue exploratrice dans l’âme, j’ai retrouvé le temps de quelques heures cette curiosité enfantine qui rythmait mes toutes premières visites.
Offrir une nouvelle vision de la Renaissance à travers l’installation d’œuvres contemporaines qui s’intègrent dans les salles du château : tel est l’objectif de ces enchantements. Mission réussie pour les deux artistes qui donnent à voir un aspect décalé des collections, tout en restant cohérent avec les œuvres originales. Banquet animé, meubles à secrets, mondes miniatures et robes immenses : en misant sur l’imaginaire à travers l’automate, cette expérience de visite inédite invite le visiteur dans un parcours féerique où la magie produit son effet.
Joanna Labussière
#azaylerideau
#pietsOetpeterkeene
#installationsoniriques
Pour en savoir plus :
-Sur le château d’Azay-le-Rideau :http://www.azay-le-rideau.fr/
-Sur l’exposition « Les enchantements d’Azay » :http://www.azay-le-rideau.fr/Actualites/Les-enchantements-d-Azay
-Sur le travail des plasticiens Piet.sO et Peter Keene :http://www.pietso.fr/,http://www.peter-keene.com/home.html
-Petit tour d’horizon des « Enchantements d’Azay »guidé par l’artiste Piet.sO :https://www.youtube.com/watch?v=tILcUSMAg_Y

BAZAR-DONS!
La ferblanterie, lieu de création indépendant, est un endroit atypique où se côtoient plasticiens, musiciens et performeurs dans une ambiance familiale. Celieu, trop peu connu à mon goût, regroupe 35 ateliers d'artistes ainsi qu'un hall d'exposition dans un hangar aménagé au fil du temps par ceux qu'on nomme amicalement les « ferblanteux ».
© Magali Dulain
Ce week-end du 4 octobre, se déroulaient les portes ouvertes, sous le titre de « Bazardons ». Trois jours durant lesquels cuisine, musique, danse, échange et partage étaient les maîtres mots. A l'honneur, le thème de l'immigration et de la solidarité.
Al'entrée du hangar, un accueil particulièrement chaleureux m'attend. Un prix libre est mis en place afin d'aider les artistes qui joueront toute la nuit ainsi que les migrants. S'ensuit un décor complètement dingue, dans l'esprit brocante.Une multitude de fauteuils sont installés au plaisir d'y voir s'y plonger les spectateurs.
Plusieurs ateliers cohabitent, celui de Magali Dulain attire particulièrement mon attention. Accrochés un peu partout, des dessins aux traits enfantins et aux couleurs vives, s'animent sous les guirlandes lumineuses. Des mélanges d'aquarelles et de feutres et une poésie à tout épreuve. Je rentredans son atelier et me sens alors complètement imprégnée de cette candeur. Un beau voyage inattendu.
Déambulant un verre de Mojito à la main (commandé dans un bar improvisé dans un des ateliers), je tombe sur une friperie, puis sur une piste de danse au détour de laquelle je croise quelques étrangers avec lesquels je pratique mon anglais :
« -I'm hungry, do you know if there is something to eat around ? »
Euh, yes, i think there is....euh....there is a kitchen, you can...take...everything you want...it's free »
Après avoir fait le tour des ateliers, les lumières s'éteignent et une batterie raisonne dans le hangar. Une voix puissante se réveille et transforme le lieu en un véritable club de Jazz américain. Old chaps, groupe lillois de swing, envoie un groove d'enfer. La chanteuse, véritable réincarnation d'Amy Winehouse est transcendante. Enchaînement de morceaux très jazzy et de quelques instants de hip-hop : de savoureux mélanges sont créés par une belle équipe.

© crédit photo: Alain Epaillard
Si la ferblanterie semble être un lieu épicurien, il reste avant tout un lieu d'art et d'actions culturelles : depuis quelques semaines, le collectif organise de multiples ateliers artistiques et intervient dans la jungle de Calais ainsi qu'auprès des migrants installés au Parc des Ollieux (plusieurs mineurs dorment sous des tentes depuis 4 mois). Les artistes se mobilisent tous et sont réellement touchés par ces problématiques. Les portes ouvertes étaient une première action, invitant les gens à déposer des vêtements ou des denrées alimentaires. Etant moi même touchée par ces phénomènes de société qui dessinent notre Région, il me semblait nécessaire de montrer que la solidarité et l'action se déroulent différemment et en dehors de ce que l'on pense et que l'Art, reste un moyen de partage, d'ouverture et d'entraide.

© crédit photo: La ferblanterie
Loin de l'image inaccessible de l'Art, les artistes de La ferblanterie prônent un art conscient et conscientisé, sans se prendre au sérieux. On retrouve ici quelques uns des vrais acteurs lillois, de vrais passionnés loin des mondanités.
Une belle et grande famille qui donne envie de s'y plonger.
MW
#solidarité
#migrants

Cathédrale de Reims : un rêve de couleurs, entre mélodies et féérie visuelle
A l’occasion du 800ème anniversaire de la Cathédrale Notre-Dame de Reims, la ville a souhaité offrir un spectacle de polychromie dynamique afin de mettre en valeur l’architecture de cette grande dame.

© Gilbert Coutelet
Du 6 mai au 23 octobre 2011, puis du 25 novembre au 1er janvier 2012, ce spectacle de 25 minutes s’est répété tout d’abord 3 fois par soirée, puis 2 fois seulement car les citoyens et touristes n’étaient que très peu nombreux lors de la troisième représentation. Entre les deux spectacles, 10 minutes de polychromie fixe permettent au public de s’avancer afin d’admirer la précision du travail. A la fin deuxième représentation, elle est de 15 minutes. Un système de boucle magnétique est disponible dans le périmètre de la tour gauche projetant le spectacle pour les personnes malentendantes. Le partenariat entre la Ville de Reims, Reims Métropole et l’association Unis-Cité a permis l’instauration, certains soirs, d’un service d’accompagnement dans le déplacement des personnes à mobilité réduite ou vulnérables. Pour les personnes souffrant d’un handicap visuel, des accompagnateurs expliquent les éléments visuels du spectacle.
Hélène Richard et Jean-Michel Quesne, membres du collectif Skertzò (metteurs en scène de patrimoine depuis 1988), se sont attelés à la tâche. Maîtres de la projection du trompe-l’œil et de l’illusion d’optique, ils ont créé cette polychromie de très haute définition grâce aux pigments de couleurs retrouvés sur la statuaire multiséculaire du monument. En effet, lors des dernières restaurations, les évolutions technologiques ont permises de faire des analyses macro et microscopiques des prélèvements faits sur la pierre. Ces méthodes ont permis de rendre sa couleur originelle à « L’Ange au Sourire » et aux autres personnages témoins de l’histoire et messagers de la Cathédrale. Lors du spectacle, le son délimité accroît les différentes visions de la façade occidentale.
Cet exploit fait appel aux techniques les plus récentes de projection vidéo et donne au spectateur, la sensation d’être au cœur de cet aller-retour dans le passé. En cela, les créateurs de l’ère moderne souhaitent faire perdurer les prouesses des grands bâtisseurs, en rendant la vie à ce monument.Une des principales difficultés a été de s’adapter à la complexité de la statuaire ; les nombreux détails ont nécessité une très grande précision dans la projection. Les portails ont été extrêmement travaillés car ils sont proches du public et donc doivent être « parfaits ».
Toutefois, la taille imposante de la cathédrale fait que, peu importe où l’on se trouve, l’on ne voit jamais deux fois la même chose. Des détails des sculptures entourant les deux roses nous sautent aux yeux si l’on se trouve plus en arrière du parvis, alors que la projection sur les portails peut attirer notre attention durant tout le spectacle. Il a donc fallu que les créateurs utilisent des nouveaux projecteurs à très forte puissance qui sont apparus sur le marché il y a très peu de temps, et des vidéoprojecteurs de dernière génération.
Cette mise en scène permet à tous de revivre les scènes des siècles passés. En effet, dès la tombée de la nuit, la pierre de l’édifice s’anime et raconte son histoire. Le public a l’impression d’assister à un ballet où les scènes de différents siècles s’enchaînent comme des actes, mêlant constructions, sacres, cérémonies et Histoire de France. Le programme musical mis en œuvre par Rachid Safir laisse entendre des morceaux du Moyen-âge et de la Renaissance mais aussi de l’époque Baroque et contemporaine afin de rythmer les scènes. Peut-être ne manque-t-il que les « Acclamations carolingiennes » (Christus Vincit) qui étaient chantées au sacre de tous les rois jusque Charles X.
Pour les Rémois, cette vision nouvelle de leur cathédrale permet une réappropriation et une redécouverte de ce lieu qu’ils côtoient quotidiennement. C’est d’ailleurs l’un des objectifs d’une installation urbaine. En effet, ce spectacle est gratuit, ouvert à tous et libre d’accès. Ainsi, le public n’a cessé d’emplir le parvis ; au 27 octobre, Rêve de Couleurs avait rassemblé plus de 300 000 personnes (avec une fréquentation minimum de 500 personnes les soirs de mauvais temps). Ce fut un facteur de cohésion sociale important car les Rémois ont souhaité partager ce moment avec leur famille et amis.
De plus, la diffusion de cet événement dans les médias a fait venir des touristes du monde entier (Européens, Américains, Australiens et Japonais) générant des retombées économiques locales immédiates et importantes. Le bouche-à-oreille a aussi parfaitement fonctionné, faisant se déplacer des médias étrangers non sollicités. De plus, l’investissement dans ce type de matériel va permettre à la ville de le laisser en place et de le reproduire chaque année, comme la polychromie projetée sur la cathédrale d’Amiens depuis 10 ans chaque été.
Cependant, chaque lieu a sa propre identité, sa propre histoire. Skertzò a toujours souhaité s’adapter à ce paramètre comme la projection de séries impressionnistes sur la Cathédrale de Rouen ou la projection des mythes de Chambord sur le château, tout en y apportant un changement de la perception du monument ; une métamorphose pour briser la routine visuelle.
Célia Hansquine

Ceci n'est pas...
3h30 à Courtrai le 18 novembre 2015, sur la Korte Steenstraat, une vitrine métallique s’ouvre sous le regard intrigué de quelques passants. Nous sommes devant de l’installation Ceci n’est pas... de Dries Verhoeven, elle s’ouvre ici pour le 6ème jour consécutif. Le rideau se lève.
13h30 à Courtrai le 18novembre 2015, sur la Korte Steenstraat, une vitrine métallique s’ouvre sous le regard intrigué de quelques passants. Nous sommes devant de l’installation Ceci n’est pas... de Dries Verhoeven, elle s’ouvre ici pour le 6ème jour consécutif. Le rideau se lève. Un personnage assis sur une balançoire bouge au rythme d’un bruit sourd. Il est vêtu uniquement d’un body couleur chair et d’une paire d’ailes en plumes orange. «Tu es un homme ou une femme ? » l’interroge une passante. Le personnage la regarde en souriant, muet. Cette question se répète de nombreuses fois au cours de la performance. Car il s'agit bien d'une des questions posées implicitement par l'artiste à travers ce tableau humain.
Présentée dans le cadre du NEXT Festival, cette installation est issue de la série Ceci n'est pas...de l'artiste Dries Verhoeven qui comprend dix différentes scènes dans une boîte en verre insonorisée. Il présente dans ces boîtes des personnages joués par des acteurs dans des scènes “perturbantes”. La veille, dans Ceci n’est pas de l’histoire, un homme noir enchaîné comme un esclave endossait le rôle de Père Fouettard. Le lendemain, Ceci n’est pas notre peur montrait un homme en train de faire la prière musulmane, en écho avec les attentats terroristes ayant eu lieu en France. A travers sa série, Dries Verhoeven entend montrer des situations suscitant un “malaise collectif”, des images provocantes.
L’installation du 18novembre illustre ce malaise, perceptible à travers les réactions du public que nous avons constaté. C'est ici la notion de genre qui est abordée. A première vue, c'est une femme avec de longs cheveux blonds. Cependant, sa tenue moulante dévoile un corps androgyne, des jambes musclées et un sexe d'homme. A travers les réactions collectées, la question du genre de la personne n'est pas tranchée : tous les spectateurs hésitent entre homme ou femme mais ils envisagent rarement la possibilité des deux sexes chez une même personne. Mais avant le sujet de l'œuvre, c'est la curiosité qui attire de nombreux passants. Ils veulent voir de quoi il s'agit. : "Qu'est ce qu'il fait là ?", "Est-ce vraiment un humain ou est-ce une poupée ?" semblent-ils penser. Beaucoup d'entre eux s'arrêtent, y compris des cyclistes, pour regarder. Certaines personnes attendent quelque chose puis en voyant que "rien" ne se passe, ils repartent. Certains ne s'arrêtent pas mais se retournent plusieurs fois. D'autres prennent des photographies ou se prennent en groupe avec l'œuvre en arrière-plan. Cette installation suscite toujours une réaction, elle interpelle les passants, rarement indifférents. Sa place dans l'espace public dérange, crée une rupture.
Une jeune adolescente s'approche vers nous et nous demande en flamand "C'est une femme ou un homme ?". Elle nous explique ensuite en anglais qu'elle n'aime pas vraiment ce genre d'installation dans la rue. Pas personnellement mais car l'œuvre se situe à Courtrai. "Ici les personnes jugent" précise t-elle. Pourtant, un photographe avoue qu'il a été surpris de la bienveillance et de la tolérance des gens même face aux autres "tableaux" présentés par l'artiste les jours précédents, comme une jeune fille enceinte qui danse.Plus tard, la même adolescente dit son incompréhension mais en lisant le cartel, elle y a trouvé du sens : "There is a meaning, it's different".Pour autant le discours de l'œuvre et le cartel ne répondent qu’à une partie des interrogations : un court texte accompagne l'oeuvre mais ne la commente pas vraiment. Il constate des faits liés au monde occidental, à la société belge, en lien avec la thématique de la scène du jour. Il y est écrit :
" Dans le monde occidental, la pensée s’inscrit dans la dichotomie homme/femme. Selon Freud, la première chose que nous constatons à chaque nouveau contact est si quelqu’un est homme ou femme. Quand la reconnaissance du sexe ne se déroule pas automatiquement, cela engendre de l’incompréhension, de l’irritation ou de la joyeuse confusion. En Belgique, l’état civil permet de changer de sexe si la personne en question a la conviction permanente et irréversible d’appartenir à l’autre sexe et si une intervention médicale a rendu impossible sa capacité de reproduction. Contrairement à l’Australie, par exemple, le choix de n’appartenir à aucun des deux sexes n’est pas possible en Belgique. Les personnes à l’identité de genre trouble se heurtent toujours à beaucoup d’incompréhension sur le plan social, et plus particulièrement de la part des milieux religieux traditionnels.Cependant, trouver un emploi n’est souvent pas simple non plus pour ces personnes, si ce n’est dans l’industrie du divertissement."
Etant si général, le texte, tout comme l'œuvre laisse planer de nombreux doutes chez les spectateurs. Aucune médiation n'est proposée, le spectateur est seul face à ses interrogations. Des personnes se posent des questions entre elles, essayent de nous en poser, sans réponses précises. C'est justement sur cette ambivalence que joue Dries Verhoeven. Il ne répond jamais aux questions posées par l'œuvre,il suscite un débat et une réflexion chez les spectateurs. Dans la présentation de sa série, il interroge : “Why are some images considered tainted when they weretolerated just twenty years ago ? (Pourquoi certaines images sont-elles considérées comme immorales alors qu'elles étaient tolérées il y a seulement vingt ans ?) " ou "Is it good that our children do not see certain things, or have we gone to the extremes inour drive to protect? (Est-ce une bonne chose que nos enfants ne voient pas certaines choses ou sommes-nous devenus trop extrêmes dans nos attitudes de protection ?)". Toutes ces performances abordent une question d'actualité : elles touchent nos instincts et nos sentiments comme la peur, le dégoût, la honte... La neutralité est presque impossible : chaque personne interrogée donne un avis et expose une certaine vision de la société.L’artiste explique qu’il présente des acteurs comme des images commerciales pour pousser les visiteurs à avoir une relation avec ce qu’ils voient.
Les bruits qui accompagnent l'installation du 18 novembre transforment cette personne en une attraction de foire, comme dans une galerie des monstres contemporaine. À de nombreuses reprises, le rideau tombe et l'œuvre est dévoilée de nouveau. Dans son dispositif même, la notion de dévoilement et de spectaculaire est palpable.Quasi nu, le corps androgyne est exposé à la vue et au jugement de tous. "C'est original" commente un homme qui a profité de sa pause déjeuner pour se rendre sur place avec ses collègues. Mi-gênés, mi-intrigués, ils restent postés un moment face à la vitrine de verre.La force de l'œuvre réside aussi dans les débats qu'elle suscite. Cela est le cas avec toute la série Ceci n'est pas. Dans chaque ville où les œuvres ont été présentées, la presse en parlait, les réactions du public étaient recueillies, accueillantes ou hostiles. Devant, les personnes s'interrogent sur la difficulté de vivre cet entre-deux, à la fois homme et femme. Des questions éthiques, scientifiques, sociales émergent : doit-on rester comme nous sommes ?Avons-nous en nous-mêmes une nature d'homme ou de femme ? Peut-on être asexué ?Face à ces questions, les adultes s'avèrent parfois plus ouverts que les jeunes. "Moi, je n'ai aucun problème avec cela" avoue une passante tandis qu'un jeune avec son groupe d'amis explique "On doit rester comme on est (...) Tu dois rester homme parce que la nature a décidé que tu es né ainsi". Est-ce pour cette raison que l'installation s'intitule Ceci n'est pas la nature ? Le titre,comme celui de toute la série, semble plutôt être un pied de nez.Implicitement, il invite à se rendre compte de l'absurdité de nos préjugés. Tout au long de l'après-midi, le personnage se balance et les bruits sourds de la foule se poursuivent. Ce bruit festif et les plumes colorées évoquent la scène queer ou le Carnaval de Rio, où le genre n'a pas d'importance.
J. Deschodt, T. Rin et H. Ferrand
Crédits photo : T. Rin et J. Deschodt
#NEXTFestival
#artcontemporain
Pour découvrir l'installation :
Vidéo réalisée par J. Deschodt :https://vimeo.com/150199389
Pour aller plus loin :
Vidéo réalisée par les fondateurs du site Ceci n'est pas Kortrijk :https://www.youtube.com/watch?v=yGzRr3APjpA
Site de l'artiste et présentation du projet (EN) :
http://driesverhoeven.com/en/project/ceci-nest-pas/
Cultures souterraines
Qui n'a jamais rêvé de s'enfoncer sous terre, d'explorer grottes et lacs souterrains, équipé d'une lampe frontale, d'une carte, d'une combinaison et d'un harnais ? Il en est sûrement parmi vous qui ont réalisé ce rêve, amateurs ou professionnels. Mais n'importe qui ne peut pas s'improviser spéléologue, et encore moins dans un cadre urbain. Dans les milieux cataphiles¹, vous êtes un « touriste » si c'est votre première descente. La cataphilie contemporaine est proche de l'urbex, l'exploration urbaine. L'urbex consiste à explorer des lieux construits par l'homme, abandonnés ou non, interdits ou difficiles d'accès. Être cataphile ou explorateur urbain ce n'est pas la même chose, les seconds qui aiment les souterrains ne sont pas des cataphiles.
Quid du culturel dans tout cela ? Et bien, certains de ces amateurs de souterrains ont choisi de rendre accessibles ces endroits à un public, certes peu nombreux. Différentes initiatives peuvent être recensées, mais la plupart d'entre elles restent inconnues, introuvables. Festivals, expositions, lieux culturels, on trouve de tout sous terre !
Sous terre, tout est possible
La Mexicaine de perforation est probablement le plus connu de ces groupes, responsable des Arènes de Chaillot, salle de projection clandestine sous le palais de Chaillot. Branche « événements artistiques » de l'UX, agrégation de groupes clandestins, la Mexicaine de perforation a pour but de créer des zones libres d'expression artistique. À l'origine de plusieurs festivals de cinéma mais aussi de représentations théâtrales, LMDP n'investit pas uniquement des lieux souterrains (le Panthéon, les grands magasins,...). Urbex Movies et Sesión Cómod sont les deux festivals qui ont été organisés par LMDP. Le premier projetait des classiques sur le thème de la ville comme Eraser Headde David Lynch, Fight Clubde David Fincher ou encore Ghostin the Shellde Mamoru Oshii. Le second projetait des films en lien direct avec le souterrain, comme La Jetéede Chris Marker ou Le Dernier Combatde Luc Besson. En 2004 la salle de projection fut découverte par la police, et EDF porta plainte pour vol d'électricité (il fallait bien faire fonctionner ce cinéma...).
La salle de projection clandestine à Chaillot ©Urban Resources
Directement issue de l'héritage de la Mexicaine de Perforation, la Clermontoise de Projection Underground, basée à Clermont-Ferrand, organise lors du Festival Underfestprojections, concerts et expositions. A lire dans « Urbexet culture avec la Clermontoise de Projection Underground » à paraître bientôt !
Bien sûr, tout cela est clandestin, et donc interdit. Même sans laisser de trace, pénétrer dans un lieu privé est interdit par la loi. Celui qui se fait prendre s'expose à des poursuites. C'est pour cela que tous ces événements ne concernent que quelques personnes, en général entre trente et cinquante. De plus, la communication est très limitée, il n'est pas toujours facile de savoir comment procéder pour assister à un de ces événements ! C'est le cas des vernissages de Madame Lupin, des expositions d'art contemporain dans des lieux insolites, interdits au public. Il faut réserver sa place, les instructions sont envoyées très peu de temps avant la tenue de l'exposition. Avec quatre expositions à son actif, cette association propose des lieux aussi éclectiques qu'une piscine désaffectée, le fort d'Aubervilliers, un lieu souterrain ou encore le musée des Arts et Traditions Populaires². En plus de ces expositions, l'association organise régulièrement des dîners des lieux insolites. L'exposition Hiddenunder the sand se déroulait dans un lieu souterrain inconnu, partiellement ensablé.
« Hiddenunder the sand » ©G.V.
Des événement culturels clandestins ?
Toutefois, l'occupation culturelle d'un lieu souterrain ne se fait pas forcément de manière illégale, des initiatives légales ont aussi vu le jour. En Croatie, la ville de Pula a pris l'initiative d'ouvrir ses souterrains datant de la Première guerre mondiale au public, tout en proposant régulièrementdes expositions et des manifestations culturelles.
Les souterrains de Pula ©S.B.
Le festival Art souterrain de Montréal
Encore plus développé, le festival Art souterrain se tient à Montréal tous les ans, à l'occasion de la Nuit Blanche. Le but de ce festival est d'exposer les œuvres d'environ quatre-vingt artistes dans la ville souterraine. En effet, la ville possède un réseau souterrain ultra développé (33 km sous terre) qui permet de relier les différents quartiers de la ville. De nombreux commerces et services sont implantés dans ce réseau. En 2016, pour la 8ème édition, le festival Art souterrain a proposé quatre circuits qui emmenaient le public dans treize édifices souterrains.
Doté d'un commissariat d'exposition, le festival propose aussi un parcours « satellite », dans des galeries et lieux culturels de la ville, ainsi qu'un grand nombre d'activités. Visites guidées, visites d'ateliers d'artistes ou médiations pour les scolaires sont proposées tout au long du festival, qui dure presque un mois entier. La prochaine édition se déroulera du 4 au 26 mars 2017, et aura pour thème « Jeu et diversion ».
Et même sur Google !
Sur un terrain plus institutionnel et dématérialisé, Google Arts & Culture regroupe sous le projet Curio-cité des expositions en ligne et des explorations urbaines dans des lieux normalement interdits au public, inaccessibles ou même détruits. Ainsi il est possible de « visiter » les sous-sols du palais de Tokyo, la verrière du Grand Palais, ou encore la fameuse tour 13, investie par de nombreux artistes puis démolie.
L'occupation culturelle des lieux souterrains par des collectifs est due à une convergence entre le fait de braver l'interdit, de redonner un but à des lieux désaffectés, de contrer un système « élitiste » de l'exposition, et tout simplement aussi, de partager des moments chaleureux. La plupart de initiatives sont probablement inconnues, tenues secrètes. Faut-il qu'elles restent telles quelles, ou qu'au contraire, il y ait de la communication et donc une ouverture au public ? Une normalisation, une légalisation, une institutionnalisation ? Cela ne risquerait-il pas de les faire disparaître, de déformer ces pratiques si uniques ?
Juliette Lagny
#artsouterrain
#urbex
1 Un cataphile est une personne qui aime visiter les anciennes carrières souterraines de Paris, de manière interdite.
2 Article sur l'exposition au musée des Arts et Traditions Populaires http://www.linstantparisien.com/paris-underground/

CURA : l’art contemporain en scène
Dans le cadre du projet national CURA, les arts visuels s’emparent de la scène. Pour cette saison 2024-2025, le Tandem Scène nationale (Arras / Douai) collabore avec le curateur Mehdi Brit pour proposer quatre événements d’art contemporain. Pour mieux appréhender le projet CURA, nous avons rencontré Fabien Hénocq, secrétaire général du Tandem, et Mehdi Brit.
Logos du Tandem Scène nationale et du projet CURA
Le projet CURA au cœur des scènes nationales
La saison 2024-2025 du Tandem Scène nationale met à l’honneur le curateur, directeur artistique et directeur de projets culturels Mehdi Brit, responsable du spectacle vivant de la région Île-de-France. Fort de son expérience dans les domaines des arts visuels et du spectacle vivant, Mehdi Brit a fondé plusieurs festivals et projets culturels sur la scène française et internationale (Festival de la Croatie et In Process en France, Festival Emerge à l’international (Belgique, Irlande)…), le magazine Revue Diapo, et a publié le premier ouvrage sur l’histoire de la performance en France : Interviewer la Performance. Regards sur la scène française depuis 1960 (2014).
Tandem Scène nationale, dirigé par Gilbert Langlois, réunissant le Théâtre d’Arras et l’Hippodrome de Douai, s’associe au projet CURA durant l’année 2024-2025. Ce projet est initié par le Centre national des arts plastiques (Cnap), l’association des scènes nationales (ASN), le ministère de la Culture et la Direction générale de la création artistique (DGCA). Cette première édition de CURA vise à soutenir la présence des arts visuels et de la pratique curatoriale au sein des scènes nationales. C’est pourquoi ces dernières sont mises à l’honneur dans toute la France pour la saison 2024-2025, comme La Maison de la Culture à Amiens, L’ARC scène nationale du Creusot, le Volcan au Havre, le Phénix de Valenciennes, ou encore la Garance à Cavaillon. C’est une occasion pour ces scènes nationales d’expérimenter une programmation d’art contemporain pour une saison et de faire découvrir la création contemporaine à un large public sur un vaste territoire.
Mehdi Brit s’aventure en région inconnue pour créer un projet conceptuel et expérimental pensé uniquement pour Tandem et ses espaces. Que voir durant les temps forts de CURA ? Des espaces exploités différemment, des actes sur des temps éphémères, ou encore différents spectacles dans une journée qui mêlent performance, danse, chant, audiovisuel. Ce changement de rapport, qui est d’investir des lieux durant toute une journée, est expérimental pour le Tandem. Pour cette saison, nouvel enjeu, nouveau défi : présenter au public des arts visuels de manière pluridisciplinaire qui se manifestent par la découverte de 50 œuvres d’artistes nationaux et internationaux spécialement choisis pour ce projet, présentés pendant huit jours, sur quatre temps.
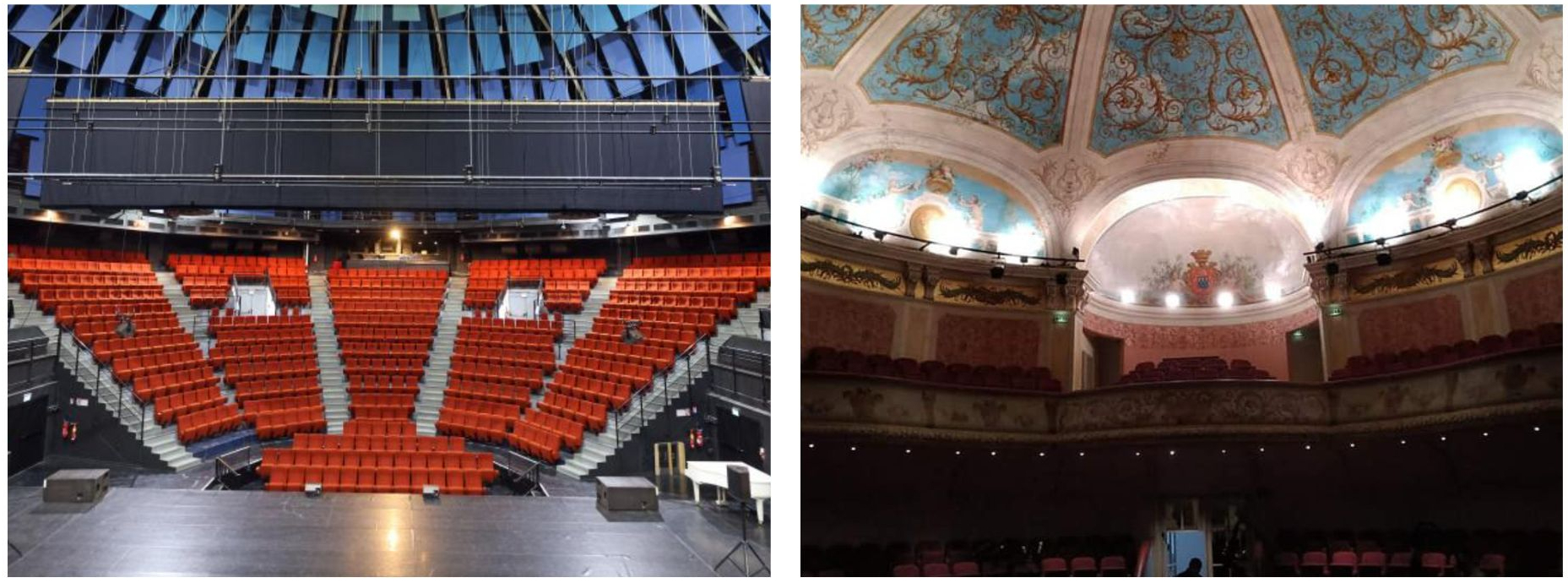
A gauche : L’Hippodrome de Douai, inauguré en 1904, est inscrit comme Monument historique. Il est l’un des six cirques en dur de France © Tandem.
A droite : Une des salles avec coupole à l’italienne du Théâtre d’Arras. Le bâtiment, situé en plein centre-ville, est inscrit comme monument historique © Tandem.
Un événement en quatre actes
Mehdi Brit s’est donné comme fil rouge le tragique et la tragédie : relations humaines, espaces politiques et sociaux… autant de thématiques abordant des sujets sociétaux et associant divers arts, la performance, la musique, la danse, ou encore le chant. Mehdi Brit cite la latiniste et helléniste Florence Dupont, pour qui la tragédie fait figure d’art total car tous les arts sont explorés en son sein. En volonté totalisante de réaliser à travers l’union des arts un rituel impliquant le public, Mehdi Brit invite ce dernier à déambuler dans un spectacle immersif. Établir un lien entre le vivant et le visuel, entre le public et les artistes, ces chapitres jouent à faire dialoguer les corps.

Cyprien Gaillard, Real Remnants 2, © CG.
ACTE I - Entre les deux rives : le regard de la Tempête
Le premier acte s’inspire fortement de la pièce de théâtre de William Shakespeare, La Tempête (1610-1611), qui questionne les questions d’exil, de frontière, de refuge. Ce voyage immersif se tiendra du 22 au 24 novembre 2024 à Douai en compagnie d’artistes tels que Shangguan Zhe ou Korakrit Arunanondchai et de leurs installations en accès libre à l’Hippodrome. Le film du plasticien Cyprien Gaillard, Real Remnants of Fictive Wars I, entre Land Art et romantisme, sera à découvrir au cinéma Paul-Desmarets afin d’appréhender la notion de vandalisme, chère à l’artiste. En salle Obey, durant une trentaine de minutes, la chorégraphe Ola Maciejewska revisitera les danses serpentines inventées par la danseuse américaine du XIXe-XXe siècles Loïe Fuller sous la forme de mouvements changeants, invitant le public à une réflexion sur la métamorphose. Une programmation est associée aux différents actes et proposera en novembre un concert-DJ Set de l’auteur-compositeur-interprète Dominique Dalcan. Le leitmotiv de ces actes sera l’organisation de cycles de rencontres avec la philosophe Fabienne Brugère en lien avec les thèmes abordés dans chaque chapitre. La première table ronde questionnera l’exil.

Korakrit Arunanondchai, Songs of dying © KA.
ACTE II - Quand la catharsis flirte avec le crépuscule
Pour ce second acte symbolisant l’acmé, moment de tension maximale, Mehdi Brit, du 28 au 30 mars 2025, invite 9 artistes internationaux ainsi que des élèves des conservatoires d’Arras et de Douai à envahir la scène, inonder les espaces du théâtre d’Arras. Acte de débordement avec Fireflies, film de Pauline Curnier Jardin qui explore un univers peu orthodoxe qu’est celui des travailleuses du sexe, ou encore énergie euphorisante grâce à la performance de Tarek Atoui abordant en musique des problématiques socio-politiques actuels, Quand la catharsis flirte avec le crépuscule est un acte de chaos, de tension recherchée, afin d’illustrer de puissants moyens d’expression et de revendication identitaire.

Dominique Dalcan © DR.
ACTE III - Le désenchantement, les ruines et le lointain
Après l’euphorie, la redescente. Alors que l’acte précédent traite de tension et de débordement, dans une joie certaine, ce troisième acte aborde la ruine. Installés à Douai les 12 et 13 juin 2025, les artistes présents s’interrogent sur l’effondrement de notre monde, ces différentes causes, tout en gardant une lueur d’espoir. Marcos Ávila Forero, lauréat du prix Ricard 2019, y présente notamment Un autre « Perses » d’Eschyle, une installation, performance, lieu de débat et film qui rapproche les tensions actuelles au Moyen-Orient et cette tragédie antique narrant la bataille entre les Grecs et les Perses. Cette œuvre cohabitera avec d’autres performances ou projections, comme Untitled (Human Mask) de Pierre Huyghe, où l’on observe ce singe au masque d’humain, abandonné dans les ruines de Fukushima. Il s’agit ici de sublimer le désenchantement, d’appuyer sur ce qui va mal pour espérer mieux, d’où le lointain salvateur du titre de l’acte.

Untitled (Human Mask), Pierre Huyghe, 2014 © PH.
ACTE IV - Sublime or Something to love
Et quel meilleur espoir que l’amour ? Le weekend des 14 et 15 juin 2025, Arras accueille une ode à l’amour. Korakrit Arunanondchai est de nouveau exposée pour son film Songs for living, réalisé au moment du déconfinement, qui redéfinit le lien entre l’humain, son environnement, et l’autre. À travers le rapport amoureux, qu’il soit charnel, platonique ou sublimé, l’intention est principalement de finir sur une note positive. La musique a une place importante dans cet acte, avec des musiciens et artistes protéiformes comme Chenchu Rong ou Erwan Ha Kyoon Larcher. Dans toutes les histoires, l’amour est présent, même si les passions sont parfois des souffrances. Aimer l’autre, c’est le regarder différemment, l’analyser d’une façon singulière, et c’est ce qu’explorent les derniers artistes du projet CURA. Le sentiment amoureux est un moyen de fédérer et de sortir de ces ruines. L’amour vient nous réenchanter.

Song for living, Korakrit Arunanondchai, 2022 © KA.
Mais à quoi s’attendre ?
Le projet CURA est un moyen ambitieux de réunir un grand nombre d’artistes, présentant des œuvres hétéroclites et singulières allant de la vidéo à la mode, en passant par la performance. C’est l’occasion pour le Tandem de présenter des œuvres transdisciplinaires, et non pluridisciplinaires. Le projet CURA invite les visiteurs à lâcher prise, à se saisir d’éléments qui leur feront écho. Le temps d’un acte, le théâtre se transforme en espace d’exposition polymorphe.
Mais quels sont donc les publics ciblés ? Ni Arras, ni Douai, n’ont de centre d’art contemporain et les habitués du Tandem sont majoritairement âgés. Cependant, en plus d’être une occasion d’intéresser un public plus jeune, la réalité est que les propositions de Mehdi Brit s’insèrent parfaitement dans la programmation du Tandem. Depuis plusieurs saisons, cette Scène nationale propose des spectacles hybrides mêlant la danse, le théâtre et les arts visuels. Si « l’art contemporain » peut faire peur du fait d’être conceptuel et parfois difficile à saisir, les quatre actes qui ponctuent cette saison trouveront leur public. L’enjeu pour le Tandem est maintenant de communiquer sur ces événements pour donner leurs repères aux spectateurs. Cela passe également par la gratuité de certaines installations, permettant à tout un chacun de s’y risquer. Les actes sont organisés comme des moments de vie, les visiteurs sont invités à investir l’espace différemment, à sortir de l’évidence du rapport aux salles de spectacle, à rester sur les lieux plusieurs heures en profitant d’une offre de restauration.
Le risque est tout de même présent : les œuvres contemporaines sont ici données au public pour qu’il s’en saisisse, qu’il écrive sa propre histoire au travers de ce qui résonnera en lui. Malgré cette volonté fédératrice de rassembler les publics et les artistes dans une forme de communion, il n’empêche qu’un manque de scénarisation peut déranger certains visiteurs qui ont besoin de trouver du sens et de connecter ces œuvres entre elles. La médiation autour de Cura devra être explicite et accessible pour que le contenu des quatre actes produise les émotions escomptées.
Le projet Cura de Mehdi Brit et du Tandem Scène nationale nous invite à être curieux et à découvrir des œuvres d’artistes contemporains, internationaux et reconnus. C’est un événement unique, et non une simple exposition : temps forts, formes variées, sujets actuels qui touchent tout le monde. Sur scène, l’art vivant prend tout son sens.
Nous souhaitons remercier Mehdi Brit et Fabien Hénocq pour ces temps d’échanges qui ont nourri la rédaction de cet article.
Séléna Bouvard & Jules Crépin
En savoir plus :
- Découvrez la programmation des événements de Mehdi Brit au Théâtre d’Arras et à l’Hippodrome de Douai pour la saison 2024-2025 : https://www.tandem-arrasdouai.eu/programme/arts-visuels
- L’appel à projet Cura, c’est quoi? : https://www.cnap.fr/programme-national-cura/appel-projet-cura
#artcontemporain #artsvisuels #scènenationale
David Bowie is...an Alien
« David Bowie is …an alien ». Oui…je n’ai pu m’empêcher de poursuivre le titre de l’exposition car, entre nous,n’est-il pas là pour nous y inciter ? Je saisis donc l’occasion pour vousfaire un débriefing de mon voyage interstellaire à la Philarmonie de Paris.
Créditphotographique : La Philarmonie de Paris
« David Bowie is …an alien ». Oui…je n’ai pu m’empêcher de poursuivre le titre de l’exposition car, entre nous,n’est-il pas là pour nous y inciter ? Je saisis donc l’occasion pour vousfaire un débriefing de mon voyage interstellaire à la Philarmonie de Paris.
“There’sa Starman waiting in the sky. He’d like to come and meet us but he thinks he’dblow our minds […] He told me: Let the childen lose it, let the children use it”[1]
Crédit photographique : P.
Sortie du métro parisien : Leshalles, la cité de la musique, sa verdure et son mobilier urbain rouge. Rien nesemble avoir changé au parc de la Villette. Si ce n’est…cette immense navettespatiale argentée à côté de la cité de la musique. Les reflets du soleilsur ces tuiles d’aluminium m’éblouissent tandis que je me laisse guider vers ce vaisseau intergalactique dédié à la musique inauguré en janvier 2015. Le bâtiment est fascinant.
Mais une fois entré, j’appréhende un peu. Des éléments de constructions trahissent un ouvrage encore en travaux … j’espère simplement querien ne va s’effondrer mais, comme certains fans, je suis trop impatient pour faire demi-tour. Une fois à l’accueil, l’agent m’invite à m’équiper d’un audioguide intelligent. J’écoute ses instructions: « C’est très simple. Il n’y a pas de boutons. Vous avez simplement à vous approcher de l’entrée et l’expositionfera le reste ». Entre scepticisme et excitation, je pose le casque sur mes oreilles. Il grésille. Tandis que je franchis le seuil de l‘exposition, un faible écho musical semble perceptible. Puis l’intro de « SpaceOddity » se met à sonner. Le voyage peut alors commencer.
“Ten, nine,eight, seven, six, five, four, three, two, one, lift off.This is Ground control to Major Tom…”[2]
Dans une ambiance sombre et intimiste, la musique vous emporte et vous berce au gré des séquences qui dépeignent l’artiste. Elle vous fait oublier toute notion de temps. Une première salle nous présente la naissance d’une icône jusqu’à son premier voyage fictif dans l’espace en 69. Des écrits, des dessins, des objets personnels sont accompagnés de cartels que je ne me suis pas lassé de lire. Chaque objet fait sens et ne tombe pas dans l’illustratif.
30 minutes plus tard, je me rends compte que je suis toujours dans le premier espace, à travers le continuum de sa jeunesse. Je prends conscience du monde qui m’entoure. Bowie est autour de nous, il est l’espace dans lequel nous circulons. Le parcours n’est pas uniquement chronologique mais aussi thématique. On retrouve de manière complète mais loin d’être exhaustive ses influences, ses voyages, ses personnages, sa méthode de travail, sa palette d’artiste, ses époques et ses tendances… Les différentes thématiques s’enchevêtrent et se répondent. Elles se font écho l’une l’autre. Voilà ce que cherchent à vous faire ressentir les deux commissaires de l’exposition. Bowie est partout.
Crédit photographique : P.
La mise en espace est d’ailleurs parfois déroutante. Elle prend la forme d’une déambulation dont la musique est la ligne conductrice à travers les différentes planètes de Bowie. Le voyage est parfois frustrant car nous sommes désorientés par la profusion de séquences mais cela est pardonnable. David Bowie a toujours voulu déstabiliser son public au travers de ces multiples facettes. L’exposition ne fait que suivre les différentes directions que sa carrière a tracées.
Au départ, nous nousimaginons que la musique évolue au fil de notre pérégrination mais ce n’est pas le cas. Ce sont nos déplacements à proximité de points stratégiques qui déclenchent le son et nous guident à travers l’exposition. Ce n’est plus uniquement le regard qui invite à appréhender l’espace mais aussi le son. Nous pouvons entendre la voix de Bowie chanter, jouer et nous parler au creux de notre oreille. Il est là quelque part autour de nous.
“Changes. Turn and face the strange […]Changes. Just gonnahave a different man. Time may change me but I can’t trace time”[3]
Nous regardons des indices : des brouillons de ses textes, des accessoires de scènes ou encore des mannequins portant ses costumes de scènes. Seulement il suffit de regarder autour de soi pour se rendre compte que la fréquence audio est toujours associée à un écran. Et c’est peut-être là que le bât blesse. Le visiteur est inlassablement invité à se tourner vers un écran ou une projection murale. Cela nuit parfois au confort de l’exposition. Le public s’agglutine devant les écrans et les costumes mis en scène. La circulation devient alors perturbée et on est à la limite de perdre patience pour voir une simple vitrine.
Si l’afflux de visiteurs est un obstacle à travers cette quête de Bowie, observer le public m’a captivé car, dans ce voyage dans l’univers de Bowie, nous ne sommes pas aussi seuls que le suppose ce casque qui isole. Le public se permet des petites libertés. Les fans chantent comme à la maison, les adeptes se laissent aller à faire des commentaires à haute voix : l’ambiance est conviviale. Bowie est partout !
Un damier au sol en interaction avec neuf écrans nous le traduit ingénieusement. Selon neuf cases sur lesquelles vous vous placez, le son d’un des clips diffusés sur un des écrans se déclenche. D’une case à l’autre vous voyagez à travers ces différentes dimensions. Bowie n’est pas qu’une étoile mais plusieurs étoiles qu’il a été, qu’il est et qu’il restera. En y pensant, nousne sommes pas loin de l’adoration et du culte de la personnalité.
Crédit photographique : P.
“Believingthe strangest things, loving alien…”[4]
Pour ceux qui ont été envoûtés par le chant des sirènes…ou plutôt de Bowie …Il vous est possible de finir votre visite dans une salle d’ambiance. Affalé dans un canapé, des images deconcerts de Bowie sont projetées sur l’ensemble des parois en toile derrière lesquelles se cachent des costumes flottants dans l’obscurité. A défaut de trouver une place pour profiter pleinement de cette aire de repos après près de 2h d’exposition, je quitte le navire à contre cœur. A la sortie, délesté de mon équipement auditif, la lumière de l’extérieur et le passage inévitable par la boutique me ramènent brutalement sur terre. Mais c’est avec les yeux et les oreilles pleines d’étoiles que je repars de cette exposition.
Exposer Bowie est un défi brillamment relevé pour les fans comme pour les novices. La presse n’a de cesse de parler d’ « Odyssée », de « Voyage dans l’espace », d’ « Ovni » à propos de Bowie et son exposition. Les qualificatifs ne sont pas de trop à la Philharmonie de Paris. Le lieu, de par sa fonction et son architecture, est l’endroit idéal pour accueillir la rétrospective de la vie de cette icône. L’exposition dépeint un esprit infiniment miroitant et polymorphe. L’exploit est réussi. Il ne vous reste plus que jusqu’au 30 mai 2015 pour partir en voyage sur Mars avec David Bowie, l’extraterrestre aux yeux vairons.
“Oh man ! Look at those cavemen go. It’s a freakiest show. Take a look at the Law man beating up the wrong guy. Oh man! Wonder if he’ll never know? He’s in the best selling show.Is there life on Mars?”[5]
Persona
Pour en savoir plus :
http://davidbowieis.philharmoniedeparis.fr/
#David Bowie
#Musique
#Immersion
[1] Bowie David, Starman, The Rise and Fall of ZiggyStardust and the Spiders from Mars, 1872.
[2] Bowie David, Space Oddity, Space Oddity, 1972.
[3] Bowie David, Changes, Hunky Dory, 1971.
[4] Bowie David, Loving the Alien, Tonight, 1985.
[5] Bowie David, Life on Mars ?, Hunky Dory, 1971.

Deux temps forts au Mémô
Chaque année, le collectif Nancéien "Le Mémô" est créateur de moments culturels forts dans la région comme Les Escapades et le Festival Michtô. Programmés en automne, ce sont des rayons de soleil avant la grisaille de l'hiver... Focus sur deux événements marquants de l'année !
Le collectif
«La culture est un bien commun, un outil puissant et fédérateur qui contribue à donner à chacun les clés de l’émancipation.» Le Mémô
Le MEMÔ, c'est un collectif, un espace de rencontres entre artistes, techniciens, publics de tous horizons, habitants du quartier Sauvoy et professionnels du milieu culturel. Il s'est construit en 2015 à Nancy, et organise tous les ans un festival d'arts et spectacle de rue : Michtô. La volonté d’ouvrir le champ des possibles, c'est aussi un point de ralliement immanquable pour toutes les personnes qui prennent part à la construction du projet !
Les escapades
C'est l'effervescence au Haut Du Lièvre ! Plusieurs semaines par an, le collectif co-construit un projet artistique avec les quartiers dits populaires de Nancy et une compagnie d'art et spectacle de rue. Ils/elles s’installent dans un lieu, une rue, devant les écoles. Au fil des jours, les habitants du quartier, passants, mères de famille, enfants, instituteurs, joggeurs, grand-pères deviennent curieux, et avec le bouche à oreille rejoignent la création collective.
Il y a deux ans, c'est la compagnie de théâtre de rue et marionnettiste Bread & Puppet qui, avec leurs valises remplies de papier mâché et de révolte s'est installée dans les rues. Comme marque de fabrique, un vieux bus totalement transformé porte la parole des habitants mis à l'écart de la ville : "Les possibilitaires chient sur les impossibilités !","Ce capitalisme doit s'arrêter maintenant !", "Les mains ôtées aux citoyens doivent leur être rendues ET dans un état amélioré!..." Et puis comme ça, avec un bus un peu bavard, les escapades commencent ! Allons-y !

Décoration du bus - On le peint en noir et on gratte la peinture fraîche pour dessiner. Crédits: Alexis Pernet

Exemple de phrase engagée qui recouvre le bus. Crédits: Alexis Pernet
C'est alors le top départ de la création de la parade révoltée qui serpentera les rues. Matériel à disposition : du carton, des agrafes, de la peinture, du papier et de la colle. Tout a été récolté dans la rue, ou par dons ! Fabrication de marionnettes de vache, de sanglier, d'oiseaux, d'animaux divers et variés et de toute les tailles : pour les grands, pour les petits, à deux, à trois, à quatre, ou tout seul... Slogan choc, la parade est accompagnée d'une fanfare qui, à coups de trombone et de tambour, réveille le quartier et invite les habitants à descendre de leur immeuble pour se joindre à la déambulation. À la fin, sur une petite placette entourée d'arbres, une "constatoria" (conte chanté) sur le thème du COURAGE commence. "Courage d'être nu !", "Courage de se sortir de la boue !", "Courage de planter ce qui manque !", "Courage de détruire quand nécessaire !", "Courage de penser", "Courage de repenser !", "Courage d'abandonner !", "Courage de ne pas abandonner !", "Courage de parler !", "Courage de décider !"... Tout le monde crie qu'il faut se donner du courage ! Des regards, des larmes qui montent, des mains qui se tiennent, des corps qui s'enlacent... Quelle aventure !

Panneau en carton qui etait au devant de la parade. Nom de la manifestation. Crédits: Alexis Pernet
Le festival Michto
Ce fameux projet Michtô est né en 2006 de l’engagement de copains d'école, étudiants de théâtre à Nancy qui ont grandi ensemble. Passionnés de théâtre de rue, ils ont été bercés par la légende du festival Mondial de théâtre souvent évoquée par leurs aînés comme symbole d’une époque révolue, d’une époque où tout était à écrire et où tout était possible. Ils ont été formés et accompagnés par des acteurs de cet événement encore aujourd’hui décrit comme une utopie théâtrale, l'âge d'or du théâtre de rue. Le collectif "Le Mémô", porteur du festival Michtô a laissé la place à la spontanéité pour, comme l’avait fait son aîné, réinventer un moyen d’expression parallèle à celui des structures culturelles conventionnelles.
Chaque année, en octobre : un appel à participants est construit ensemble ! Une armée de bénévoles et de professionnels s'allient et, sur plusieurs semaines, vivent une aventure à la fois commune et singulière. En choisissant la voie du collectif et de la co-construction, le festival se démarque d’autres expériences plus conventionnelles. Ici, les codes sont régulièrement repensés puisqu'ils émanent directement des acteurs impliqués. Team communication, accueil du public, restauration, accueil des artistes, régie, lumière des spectacles, scéno... Un melting-pot de compétences mis au profit d'une création artistique et culturelle commune!
Depuis plus de 10 ans, Michtô agite la ville et est une parenthèse de 2 semaines colorée et artistique dans la grisaille de l’automne.
Ce festival a pour but de permettre l'accès à la culture de qualité pour tous. Un des points forts et engagé pour les spectacles, la tarification : différents tarifs sont proposés : le tarif de base pour tous les spectacles à l'intérieur du chapiteau (5€) et le tarif dit solidaire (8€). Le second tarif à 8€ n'apporte rien de plus pour le spectateur, mais permet à d'autres de pouvoir payer moins cher. Sur la base du volontariat, c'est un modèle qui rencontre un franc succès à chaque édition ! Il n'y a pas de document à fournir pour payer le tarif à 5€. La stigmatisation par le revenu, on n’en veut pas !
Alexis
Pour en savoir plus :
Site du mémo http://www.le-memo.com/
Le festival et la programmation : http://www.festivalmichto.com/
#ArtVivant #ArtDuSpectacle #ActionCulturelleEtMediation

Et la lumière fut !
Cette année, Reims fête comme il se doit le huit centième anniversaire de sa cathédrale. Chef-d’œuvre de l’architecture gothique, cette dernière s’est vue ornée des nouveaux vitraux d’Imi Knoebel. L’artiste contemporain allemand répond ici à une commande publique soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication. Ce n’est pas la première fois que des vitraux d’édifices religieux rémois sont réalisés par des artistes contemporains. Leurs implantations témoignent du savoir-faire des maîtres verriers locaux tel que Simon Marq.
© Musée des Beaux-arts de Reims
À cette occasion, le musée des Beaux-arts de Reims présente une exposition dédiée aux vitraux et à leur changement de perception grâce à ces artistes. Cette irruption de l’art profane dans un contexte sacré et dans une spécification artisanale fait écho à la reconstruction de quantité d’édifices religieux après les grandes guerres mondiales. Tel est le fil conducteur de cette exposition intitulée Couleurs et lumières : Chagall, Sima, Knoebel, Soulages… des ateliers d’art sacré au vitrail d’artiste.
En parallèle avec la mise en lumière et couleur exceptionnelle de la façade de la cathédrale de Reims, les commissaires David Liot, directeur du musée et Catherine Delot, conservatrice en chef, nous entraînent dans un parcours initiatique avec le travail du verre, de la couleur et de la lumière. Dessins, croquis, préparations, mais aussi focus sur les artistes qui marquent le renouveau du vitrail et son évolution : cubisme, fauvisme, abstraction.
Ainsi, on retrouve le travail préparatoire d’Imi Knoebel : du rouge, du jaune et du bleu dans tous les sens ! Ces couleurs primaires, qui font partie de la palette de l’artiste, font résonance avec celles utilisées par les maîtres verriers jusqu’au 19ième siècle. Pour mettre son travail en condition, les commissaires de l’exposition ont opté pour une remarquable approche : un vitrail de l’artiste a directement été inséré au cœur de l’un des murs du musée ouvrant la perspective sur la cathédrale !
Ceux qu’il a réalisés pour la cathédrale de Reims prennent place de part et d’autres des vitraux qu’avait achevés en 1974 Marc Chagall. Dans cette lignée, le musée des Beaux-arts de Reims nous présente le travail de Chagall, bien-sûr la préparation des vitraux de la cathédrale de L’ange au sourire, mais aussi ceux qu’il a exécutés pour d’autres églises. Ainsi le travail de Sima, de Da Silva, qui ont eux aussi travaillé le verre sur d’autres édifices religieux rémois, mais aussi toute la genèse des vitraux de Pierre Soulages à l’abbaye de Conques sont exposés.
On comprend vite à quel point la création contemporaine a su saisir l’opportunité de s’immiscer là où l’on ne l’attendait plus. La lumière et le verre comme médium permettent de travailler la couleur, la translucidité et de révéler les architectures sacrées. Ainsi en témoigne le parti pris de la scénographie d’exposer sur des cimaises colorées, plongeant le visiteur dans l’ambiance émanant de chaque artiste. Les vitraux et esquisses sont d’une grande splendeur, leur mise en situation est vraiment très réussie, surtout pour une exposition consacrée aux vitraux et donc à la lumière. En effet, nombre d’entre eux sont exposés dans des caissons lumineux en fer forgé, tel le plomb d’un vitrail, laissant apercevoir les détails et autres imperfections du verre, devant nous, à posture humaine. Splendide !
Catalogue de l’exposition, Co-édition Point de vues et Musée des Beaux-arts de Reims
Heureusement, pour pallier ce bémol, un magnifique catalogue a été réalisé afin de pousser plus loin la réflexion sur le vitrail, rappelant les liens fondamentaux entre l’artiste et le maître verrier, la couleur, le verre et la lumière.
Romain Klapka
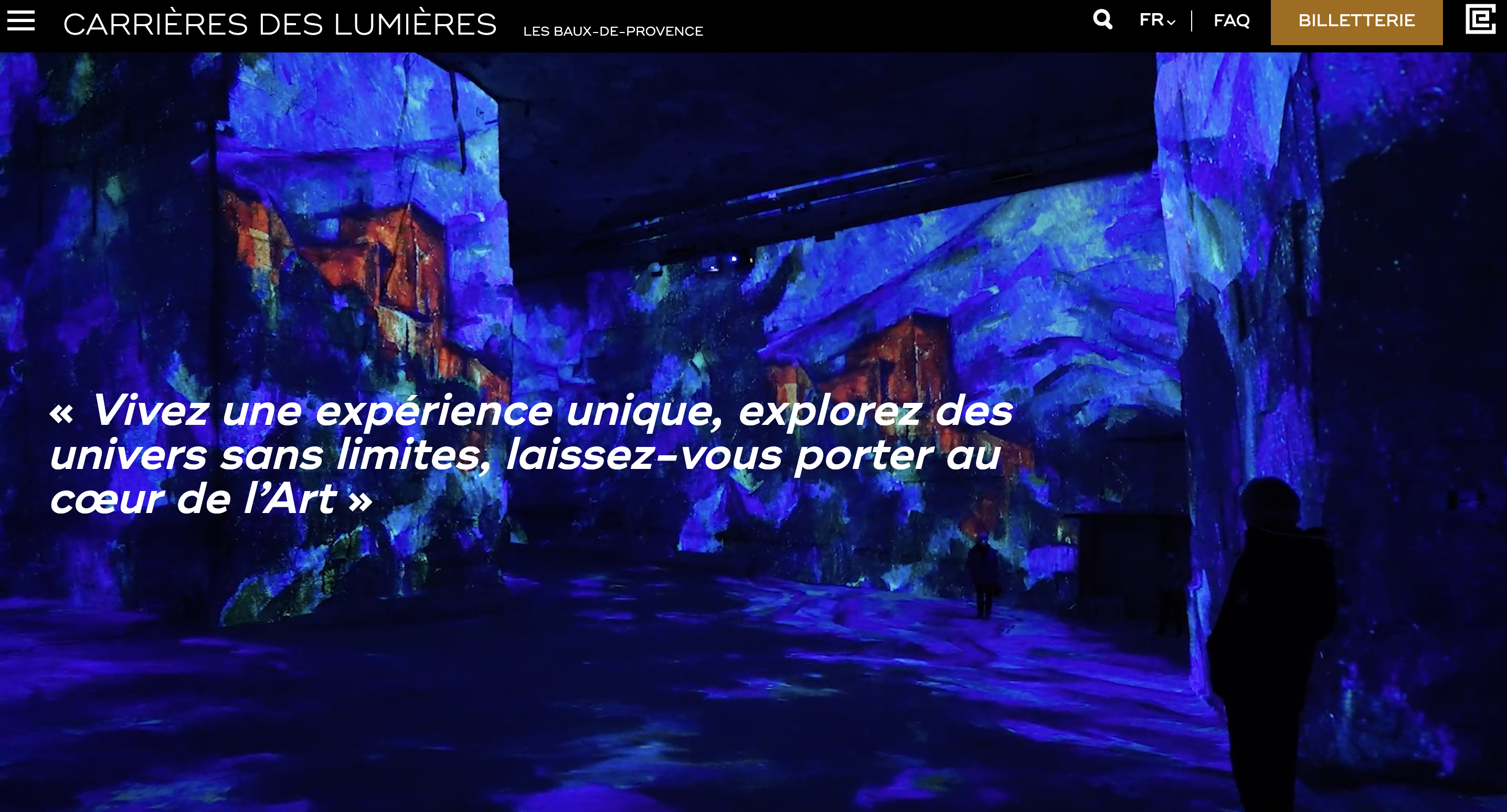
L'immersif, un appât des publics
Certains de mes amis « n’aiment pas » l’Art. Face à ma mine déconfite, ils concèdent souvent qu’ils préfèrent le « vrai Art », à savoir celui du réalisme, de la précision, du détail, de la technique et de la beauté — au sens kantien du terme. Pourtant, ils se surprennent eux-mêmes à s’émerveiller devant des expositions d’un genre nouveau : l’Art Immersif. Sorties de leurs cadres, la peinture et la photographie se métamorphosent en immenses projections sont les yeux ébahis de leurs nouveaux publics. La sculpture n’a rien à leur envier : elle invite à présent le visiteur à la traverser au lieu de la contourner. Parfois à l’aide d’un casque de réalité virtuelle, l’image et le son remplissent l’espace et enveloppent le spectateur. Les cinq sens sont occasionnellement mobilisés.
Image d'intro : site web de la Carrière de Lumières
Un succès commercial
L’entreprise privée Culturespaces, cinquième acteur culturel français pour les monuments, musées et centres d’arts, se décrit comme un « pionnier des centres d’art numérique et des expositions immersives dans le monde ». Les chiffres attestent de leur succès : leur premier espace la Carrière des Lumières à Baux-de-Provence accueillait 239 000 visiteurs à son ouverture en 2012. Aujourd’hui, ils sont près de 770 000 chaque année. En 2017, l’espace obtient le prix de « la meilleure expérience immersive au monde », décerné par l’association à but non-lucratif Themed Entertainment Association qui récompense majoritairement… des attractions de parcs à thème.
Après le succès de l’Atelier des Lumières (le premier centre d’art numérique de Paris, 1 400 000 visiteurs/an, 2018), du Bunker des Lumières (Jeju, île sud-coréenne, 2018), du Bassin des Lumières (le plus grand centre d’art numérique au monde, 14 500 m² de surface de projection, 2020), leurs espaces d’expositions immersives se multiplient et s’exportent à l’étranger. Entre 2021 et 2022, Culturespaces inaugurera quatre nouveaux lieux à Dubaï, New-York, Séoul et Amsterdam.
La société produit deux types d’exposition : des « expositions temporaires classiques » dans les musées dont elle assure la gestion (Musée Jacquemart-André, Musée Maillol, Hôtel de Caumont…) et des « expositions numériques immersives » où se succèdent des peintres du XIXe et du XXe siècles (Van Gogh, Monet, Chagall, Gauguin, Klimt, Dali, Picasso…) et de la Renaissance (Michel-Ange, De Vinci, Raphaël, Bosch, Brueghel, Arcimboldo…). Dans un format plus court, elle propose aussi des expositions sur Kandinsky, Paul Klee, Yves Klein… voire des créations d’artistes contemporains. On ne saurait leur reprocher que toutes leurs expositions numériques soient quasi-identiques d’un espace à l’autre : il est plus simple de transporter une exposition numérique qu’une exposition faite de chefs d’œuvre uniques et aux valeurs inestimables, surtout à l’international.
Ces expositions ne sont-elles donc pas l’occasion pour les visiteurs de découvrir ou de redécouvrir les travaux des peintres les plus célèbres ? C’est en tout cas la volonté affichée par la Fondation Culturespaces dont la mission est de « permettre aux enfants les plus fragilisés d’avoir accès à l’art et au patrimoine pour éveiller, développer et révéler leur créativité […] afin de lutter contre les inégalités d’accès à l’art et au patrimoine ». Une initiative louable et sans doute bienvenue lorsque que l’on s’intéresse aux tarifs de l’Atelier des Lumières.
Source : site web de l’Atelier de Lumières
Dans leur Sociologie de la démocratisation des musées (2011), Jacqueline Eidelman et Anne Jonchery donnent les chiffres suivants concernant les visiteurs des musées parisiens : « Sous l’angle de leur inscription sociale, les 18-25 ans sont […] en majorité issus des classes moyennes (45 %) et de la classe supérieure (30 %), mais le quart d’entre eux provient d’un milieu modeste : ce sont ces derniers qui s’avèrent les plus mobilisés par la gratuité. […] Au total, les visiteurs âgés de 18 à 25 ans pensent que la gratuité constitue un « coup de pouce » ou un « plus » à leurs pratiques culturelles (85 %). »
La logique commerciale de Culturespaces n’est cependant pas à décrier pour autant. La majorité des expositions immersives affichent des tarifs similaires, et présentent au moins l’avantage d’être plus intuitives et accessibles que les expositions dites classiques. L’exposition teamLab : Au-delà des limites présentée à la Grande Halle de la Villette en 2018 proposait ainsi une belle entrée en matière d’art numérique contemporain. Cette dernière plongeait ses visiteurs dans un univers psychédélique et les rendaient acteurs de l’immersion : toucher la cascade numérique pour qu’elle s’écarte, s’assoir sur le sol et contempler les fleurs pousser autour de soi…
L’immersif au musée
Pour autant, il ne faut pas confondre œuvre et expérience de l’œuvre. Pour Isabelle Cahn, historienne de l’art « on doit pouvoir avoir la liberté d’interpréter les œuvres […] Mais il faut trouver un juste équilibre entre pédagogie et divertissement. Les procédés immersifs, la 3D ou la réalité virtuelle peuvent réellement aider à mieux regarder les œuvres ». Vincent Campredon, directeur du Musée national de la marine à Paris confie ainsi au Monde : « Un musée a une mission de conservation des œuvres. Mais il doit aujourd’hui parler aux jeunes, être plus accueillant, plus collaboratif. Les publics doivent être au cœur de nos préoccupations ». Dans le même article, Constance Guisset, scénographe, explique : « Si on veut que les expositions ne soient pas réservées aux “sachants”, il faut aujourd’hui les mettre en scène un peu comme un spectacle ».
De nombreux musées tentent donc de développer leur attractivité en proposant des expériences immersives, même partielles, au sein de leurs expositions. Parfois, ce sont quelques œuvres qui sont placées en début de parcours, ce qui a l’avantage de marquer la visite. Prenons l’exemple de l’exposition — très instagrammable — Colors qui a récemment pris fin à Lille3000. L’une des œuvres, First Light de Georg Lendorff, invite le visiteur à traverser ses milliers de fils suspendus pour entrer dans un espace spatio-temporel hypnotique, mobilisant simultanément la vue, l’ouïe et le toucher. Effet garanti.
Certaines institutions semblent se lancer un défi de plus grande envergure. En janvier 2021, la Banque des Territoires, au titre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat, et VINCI Immobilier annonçait la création de Grand Palais Immersif, une « nouvelle filiale spécialisée dans la production, l’exploitation et la diffusion d’expositions numériques, pour le public parisien, national et international ». Pour l’instant, en France en tout cas, les expositions et musées entièrement immersifs sont donc l’affaire de grands groupes internationaux, comme le prouve encore le musée immersif de la marque Yves Rocher situé à La Gacilly en Bretagne.
Source : site web du Musée immersif Yves Rocher
Fun fact : en 2019, l’ICOM a demandé à chacun de ses pays membres de donner une ou plusieurs propositions de re-définition du musée. Parmi les 269 définitions formulées, le Qatar était le seul pays à inclure la notion d’expérience immersive.
L’immersif est probablement un appât pour un public friand de spectacle, mais il ne faut pas pour autant le condamner. Ces nouvelles mise-en-scène numériques ont l’avantage de proposer un contenu accessible qui ne nécessite pas de connaissances préalables ou de sensibilité particulière. Elles se laissent apprécier en toute simplicité. Dans le cas des productions Culturespaces, peut-être piqueront-elles la curiosité de nouveaux publics pour les musées ?
Il ne s’agit pas de remplacer les œuvres par des expériences : ce n’est pas la vocation de nos musées et de toute façon, nos institutions n’en ont pas les moyens financiers. Les professionnel.le.s des musées doivent trouver un équilibre entre le fond et la forme. Trop de fond, c’est lourd ; trop de forme, c’est vide.
Emma Levy
Pour aller plus loin :
-
Eidelman, J. & Jonchery, A. (2011). Sociologie de la démocratisation des musées. Hermès, La Revue, 61, 52-60.
-
L’exposition Team Lab de la Villette (2018)
-
Lesauvage, Magali. (2019, 15 mars). Les expositions immersives : in ou out ? Le Quotidien de l’Art.
-
Pietralunga, Cédric. (2021, 3 novembre). Expérience immersive et objets parlants : les musées innovent pour attirer un nouveau public. Le Monde.fr
-
Propositions de définitions du musée par l’ICOM
-
Sonveau, Aimé (2022), Expérience sensorielle, sensationnelle ou sensible ? L'art de Muser
#immersif #experience #numérique

L’éloge, le spectacle vivant à l’ère du digital
En pleine mutation numérique, le spectacle vivant trouve une nouvelle voie pour toucher un public plus large grâce à des initiatives innovantes. Parmi celles-ci, L’éloge, un média culturel fondé en 2020 par Constance Arnoult et Anaëlle Malka, démontre que les plateformes digitales comme Instagram peuvent être des outils puissants pour promouvoir les arts de la scène.
Une initiative née durant le confinement
L’idée de créer L’éloge a germé pendant le confinement de 2020, une période propice à l’exploration de nouveaux formats. Constance Arnoult, danseuse passionnée et ancienne élève du Conservatoire de Tours, a commencé par partager des recommandations littéraires sur Instagram. Le format des « Claques littéraires » court, rythmé et frais, fonctionne. Face à l’enthousiasme suscité par ses vidéos, elle s’associe avec son amie Anaëlle Malka pour créer un compte Instagram relayant leurs coups de cœur culturels : littérature, cinéma, danse. Leur objectif ? Dépoussiérer l’image parfois élitiste des arts de la scène et les rendre accessibles à un public jeune.
 Constance Arnoult et Anaëlle Malka devant le Théâtre du Châtelet © India Lange
Constance Arnoult et Anaëlle Malka devant le Théâtre du Châtelet © India Lange
Quatre ans après, l’on peut dire que le succès est au rendez-vous : avec près de 40 000 followers sur Instagram, L’éloge fait office de figure de proue dans son domaine. L’équipe rédaction s’est agrandie avec Dobra Szwinkel et Emma Lavenka pour continuer à produire du contenu toujours plus qualitatif. Le média est relayé et reconnu : Vanity Fair leur accorde un article à l’occasion de la cérémonie Les Éloges. La liste des partenariats s’allonge et l’on fait confiance au média : l’équipe est régulièrement invitée à venir en coulisses de divers spectacles comme en octobre dernier où le média était invité à filmer les behind the scene des répétitions du gala d’ouverture du Palais Garnier. Les maisons Guerlain et Cartier sont fréquemment partenaires d’événements réalisés par L’éloge.
Une diversité de contenus
Aujourd’hui, L’éloge propose une vaste gamme de contenus : des interviews et chroniques sur le théâtre, le ballet et l’opéra, mais aussi des guides sur les expositions et sorties cinématographiques. Le principe des « Claques littéraires » est poursuivi et s’étend à d’autres domaines : les cabarets, les comédies musicales, etc. Le média relaie l’actualité du spectacle vivant en France, à Paris principalement, et plus rarement à l’échelle internationale. Ainsi, des guides concernant l’actualité des sorties des 7 arts sont publiés par saisons avec un bref décryptage du synopsis des spectacles en question et des informations pratiques.
 Publication Instagram « Le guide, coups de cœur du off Avignon » © Maria Clauzade
Publication Instagram « Le guide, coups de cœur du off Avignon » © Maria Clauzade
L’éloge met en avant des nominations et attributions de rôle comme celle de Roxanne Stojanov en tant que danseuse étoile de l’Opéra de Paris ou encore Angelina Jolie dans le biopic de Maria Callas en tant qu’interprète de la célèbre cantatrice. Les posts sont des rencontres filmées avec des acteurs du spectacle vivant dans les coulisses de leur travail pour échanger sur leur métier ou évoquer leurs propres recommandations culturelles à l’instar de l’actrice française Anna Girardot qui s’est prêtée au jeu. Ces vidéos sont généralement un format court d’une à trois minutes maximums, correspondant parfaitement à la plateforme Instagram. Les « Starter Pack », des focus sur des personnalités, viennent compléter le tableau des contenus proposés par L’éloge.
 Compte Instagram de L’éloge © L’éloge
Compte Instagram de L’éloge © L’éloge
Les posts sont publiés majoritairement sur Instagram et sur YouTube. Quelques rencontres ont été enregistrées en podcast, disponibles sur toutes les plateformes de streaming audios, bien que ce ne soit pas plus approfondi par le média.
L’approche de L’éloge se distingue par sa vision positive : l’équipe de rédaction présente uniquement des spectacles et œuvres qu’elles apprécient. En s’abstenant de toute critique négative, elles ne s’inventent pas critiques d’art et valorisent foncièrement l’essence créative et humaine des arts de la scène.
La Cérémonie Les Éloges : une ode au spectacle vivant
En complément de leur activité en ligne, L’éloge organise depuis 2023 une cérémonie annuelle pour célébrer les arts scéniques avec comme partenaires le Théâtre du Châtelet, Vanity Fair et la French Touch. À l’image des Molières, cérémonie de récompense du théâtre français et des Trophées de la comédie musicale, Les Éloges propose une cérémonie qui récompense tous les acteurs du spectacle vivant, artistes comme artisans. La première édition, tenue au Théâtre du Châtelet en octobre dernier, présente des catégories mettant à l’honneur des chefs d’ateliers perruques, coiffures et maquillage, des chorégraphes, des chefs d’ateliers costumes et designers ou encore scénographes.
 Constance Arnoult, Elysée Moon, Dobra Dobra Szwinkel et Emma Lavenka à la cérémonie L’Eloge© India Lange
Constance Arnoult, Elysée Moon, Dobra Dobra Szwinkel et Emma Lavenka à la cérémonie L’Eloge© India Lange
La seconde édition, en 2024, a confirmé le succès de cet événement. Avec la drag-queen Elysée Moon comme maîtresse de Cérémonie, le metteur en scène Vincent Huguet en parrain de cette édition, les Éloges a récompensé des figures emblématiques telles que Marina Hands, comédienne et metteuse en scène, qui a reçu l'Éloge d’Honneur. La Claque, prix donné par les fondatrices de L’éloge, a été attribué au spectacle L’Art de la Joie d’après Goliarda Sapienza, pièce mise en scène par Ambre Kahan. Enfin, l'Éloge du Public est revenu à Mais quelle Comédie ! spectacle musical conçu et mis en scène par Serge Bagdassarian et Marina Hands joué à la Comédie Française.
 Marina Hands, Eloge d’Honneur 2024 © Jean-Louis Fernandez
Marina Hands, Eloge d’Honneur 2024 © Jean-Louis Fernandez
Cette soirée festive, placée sous le thème des arts forains, a été émaillée de performances artistiques vibrantes : d’un défilé Repetto par la compagnie Gam en passant par une performance de cirque de la compagnie Le Roux. La cérémonie Les Éloges réaffirme le rôle essentiel des arts de la scène dans notre société.
Mais une définition du spectacle vivant qui a ses limites
Malgré les nombreuses qualités de L’éloge, un élément clef semble manquer à leur initiative : la représentativité de la diversité du spectacle vivant. En se concentrant exclusivement sur les formes traditionnelles scéniques telles que le théâtre, l’opéra, le ballet et le cinéma, les expressions artistiques non-conventionnelles et contemporaines sont délaissées comme les arts de la rue, la scène drag ou humoristique. La subjectivité du média atteint là sa limite : en cantonnant le spectacle vivant uniquement aux arts scéniques, L’éloge réduit la visibilité de ce dernier. Bien qu’il y ait une ouverture dans les thématiques abordées avec des contenus portant sur les cabarets ou encore les arts de la marionnette, le choix des contenus mis en avant reste essentiellement traditionnel et à destination d’une certaine catégorie sociale. Ce parti-pris, bien que défendable, peut sembler réducteur voire même trompeur, car il ne reflète pas la richesse et la pluralité du spectacle vivant dans sa globalité, ni la volonté revendiquée par le média de rendre la culture plus accessible. Intégrer ces formes alternatives d’expressions artistiques enrichirait leur démarche de manière plus inclusive et représentative des réalités actuelles des arts de la scène. À quand une Claque Humoristique à propos du spectacle Attends-moi j’arrive ! d’Emma Bojan ou encore une Claque Circassienne sur Le Souffle de Mellia de la compagnie équestre L’Art est Cabré ? Le média aurait tout à gagner – public et enrichissement - à ouvrir leurs thématiques, sans pour autant diminuer la qualité de leur contenu. De plus, on note également que les recommandations culturelles faites par L’éloge sont en grande majorité concentrées autour de Paris. À nouveau, on observe une volonté d’ouvrir le sujet en s’intéressant aux grandes villes de France comme le montre la rencontre avec la danseuse étoile Mathilde Froustey à l’occasion du ballet Casse-Noisette à l’Opéra de Bordeaux ou encore la mise en avant du Festival d’Avignon. Cependant, ces initiatives restent minoritaires en comparaison avec le tropisme parisien de leur contenu. Les partenaires auxquels s’associe L’éloge peuvent aussi être interrogés. Pourquoi ne pas les diversifier en mettant en lumière des structures de la culture plus petites qui auraient besoin de plus de visibilité ? Peut-être une marge d’évolution pour L’éloge dans les années à venir ? Affaire à suivre.
Un avenir fait de projets nombreux
À sa manière, L’éloge incarne une nouvelle façon de mettre en avant les arts du spectacle vivant dans une société où les réseaux sociaux sont les premiers moyens de communication. Le travail de L’éloge rappelle que le spectacle vivant, loin de s’éteindre face aux technologies, peut s’enrichir et toucher un large public.
Constance Arnoult dans un interview donné à la French Touch, évoque des projets futurs allant de collaborations internationales, à la création d’un festival en passant par le rachat d’un théâtre. L’avenir de L’éloge s’annonce à son image : brillant.
Louise Cherel
Pour aller plus loin :
Compte Instagram de L’éloge : @l_eloge_
Compte Instagram Prix du spectacle vivant Les Éloges : @les_eloges
Article Vanity Fair sur la cérémonie Les Éloges : https://www.vanityfair.fr/galerie/les-eloges-une-ceremonie-hors-des-clous-pour-celebrer-le-spectacle-vivant-dans-ce-quil-a-de-plus-vibrant
#spectaclevivant #lEloge #media

L’expo Métal par une non-métalleuse
« Les sept Chapelles du Métal », Exposition « Metal. Diabolus in Musica » à la Philharmonie de Paris ©E.L

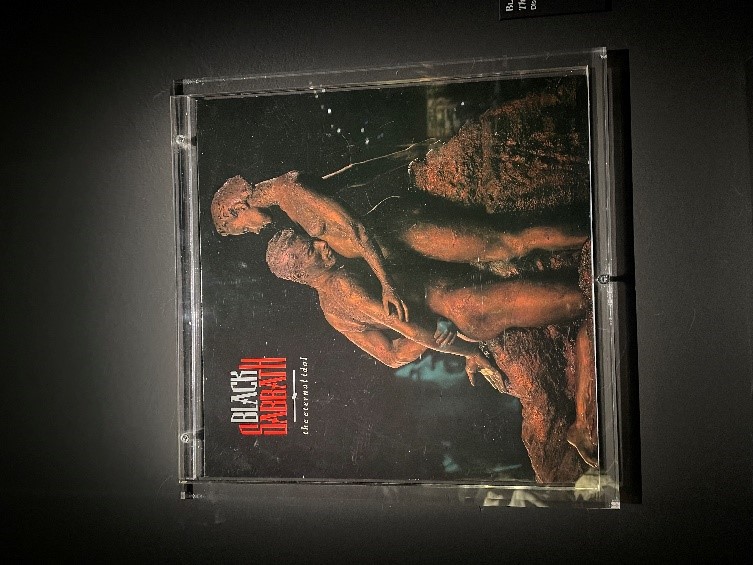
« L’éternelle Idole » de Rodin mise en relation avec l’album des Black Sabbath, The Eternal Idol ©E.L

Face à l'entrée dans "les sept chapelles du metal". Moment où le titre Thunderstruck de AC/DC a joué. ©E.L
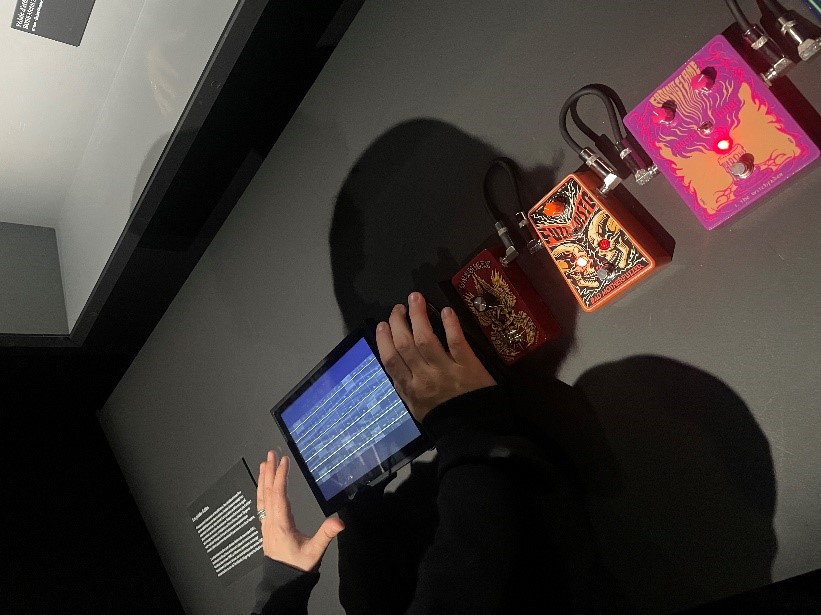
Manipe qui permet de simuler les différents effet des pédales sur une guitare électrique ©E.L

Espace immersif au cœur du Hellfest ©E.L
Southern fist
Rise through that jungle mist
Clenched to smash ower so cancerous
Black flag with a red star
A rising sun loomin over Los Angeles
Yes for Raza livin in LaLa
Like Gaza on to that dawn Intifada
Reach for the leassons that masked pass on
Seize that metropolis
Its you built on
Everything can change on new years day

Détail caché : certains mannequins font le signe des cornes (autrement appelé cornes du diable) ©E.L
L’exposition entre en scène
Lorsque le théâtre rencontre l'exposition ? La metteuse en scène Liza Machover désacralise et transforme cet espace en un lieu d'exposition où les spectateurices sont prié.e.s de "s'activer".
© Cyrielle Voguet - Stéphane Toque.
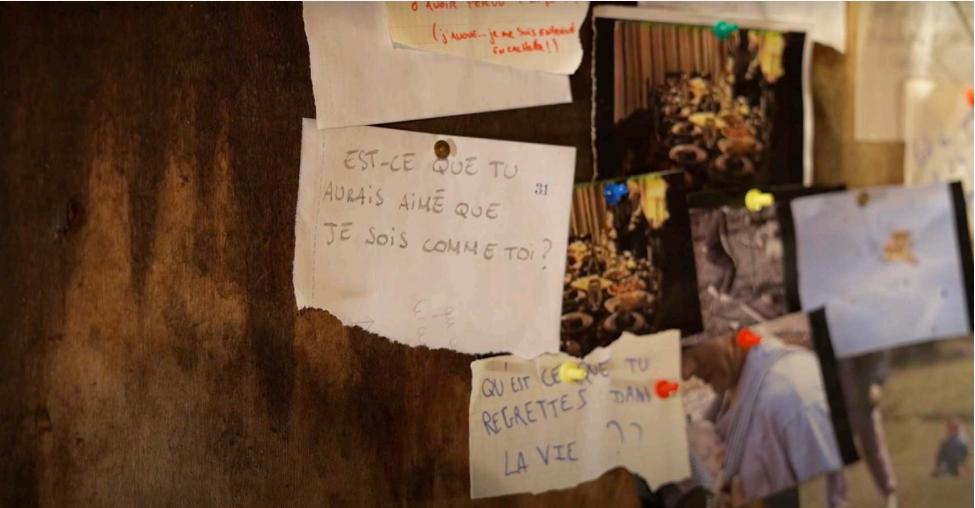
© Claire Dantec.
“Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités”. Sur ces graves paroles de l’oncle Ben s’ouvre la pièce L’île aux pères au Théâtre 13/Bibliothèque à Paris. Mis en scène par Liza Machover, le spectacle sous-titré ou pourquoi les pères sont-ils absents ou morts tente de faire cap sur la mystérieuse contrée des paternels, là où résident ceux qu’on ne voit plus ou peu. Dans une quête aussi drôle qu’éprouvante, trois super-héros - Florian Bessin, Julien Moreau et Thibault Villette – veulent découvrir les coordonnées géographiques de ce refuge, et percer les secrets de leur propre masculinité en rejouant les moments de leur enfance marqués par leur père.

© Cyrielle Voguet - Stéphane Toque.
Après plus d’une heure de spectacle, la scène est transformée en un espace d’expérimentation et les spectateurices jusqu’alors assis.es sont invité.e.s à explorer l'archipel, muni.e.s d’un casque audio et de leur curiosité. Différentes stations proposent de prolonger la recherche initiée par les comédiens, à condition d’être actif.ve, d'aller brancher sa prise jack aux différents points d’écoute installés, d’écrire une carte postale, ou de confier à “DJ Papa” une musique nous rappelant notre père pour qu’elle soit jouée.
Un spectacle impliquant
Mais bien avant, la représentation débute dans la rue Chevaleret, devant le théâtre, par un cap ou pas cap lancé par les protagonistes pour éprouver entre eux leur virilité. Pendant une dizaine de minutes, ce sera à celui qui saute le plus haut, est le plus agile, a le plus de cran - lorsqu’il accepte de lécher la semelle de sa chaussure -, et ce, jusqu’au défi potentiellement mortel.
Poussé dehors sans aucune autre instruction que “La première partie se déroule à l’extérieur, sortez S.V.P” criée par le régisseur, les spectateurices s’agglutinent autour des acteurs sortis de nulle part. Nous rions, grimaçons, nous nous gênons ou nous cachons les yeux.
Le ton est donné dès cette première scène : je vais être dérangée. D’ailleurs, je ne sais pas bien quoi faire de mon corps, ni même si cela a de l’importance puisque ces trois hommes traversent l’assemblée sans se soucier de ce qui les entoure ; mais puisque le théâtre interactif ne m’est pas familier, leur attitude me rassure. Je me détends en comprenant que la suite se passera à l’intérieur.
La salle suit le modèle de la black-box, une formule qui permet une grande flexibilité dans la configuration de l’espace : c’est une pièce peinte en noir, dont le sol est partagé par la scène et la première rangée du public, sans distinction de niveau, et dont la capacité d’accueil est restreinte. Nous nous installons sur les longueurs de la scène rectangulaire, de sorte à se faire face.
J’ai le sentiment d’assister à différents spectacles à la fois, tant la pluralité esthétique est forte : conte, séquence théâtrale, acrobatie et combat, témoignage, fable, et même danse. Les super-héros virils investissent l’espace en s’appuyant sur un décor entre l’atelier-garage et la cabane d’enfant grandeur nature. L’impression d’être happée dans un monde fantasmagorique, entre vécus et représentations culturelles, s’intensifie avec l'exposition qui suit et se double d’une invitation à confronter nos intimités.
Une installation interactive
L’installation éclatée en plusieurs îlots met en espace la mémoire. Les spectateurices peuvent interagir avec les acteurs présents : Thibault Villette, alias DJ PAPA s’occupe de la playlist des papas, Florian Bessin transmet un savoir qu’il tient de son paternel, Julien Moreau interprète les danses de pères que le public lui livre. La metteuse en scène propose d’échanger avec le public sous le grand tipi enfantin.
Au plafond est hissée une voile de parapente constellée de lumières de laquelle pendent des câbles avec des noms de pères, points d’écoute pour entendre leur vécu (1 à 8 min). Dans le même esprit, des cabines de plage taille enfant, aux couleurs acidulées, contiennent les témoignages audios des trois interprètes portant sur leur rapport à la paternité, ainsi que des extraits de leurs films de famille (~10 min). Sur des télévisions des années 90 sont également diffusées des scènes de films entre des pères et leur fils ayant trait à la figure du père absent (~5 min).
Dans cet espace scénique aux allures de fête foraine figure une présentation textuelle de Liza Machover explicitant sa démarche et ses motivations, et qui s’apparente à une médiation introductive. Enfin, il nous est proposé d’écrire sur un papier la question que nous voudrions poser à notre père et l’afficher au milieu d’autres, ou encore rédiger la carte postale que nous aurions aimé recevoir de lui.
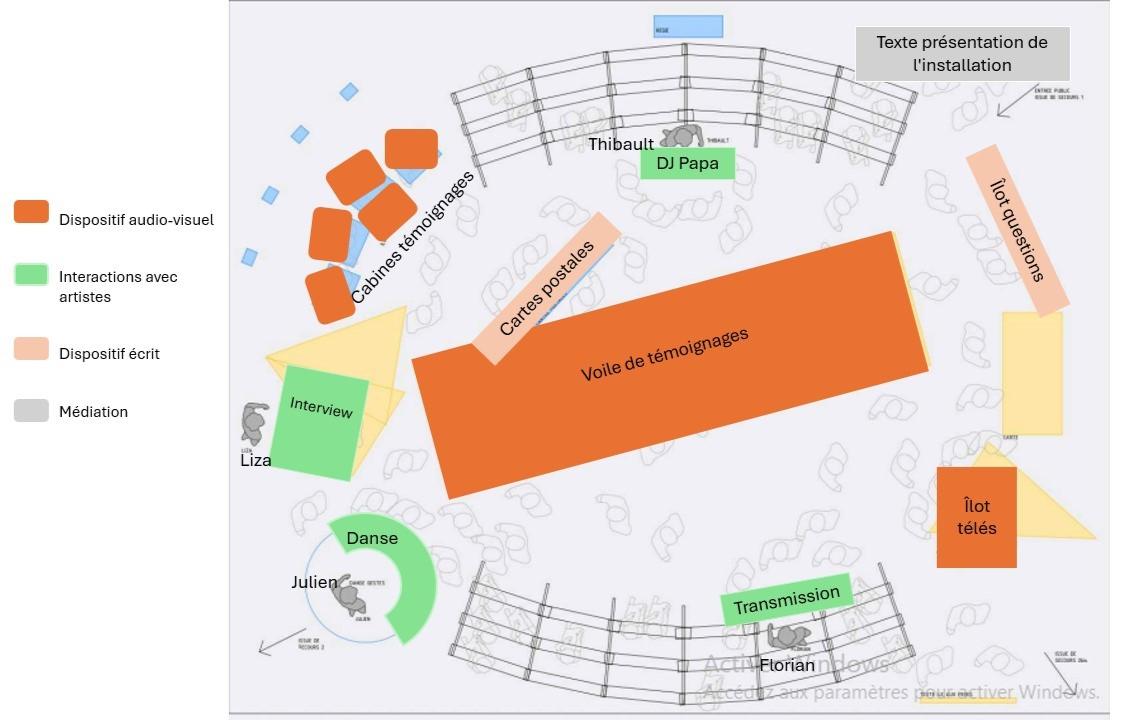
Titre : « Organisation spatiale de l’installation » – modification de l’organisation spatiale tirée du Dossier de diffusion.
L’œil muséographique : analyse de l’installation
Chargée de la scénographie du projet, Carine Ravaud propose de faire interagir le corps des spectateurices avec l’œuvre et l’environnement, pratique que l’on nomme immersive. Cette dernière se concentre sur la corporéité de l’individu (ses capacités sensorielles et émotives) transformée par l’interaction avec le spectacle et surtout avec l’exposition. Ici, la scénographe habituée à l’exercice de l’exposition, du spectacle vivant et de l’installation: [1], fond ces trois formes en un même espace théâtralisé, donnant un contexte au récit.
L’assistance entre en connexion avec les différents témoignages présentés et est même encouragée à afficher sa vulnérabilité en laissant une trace de ses propres interrogations (cf. Plan de l’exposition : les dispositifs écrits). Dans cette perspective, la scénographie choisie pour l’exposition s’apparente à une déambulation, faisant intervenir le public comme activateur de l’œuvre. A la différence près qu’une scénographie déambulatoire - à proprement parler - implique que ce déplacement fasse exister la dramaturgie de la pièce.
Cette approche de la scène désacralisée s’inscrit dans une longue tradition renversant le rapport vertical classique entre spectateurices et acteurices, tel que le fit Augusto Boal en conceptualisant le Théâtre de l’opprimé, une pratique militante dont l’une des expressions, le « forum », permet l’intervention de personnes du public au cours de représentations publiques afin qu’iels proposent des modifications de l’action dramatique.
Chez Machover, au contraire, le récit du spectacle préexiste, mais la proposition de continuer collectivement la recherche, de la mener de façon personnelle et de l’ancrer dans le réel, ne trouve du sens que si les spectateurices la saisissent.
Ce fractionnement de l’espace scénique en stations interactives laisse une liberté totale d’implication et de déplacement, induit des rythmes et des parcours différents, si bien que chacun.e a une expérience personnelle, introspective autant que contemplative. Cette complicité entre l’individu et le groupe tient évidemment au caractère universel du thème de la paternité mais également aux dispositifs encourageant le lien, l’empathie et la curiosité. Livrer sciemment le pas de danse signature de notre père, ou sa préférence musicale n’a aucun intérêt en soi, si ce n’est réanimer les souvenirs et les questionnements ainsi que la création d’un espace intime et éphémère de partage, une relation. C’est en cela que progresse la recherche de L’île aux pères, libérée du rapport vertical et pédagogique de la scène au profit d’un espace trouble et dialectique.
Théâtre 13 – Paris
Site Bibliothèque
du 23 septembre au 4 octobre 2024
Théâtre du Point du Jour – Lyon
du 29 janvier au 1er février 2025
Romane Ottaviano
[1]Avec l’agence Arter, elle réalise la scénographie des deux dernières éditions de l’exposition Photoquai du musée du Quai Branly, ainsi que la production technique de l’exposition Contact d’Olafur Eliasson à la Fondation Louis Vuitton en 2015. ↩
Pour aller plus loin :
- https://youtu.be/YbJHujxz2r0
- MAZLOUMAN Mahtab, « Le sens par le sens : l’espace immersif », [En ligne], ARTCENA. Le sens par les sens : l'espace immersif | ARTCENA
«La scénographie : métamorphoser l’espace », France culture, 2017.
#Théâtreparticipatif #Scénographie #Masculinités

La 12ème Biennale d'art contemporain de Lyon nous raconte des histoires...
Entre temps… Brusquement et ensuite : tel est l’énigmatique titre de la 12ème édition de la Biennale internationale d’art contemporain de Lyon.
Le commissariat de l’exposition a été confié à Gunnar B. Kvaran, invité par Thierry Raspail à venir coproduire l’événement…et quel évènement ! Jeff Koons, Yoko Ono, Fabrice Hybert ou encore Dan Colen ont été conviés mais c’est aussi toute une nouvelle génération d’artistes qui s’expose dans le cadre de cette nouvelle biennale. Gunnar B. Kvaran a choisi de développer cette année le thème du Récit à travers la thématique de la Transmission, fil conducteur qui traverse les biennales depuis trois années.Soixante-dix-sept artistes venus du monde entier ont débarqué à Lyon pour venir nous raconter leurs récits, leurs histoires tantôt plaisantes et amusantes, tantôt mélancoliques et révoltantes, tantôt scabreuses et déroutantes…
Visiter la Biennale d’art contemporain ? C’est d’abord une affaire de temps. Dispersée sur cinq lieux à travers la ville, le visiteur est amené physiquement à se déplacer dans la capitale des Gaules pour découvrir les espaces par métro, vélo, auto et même par bateau [1]!L’exposition consiste en un parcours, en une sorte de chasse aux trésors où les merveilles seraient les œuvres. Sont à découvrir l’exposition internationale, dispersée au sein du Musée d’art contemporain (Lyon 6e), de l’espace d’exposition La Sucrière(Lyon 2e), de la Fondation Bullukian(Lyon 2e) auxquels s’ajoutent deux nouveaux espaces insolites : l’église Saint-Justet la Chaufferie de l’Antiquaille (Lyon 5e) mais pas seulement !
Résonanceset Veduta, les deux autres plateformes de la Biennale, associent de nombreuses galeries et institutions de la ville,de la région et du pays pour faire « résonner » l’exposition dans d’autres lieux mais pas seulement ! Une soixantaine de particuliers ont été sollicités, habitant Lyon et sa périphérie, pour exposer au sein de leurs maisons et appartements des œuvres des artistes de l’exposition internationale.Les habitants peuvent (ou non) ouvrir leur lieu de vie transformé, le temps de quelques mois, en espaces d’exposition insolites. L’idée me semble amusante et décalée : ces citoyens lyonnais deviennent les gardiens, les protecteurs et les médiateurs des œuvres. Les regards qu’ils peuvent proposer sur les pièces doivent être extrêmement intéressants, mais je doute que de nombreux visiteurs disposent de temps suffisant pour contempler ces œuvres chez des inconnus. En outre, l’ouverture de ces «annexes d’exposition » dépend des initiatives individuelles. Savoir où ces œuvres sont disséminées se révèle particulièrement complexe.
Installation,Tavares Strachan, 2013© Buriedatsea.org
Visiter la Biennale ? C’est un peu comme se lancer dans la lecture d’une nouvelle… mais une nouvelle visuelle écrite à soixante-dix-sept mains. Les artistes narrent des histoires, des fictions brèves mais intenses, souvent inattendues et dérangeantes qui viennent perturber le spectateur. Comme à la lecture d’une nouvelle, il faut prendre du temps pour découvrir les lieux de l’action, s’imprégner des ambiances pour se plonger entièrement dans l’univers et dans l’imaginaire des histoires qui nous sont proposées. Les formes artistiques sont multiples : vidéos, installations, performances… Chaque artiste relate une histoire parfois haute en couleurs, drôle, imaginaire, spectaculaire, onirique, personnelle ou collective. Parmi les œuvres les plus marquantes de cette biennale, Tavares Strachan raconte dans son installation le récit visuel de la vie de Sally Ride, première femme américaine cosmonaute, oubliée par l’Histoire puisqu’elle était homosexuelle et donc trop peu dans les normes pour devenir une icône américaine. Une superbe sculpture de néon suspendue dans les airs rend superbement hommage à cette femme effacée des mémoires collectives.
God Bless America, Erró, 2003-2005 ©Esbaluard.org
Les artistes de la Biennale racontent aussi notre Histoire, celle avec un grand H. Au rez-de-chaussée de la Sucrière, Erró expose God Bless Bagdad,un immense tableau en noir et blanc dont le titre fait écho à la célèbre phrase God bless America lancée par Georges W.Busch au moment du déclenchement de la guerre en Irak. Dans une scène apocalyptique à la fois dramatique et ironique, Saddam Hussein côtoie un Georges W Bush déguisé en Captain America mais aussi une caricature de Ben Laden, des héros tirés de comics comme Hulk, le Joker et une pléthore de squelettes-soldats. L’horreur de la guerre côtoie l’humour et rejoint l’ultra-violence des personnages de bande dessinée.
The Great Art History, Gustavo Speridião, 2005-2013 crédits : Astrid Molitor
L’artiste brésilien Gustavo Speridiãoré invente dans son œuvre The Great ArtHistory les grands jalons de l’Histoire de l’Art en une série d’images imprimées sur des feuilles A4 où il juxtapose une image d’actualité, ou une image reconnaissable de tous, avec un titre évoquant les grandes mouvances de l’Histoire l’Art occidental. Les résultats sont très drôles, absurdes mais souvent tragiques. Les références se mélangent, s’amalgament en une fascinante installation qui rappelle le caractère profondément construit des grands mythes de notre Histoire.
My Mummy was beautiful, Yoko Ono, 2013 crédits : Astrid Molitor
Dans un registre plus poétique, les spectateurs sont amenés à se raconter à travers l’œuvre My Mummy was beautiful,œuvre touchante de l’artiste japonaise Yoko Ono où le visiteur est invité à inscrire sur les murs de la Sucrière un souvenir, un mot, une pensée pour toutes les mères du monde. Le spectateur devient acteur…ou plutôt conteur. Yoko Ono a d’ailleurs lancé durant toute la durée de la biennale une œuvre collaborative[2], où chaque personne peut raconter son rêve d’été : ces souvenirs d’un moment éphémère sont affichés de façon aléatoire sur l’un des murs de la Fondation Bullukian.
Cette sélection « coup de cœur » d’œuvres présentées dans cet article ne donne qu’un aperçu de tout ce que vous allez pouvoir découvrir lors de votre passage à la Biennale. Entre-temps, brusquement et ensuiteestune exposition qui surprend, bouscule et questionne le spectateur. Je me suis quelque fois sentie un peu perdue face à la multiplicité des œuvres, des propositions et des discours. Ne cherchez pas « Le » sens des œuvres exposées, ils sont multiples et le plus intéressant sera celui que vous leur donnerez. L’exposition était, pour moi, comme un grand livre ouvert à parcourir : il fallait passer d’une histoire à une autre et découvrir des univers extrêmement différents. Le nom de cette nouvelle Biennale est particulièrement bien choisi. Sonnant comme l’accroche d’une intrigue de fiction, Entre-temps, brusquement et ensuite est en quelque sorte le commencement de l’histoire pour le spectateur : cet étrange titre suscite l’interrogation, la perplexité mais aussi l’imagination. Chaque visiteur peut, ainsi, créer sa propre histoire à partir de ces opérateurs de récit.
Les artistes de la Biennale vont vous raconter des récits, certes, mais cette exposition permet également une profonde réflexion sur la nature de ces histoires, car elles ne sont pas toutes bonnes à entendre comme nous l’a montré l’artiste Erró avec son œuvre God Bless Bagdad… Et ensuite ? Il ne vous reste plus que quelques semaines pour venir explorer cette 12èmeédition, ouverte jusqu'au 5 janvier 2014. Une occasion à ne pas manquer !
Astrid Molitor
[1] Il est en effet possible de relier les différents lieux de l’exposition grâce à des navettes fluviales ! http://www.rhonetourisme.com/fetes-evenements/ce-week-end/navettes-fluviales-speciales-biennale-d-art-contemporain-de-lyon-390789/
[2] http://onosummerdream.com/
Liens et informations pratiques :
- Site de la Biennale : http://www.biennaledelyon.com/
- Carte présentant les différents lieux de l’Exposition internationale (GoogleMap) :
A= Le Musée d’art contemporain
B= La Sucrière
C= La Fondation Bullukian
D= L’Église Saint-Just
La Maison de la Marionnette & le Wayang d'Indonésie
Un écran de tissu est déroulé dans la salle, une lampe halogène pend derrière. Elle éclaire des marionnettes de cuir et de corne et permet à l’histoire de se dérouler. Voici le Wayang Kulit, le théâtre d’ombres indonésien. Undalang manipule les marionnettes et propose au public une pièce d’une nuit entière rythmée d’un savant mélange de chants, de poésie, de féerie. Ce dalang est l’homme qui actionne le corps des marionnettes, mais il est accompagné par un gamelan, un orchestre. L’histoire qu’il raconte est souvent tirée des épopées hindoues le Mahâbhârata et le Râmâyana. Dans sa toute dernière exposition, la Maison de la Marionnette détaille les différents types de Wayangqui existent à travers des marionnettes découvertes de manière inédite.
©Maëlle Sinou
En effet, à la Maison de la Marionnette, différentes idées cohabitent : former à l’art de la manipulation, être un centre der essources mais aussi de résidences pour les artistes marionnettistes, valoriser un patrimoine pluriel fondé sur les marionnettes ainsi que les histoires qu’elles cachent, leurs usages et leur fabrication. Au sein d’une collection internationale regroupant 2500 pièces d’Europe, d’Afrique ou d’Asie, les personnages du wayang sont réveillés pour nous faire découvrir la culture indonésienne. Cette dernière, particulièrement syncrétique, combine les influences de la culture hindoue dans la Wayang Kulit, mais aussi celles deslégendes de l’islam qui ont donné des formes propres au Wayang Klitik ou au Wayang Golek .
© CMFWB / DGNP
© CMFWB / DGNP
L’exposition met en valeur les formes de marionnettes qui découlent de ce croisement culturel. Ainsi, au rez de chaussée, le parti pris est d’exposer les différents types de Wayang, car s’il s’agit au départ d’un théâtre d’ombres, des pièces en ronde bosse existent aussi avec des traits particuliers en fonction de leurs rôles. À l’étage, le discours est focalisé sur le récit du Râmâyana. Les personnages présentés proposent une grande diversité, entre beauté et grotesque. En effet, des caractères se distinguent : la catégorie Putri Dangah concerne la dame noble et élégante qui possède des traits fins, une peau blanche et des yeux baissés, tandis que les démons Petruk semblent héler le visiteur avec leurs trognes grimaçantes voire belliqueuses. L’exposition se déploie sur tous les niveaux de la Maison de la Marionnette : aussi, les pièces javanaises côtoient celles africaines ou européennes. Dans ce sens, les personnages décrits peuvent être comparés à ceux que le public connaît déjà, et en même temps dévoiler leurs propres subtilités.
Cette exposition s’intégrait dans la programmation de la biennale d’art Europalia. Cette dernière, à chacune de ses éditions, promeut la culture d’un pays à travers toutes les disciplines de la mode à la littérature, de la gastronomie au théâtre. Elle s’étend sur plusieurs villes belges et limitrophes afin d’ouvrir le public européen à de nouvelles inspirations, de nouvelles créations. Après la Chine, le Brésil, l’Inde, la Turquie... cette année, le choix s’était porté sur l’Indonésie. La Maison de la Marionnette de Tournai participait à cette dynamique et proposa autour de son exposition des workshops de construction de marionnettes, une visite guidée portée sur le Râmâyana pour les 6-12 ans et un spectacle du dalang I Made Sidia, invité spécial de l’événement.
©CMFWB / DGNP
Coline Cabouret
#ombres
#marionnettes
#festival
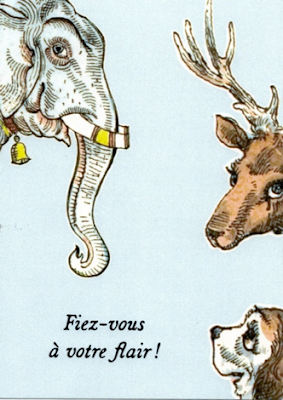
La Maison-Musée Hector-Berlioz : à voir et à entendre !
« Je suis né le 11 décembre 1803 à la Côte Saint-André »
(c) Musée Hector-Berlioz
Cette simple phrase amorce les mémoires rédigés par Hector Berlioz publiés en 1865. C’est naturellement que l’on trouve dans cette commune iséroise le musée qui lui est dédié, au sein même de sa maison natale. Elle a été acquise en 1932 par l’association « les Amis de Berlioz » dans le but d’en faire un musée dédié à la mémoire de celui-ci, puis inauguré en juillet de la même année après réhabilitation. Le musée devient un établissement départemental à partir de 1968 mais sera géré par l’association jusqu’à la fin du XXème siècle. Par la suite, trois phases de réhabilitation seront initiées (1969-1975, 1989-1990 et 2002-2003). Ces différentes étapes de travaux ont pour objet la reconstitution du cadre de vie de la maison au moment où le jeune Hector y habitait. L’avant-dernière phase a aussi permis d’ajouter une boutique et une salle d’exposition temporaire qui confère alors une meilleure envergure au musée.
La scénographie du lieu est composée en trois parties. Tout d’abord au rez-de-chaussée, une première salle présente Hector Berlioz en son temps avec différents repères chronologiques. Le courant artistique et littéraire du romantisme est l’axe qui relie le compositeur avec d’autres personnalités majeures de cette philosophie (Hugo,Liszt, Byron, etc). Une introduction succincte sur la vie personnelle de Berlioz, ainsi que ses succès et ces déconvenues vient clore ce premier niveau.Etant le seul accessible aux personnes à mobilité réduite, il était nécessaire d’y faire une présentation générale de la vie et de l’œuvre du compositeur. Ensuite,les étages ont été reconstitués pour mettre en scène la vie de la maison lorsque Berlioz enfant y vivait. Lors de la dernière réhabilitation, des enduits et peintures murales du XIXème siècle ont été retrouvées sous des couches de décors précédents. Leurs restaurations permettent de mettre en scène au mieux le mobilier d’époque. Pour finir, un voyage musical est proposé dans l’auditorium du musée. Installez-vous confortablement et laissez la musique vous faire découvrir l’univers de Berlioz.
Une majeure partie des collections du musée est composée de dons de la descendance d’Hector Berlioz. Ce sont surtout des ressources manuscrites, partitions, mémoires et carnets de voyage du compositeur. Mais une part importante de la correspondance de la famille Berlioz y est aussi conservée. Il y a deux espaces de conservation des collections dans le musée : la réserve pour les objets et le centre de documentation (créée en 1965) pour les collections papier.
Les missions
Mes missions au sein du musée Hector-Berlioz avaient pour fil conducteur de me faire découvrir le métier de régisseur des collections. Au cours de ces quatre mois, j’ai pu étudier toutes les étapes de l’œuvre dans les collections, de son arrivée dans le musée à sa mise en exposition.
A ce titre, je me suis occupée du classement de trois fonds. Le premier fonds concerne une cantatrice iséroise,Ninon Vallin. Il contient environs 400 photographies et 700 articles de presse.Le second a été donné par l’Orphéon Municipale de Grenoble, association musicale importante de l’Isère au XXème siècle. Il est composé des documents administratifs de l’association, des photographies de leurs représentations ainsi que de médailles. Ces deux fonds n’ont pas de lien direct avec Hector Berlioz mais ils permettent une veille patrimoniale de l’histoire musicale de l’Isère. Le troisième a été légué au musée par une descendante de la famille Berlioz, Catherine Reboul-Vercier, et contient près de 700 lettres et documents administratifs ayant appartenu au compositeur et à sa famille. Un point important est donné à la cohérence dans l’organisation de ces fonds. Du classement au rangement, cela doit être fait de la manière simple et juste afin que toutes personnes souhaitant l’étudier puissent le faire le plus facilement possible.
Par la suite, je me suis occupée de réorganiser la réserve du musée. Elle se compose d’un meuble à plan, de trois armoires et de rangement pour tableaux. Mon travail s’est surtout centré sur du dépoussiérage et conditionnements d’objets. Ce sont des étapes importantes permettant de mettre en œuvre les bonnes conditions de conservation préventives pour les collections. Selon les caractéristiques physiques des objets,différents conditionnements ont été choisis. Pour les objets sans trop de volume, comme les médailles et baguettes de chefs d’orchestres, le conditionnement choisi est de la mousse de polyéthylène dans laquelle sont formés les emplacements pour les objets pour ensuite être ranger dans des boites de conservation. Ce système permet de les ranger par type. Les objets plus lourds et volumineux, tel que la vaisselle, n’ont pas été conditionnés pour une meilleure observation. Les étagères où elle est rangée sont protégées par des films de polyéthylène afin d’éviter le contact de l’objet avec des surfaces non-neutres.
Enfin, j’ai participé au montage de l’exposition « Berlioz en Italie. Voyage Musical ». Je me suis intéressée aux parties administratives préalables à la venue et au convoiement des œuvres. Cette mission passe par la création des fiches de mouvement d’œuvres, la prise de contact avec des convoyeurs spécialisés et la création des fichiers d’assurances. J’ai accompagné mon tuteur à Marseille pour récupérer une dizaine d’instruments de musique méditerranéenne, prêtés par un musicologue. L’exposition était essentiellement composée de tableaux, gravures et de manuscrits de Berlioz. De mauvaises mesures des tableaux avaient été données ce qui a causé une remise en question de la scénographie une semaine avant l’inauguration. La place restreinte des salles et des contraintes de l’agencement (deux salles avec plafond voûté) ont été problématiques pour résoudre les problèmes. Finalement, nous avons dû supprimer des lithographies pour laisser plus de places aux tableaux et aux textes.

(c) Portrait d'Hector Berlioz, Émile Signol - Villa Médicis
L’exposition vise à faire connaître une étape importante dans la vie du compositeur français. Lorsqu’il gagne leprix de Rome en 1830, par deux tentatives infructueuses, Berlioz quitte à regret Paris pour devenir pensionnaire à la Villa Médicis durant un an. La cité romaine lui semble bien moins attractive que la capitale française et il méprise la musique italienne. Il va s’évader le plus souvent possible pour découvrir les provinces et paysages qui formeront trente ans plus tard l’Italie unifiée. Le musée a choisi de présenter des tableaux et lithographie de la première moitié du XIXème siècle représentant les régions telles que Berlioz les a visitées pendant son voyage. Des manuscrits sont présents afin de compléter ses œuvres montrant que le compositeur a gardé en lui les souvenirs passé en Italie. Il s’est inspiré de ces sonorités tout au long de sa carrière pour de nombreuses œuvres, de Benvenuto Cellini à Béatrice et Bénédict en passant par Les Troyens.
Laura Clerc

La scénographie au théâtre : Marivaux, Les serments indiscrets
LUCILE « Je remarque que les hommes ne sont bons qu'en qualité d'amants (…) dès qu'ils sont heureux, les ingrats ne méritent plus de l'être. »
Acte I, Scène II
Lucile et Damnis © Anne Nordmann, Le Théâtre du Nord
Faire passer des idées ? Du sens ? Avec quels outils ? Quelle place pour le public/ spectateur ? Quelle différence entre le spectateur au théâtre et le regardeur au musée ? Existe-t-il une véritable différence entre les cénographe qui travaille pour le théâtre et celui qui travaille pour une exposition ? Je tenterai de répondre à ces questions à partir de la pièce mise en scène par Christophe Rauck, grand prix du meilleur spectacle théâtral de l’année 2012/2013 pour Les serments indiscretsde Marivaux.
Comment traiter en 2014 un sujet dix-huitièmiste et qui semble si loin de nous : le mariage arrangé de deux jeunes bourgeois … ?
Par la scénographie ! C’est d’abord elle qui m’a interpellée, ni passéiste, ni abstraite, elle est pleinement contemporaine. Faire entrer le spectateur/ public dans l’univers de l’acteur, le faire entrer sur scène, lui donner le sentiment de participer à l’action. Voilà à mon sens l’un des rôles majeurs de la scénographie. C’est ce but qu’atteint Aurélie Thomas (scénographe) en créant trois espaces unifiés par le mouvement des comédiens : l’arrière-scène – qui tient lieu de coulisses à la pièce –, la scène et les gradins. Si l’intervention des comédiens dans l’espace du public, est un choix pertinent mais au final peu utilisé, le choix de créer un espace relevant presque de l’intime est très bien utilisé. Suggérer sans montrer. Ici et là, on devine dans les deux pièces du fond, le mobilier et les silhouettes des personnages. Le procédé devient réellement intéressant lorsque Damnis fou de rage, lance les meubles des pièces adjacentes sur la scène. La violence est accentuée par le fait que nous ne voyons et n’entendons que le fracas de ceux-ci. La scénographe répond ici à la curiosité primaire de l’homme : voir ce qui est caché, ce qui lui est interdit.
Concernant le mobilier, j’ai particulièrement apprécié qu’il ne soit pas aseptisé. Ces objets sont des : bougies à l’avant de la scène, mobilier de style XVIIIème recouvert de tissus sobre et contemporain, rideau reprenant le rideau à l’italienne, etc. Bref un décor de goût qui évite l’anecdotique et que l’on pourrait encore trouver aujourd’hui dans un appartement bourgeois.
La modernisation de la pièce passe également par l’utilisation de la caméra et de la vidéo. Si souvent le numérique – dans les expositions comme dans les pièces de théâtre – se résume à faire du « numérique pour le numérique », à donner l’illusion de la modernité, ici Kristelle Paré met le multimédia au service de la pièce et la projette dans une problématique toute contemporaine. Malgré cela les origines de l’œuvre ne sont pas niées puisque j’ai eu le plaisir de redécouvrir sur grand écran des scènes galantes de Fragonard ou Watteau, accompagnées par La non-demande en mariage de Georges Brassens.

Phénice et Damnis c Anne Nordmann pour le théâtre du Nord
C’est Phénice – l’un des personnages les plus intéressant joué par Sabrina Kouroughli - qui intègre tout au long de la pièce l’outil multimédia. Petite sœur indiscrète et espiègle, elle enregistre et se joue des situations familiales. Filmant la relation ambiguë de sa sœur Lucile avec Damnis, elle donne l’impression au spectateur d’être un voyeur venant se mêler d’affaires qui à l’origine ne le concerne en rien. J’ai particulièrement apprécié l’humour lors de la scène filmant les ébats de Phénice et Damnis, une scène faisant écho à certaines vidéos visibles sur le web. La scène finale, filmée en cadrage serré sur l’ensemble des personnages, permet au spectateur de découvrir les détails de ces visages que l’on voit d’habitude de si loin … La caméra permet ici au spectateur d’être un acteur silencieux de la pièce.
Phénice et sa caméra, Crédits : Anne Nordmann, Le Théâtre du Nord
C’est par l’intelligence de la scénographie et de l’utilisation des outils multimédia, que l’œuvre entre pleinement dans le XXIème siècle. En effet si le metteur en scène est un acteur incontournable de la pièce, de par son rôle de direction et de médiateur entre les différents acteurs du projet, j’ai senti dans cette pièce toute l’importance de la scénographie. Elle ne se résume pas ici à un simple décor qui viendrait accueillir les acteurs, mais porte en elle-même du sens, modernise l’œuvre de Marivaux, et prend ainsi une place aussi importante que n’importe quel personnage.
Ainsi s’il n’existe pas réellement de différence entre la scénographie théâtrale et muséale, le changement vient du mouvement. En effet si au théâtre l’action vient d’une pièce où le spectateur est statique, au musée la problématique est inversée, le public en mouvement contemple l’œuvre statique. Mais en dehors de cette caractéristique qui doit être bien entendu prise en compte, la scénographie doit toujours être vecteur de sens. Or j’ai parfois le sentiment en visitant certaines expositions d’avoir plutôt affaire à une décoration. De même l’utilisation de la caméra peut être ici une piste de réflexion dans le cadre du musée. Pourquoi ne pas réfléchir autour de cette idée d’une caméra qui intègre le spectateur, dans le cadre d’une exposition. Il pourrait en effet être intéressant de faire du public, un nouvel acteur, qui pourrait ainsi partager son avis sur l’exposition ou sur une œuvre, donnant de cette manière à son discours autant de légitimité qu’à celui d’un professionnel.
Ainsi dans une formation de muséographe, et même si la scénographie n’est pas au centre de notre travail, il me semble nécessaire d’avoir une vision interdisciplinaire, celle-ci nous donnant des pistes pour travailler en bonne intelligence avec un scénographe.
Si vous avez manqué les représentations lilloises, je vous conseille de faire comme moi et d’aller voir Phèdre au Théâtre du Nord dans une nouvelle collaboration de Christophe Rauck et Aurélie Thomas.
Cette interdisplinarité indispensable est également mise en valeur par le théâtre qui organise très ponctuellement des expositions. Cela me donnera l’occasion de vous reparler de scénographie lors de mon prochain article, mais cette fois pour une exposition au théâtre.
Marion Boistel
Pour aller plus loin :
Pour de plus amples informations surla pièce.
Pour approfondir la problématique de la scénographie au théâtre
#Théâtre
#Scénographie
#Christophe Rauck
Le drag et la scène ballroom : entre divertissement, politisation et art
La performance drag s’introduit et tente de se faire une place parmi les pratiques artistiques reconnues. Récemment, les drags queens gagnent les galeries et les musées. Elles affirment ainsi leur place non seulement en tant qu’artistes, mais aussi en tant qu’icônes fondamentales de la diversité et de la créativité au XXIe siècle. Toutefois, si leur présence s’accroît, rares sont les institutions qui leur consacrent une exposition entière.
© Din, Pexels
Le 6 avril dernier, la Piscine de Roubaix organisait un concours de drag queens en partenariat avec l’école Esmod de Roubaix. Dans le cadre d’une exposition rétrospective de Jeremy Deller, le musée des Beaux-Arts de Rennes a accueilli une performance de drag queens. Le Palais des Beaux-Arts de Lille avait également présenté une soirée spéciale “Drag Palace” en juin 2024. Les performances et artistes drag sont surtout citées de manière succincte ou prennent part à la programmation autour d'une exposition dans le cadre de médiation, d’atelier ou de hors les murs, comme si elles ne pouvaient franchir ce plafond de verre de la reconnaissance institutionnelle muséale.
Naissance d’un divertissement artistique
Le drag, tel que nous le connaissons aujourd’hui, s'épanouit dans les années 1960 aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi en France, à Paris, en particulier dans le quartier de Pigalle. Il se développe autour de la performance scénique dans les bars et cabarets, lors de compétitions pendant lesquelles plusieurs concurrentes s’affrontent dans des épreuves de roast and shade, de lip sync, de danse ou encore de catégories. Ces compétitions prennent un nouveau tournant avec la création de la scène ballroom. En effet, à la fin des années 60, les compétitions qui ont lieu principalement à Harlem à New York, sont constamment gagnées par des drag queens blanches. Les compétitrices noires et latinas décident alors de quitter cette scène et de créer la leur. En raison de leurs conditions de vie précaires, elles ne peuvent louer que des salles municipales de bal. Par métonymie, ces nouveaux lieux de rencontre et de développement d’une culture propre, prennent le nom de ballroom. Initialement, la ballroom est composée principalement de femmes trans africaines-américaines ou latinas, mais s’élargit rapidement.
Se développe également la communauté drag king. De la même façon qu’une drag queen s’approche d’une esthétique dite « féminine » en performant les stéréotypes du genre féminin, un drag king se tourne vers une esthétique dite « masculine », en performant les stéréotypes du genre masculin. Toutefois, le drag king n’est pas le pendant masculin absolu de la drag queen. Plusieurs chercheureuses situent la naissance des pratiques king au début des années 1990, dans les bars underground de New York, de San Francisco et de Londres. Si les drag kings s’inspirent des mouvements queer nés aux États-Unis à la fin des années 80, ils s’inscrivent également au sein d’une culture de la performance et du travestissement bien plus ancienne, qui remonte aux années 1860.
Vers la reconnaissance d’un art vital
Dans un premier temps, la scène ballroom est un espace-temps non-mixte, sorte de parenthèse safe loin d’un monde discriminant et dangereux comme scène clandestine, car illégale. Il s’agissait de lieux de rencontre, de création, de divertissement, de fête, de libération et de spectacle où étaient célébrés des corps et identités discriminées. Le drag est aussi un exercice de libération identitaire, un affranchissement des codes. Pour beaucoup, le fait de pouvoir s’exprimer et d’être soi sans peur est libérateur. Le fait de s’habiller de tenues extravagantes, colorées et pailletées a un effet performatif de la joie. Il s’agit pour les drag queens et kings de faire une performance pour répandre cette joie et cette fête. Ainsi, ielles sont de véritables performeureuses multidisciplinaires. En plus de se maquiller, confectionner leur tenue et perruque, ielles mettent au point de véritables spectacles, alliant différents arts de la scène. Progressivement ielles sont reconnues comme telles, même si cela reste lent et minime. Cette reconnaissance intervient surtout dans les années 2000, notamment grâce à l’émission américaine RuPaul Drag Race, lancée par la célèbre drag queen RuPaul. Cela participe largement à l'intégration de la culture drag à la culture populaire américaine. Ces dernières années, la communauté ballroom connaît également un regain de visibilité notamment grâce au succès de la série Pose. Ce n’est pas la première fois que le drag et la culture de la scène ballroom connaissent une résurgence dans la culture populaire. Dans les années 90, les films Paris is Burning et Priscilla, folle du désert, avaient provoqué l’intérêt et le dépassement des frontières américaines, notamment en France grâce à Mother Niki Gucci et Mother Lassandra Ninja. En 1990, Madonna « strikes a pose », dans sa chanson Vogue, reprenant les mouvements du voguing, danse née au cœur de la scène ballroom dans les années 70. Toutefois, il faut mettre en avant la longévité inédite de ce récent engouement. RuPaul est une figure de la pop culture depuis plus de 10 ans. Avec la génération YouTube et les réseaux sociaux, de plus en plus de drag queens émergent. Certaines vont même au-delà du drag comme performance, comme la drag queen américaine Violette Chachki, ou la française La Grande Dame défilant comme mannequin pour des marques de luxe comme Prada, Moschino ou encore Jean-Paul Gaultier. Si l’émission et les différentes franchises donnent accès au grand public à l’envers du décor, cela se fait dans le cadre du divertissement. De plus, le caractère léger voire frivole des performances, rend pénible sa reconnaissance comme art à part entière. Esthétique révolutionnaire et nouvelle manière de faire performance, le drag s’inscrit pourtant dans la lignée des arts du spectacle.

© Kamaji Ogino
Le dérangement des codes et identités genrés.
En tant qu'élément important de la culture queer, le drag dérange non seulement parce qu'il introduit de nouvelles valeurs esthétiques, mais aussi et surtout parce qu'il prône les différences et s'attaque aux idées préconçues sur le genre et les identités différentes qui existent dans la société. Le drag dérange les codes et met en avant une pluralité des genres, mais surtout la fluidité d’expression de genre puisqu’il s’agit de créer son personnage. De même pour la scène ballroom de manière générale, qui promeut l’inclusivité en opposition à la société discriminante. Les compétitions célèbrent toutes les identités, alliant mode, esthétisme, performance. Le drag et la scène ballroom cherchent à effacer toutes les distinctions d’origine, de genre et de sexualité.
A la fin des années 80, la pensée queer se théorise et accompagne la diffusion de la culture de la scène ballroom. Cette pensée pose ce principe fondamental : le genre est une construction sociale et non une définition biologique. La binarité homme/femme est remise en question. L’avènement de cette pensée prend place en 1990 lorsque Judith Butler publie l’essai fondamental Trouble dans le genre. Instaurant la théorie queer comme discipline universitaire, cet ouvrage est la rampe de lancement des études du genre. De même, lorsque Monique Wittig publie The Straight Mind (1992), exposant le contrat hétérosexuel comme régime politique au fondement de la société binaire et patriarcale.
Ce sont des questions encore très actuelles et le drag, comme pratique du divertissement, est idéal pour une génération critique du genre. Une réelle corrélation existe entre la théorie des études du genre et la pratique du drag. Non seulement transgression du féminin et du masculin, le drag invente des créatures queer surréalistes avec le mouvement des clubskids qui interprètent non pas un personnage genré, mais une sculpture vivante.
De manière générale, cette nouvelle scène artistique tente de faire comprendre et accepter l’abandon d’une société binaire. De multiples ateliers tels que les ateliers de Louise De Ville, qui a importé le drag king en France à partir des années 2000, sont créés et ouverts à toustes pour apprendre les bases de cette pensée minorisée. Thomas Occhio, drag king français, explique l’aspect politique fulgurant de la scène drag à la lumière de sa déconstruction du patriarcat et de toutes les injonctions féminines sur l’appropriation de l’espace et des corps. Le fait d’être dans une société patriarcale donne une dimension politique au drag king. Là où la drag queen présente une ode à la féminité, le drag king prend exemple sur une masculinité dominante, néfaste.
L’art du drag et la culture de la scène ballroom questionnent des grands concepts comme la féminité, la masculinité, mais également l’hétérosexualité, la blanchéité et les classes sociales. Il met l'accent sur l'intersectionnalité et la multidisciplinarité.

© Rosemary Ketchum
Le corps : un étendard politique
L’art du drag et plus généralement la culture de la scène ballroom sont par essence politiques. Toutefois, il faut exercer une distinction entre la conscientisation et la politisation. L’art du drag est politique en soi, car il vient questionner de grands concepts, et apparaît même comme symbole de résistance et de résilience. Mais cela est-il fait en conscience d’être politique ?
La scène ballroom apparaît comme cas d’école de l’incarnation de l’intersectionnalité, de la pratique artistique comme pratique politique parce que c’est une culture, un mouvement. Elle est une scène intrinsèquement politique mais pas nécessairement politisée : politique parce qu’elle a été créée pour des raisons politiques dans un système raciste, patriarcal et classiste, mais elle n’est pas constamment dans le pro-activisme, dans un militantisme de terrain.
Souvent, un but politique est projeté sur la scène ballroom, voire militant, ce qui implique une conscientisation. La scène ballroom est une scène queer racisée noire-latina donc elle est politique en soi parce qu’elle est l’avènement de la revendication, la volonté d’existence, de représentation de cette communauté par elle-même et pour elle-même. De plus, elle est le lieu de la mise en mouvement de corps minorisés. La mise en mouvement d’un corps est politique ; mais concernant les corps minorisés, exister dans la rue est un acte politique, même involontaire, car ces corps sont discriminés et à l’encontre des codes imposés par les groupes dominants. Toutefois, cette politisation n’est pas forcément conscientisée, ou revendicative.
Il convient de distinguer les artistes dépolitisé.e.s et celleux apolitiques pour des raisons stratégiques. Une branche tend vers le mainstream, au profit d’une plus grande visibilité quand une autre plus radicale crée des espaces militants pour porter les messages. Prenons l’exemple de la drag queen Symone, gagnante de la saison 13 de RuPaul Drag Race. Après avoir défilé avec un durag, elle affirme : « Durag is a part of black culture and I wanted to celebrate that on the stage ». Pour l’épisode 9, elle défile également les mains en l’air, vêtue d’une longue robe blanche sur laquelle on peut voir à l'arrière deux trous de balles, ainsi qu’une coiffe blanche sur laquelle est écrit « Say their names », tout en énumérant les noms de Breonna Taylor, George Floyd, Brayla Stone, Trayvon Martin, Tony McDade, Nina Pop, Monika Diamond en voix off. D’autres comme Courtney Act ou Nina West de la saison 11 s’affirment également activistes et leurs performances sont militantes.
La mainstreamisation : entre visibilisation, reconnaissance et appropriation
En raison du succès rencontré, l’art du drag et la culture de la scène ballroom sont sortis de leur sphère initiale pour le mainstream et la pop culture, pris dans des logiques de capitalisation et de mainstreamisation. Les codes d’émancipation de la scène ballroom sont davantage célébrés, mais principalement lorsqu’ils sont dépolitisés.
Deux visions apparaissent alors : l’une positive, car cette mainstreamisation apporte de la visibilité sur des groupes minorisés et permet à davantage de personnes de s’identifier et de ne pas se sentir isolées. La mainstreamisation est intéressante en ce sens qu’elle permet d’exister hors de la ballroom. Elle permet la représentation culturelle. Une autre vision, plus négative apparaît lorsqu’un public non concerné intègre la scène ballroom et les performances drag et capitalise. D’autant plus que dans cette capitalisation, les personnes employées pour représenter la scène ballroom ne sont pas nécessairement les principales concernées.
La marchandisation du drag, l'introduction d'une recherche pécuniaire, semble nier son aspect politique. Mais cette critique essentialise les identités. La rémunération et la professionnalisation sont une manière pour les drag queens et drag kings de se faire reconnaître et d’être pris.es au sérieux. Il faut nuancer la condamnation du profit puisqu’il concerne des personnes évoluant dans les marges, voulant parfois en sortir. La fidélité aux marges est une posture théorique, car toute personne a besoin de revenus dans un système capitaliste. Cela reflète l’injonction à la pureté militante contre la monétisation d’une identité ainsi que le refus de la sociologie d’allier expérience et expertise perpétuant le mythe du faux activiste intéressé.
Le problème de cette mainstreamisation est donc l’appropriation non-respectueuse de cette culture par la classe dominante.
Dans sa conférence « Décolonisons ledancefloor » (2017), l’activiste queer et féministe Habibitch dénonce l’appropriation culturelle qui découle de cette mainstreamisation. Iel explique que « toutes pratiques artistiques créées et fédérées par les communautés marginalisées sont au centre du processus d’appropriation culturelle ». Il y a appropriation culturelle quand il y a capitalisation donc profit, qu’il soit matériel ou immatériel, d’éléments de cultures d’un groupe dominé, par le groupe dominant. Habibitch inscrit cela dans un continuum colonial : parce qu’aujourd’hui la colonisation géographique et territoriale est moindre, c’est la culture qui est colonisée. Iel reprend ainsi les mots d’Aimé Césaire dans son Discours sur le colonialisme (1950) dans lequel il explique l’effet retour du colonialisme par l’appropriation culturelle. Ce continuum colonial passe d’une colonisation matérielle à une colonisation immatérielle, qui s’exprime dans le domaine de la culture et du symbolique.
Régulièrement, les groupes dominants se saisissent de pans culturels de l’Autre, font du profit, ne prennent pas en considération la charge mentale et la charge raciale des personnes ayant créé ces cultures dans un souci de survie. L’écrivain afro-américain Greg Tate résume cette friction en quelques mots : « Everything but the Burden », titre de son livre publié en 2003. En ces termes, il dénonce l’appropriation d’une culture de communautés minorisées pour en tirer profit et sans penser à la raison d’être de l’élément de culture en question, de son origine et de son aspect politique. Par exemple, le succès est davantage tourné vers le voguing – pratique de danse et performance - et moins vers la ballroom comme réunion d’individus. Il y a de la part de la classe dominante, une instrumentalisation des communautés minorisées par l’adoption de leurs codes.
La mainstreamisation est donc indissociable des notions de domination et d’asymétrie. Le risque ne réside pas dans l’impératif économique des communautés concernées faisant perdre la visée politique ; mais dans l’appropriation des dominants, invisibilisant les histoires passées comme présentes. De plus, la mainstreamisation entraîne l’arrivée d’un nouveau public au sein des clubs. Ces personnes, qui ne sont pas forcément de la communauté, peuvent par leur curiosité, fétichiser et exotiser les participant.e.s de la culture en question. Les menaces de rendre la scène moins safe et d’outer des personnes augmentent puisque de plus en plus de personnes filment et postent sur les réseaux sociaux. Il y a donc une responsabilité individuelle à respecter l’histoire de cette scène artistique quelle que soit notre identification.
L’art du drag rejoint la scène ballroom dans des impératifs intrinsèquement politiques. Les deux ont offert une incarnation possible de toutes ces personnes marginalisées et minorisées, dans un espace flamboyant et au croisement de toutes les identités. Cette nouvelle manière de s’exprimer par la performance, la danse, le maquillage et l’esthétique s’éprend du dancefloor qui devient le lieu parfait d’expression et de résilience en troublant les codes et identités genrées. Entre défauts de reconnaissance et appropriation culturelle poussée par la capitalisation et la mainstreamisation, l’art du drag et la ballroom ont des défis à surmonter.
Adèle-Rose Daniel
#Drag #Ballroomscene #Arts
Le monde décapant du Bazarnaom d'Hiver
Un soir, ma mère me propose de participer à un événement assez attendu par les habitants de Caen : le Bazarnaom d’Hiver. Cet événement est organisé par un collectif spécialisé dans les spectacles de rue. Tous les deux ans, il imagine un univers extravagant et burlesque pour présenter des créations de compagnies locales ou nationales de théâtre et spectacles de rue. La convivialité et le rire y sont obligatoires !
© Bazarnaom
Un soir, ma mère me propose de participer à un événement assez attendu par les habitants de Caen : le Bazarnaom d’Hiver. Cet événement est organisé par un collectif spécialisé dans les spectacles de rue. Tous les deux ans, il imagine un univers extravagant et burlesque pour présenter des créations de compagnies locales ou nationales de théâtre et spectacles de rue. La convivialité et le rire y sont obligatoires !
La thématique de cette année est « Un monde de fou ! », laissant présager des représentations déjantés. Pour attiser la curiosité et le suspens, le lieu est gardé secret. Nous avons donc rendez-vous sur une place du centre-ville, qui à l’heure dite est assez calme, sans aucune structure présageant que du théâtre va commencer ici.
Et tout d’un coup des sifflets, des cris, des bruits de train et un groupe d’hommes déguisés en cheminots perturbent le calme de la place ! Ils réunissent les gens, un peu chamboulés de ce vacarme inattendu, les font s’installer dans des wagons imaginaires, en rang par deux. Chacun est gentiment bousculé de sa zone de confort. Certains ont du mal à jouer le jeu, n’ayant pas l’habitude d’être impliqués et investis lorsqu’ils assistent à des spectacles. Mais dans l’ensemble, la situation cocasse établit une bonne ambiance.
Une fois le cortège organisé et rangé, le ‘train’ peut quitter sa gare : nous voilà donc entraîné par les comédiens-cheminots de trottoirs en trottoirs. On se laisse guider, on parle avec les autres « passagers » tout en redécouvrant la ville. Le voyage est presque la métaphore d’une traversée des mondes, une épopée initiatique pour pénétrer dans l’univers farfelu du Bazarnaom. Ce parcours devient une sorte d’engagement des participants à lâcher prise, se laisser surprendre et partager un moment divertissant.
Une fois arrivés, une fanfare de non professionnels, ni même réellement amateurs (simplement curieux de nouvelles pratiques), nous accueille dans la cour par un joyeux vacarme désaccordé. Nous découvrons que c’est une ancienne caserne de pompiers qui est réinvestit (d’ailleurs en clin d’œil avec le premier spectacle de la troupe fondatrice du Bazarnaom qui mettait en scène des pompiers).
La fanfare de bienvenue, © Béa Guillot
À l’intérieur, nous découvrons ununivers loufoque propre au Bazarnaom : une boutique d’objets improbables, dite « La charcuterie d’œuvres » (qui est en fait une vitrine des accessoires des spectacles précédents), une boîte à photos (photomaton avec des ornements et chapeaux saugrenus) et un atelier de sérigraphie. Au cœur de ces animations, deux espaces distincts accueillent les spectacles : un podiumde défilé et un petit amphithéâtre.
La bulle ainsi créée suscite l’imagination, la découverte et l’échange de souvenirs d’anciens spectacles. L’environnement semble hors norme : les gens échangent entre eux sans se connaître, racontent leurs souvenirs sur les éditions précédentes alors qu’ils n’auraient probablement pas échangés un sourire ailleurs. C’est la redécouverte du partage et de l’instant présent.
Machine à remonter le temps en vente (2 756€), réellement ancien accessoire, © Béa Guillot
Le premier spectacle de la soirée, Cocktail Party, est presque muet mais très explicite. La société contemporaine y est passée au crible : le rapport à autrui, le bonheur, l’amitié, l’amour, la sexualité, la maladie, la mort, la société de consommation, les apparences ou encore l’entre-aide sont autant de thématiques évoquées dans ce pamphlet au rire grinçant.
Le deuxième spectacle, Défilé Bœuf Mode, évoque, sous couvert d’un défilé, la diversité, la liberté, l’écologie, la religion, le paraître et même la politique avec beaucoup d’humour.
Création pour Défilé Bœuf Mode, © Béa Guillot
Ces propositions théâtrales en apparence absurdes sont très subtiles et clairvoyantes. « Nos idées sont parfois tordues, mais c’est en pliant les idées-reçues qu’on pourra avancer ensemble », nous annoncent-ils. Nous sommes invités à questionner notre environnement, réfléchir en s’amusant et nous éloigner de « notre bulle ». Cette immersion dans un monde annoncé comme fou est surtout un miroir grossissant de notre société.
Finalement cette soirée fut un enchainement de surprises et d’étonnements. L’entrée en matière assez atypique donne un avant-goût : on rit, on discute avec des inconnus, on se laisse transporter et on se déconnecte du quotidien. Sans réellement s’en rendre compte, notre imagination est éveillée et on regarde l’environnement différemment ; l’attitude change.
Le plus épatant, c’est que le Bazarnaom continue d’exister et de s’enrichir à chaque nouvelle édition grâce à l’engouement et l’appui des citoyens, plus que celui des politiques. De fait, le soutien des instances territoriales a longtemps été timide. Aujourd’hui finalement, la ville de Caen, le département Calvados et la région Normandie sont partenaires. Bien que le ministère de la Culture ne soit pas engagé à soutenir l’événement, une certaine forme de démocratisation culturelle s’est développée d’elle-même : les gens, d’âges et catégories socio-professionnelles étendues, se retrouvent sans séparation, unis par les mêmes goûts. La reconnaissance de l’événement par le monde du spectacle vivant au niveau national n’a pas attendu ces appuis ! La liberté de créer et la persévérance des acteurs de ces espaces artistiques alternatifs face au désintérêt des politiques est une belle leçon.
CM
#artderue
#spectaclevivant
#partage
Pour en savoir plus:
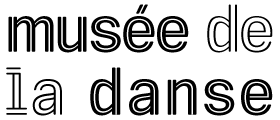
Le musée de la danse numérique : une expérience interactive saisissante!
Le musée de la danse numérique illustre un dispositif d'innovation culturelle soutenu en 2010 par le programme « Culture Labs » mis en place par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Design graphique et interactif : g.u.i.
(Nicolas Couturier,
Bachir Soussi-Chiadmi, Julien Gargot)
Le musée de la danse numérique illustre un dispositif d'innovation culturelle soutenu en 2010 par le programme « Culture Labs » mis en place par le Ministère de la Culture et de la Communication. « Né d'un croisement contre-nature entre le musée, lieu de conservation, la danse, art du mouvement, et le centre chorégraphique, lieu de production et de résidence, le Musée de la danse est un paradoxe qui tire sa dynamique de ses propres contradictions : un espace expérimental pour penser, pratiquer et élargir les frontières de ce phénomène qu'on appelle la danse ; et une opération qui s'actualise à chacune de ses manifestations ».
Le Musée de la danse se caractérise comme une « idée nomade » qui interroge son statut et sa mise en forme. Son exposition permanente intitulée « « Expo zéro » est un projet d’exposition sans œuvres : pas de photos, de sculptures, d’installations ni de vidéos. Zéro chose, aucun objet stable. Mais des artistes, des zones occupées par les gestes, les projets, les corps, les histoires, les danses que chacun a bien voulu imaginer ». Créée à l'initiative de Boris Charmatz, elle accueille dix personnalités (artistes, architectes, chercheurs...) en résidence dans des espaces (Le Garage/Rennes, Le LiFE/Saint Nazaire, TheatreWorks/Singapour) pour présenter leurs visions, subjectives et utopiques, de ce que pourrait être un «Musée de la danse». Original, innovant et surprenant, le Musée de la danse interroge la définition même du musée à partir de l'exposition d'un patrimoine immatériel tel que la danse.
« Expo Zéro » propose une visite virtuelle par une interface interactive Flash/ActionScript 3 afin de créer un parcours vidéo immersif. Considérant le public au cœur des préoccupations du musée, « Expo Zéro » amène une approche participative du visiteur en lui laissant la liberté de son parcours. Dès le départ, on lui demande : « Par où voulez-vous entrer : [l'entrée normale] ou [une porte dérobée] ? ». Selon le profil des publics, deux approches sont offertes : la sécurité d'un parcours traditionnel ou le danger d'un parcours « aventure ». Adapté à la sensibilité de chacun, ce simple dispositif permet de répondre aux attentes du visiteur et de se l'approprier. On se pose alors la question si le contenu varie en fonction des chemins choisis. A fortiori pas complètement, certaines séquences se recoupent et d'autres sont exclusives. Ainsi il n'y a pas de perte de contenu et chacun s'y retrouve à son niveau.
Calquée sur l'expérience du réel, la visite se fait progressivement de l'extérieur vers l'intérieur. La version « aventure » saisi le visiteur dans la spirale de folie de Boris Charmatz qui expose théâtralement ses interrogations sur la naissance du musée de la danse : « par où se fait l'entrée, de quelle manière et que découvre-t-on en premier ? » Le visiteur est aussitôt appelé à réagir : « Que mettriez-vous dans la première pièce : [une sculpture de corps] ou [une danseuse au travail] ? » Toujours présenté sur le ton de l'humour et du décalage, le postulat de l'œuvre se pose alors : objet ou humain ? L'ironie à toute épreuve, la sculpture de corps n'est en fait pas un objet. Il s'agit d'une performance nouant des danseurs entre eux dans des positions insolites et exubérantes. A l'inverse, la version dite « normale » propose « d'écouter une discussion sur les musées » d'un illustre inconnu. Son discours présente au visiteur le principe de l' « Expo Zéro » qui est avant tout conceptuel : « présenter des mouvements, des corps et des chorégraphies sans tomber dans les musées traditionnels, lieux d'accumulation d'objets (costumes, décoration, photo, etc). » L'importance, selon lui, est simplement la transmission du savoir. Ainsi averti, le visiteur peut continuer son parcours en connaissance de cause.
Le musée de la danse ne tient pas à retracer l'histoire de la danse, cependant la notion de « patrimoine chorégraphique » est tout de même évoqué. Parmi les grandes figures de la danse sont citées Vaslav Fomitch Nijinski, Pina Bausch et Trisha Brown. Leur œuvres sont amenées à être (re)découvertes soit à travers des ré-appropriations, soit d'une manière encore décalée telle qu'« une partition de Trisha Brown à l'envers ». Par ailleurs, quelques grandes disciplines sont aussi évoquées comme le « contact improvisation », une des formes les plus connues et les plus caractéristiques de la danse postmoderne. Enfin, une rencontre avec Tim Etchells (grand performer contemporain) permet de se questionner sur ce qu'est la performance. La visite permet au spectateur de mettre directement en application cet enseignement en décrivant la performance suivante. Par la même occasion, Tim Etchells interroge le rapport de proximité entre l'œuvre (le danseur) et le public. Quelques séquences plus tard surgit une proposition encore plus déroutante. Le visiteur est appelé à payer un euro symbolique pour « visiter l'expo spéciale de Tim Etchells ». L'artiste explique que « tout le reste est gratuit mais celle-ci est vraiment spéciale » et un message de contribution est alors envoyé à l'écran avec l'adresse postale où l'envoyer. Peut-être incongru, la question est ici d'interroger les politiques tarifaires des musées. Provocation ou véritable test, on ne comprend pas nécessairement la démarche. Quoi qu'il en soit, cela peut être vécu comme une frustration car on passe un premier sas en donnant de l'argent virtuel puis une nouvelle frontière nous rappelle d'envoyer une réelle contribution. Cette fois, c'est la frontière du réel et du virtuel qui pose question d'une façon dérangeante.
Le musée de la danse numérique est d'une qualité plastique remarquable. Tous les cadrages, points de vue et angles de vue sont pris d'une manière intimiste. La notion de spectacle s'efface, on découvre l'envers des décors et on pénètre dans le quotidien des danseurs d'une manière sensible. Le parti-pris cinématographique ne fait qu'accentuer ce caractère immatériel par des compositions d'images complexes (mises en abîmes, interpénétrations de plans, surfaces réfléchissantes, etc). De plus, des effets visuels de floutage dématérialisent les images qui deviennent peu à peu des mirages, des illusions ou même des rêveries. On a l'impression de se réveiller à chaque fois dans de nouveaux lieux. Les espaces ne sont pas clairement identifiables et on se demande souvent où on a été transporté, quelques fois dans les recoins d'une friche, d'autres dans une salle de danse ou alors même perdu dans des couloirs... L'ambiance sensorielle particulièrement bien travaillée reste toujours très subtile et très prenante. Privilégiant le silence à la musique, il y a toujours des sons parasites, des bruitages, des grincements... La séquence « couloir obscur » met le spectateur en position d'aveugle. Un chuchotement intrigant à la respiration lourde fait appel à l'imaginaire du spectateur. On lui demande de se visualiser tout ce qui n'est pas perceptible à l'œil et de se créer son paysage fantasmagorique.
Conçu comme un musée vivant, la médiation privilégiée est celle du « guide-artiste » qui commente les chorégraphies en temps réel ; cela peut être le danseur ou son professeur. La plupart d'entre eux parlent uniquement en anglais mais de façon lente et compréhensible. Cependant, il est dommage que, pour un individu sans aucune notion d'anglais, ces outils de médiations ne soient pas accessibles. A contrario, il est annoncé une version de la visite en anglais et les choix des parcours sont uniquement écrits en français. Il semble que la question des langues ai été malheureusement négligée. Pourtant, ce musée laisse penser à une nouvelle approche de l'accessibilité des musées. La position d'aveugle est directement vécue dans le parcours, (la partie auditive perd de son intérêt si on ne parle pas anglais), l'accessibilité en ligne est gratuite et facile pour chacun. Il peut néanmoins manquer un peu d'informations pour ceux qui n'ont pas de connaissances de la danse contemporaine. Le musée de la danse revendique clairement que l'approche expérimentale doit primer mais doit-on pour autant négliger l'aspect culturel?
Le musée de la danse propose avant tout un bel espace de réflexion sur l'exposition du patrimoine immatériel. Mettant sens dessus dessous les rapports établis entre le public, l'art, ses territoires physiques & imaginaires, le Musée de la danse propose une approche muséographique hybride et ludique. Sa mission de délectation est ainsi assurée. « Expo Zéro » interroge les formes de médiations traditionnelles et nous laisse penser que les voies de l'humour et du décalage permettent de faire passer un discours plus fluidement. Quel bel espoir de voir la conception, la démocratisation culturelle évoluer !
Elodie Bay

Le Musée des Instruments de Musique de Bruxelles : mécréants ou serviteurs de la musique ? Le grand inquisiteur a mené l'enquête.
Voicile cri de rage et l'état d'esprit frondeur avec lequel Tomas del Torquémidi, grand inquisiteur et critique musical, vint à Bruxelles ce samedi 3 novembre 2012, prêt à en découdre avec ces mécréants. Mais bien vite il déchanta et dût remballer son zèle légendaire. D'abord il fut interloqué par les logan du MIM : « vous allez voir ce que vous allez entendre ».
« Entendre » et « voir », deux mots qui résument bien le parcours proposé par ce musée, et la façon dont il met en valeur sa collection.

Crédits : Daniel Bonifacio
Ici, point de bagatelles. Et quand bien même, ce sont des objets parfaitement conservés et fort bien mis en valeur par des lumières individuelles et des cartels complets. Tout cela dans des vitrines thématiques avec un nombre d'instruments restreint présentés de façon claire : sur 8000, 1200 ont été savamment sélectionnés. Chacun se laisse admirer comme le tableau d'un musée des beaux arts, avec une scénographie dynamique. Le volet « voir » était donc réussi, mais n'aurait pas suffit à calmer le zèle de Torquémidi.
Car cet homme aux oreilles nymphomanes avait besoin de sentir les sons vibrer. Le musée lui a permis d'atteindre de multiples orgasmes auditifs grâce à l'audioguide qu'il a reçu à l'accueil. Celui-ci déclenche automatiquement la musique liée au groupe d'instrument de la vitrine devant laquelle on se trouve. Musique qui permet à la fois de restituer le son de l'instrument, mais aussi le genre de musique lié à la période, à la situation géographique et au contexte social dans lequel il était utilisé. L'inquisiteur fut alors emporté dans une orgie sonore, il vit dans son esprit les instruments revivre.
Bien qu'il n'ait fait que la visite individuelle, il avait apprit que le musée proposait en outre des ateliers musicaux, surtout pour les enfants et les personnes handicapés. Ils permettent aux visiteurs d'essayer des instruments. Pour les sourds et mal-entendants il y a même un caisson vibrant qui leur permet de ressentir différents sons à travers tout leur corps. Encore un moyen, pensait-il, de rendre à leurs instruments leur véritable nature. Il y a aussi les visites guidées. Bien qu'il n'en fit pas, il avait écouté au loin, puis posé des questions à un des guides. Il apprit alors que les visites guidées avaient un thème précis qui changeait régulièrement, afin de révéler les multiples richesses de l'exposition et d'augmenter la probabilité de faire revenir les visiteurs pour revoir le parcours.
Et c'est bien le parcours muséographique qui acheva de convaincre Torquémidi que le MIM n'était pas le diable. Celui-ci permet en effet de remettre les instruments dans leur contexte, de raconter leur histoire ; mais mieux encore il apporte des réflexions sur la musique. Il y a d'abord quatre grands thèmes : au premier étage les traditions du monde (musiques traditionnelles du monde entier), au second la musique savante occidentale (de l'antiquité à la fin du XIXe), au quatrième les claviers et les cordes, au sous-sol les instruments mécaniques (qu'il n'a pas eu le temps de visiter). A travers ces thèmes, on y raconte l'histoire de la musique, on y fait un tour du monde, on y fait de l'anthropologie musicale.
Une de ces réflexions porte sur l'origine populaire de chaque instrument. Il y a comme un effet miroir entre le premier et le deuxième étage. Les violons des ménétriers deviennent ceux des musiciens de la cour du Roi, les hautbois des fêtes populaires se retrouvent dans les ensembles baroques... Le musée pourrait presque être qualifié de musée ethnologique.

Crédits : Daniel Bonifacio

Crédits : Daniel Bonifacio
Ainsi, chaque instrument est rendu vivant à la fois par le son, mais aussi par son contexte, son utilisation, son histoire. Par exemple, on apprend que la plupart des instruments nous viennent d'Orient, la cornemuse était très répandue dans toute l'Europe. On apprend comment le clavicorde du XVIe est devenu le piano moderne. On peut entendre la musique des grands compositeurs tel qu'eux l'entendaient avec les instruments de leur époque.
Tout cela plût beaucoup à l'inquisiteur. Mais, épouvanté par ce sentiment bizarre d'être heureux et satisfait, il s'en alla aux toilettes (très propres et spacieuses par ailleurs), se mit de l'eau fraîche sur le visage, et remit son esprit critique en état de marche. Et là, bien que restant satisfait globalement, il commença à être irrité par certaines choses. Et remarqua que la muséographie était encore en gestation, et que quelques détails pourraient être améliorés.
L'audioguide joue certes les sons, mais aucune information sur le morceau joué : quel style, quel époque, titre ? Est-ce une musique typique de l'époque et de quel milieu social ? La musique que joue l'ensemble gamelan, par exemple, aurait mérité un développement : elle est, en effet, jouée par des musulmans mais comporte encore les formes et une spiritualité propres à l'hindouisme. Seul la photo de l'instrument apparaît sur l'écran, tant pis pour les curieux et les mélomanes, tant mieux pour Torquémidi qui est enfin redevenu un peu frustré et hargneux.
De plus le caractère automatique de cet audioguide irrita Torquémidi, qui n'avait pas forcément envie d'écouter des minutes d’accordéon et était passé devant les flûtes dont la musique avait du mal à se déclencher, il aurait préféré le faire de lui-même. Et il se trouvait ridicule avec ce gros boîtier lourd qu'il collait à son oreille depuis deux heures, alors qu'un petit casque aurait été plus pratique.
La médiation pour les visites non guidées le laissa aussi perplexe. Ce maniaque a cherché longtemps la partie numéro cinq qui n'existe visiblement pas, et il ne comprenait plus l'ordre de la visite qui était mal indiquée, passant de la partie 6 à la partie 22 puis la 15 ; mais où est donc la 5 !? Il regrettait de ne pas avoir fait la visite guidée, mais encore plus que l'audioguide ne fasse pas cet office.
Cet inquisiteur d'habitude si exalté à l'idée d'assouvir sa haine à travers des articles assassins, rentra chez lui fatigué et malheureux d'être aussi content. Le MIM n'a visiblement pas fait de ses 8000 instruments des vulgaires babioles, au contraire : ils les fait vivre, puis à travers eux nous raconte l'histoire de la musique et nous fait voyager. Il devait bien admettre que finalement la musique pouvait avoir sa place dans un musée.
Daniel Bonifacio
Musée des Instruments de Musique de Bruxelles : http://www.mim.be/
Du mardi au vendredi : 9h30 - 17h00
Samedi et dimanche : 10h – 17h00

Mercredi jour de pluie
Aujourd'hui, c'est mercredi. Comme chaque personne en vacances, je n’ai pas fait la moitié de ma To do List. Et pourtant, troisième case à cocher et programme du jour : l'exposition Comédies Musicales à la Cité de la Musique.
Dans le train je réfléchis à ce qui m'a donné envie d'aller la voir : élargir mes connaissances sur ce sujet, certes, mais surtout, oui surtout parce que j’espère qu’ils ont intégré West Side Story, comédie musicale que je chéris depuis le lycée. Voilà, c'est ça. C'est West Side Story qui m'amène à Paris. J’arrive Tony !
Mary Poppins © The Walt Disney Pictures

Murs d’affiches de films © L.L.
Sautons dans le contexte de la comédie musicale
Mon billet en poche, je mets le casque de musique qu’on me tend. Je suis immédiatement séduite, le son est bien meilleur que dans des écouteurs. Je fais quelques pas et me retrouve face à un mur d'affiches. Les demoiselles de Rochefort..., La mélodie du Bonheur..., et mon œil s'arrête net sur l'affiche de West Side Story. Ouf ils ne l'ont pas oublié ! La scénographie moquette et salles sombres rappelle l’univers du cinéma. Il y a déjà du monde. Une petite fille s'arrête devant un portant de costumes dissimulé dans un coin et, comme s'il était réservé à des V.I.P., la fillette hésite puis enfile une robe de princesse.
Nous sommes introduits dans l’exposition par la comédie musicale à succès Singin’ in the rain diffusée sur un grand écran ainsi que les nombreux films qui citent cette chanson : même Les Daltons la chantent ! Ce film de 1952 s’inscrit dans les débuts du genre de la comédie musicale à Hollywood. Cette entrée en matière suggère les thèmes de l’exposition : le scénario, la danse, le chant. Je me sens très vite immergée : je me concentre sur chaque son que j’entends. Je perçois Le Prologue de West Side Story dans la grande salle. Beaucoup d’informations sont projetées sur le mur sur l’histoire et l’évolution de la comédie musicale des années 1920 au phénomène La La Land. Les premiers films comportant de la musique diffusaient le son sur des phonographes placés dans la salle de projection, c’est le système du Vitaphone. Puis Le Chanteur de Jazz (1927), premier long-métrage sonore, insère des scènes chantées et des dialogues. C’est ainsi que le musical dans le film fait son apparition. L’apogée de la comédie musicale dans les années 1950 n’est pas ralentie par la guerre froide. Elle est considérée comme un réel divertissement puisque le film Un Américain à Paris reçoit l’Oscar en 1951.
Même s’il subit les restrictions de la censure, ce genre parvient à exprimer des sujets majeurs de l’époque tels que la lutte syndicale et le racisme. En 1973, Jesus Christ Superstar est un opéra-rock sous un air de mouvement hippie. Dès les années 2000 le cinéma développe ses effets visuels et les comédies musicales tendent vers le rêve et l’imaginaire comme dans Le retour de Mary Poppins (2018). A regarder le peu de personnes à mes côtés, il me semble que ce mur présente une quantité trop importante de données, d’autant plus qu’elles défilent chronologiquement et qu’il faut donc attendre le déroulement complet pour avoir un aperçu de cette évolution. Même si l’idée d’une projection est plutôt agréable et varie d’un panneau classique.
Musique, danse, chant, cinéma
Les petites salles qui suivent traitent chacune d’un thème. Celle sur le chant propose d’utiliser notre casque audio. Je n’attends pas très longtemps une place sur le module où on peut déplacer une statuette afin d’entendre chanter des acteurs dans certains films.

Module Les acteurs chantent © L.L.
Le chant est ici travaillé en amont et devient partie prenante du défi du comédien. Je poursuis ma déambulation vers Bernstein et ses compositions, notamment les partitions de West Side Story et Un Jour à New York. Je ne peux dire s’il y a une quelconque chronologie dans l’agencement des espaces car le focus suivant porte sur le succès 2016 : La La Land. Les deux acteurs dansent sur un support en carton tandis que les visiteurs écoutent le réalisateur, inspiré des Parapluies de Cherbourg, mélodrame amoureux de 1964.
Qui a dit pour enfants ?
Une petite salle est réservée au cinéma pour enfants. Je suis plutôt ravie par les planches de dessins préparatoires de Baloo ou de Simplet, mais moins par l’ambiance de la pièce que j’aurais souhaitée plus magique, la plupart des films projetés étant des Disney. Cette salle semble dissimulée dans un coin et n’est pas signalisée, alors qu’elle peut permettre aux enfants de regarder un extrait de film puis de s’interroger sur celui-ci en soulevant des panonceaux questions.

Dessins préparatoires de Disney Enterprises © L.L.
Bienvenue au cinéma
Je suis attirée par la grande salle, avec en son centre une longue banquette pour le visionnage d’extraits de comédies. L’écran surprend par sa longueur et les films sont diffusés chronologiquement par thèmes : après les claquettes de Fred Astaire, on retrouve New York et la tension des clans dans West Side Story. L’air de la fête de La Belle est La Bête est dynamisé par le fractionnement de l’image à l’écran selon le rythme de la chanson. Les images du film de 2017 sont confrontées à celles du dessin d’animation et des dessins originaux.
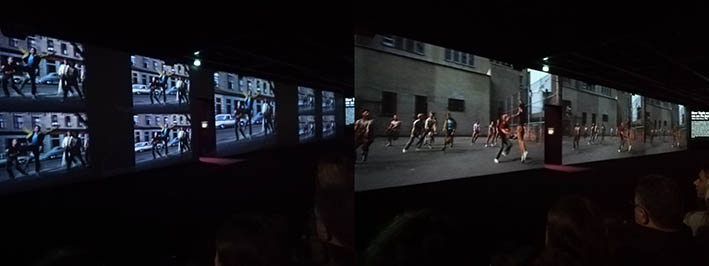
Grand écran avec images de West Side Story © L.L.
Claquettons ensemble
Derrière moi, on chantonne sur le fameux “lolita” de Maryline Monroe, on claque des doigts, on applaudit même. On peut aussi constater l’importance de la danse et ses effets visuels avec Busby Berkeley. La danse a une part importante dans l’exposition, et dès l’affiche avec la chaussure à claquettes. Dans The Artist, le rôle majeur du chorégraphe a permis une scène de danse culte. Les vidéos des entrainements jusqu’aux images finales affirment la difficulté des acteurs pour apprendre une danse. Chaque visiteur se promène avec son câble du casque audio, cherchant à pouvoir le brancher là où cela lui chante et je croise à nouveau la fillette qui déambule. Je me décide enfin à me diriger vers la petite porte au centre du grand écran, non sans une certaine gêne en pensant à tous ses regards dirigés indirectement vers moi. Ce que je découvre me fait très plaisir. Sur le mode de l’expérimentation, une petite salle mystère nous propose une initiation aux claquettes, avec un professeur présent tout l’après-midi. La moitié de la vingtaine de personnes présentes est sur scène. Dans une ambiance détendue et rythmée, Fabien Ruiz leur apprend une courte chorégraphie sur un fond musical.
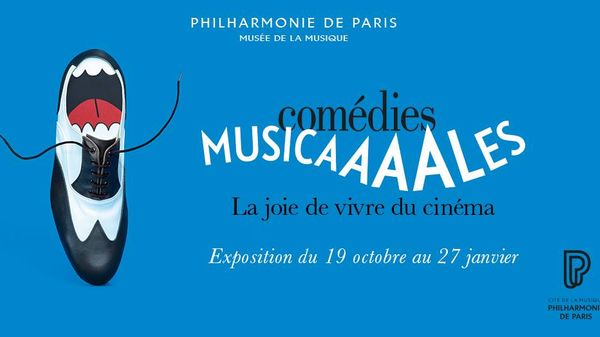
Affiche de l’exposition
Ouvrir et réfléchir
La fin de l’exposition m’a semblée décousue car les thèmes abordés ne sont pas toujours en relation immédiate les uns avec les autres. On découvre les costumes de Peau d’âne dans une section réservée aux métiers de créateurs avec de délicates maquettes de costumes. Tout près d’elle, le thème “La comédie musicale à travers le monde” semble nous inviter à approfondir le sujet par des vidéos. Cette thématique aurait-elle dû être plus développée ? Je pense que l’intérêt premier de cette exposition est de refaire vivre les comédies musicales qui ont fait grandir ce genre, les recontextualiser pour mieux les remontrer au public. Cette partie intéressante semble intégrée au reste alors qu’il s’agit d’une ouverture sur le monde qui mérite de questionner le visiteur.
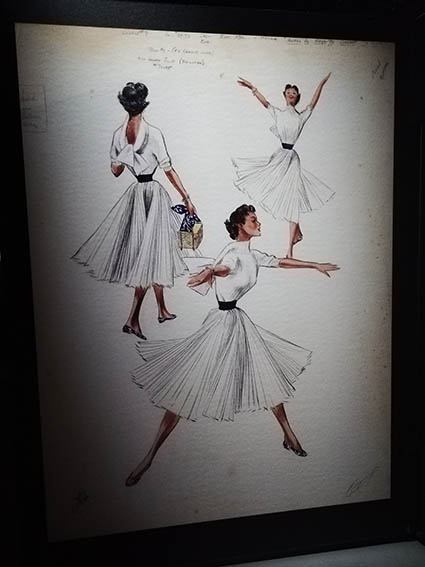
Maquette de costume pour Cyd Chariss dans Tous en scène © L.L.
En sortant de cette exposition, je réalise que j’ai le sourire aux lèvres et que je me pose plein de questions. Elle a réveillé ma curiosité et m’a donné envie de danser et chanter, de regarder les films que je ne connaissais pas et de partager mon ressenti !
Dans la boutique, je croise le monsieur de caméra café : Bruno Solo. Il semble très content de l'exposition et achète l'affiche de Sing'in the rain. C'est la fin de ma visite. Les gens sortent souriants, un catalogue d'exposition ou une affiche sous le bras, et sous la pluie. Et moi j’ai l’air de Sing'in the Rain qui danse dans ma tête.
Lauréline Lefay
Pour en savoir plus :
https://www.cnc.fr/cinema/dossiers/les-comedies-musicales_899184
https://www.universalis.fr/dossier-du-mois/article/la-comedie-musicale/
https://www.francemusique.fr/comedies-musicales

Osez, osez, Evelyne !
La Zouzeau Next festival : embarquez à bord du Galaxia, une expérience unique
Article à plusieurs mains
La Zouze est une compagnie de danse, notamment conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication, basée à Marseille et dirigée par Christophe Haleb, tour à tour chorégraphe, directeur artistique, danseur et pédagogue. Née il y a 20 ans, cette compagnie a la particularité d’investir sans cesse de nouveaux lieux et de construire des créations de manière collective, y faisant intervenir le réseau culturel local. L’expression « laboratoire participatif public » la définit parfaitement. Espace, corps et interdisciplinarité en sont des maîtres mots. Depuis ses débuts au Théâtre Contemporain de la Danse à Paris, puis sa participation au festival d’Avignon, au Théâtre National de Chaillot, à la Townhouse Gallery au Caire ou encore lors de l’inauguration du MUCEM, La Zouze cherche toujours à s’ouvrir à de nouveaux spectateurs et à multiplier les regards. Sa participation à la soirée de clôture « See You NEXT Time » du Next festival, qui s’est déroulé du 15 au 30 novembre 2013, fut une nouvelle occasion de choix pour proposer son univers à un public habitué aux créations contemporaines novatrices et engagées. Elle proposait son spectacle Evelyne House Of Shamedécliné pour l'occasion en Galaxia. C'est de cet événement dont nous allons développer le déroulement.
Evelyne House Of Shame
Ce festival international et transfrontalier vise à soutenir, produire et diffuser la création et les nouvelles formes artistiques dans le domaine des arts vivants au sein de l’Eurométropole Lille - Kortrijk - Tournai et Valenciennes. En collaborant ensemble, ce sont cinq structures culturelles qui s’unissent pour dynamiser cette région : la Maison de la Culture de Tournai, le Cultuurcentrum de Kortrijk, le centre d'arts de BUDA de Courtrai, La Rose des Vents à Villeneuve d'Ascq et l'Espace Pasolini, théâtre international de Valenciennes.
Crédits : Lucie Vallade
Le Master MEM impliqué dans le spectacle vivant ?
En ce qui concerne notre stricte participation en amont, rappelons tout d’abord que d’autres étudiants préparaient également cette soirée avec nous, « muséophiles ». Trois étudiants en Arts du spectacle de l’Université d’Artois répétaient au sein de l’atelier chorégraphique et des étudiants des Beaux-Arts de Tournai s’occupaient des projections vidéos et autres technologies iconographiques et ont, comme nous, collaboré à la mise en place d’éléments plastiques et scénographiques. Pendant ce temps, nous nous sommes astreintes, ainsi que Aurélien, étudiant en Master 2 Arts du spectacle à l’Université d’Artois, à des tâches manuelles et artistiques : peinture de socles/estrades et atelier graphique.
Crédits : Lucie Vallade
Eh bien oui, ces cubes blancs que vous voyez dans cette photo à droite, ce sont nos petites mimines qui les ont peints, et en rythme, pendant les répétitions chorégraphiques ! Sous-couche, couche et retouches, nous sommes prêtes pour nos montages d’expo !
En ce qui concerne l’atelier graphique, nous mettions à contribution nos imaginaires et nos références en tous genres. Notre objectif ? Concevoir et dessiner des typographies, les attribuer à des phrases puis les apposer sur des plaques en polystyrène. Dans quel but ? Comme à l’arrivée en gare ou à l’aéroport, que chaque danseur tienne une plaque afin d’accueillir le public. Nous y avons mis soin et rigueur, mais nous ignorions alors le destin des dites plaques… être détruites : l’art de l’éphémère. Ce que nous retiendrons ? L’esprit d’équipe et d’initiative, de la bonne humeur sous des ambiances festives avec un accueil chaleureux de la part de la compagnie : un régal ! Enfin, n’oublions pas l’essentiel, participer à cet évènement aura nourri et stimulé notre regard sur la place des arts du spectacle au sein des musées et des espaces d’exposition.
Entre les guides et la piste de danse : entre organisateurs et spectateurs
Samedi soir, 23:00, le moment est venu pour nous d'accomplir la modeste – mais ô combien importante – tâche qui nous a été confiée : actionner les guindes de la structure qui constitue la pièce maîtresse de la soirée. C'est notamment autour de cette impressionnante méduse de papier que la fête s'articule. Imposante et informe, ajourée à la manière d'une délicate dentelle, elle devient un support à des projections lumineuses faisant varier l'atmosphère.
Crédits : Marine
 Sa robe, tantôt mauve ou bleutée, accompagne une musique parfois enjouée puis inquiétante. Le temps d'une soirée, nous devenons marionnettistes et jouons avec les ficelles de ce décor qui respire au rythme de la fête. Attentifs, nous travaillons en symbiose avec les collègues situés de part et d'autres de la salle afin de chorégraphier les mouvements de l'élégant OVNI. L'interaction entre également en jeu avec la musique, les danseurs, les chanteurs et les participants qui se retrouvent parfois enfermés dans le ventre de la bête qui finira en miettes. En effet, à mesure que les passagers du vaisseau imaginaire GALAXIA s'approprient les lieux, ils commencent à jouer avec la structure en allant jusqu'à la déchiqueter pour en faire des confettis ou un habit de fortune. La force de ce décor éphémère réside dans l'esthétique de la destruction. Qu'il s'agisse des pancartes que nous avions confectionnées, du décor tout entier ou des costumes des danseurs, tout finit par être dissolu dans l'atmosphère festive. A l'image de l'ambiance, le décor évolue jusqu'à laisser place à un nostalgique capharnaüm, comme dans toute fête réussie...
Sa robe, tantôt mauve ou bleutée, accompagne une musique parfois enjouée puis inquiétante. Le temps d'une soirée, nous devenons marionnettistes et jouons avec les ficelles de ce décor qui respire au rythme de la fête. Attentifs, nous travaillons en symbiose avec les collègues situés de part et d'autres de la salle afin de chorégraphier les mouvements de l'élégant OVNI. L'interaction entre également en jeu avec la musique, les danseurs, les chanteurs et les participants qui se retrouvent parfois enfermés dans le ventre de la bête qui finira en miettes. En effet, à mesure que les passagers du vaisseau imaginaire GALAXIA s'approprient les lieux, ils commencent à jouer avec la structure en allant jusqu'à la déchiqueter pour en faire des confettis ou un habit de fortune. La force de ce décor éphémère réside dans l'esthétique de la destruction. Qu'il s'agisse des pancartes que nous avions confectionnées, du décor tout entier ou des costumes des danseurs, tout finit par être dissolu dans l'atmosphère festive. A l'image de l'ambiance, le décor évolue jusqu'à laisser place à un nostalgique capharnaüm, comme dans toute fête réussie...
Grâce à ce rôle « d'actionneurs de guindes » synchronisés, nous faisons désormais partie intégrante de la troupe. Une intégration qui s'est difficilement mise en place pendant la phase de préparation. Côtoyer des danseurs dont le rapport au corps est tout à fait différent du nôtre nous a renvoyées à notre propre relation au corps. Leur « décomplexion » suscite l'admiration autant qu'elle nous confronte crûment à notre pudeur « intériorisante ». Lorsque notre mission est achevée, nous pouvons désormais nous mêler à la foule, portées par la joie d'avoir participé à la mise en place des festivités. Nous pouvons alors laisser s'exprimer nos corps dans la folie galaxienne. Situés entre membres actifs de la troupe et simples spectateurs, notre statut particulier nous a permis de nous investir dans un rôle de relais avec le public en lui montrant la marche à suivre pour le quadrille ou le jeu du Kissing-Game.
Concentrées puis décontractées, nous avons pu expérimenter la soirée selon différents points de vue ce qui l'a rendue d'autant plus agréable à vivre. Une expérience iconoclaste qui fait du bien et que nous avons hâte de renouveler uniquement du côté du spectateur ! Notre perception en sera-t-elle changée ?
Evelyne, je t'aime... moi non plus...
Chez Evelyne, le public catapulté spect’acteur se trouve sur le plateau, ou plus exactement l’espace du spectateur et l’espace du performeur, traditionnellement distincts, forment un éden unique à vivre ensemble. Si une partie du public (averti de l’originalitéde l’œuvre dans laquelle il a choisi d’entrer) joue le jeu et profite pleinement de ce moment hors du temps pour s’exprimer et éprouver sans taboucette contrée de liberté, cette aire partagée demeure pour beaucoup difficile à investir et apprivoiser.
 Sous-estimer le cadre et le rôle habituellement dévolu au spectateur et la proposition de s’en écarter constitue, dans le meilleur des cas, une maladresse. Troquer les limites rassurantes de son fauteuil contre l’inconnu in situ demande parfois efforts et encouragements.
Sous-estimer le cadre et le rôle habituellement dévolu au spectateur et la proposition de s’en écarter constitue, dans le meilleur des cas, une maladresse. Troquer les limites rassurantes de son fauteuil contre l’inconnu in situ demande parfois efforts et encouragements.
Crédits : Marine
Au cours du spectacle, le public est notamment sollicité afin de former différents groupes en fonction de caractéristiques capillaires. Une jeune femme blonde paraît désorientée. Elle hésite à rejoindre le groupe en train de se constituer, à la périphérie de la salle, autour d’un danseur chef de file des créatures à la chevelure couleur des blés.
Quels risques prend-elle ? Quelles peuvent être les raisons de ses tergiversations ?
Quitter temporairement son groupe d’amis et être confrontée directement à des inconnus.Être exposée au regard de l’assemblée le temps de l’exposition de ce petit groupe sous les feux des projecteurs. Participer et être éventuellement entraînée, ensuite, dans les circonvolutions du spectacle qu’elle ne maîtrise pas.Cette jeune femme, rassurée sur la suite des événements, rejoint finalement quelques courageux intrépides et s’installe au pied du podium où trône la reine des êtres de son espèce. Elle contribue ainsi à la création d’un des nombreux tableaux de la pièce… Elle n’a cependant pas connu le souffle rafraîchissant du lâcher prise.
Le spectacle suit son cours, avec ou sans elle, mais le principe est la participation du public. Il s’enrichit de celle-ci et s’épanouit à cette condition.Dans cette optique les professionnels et amateurs bénévoles référents au cœur de la structure protéiforme d’Evelyne ont tout à gagner à prendre quelques instants supplémentaires pour guider en douceur les participants. Mieux accompagnés, ces derniers bénéficieront de la dynamique d’enrichissement par l’expérience initiée par la Diva.
Deux spect'actrices livrent sans détour leurs impressions :
Pauline, intéressée par « le concept de spectacle interactif », regrette qu'il ne soit pas « complètement exploité par la troupe qui propose surtout une déconstruction de l'organisation spatiale de la pièce de théâtre. Une grande partie de la soirée se passe à observer les différentes performances. Le public reste dans le flou quant au rôle et aux initiatives qui lui sont laissés. Le point culminant de la soirée reste le quadrille, qui rassemble le public. Mais la participation[de celui-ci], trop irrégulière par rapport aux nombreux moments de flottement, ne m'a pas permis de me prendre au jeu ». Cyrielle est arrivée à la Maison de la Culture « pleine de curiosité et d'attentes » se demandant d'emblée « comment la troupe [animera] cette soirée présentée comme totalement folle ? ». Lors du concert d'ouverture, elle est « surprise par l'immobilité du public ». « La troupe nous emmène ensuite dans les différents espaces où se déroulent des performances auxquelles le public est parfois invité à participer. Ces moments participatifs sont très amusants mais on peut regretter que les performances non participatives soient parfois trop longues et trop à distance du public qui, n'étant pas dans le même monde que la troupe, a parfois du mal à comprendre ce qui se passe autour de lui. La troupe a voulu déstructurer les codes de la fête et elle y est arrivée mais peut-être un peu trop, car le fêtard devient souvent plus spectateur qu'acteur de la fête, d'autant que les temps morts entre deux performances sont souvent longs. »
Toutes deux auraient souhaité des moments consacrés à la danse plus développés aucours de la soirée ainsi qu'une plus forte présence de la musique, mais concluent respectivement ainsi : « certains moments étaient vraiment bien, mais trop rares pour exploiter le concept jusqu'au bout »,« j'ai passé une très bonne soirée, inhabituelle, déjantée, à l'image de La Zouze."
Le public d'Evelyne, tout comme elle, est exigeant et cela ne peut qu'être source d'émulation pour de futures expériences plus riches et appréciées.
Evelyne propose, en plus de cette invitation à faire « spectacle » ensemble, son corps augmenté, détourné, paré, nu. Ce corps n’est pas à bonne distance, sur le plateau, mais effleure, entoure le spect’acteur. Le regard et l’attitude, mis en question, se travaillent.
Certains considèrent Evelyne comme une provocation, d’autres comme une créature séduisante qu’il faut suivre sans crainte, d’autres encore comme un cadre privilégié où expérimenter prudemment ses différentes limites.
Evelyne peut être tout cela et plus encore, c’est à vous de la sculpter, de la vivre, de la partager.
Osons entrer dans la danse, apprenties muséographes !
Quel intérêt des étudiantes en muséographie peuvent-elles bien trouver à participer à l'élaboration de la soirée de clôture du festival Next ? A priori cela n'a rien d'évident, et pourtant, le travail fourni par la compagnie La Zouze n'est pas si éloigné du travail du muséographe. Le muséographe conçoit les contenus d'une exposition. Il construit un discours dont le déroulement se traduit sous la forme d'un parcours rythmé. La compagnie travaille à la construction d'un scénario dont la pertinence tient aux rythmes, à l'interaction publics-troupe et à une mise à distance avec les codes de la fête. Notre participation à l'élaboration d'un spectacle vivant intégrant diverses disciplines telles que la danse, le théâtre, les arts plastiques et la musique nous a permis d'entrer, pendant quelques jours, dans un milieu culturel que nous avons peu l'occasion de côtoyer de l'intérieur. Ce temps nous a permis d'appréhender les parallèles et les différences entre la construction et la mise en scène d'un spectacle vivant et d'une exposition. La place du corps, centrale chez les danseurs, nous a forcées à interroger nos propres rapports, plus abstraits, plus distanciés. Ces moments vécus sont nécessaires à la réaffirmation de la place éminente que doit faire le muséographe au corps du visiteur, de parler autant à ses sens qu'à son intellect pour produire un parcours d'exposition sensé. Une exposition efficace travaille donc le corps du visiteur pour lui faire prendre conscience de lui-même par rapport à un espace donné. Les dispositifs de médiation étant à la fois outils et conditions de ce rapport singulier du corps à un espace.
Lucie Vallade, Anne Hauguel, Marine, Ophélie Laloy
étudiantes en Master Expo-Muséographie à l'Université d'Artois
La forme participative de cet article traduit l’ambiance de la soirée et le travail de la Compagnie La Zouze. C’est en unissant nos expériences, nos idées et nos savoir-faire qu’il a pu voir le jour !
Nous remercions la Compagnie La Zouze de nous avoir accueillies et tout particulièrement Christophe Haleb et Laurent Le Bourhis ; Amièle Viaud de La Rose des Vents ; la Maison de la Culture de Tournai ; nos collègues d'Arts du Spectacle ;notre responsable de formation Serge Chaumier et tuteur de projet Isabelle Roussel-Gillet.
Légende des photos :
Photo 1. J-1, répétition sur ces socles.
Photo 2.J-1, (avec Laurent) le moment où il faut penser et réaliser les panneaux qui accueillent les spectateurs comme les voyageurs dans les aéroports.
Photo 3 . Jour J, la structure de papier respire doucement, nous tirons les ficelles.
Photo 4. Jour J, le moment où il faut rejoindre le groupe auquel on appartient, la reine des créatures blondes sur son piédestal.
Liens des reportages vidéo de Notélé :
Si on sortait… avec la compagnie de laZouze - 29/11/13
See you next Time - Spectacle declôture du festival Next à Tournai - 06/12/13
# La Zouze
#Evelyne HouseOf Shame
#Galaxia
#Next Festival
#participatif-interdisciplinarité
[1] Lesvendredi 17 & samedi 18 janvier à 20h30 : EVELYNE HOUSE OF SHAME aux Halles de Schaerbeek à BRUXELLES. Du08 au 16 janvier : résidence in situ, ateliers chorégraphiques etplastiques.

Portrait d’artiste : Boris Charmatz
En 2005 la chorégraphe Trisha Brown confie à Rosita Boisseau, journaliste pour Le Monde : « Je suis une travailleuse, une danseuse, une sorte de machine à danser »1. Une autre « machine à danser » est le petit prodige venu de Chambéry, Boris Charmatz qui intègre en 1986 l’école de danse de l’opéra de Paris. Il y reste jusqu’en 1989 puis rejoint le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon.
Depuis les années 90, les parquets de danses sont les témoins de changements importants dans la manière d’aborder cet art. Ce nouveau courant qu’est la non-danse rejette les formes spectaculaires. Les multiples collaborations et créations de Boris Charmatz font rapidement de lui le chef de fil de ce courant. Il bouleverse les codes de la danse contemporaine en mettant à l’épreuve dans des pièces originales les limites de la danse. C’est le cas pour Héâtre-élévision (2002) dont la frontière entre installation artistique et pièce chorégraphique sont abolis. Les arts communiquent et s’enrichissent mutuellement.
Boris Charmatz accorde une importance à la transmission et à l’échange avec le public. A l’instar de Trisha Brown qui multiplie les performances dansées dans des endroits insolites, Boris Charmatz troque ainsi les traditionnelles salles d’opéra pour des étendues de macadam. Il n’est plus question de quatrième mur, la scène n’existe plus. Les spectateurs sont placés au même plan que les danseurs, ces derniers n’hésitant par à intéragir avec ceux venus les admirer silencieusement. Notre chorégraphe multiplie actions et autres dispositifs. Comme Bocal, une école de danse itinérante sans professeur ni mur, savant mélange entre musée hors les murs et incubateur de nouveaux talents.
Musée de la Danse
En 2009, il prend la direction du Centre Chorégraphique de Rennes et de Bretagne. Dans sa volonté de faire communiquer les arts, le centre est muté en un musée de la danse. Il remet en question la place de la danse dans l’espace public. A travers ce centre qui prend un nouveau visage, la notion de musée est également questionnée : « Je propose de fondre toutes les missions dévolues à un Centre chorégraphique national et de les agiter dans un cadre ancien et nouveau à la fois, un cadre drôle et désuet, poussiéreux et excitant, un musée comme il n’en existe nulle part ailleurs. Je voudrais opérer une transfiguration qui donne sens aux missions qui se sont façonnées au cours de l’histoire de cette institution. »2. Il souhaite ainsi concilier création et transformation dans une sorte de musée-laboratoire.
Il prend donc l’initiative de rédiger Manifeste pour un musée de la Danse. Boris Charmatz part du constat que très peu de musées sont dédiés à cet art, même à travers le monde. Cela peut s’expliquer par le caractère pérenne du musée, une entité qui se veut fixe. Alors que la danse, par définition, s’inscrit dans un période courte. C’est un art éphémère et immatériel dans le sens de la pratique. Néanmoins selon Boris Charmatz, ces deux mondes peuvent se rencontrer voire se confronter. La nouvelle muséographie qui fait force dans les esprits et dans les institutions, ses modes de pensées, dispositifs et technologies favorisent cette union. Le manifeste conclut sur une charte de ce que pourrait incarner le musée de Danse. Il en ressort les « 10 commandements » de son musée. Je vous invite à lire, ce qui peut être pour Boris Charmatz sa bible pour un musée idéal, disponible sur le site internet du Musée de la Danse.
Fous de danse
Initié par le Musée de la Danse, Fous de Danse est une manifestation de danse dans l’espace urbain, chère aux yeux de Boris Charmatz, « Comme beaucoup de gens, j’ai été très marqué par les assemblées citoyennes dans l’espace public. » Il n’est pas à son premier essai et tend à ouvrir les frontières de la danse où l’édition 2017 s’est déroulée à Brest et à Berlin. Fous de danse fait référence au titre d’une revue publiée dans les années 90. Il souhaite l’horizontalité, la transversalité et la gratuité.
C’est donc sur l’esplanade Charles-de-Gaulle que l’édition de 2018 a pris place, devenue le temps d’une journée un théâtre éphémère. Fous de Danse réunit des chorégraphes-danseurs venus de différents pays pour faire découvrir et faire danser près de 16 000 Rennais. Des danses traditionnelles du Maghreb avec Filipe Lourenço au fest-deiz avec les Frères Guichen et Krismenn & Alem, les formes et les pratiques se complètent pour créer un nuancier de chorégraphies. C’est évidemment sans compter sur la présence de Boris Charmatz qui ouvre le festival par un échauffement pour tous ainsi qu’une danse collective. Il guide, enseigne, entraine. Bref, il incarne plusieurs personnages, plusieurs rôles.
En 2018, Boris Charmatz fait ses adieux au Centre Chorégraphique de Rennes et de Bretagne, alias le Musée de la Danse. Dix ans se sont écoulés, et il continue d’enchaîner des projets les plus audacieux comme Fous de Danse. Et pour autant, il n’arrête pas de danser.
Edith GRILLAS
#danse
#Rennes
#portrait
1Trisha Brown : "Je suis une sorte de machine à danser"
2Citation issu du Manifeste pour un musée de la Danse : Manifeste pour un Musée de la Danse
image : © France 3 Bretagne - M.A. Mouchère

Quand La Scène au Louvre Lens se met à conter la Danse…
Au milieu de l’obscurité la Scène impressionne… salle de spectacles et de conférences, reliée à la nef transparente et lumineuse du Louvre-Lens, elle appelle au prolongement des sens par l’univers des arts vivants qui en cette soirée hivernale du mois de mars a présenté Three Spells de Damien Jalet.

Hall de La ScèneCrédits : L'Art de Muser
Le visiteur, accueilli dans un hall jonché d’une mosaïque de fleurs (œuvre contemporaine réalisée par l’artiste Yayoi Kusama), pourra se laisser agréablement surprendre. La composition dévoile boutons, feuilles et fleurs centrées par de grands yeux ouverts sur le monde…qui ce soir là offrait la danse …
Three spells est le fruit d’une collaboration entre Damien Jalet, Alexandra Gilbert, Sidi Larbi Cherkaoui et le musicien Christian Fenez.
Ce triptyque de courtes pièces met en scène la puissance fougueuse et sensuelle du duo Damien Jalet et Alexandra Gilbert.
Entre spiritualité et surréalisme, les chorégraphies, telles des rites, oscillent entre animalité et infinie douceur.

Venus in fursCrédits : Arnold Groeschel
Venus in furs a été chorégraphié par Damien Jalet pour Alexandra Gilbert. Superbe métamorphose d’un corps sous l’effet d’une mue donnant naissance à une femme rejetant sa part animale. Dans l’espace neutre magnifié par une lumière discrète, une acoustique musicale envoûtante, le chant des deux interprètes surgit au final comme un cri.

Crédits : Arnold Groeschel
Akekos’ouvre également dans un espace son lumière tout aussi discret et dévoile le corps d’une gitane cachée sous une impressionnante chevelure noire. Sa danse évolue dans la manipulation de cette chevelure qui devient comme porteuse de sa propre gestuelle. Sous cette extrême fluidité, des éléments de l’univers folklorique des balkans et mythes japonais ont inspiré cette nouvelle de Pouchkine chorégraphiée par la complicité de Sidi Larbi Chearkaoui et Damien Jalet. L’histoire évoque un exilé russe qui en proie à sa passion va tuer sa propre femme. Damien Jalet exulte une magnifique et toute puissante interprétation.

Crédits : Arnold Groeschel
Venari clôt ce triptyque. Rituel de la chasse à courre, le mythe grec d’Actéon. Chasseur transformé par la déesse Arthémise et les études de Georges Bataille sur la peinture pariétale ont été les sources de ce solo. Pause du geste comme un silence et éclat du corps dans l’espace s’alternent subtilement pour donner vie à la mort… Sublime Damien Jalet ! et merveilleuse approche du Louvre Lens…
Isabelle Capitani

Quand nos cimetières abritent le matrimoine
Pour une réhabilitation de la notion de matrimoine
Les termes “héritage culturel” et “patrimoine culturel” sont souvent considérés comme équivalents dans la langue française. Étymologiquement, le mot patrimoine vient de “pater” qui signifie “père” en latin. Or, notre héritage culturel ne se résume pas uniquement à ce que nous ont transmis nos “pères”. Le mot “patrimoine” laisse par contre tout un pan de notre culture : celle portée par nos "mères''. Or, les productions des inventeurs, écrivains, chanteurs, compositeurs, sculpteurs, ou encore industriels sont bien plus documentées et mises en lumière que celles des inventrices, écrivaines, chanteuses, compositrices, sculptrices, industrielles, etc. Des femmes, parfois reconnues pour leurs œuvres ou travaux à leur époque, ont été oubliées en quelques décennies.
Image de couverture : Extrait du spectacle Celles d'en dessous © Laure Fonvieille
La notion de matrimoine existe depuis le Moyen-Age mais elle tombe en désuétude au profit de la notion de patrimoine. Depuis une vingtaine d’années, le terme matrimoine est réhabilité pour souligner le rôle que les femmes ont joué dans le développement culturel. L’association Homme-Femme Île-de-France (qui lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes dans les milieux de l’art et de la culture) crée en 2015 les “Journées du matrimoine”. Cet événement entend valoriser l’héritage invisibilisé des précédentes générations de femmes. Il se déroule désormais tous les ans le week-end de la troisième semaine de septembre en écho aux “Journées européennes du patrimoine”.
Une visite atypique proposée par la Cie “La Mort est dans la Boîte”


Extraits du spectacle Celles d'en dessous: Sophie Renou interprète Elisa Bordillon (à gauche) Emmanuelle Briffaud joue Pauline Isabelle Lefèvre-Utile (à droite) © Guillaume Gatteau
Les spectateur.rice.s quittent Madame Lefèvre-Utile pour faire la rencontre de l’excentrique Topette, jouée par Camille Kerdellant. Topette est issue de la grande bourgeoisie nantaise. Chanteuse de rue dans les années 1920, elle formait avec sa sœur le duo “Topette et Carafon”. Titubante, elle accueille les spectateur.rice.s une flasque à la main. Son discours est confus. Elle interpelle les visiteur.euse.s, les provoque, les amuse avant de leur livrer un terrible secret. Fantôme extravagant, elle disparaît subitement en chantonnant entre deux gorgées d’alcool.
La visite se poursuit dans un nouvel espace du cimetière. C’est alors à Yvonne Pouzin-Malègue (1884-1947), jouée par Hélène Vienne qu’est rendu hommage. Elle explique aux visiteur.euse.s comment elle a dédié sa vie à la médecine. Elle soutient sa thèse en 1916 et trois ans plus tard elle devient la première femme médecin des Hôpitaux de France. Elle se consacre alors pleinement au traitement de la tuberculose.


Extraits du spectacle Celles d'en dessous : Camille Kerdellant joue Topette (à gauche) et Hélène Vienne incarne Yvonne Pouzin-Malègue (à droite) © Guillaume Gatteau
La déambulation spectacle se finit sur la tombe de Colette Robertin (1946-2012). La comédienne Manon Payelleville retrace aux visiteur.euse.s la vie et les combats de cette éducatrice et militante de gauche décédée il y a quelques années.
Celles d’en dessous est un spectacle original qui rend hommage aux femmes inhumées au cimetière Miséricorde. Il propose aux spectateur.rice.s de se plonger dans la vie de cinq femmes aux parcours différents qui ont laissé leurs traces chacune à sa façon. Chaque micro-récit s’ancre à un moment clé de leur vie tout en renvoyant à des événements post-mortem. Par exemple, le personnage de Pauline Isabelle Lefèvre-Utile évoque l’évolution de l’entreprise LU après sa mort tandis que le personnage de Yvonne Pouzin-Malègue fait allusion aux progrès de la médecine dans le traitement de la tuberculose. Ces anecdotes ramènent ponctuellement les spectateur.rice.s dans leur époque et assurent le lien entre “celles d’en dessous” et “celleux d’au-dessus”.

Extrait du spectacle Celles d'en dessous, Manon Payelleville incarne Colette Robertin © Guillaume Gatteau
La petite histoire du projet Celles d'en dessous
Le projet Celles d'en dessous naît en 2019 de la rencontre entre Nathalie Bidan et la compagnie « La mort est dans la boîte ». Laure Fonvieille, directrice artistique de la compagnie et metteuse en scène de Celles d’en dessous explique : « Nathalie Bidan est chargée de la valorisation du patrimoine funéraire rennais. Intriguée par le nom de notre compagnie de théâtre, elle a imaginé que nous ne serions pas effrayées à l’idée de faire du théâtre dans un cimetière. Elle avait vu juste ! » [propos recueillis par Elise Franck] C'est ainsi que Laure Fonvieille a imaginé le projet Celles d'en dessous qui entend valoriser les femmes du passé mais aussi donner à voir les cimetières comme des lieux de mort, de vie, de promenades, de mémoire et d’histoire. La première représentation a eu lieu en juin 2019 au Cimetière de l’Est, à Rennes.
Depuis, d'autres spectacles ont été programmés dans les cimetières de Nantes, Rennes et Strasbourg. Si les spectacles sont sur mesure, la démarche est toujours la même. La compagnie effectue une visite du cimetière qu'elle compte investir. Elle repère une dizaine de sépultures. A partir de ce repérage, un choix est arrêté en fonction du contenu qui peut être délivré sur les personnes inhumées et du parcours qui peut être créé entre les tombes.
Afin d’écrire la pièce, la metteuse en scène entame une première phase de documentation grâce à la bibliographie et aux archives existantes sur les protagonistes. Pour le spectacle au cimetière Miséricorde de Nantes, Agathe Cerede, stagiaire au patrimoine funéraire de la ville de Nantes a accompagné dans la compagnie dans ses recherches . Laure Fonvieille a interviewé les associations et les familles des défuntes pour nourrir la pièce. Les textes des pièces sont écrits par Laure Fonvieille mais aussi Manon Payelleville, Sophie Renou et Camille Kerdellant.
Valoriser le matrimoine en ligne.
D'autres initiatives, notamment sur internet émergent pour entretenir la mémoire de ces femmes dont on parle peu ou plus. Le collectif Georgette Sand a par exemple mis en place le Tumblr “Invisibilisées”. Ce Tumblr s’apparente à une base de données valorisant les femmes évincées des manuels d’Histoire ou de sciences. Camille Paix, quant à elle, alimente régulièrement son compte Instagram “Mère Lachaise” avec des portraits et de courts textes. Elle souhaite faire perdurer par ses dessins la mémoire des femmes enterrées au cimetière du Père Lachaise. Son travail est complété d’un plan du cimetière pour retrouver les sépultures des femmes qu’elle illustre.
Extrait du compte Instagram “Mère Lachaise” © Camille Paix
Il se cache dans nos cimetières un matrimoine souvent méconnu. Les artistes d’aujourd’hui s’inspirent de la vie de ces femmes dont on peine parfois à déchiffrer le nom sur les sépultures. Marie Morel, artiste peintre, a par exemple réalisé quatre-cents portraits de femmes ayant joué un rôle dans les domaines scientifiques, politiques, artistiques ou investies dans les luttes sociétales majeures de l’Histoire. Les vies de “celles d’en dessous” continuent donc de nourrir la création contemporaine dans les champs du spectacle vivant, du dessin ou de la peinture. La pièce Celles d’en dessous se jouera de nouveau le 20 mars 2022 au cimetière Miséricorde à Nantes et le 18 septembre au nouveau cimetière de Strasbourg. Serez-vous au rendez-vous pour écouter ce que “celles d’en dessous” ont à vous raconter ?
Image vignette : Cimetière Miséricorde à Nantes © EF
Pour aller plus loin :
-
Celles d’en dessous est un spectacle produit par la compagnie “La Mort est dans la boîte “ : https://cielmdb.com/2018/06/02/celles-den-dessous/ (Mise en scène, costumes et écriture : Laure Fonvieille / Comédiennes : Sophie Renou, Emmanuelle Briffaud, Camille Kerdellant, Hélène Vienne, Manon Payelleville)
-
Compte Instagram Mère Lachaise : https://www.instagram.com/merelachaise/?hl=fr
-
Site internet “Le Matrimoine”: https://www.lematrimoine.fr/
-
Tumblr Les Invisibilisées : https://invisibilisees.tumblr.com/
-
Lien vers le projet artistique de Marie Morel “Les femmes des siècles passés” : http://mariemorel.net/les-femmes-des-siecles-passes/60mapvxu06mj2x6mko9jnvhal9re79
#matrimoine #cimetières #lamortestdanslaboite

Recommencer ce monde - Grande Ville : Chercher sa place dans un environnement en mutation
Cet article propose de croiser deux expériences, celle de la performance Recommencer ce mondeau Théâtre du Fil de l’eau et celle de l’exposition Grande Ville aux Magasins Généraux : deux propositions culturelles qui insèrent au cœur du tissu urbain parisien les questions écologiques et sociales.
© Denis Darzacq
Deux manifestations, une implantation géographique
Des dispositifs artistiques multiples questionnant les représentations de nos environnements vécus, urbains et naturels, et nos rapports à eux.
Recommencer ce monde (Les créatures fabuleuses)
Des muséographies propices au désir de renouveler le regard porté à ce(ux) qui nous entoure(nt).
Grande ville
Curatée par Anna Labouze et Keimis Henni (fondateurices d’Artagon), Grande ville regroupe, jusqu’au 17 novembre, 23 artistes et un collectif sur le plateau d’exposition des magasins généraux. Sans distinction de parties ou de parcours, le projet est une invitation à explorer des nouveaux horizons et à penser des modes de vie urbains renouvelés.
Alors que le titre, Grande ville, pourrait s’emplir d’images grises et de béton, de violence ou d’impasses, chaque artiste exprime intimement son rapport vécu à l’environnement urbain. La douceur et la vitalité qui émanent de cette exposition sont immédiatement visibles à travers la profusion de couleurs, les installations textiles et les propositions joyeuses d’investissements des espaces citadins : projet de faux déboulonnement de la statue de Gallieni, orchestré par l’artiste Ivan Argote, l’activiste Françoise Vergès et le journaliste Pablo Pillaud-Vivien, ou encore série photographique de Randa Maroufi qui met en scène des groupes de femmes dans des espaces généralement investis par des hommes.

CHOUROUK HRIECH - LA VOCE DELLE LUNA #1 © Chourouk_Hriech - Courtesy Galerie Anne-Sarah Bénichou
Volontairement non cloisonné, l’espace permet à chaque visiteureuse d’associer librement les oeuvres, en explorant ses propres chemins de désirs. Cette notion, utilisée notamment en géographie et en urbanisme, désigne des axes de circulations qui apparaissent spontanément à la suite d’un emprunt régulier par les humains mais aussi les animaux et contournant les passages existants ; les tracés habituels. Ici, cela permet la création d’une visite personnelle et unique, propice à inciter chacune à prendre le temps, à s’approprier l’espace ; le vivre.

© Marc Domage
Susciter l’espoir, initier le changement.

JEAN CLARACQ - Grindrs Hookup - 2017 © Jean Claracq - courtesy Galerie Sultana - Paris
Sasha Pascual
Liens utiles :
Crédit photos :
- Recommencer ce monde : © Denis Darzacq avec l’aimable autorisation du festival d’automne
- Grande ville :© Chourouk_Hriech - Courtesy Galerie Anne-Sarah Bénichou, © Marc Domage, © Jean Claracq - courtesy Galerie Sultana - Paris, avec l’aimable autorisation des magasins généraux
#artcontemporain #écologie #natureculture

Rencontrez les Divas à l'Institut du Monde Arabe - point de vue d'Elise
L’exposition Divas a fait de l'œil à Elise et Marco qui l’ont vu de concert sans le savoir. L’occasion était trop belle pour ne pas comparer leur point de vue. Écrits entre quatres yeux, ces deux articles montrent que malgré deux visites différentes, leurs impressions sont au diapason. Au regard de nos compte-rendus, vous pouvez aller voir cette exposition les yeux fermés … et les oreilles grandes ouvertes !
Image d'en-tête : Tenues de scène, exposition “Divas, de d’Oum Kalthoum à Dalida” à l’Institut du Monde Arabe © EF
Le week-end du 22 et 23 mai 2021, les Français.e.s pouvaient courir les bars ou visiter des expositions fraîchement réouvertes. Moi, j'étais au musée. En plus, il pleuvait à Paris : la perspective de finir trempée devant une bière ne m'enchantait guère. Les belles expositions ne manquaient pas et on peut dire que j'avais l'embarras du choix. Je me suis donc décidée pour l'exposition “Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida”. Le samedi, munie de mon billet, je me dirige vers l'Institut du Monde Arabe. Non sans jouer des coudes, je découvre cette exposition sonore et colorée qui dresse les portraits de grandes chanteuses et actrices. L’exposition se déploie sur 1000 m² répartis sur deux étages. Elle suit un parcours chronologique de 1920 à nos jours, avec en toile de fond le contexte historique et politique de l’époque. “ Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida” est une exposition signée Hanna Boghanim et Elodie Bouffard à découvrir jusqu'au 26 septembre 2021.
Une rencontre avec les divas
L’exposition plonge le.la visteur.euse dans l’intimité de ces icônes comme pourrait le faire la presse “people”, relatant leurs amours, divorces et remariage. Il est également question d'exil et de retour en terre natale. Les modules ou salles dédiées aux divas expliquent les moments clés de la carrière de chacune. Le module mettant à l’honneur Dalida permet par exemple de découvrir un pan de sa carrière en Égypte moins connu par le grand public français. L’exposition documente aussi la vie de ces artistes arabes grâce à des interviews inédites, des extraits de presse, des disques, des costumes et parures de scène mais aussi des objets plus personnels leur ayant appartenu. Par exemple, au niveau 2, une vitrine consacrée à Warda expose ses vêtements, son oud, sa valise, ses passeports, son poudrier, son parfum, son livre de chevet ou encore son pilulier. Ces objets personnels sont attendus par les admirateur.rice.s de l’artiste. Par cette mise en vitrine, un statut presque reliquaire est conféré à ces objets du quotidien, créant une rencontre entre le.la visiteur.euse et cette artiste emblématique.

Vitrine dédiée aux objets personnel de Warda, exposition “Divas, de d’Oum Kalthoum à Dalida” à l’Institut du Monde Arabe © EF
Une exposition musicale
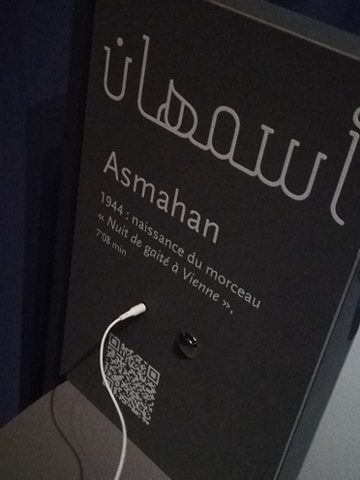
Borne d’écoute, exposition “Divas, de d’Oum Kalthoum à Dalida” à l’Institut du Monde Arabe © EF
Une exposition mettant en lumière des féministes et militantes
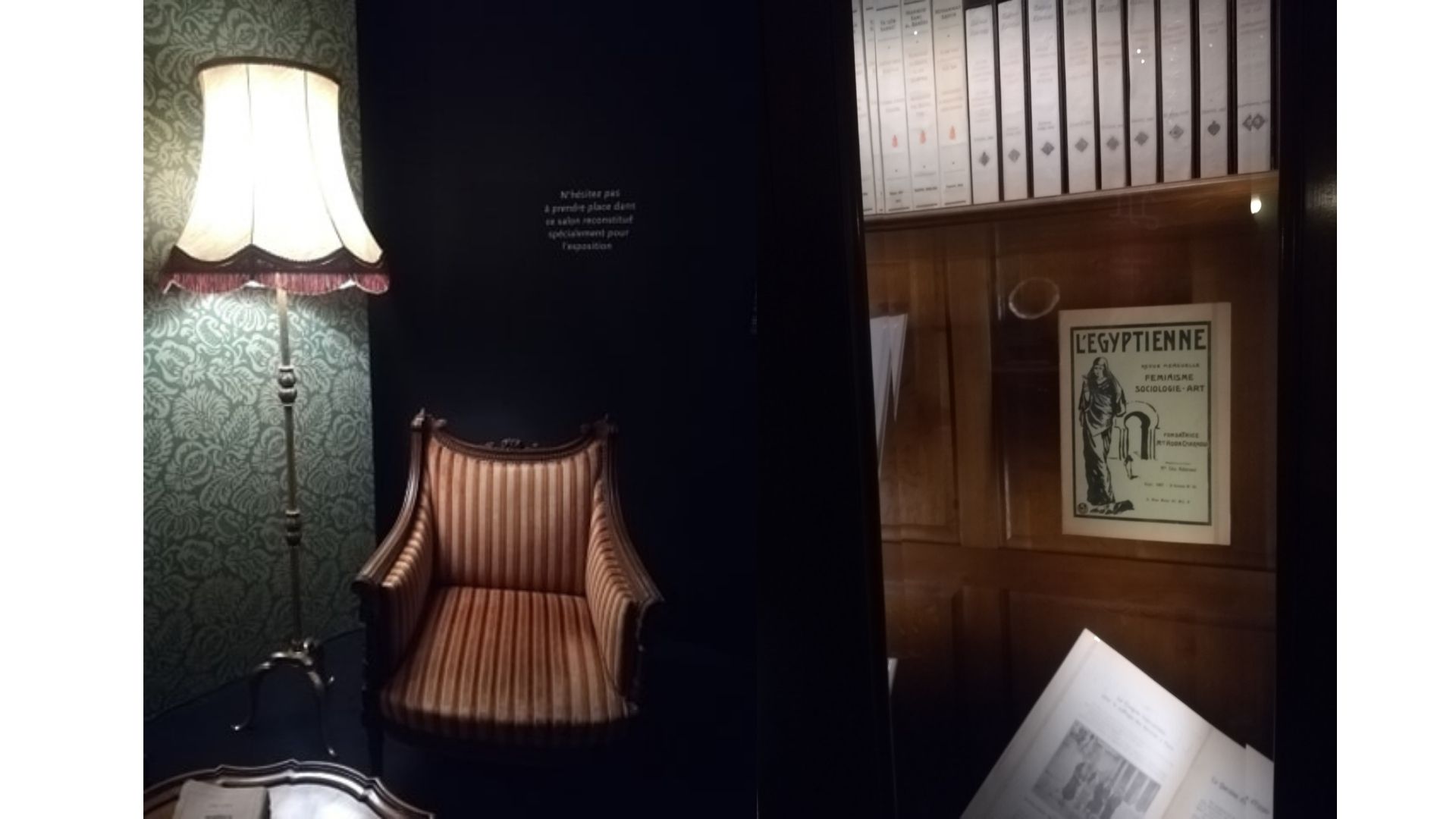
Reconstitution d’une bibliothèque fémniste et d’un salon, exposition “Divas, de d’Oum Kalthoum à Dalida” à l’Institut du Monde Arabe © EF
Fin de visite au pas de course

Collage de Nabil Boutros à partir de photogramme du film “Ma femme est PDG” de Fatîn abdel-Wahab, exposition “Divas, de d’Oum Kalthoum à Dalida” à l’Institut du Monde Arabe © EF

Vitrine inspirée du roman graphique “ô nuit, ô mes yeux” de Lamia Ziadé, exposition “Divas, de d’Oum Kalthoum à Dalida” à l’Institut du Monde Arabe © EF
Il existe d'autres façons de prolonger sa visite. L'Institut du Monde Arabe propose une websérie sur youtube autour des grandes thématiques de l’exposition et une playlist inspirée des divas disponible sur Deezer.
Elise Franck
Le point de vue de Marco est à lire ICI !
Pour aller plus loin
- Playlist Deezer inspirée de l’exposition :https://www.deezer.com/fr/profile/3478685424.
- Web Série : https://www.youtube.com/watch?v=SclFMPjkZ40&list=PLiykn3soZGDkcq6WMh5O3nPCZI3BNjPYb
#divasarabes #IMA #expositionparis

Rencontrez les Divas à l'Institut du Monde Arabe - point de vue de Marco
L’exposition Divas a fait de l'œil à Elise et Marco qui l’ont vu de concert sans le savoir. L’occasion était trop belle pour ne pas comparer leur point de vue. Écrits entre quatres yeux, ces deux articles montrent que malgré deux visites différentes, leurs impressions sont au diapason. Au regard de nos compte-rendus, vous pouvez aller voir cette exposition les yeux fermés … et les oreilles grandes ouvertes !
Image de vignette : Shirin Neshat, Ask My Heart, Looking for Oum Kulthum, 2018 @Marco Zanni
Image d’en-tête : Entrée de l’exposition sous le regard des divas @Marco Zanni
“Diva” : ce mot vous évoque-t-il une grande cantatrice à la vie tumultueuse et indépendante ? Maria Callas, la Castafiore ou Mariah Carey ? C’est pour découvrir un autre type de divas que j’ai bravé la foule du premier week-end de réouverture des musées à l’Institut du Monde Arabe (IMA). L’exposition Divas, de Oum Kalthoum à Dalida présente ces icônes de la musique et du cinéma du monde arabe, en grande partie méconnue du public occidental. Retour sur une (re)découverte musicale et visuelle.
Une rencontre avec les divas
L’exposition plonge le.la visteur.euse dans l’intimité de ces icônes comme pourrait le faire la presse “people”, relatant leurs amours, divorces et remariage. Il est également question d'exil et de retour en terre natale. Les modules ou salles dédiées aux divas expliquent les moments clés de la carrière de chacune. Le module mettant à l’honneur Dalida permet par exemple de découvrir un pan de sa carrière en Égypte moins connu par le grand public français. L’exposition documente aussi la vie de ces artistes arabes grâce à des interviews inédites, des extraits de presse, des disques, des costumes et parures de scène mais aussi des objets plus personnels leur ayant appartenu. Par exemple, au niveau 2, une vitrine consacrée à Warda expose ses vêtements, son oud, sa valise, ses passeports, son poudrier, son parfum, son livre de chevet ou encore son pilulier. Ces objets personnels sont attendus par les admirateur.rice.s de l’artiste. Par cette mise en vitrine, un statut presque reliquaire est conféré à ces objets du quotidien, créant une rencontre entre le.la visiteur.euse et cette artiste emblématiqVitrine dédiée aux objets personnel de Warda, exposition “Divas, de d’Oum Kalthoum à Dalida” à l’Institut du Monde Arabe © EF
Le parcours : “un voyage en quatre actes”
Le parcours est divisé en quatre sections, déployées sur deux niveaux. Les trois premières parties sont chronologiques.
1920 : l’époque des pionnières. Au rez-de-chaussée, le public est accueilli par une introduction sur le Caire au début du XXème siècle. Dans cette capitale cosmopolite, la musique se popularise avec l’apparition des salles de concerts et des disques 78 tours. Les premières chanteuses participent à la naissance d’une industrie musicale et du cinéma. Elles s’appellent Mounira al-Mahdiyya, Badia Massabni, Bahiga Hafez, Assia Dagher. La transformation est aussi sociale, les développements du féminisme dans la bourgeoisie cairote accompagnent la présence nouvelle des femmes seules sur scène.
1930-1970 : l’âge des grandes voix. Cette deuxième section, introduite par un panneau au rez-de-chaussée, débute à l’étage. Dans les années 1930, l’essor du cinéma parlant et de la radio contribue à la starification des interprètes. Elles sont quatre “voix d’or” ‒ Oum Kalthoum, Warda, Asmhahan et Fayrouz ‒ adulées dans le monde arabe pour leur performances scéniques et leur vie.
1940-1970 : le temps des stars de Nilwood. Dans l’après-guerre, le cinéma égyptien domine avec ses comédies musicales ou ses mélodrames. Les intrigues simples laissent toute la place aux nouvelles égéries du grand écran : danseuses (Samia Gamal), chanteuses (Laila Mourab, Sabah) ou actrices (Faten Hamama, Souad Hosni). Le couloir les présentant une à une s’achève sur Dalida, qui débute sa carrière en Egypte en 1954. Cet âge d’or de l’industrie culturelle égyptienne s’éteint dans les années 1970, marquées par plusieurs crises diplomatiques, économiques et politiques.

Les différentes ambiances des trois sections chronologiques @Marco Zanni
La dernière section évoque l’héritage de ces divas des années 1930 à 1970. Ces femmes ont créé un patrimoine culturel populaire et ont traversé de grands changements sociaux ou politiques. La section contemporaine vient justement questionner leur place et leur héritage au regard du monde arabe contemporain. La réutilisation de ces figures indépendantes en fait des personnalités d’actualité, symbole d'émancipation ou d’une recherche identitaire. Elles peuvent devenir au contraire l’exemple critique de l’instrumentalisation du corps des femmes dans les industries du divertissement.

Nabil Boutros, Futur Antérieur : Par ses photomontages utilisants des extraits de films égyptiens des années 1960, l’artiste interroge les promesses sociales d’une époqueavec un regard critique et nostalgique @Marco Zanni
Ce parcours chronologique, principalement sur l’Egypte et le Levant, est classique mais clair. Les sections s’enchaînent avec la même structure, malgré quelques dissonances : introduction, présentation individuelle des divas, un focus culturel ou social. L’affluence m’a fait remarquer les espaces contraints et sinueux. L’abondance du multimédia et des textes, marqués par la succession des divas, donne une certaine redondance et longueur à la visite. Heureusement, l’exposition reste dynamique par sa muséographie centrée sur la notion de “spectacle”.
De la salle de spectacle...
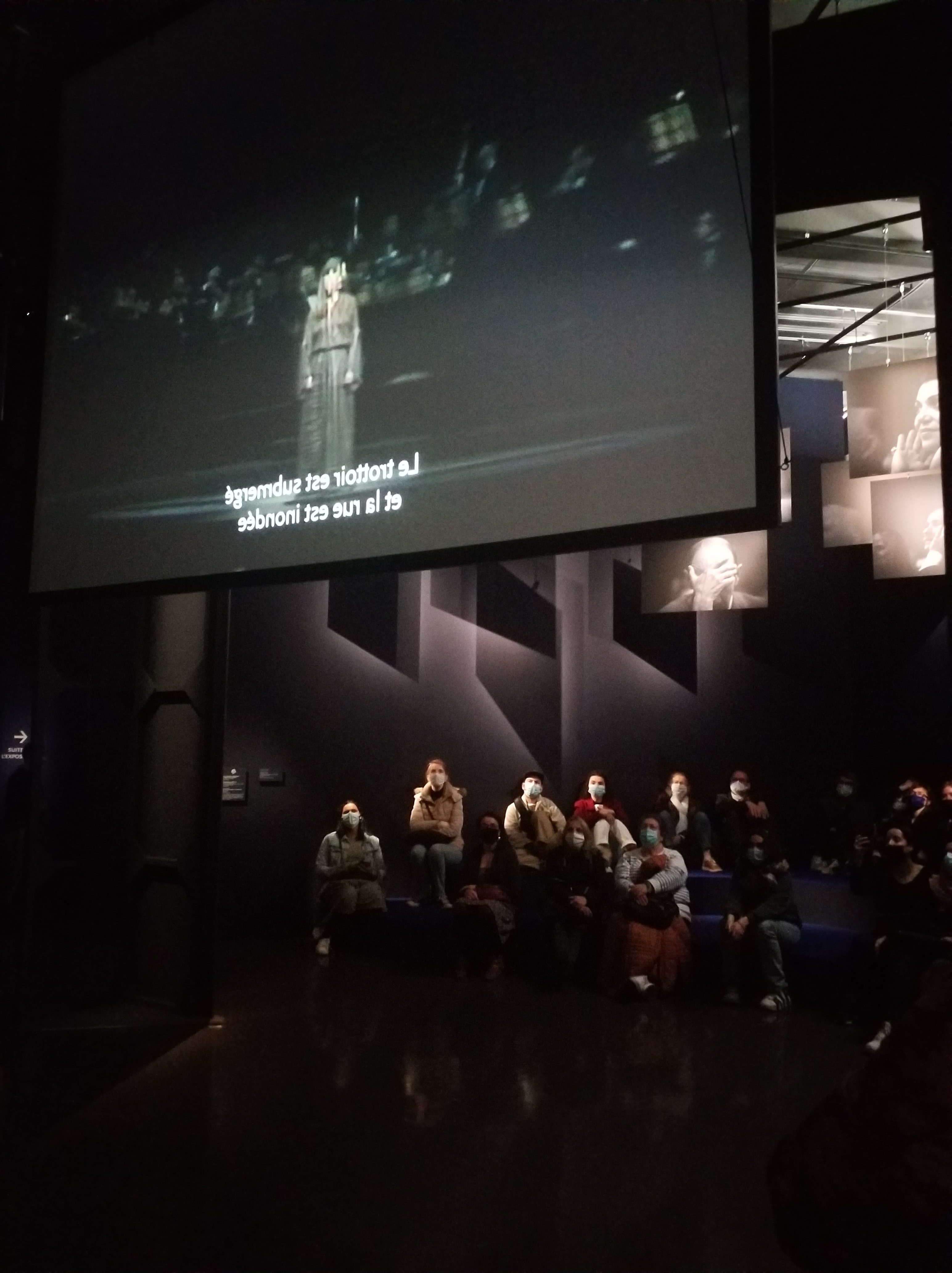
Photo de la salle, avec Fayrouz sur scène @Marco Zanni

Randa Mirsa & Waël Kodeih, Dernière Danse, 2020 @Marco Zanni
La diversité des dispositifs multimédias ou immersifs va de pair avec leur nombre. A noter que la multitude de sollicitations visuelles peut gêner les personnes sensibles aux bruits, aux stimulations visuelles ou aux espaces confinés
… aux vedettes.
Le spectaculaire de l’exposition est également assuré par l’omniprésence de la figure de la vedette, de la diva, de la star.
Les différentes tenues de scène sont ainsi centrales dans l’exposition, en ce qu’elles incarnent la silhouette de la diva autrement que par l’image ou le son. La retenue reste de mise sur le strass et les paillettes : l’ambiance est plutôt celle d’une visite privilégiée en coulisses qu’une débauche de luxe et de sequins. Les robes de scène sont accompagnées de bijoux, coiffes, effets personnels … représentant l’apparence publique et flamboyante des interprètes.

Tenues de Dalida. Le musée a consacré un mini-reportage à leur arrivée dans l’exposition @Marco Zanni
L’emphase est particulièrement mise sur les visages des divas. Elles apparaissent dès l’entrée de l’exposition, projetées sur un grand rideau de fils. Sur chaque panneau leur étant dédié, ces visages apparaissent comme sur des affiches de cinéma. L’en-tête des panneaux, en relief, peut également rappeler les affiches de cinéma. La chanteuse libanaise Fairouz n’est elle pas exposée via ses tenues mais par des affiches placardées sur toute la hauteur du mur.
Des supports plus originaux contribuent à la théâtralisation de la vie des chanteuses et actrices. Celle de la chanteuse syrienne Asmahan est illustrée par une vitrine scénarisée, alternant extraits de films sur plusieurs écrans et des dialogues fictifs diffusés en regard d’objets éclairés.

Vitrine sur la chanteuse Asmahan, chanteuse syrienne divorcée, libre, espionne qui illustre parfaitement l’idée de diva au destin exceptionnel @Marco Zanni
/p>
Une exposition qui se poursuit...
Je ressors de l’IMA avec l’impression d’avoir assisté à une représentation d’anthologie. J’ai surpris plusieurs personnes chantonner leur chanson favorite ou s’émouvoir à la vue d’une vidéo de concert. Difficile de sortir de l’exposition sans avoir des chansons plein la tête, et l’envie d’en découvrir plus. L’IMA a justement mis en place plusieurs dispositifs autour de l’exposition, parfois anecdotiques (un ensemble de filtres Instragram) ou plus documentaires. Une série de mini-vidéos permet d’en découvrir plus sur certaines figures, et une programmation culturelle viendra mettre l’accent sur la place des femmes dans les sociétés arabes. Une playlist donne enfin l’occasion de se replonger dans l’exposition et de continuer de se familiariser avec les grandes voix des divas.
Marco Zanni
Le point de vue d'Elise est à lire ICI !
#divasarabes #IMA #expositionparis

Tendez l’oreille...
A l’heure où nos oreilles n’ont, pour seul refuge, que le sommeil pour lutter contre les agressions sonores de notre quotidien, Baudouin Oosterlynck, plasticien belge, nous invita, lors d’une exposition monographique, à « écouter la forme de l’air ».

© M. Tresvaux du Fraval
A l’heure où nos oreilles n’ont, pour seul refuge, que le sommeil pour lutter contre les agressions sonores de notre quotidien, Baudouin Oosterlynck, plasticien belge, nous invita, lors d’une exposition monographique, à « écouter la forme de l’air » (1). L’artiste s’installa, durant près de trois mois, dans un site reculé, loin de toute pollution : le Musée d’arts contemporains (MAC’s) du site du Grand Hornu, dans le Hainaut (Belgique).
Dans l’œuvre d’Oosterlynck se rencontrent l’histoire de l’art et la gymnastique, deux de ses passions : les visiteurs, en entrant dans l’unique salle d’exposition, s’apprêtaient à effectuer une acrobatie auditive.Cependant, rassurez-vous, pas de courbatures au sortir de cette exposition, uniquement une délicate impression d’avoir redécouvert l’un de nos sens.
Disposées de manière ordonnée sur des tables et mises à disposition de chacun (petit ou grand), des « prothèses acoustiques » composées de stéthoscopes, d’aquaphones et d’instruments de chimie en verre, intriguaient et interrogeaient les visiteurs. Les murs blancs de la pièce d’exposition pouvaient rappeler l’atmosphère froide et aseptisée de certaines salles d’hôpital où nous retrouvons, également, des instruments aux formes similaires. Malgré l’invitation appuyée du personnel du musée à venir les manipuler, les futurs auditeurs hésitaient devant la beauté fragile de ces objets… Quelques secondes plus tard, ni une, ni deux, ils se lançaient dans cette expérience sensorielle.
Si l’ouïe est requise, la vue et le toucher sont aussi importants pour l’appréciation de ces œuvres tout à la fois ludiques, poétiques et drôles. L’exposition accorde une place importante à l’hygiène des visiteurs, en leur proposant de nettoyer, après chaque utilisation, les embouts des stéthoscopes grâce à des mouchoirs désinfectants disposés de manière discrète, dans une petite boîte blanche, au centre de chaque table.
Certaines œuvres, intouchables, étaient soit placées sous vitrines, soit suspendues au plafond par des fils transparents. Une quantité importante de dessins de l’artiste (des croquis préparatoires précédents chaque réalisation d’objet), difficilement compréhensibles – car il s’agit plus de dessins poétiques que techniques – étaient accrochés au mur à proximité les uns des autres.
L’interactivité entre les œuvres et les visiteurs justifie en grande partie le succès de cette exposition. Cependant, de nombreuses questions demeurent en suspens. Mais, qu’en est-il de la connaissance théorique du travail de l’artiste ? Pourquoi a-t-il réalisé ces instruments ? Quelles sont ses réflexions ? Où sont les cartels ?
Il est important de noter qu’aucune information n’était transmise aux visiteurs – hormis un livre, disposé sur une table à l’extérieur de l’exposition, dont à première vue, nous pouvions penser qu’il correspondait au livre d’or ; il s’agissait en réalité de la monographie de l’artiste.
Trois agents de surveillance vous permettaient d’entrer dans la salle (une file d’attente était prévue à l’unique entrée-sortie afin d’optimiser au mieux la visite). De plus, ceux-ci nous indiquaient comment manier les objets. Cependant, nous pouvions regretter l’absence de guides ou de médiateurs. En effet, malgré la grande écoute adonnée à chacun des visiteurs, le personnel interrompait brusquement ses explications afin d’interdire la manipulation de certaines œuvres, réservées uniquement à l’usage de l’artiste (point de cartels ni de panneaux explicatifs ne prévenaient les visiteurs).
Pour les explications, mieux valait être au MAC's lorsque l'artiste est venu en personne présenter ses œuvres. En effet, Baudouin Oosterlynck est intervenu à deux reprises au cours de l’exposition. Entre les objets, les visiteurs et l’artiste, une relation viscérale se mettait en place. L’artiste expliquait alors, à l’intérieur de la salle d’exposition ou dans la cour principale et verdoyante du Grand Hornu, ses instruments avec humour, passion et patience.
Une exposition déconcertante dont l’originalité ne tenait pas à l’événement en lui-même, mais bien aux œuvres de cet artiste malheureusement peu connu du grand public.
Marie Tresvaux du Fraval
Exposition Instruments d’écoute (du 20 novembre 2011 au 5 février 2012) au Musée des Arts Contemporains du Site du Grand-Hornu
(1) Baudouin Oosterlynck, cité dans le magazine lesoir.be, le 21 janvier 2012
UNE SOIRÉE ZUMBA
Jeudi 1er octobre 2015 – 20 h 00. Je suis assise dans un des magnifiques fauteuils en velours rouge de l’Opéra de Lille, en train d’écouter Madame la Directrice Caroline SONRIER exposer la programmation artistique de la saison 2015/2016. Les statues représentants les personnifications de la Danse, la Musique, la Tragédieet la Comédie me dominent depuis le plafond doré.
Attendez un moment avant de bâiller.
Le parterre et le premier balcon de l’opéra sont pleins, mais aucun des spectateurs n’a plus de 28 ans. Autour de moi, les langues des étudiants Erasmus se mélangent : anglais, espagnol, italien... Dans une demi-heure, nous aurons tous abandonné nos manteaux pour nous lancer dans une session de danse, avant de nous restaurer avec une petite bière assis sur le tapis rouge du grand escalier.
C’est ce qui se passe à la Soirée Découverte de l’Opéra de Lille : une invitation aux jeunes pour passer une soirée « dans la maison », avec l’espoir, bien entendu, qu’ils auront envie de revenir.
L’accueil chaleureux de Caroline SONRIER met l’accent sur le mot clé d’ouverture (à double sens : vers les artistes et vers le public), un aspect porté par l’architecture même du théâtre, qui dispose d’un foyer s’étendant sur l’intégralité de sa façade principale, vers l’extérieur. C’est la volonté qui guide le théâtre depuis sa rénovation, quand l’impulsion de Lille 2004 lui a rendu sa grandeur.

Photographie : L.Zambonelli
Ma présence à cette soirée démontre que cette politique de médiation culturelle est efficace. Je suis rentrée à l’opéra un peu par hasard lors des Journées du Patrimoine. Comme moi, beaucoup d’autres jeunes et d’étudiants sont entrés par curiosité, pressés de voir et découvrir un lieu un peu sacré comme celui-ci. L’équipe présente nous a alors parlé de la Soirée Découverte et nous a invités à y participer : la simple évocation d’un drink a fait le reste.
Au programme de cette soirée apparait un paragraphe sibyllin qui annonce que la chorégraphe et son équipe nous feront « partager » un moment de danse. Mais surprise ! Si la plupart de nous s’attendait simplement à profiter d'un morceau de ballet, une fois tous rassemblés dans le Foyer, nous n’assistons pas à une démonstration, mais nous participons. Alors qu’on est en train d’essayer d’apprendre quelques pas tirés de Xerse, (premier Opéra qui ouvre la saison 2015), je ne peux pas m’empêcher de faire une similitude très irrespectueuse et de nous imaginer élèves de Zumba dans une gym d’exception.
Mais enfin, n’était-ce pas l’objectif de la soirée : nous mettre à l’aise dans les espaces monumentaux de l’Opéra ?
Photographie : L.Zambonelli
Les initiatives d’appropriation des établissements culturels de la part d’un public (notamment jeune) se multiplient donc non seulement dans le monde muséal, où le flash mob et la nuit des musées font désormais partie des outils classiques de médiation, mais aussi ailleurs. Peut-être alors pourrait-on saisir cette dernière forme d’inclusion des visiteurs proposée par l’Opéra et imaginer une session de Danse dans le merveilleux hall du Palais des Beaux-arts de Lille, en lien bien sûr avec une programmation ? Joie de Vivre, Joie de danser !
Une petite anecdote en guise de conclusion : il y a trois ans, pendant la première version de la Soirée Découverte, une jeune fille de 23 ans, séduite par la politique novatrice de cet établissement culturel, s’entretient longuement avec les artistes et l’équipe de l’Opéra. Elle s’appelle Marion GAUTIER. Elle est aujourd’hui Présidente de l’Opéra de Lille, ou de « la fabrique à émotions » comme elle l’aime à l’appeler.
Si ce n’est pas le conte de Cendrillon de la médiation culturelle !
Lara ZAMBONELLI.
#MEDIATION
#OPERA
#LILLE

Urbex et culture avec la Clermontoise de Projection Underground
Depuis 2014 je participe tous les ans à l'Underfest, un festival culturel qui proposed'assister à des concerts et des projections de courts métrages dans des lieuxinhabituels.
Underfest 2014, The Delano Orchestra © Clermontoise de Projection Underground
Tous les Clermontois le savent, la butte de la vieille ville est trouée de caves, formant un formidable labyrinthe souterrain. Grâce à la Clermontoise de Projection Underground, ces caves accueillent musique et cinéma le temps d'une soirée au début de l'été.
Pour participer, il faut s'inscrire via la page Facebook de l'organisation. Le jour même de l'évènement, on reçoit une heure et un point de rendez-vous, ainsi qu'une liste d'équipements nécessaires, gants, vêtements chauds et résistants, lampe frontale, … Quelques heures plus tard, les participants se regroupent àl'heure et au lieu dit, nous sommes une quinzaine, parfois près de trente mais pas plus, il faut rester discret …
Édition 2014, Julien Estival © Clermontoise de Projection Underground
La soirée débute par un concert, joué par un groupe ou un artiste clermontois, j'ai eu la chance d'assister aux performances de Morgane Imbeaud et Guillaume Bongiraud, The Delano Orchestra, Julien Estival ou encore The Arberdeeners cette année. Petite cave exiguë ou immense espace vide, éclairé à la bougie, l'effet est saisissant, l'ambiance intimiste.
En 2015, les concerts étaient remplacés par une rencontre avec un.e chef clermontois.e et une dégustation. Les chefs ont cuisiné devant nous, tout en présentant leurs produits et parfois partageant leurs recettes. Chips violettes, panacotta à l'agar-agar, tourte aux orties, des mets originaux mais surtout délicieux. Le nombre d'assiettes étant restreint, tout le monde partage et discute avec son voisin.
Édition 2015. Tourte aux orties, fleur de mauve et tomates anciennes.
Après le concert / la dégustation, petite pause exploration, tout seul ou en petit groupe, tout le monde s'éparpille lampe de poche au poing. Certaines caves semblent ne jamais se finir, les salles voutées et les escaliers se succèdent, s'enfonçant toujours plus sous la terre. La première année, alors que nous étions réunis dans un cave près de la place de la Victoire, accompagnés de l'organisateur de l'évènement, nous nous sommes aventurés plus loin. Nous avons tous rampé dans une petite ouverture à travers une porte à moitié défoncée communicant avec la cave d'à côté. Encore quelques mètres plus bas et nous étions sous la place de la Victoire. Surprise, on peut y voir les restes d'un aqueduc, datant probablement de l'antiquité tardive ou du haut Moyen Âge.
Chaque soir, la projection propose plusieurs courts métrages autour d'un thème choisi. Lors de ma première participation au festival, tous les courts métrages traitaient de l'Urbex. Ce fut une sacrée découverte pour moi et depuis cette soirée je regarde la ville différemment, rêvant moi aussi de m'introduire dans les réserves d'un grand musée parisien ou d'explorer une friche industrielle. Cet été, j'ai pu voir La Jetée, réalisé par Chris Marker en 1962. S'agit-il d'un clin d’œil du centre de documentation du même nom dédié au festival du court métrage de Clermont-Ferrand ?
Édition 2016, The Aberdeeners. On aperçoit les photographies derrière le groupe. ©Clermontoise de Projection Underground
Les caves ne sont pas l'unique terrain de jeu de la Clermontoise de Projection Underground. Le festival s'est introduit plusieurs fois dans un bâtiment en travaux sur une des rues les plus passantes de Clermont-Ferrand. Alors le soir, il ne faut pas trop s'approcher des vitres avec nos lampes, pour ne pas attirer l'attention. Dans ce bâtiment, un photographe a installé ses créations, des portraits noir et blanc, imprimés en grands formats. Quiconque s'introduit dans le bâtiment peut venir les contempler, aussi longtemps qu'il le souhaite et à n'importe quelle heure, ce musée n'a pas d'horaires...
L'illégalité du festival signifie que chacun engage sa propre responsabilité, pas d'assurance pour les blessés ! À chaque festivalier de faire attention là où il marche et à se conduire de façon responsable.
Quelques heures plus tard, les festivaliers émergent, les vêtements souvent salis par la poussière ou la boue, suffocant dans leurs vêtements trop chauds pour la saison mais comblés.
L'Underfestallie culture et exploration urbaine, festival gratuit, il se veut accessible à tous (enfin, ceux qui connaissent!), avec une forte dimension locale, promouvant des artistes de Clermont-Ferrand et faisant écho au festival ducourt métrage. Pour les participants, c'est l'occasion de découvrir des espaces auxquels ils n'ont pas accès en temps normal et d'assister à des évènements culturels dans des lieux insolites, dans une ambiance chaleureuse et détendue. L'enjeu est de s'approprier l'espace urbain et de jouer avec, de sortir la culture des musées ou des salles de concert.
Clémence L.
Facebook de la Clermontoise de Projection Underground
#urbex
#arts
#cinéma
#concert
#culturealternative