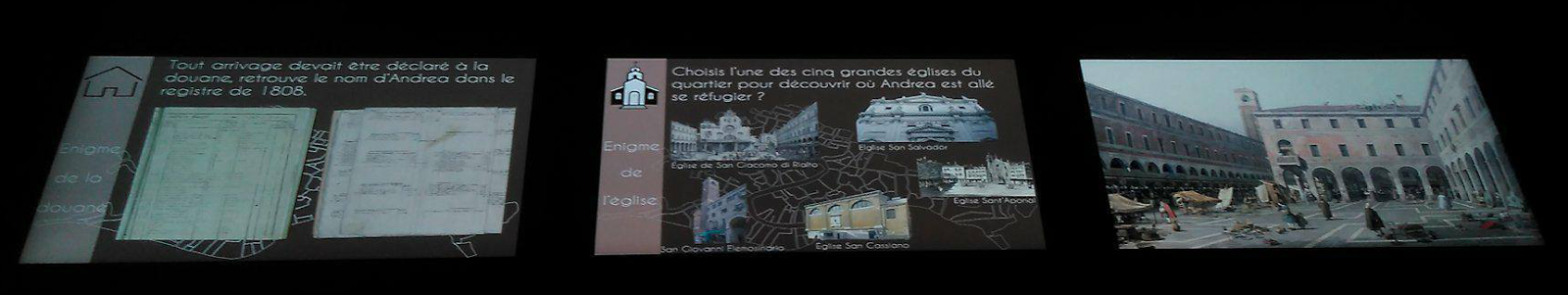Nouvelles technologies et musées
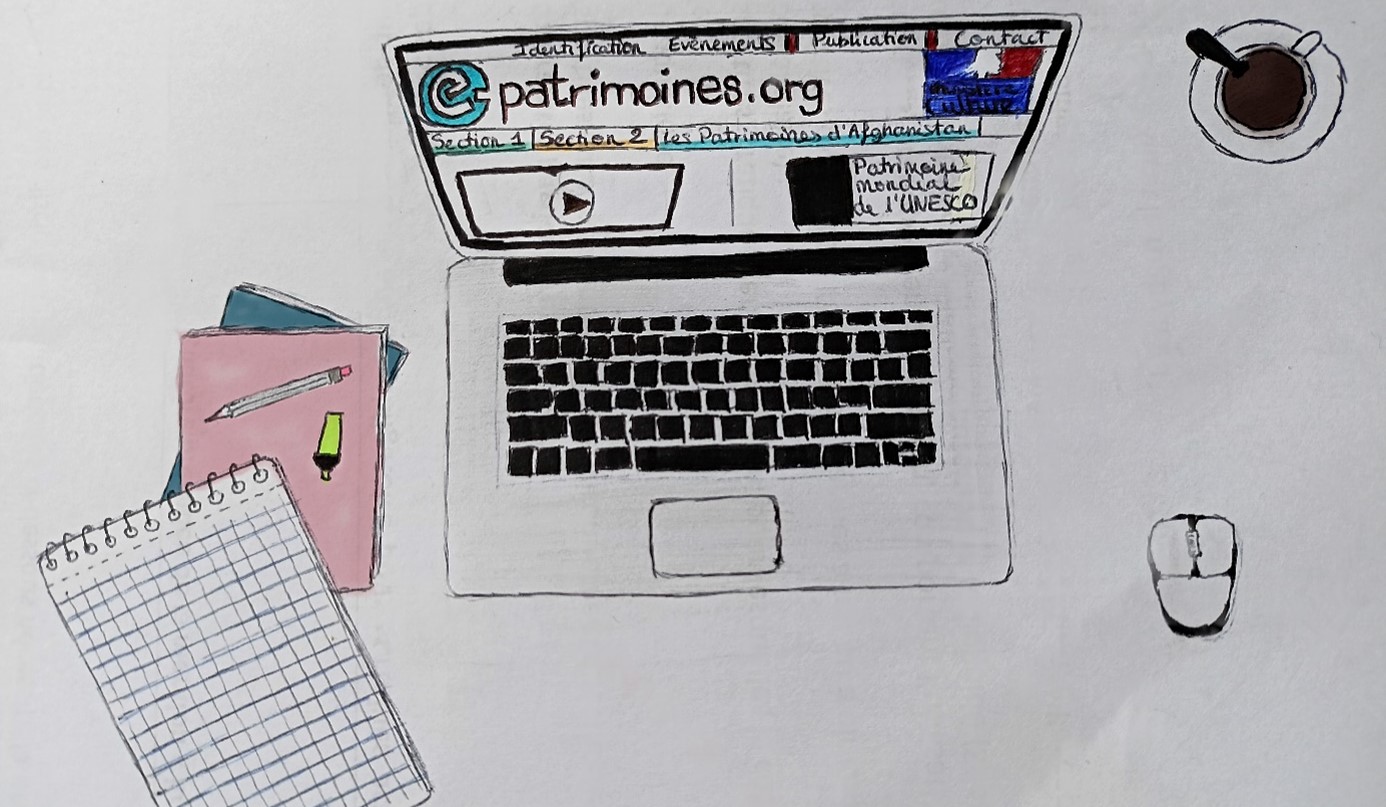
E-patrimoines.org : formations gratuites et continues dans le domaine du patrimoine matériel et immatériel
Vous souhaitez comprendre les patrimoines matériels et immatériels ? Apprendre de professionnels à votre rythme ? Ou tout simplement (re)découvrir le patrimoine francophone ? E-patrimoines.org propose des formations continues et gratuites sur le patrimoine.
E-patrimoines.org, qu’est-ce que c’est ?
E-patrimoines.org est une plateforme de formations continues et gratuites sur les patrimoines matériels et immatériels. Créée en 2011 par le Département des Affaires Européennes et Internationales (DAEI), direction générale des patrimoines du ministère de la Culture, en collaboration avec l’Agence Universitaire de la Francophonie AUF et l’Université Numérique Francophone Mondial UNFM, elle est destinée à un public francophone professionnel et universitaire dans le domaine du patrimoine. Depuis le 1er janvier 2021, le directeur général des patrimoines et de l’architecture succède au DAEI pour une nouvelle mission, le patrimoine mondial.

Liste de la Section 1 des modules disponibles sur la plateforme e-patrimoines.org. ©UNFM
Quels modules ?
17 modules sont disponibles sur la plateforme, il y en a pour tous les goûts : celui sur Les Grands Sites de France où l’on découvre ou redécouvre des sites français comme le Puy Mary dans le Cantal, saisir la diversité des corps de métier dans le module les Jardins un Patrimoine à Conserver ou encore la contribution de la France dans Le Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Un module dure entre 5 et 10 heures avec en moyenne 15 vidéos de plus ou moins 30 minutes. Par exemple, le module Trafic Illicite dure environ 6 heures pour 10 vidéos. Des événements et des colloques, dans le but de garder le lien avec les pays francophones, sont également retranscrits, le dernier en date est Conflits Armés et Patrimoine (2019).
J’ai posé quelques questions à
- Le dernier datant de 2019, prévoyez-vous de nouveaux séminaires ou colloques ?
« En octobre 2022, il y aura un séminaire à l'Ecole militaire sur l'architecture militaire » Caroline Kurhan, Responsable des patrimoines en Afrique, Département des affaires européennes et internationales, Direction générale des patrimoines, Ministère de la culture et de la communication
- Un nouveau module est-il en projet ?
« 3 modules sont en cours d’achèvement et seront lancés avant décembre 2021 :
- Les patrimoines de l’Afghanistan ;
- Le patrimoine mondial enregistré en 2016 mais complété en 2021 avec une partie sur l’élaboration d’une candidature à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial (Convention de 1972)
- Et un module sur le Gabon. »
Mon module préféré est le module 3 : Conservation Préventive. Des cours très complets allant de l’intérêt de cette discipline à la gestion des risques en s’appuyant sur des exemples concrets. Ce module va explorer en profondeur des questions très précises comme le choix de la lumière et les types d’éclairage ou le cas des climats tropicaux. Tous les intervenants, sauf un, travaillent au C2RMF (Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France) une branche du ministère de la Culture. Beaucoup de musées ont aujourd’hui leur propre centre de recherche et de conservation, des interventions de professionnels venant de ces centres seraient un bon moyen de compléter les points de vue et les méthodes de conservation préventive dans les musées.

Détails du module 3 : Conservation préventive. ©UNFM
Dans la vidéo 13 : 4-1. Lumière et éclairage muséographique – Jean-Jacques Ezrati, conservateur du patrimoine, département de conservation préventive (C2RMF), le début est consacré à la définition du mot musée qui découle sur une explication des mots scénographie, expographie et muséographie. La scénographie concerne la mise en espace, la mise en perspective, la traduction d’un discours dans les trois dimensions. L’expographie regroupe la scénographie dans le contexte de l’exposition, les règles de sécurité, l’ergonomie visuelle et sensorielle et la médiation. La muséographie dite « bis » correspond à l’expographie qui tient compte de la conservation (de ces témoins matériels).
Ce module date de 2013, or les définitions des mots scénographie, expographie et muséographie ont bien évolué depuis. Une exposition est toujours une affaire de fond (la muséographie) et une affaire de forme (la scénographie et le graphisme). L’expograhie est un terme de 1993 proposé par Desvallées pour compléter le mot muséographie. L’expographie serait “l’art d’exposer”, c’est la mise en exposition, c’est-à-dire la mise en espace et les techniques liées aux expositions (à l’exclusion des autres activités muséographiques comme la conservation, la sécurité, …)[1]. D’après l’Association des muséographes[2], dans un musée ou dans une exposition la part de la muséographie est celle qui a trait aux contenus, au scénario du parcours et aux modalités de la médiation entre un thème et des visiteurs. La scénographie concerne le traitement des espaces et des volumes, les matières, le design des mobiliers et supports physiques des collections, la mise en lumière, les décors. La question de l’actualité des informations des modules les plus anciens peut donc se poser.
Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur le site https://www.e-patrimoines.org/patrimoine/ en haut à droite dans « Identification » puis remplissez « Nouvel utilisateur ? ». Prévoyez un peu de temps, une partie motivation, expériences professionnelles et diplômes seront à développer. Après avoir complété les trois premières cases (Nom d’utilisateur, Courriel et Confirmation e-mail), vous devez cocher les modules qui vous intéressent. Rassurez-vous ce choix n’est pas définitif, vous aurez accès à tous les modules une fois votre dossier validé. S’ensuit une série de questions sur vos coordonnées, puis on vous demande où vous souhaitez suivre les cours, par exemple à domicile pour les cours en ligne, ou choisir les cours au campus de l’AUF. Le reste des questions est destiné à mieux vous connaître, votre parcours, vos motivations et vos projets.
Ça y est, votre dossier est retenu ! Félicitation, vous pouvez désormais dévorer les modules. Avant de commencer, il faut tout de même avoir une connexion Wi-Fi. Malheureusement, vos données mobiles ne vous donnent pas accès aux cours. Un peu dommage si l’on souhaite visionner les modules en extérieur ou si votre logement ne dispose pas d’une box internet.
Moodle ICOM
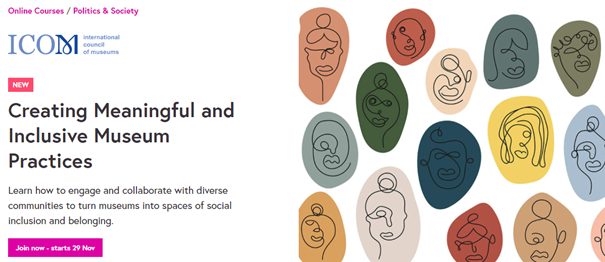
Moodle ICOM ©FutureLearn
Si cette méthode de formation vous intéresse, l’ICOM (International Council Of Museum) a créé son premier Moodle qui débutera le 29 novembre 2021 sur l’engagement et la collaboration avec diverses communautés pour transformer les musées en espaces d'inclusion sociale et d'appartenance. Ce cours est destiné aux professionnels des musées. Pour plus d’information rendez-vous sur https://www.futurelearn.com/courses/meaningful-inclusive-museum-practices
Pour en savoir plus :
- https://www.e-patrimoines.org/patrimoine/wp-content/uploads/Montage-juin-2018.pdf
- Pour toute question :
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Notes :
[1] Gob, A., & Drouguet, N. (2021). Introduction. Dans La muséologie : Histoire, développements, enjeux actuels (5e éd., p. 17). ARMAND COLIN. ↩
[2] Muséographie ? Notre approche. Muséographes (Les). Consulté le 13 novembre 2021, à l’adresse https://les-museographes.org↩
#formationgratuite #patrimoine #ministèredelaculture

Enfants-Parents, souriez, vos gènes sont étudiés !
La Cité des Sciences et de l'Industrie, dans le XIXè arrondissement de Paris, propose depuis mai 2002, une exposition sur : « L'Homme et les gènes ».Pour la concevoir, le musée a fait appel au généticien Axel Kahn, spécialiste en biochimie et chercheur à l'Institut National de la Santé Et de la Recherche Médical (INSERM). Son objectif dans cette exposition est de montrer les mécanismes de l'évolution et en particulier celui de l'homme.
A la découverte du corps humain
Cette exposition permanente est divisée en quatre parties. Dans un premier temps, le visiteur est invité à découvrir l'histoire de l'évolution et de la vie. Il sera alors prêt à plonger dans l'exploration des gènes humains pour comprendre leur rôle. Ensuite, il pourra étudier le génome, c'est-à-dire l'ensemble des chromosomes chez une personne. Pour terminer ce voyage génétique, le visiteur rentrera au cœur du débat actuel sur la recherche. Voulez-vous participer à un futur débat citoyen ? Alors, venez donner votre point de vue sur les tests génétiques !
Savez-vous lire les gènes ?
A la fin de la deuxième partie de l'exposition, le visiteur est convié à explorer et à décrypter le rôle des gènes grâce à un outil de médiation : « le photomaton de l'expression génétique et culturelle ». A la fois ludique et pédagogique, les petits comme les grands se prêtent volontiers au jeu.
Crédits : L.P
Il ne s'agit pas d'un simple photomaton classique. Celui-ci est contrôlé par un ordinateur tandis qu'une imprimante et plusieurs écrans lui sont rattachés. Quand le visiteur met en marche la machine à l'aide d'une souris, une voix lui explique le rôle des gènes : chaque individu est unique, personne n'a le même patrimoine génétique, la même vie ou le même environnement culturel. Le but de cette machine consiste à photographier une partie du visage de l'utilisateur (ses yeux, sa tête, son nez...) afin que le défilé de la diversité débute.
Après ce tirage de portrait, la voix lui demande de sélectionner son groupe sanguin (A, B ou O), pour lui expliquer qu'il y a deux sortes de gènes transmis : des gènes visibles et invisibles, ce qui rend l'individu unique alors qu'il y a juste 0,1% de différence entre chaque individu. Subtile la nature ! Rien n'est définitif dans nos gènes car ils peuvent être modifiés par notre culture, notre environnement, notre histoire personnelle ou encore nos passions.
Derrière le photomaton, plusieurs écrans montrent les différentes photographies prises par les visiteurs mais seulement dans un ordre précis. Chaque photographie est alignée en fonction du même groupe sanguin des visiteurs.
Crédits : L.P
Ludivine Perard
Plus d'infos :Cité des Sciences et de l'IndustrieL'exposition : L'Homme et les gènes

"Aventuriers, en route vers le passé!"
Parmi les parcours possibles offerts par son audio-guide, le Louvre-Lens propose aux enfants âgés de 8 à 12 ans un voyage au cours duquel, à travers l’avatar de Miss Anne ou Doc Sam, ils deviennent des aventuriers de l’Art prêts à explorer les âges, de l’Antiquité au XIXème siècle. En quête d’aventures, mes rêves de petite fille fan d’Indiana Jones sont ressortis et je me suis lancée dans ce périple temporel d’une durée de quarante-cinq minutes !
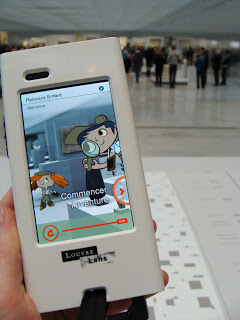
Crédits : Emilie Etienne
La chasse aux trésors
A l’aide d’une carte, l’aventurier a pour mission de remonter le temps et de partir à la conquête de dix œuvres dans la « Galerie du Temps ». Sur un fond sonore approprié et un ton humoristique qui sollicite l’attention de l’enfant, le discours, semblable pour les deux avatars, est très agréable et accessible à tous. En incitant l’aventurier à se référer au cartel, le guide l’encourage également à devenir un visiteur indépendant, avide de connaissances.
Les outils
Pour l’aider dans sa quête du savoir, l’aventurier de l’Art dispose d’une mallette scientifique qui lui permet de compléter le discours du narrateur. Celle-ci contient des dispositifs qui lui permettent notamment de dater, de scanner et de s’interroger sur l’œuvre.
Pour moi, quelques inconvénients sont à relever sur les performances de l’appareil mal ou très peu exploitées. L’application « Scannix » permet d’orienter l’enfant sur certains éléments de l’œuvre grâce au discours du narrateur. Mais il écoute les indications sans pouvoir visualiser les détails sur l’écran qui ne diffuse que la photographie complète ou partielle de l’œuvre. J’aurais apprécié être guidée et pouvoir zoomer en même temps que le commentaire. D’autant plus que les collections, situées en hauteur, peuvent être difficilement accessibles aux enfants qui ne peuvent pas en apprécier toutes les subtilités !

Crédits : Emilie Etienne
Attention ! Traverser les siècles, voire les millénaires, n’est pas si facile ! L’esprit d’aventure ne suffit pas, il faut également être curieux car pour accéder à l’œuvre suivante, les aventuriers de l’Art sont mis à l’épreuve. Une énigme est posée pour chaque œuvre avec quatre possibilités de réponse. Le droit à l’erreur est autorisé mais, en cas de mauvaise réponse, il n’obtiendra pas le trésor de l’étape en récompense mais pourra passer à l’œuvre suivante.
En plus des énigmes, le parcours est semé d’embuches. Deux scientifiques, le professeur Mezopo et le scientifique Paolo Plano, attendent l’aventurier au détour d’un siècle pour le mettre en difficulté. Simples et ludiques, ces épreuves permettent à l’archéologue et l’artiste, qui sommeille en nous, de s’exprimer et d’appliquer sur le terrain les connaissances acquises.
Point négatif : l’application « énigme » est proposée en premier, suivie par celle de la « mallette pédagogique ». Or, l’option« énigme » choisie, il n’y a pas possibilité de retour sur la « mallette pédagogique » pour cultiver son érudition. Cette dernière est jugée inutile en cas de bonne réponse. Dans ce cas, il serait appréciable d’inverser la disposition de ces applications.
Leretour au XXIème siècle se fit sans trop de difficultés. Grâce à des commentaires concis et des outils qui permettent de capter l’attention des enfants, les siècles passent rapidement. Ce voyage dans le temps m’a permis de me rendre compte d’une chose. En comparaison, le discours du parcours adulte, souvent trop long et monotone, paraît sortir tout droit d’un autre âge.
Emilie Etienne

"La Prédication de Marie Madeleine" a son application !
« Nous souhaitons avant tout partager cette histoire avec le plus grand nombre ! Grâce à ce nouveau musée [le Musée d’Histoire de Marseille], nous accueillons désormais le public dans de bonnes conditions pour lui transmettre ces connaissances, pour qu’il prenne plaisir à découvrir son/notre histoire avec des outils performants »[1]. Quels sont donc ces outils performants qui auraient le pouvoir de conquérir le public ? Le multimédia, bien sûr !, qui s’invite au Musée d’Histoire de Marseille à travers plus de 150 créations pour favoriser l’accessibilité des contenus au public. Pari réussi ? Et si nous expérimentions l’un de ces fameux outils ? Allons direction la séquence 7 de l’exposition permanente pour (re)découvrir « La Prédication de Marie Madeleine »[2]…
Une œuvre, deux supports
Vue de l’exposition
© Cyrielle Danse

A nous de jouer !
Comment ça marche ? L’ensemble de la navigation se fait de façon tactile. La page d’accueil, représentant l’œuvre, décrit rapidement la dite œuvre, comme le ferait un cartel. Puis le visiteur peut poursuivre en appuyant sur « Démarrer ». C’est parti ! L’application interpelle le visiteur en ces termes : « Bienvenue. Explorez le tableau en zoomant et en vous déplaçant à votre guise dans la toile. Pour en savoir plus, suivez la visite guidée ». En effet, dans l’angle inférieur droit de l’écran, le visiteur a deux possibilités : soit effectuer une « exploration libre », soit une « visite guidée ». Comme le précise l’encart de présentation, la première possibilité permet au visiteur de zoomer et de se déplacer dans la toile comme il le souhaite. Il peut ainsi observer des détails qu’il ne verrait pas avec une telle précision face à l’œuvre originale. Si le visiteur choisit la seconde possibilité, trois offres lui sont proposées : explorer « le paysage », « les techniques picturales » ou « le sens religieux ». Il sélectionne une des rubriques et découvre sur la représentation de l’œuvre des numéros, respectivement neuf, sept et trois, qu’il peut « toucher » pour faire apparaître, à côté de la zone de l’œuvre sélectionnée et zoomée, des informations concises et claires. Le visiteur découvre ainsi l’œuvre en fonction de sa curiosité.
Vue de détail du tableau
Alors satisfaits ?
« La Prédication de Marie Madeleine »
© http://catalogue.drouot.com/
C. D.
Pour en savoir plus : Musée d’Histoire de Marseille
#multimédia
#application
#musée
[1]Laurent Védrine, conservateur du Musée d’Histoire de Marseille, Marseille, La revue culturelle de la Ville de Marseille, Le Musée d’Histoire, n°243, décembre 2013, p. 20.
[2]« La Prédication de Marie Madeleine », attribuée à un collaborateur d’Anton Ronzen, 1517, huile sur bois, numéro d’inventaire 2007.0.244, dépôt du Musée National du Moyen-Âge.

"Suis moi !", cheminer à l'Historium de Bruges
L’Historium de Bruges guide ses visiteurs pendantune heure dans les dédales de la Bruges médiévale. Cela suit l’histoire d’unjeune apprenti du peintre Van Eyck qui doit aller chercher une jeune femme etun perroquet vert pour le dernier tableau de son maître. L’histoire, pleine depéripéties, est racontée en séquences qui intègrent, chacune, une vidéo et unereconstitution physique des lieux de l’action.
Séquence dans l’atelier de van Eyck @Trip Advisor
L’Historium est un projet qui met en collaborationdes familles nanties de Flandre occidentale, une brasserie, la BNP ParibasFortis et le gouvernement flamand. Il a ouvert en 2012 avec un objectif derentabilité élevée envers ses investisseurs. Cela explique en partie le prix dubillet (12 euros) mais aussi la nécessité d’accueillir toujours plus devisiteurs. Comment, dans ce cas,atténuer l’effet de « foule » ? Comment faire croire au visiteurqu’il est le seul ici, ou presque ?
Cheminer en groupe
La solution est une histoire de flux : l’Historiuma choisi de segmenter les flux de visiteurs en petits groupes qui se suiventmais ne se voient ni ne se croisent ! Chaque groupe vit l’expérienceindépendamment. Pour ce faire, les créateurs de ce système se sont inspirés desattractions touristiques : pensez aux longues files qui sont ensuiteséparés en petits groupes pour rentrer dans la maison hantée ou le petit train.Une fois séparés, les visiteurs sont guidés dans un cheminement précis.
Suivre
Ce cheminement est visible au sol par des traces depas blanches. Ces traces, comme autant de petits cailloux blancs nous indiquentpar où se fera la sortie dans chaque salle. Il n’y a qu’un parcours possibleparmi ces salles. Par contre à l’intérieur des salles les déplacements sonttrès différents. La reconstitution et la vidéo s’accordent de manière variée :
- Dans une salle ronde avec des voutes la reconstitution conduit à tourner autour du pilier central, découvrant la vidéosur plusieurs petits écrans comme autant de fenêtres sur les murs.
- Dans un espace en couloir représentant le marché, la vidéo est le long du mur, comme si le visiteur regardait la scène par la fenêtre d’une maison, depuis la rue.
- A un autre endroit, il faut lever les yeux quand, en haut d’un escalier, une porte s’ouvre qui révèle sur un écran une autre pièce, l’atelier du peintre, où se déroule la scène.
- Enfin, pour une scène de repas, le visiteur entre dans une pièce sombre et l’écran est inséré dans une grande table centrale. La scène est filmée en plongée ce qui donne vraiment l’impression deregarder la vidéo par-dessus l’épaules des personnages.

La pièce reconstituée : Atelier du peintre @Historium
Afin de ne pas perdre le spectateur et de rythmer son parcours, l’audioguide qui diffuse le son de la vidéo intègre des consignes « dissimulées » : l’apprenti nous dit « viens, suis-moi », « allons vers le marché » ou encore « il fauts e dépêcher ! ».
Déambuler dans les coulisses
Après l’histoire de Jacob, l’apprenti de Van Eyck, et sa folle journée à travers Bruges, le visiteur entre dans un espace d’exposition plus classique. Il y trouve des informations scientifiques et historiques sur la Bruges médiévale avec des cartels, des manipulations et des tests sur des écrans interactifs.
Dans cet espace où le temps n’est pas compté, ladéambulation est laissée libre. C’est un espace de « coulisses »après la représentation. C’est aussi là qu’est, d’ailleurs, présenté un making of du film. Les audioguides nepassent plus automatiquement d’une piste à l’autre : il faut taper desnuméros pour déclencher un commentaire.
Visiter sans bouger
Point d’orgue de ce cheminement, l’Historium nous propose un voyage immobile. En effet, après la visite, ceux qui le souhaitent peuvent expérimenter 10 minutes d’immersion totale dans un monde virtuel reconstituant la ville au Moyen Âge. Nos yeux et nos oreilles sont monopoliséspar un masque (l’oculus rift) et un casque. L’expérience est très réussie : nous sommes libres de bouger la tête et découvrons la reconstitution non seulement à 360° mais aussi au-dessus et au-dessous de nous. Pour plus de mouvement, nous sommes placés dans une barque qui avance. L’arrivée aux portes de la ville est spectaculaire !
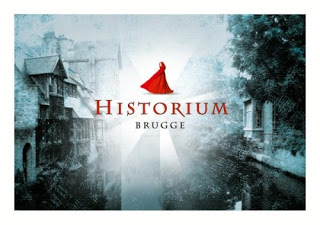
Logo de l’Historium @Historium
En liberté conditionnelle ?
Au terme de ce voyage je m’interroge : ai-je été l’otage consentant du cheminement chuchoté par l’Historium ? Je n’avais la plupart du temps ni le choix de mon parcours ni celui de mon rythme (la petite salle d’exposition mise à part). Pourtant la sensation est plutôt celle d’avoir été une invitée privilégiée de ce voyage où tout s’est accompli pour mes yeux uniquement, ou presque.
Après réflexion, je pense identifier deux ficelles à ce tour de magie : le conte et la nouveauté.
- Personne ne se lasse des histoires qui, depuis notre enfance, nous tiennent en haleine jusqu’à leur résolution. Suivre Jacob est facile quand il nous raconte son histoire : nous retrouvons les repères familiers que sont les différents personnages, l’unité relative de lieu, un début et une fin (de fait « Jacob et Anna vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ».).
- La nouveauté et la découverte renforcent l’estime du visiteur valorisé par la technologie développée pour lui et les surprises qu’elle réserve, de l’oculus rift à la curiosité de savoir où sera l’écran dans la prochaine salle ? Y aura-t-il encore de la neige qui tombe du toit ? etc.
Le gout de l’innovation : on ne se voit pas mouton parce qu’on découvre. Soit découvrir la technologie soit découvrir la salle avec ses sons, ses bruits, ses décors, son film.
PS : Je ne résiste pas à vous dire que, selon le site internet de l’Historium, durant la première journée de tournage les deux bébés acteurs ont fait pipi sur la cape de l’héroïne, Anna, à huit reprises.
#Bruges
#Voyage
#Historium
Pour en savoir plus : https://www.historium.be/fr

« Si Versailles m’était conté » … et la suite !
Pourquoi ne pas découvrir Versailles sous un autre jour, celui de l’ère numérique ? Pourquoi pas ! Dans la lignée du projet “le Grand Versailles” lancé par l’Établissement public de Versailles.
© Château de Versailles
Sous un nouvel angle, il met en place différents outils de médiation et d’interaction afin de susciter l’imaginaire et la curiosité des visiteurs. Ce projet établi en 2006, par le ministère de la Culture, est une phase expérimentale du “Grand Versailles”, et il tend dans un but imaginatif, d’améliorer les différents outils de médiation. Il se veut multi-public, multi-lingues, multi-services, multi-supports. Le Château se voit doté d’un nouveau statut ; celui d’un gigantesque laboratoire multi-disciplinaire et virtuel, en effet ce projet propose une approche évolutive d’un point de vue de la médiation culturelle.
Prenons l’exemple du site internet du projet “le Grand Versailles”, il propose un outil novateur et interactif se basant sur les nouvelles technologies. Il offre, également de manière intéressante et exhaustive, des ambiances inédites et particulières avec notamment l’utilisation des images 3D. Le visiteur prend la place d’un “visiteur virtuel”. Il navigue ainsi aisément du château aux autres domaines proposés.
Alors, en navigant dans ce site, on se plonge directement dans l’ambiance « Versailles » (les couleurs, la musique …) : une manière ludique et intéressante de visiter ce vaste domaine. Ce site s'inscrit dans plusieurs choix de parcours explicatifs qui sont à la fois scientifiques, techniques et instructifs.
La découverte du château se fait par la Galerie des Glaces en 3D, mais aussi de la Cour Royale, de la cour des Marbres, des visuels panoramiques des jardins, le survol de la Grande Perspective.
Le site aborde une chronologie qui manque de dynamique et d’informations historiques. Le site mêle également des vidéos, des petits documentaires sur les pièces du Château qui sont habituellement fermées au public.
Le plus interactif et le plus envoûtant dans les différents outils proposés par le site reste sans nul doute la visite du domaine de Marie-Antoinette, une visite téléchargeable sur un iPod, accessible gratuitement sur iTunes Store. Une visite virtuelle assez bien conçue dans son ensemble, nous sommes accueillit par une douce et légère voix : « vous venez de franchir les grilles de mon domaine, suivez mes pas… », le visiteur se laisse ainsi entrainé par les commentaires du vidéo guide. Le parcours est ainsi divisé en cinq étapes (le Petit Trianon, le jardin à la française, le Belvédère, le Hameau de la Reine et le Temple de l’Amour), et toujours accompagné des commentaires de Marie-Antoinette.
Les parcours sont ponctués par différentes étapes inédite comme la découverte du Petit Théâtre de la Reine (la machinerie du théâtre), ou encore de la Chapelle, et d’autres vidéos intéressantes révélant différentslieux fermés au public.
Un bémol est cependant à souligner : une certaine frustration se fait sentir dès la fin de la visite du domaine de Marie-Antoinette, d’une durée relativement limitée qui empêche donc une immersion dans l’atmosphère de cette époque. Mais cela ne va pas plus loin, et le « visiteur virtuel », reste sur sa faim.Celui-ci se sent enthousiaste de découvrir plus, d’apprendre d’avantage sur le château, sur son histoire, sur les personnages historiques qu’il a abrité. L’enthousiasme perd vite de son envol.
Le site ne propose toujours pas d’autres thématiques, tout autre fait historique, des vidéos sur le château, ou autres domaines, de salles en 3D et lachronologie reste succincte.
Le site n’a pas développé d’autres applications, ni d’autres salles en 3D, ou d’autres vues du château, il n’y a pas vraiment de continuité. Certes, ce projet faisait partie de la rénovation de Versailles, mais cela semblait pertinent vis-à-vis de la connaissance de ce vaste patrimoine, de continuer d’enrichir ce site. Cet outil de médiation demeure quoi qu’il en soit pratique, instructif et présente une conception originale et moderne.
Aujourd’hui la découverte se fait par le site de Versailles qui propose de multiples outils de médiation virtuel et numérique. Ce site est disponible, riche et édifiant,et ne génère donc plus de frustration, avec par exemple « Versailles en direct » à destination des scolaires, avec un parcours spécifique. Cet outil propose de découvrir Versailles à distance. Un travail important sur l'espace pédagogique a été mis en place, proposant aux jeunes publics des parcours et des espaces ludiques et instructifs.
Chloé MEUNIER

24h dans la vie d'une museomixeuse
Le titre est trompeur. En 24h on ne fait pas un Museomix mais un Mixday ! C'est la formule choisie par Museomix île de France pour 2015 puisque, malgré ses efforts, la Cité des Sciences n'était pas complètement remise de l'incendie survenu le 20 août. Envers et contre la malchance, 60 museomixeurs ainsi qu'une équipe organisatrice survitaminée se sont retrouvés dans les entrailles de la cité des sciences, samedi 8 Novembre.
Les missions que nous avions acceptées étaient claires : booster Museomix Ile-de-France et créer des dispositifs de médiation innovants pour la cité des enfants.
Pour museomixer encore mieux en Ile de France - notre île a déjà quatre Museomix à son actif ! - nous avons brainstormé, avec entrain et beaucoup de café. Au bout de 2h, sur nos tables couvertes de gribouillis gisaient des pépites : avoir des outils simples ethomogènes pour présenter Museomix, animer la communauté autour des prototypes pour des apéromix plus épicés, mieux transmettre l'expérience d'un Museomix à l'autre par exemple.
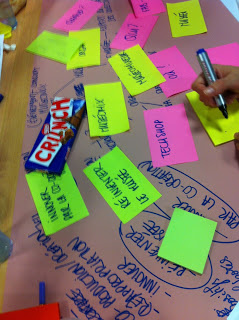
Brainstorming. Crédits E.L.
Ensuite nous avons pénétré, en apnée à cause de quelques courants de fumée toxique, dans la cité des enfants. J'ai eu le privilège d'avoir pour guide une des créatrices de la cité des 2-7 ans, une cité toute entière pensée autour des capacités individuelles et collectives que possèdent les enfants de cet âge. S'exercer, découvrir ses propres forces, s'amuser, rendre fiers ses parents et soi-même dans un même lieu ! Je vous assure que même à 23 ans j'avais envie d'enfiler un petit casque, un petit gilet et d'aller construire un mur de brique en mousse avec mes amis !
Comme à Museomix, les temps de pause n'en sont pas (ils sont des espaces d'inspiration et de rencontres), le déjeuner n'échappe pas à la règle ! J'ai découvert un embryon de Museomix danois incarné par Karine en dévorant mon assiette de salade et viande froide.
Avec le café vient le moment de pitcher : présenter son idée pour rassembler autour d'elle une petite équipe pluridisciplinaire. 8 groupes se forment. C'est parti pour 4h30 de mini marathon créatif. Nous découvrons alors le fabuleux labyrinthe (FabLab, laboratoire de fabrication) avec ses découpeuses laser, ses imprimantes 3D, sa brodeuse laser et mille autres merveilles de technologie à notre disposition pour l'après-midi.
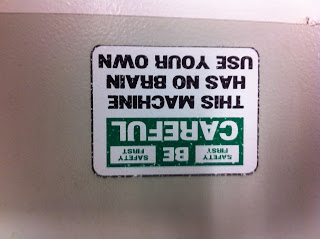
"This machine has no brain. Use your own" Crédits : E.L.
Quand sonne six heures et demie, il faut partager nos projets, les présenter aux autres groupes et à la caméra. Par exemple, les plus fous d‘entre nous ont imaginé comment révolutionner les toilettes de la cité des enfants : pourquoi se limiter à en faire un espace utilitaire et tristounet ? Pourquoi ne pas y placer des manipulations sur le circuit de l’eau ? Les questions d’écologie ? La production d’excrément par les différentes espèces ? D’autres ont imaginé un arbre aux branches basses dans la cité des 5-12 ans où l’on pourrait construire des cabanes, un jeu collaboratif qui fait écho au chantier des 2-7 ans. Il y avait aussi des lunettes pour une immersion totale et « voir par les yeux » de différents animaux, une rivière qui guide les enfants pour entrer et sortir de la cité, un habillage « teaser » du hall d’accueil, un jeu d’ombres qui oppose des équipes d’enfants et d’adultes et enfin la Museobox !
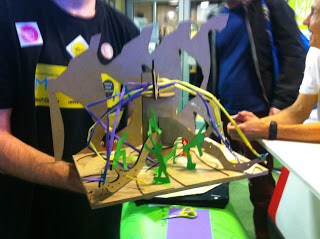
Maquette de l'arbre aux branches basses. Crédits : E.L.
Notre merveilleuse « Museobox » (votre auteur perd ici son objectivité, toute gaga devant son bébé), outil efficace au service de la présentation de Museomix, se décline en une boite/coffre au trésor et un puzzle bourdonnant d’idées. La boîte qui s’ouvre et révèle ses secrets (tiroirs, pictogramme de présentation des différents acteurs) permet d’animer la présentation de Museomix. Le puzzle fait de pièces octogonales (découpées au laser !) permet de d’expliquer comment implanter Museomix à un endroit où il n’existe pas encore.

Puzzle. Crédits : E.L.
Les prototypes étaient beaux mais rarement fonctionnels en raison du timing très serré. En trois jours tout serait possible. Lors des adieux pendant le dîner, on parlait déjà de se revoir très vite et surtout, de lancer Museomix idf 2016 !
Eglantine Lelong
#Museomix #Création #Mixday
Pour aller plus loin :
http://leratdemusee.com/2015/11/11/pimp-my-museum-museomix-cette-belle-aventure/

5 questions pour comprendre l'open data dans les musées
Qu’elle soit big ou open, la data interroge. Notre société produit aujourd’hui de la donnée en masse et en permanence : comment est-ce que cela impacte le milieu culturel ? Un focus sur l’open data et les musées.
1. L'open data, qu'est-ce que c'est ?
L’open data, ou en français « ouverture des données », est le fait de mettre à disposition des citoyens les données publiques des institutions. Cela s’applique aussi bien aux administrations régionales qu’aux équipements sportifs municipaux, à la sncf ou aux musées nationaux. En France, le cadre légal rend obligatoire la mise à disposition des données produites dans le contexte professionnel des administrations publiques, mais chaque institution le fait à sa manière. Le but de l’open data est de rendre les données gratuites et réutilisables, et cela sans contrainte technique pour l’utilisateur. Évidemment, certaines données sont exclues de l’ouverture au public : les données sous secret légal, soumises au droit de la propriété intellectuelle ou encore celles pouvant toucher à la sécurité nationale.
L’open data est la forme numérique de l’ouverture des données : les jeux de données produits par les administrations sont regroupés en ligne, sur des sites identifiés. Attention cependant à ne pas confondre ouverture et accessibilité : quand il faut cliquer sur cinq ou dix liens internet consécutifs pour trouver le jeu de données que l’on cherche, c’est que les données sont disponibles (ouvertes), mais pas accessibles ! Aussi, militer pour l’open data, ce n’est pas seulement aller dans le sens de la mise à disposition des données pour le public, c’est aussi militer pour qu’elles soient accessibles au plus grand nombre le plus facilement possible.
Et les musées ? Pendant longtemps ils ont été exclus de l’obligation juridique de mise à disposition des données, au titre du régime dérogatoire des données culturelles selon la loi CADA de 1978. Aujourd’hui, ils sont soumis à cette obligation comme les autres administrations. En revanche, les institutions culturelles publiques ont le droit de demander une redevance pour toutes les données issues de la numérisation des collections (car c’est un processus qui peut être très coûteux). C’est la raison pour laquelle la Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais peut facturer des numérisations haute définition d’œuvres pourtant dans le domaine public (et donc soumises à l’ouverture des données). Dans les faits, les musées sont aujourd’hui libres de mettre ou non à disposition gratuite du public les données dont ils disposent, et de choisir les licences sous lesquelles ils diffusent leurs données : autoriser la réutilisation commerciale ou non, faire figurer le crédit du photographe ou seulement de l’institution, etc.
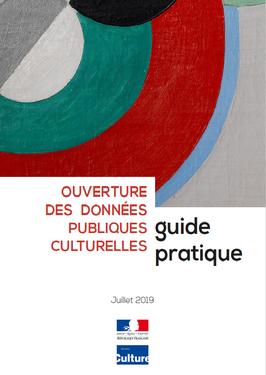
Le guide pratique pour l’ouverture des données culturelles
publié par le service de l’innovation numérique du Ministère de la Culture
2. A quoi ça sert ?
Avant toute chose, il s’agit de la transparence des administrations dépendantes de l’État. L’ouverture des données, avant d’être un moyen de diffusion des données culturelles pour valoriser des collections de musée, sert à asseoir la confiance entre les citoyens et l’État : tout citoyen a le droit fondamental d’accéder aux données produites dans l’exercice de leurs fonctions par les collectivités territoriales et par l’État. Dans les institutions culturelles, il s’agit principalement de rendre le patrimoine commun accessible à tous, en tant que service public.
De nombreux autres enjeux s’ajoutent évidemment à cette approche principale. Dans le milieu des musées, il y a bien entendu des enjeux économiques : les musées conservant des œuvres très célèbres savent que même si les données sont payantes, il y aura un public qui acceptera de payer le prix fixé par l’institution. À l’inverse, pour des musées de moindre envergure et qui ne bénéficient pas d’une grande renommée, facturer des visuels risque d’être une barrière à l’accessibilité de leurs collections. Tout est question d’équilibre, et c’est aujourd’hui une question qui se résout au cas par cas dans chaque institution. Mais quel que soit le musée, l’un des enjeux est tout simplement de diffuser des données fiables, vérifiées et sourcées sur les objets conservés. Par exemple, quand les musées de beaux-arts mettent en ligne des numérisations haute définition des œuvres, cela évite que le public accède à des reproductions faussées, notamment au niveau de la colorimétrie (il s’agit d’éviter le fameux « syndrome de la laitière jaune », du nom d’une œuvre de Vermeer dont circulent sur internet des images aux couleurs criardes).
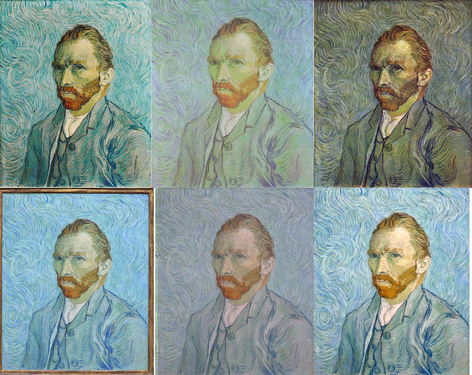
Quand l’institution ne met pas en ligne de reproduction, à quelle image se fier ?
regroupement par Sarah Stierch pour https://yellowmilkmaidsyndrome.tumblr.com/
Le propre de l’open data est d’être réutilisable par les publics : qu’il s’agisse d’une classe de primaire qui fait de l’éducation artistique et culturelle, d’une étudiante en histoire de l’art qui utilise les données pour ses recherches ou bien d’un habitant qui souhaite se renseigner sur le patrimoine local, tous bénéficient de l’accessibilité des données du patrimoine. Les données ouvertes sont librement réutilisables : l’open data favorise aussi l’innovation et ne décide pas des usages qui pourront être faits des jeux de données mis en ligne.
3. Quelle différence entre open data, open content et openglam ?
On entend plusieurs termes différents : il faut différencier open data (données ouvertes) et open content (contenus ouverts), qui ne recouvrent pas exactement la même chose. Les données, ce sont par exemple les informations d’inventaire qui accompagnent les objets de musée : date de création, date d’entrée dans l’institution, auteur, prêts dans telle ou telle institution... Et le contenu, c’est surtout la numérisation de l’objet : haute ou basse définition, 2D ou 3D pour les objets en volume, téléchargeable ou non. La plateforme Google arts and culture met par exemple à disposition du public des visuels en très haute définition des œuvres, mais ne permet pas toujours de les télécharger ni de les réutiliser : il s’agit donc de diffusion, mais pas d’open data ni d’open content, car l’image n’est pas réutilisable par les publics et reste protégée. À l’inverse, le site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France propose des versions numérisées de livres, affiches, estampes et photographies, avec les données qui les accompagnent, et permet à la fois la consultation en ligne et le téléchargement (sous différents formats au choix : texte, pdf ou image). C’est un très bon exemple d’open data dans une institution française importante.
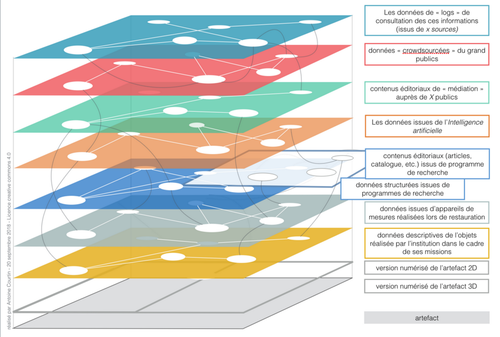
Les données des objets culturels : un mille-feuilles complexe
illustration par Antoine Courtin sous licence creative commons 4.0
L’openGLAM, c’est encore autre chose. GLAM est l’acronyme anglais de Galleries, Libraries, Archives and Museums (galeries, bibliothèques, archives et musées). Il s’agit d’un réseau d’échange et de travail pour les professionnels des milieux culturels qui défendent l’approche open data dans les institutions GLAM. L’open data culturel pose en effet des questions différentes des autres milieux : la gestion technique des images haute définition (donc des fichiers lourds), par exemple, ou encore la question des droits patrimoniaux rattachés aux images produites et diffusées.

Le logo OpenGLAM / Open Knowledge Foundation
4. Où est-ce que ça se passe ?
La base des collections des musée de France, Joconde, est hébergée sur la Plateforme ouverte du patrimoine : elle est incontournable pour l’accès aux collections des musées français quelle que soit leur typologie, et elle reverse directement les informations sur un site ministériel d’open data, « data.culture.gouv.fr ». Les musées labellisés « musée de France » sont donc invités à y déposer régulièrement leurs collections, de manière à avoir une base de données centralisée qui fasse référence.

La plateforme ouverte du patrimoine regroupe différentes bases de données culturelles françaises
5. L'open data, musée de demain ?
On entend parfois dire que le numérique cherche à remplacer les musées, mais ce n’est pas vrai : le numérique occupe une place spécifique pour chaque musée et offre des possibilités nouvelles et différentes. Se sentir menacé par la diffusion libre des données sur internet, c’est considérer que le travail fourni par les institutions se limite à présenter les œuvres et leurs cartels aux publics, mais les musées font bien plus que cela. Les musées sont des lieux de vie, de partage, d’échange, de création ; les musées sont des lieux de production et de diffusion des savoirs ; ils permettent à des communautés de se tisser, se retrouver, se pérenniser ; ils organisent un patrimoine commun qui permet de vivre ensemble, à l’échelle de la société.
Marie Huber
#opendata
#diffusion numérique
#gestiondescollections
Pour aller plus loin :
Cet article s’appuie notamment sur le travail d’Antoine Courtin
https://twitter.com/seeksanusername
Sur mon apprentissage au musée de Saint-Brieuc avec Nicolas Poulain
https://twitter.com/NicoCG70
Et sur une présentation de Camille Françoise dans le master MEM
https://twitter.com/CMFrancoise
Voir par exemple le carnet Hypothèses Numérique et recherche en histoire de l’art
https://numrha.hypotheses.org/
Et le réseau des muséogeeks http://www.muzeonum.org/wiki/doku.php?id=museogeek

A la recherche des trésors perdus…
Vous en avez assez que votre enfant joue toute la journée sur son ordinateur à des jeux d’action ou de combat ? Profitez de sa passion en lui proposant plutôt de découvrir un nouveau moment de récréation numérique, ludique et passionnant.
En 2008, fût lancé sur la toile un jeu élaboré par le Service éducatif du Musée des Beaux-Arts de Rennes (Bretagne) : La Chambre des merveilles – ce titre, pour certains évoquera les contes de Lewis Caroll, pour d'autres, la série Tomb Raider. Ce jeu interactif à destination des 8-12 ans (voire plus !) emmènera votre enfant à travers le monde, à la recherche d’objets précieux appartenant à Christophe-Paul de Robien.
Ce dernier, riche et puissant marquis breton du XVIIIe siècle, était un fin collectionneur, et parcourait le monde à la découverte d’objets rares - on a estimé qu’il avait recueilli 8000 objets ! Afin de valoriser cet ensemble, il constitua son propre « cabinet de curiosités » et réalisa une encyclopédie abondamment illustrée. Aujourd’hui, la collection est dispersée et exposée à travers diverses institutions et seule une partie est conservée au Musée des Beaux-Arts de Rennes.
Ce dernier, pour l’élaboration de ce nouveau service numérique, reçut le soutien de la Annenberg Fountion avec le FRAME (French regional American Museum Exchange) (1).
Gratuit et très facile d’accès (il vous suffit de vous rendre sur la page d’accueil du site internet du musée), le jeu se veut à la fois amusant et éducatif. Il se présente sous la forme d’un mini-site interactif, dont le graphisme (en Flash) et la mise en scène sont bien pensés. Lors d’une introduction de quelques secondes, le marquis de Robien se présente en personne – tout du moins, son buste gravé en noir et blanc, dont les yeux, la bouche et les oreilles (!) sont animés. Cette entrée en matière permet au joueur de comprendre qui est le Marquis, et ce que représente sa collection de curiosités ; en outre, nous est présentée notre mission : arpenter le globe terrestre et découvrir les objets manquants au nouveau cabinet de curiosités de Christophe-Paul de Robien.
Ce dernier vous quittant, vous vous trouvez face à un florilège d’objets précieux disposés de manière aléatoire sur le fond d’une salle remplie d’étagères. De tailles différentes, les photographies des objets sont de bonne qualité et les couleurs sont parfaitement restituées. Parmi ces objets, vous distinguez certaines formes grises. Elles représentent la clé de votre réussite : ce sont les « objets mystérieux » qu’il va falloir trouver.
Votre croisade se fera à l’aide d’un globe terrestre se trouvant au premier plan. Après avoir choisi votre aire de prospection (Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Europe et Océanie), grâce à votre lampe torche, il vous faudra parcourir de magnifiques cartes représentant les différents continents, puis tendre l’oreille et entendre le son des « cloches » - un petit bruit augmente à mesure que votre souris se rapproche de chacun des fameux « œufs », soit les objets merveilleux. A chaque objet retrouvé correspond un mini jeu, soit didactique (choisir les bons ingrédients du chocolat maya et mélanger le tout dans un vase maya; compléter de perles colorées un porte-bébé d’Amérique du Nord …) soit simplement divertissant (le traditionnel puzzle ou encore le jeu des sept différences). Une fois le jeu remporté, vous pourrez crier « hourra » et être fier de compléter la collection du marquis de Robien.
Même après avoir trouvé les « objets merveilleux », vous pourrez poursuivre votre aventure en parcourant les pages de l’encyclopédie. Il s'agit de notre coup de cœur: finement réalisée, elle constitue une vraie merveille d’interactivité. Le traditionnel livre y est quelque peu revisité : les longs discours qui risqueraient d’assommer votre enfant sont ici remplacés par un texte simple, clair expliquant chaque objet et fournissant des données concernant ses dimensions, sa situation géographique et sa date de création. En outre, le livre est illustré de belles photographies des objets. Un bel hommage rendu à tous les ouvrages chargés d’histoire, dont il ne manque que l’odeur typique ; tout le reste y est (le bruit des pages tournantes, la couleur alternée par le temps…).
Après avoir passé un bon moment à la découverte de cette aventure, vous comprenez rapidement pourquoi ce jeu s’est vu décerné, en 2008, le Muse Award par the American Association of Museums (2).
Marie Tresvaux du Fraval
Retrouvez le jeu sur le site du Musée des Beaux-Arts de Rennes ou sur le site du FRAME
(1) FRAME est une association de douze musées américains et de douze musées français. Ces musées ont été choisis comme représentants de la richesse et de la vie muséale des deux pays.
(2) Prix prestigieux attribué chaque année par cette Association américaine des Musées, créée en 1906. Elle réunit des musées et des institutions éducatives afin de promouvoir la coopération et les échanges et ainsi, rehausser la qualité des expositions.
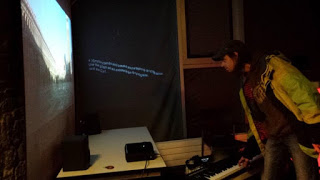
A la rencontre d'ingénieurs créatifs à la Casemate
Une bâtisse historiquement militaire a laissé place à l’ère du numérique, du fablab et de la convivialité. Je viens découvrir à la Casemate de Grenoble des installations pluridisciplinaires, sans idée préconçue ni connaissance des participants. Prêts pour une ascension à la fois technologique, artistique et scientifique ?
L’objectif de ma visite est avant tout d’apprécier et de découvrir les tendances permettant de relier les disciplines croisant l’art, la science et la technologie, autrement dit « AST ». Ce sigle correspond aussi à l’option en Master 2 Sciences cognitives à Grenoble, diplôme co-dirigé par Claude Cadoz et Jérôme Villeneuve. Pendant deux jours, une dizaine d’étudiants ingénieurs présentent le fruit de leur travail réalisé entre 2016 et début 2017.
Récit-fiction basé sur l’exposition « Intersections » à la Casemate.
Je quitte la lumière diurne pour pénétrer dans une galerie voûtée. De jeunes gens se croisent, échangent autour de différents pôles qui semblent ludiques et attractifs. J’entends, que dis-je je ressens les ondes sonores de toutes parts autour de moi. Plus j’avance, moins je comprends.
Un homme s’avance vers moi : « vous voulez essayer ? ». Il me montre du matériel informatique, sonore et visuel disposé sur le côté. Comme je lève les yeux, attirée par un grand écran sur le mur juste derrière moi, il me dit : « Ce sont des glitchs sur l’écran ». Mais enfin, dans quel monde ai-je mis les pieds ? Je tente une réponse : « Euh… tu veux dire Pitch ? »
Création « Le Langage des glitchs » de Jose Luis Puerto © H. Prigent
Entre temps, un jeune homme s’est installé devant le clavier et s’amuse déjà à produire des sons : la photo sur le grand écran change légèrement d’aspect, modifications qui peuvent paraître imperceptibles. L’étudiant-concepteur Jose Luis Puerto m’explique en même temps que je visualise les évolutions de la photo : « En fait, il existe des glitchs audio ou vidéo. Vous pouvez les voir sur l’écran, ce sont des dysfonctionnements informatiques et chacun peut les créer volontairement. Ce que je présente ici pourrait se retrouver ailleurs, pour envisager d’autres manières de communiquer et aller vers de l’inattendu. » A écouter cet étudiant-ingénieur, je me dis que son installation est certainement promise à des applications plus larges que ce que j’imaginais.
Est-ce que j’aime ou non cette proposition intitulée « Le langage des glitchs » ? Il s’agit surtout d’un ressenti, comme parfois face à une œuvre d’art dont je ne connaîtrais ni le contexte ni le courant artistique. Cette installation me paraît surprenante : la photo urbaine, les sons reliés de manière indéterminée au visuel, la médiation sur l’intention créative qui m’ouvre de nouvelles perspectives.
J’essaie quelques notes sur le clavier et je trouve une certaine satisfaction à interagir avec la photo dont certains pixels disparaissent, selon la touche sonore activée. Jusqu’à quel point cette proposition de communication pourrait être modifiée comme je le souhaiterais ? Ajouter une seconde personne et un second clavier ? Proposer une autre photo où l’apparition et la disparition des glitchs aurait une signification particulière ? Finalement « Le langage des glitchs » peut devenir source d’inspiration alors qu’au premier abord, il me paraissait si hermétique !
Je dois me ressaisir car le temps ici est compté. La salle de la Casemate fermera dans moins d’une heure et il me reste une dizaine d’œuvres à découvrir : j’en choisirai quelques-unes pour prendre le temps de les expérimenter. Je reprends ma déambulation guidée par les sons et les mouvements des visiteurs.
Je suis naturellement attirée par un petit groupe qui paraît danser et s’amuser devant des enceintes. Je ne peux m’approcher plus de l’installation sonore car tous restent à quelques mètres de distance, comme devant un spectacle invisible. Je m’arrête donc derrière un homme dont les bras se meuvent en l’air puis de chaque côté. Est-ce qu’il s’agit de chercher comment donner vie à une œuvre musicale plus ou moins perceptible ? Quelle idée enthousiasmante que de dessiner les harmonies et les rythmes dans l’espace !


Création « Musique en mouvement » de Simon Fargeot © H. Prigent
C’est tellement génial que plusieurs visiteurs attendent déjà leur tour pour tester cette proposition de Simon Fargeot : « Musique en mouvement ». Je prends plusieurs minutes à observer et apprécier le tempo. Quelques photos me permettront d’immortaliser les gestes tantôt spontanés du visiteur tantôt guidés par le concepteur amusé. Je continue mon parcours : d’autres bruitages me lancent des appels, sous d’autres voûtes aux éclairages incertains.
Je m’aventure à quelques pas de là, sans bien identifier la suite. Soudain, je me retourne et je me trouve face à un regard perçant dans la pénombre. Ces yeux me fixent et je ne peux les ignorer, tandis que l’image évolue sans cesse et de manière accélérée. « C’est du speed painting ! », m’indique le créateur Florent Calluaud. Face à cet écran disposé sur un chevalet, je découvre ainsi toutes les étapes de conception de son œuvre picturale intitulée « Danse avec les loups ».
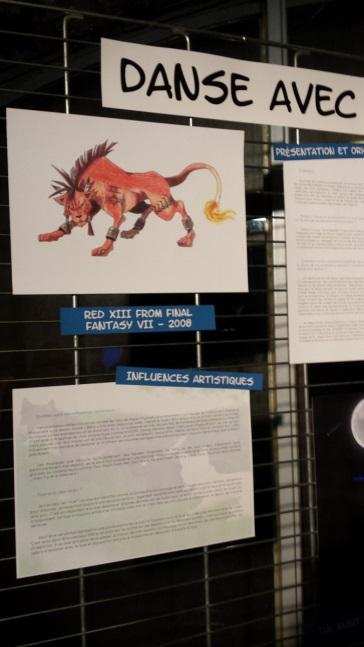
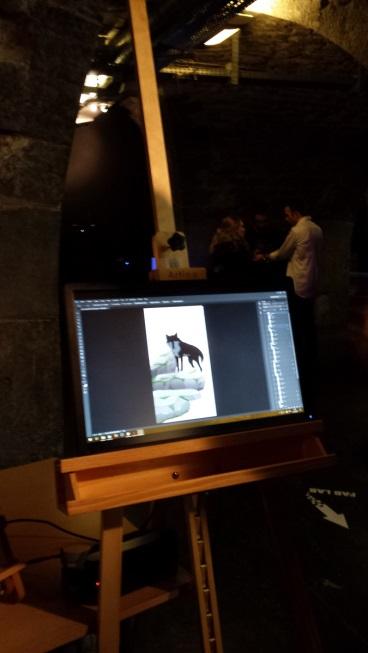
Création « Danse avec les loups » de Florent Calluaud © H. Prigent
Ce dessin est réalisé à partir d’une tablette graphique et s’accompagne d’une musique ainsi que du récit de l’auteur : quels outils ont été utilisés, quelles étapes ont été nécessaires, quelles questions se sont posées au fur et à mesure ? Pour le créateur, « ce qui est important est le lien entre la musique et le dessin qui permettent de raconter une histoire, faire voyager dans un imaginaire et faire ressentir l’émotion qui s’en dégage. » Cette œuvre m’évoque la sérénité et un voyage à travers le temps… réel ou imaginaire ? Je ne sais plus !
Pour la prochaine destination, je me retrouve téléportée sur des rails et j’avance à une allure agréable, me permettant d’apprécier les éléments de paysage de part et d’autre. Je ne crois pas être une passagère, mais plutôt la conductrice d’un train que je ne vois pas. Cette sensation d’avancer au bon rythme va se confirmer par la proposition du créateur et étudiant Adrien Bardet : « Voulez-vous monter à bord ? » Il me désigne un appareil de type console de mixage sonore. Je saisis le casque qu’il me tend pour m’imprégner de l’univers sonore qu’il a créé.
Je m’attendais à pouvoir varier la vitesse de mon voyage ou à changer la direction sur les rails comme dans un jeu vidéo. Là encore, je suis surprise par la finesse de la proposition intitulée « Soundscape ». Il s’agit de faire varier différents paramètres sonores qui influent en même temps sur la colorimétrie, sur les contrastes, bref sur l’ambiance visuelle du paysage et du voyage ferroviaire. [ndlr : je vous prie de m’excuser pour le flou de ma photo ci-dessous !]
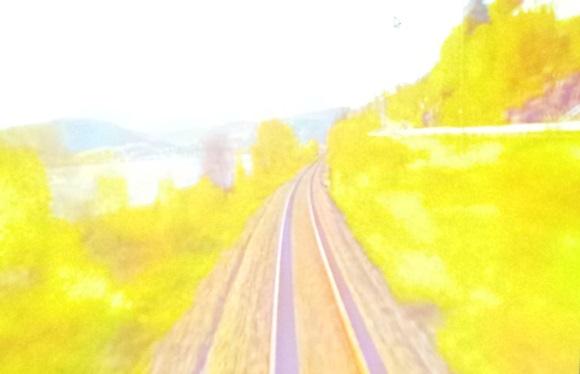
Création « Soundscape » d’Adrien Bardet © H. Prigent
Cette installation me semble aboutie, par la possibilité de vivre entièrement l’expérience en autonomie et par le niveau d’interaction proposé qui génère simplement du plaisir. Il est intéressant de pouvoir utiliser soi-même une palette des possibles visuels et sonores. Je consulte l’heure : il est temps de « descendre » du train pour aller vers une dernière rencontre avec la technologie…
En retirant mon casque, je me sens gênée par le brouhaha des installations autour car presque toutes émettent du son. Le lieu, tout en étant convivial, ne permet pas d’isoler les bruits les uns et des autres, sauf à proposer un casque individuel comme je viens d’en faire l’expérience.
Pour apprécier le quart d’heure restant, je reviens sur mes pas et m’avance vers un autre ingénieur-créateur. Assis, il est entouré de deux écrans : son ordinateur portable devant lui et un plus grand écran de démonstration sur sa gauche. Vais-je réussir à entendre et apprécier sa proposition sensorielle ? Je me concentre pour saisir au plus juste son œuvre.
Au premier abord, je ne suis pas certaine de distinguer l’outil de la création effective et je me renseigne sur le type d’expérience proposée. Antoine Goineau, concepteur de « Temps comme Tempo », me répond qu’il s’agit de générer une musique à partir de cette première photo à l’écran : chaque partie de l’image correspondra à une partie sonore différente. « L’utilisateur pourra par la suite relier le tempo de la musique créée à sa vitesse, à la perception du temps qu’il aurait en étant dans le cadre de la photo », précise-t-il.

Création « Temps comme tempo » d’Antoine Goineau © H. Prigent
Je comprends à peu près l’idée, qui me paraît ambitieuse et inédite. Mais ne pouvant justement pas créer mon propre tempo, cela reste abstrait. Comme pour la majorité de ces étudiants, son travail est en cours. Le créateur de « Temps comme Tempo » est le seul à me l’avoir précisé : à quel stade en sont les autres créations ? Cela est très difficile à déterminer lorsqu’on n’a pas l’habitude de ce type d’installation. Cette dimension « work in progress » me plaît beaucoup bien que cela place les exposants dans une position inconfortable. J’apprendrai par la suite que chaque étudiant est également évalué, pendant cette exposition « Intersections », par les deux enseignants du Master.
Il est un peu difficile d’entendre l’ambiance de « Temps comme Tempo », d’autant plus que les participants s’agitent avant l’heure de fermeture de la Casemate. J’apprécie tout de même la démonstration, en la percevant comme poétique et originale. Devant mon intérêt pour cette installation, il me détaille les logiciels utilisés et les langages informatiques. C’est une bonne idée d’aller au-delà de l’intention artistique pour les relier aux aspects plus techniques, bien que je ne sois pas sûre de retenir ces précisions pointues. A présent, chacun range à présent son installation car le lieu ferme d’ici cinq minutes. Je suis ravie d’avoir rencontré une partie de ce groupe d’étudiants ingénieux autant qu’audacieux.
Hélène Prigent
Pour plus d’informations sur ce master : http://phelma.grenoble-inp.fr/masters/
La Casemate de Grenoble, CCSTI* ouvert sur les évolutions actuelles, propose régulièrement des activités pluridisciplinaires. Cette visite donne réellement envie d’explorer des créations technologiques et scientifiques.
#promenadesonore
#labo
#experimental
*Missions du CCSTI (Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle) de la Casemate à Grenoble :
1. centre de production pluridisciplinaire qui travaille sur les thématiques scientifiques et industrielles fortement ancrées localement (numérique, micro et nanotechnologies, sciences du vivant, neurologie, énergie). Les sujets sont traités sous l’angle des rapports entre les sciences et la société : innovation et développement durable, bioéthique, nouvelles énergies etc…
2. animation au niveau régional, du réseau de culture scientifique et technique
3. centre de ressources (ex : banque d’expositions itinérantes) qui favorise l’émergence et le dynamisme de projets et de structures dans le domaine de la CSTI.

Histoire des fortifications de la Casemate
Au début du XIXe siècle, de grands travaux à caractère défensif sont entrepris pour protéger Grenoble par une enceinte dont les Casemates Saint-Laurent. Mais après les bombardements aériens de la première Guerre Mondiale, ces enceintes de protection sont devenues inutiles. Après l’échec d’une reconversion en projet commercial, l’agence de l’urbanisme de Grenoble investit le lieu, avant de laisser la place au CCSTI en 1979. Aujourd’hui, les locaux occupent l’étage pour le fablab, et le rez-de-chaussée pour l’accueil du jeune public et les bureaux. La Casemate partage le bâtiment fortifié avec la Maison Pour Tous Saint-Laurent et des annexes au Musée archéologique Saint-Laurent.

À qui appartiennent les objets ?

Le Trésor des Marseillais reconstitué en 3D par le MAP © MAP (UMR CNRS/MCC 3495)
Le Trésor des Marseillais et les sanctuaires panhelléniques
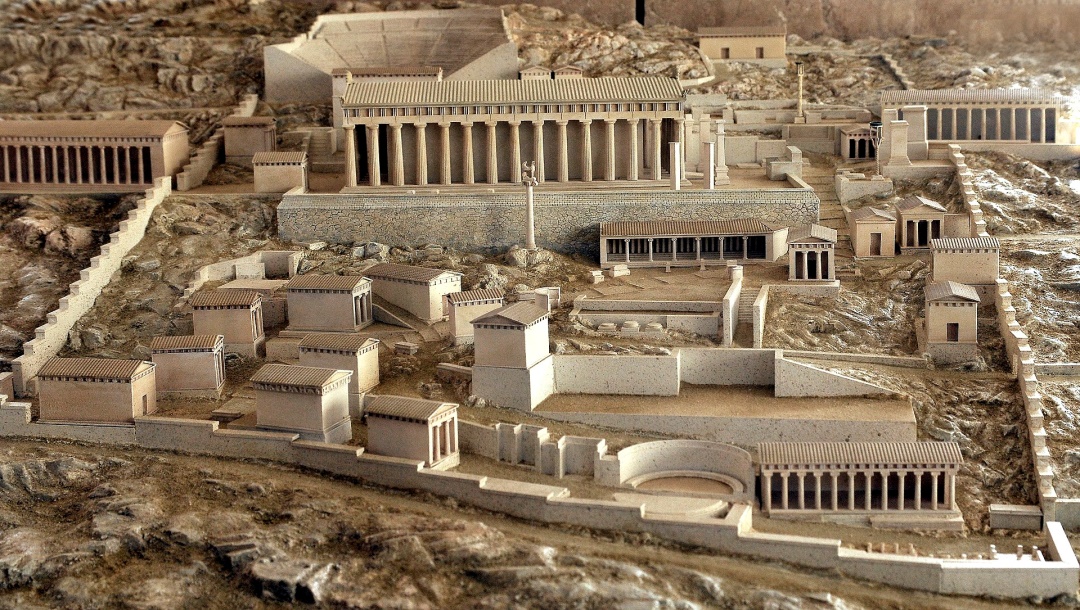
Maquette du sanctuaire d’Apollon reconstitué, exposée au Musée Archéologique de Delphes © Luis Bartolomé Marcos
Restitution, propriété et héritage culturel
Le rôle du musée et des nouvelles technologies en question
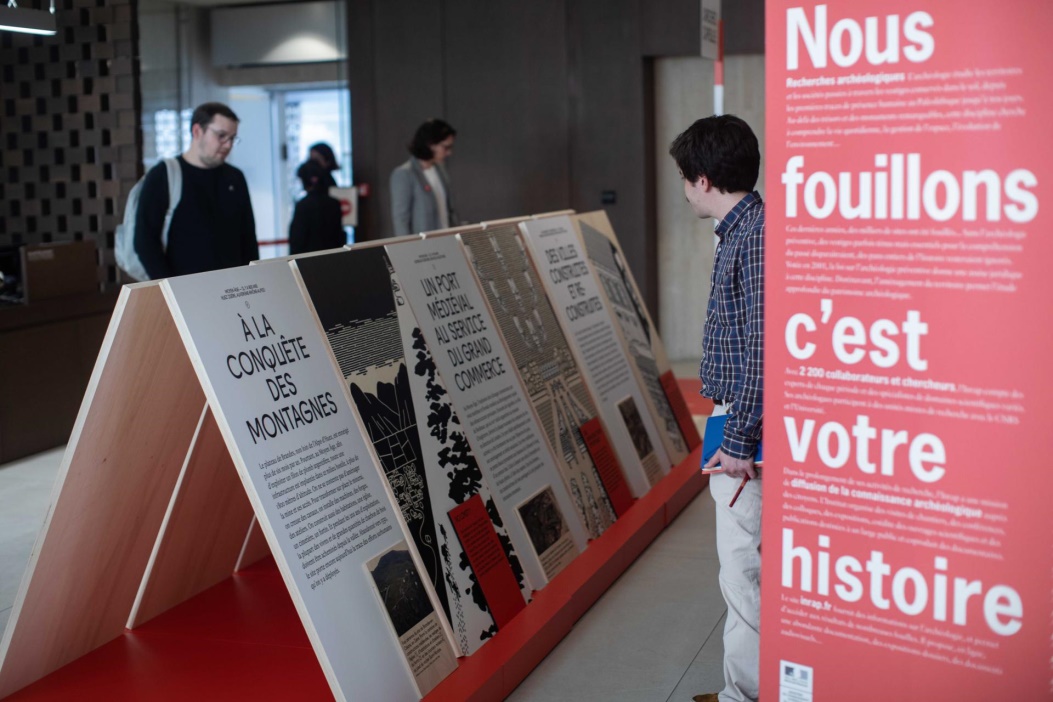
Visite de l'Archéocapsule « Archéologie de l'aménagement du territoire » au Musée de Cluny © Inrap
# Collections# Patrimoine# Héritage
Pour aller plus loin, bibliographie et sitographie thématiques…
-
Le Trésor des Marseillais et les sanctuaires panhelléniques
Colonge Victor, Le rôle des grands sanctuaires dans la vie internationale en Grèce aux Ve et IVe siècles av. J.-C, Thèse de doctorat en Histoire Ancienne, sous la direction de Nicolas Richer, Lyon, École Normale Supérieure, 2017, 900 p.
Poirier Henri-Louis et Musée d’archéologie méditerranéenne, Le trésor des Marseillais: 500 av. J.-C., l’éclat de Marseille à Delphes, Paris, Somogy, 2012, 247 p.
Centre de la Vieille Charité - Marseille, https://vieille-charite-marseille.com/archives/le-tresor-des-marseillais-500-av-j-c-l-eclat-de-marseille-a-delphes
Le Trésor des Marseillais : récit d’une expérience | Maud Mulliez, http://restauration-peinture.eu/archeologie/le-tresor-des-marseillais-experience/
-
Restitution et politique culturelle
Collège de France, Annuaire du Collège de France 2016-2017: résumé des cours et travaux : « À qui appartient la beauté ? Arts et cultures du monde dans nos musées », 117e année, 2019.
Kowalski Wojciech W., Restitution of works of art pursuant to private and public international law, Leiden, Boston, Brill, 2008, 244 p.
Prott Lyndel et O’ Keefe Patrick, « “Cultural Heritage” or “Cultural Property”? », in : International Journal of Cultural Property, no 2, vol. 1, 1992, p. 307.
Savoy Bénédicte, Sarr Felwine, Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle, 2018, 232 p.
-
Le musée et les nouvelles technologies
Martin Yves-Armel, « Innovations numériques / révolution au musée ? », in : Publications du musée des Confluences, no 1, vol. 7, 2011, pp. 117‑128.
Inrap | Archéologie et société : les Archéocapsules, https://www.inrap.fr/archeologie-et-societe-les-archeocapsules-13968 , 30 octobre 2018
Repenser le musée à l’aune de l’archéologie contemporaine, https://www.icom-musees.fr/actualites/repenser-le-musee-laune-de-larcheologie-contemporaine , 19 février 2019
(Image de couverture © Sylvie Puech.)

Application augmentée, défi relevé
Avec 4 millions de visiteurs par an, difficile de profiter comme il se doit de l’intérieur de la cathédrale de Strasbourg. Mais l’équipe du projet « le Défi des bâtisseurs » a pensé à tout en redéfinissant le principe même de la visite, grâce à une application mobile gratuite disponible sur l’Appstore et Google Play qui vous fera découvrir les chefs-d’œuvre gothiques de la vallée du Rhin, avec les cathédrales d’Ulm et de Fribourg comme points de chute remarquables. Cet outil est intégré à un projet transmédia global, comprenant un film en 3D et un web-documentaire toujours autour du thème de la cathédrale et de ses bâtisseurs.
 © Inventive Studio
© Inventive Studio
La ville de Strasbourg est la première à bénéficier, de ce qui est la première version de l’application. Deux langues sont actuellement disponibles au téléchargement, le français et l’allemand, bientôt enrichi d’une version anglaise. La technologie développée intègre QR code et tag NFC disséminés dans et aux alentours de la cathédrale, proposant ainsi divers points de vue sur l’édifice. Ces différents points d’intérêts, une vingtaine en tout, permettent de débloquer des contenus très variés. Nous avons par exemple des vidéos, issues du film qui a été tourné sur la cathédrale dans le cadre de ce projet, des zooms sur des détails à peine discernables à l’œil nu grâce à la modélisation 3D de l’édifice, ainsi que des mini-jeux et des challenges liés au web-documentaire, autre média intégré à cette expérience globale. C’est grâce à cette enveloppe fictionnelle et ludique que l’utilisateur s’approprie facilement les informations historiques. Cette application constitue donc un outil parfait pour devenir incollable sur la cathédrale de Strasbourg. Car la diversité des éléments proposés ne nous donne pas le temps de nous ennuyer une seconde. Nos yeux sont captivés par la réalité augmentée qui nous emmène des différentes places autour de la cathédrale, jusqu’aux salles du Musée de l’Œuvre Notre Dame.
 © Inventive Studio
© Inventive Studio
Cette utilisation des nouvelles technologies rajeunit l’image de l’édifice et plus globalement de la ville. L’application est clairement destinée à un public jeune, adepte des nouvelles technologies, visitant ou habitant Strasbourg. A nous la vie de gargouille et de bâtisseur, on nous invite d’ailleurs à poursuivre cette dernière chez soi par le biais du web-documentaire, où il nous est proposé à l’aide d’experts de construire une deuxième tour à la cathédrale. Grace à la réalité augmentée, vous pourrez ensuite retourner sur place pour visualiser votre création, ainsi que celle des autres utilisateurs sur votre écran. Si vous êtes comme moi, émerveillée du résultat, vous avez la possibilité de voter pour votre tour préférée et de la partager sur les différents réseaux sociaux.
Au final, nous avons une réalisation soignée et convaincante malgré les manques affichés par la première version. En effet, comme souligné précédemment, la version anglaise n’est pas encore disponible. De même pour les liens avec les autres lieux remarquables tel Fribourg, qui sont pour le moment bien moins explorés que ceux avec les autres média de ce dispositif d’un nouveau genre. Mais des mises à jour sont d’or et déjà prévues pour combler ces manques. En attendant rendez-vous à Strasbourg pour cette visite augmentée.
Anaïs K.
Au Musée de Flandre de Cassel, « cette oeuvre est à toucher ».
Situé sur la Grand Place de Cassel dans le département du Nord et à environ cinquante kilomètres au nord est de Lille et dix kilomètres au nord de Hazebrouck, ce musée que l’on pourrait qualifier de « Beaux-arts », propose des médiations tactiles originales et plutôt novatrices. Il prend place au sein de l’Hôtel de la Noble-Cour (XVIème siècle) classé monument historique depuis1910 et entièrement rénové. Ce même monument fût le théâtre en 1964 de l’inauguration d’un musée d’art, d’histoire et du Folklore. En le rachetant en1997, le département en aura la tutelle et le chantier du musée de Flandre ne s’ouvre qu’en 2008 après dix ans de fermeture. Projet muséographique moderne et unique en Europe, la thématique s’inscrit dans le territoire et sa priorité constitue la mise à jour de l’identité culturelle et artistique de la Flandre en valorisant sa richesse à travers les âges. Les collections présentées initient un dialogue entre les oeuvres dites « classiques », ethnographiques et contemporaines.
On note immanquablement un objectif d’accessibilité à un large public. Fonctionnel pour les personnes à mobilité réduite, ce musée présente des médiations et animations diverses pour optimiser l’accès à la compréhension des œuvres : outils multimédias, panneaux explicatifs, visites guidées adaptées aux publics (visites en LSF, pour les enfants…), ateliers divers, attention particulière donnée aux groupes et bien d’autres. Le musée de Flandre accorde en outre un soin particulier en faveur des personnes déficientes visuelles ; c’est notamment la raison pour laquelle ont été crées ces maquettes tactiles qui permettent de surcroît de donner vie à ses collections. Ces publics spécifiques sont bien pris en compte et impliqués. Le parcours muséographique est partagé en quatre thématiques ambivalentes «Soumission et Colère », « Entre Terre et Ciel », « Mesure et Démesure » et «Ostentation et Dérision » et est enrichi d’une maquette tactile par thème permettant une approche sensorielle du contenu de l’exposition permanente.
"Carnaval de Cassel" d'Alexis Bafcop – 1876
© Artesens, association dont le « but est d’offrir un éveil à l’Art par le biais des sens », a réalisé les maquettes tactiles de l’exposition permanente
Ces maquettes représentent une adaptation en 3D et reliefs d’œuvres phares au sein des thématiques dans lesquelles elles sont disposées ainsi que des cartels qui les accompagnent. Ces derniers sont constitués d’une apposition en transparence d’un texte en braille sur le texte classique, ce qui est pertinent pour des publics souvent non pris en compte. Leur sens du toucher est sollicité par le relief et la description ; l’imagination opérant, d’autres images peuvent naître.
Pour les deux premières maquettes du parcours, on peut parler d’une traduction sensorielle de l’image picturale et de support de délectation esthétique de quelque visiteur. Présenté différemment, l’art est perçu autrement et de façon inhabituelle. De fait, des publics plus « secondaires » peuvent également utiliser ces maquettes. Par exemple, toucher un expôt présent dans un musée s’assimile à l’élan naturel de l’enfant. Je vis d’ailleurs un enfant, sourire aux lèvres, prononcer un « je peux toucher ? » adressé à sa mère les yeux pétillants : les doigts s’affairaient déjà à toucher cette maquette simultanément au son produit. Ainsi il est possible que le jeune public soit d’entrée capté par une maquette tactile car elle peut donner l’occasion de s’approprier ce qu’il peut considérer comme un jeu, alors même qui lui est transmis un certain savoir. Et même si son interprétation est approximative, l’enfant est accompagné dans sa dynamique et sa soif de découverte du monde qui passe principalement par l’usage des yeux et des mains. Un musée communément boudé par l’enfant est devenu vivant et attractif, alors que sans médiation particulière la visite revêtirait un aspect contraignant par l’attention et la concentration nécessaire à l’observation des œuvres (si différent de son environnement habituel).
La troisième maquette présente un aspect plus didactique au regard de l’histoire de la pièce où elle se situe : cette ancienne cuisine est baptisée « Gourmandise » dans le parcours de visite. Celle-ci est plutôt un « meuble tactile » avec plusieurs tiroirs à ouvrir de haut en bas et séparé en deux : la gauche éclairant sur la gastronomie « chez les riches », la droite celle « chez les pauvres ». Le tiroir le plus bas présente deux maquettes en relief illustrant deux scènes de repas. La lecture du cartel incite à découvrir successivement les tiroirs afin de toucher et décrypter les différents objets : porcelaine, fruits de mer, légumes… Le toucher est confronté à l’aspect des matières : lisse, rugueux, chaud, froid etc., ce qui participe à l’apprentissage des différentes perceptions. Cette maquette tactile ramène à la réalité en réajustant la thématique abordée à la réalité du quotidien. Enfin, la dernière apporte et révèle une plus-value du discours véhiculé par le musée. C’est ainsi que celle représentée par la photographie ci-dessus invite plutôt les visiteurs à s’imprégner des us et coutumes flamands : la tradition spécifique, le carnaval et de surcroît celui de Cassel. Cette création comportant des pièces mobiles évoque l’ambiance et l’énergie de la fête avec la foule, les danseurs et l’identification d’un géant (Reuze Papa), élément reconnu du patrimoine cassellois. L’esprit du carnaval transparaît d’une manière innovante. Le nouvel élan du musée, incarné par la diffusion de ce type de médiation, met à jour un renouveau dans l’interaction avec l’art et les oeuvres, ouvrant alors d’autres perspectives d’expériences émotionnelles et/ou sensorielles.
A quand la généralisation de ces médiations dans les musées « traditionnels » pour démocratiser et favoriser l’accessibilité à l’art et principalement aux Beaux Arts, au plus grand nombre ?
Lucie Vallade

Au musée j’ai touché … !
Les célébrités … Un milieu qui fait tant rêver. Autant de strass et de paillettes, que vous pouvez admirer au Musée Grévin à Paris … Stop ! Si on reformulait cette introduction pour les personnes non ou mal voyantes ça donnerait plutôt ça : Les célébrités … Un milieu qui fait tant rêver. Autant de strass et de paillettes, que vous pouvez TOUCHER au Musée Grévin à Paris.

©Buisson Alizée
Et si on visitait le musée Grévin ?
« Toucher », un mot qui fait peur lorsqu’il est associé au monde muséal ! Certes des questions de sécurité et de conservation sont sous-jacentes mais un non ou mal voyant n’aurait-il pas le droit de visiter un musée ?
Dans le cas du musée Grévin, rien n’indique sur le site internet de l’institution si ce type de public est pris en compte ou non. Il faut donc téléphoner ou se rendre sur place afin d’être informé que ce musée est accessible pour ces personnes. Ce renseignement pris, la visite peut commencer !
Et si on écoutait ?
Avant d’accéder aux statues, le visiteur est invité à rentrer dans « Le palais du mirage » pour un son et lumière invitant au voyage et à la rêverie ! Bien que les personnes non ou mal voyantes ne puissent pas profiter pleinement du spectacle, ils peuvent écouter la musique et par celle-ci s’immerger dans les diverses ambiances proposées. En effet, la musique qui est assez forte et prenante comporte des bruits d’animaux permettant de comprendre et d’imaginer les divers paysages dépeints. Ainsi, l’absence de l’un des cinq sens n’est pas gênant pour vivre cette expérience, ce spectacle de son et lumière.

©Buisson Alizée
Et si on touchait ?
Par la suite, les salles présentant les sculptures de cire dans un décor ne semblaient pas, à priori, être un outil de médiation pour ce public spécifique. Cependant, ces personnes sont autorisées à toucher les sculptures. Ainsi, une personne ayant eu cet handicap au cours de sa vie, qui a donc déjà pu visualiser les célébrités, peut grâce au toucher deviner les personnages représentés. En revanche, on pourrait se demander l’utilité de ce sens si la personne n’a jamais vu les célébrités ? Alors, le but de la visite du musée Grévin serait de pouvoir modéliser, pouvoir poser des courbes sur une voix, un nom. On peut noter une limite à cette ponctuelle autorisation car les statues de cire restent assez fragiles. Les mal ou non voyants ne doivent pas toucher les yeux qui sont de véritables prothèses oculaires et doivent faire attention au niveau du visage car ce dernier est maquillé à la peinture à l’huile. Le verbe adéquat serait donc plus « effleurer » que « toucher ». De plus, certaines sculptures sont inaccessibles puisqu’elles sont mises à l’écart du visiteur par un cordon.
Et si on sentait ?
Outre les statues, le toucher et l’odorat sont mis en avant dans la partie explicative sur la réalisation des statues de cire. En effet, des mains faites de diverses matières à reconnaitre sont présentées, avec au dessus un bouton à actionner afin de sentir l’odeur de la cire chaude. De même, des rouleaux composés de différents tissus peuvent être palpés. Cependant, les réponses ou même les explications ne sont pas écrites en braille tout comme les cartels associés aux statues de cire, ou encore les cartels indiquant les accessoires que le visiteur peut utiliser. Par ailleurs, de nombreux objets sont présentés sous vitrine et certaines vidéos sont projetées sans son ce qui réduit considérablement l’accès aux informations pour ce type de public.

©Buisson Alizée
Malgré quelques outils de médiation adaptés aux mal et non voyants, une visite, seul, ne pourrait pas être envisageable ne serait-ce que pour pouvoir suivre le « sens de la visite ». Mais accompagné, le musée Grévin reste une institution accessible à ce handicap et applique la gratuité envers les personnes handicapées.
Alizée Buisson
10 boulevard Montmartre
75009 Paris
Du lundi au vendredi : 10h00 – 18h30
Samedis et dimanches : 10h00 – 19h00

Ballade en MEP virtuelle
La Maison Européenne de la Photographie inaugurait au printemps dernier son tout nouvel espace d’expression : une plateforme virtuelle mettant à l’honneur l’image dématérialisée.
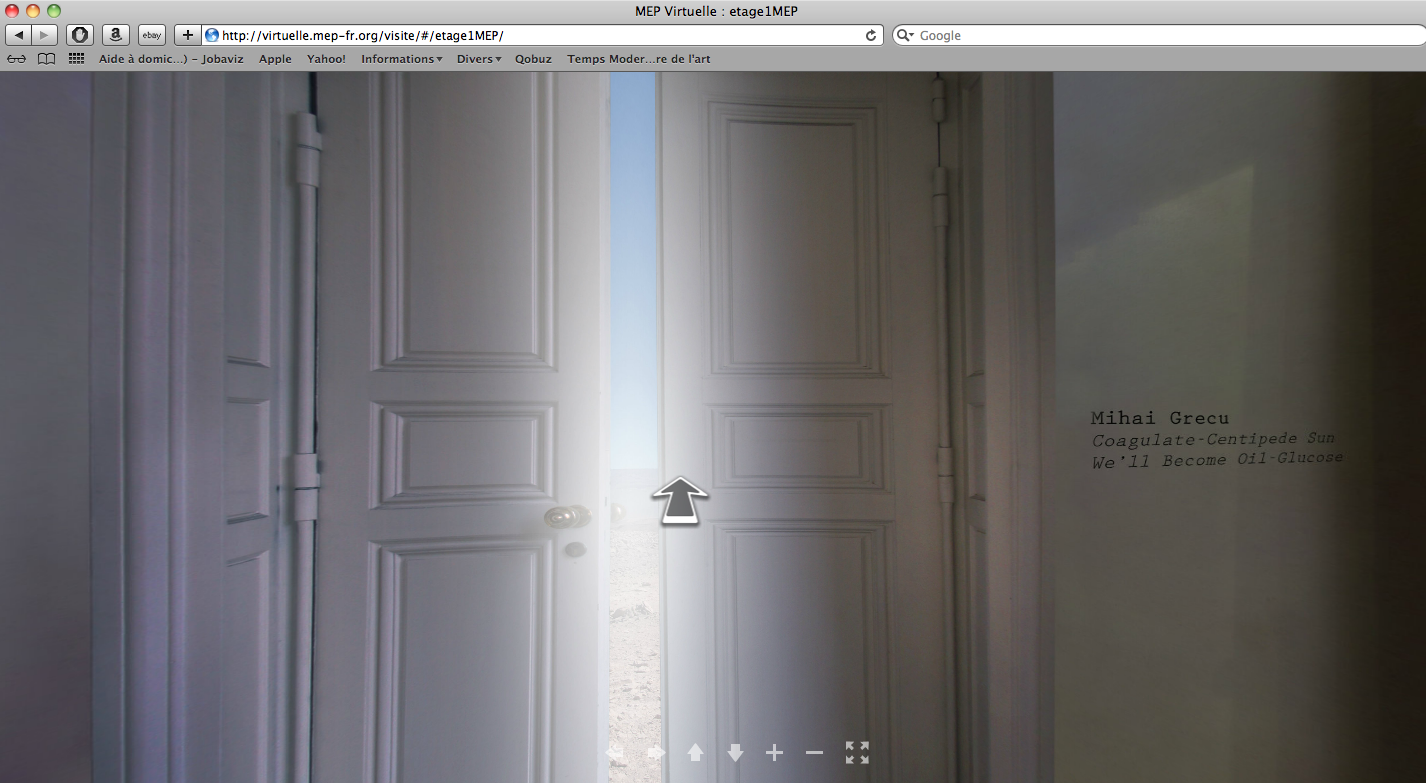
Entrée de l'exposition dédiée à Mihai Grecu © mep virtuelle
Le dispositif modélise en 3 dimensions le bâtiment de la MEP rue de Fourcy à Paris et y « introduit » une programmation parallèle. Les propositions portées sur le site web ne font pas l’objet d’une mise en exposition dans les murs. Et pour cause, le projet privilégie le support virtuel pour explorer au maximum les potentialités de l’image numérique.
La page d’accueil nous invite à entrer dans l’exposition de notre choix. A ce jour, la MEP dédie son espace virtuel à trois artistes internationaux : Atsunobu Kohira, Dionisio Gonzalez et Mihai Grecu. Avantde démarrer sa visite, l’internaute peut cliquer sur le nom de l’artiste exposé pour accéder à une présentation écrite de son travail.
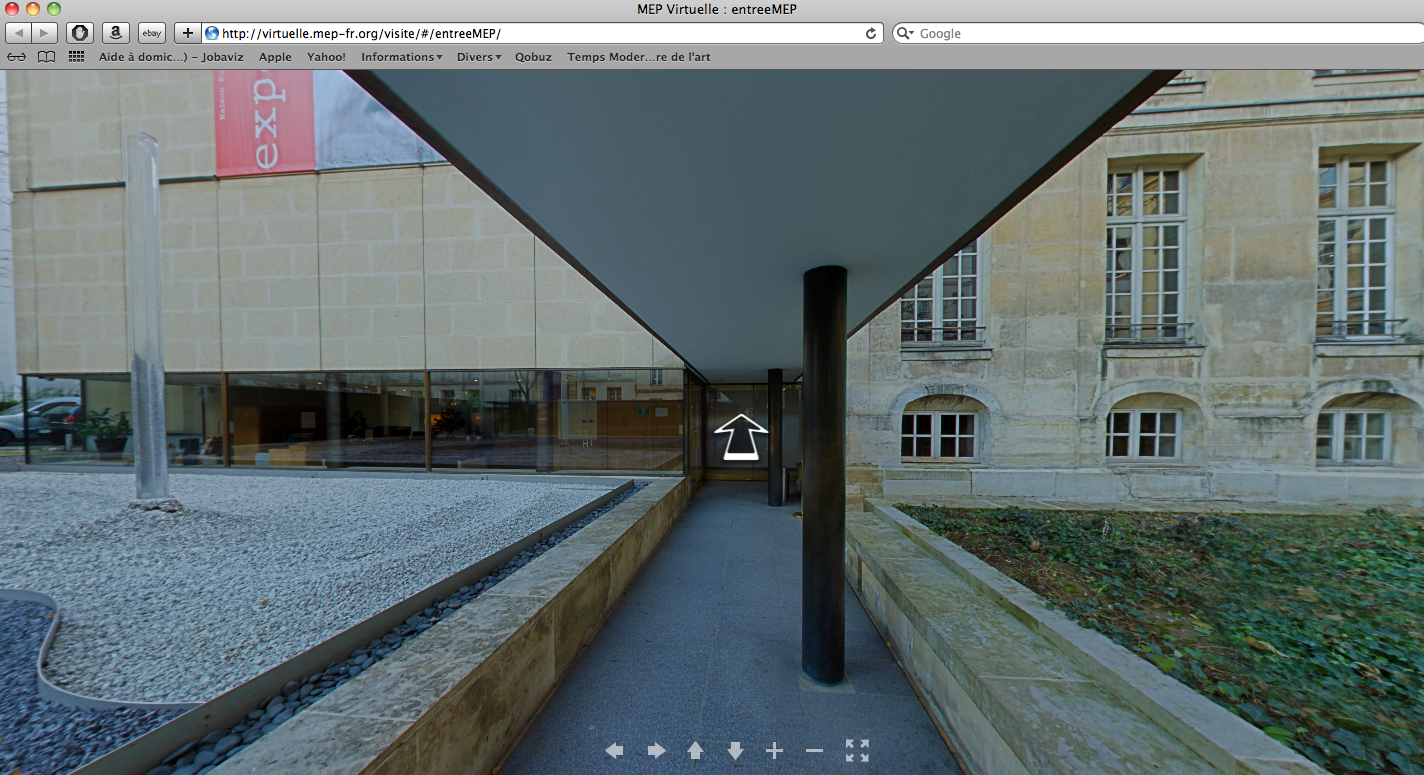
Entrée principale © mep virtuelle

Escalier © mep virtuelle
Après avoir sélectionné le menu « entrez dans l’exposition » l’internaute est dirigé vers une nouvelle page web. Il découvre la façade extérieure du musée en 3D. Grâce à un système de fléchage il traverse le hall, monte l’escalier principal et atteint finalement la porte d’entrée de l’exposition, légèrement entrouverte. Le sens porté par cette introduction n'est pas anodin : la direction du musée cherche à inscrire la révolution numérique en ses lieux. Point négatif, l’internaute ne peut passer cette introduction s’il le désire. Il est contraint de répéter ce trajet pour accéder à chaque exposition proposée sur le site. Ce système rend la navigation peu fluide et souligne, sans le vouloir, une certaine fixité du dispositif. Aussi étrange que cela puisse paraître, le visiteur est obligé de quitter le musée virtuel et d’y entrer à nouveau pour visiter une seconde exposition.
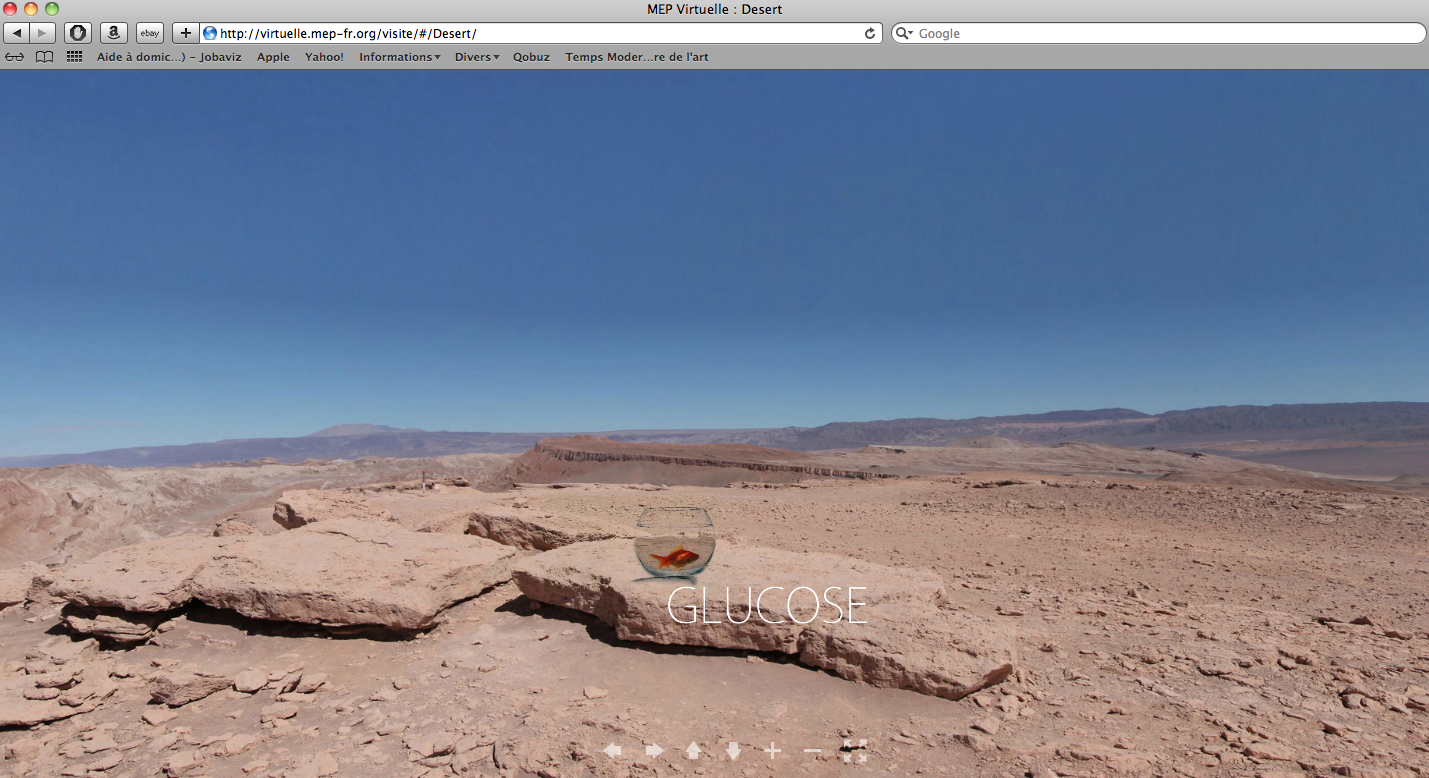
Exposition dédiée à Mihai Grecu © mep virtuelle
La première exposition programmée sur le site de la MEP virtuelle [consacrée à l’artiste roumain Muhai Grecu] cherche à transformer l’espace muséal traditionnel. Le décalage entre l’entrée du musée, son grand escalier couvert de velours rouge et l’univers composé derrière la porte de l’exposition surprend le visiteur. Les vidéos de Muhai Grecu sont exposéesdans un désert modélisé en 3D. Plusieurs images-symboles ponctuent l'étendue de sable : un poisson dans son bocal, une épaisse fumée, la silhouette d'un homme, un soleil de plomb. Chaque image correspond à une création vidéo. En un clic, l'internaute est redirigé sur le site de l'artiste où il pourra consulter le fichier en streaming.
On peut lire dans cette proposition la volonté de créer un espace immersif. La fonction 360° happe l’internaute et agît comme dispositif de médiation en le plongeant dans l’univers du vidéaste. Avec ce désert en 3D le travail d’animation de Muhai Grecu est aussi valorisé que ses créations vidéo.

Exposition dédiée à Denisio Gonzalez © mep virtuelle
Dans un tout autre registre, la présentation des œuvres de Denisio Gonzalez fait l'objet d'un accrochage dans une salle d'exposition 3D. En portant ce projet, le commissaire transpose à l’expérience d’une visite d’exposition la relation que nous entretenons quotidiennement avec les images présentes sur nos supports numériques. L'internaute parcourt l'espace virtuel en ayant la possibilité d’opérer un puissant zoom sur chaque photographie en haute définition. Son rapport à l’image en est modifié : l’effet loupe trouble sa perception des dimensions originelles de l’œuvre mais lui permet d’en saisir les moindres détails.
Ces deux expositions monographiques s’appuient sur les potentialités du numérique pour valoriser le travail vidéo et photographique des artistes présentés. Dans les deux cas de figure, elles parviennent à plonger l’internaute dans les œuvres exposées grâce aux dispositifs qu’elles développent (fonction 360°, zoom puissant). Selon moi, si elles nous permettent bien de découvrir des artistes, elles nous privent d’une médiation écrite qui nous donnerait la chance d’associer au plaisir de la découverte une appropriation plus importante du contenu des œuvres.
Il nous faudrait enfin ajouter qu'en lançant cet espace d'exposition virtuel la MEP élargit la définition de son public à des visiteurs non présents physiquement dans l'institution. En cela, elle répond à la première mission d'un musée : diffuser des contenus - et conçoit une médiation numérique spécifique autour de propositions artistiques. Élément intéressant, chaque nouvelle programmation vient enrichir le fond "permanent" d'expositions virtuelles, constituant un espace de consultation libre. Si le dispositif démocratise l'œuvre de certains artistes et interroge une redéfinition de notre relation aux images, il ne peut remplacer les interactions qui découlent d'une mise en exposition réelle et les expériences qu'elle suscite. D'où l'importance qu'il reste complémentaire aux expositions in situ.
N.D.
Pour en savoir plus : - Cliquez ici pour découvrir les expositions !
#nouvellestechnologies
#musées
#photographie
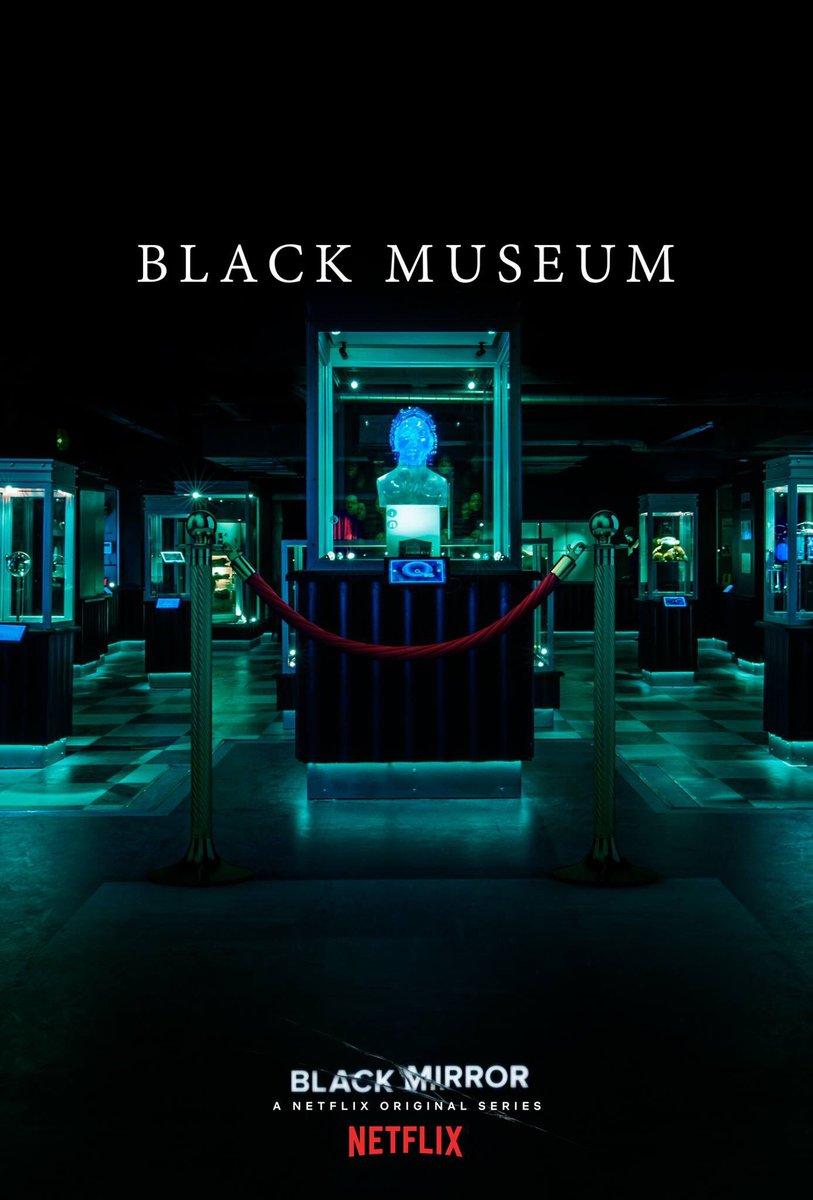
Black Museum : musée imaginaire ou musée du XXIe siècle ?
Les épisodes se suivent dans Black Mirror mais ne se ressemblent pas. À chacun son récit, son ambiance et ses personnages. Les histoires, indépendantes les unes des autres, ont pourtant un point commun: elles anticipent une société dystopique liée à l'usage des nouvelles technologies. Black Mirror questionne l'influence de ces innovations sur l'espèce humaine. Intelligence artificielle, addiction à la culture du « like », réalité virtuelle ou encore robotisation, la série aborde des thèmes d'aujourd'hui et de demain. Le futur dépeint, parfois très proche de la réalité, ne laisse pas indifférent. Souvent noirs et satiriques, les épisodes qui entrent en résonance avec notre époque actuelle encouragent l'auditoire à réfléchir.
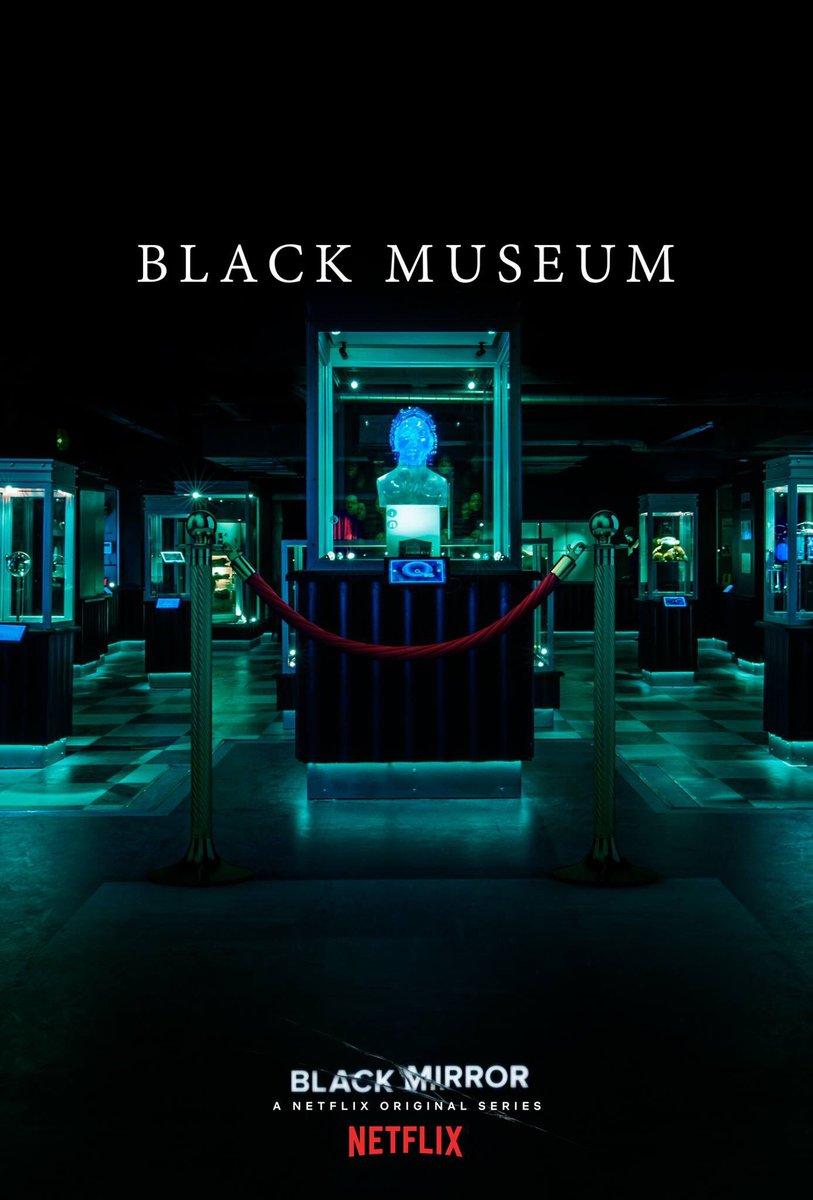
Black museum, S4E06 © Twitter BlackMirror
Unique en son genre, la série anglaise a su très vite me conquérir. C'est avec joie et impatience que je découvrais en ce début d'année les six nouveaux épisodes. Le dernier a retenu toute mon attention, non pas pour ses qualités de réalisation ou de jeux d'acteurs, mais parce que l'action se déroule dans un musée quelque peu déroutant: le musée du crime ! Un choix de scénario qui m'invite à faire le parallèle entre cette fiction et les musées existants.
[Attention spoiler] L'épisode commence. Nous découvrons une jeune fille à bord de son auto dans un décor qui évoque assurément les États-Unis. Nish s'arrête aux abord d'une route non loin de laquelle se trouve Black Museum. À première vue nous nous demandons qu'est-ce qu'un musée peut bien faire là, dans un endroit si reculé et désertique. Bâtiment sombre, lieu dépeuplé, l'extérieur n'est que très peu accueillant et le lieu semble presque abandonné. Pourtant l'enseigne visible de loin, blanc sur fond rouge, nous rappelle qu'il s'agit d'un musée. Nish, après avoir attendu devant une porte close est accueillie par Rolo Haynes, le conservateur et propriétaire des lieux. Débute alors la visite de la jeune fille accompagnée de ce dernier qui prend alors le rôle de guide-médiateur. À l'image de l'extérieur, l'intérieur est vide : aucun visiteur ni personnel. Nous découvrons avec Nish un lieu d'exposition qui au premier coup d’œil ne comporte rien de surprenant. Sur les murs sombres quelques vidéos, galerie de ''masques'', etc. Des objets, mis en valeur par l'éclairage, sont aussi présentés sous des vitrines de verre avec un cartel numérique. La surprise réside dans le fait qu'il s'agisse d'artefacts criminologiques authentiques.

Black Museum © Black Mirror

Black Museum © Black Mirror
Le goût pour le morbide
Black Museum est un lieu qui regorge d'histoires sordides peu à peu révélées par le conservateur. Baignoire et tablette numériques ensanglantées, machines étranges, vidéos de détenus, rien d'étonnant quand on sait qu'il s'agit du musée du crime. Ce lieu semble bien plus réel qu'il ne l'est. The Crime Museum, anciennement nommé The Black Museum, existe lui bel et bien à Londres. Il abrite les pièces à conviction des crimes (armes, masques mortuaires, articles...) qui ont agités l'Angleterre. Mais le musée est seulement accessible par les membres de la police dans le cadre de conférences. Si le musée londonien n'est pas ouvert au public, le musée fictif de la série nous invite à nous interroger sur l’existence et la légitimité de certains musées : peut-on et doit-on tout exposer ?
A priori le musée du crime de Black Mirror est ouvert à tout public et le conservateur n'a aucun scrupule à exposer des objets aux lourds passés. Rolo révèle par exemple l'histoire d'un casque révolutionnaire. L'appareil, apposé sur la tête des patients, permettait aux médecins de ressentir et d'identifier la douleur de celui-ci. L'un des professionnels devenu très vite accro à la souffrance finit par poignarder un sans-abri pour sa satisfaction personnelle.
Il existe, en France et dans d'autres pays, des musées pouvant s'apparenter à celui imaginé. On trouve des musées de la torture dans différentes villes comme à Carcasonne, Amsterdam et San Gimignano en Italie. Pinces à tétons, vierges de fer, cage en fer et siège à piquants. Tant d'objets qu'on aurait préféré ne pas connaître. Plus effrayant encore, le Musée de la mort à Hollywood. Des photographies de serial killers, de têtes décapitées et de bébés morts, ainsi que des films d'exécutions y sont exposés. Difficile à y croire tant le propos est douloureux et macabre.
Cette proximité du musée imaginaire de Charlie Brooker avec le monde réel ne laisse pas indifférent. Bien que Black Museum insiste sur l'aspect obscur du lieu avec des pièces sombres et une atmosphère particulièrement lugubre, le spectateur est invité à se questionner sur ce qu'on lui donne à voir.

Objets du Black Museum exposés au Musée de Londres en 2015 © Museum of London
La technologie: pour une expérience plus que réelle
L'affranchissement du réel réside dans l'innovation technologique présentée. Comme en témoigne encore l'épisode Black Museum, Black Mirror anticipe sans cesse les potentielles évolutions techniques. La dernière vitrine présentée par le conservateur propose aux visiteurs une manipulation des plus étonnantes : activer une décharge mortelle à un ancien condamné à mort matérialisé par un hologramme. Sa douleur, ses émotions sont comme réelles puisque la conscience du détenu fut transférée en code informatique. Frisson, compassion puis réflexion. Technologie dans les musées, mais quelles en sont les limites?
Faire vivre une expérience intense et unique aux visiteurs, telle est devenue la devise de certains musées. C'est ainsi qu'ouvre en 2017 un musée-parc d'attraction, Le MM Park, sur le thème de la Seconde Guerre mondiale près de Strasbourg. Tir à la carabine, simulateurs et parcours militaire créent la surprise et l'amusement. Mais la technologie semble être la solution du futur, déjà adoptée par beaucoup de musées. Le virtuel par exemple devient peu à peu le meilleur allier du réel et entraîne les visiteurs au cœur d'une expérience sensorielle et immersive. La réalité virtuelle, qui ne cesse de se développer, fait bien évidemment écho à Black Museum. En décembre 2017, le Muséum national d'Histoire naturelle de Paris s'est d'ailleurs doté d'un cabinet de réalité virtuelle permanent. Est alors proposé aux visiteurs un voyage fictif au cœur de l'évolution. L'expérience est totale et immersive, à tel point qu'on en oublierai la nature du projet. Si la technologie se développe et s'impose peu à peu pour être utilisée à bon escient dans les musées, Black Musuem nous en rappelle les dérives et les méfaits.

Cabinet de réalité virtuelle, MNHN © Olaf Avenati, Charles Renault
Le génie de la série réside dans cette évocation d'un futur toujours très proche, voir déjà présent. Black Musuem est loin d'être mon favori, mais reste sans aucun doute un des épisodes qui m'a le plus terrifié. D’une brutalité crue mais étonnamment pertinente, cette histoire invite à méditer sur l'Homme et sur nos musées d'aujourd'hui et de demain.
C.V
#BlackMirror
#BlackMuseum
#Netflix
Pour les abonnés : https://www.netflix.com/fr/
Carte blanche à l'impression 3D au Centre Pompidou
On trouve rarement une exposition de ce type dans un musée d’art moderne. Avec Imprimer le monde, le Centre Pompidou adopte une approche semblable à celle des centres d’interprétation. Ce n’est pas tant la proposition d’une exposition thématique - rentrée depuis longtemps dans les habitudes du musée - qui surprend, mais la formalisation d’une réflexion sur un sujet qui dépasse les questions plastiques et politiques pour toucher également les domaines techniques, industriels et scientifiques.
L’exposition présente des objets partiellement ou intégralement conçus et fabriqués grâce aux technologies désignées sous le nom générique d’impression 3D. Lorsque l’on pénètre dans les lieux, leur variété est saisissante.
Stranger Visions, Heather Dewey, 2012 ©ND
Gestation numérique, fabrication automatisée
Les concepteurs donnent dès les premiers mètres la définition de l’impression 3D, également désignée sous le terme de « fabrication additive » et se proposent de retracer son « archéologie ». Une grande frise chronologique, ponctuée d’objets sous vitrine, replace cette invention dans une histoire beaucoup plus ancienne. Aux origines, deux inventions de la seconde moitié du XIXe siècle : la photogravure et les cartes topographiques, qui donnent une vision du relief par « couches ».
Le point commun réunissant ces artefacts est la conception assistée par ordinateur, la modélisation 3D, qui permet ensuite de configurer une machine, « l’imprimante » pour fabriquer, par traçage, dans l’espace, sous forme d’aller-retour, les dépôts de matière, composant finalement le résultat solide. Derrière ce terme, en filigrane, se retrouve donc l’image du robot et de l’intelligence artificielle, mis à contribution d’une production sérielle.
L’exposition réinterroge le statut de l’objet artisanal et artistique. Elle montre le travail des designers et des artisans qui allient la maîtrise de compétences scientifiques (codage, création d’algorithme) ou d’ingénierie (mise au point des machines prenant en charge la fabrication) à leur démarche de plasticien. La conséquence directe de ces pratiques est l’avènement d’œuvres ou d’objets artisanaux reproductibles, sans que le concours de la main humaine ne soit nécessaire à l’étape de fabrication. L’objet, fondé sur le principe de la reproductibilité, acquiert alors une dimension industrielle.
Open source et démarche collaborative
Passé par l’étape de la programmation numérique, le concepteur accouche d’un mode d’emploi en même temps que la machine réalise physiquement l’objet. Conséquence : la réplication de l’objet est possible à partir d’un fichier source. Héritière des idées de « démocratie technique », diffusés autour de la création de fablabs, hackerspaces et markerspace, l’impression 3D s’inscrit dans une dynamique favorisant l’accès en open source des données, autrement dit, la reproduction de l’objet et sa modification par d’autres concepteurs. L’exposition questionne également les usages pernicieux qui peuvent être faits de ce modèle de partage, et présente, par exemple, la première arme imprimée en 3D, dont le fichier numérique source fut diffusé et téléchargé près de 100 000 fois en 2013 avant son interdiction par l’Etat américain.
Outre la libre circulation des fichiers destinés à l’impression, l’exposition montre à plusieurs reprises des situations de créations collectives autour de projets de fabrication additive. Plusieurs objets présentés sont accompagnés d’une vidéo retraçant la genèse et les principales étapes de leur élaboration. Par exemple, on suit la collaboration de graphistes, de développeurs numériques et d’imprimeurs dans leur entreprise de conception et de fabrication d’une typographie produite en résine par impression 3D, utilisées dans une fonte traditionnelle.
A23D,3D-printed letterpress Font, New North Press, A2-Type et Chalk Studios, 2014, © N.D.
Vulgarisation ardue
Si elle montre la fantastique palette des matériaux (résines extrêmement légères, céramique d’argile, titane…), des textures et des tailles des objets imprimés en 3D, on regrette cependant que l’exposition ne lève davantage le mystère derrière la fabrication technique de ces objets.
GrowthTable Titanium, 2016, Mathias Bengtsson, © N.D.
Shapes ofSweden for Volvo, 2015, Lilian van Daal, © N.D.
Bien que les vidéos associées aux objets présentent les étapes de leur élaboration, les techniques et les technologies restent d’une certaine manière abstraites, puisqu’elles n’ont pas été soumises à l’épreuve de l’expérimentation par le visiteur. C’est certainement la limite de cette exposition. La présence de dispositifs d’interprétation -multimédias, manipulations - en complément des audiovisuels, aurait été appréciable pour tenter d’aborder concrètement les dimensions techniques de l’impression 3D : les questions d’algorithme, la gestion et la transformation de la matière première dans la machine, les spécificités techniques des technologies dont les noms restent énigmatiques (stéréolithographie, dépôt de matière fondue, filtrage sélectif par laser, laminage par dépôt sélectif…).
Par ailleurs, si elle soulève des questions sociétales et éthiques en évoquant la démarche de certains artistes (par exemple, la reproduction de monuments détruits en Syrie comme « réparation » de l’histoire ou la recréation de visages à partir de matériaux génétiques collectés dans des lieux publics pour interroger la « surveillance génétique »), l’exposition n’approfondit pas les enjeux scientifiques et évoque certains résultats sans les contextualiser ou les mettre en perspective. Elle expose ainsi des prothèses médicales et évoque la création du premier vaisseau sanguin imprimé en 3D, sans questionner la reproduction d’éléments bio-artificiels comme substituts du vivant, laissant le visiteur perplexe sur la faisabilité du processus et les enjeux éthique des usages.
Work in progress
Cette exposition fait entrer la pratique de l’impression 3D, pour ceux qui la découvrent ou la redécouvrent, dans une histoire déjà en marche. Elle provoque en cela une impression de vertige. Où étais-je pendant que designers, scientifiques, architectes, plasticiens, typographes, s’appropriaient un mode de conception et de fabrication tout droit sorti d’un roman de Philippe K. Dick ?
Dans L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau, le neurologue Oliver Sacks, dépeint le cas clinique d’un jeune homme, frappé de troubles de mémoire terribles, resté « bloqué » dans les années 1940 : lorsque le médecin lui montre une image de la terre vue depuis la lune, il ne peut y croire et lui répond : « vous plaisantez docteur ! Il aurait fallu apporter un appareil photo là-haut ! ». La nouvelle exposition du centre Pompidou donne le sentiment d’être dans la peau de ce patient : si l’on se pensait confronté à un avenir à peine imaginable, il faut accepter que celui-ci est déjà en cours !
N.D.
#CentrePompidou
#nouvellestechnologies
#design
Imprimer le monde, Galerie 4 Centre Pompidou,
5 mars 2017-19 juin 2017
Le site de l’exposition https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cEo9Br4/rAo9oKd
Ces monuments en pixel
Depuis plusieurs années, il n’est plus rare de voir associés patrimoine et jeu, musée et virtuel, tentant ainsi d’attirer les plus jeunes avec l'un de leur loisir. C’est dans ce principe qu’est né le projet “Hericraft v0.1 – Loire Valley Build Battle” qui invite les joueurs à créer et imaginer les châteaux-musées du Centre-Val de Loire sur le jeu vidéo Minecraft.
https://www.hericraft.fr/
Intéresser les jeunes au musée et au patrimoine est un enjeu qui ne date pas d’hier. Entre les murs des institutions, de nombreuses institutions continuent avec leurs thématiques, leurs médiations et leurs événements d’attirer les visiteurs. Une exposition n’est pas qu’un recueil de connaissances, c’est un lieu où on partage du divertissement et du plaisir pour s’enrichir en famille ou entre amis.
Depuis plusieurs années, il n’est plus rare de voir associés patrimoine et jeu, musée et virtuel, tentant ainsi d’attirer les plus jeunes en liant leurs loisirs à cet autre loisir. S’adaptant à cette cible, dans l’air du temps, le musée, en retour, se modernise. Il est présent sur les réseaux sociaux, propose des activités (escape game, challenge) ou développe et imagine de nouvelles expositions et médiations en lien avec les jeux. En 2025, l’Historial de la Grande Guerre de Péronne, en partenariat avec le Master Expographie Muséographie Écoresponsable d’Arras, proposait avec “Guerre en jeux, la vision de la guerre dans l’univers ludique” d’explorer l’univers complexe et fascinant des jeux et jouets de guerre, y compris les jeux vidéos. À Tourcoing, jusqu’au 8 février 2026, en partenariat avec le studio Ubisoft et l'Institut du monde arabe de Paris, l’Institut du monde arabe de la ville du Nord accueille l’exposition “Bagdad, Redécouvrir Madinat Al-Salam avec Assassin’s Creed Mirage” présentant des collections d’époque abbasside mises en scène dans les décors imaginés par le jeu. En 2023, le 8e Open Museum du Palais des Beaux-Arts de Lille, avec les studios Ankama et Spiders, non sans devenir une vitrine pour ces sociétés, était consacré au jeu vidéo avec un parcours invitant à une immersion dans l’univers du jeu vidéo, une plongée dans les coulisses de la création artistique et une réflexion autour de l’écosystème du milieu du jeu vidéo et sur la manière dont il reflète l’histoire et met en perspective notre réalité.
Dans un autre univers, des expositions sur l’univers des Lego voient le jour grâce à des reproductions d’œuvres célèbres : à EuraTechnologies de Lille, en décembre 2025, l’exposition internationale The Art Of The Brick propose une série de sculptures et des versions imaginées de certains chefs-d’œuvre artistiques. L’Abbaye de Saint Riquier revient avec son exposition De la Baie à l’océan - L’odyssée du Nautilus en briques Lego sur l’histoire de la Baie de Somme et l'œuvre de Jules Verne.
Pendant la COVID-19 et le confinement avec le jeu Animal Crossing : New Horizons où les musées s’installaient et présentaient leurs collections. Aujourd’hui encore, les stratégies continuent d’intégrer l’un des loisirs les plus importants, notamment chez les jeunes, à commencer par Minecraft.
Qu’est-ce que Minecraft ?
Minecraft est un jeu vidéo populaire auprès des générations de joueurs depuis sa création en 2011. Développé par le Suédois Markus Persson, alias Notch, puis par la société Mojang Studios et Xbox Game Studios, ce jeu de type aventure “bac à sable” connaît rapidement le succès. Dans une progression stable et constante depuis sa sortie, en octobre 2023, il est le premier jeu vidéo à passer la barre des 300 millions d’exemplaires vendus, confortant sa place de jeu vidéo le plus vendu de tous les temps atteint en 2016.
Pour y jouer, rien de plus simple. Minecraft ressemble au jeu Lego en mode virtuel. L’histoire plonge le joueur dans un monde créé de manière procédurale, c’est-à-dire généré aléatoirement, composé de “voxels” (cubes de pixels) représentant différents matériaux tels que le fer, l’eau, la terre, etc. À l’instar d’une histoire dont il est le héros, dans un monde forestier, caverneux, de montagnes avec des villages et peuplés d’animaux et monstres en tout genre, il peut modifier ce monde à sa volonté, soit pour survivre, soit pour créer.
Hericraft v0.1 – Loire Valley Build Battle : reproduire les châteaux-musées.
Screenshot Hericraft.fr
C’est dans ce principe qu’est né le projet “Hericraft v0.1 – Loire Valley Build Battle” organisé par Pixel Players (un réseau de professionnels du divertissement digital), le streameur Twitch et créateur de contenu Aypierre et Endorah. Ce concours gratuit, avec plus de 2500 € de récompenses à gagner, a été soutenu par la Région Centre-Val de Loire, Orange et Heritage. Les conditions de participation étaient simples : rejoindre le serveur dès le 7 novembre, s’inspirer des châteaux et sites patrimoniaux du Centre-Val de Loire puis soumettre sa création en solo sur une parcelle délimitée avant le 21 décembre.
Le défi : “recréer ou réinventer ces monuments dans Minecraft, avec créativité, respect et imagination. Ce concours gratuit met en lumière la diversité de la région Centre-Val de Loire et l’ingéniosité des builders, dans une rencontre unique entre culture, architecture et jeu vidéo.”
Il répondait à ces questions qui semblent aujourd’hui presque universelles : comment intéresser les plus jeunes au patrimoine, notamment de la région Centre-Val de Loire ? Comment les rendre accessibles à une communauté qui ne peut pas forcément venir sur place ? Et surtout, comment mêler Minecraft et le patrimoine ?
Les participants étaient encouragés à se balader sur Google Maps, à construire et imaginer selon leurs envies, mélangeant ainsi plusieurs châteaux pour en faire des institutions hybrides. Le concours a réuni 260 constructions, totalisant 3 859 heures de jeu et 3 618 349 blocs placés. Sur leurs pages Instagram, des premiers aperçus des constructions du Château de Chambord et du Château d’Azay-le-Rideau ont été publiés, montrant ainsi l’engouement et une réussite pour découvrir ou redécouvrir autrement le patrimoine. D’autres sont visibles sur Instagram avec le #hericraft. Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs enthousiastes n’ont pas hésité à soutenir le projet. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les monuments apparaissent dans Minecraft, du fait des amoureux de construction et du patrimoine.

Screenshot Hericraft.fr
Si Hericraft v0.1 est pour certains encouragé par les gains, dont des pc gamers, ce n’est pas la première fois qu’internet révèle l’intérêt des utilisateurs. La PixelWars du réseau social Reddit, un jeu en ligne qui permet de poser un pixel par un pixel sur une feuille vierge en affrontant des joueurs de tous horizons, avait démontré l’intérêt des joueurs pour le patrimoine français.
Les finalistes du concours seront annoncés début février 2026.
Mathilde Leclercq
Pour aller plus loin :
Site du concours : https://www.hericraft.fr/
Endorah : https://endorah.net/hericraft/
Interview vidéo d’Aypierre : https://www.instagram.com/p/DQ4dnAODKJY/
Twitch apprivoise les musées :
https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2347-twitch-apprivoise-les-musees
#MédiationNumérique #Minecraft #jeuvideo

Cléo 3000, le futur d'une muse
Cette année, notre équipe a eu la chance de participer à Museomix au Musée gallo romain de Lyon-Fourvière. A cette occasion votre reporter a pu interviewer un de leurs outils de médiation, venu du futur : Cléo 3000 !
Crédits : Quentin Chevrier
E.B : Bonjour Cléo, pouvez-vous expliquer à nos lecteurs en quoi consiste Museomix?
Cléo 3000 : Bonjour reporter et lecteurs, Museomix est un collectif de créateurs fous, d'innovateurs lancé en 2011. Réunissant la communauté des professionnels des musées, des acteurs de l'innovation et du numérique, ainsi que des amateurs et passionnés de culture. Museomix propose de créer une nouvelle manière de vivre le musée, en développant, sur trois jours des idées et des prototypes, présentés au public le dernier jour. C'est merveilleux que tout cela se déroule sous nos yeux en ce moment. (ndlr : l'interview a eu lieu durant le Museomix 2012 en octobre 2012)
E.B : C'est vrai que c'est impressionnant de voir tant d'idées et de projets fuser ensemble ! Votre arrivée en découle d'ailleurs ..?
Cléo 3000 : C'est exact, l'équipe de médiation en charge de créer des liens entre les prototypes et avec les visiteurs, a décidé de me faire venir du futur, de 3012. Ainsi je peux dévoiler aux générations qui m'ont précédé l'importance de l'innovation qu'ils vivent aujourd'hui à Lyon et ce que cela créera plus tard, moi par exemple ! Le tout premier robot interactif, intelligent, avec des oreilles !
E.B : Alors, merci à tous les participants, qui vous ont permis d'exister dans un lointain futur. Pouvez-vous nous présenter maintenant votre rôle auprès des visiteurs ?
Cléo 3000 : Je suis leur lien avec les médiateurs, les prototypes et les collections du musée. Il suffit d'appuyer sur un petit bouton pour que je me réveille et que je réponde à vos questions. Je fais en sorte de guider le public, comme Mercure Psychopompe, dieu des romains le faisait avec les âmes et les voyageurs. D'ailleurs toute l'équipe des médiateurs porte une couronne ornée d'ailes dorées, remémorant les attributs de ce dieu, capable de voler. Répartis aux points névralgiques du musée gallo romain de Lyon-Fourvière, les médiateurs accompagnent les visiteurs dans leur démarche d'innovation et les guident à travers les installations. Quelle belle mission !
E.B : Votre époque paraît spectaculaire ! Nos lecteurs et moi-même souhaiterions savoir ce que vous pensez de la notre. Ne sommes-nous pas trop archaïque ?

Cléo 3000 répondant aux questions des visiteurs Crédits : Quentin Chevrier
Cléo 3000 : Je conviens que votre look vestimentaire me déconcerte au plus haut point. Je ne comprends pas comment, cela fonctionne, ni la forme, ni le sens. C'est peut-être moi qui suis archaïque ! A mon époque c'est plus simple, nos tuniques ont l'air conditionné intégré, nous n'avons jamais ni trop chaud ni trop froid et nous portons de la couleur. Pour nous, le gris n'en n'est pas une. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué lors de ce week-end en 2012.
E.B : Peut-on savoir alors ce qui vous a le plus marqué ?
Cléo 3000 : Ce sont les personnes que j'ai rencontré, plus créatives les unes que les autres. Avec une volonté ferme de faire vivre le musée. C'est grâce à des événements comme Museomix, que ces lieux de culture évoluent. Le travail des museomixeurs de cette année est un exemple, parmi tant d'autres, qui nous permet de comprendre que "nouvelle technologie" n'est pas antinomique de "culture" et "mémoire".
E.B : C'est absolument exaltant en effet, merci beaucoup Cléo d'avoir répondu à nos questions.
Cléo 3000 : Ce fut un réel plaisir de satisfaire vos demandes, je suis à votre service. Merci à vous. Et vivement l'édition 3013, la 1003ème !!
Elisa Bellancourt
Informations :Museomix Museomix en Nord
Inscriptions :INSCRIPTION EN LIGNE

Computerspielemuseum
Vous êtes à Berlin et une journée pluvieuse pointe le bout de son nez ? Vous avez déjà parcouru toute la ville à pieds depuis deux jours ? Le Computerspielemuseum est le lieu où finir sa journée ! Les horaires d'ouvertures vous permettent de vous y rendre pour un début de soirée tout en jeux vidéos ! (Qui plus est, il y a une réduction sur le billet d'entrée une heure et demi avant la fermeture du musée)
Le Computerspielemuseum à Berlin © C. Camarella
"WILLKOMMEN ZUR ZEITREISE MIT PAC MAN UND CO !
GRAB THE JOYSTICK AND GET READY FOR TIME TRAVEL ! "
Le Computerspielemuseum est un musée privé, il retrace 60 ans de l'histoire du jeu vidéo sur ordinateur, ce fut l'un des premiers d'Europe à ouvrir en 1977. Les visiteurs peuvent y rencontrer tous leurs héros de jeunesse de Tomb Raider et Zelda en taille humaine, à Pac man et Pong. Certains jeux font sortir le visiteur de son petit confort mais ne vous inquiétez pas vous pourrez immédiatement replonger dans un fauteuil du XXe ou découvrir une salle d'Arcade et faire sauter le score. Tous les concepts de jeux sont présents, et cela est retracé de façon historique. Nos ancêtres jouaient par correspondance aux échecs !
Le Computerspielemuseum propose une exposition interactive, des jeux, des installations de toutes les périodes du jeu vidéo sur ordinateur à travers trois séquences : The playing man (Homo Ludens), The invention and development of the digital game et The world of the Homo Ludens digitalis.
Réflexion, mobilité, stratégie, art, danse, course, patience, résistance, entêtement, calme, frayeur, comique.
A l'entrée, un jeune homme vous donne un flyer « Exhibition Instruction Manual » ou « Bedienungsanleitung Ausstellung », de quoi parfaire son allemand.
Cela explique qu'il y a 22 bornes vidéos dans l'exposition à lancer avec un joystick et qu'il y a des jeux auxquels nous pourrons jouer. Cette petite fiche explicative laisse imaginer une exposition très immersive et accessible. C'est parti pour chasser du fantôme !
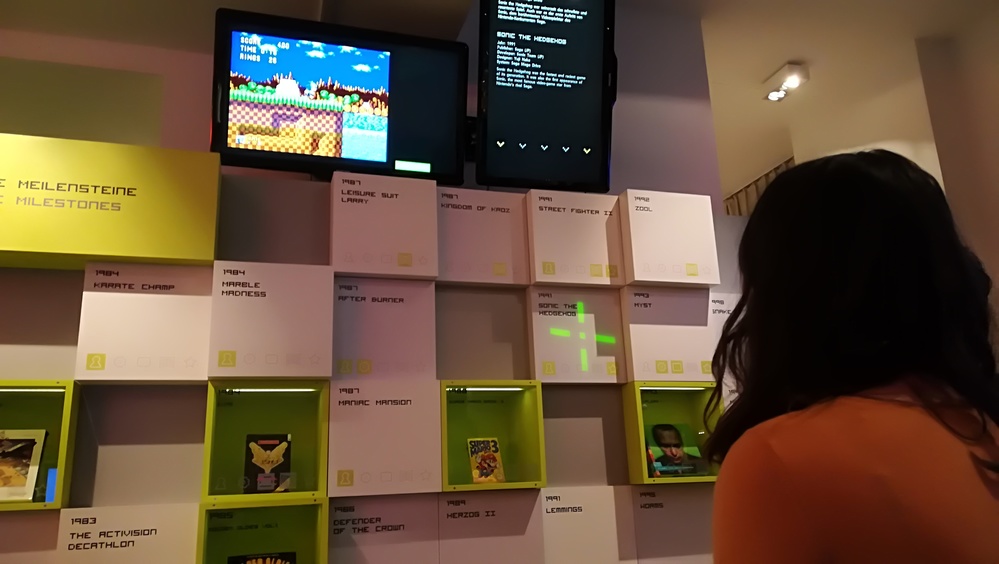
Dispositif et scénographie montrant d'anciens jeux © C. Camarella
Une ambiance comme à la maison, ponctuée de pixels aux couleurs vives, des lumières rétro et tiiou tiiou tiiou ! Une envie de toucher à tout et de remonter le passé en découvrant chaque console rangée de façon chronologique... « - Tu te rappelles de cette console ? - Oh et celle là ! - Oh regarde celle-là on dirait un scanner elle est énorme ! » Une fois le fonctionnement des joysticks compris, c'est une balade dans l'histoire du jeu vidéo sur ordinateur non sans une once de nostalgie. Il suffit de pointer la croix verte sur un pixel pour que la vidéo se lance et pas besoin de bitcoins tiiou tiiou.
Par définition « Un jeu vidéo est un jeu électronique qui implique une interaction humaine avec une interface utilisateur dans le but de générer un retour visuel sur un dispositif vidéo. Le joueur de jeu vidéo dispose de périphériques pour agir sur le jeu et percevoir les conséquences de ses actes sur l’environnement virtuel. ». tiiou tiiou tiiou Avez-vous déjà vu un joystick géant, ou un jeu qui vous donne des coups de jus et vous fouette ? L'interactivité au musée est primordiale et permet de vivre des expériences, le corps du visiteur est mobilisé de bien des façons et un vrai lien est créé entre les dispositifs de l'exposition et celui-ci. Des jeux innovants mettent en action le visiteur dans une scénographie dynamique et pixelisée.

Reconstitution en fonction de la période de la console à tester © C. Collange
Et puis la salle de tous les nostalgiques...la salle d'Arcade, elle bénéficie d'une ambiance aux lumières tamisées avec un univers sonore bien marqué tiiou tiiou où chaque visiteur donne de sa personne pour faire flancher le jeu de la borne. Chaleur, souffle haletant, excitation, les sensations sont là, l'immersion est totale. Principalement fréquentées par un public jeune, parmi lesquelles nous retrouvons toutes les personnes passionnées et celles qui veulent passer un bon moment. Ce musée est un lieu de vie, vous entendez les rires, les cliquetis des boutons, la destruction des avions tiiou tiiou tiiou mip mip mip.
Si les salles d'arcades ont décliné en France cela peut s'expliquer par l'augmentation massive des consoles de jeux de qualités extraordinaire, l'accessibilité aux multimédias plus simple et moins coûteuse aussi à l'époque de la conversion du Franc à l'Euro qui fera augmenter le prix d'une partie en salle d'arcade. Aujourd'hui cela revient dans les tendances, les bars à jeux ouvrent et nous voulons passer du bon temps dans ces endroits. Au ComputerspieleMuseum, la salle d'arcade côtoie la réalité virtuelle et fait revivre ces anciens jeux. Tiiou tiimiip miip

Salle d'arcade © C. Camarella
Tiiou tiiou tiiou, bienvenue dans un musée où le jeu vidéo n'est pas une attraction mais un médium. En effet, les artistes et les designers de jeux vidéos se sont inspirés des jeux vidéos pour créer des objets numériques et interactifs permettant de compléter leur propos.
Chaque jour, dans la rue nous pouvons reconnaître les mosaïques de Space invaders ou des blocks Tetris sur les murs des maisons. Le monde du jeu vidéo a envahi notre quotidien pour nous permettre d'échapper à une réalité T.
Le concept, der Begriff, the concept, de jeu vidéo artistique a évolué dans les années 1990. A ne pas confondre, le Game art et l'Art game. L'art est au service du jeu pour le Game art (modélisation, 3D, illustration, musique) tandis que pour l'Art game c'est le jeu qui est au service de l'art, dans ce cas le jeu sert à faire réfléchir et réagir le joueur sur des sujets précis et peu évoqués dans le jeu vidéo en général. Cela peut se rapprocher de ce que l'on appelle un « Serious Game » qui est un « défi cérébral, joué avec un ordinateur selon des règles spécifiques, qui utilise le divertissement en tant que valeur ajoutée pour la formation et l'entraînement dans les milieux institutionnels ou privés, dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la sécurité civile, ainsi qu'à des fins de stratégie, de communication. » (définition de Michael Zyda, directeur du Game Pipe).
Le Computerspielemuseum nous ouvre sur un nouveau champ de la création des jeux vidéos sur ordinateur tiiou tiiou tiiou dont le but n'est plus le seul divertissement, outre le développement d'un nouveau modèle économique, c'est un courant de « videoludique » utilisant le jeu comme un moyen d'expression.
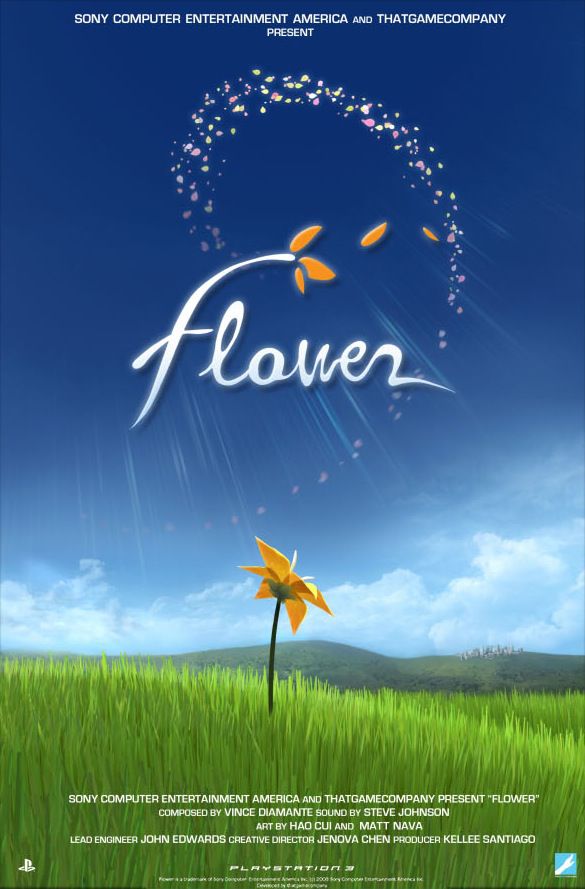
Flower, jeu vidéo © Senscritique.com

Gone Home, jeu vidéo sur ordinateur d'aventure © HunGamer Trailers sur Youtube
Allez, viens on est bien à Berlin au Computerspielemuseum ! Miip miip
C. Camarella
#Computerspielemuseum
#Berlin
#jeuxvidéos
Pour en savoir plus :
Article de Marion Coville sur les publics d'une exposition sur le jeu vidéo : http://expojeu.hypotheses.org/119
Définition du jeu vidéo : http://www.ageron.net/supports-de-cours/ensa-nancy/artem-game-lab-video-games/
Flower : https://fr.wikipedia.org/wiki/Flower_(jeu_vid%C3%A9o)
Gone Home : https://gonehome.game/
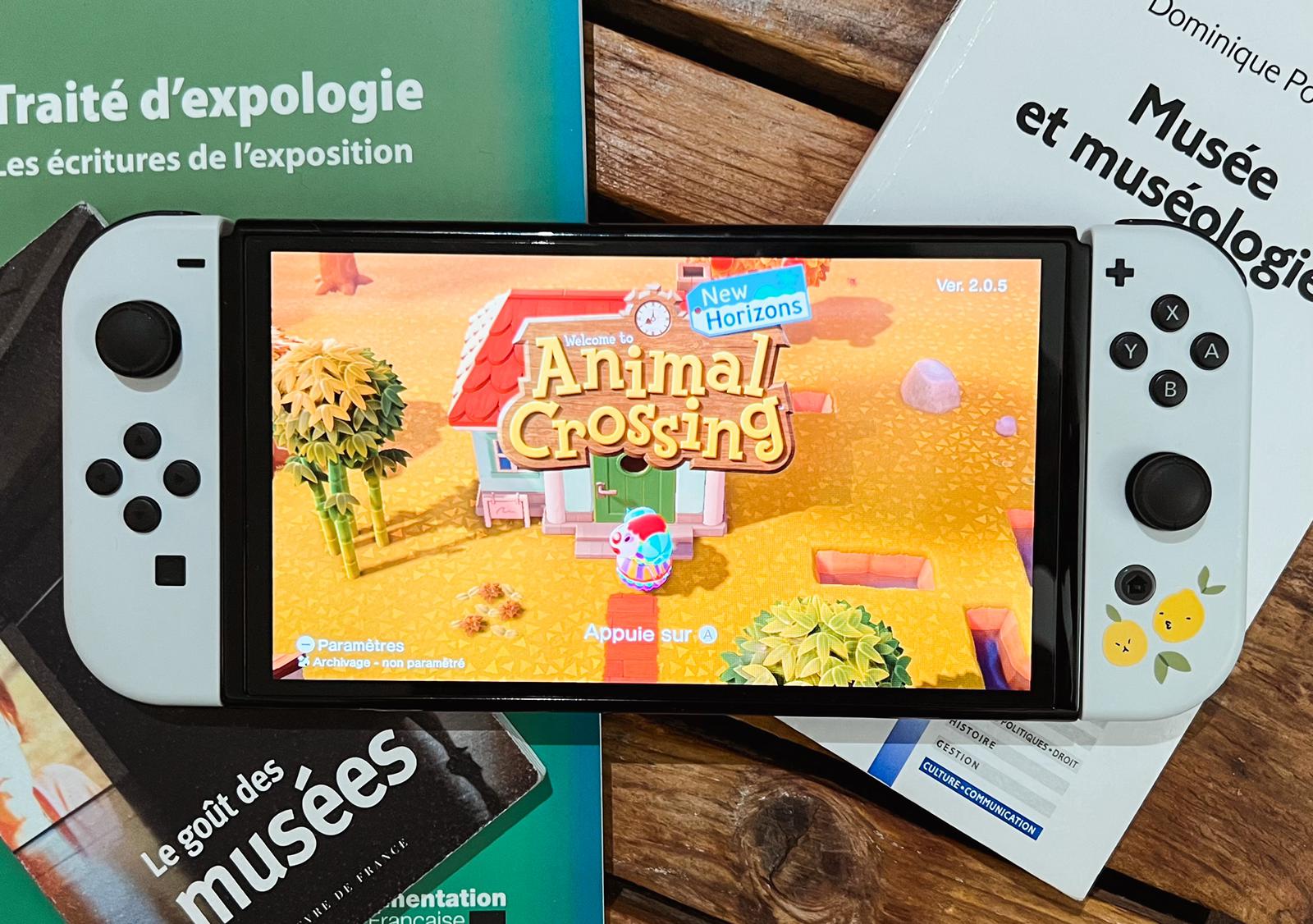
Conquête des publics connectés : où sont les musées ?
Quel avenir pour les musées dans la transition numérique ?
L’engagement numérique des musées les pousse à dématérialiser leurs collections afin de promouvoir l’ouverture culturelle et l’accès au patrimoine. Pour l’instant, peu d'offres de médiations existent réellement avec ces collections numériques. Cependant, les nouvelles problématiques, mises en exergue par la crise sanitaire, ont impliqué les musées dans de nouvelles opportunités sociovirtuelles.
En cherchant à établir un contact avec les internautes, les institutions culturelles répondent par l’accessibilité en ligne de leurs collections. Mais sur le terrain des usages numériques, les musées ne seraient-ils pas en train de passer à côté d’un certain type d'expérience muséale ?
Je vous propose d’évoquer ensemble des actions culturelles menées dans le domaine du numérique : le cas d’Animal Crossing: New Horizon ©.
Crédit image d’intro : Jeu Animal Crossing : New Horizons ©, Nintendo © / Le goût des musées, éditions Le Petit Mercure /Musée et muséologie, Dominique Poulot / Traité d’expologie, Serge Chaumier
Un musée (pas) comme les autres
Replaçons le contexte: nous sommes en mars 2020, en plein premier confinement en France, avec pour principales distractions : instagram, netflix et les jeux vidéo. La coïncidence veut que le dernier jeu Animal Crossing, très attendu, vient de sortir et trouve très rapidement son public dans cet environnement d’attente et d’incertitude.
Édité par Nintendo pour sa console, la Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons est un jeu de simulation de vie avec une nature immersive. Le gameplay est simple: customiser sa propre petite île, tisser des liens amicaux avec ses voisins, des animaux anthropomorphes et explorer les alentours. Le jeu japonais propose également une fonctionnalité qui va ici nous intéresser : la possibilité de compléter les collections du musée de l’île !
Quand il est tard le soir et que toute l'île est endormie, un petit hibou, Thibou, conservateur du musée, est bien réveillé et peut converser avec vous toute la nuit. Il laisse les portes de son musée ouvertes jour et nuit, pour vous permettre de vous balader dans les collections qui invitent à la balade et la rêverie.
Le musée se divise en 4 sections : les fossiles, les animaux marins, les insectes et la section "œuvres d’art” qui est intégrée en mai 2020. Le musée ne se caractérise pas par son implication culturelle sur l’île mais par sa fonction de recensement des ressources vivantes et sa dimension de collection d’objets rares du jeu. Ainsi les joueurs se lancent à la recherche de toutes les espèces différentes en pêchant des poissons, en attrapant des insectes ou en déterrant des fossiles. Mais il peut également acheter des œuvres d’art, auprès du mystérieux personnage de Rounard, qui fait halte sur l’île seulement quelques jours par mois. En moyennant quelques clochettes (monnaie du jeu) et en aiguisant son regard pour ne pas se faire revendre une contrefaçon, le joueur peut acquérir des chefs d'œuvres comme la Joconde ou le penseur de Rodin et les intégrer à son musée. Tel un trafiquant d'œuvres d’arts venu d’une autre réalité, Rounard fait la passerelle entre notre univers culturel et le monde d’Animal Crossing.
Dans un jeu de simulation de vie imitant nos pratiques, le musée est un vecteur de lien entre le monde réel et virtuel. Le jeu, ainsi que ces possibilités, ont conquis les internautes et certains musées. Dans un souci de se rapprocher de ses visiteurs, plusieurs initiatives sont nées des potentiels de médiation qu’offre le jeu.

La section oeuvres d’arts du musée, Jeu Animal Crossing : New Horizons ©, Nintendo©
Léo Tessier, médiateur scientifique au Muséum d’Angers, connaît bien l’univers des musées, il en a fait son métier. Et ce jeu vidéo l’inspire. Il met en place dès avril 2020, des visites virtuelles, sous la bannière de son musée dans la vie réelle. Le Nintendo Switch Online permet aux joueurs de se connecter entre eux et de s’inviter les uns chez les autres pour venir découvrir son île. Léo organise ainsi des visites de 7 personnes maximum (jauge du jeu), connectées en parallèle sur skype, et avec ce groupe réduit il mélange ses deux passions, les musées et les jeux vidéo. Il présente les collections d’Animal Crossing et n’oublie jamais de faire le lien avec son musée, à Angers.
Visite virtuelle par Léo Tessier, Muséum d’Angers / Jeu Animal Crossing : New Horizons ©, Nintendo©
« Je me suis dit que ce serait rigolo de recréer le muséum : la collection est bien sûr différente et moins fournie (une soixantaine d’objets contre 500.000 !). Mais on peut faire des parallèles : dans le jeu, où il y a un vrai souci de réalisme, j’ai par exemple un plésiosaure, ce gros reptile marin de six mètres de long et sa grande mâchoire, également présenté au Muséum. » Livre t’il dans un article pour le magazine 20 minutes.
L’initiative a commencé timidement, avec quelques créneaux, et a rencontré un franc succès. Un planning s’est vite instauré et les visites (complètes) se sont déroulées régulièrement pendant les deux mois du confinement. La visite de Léo Tessier était très pédagogique et inventive, mais également humaine et participative. Le médiateur a su transposer virtuellement une expérience de visite.
Passion culture
Imiter sans égaler
Si l'on peut saluer ces deux initiatives, les musées peinent encore à trouver leur place dans le paysage virtuel dans lequel les collections s’immiscent, mais quid de l’expérience muséale… En effet, si l’intégration, de plus en plus courante, des nouvelles technologies dans les espaces d’exposition s’avère conquérir les publics, les musées semblent encore peu innovants sur leurs propositions dématérialisées.
Voyons le cas du musée du Prado qui a créé sa propre île sur le jeu en reconstituant son propre musée. Dans un souci d’accessibilité pour les personnes ne possédant pas la console ou le jeu, des visites virtuelles sont disponibles sur Youtube. La proposition semble plus éloignée des deux précédentes en cherchant plus à tirer profit d’un effet de mode que de mettre en place une réelle ambition culturelle. En simulant leur musée dans Animal Crossing, le musée du Prado tombe dans l’écueil de simplement transposer ses collections et son identité graphique, sans exploiter l’interaction avec les visiteurs.
Un besoin de réinventer
Deux ans après le premier confinement, la fréquentation des musées n’est toujours pas remontée à sa jauge d’avant pandémie. Un besoin de se réinventer émerge.
Et si le temps était venu de continuer à explorer les espaces numériques et d’apporter des changements dans notre accès à la culture ? Et si les espaces culturels commençaient à créer des liens durables avec le public connecté ?
A l’heure ou la transition numérique est en plein essor, de nombreuses plateformes (jeux vidéo, Instagram, Facebook, …) s’installent dans les pratiques d'accès à la culture et la conditionne. Par leur rôle et leur essence, il devient alors important (peut être vital ?) que les institutions culturelles s’adaptent rapidement aux questions relatives au numérique.
Les musées gagneraient à exporter l'expérience utilisateur plutôt que simplement les contenus. Même si l’accessibilité des collections est une valeur enrichissante pour la communauté, il est intéressant d'appréhender la médiation et l'expérience de visite comme pouvant s’étendre jusque dans les univers virtuels. Les internautes restent des visiteurs, curieux de découvrir et de vivre de nouvelles expériences. Il ne s’agit plus seulement de transposer, mais d'habiter, d’inventer, de faire vivre et vibrer les visiteurs, tant dans les musées, que sur la toile.
Les musées ont toutes les clés pour conquérir les nouveaux espaces numériques, à eux d’en tirer parti.
Drella Hubert
Pour aller plus loin :
- https://experiments.getty.edu/ac-art-generator/
- https://www.rfi.fr/fr/culture/20220108-entre-coup-de-com-et-v%C3%A9ritable-m%C3%A9diation-culturelle-les-mus%C3%A9es-s-allient-aux-jeux-vid%C3%A9o
- https://medium.com/museonum/explorer-les-possibilit%C3%A9s-des-collections-ouvertes-avec-animal-crossing-new-horizons-742e3a60fb4c
#AnimalCrossing #JeuxVidéo #MédiationNumérique #MuséeVirtuel
David Bowie is...an Alien
« David Bowie is …an alien ». Oui…je n’ai pu m’empêcher de poursuivre le titre de l’exposition car, entre nous,n’est-il pas là pour nous y inciter ? Je saisis donc l’occasion pour vousfaire un débriefing de mon voyage interstellaire à la Philarmonie de Paris.
Créditphotographique : La Philarmonie de Paris
« David Bowie is …an alien ». Oui…je n’ai pu m’empêcher de poursuivre le titre de l’exposition car, entre nous,n’est-il pas là pour nous y inciter ? Je saisis donc l’occasion pour vousfaire un débriefing de mon voyage interstellaire à la Philarmonie de Paris.
“There’sa Starman waiting in the sky. He’d like to come and meet us but he thinks he’dblow our minds […] He told me: Let the childen lose it, let the children use it”[1]
Crédit photographique : P.
Sortie du métro parisien : Leshalles, la cité de la musique, sa verdure et son mobilier urbain rouge. Rien nesemble avoir changé au parc de la Villette. Si ce n’est…cette immense navettespatiale argentée à côté de la cité de la musique. Les reflets du soleilsur ces tuiles d’aluminium m’éblouissent tandis que je me laisse guider vers ce vaisseau intergalactique dédié à la musique inauguré en janvier 2015. Le bâtiment est fascinant.
Mais une fois entré, j’appréhende un peu. Des éléments de constructions trahissent un ouvrage encore en travaux … j’espère simplement querien ne va s’effondrer mais, comme certains fans, je suis trop impatient pour faire demi-tour. Une fois à l’accueil, l’agent m’invite à m’équiper d’un audioguide intelligent. J’écoute ses instructions: « C’est très simple. Il n’y a pas de boutons. Vous avez simplement à vous approcher de l’entrée et l’expositionfera le reste ». Entre scepticisme et excitation, je pose le casque sur mes oreilles. Il grésille. Tandis que je franchis le seuil de l‘exposition, un faible écho musical semble perceptible. Puis l’intro de « SpaceOddity » se met à sonner. Le voyage peut alors commencer.
“Ten, nine,eight, seven, six, five, four, three, two, one, lift off.This is Ground control to Major Tom…”[2]
Dans une ambiance sombre et intimiste, la musique vous emporte et vous berce au gré des séquences qui dépeignent l’artiste. Elle vous fait oublier toute notion de temps. Une première salle nous présente la naissance d’une icône jusqu’à son premier voyage fictif dans l’espace en 69. Des écrits, des dessins, des objets personnels sont accompagnés de cartels que je ne me suis pas lassé de lire. Chaque objet fait sens et ne tombe pas dans l’illustratif.
30 minutes plus tard, je me rends compte que je suis toujours dans le premier espace, à travers le continuum de sa jeunesse. Je prends conscience du monde qui m’entoure. Bowie est autour de nous, il est l’espace dans lequel nous circulons. Le parcours n’est pas uniquement chronologique mais aussi thématique. On retrouve de manière complète mais loin d’être exhaustive ses influences, ses voyages, ses personnages, sa méthode de travail, sa palette d’artiste, ses époques et ses tendances… Les différentes thématiques s’enchevêtrent et se répondent. Elles se font écho l’une l’autre. Voilà ce que cherchent à vous faire ressentir les deux commissaires de l’exposition. Bowie est partout.
Crédit photographique : P.
La mise en espace est d’ailleurs parfois déroutante. Elle prend la forme d’une déambulation dont la musique est la ligne conductrice à travers les différentes planètes de Bowie. Le voyage est parfois frustrant car nous sommes désorientés par la profusion de séquences mais cela est pardonnable. David Bowie a toujours voulu déstabiliser son public au travers de ces multiples facettes. L’exposition ne fait que suivre les différentes directions que sa carrière a tracées.
Au départ, nous nousimaginons que la musique évolue au fil de notre pérégrination mais ce n’est pas le cas. Ce sont nos déplacements à proximité de points stratégiques qui déclenchent le son et nous guident à travers l’exposition. Ce n’est plus uniquement le regard qui invite à appréhender l’espace mais aussi le son. Nous pouvons entendre la voix de Bowie chanter, jouer et nous parler au creux de notre oreille. Il est là quelque part autour de nous.
“Changes. Turn and face the strange […]Changes. Just gonnahave a different man. Time may change me but I can’t trace time”[3]
Nous regardons des indices : des brouillons de ses textes, des accessoires de scènes ou encore des mannequins portant ses costumes de scènes. Seulement il suffit de regarder autour de soi pour se rendre compte que la fréquence audio est toujours associée à un écran. Et c’est peut-être là que le bât blesse. Le visiteur est inlassablement invité à se tourner vers un écran ou une projection murale. Cela nuit parfois au confort de l’exposition. Le public s’agglutine devant les écrans et les costumes mis en scène. La circulation devient alors perturbée et on est à la limite de perdre patience pour voir une simple vitrine.
Si l’afflux de visiteurs est un obstacle à travers cette quête de Bowie, observer le public m’a captivé car, dans ce voyage dans l’univers de Bowie, nous ne sommes pas aussi seuls que le suppose ce casque qui isole. Le public se permet des petites libertés. Les fans chantent comme à la maison, les adeptes se laissent aller à faire des commentaires à haute voix : l’ambiance est conviviale. Bowie est partout !
Un damier au sol en interaction avec neuf écrans nous le traduit ingénieusement. Selon neuf cases sur lesquelles vous vous placez, le son d’un des clips diffusés sur un des écrans se déclenche. D’une case à l’autre vous voyagez à travers ces différentes dimensions. Bowie n’est pas qu’une étoile mais plusieurs étoiles qu’il a été, qu’il est et qu’il restera. En y pensant, nousne sommes pas loin de l’adoration et du culte de la personnalité.
Crédit photographique : P.
“Believingthe strangest things, loving alien…”[4]
Pour ceux qui ont été envoûtés par le chant des sirènes…ou plutôt de Bowie …Il vous est possible de finir votre visite dans une salle d’ambiance. Affalé dans un canapé, des images deconcerts de Bowie sont projetées sur l’ensemble des parois en toile derrière lesquelles se cachent des costumes flottants dans l’obscurité. A défaut de trouver une place pour profiter pleinement de cette aire de repos après près de 2h d’exposition, je quitte le navire à contre cœur. A la sortie, délesté de mon équipement auditif, la lumière de l’extérieur et le passage inévitable par la boutique me ramènent brutalement sur terre. Mais c’est avec les yeux et les oreilles pleines d’étoiles que je repars de cette exposition.
Exposer Bowie est un défi brillamment relevé pour les fans comme pour les novices. La presse n’a de cesse de parler d’ « Odyssée », de « Voyage dans l’espace », d’ « Ovni » à propos de Bowie et son exposition. Les qualificatifs ne sont pas de trop à la Philharmonie de Paris. Le lieu, de par sa fonction et son architecture, est l’endroit idéal pour accueillir la rétrospective de la vie de cette icône. L’exposition dépeint un esprit infiniment miroitant et polymorphe. L’exploit est réussi. Il ne vous reste plus que jusqu’au 30 mai 2015 pour partir en voyage sur Mars avec David Bowie, l’extraterrestre aux yeux vairons.
“Oh man ! Look at those cavemen go. It’s a freakiest show. Take a look at the Law man beating up the wrong guy. Oh man! Wonder if he’ll never know? He’s in the best selling show.Is there life on Mars?”[5]
Persona
Pour en savoir plus :
http://davidbowieis.philharmoniedeparis.fr/
#David Bowie
#Musique
#Immersion
[1] Bowie David, Starman, The Rise and Fall of ZiggyStardust and the Spiders from Mars, 1872.
[2] Bowie David, Space Oddity, Space Oddity, 1972.
[3] Bowie David, Changes, Hunky Dory, 1971.
[4] Bowie David, Loving the Alien, Tonight, 1985.
[5] Bowie David, Life on Mars ?, Hunky Dory, 1971.

De l’âge de pierre à l’âge des...pixels ?
« Merci de ne pas toucher », ces quelques mots font partie de notre quotidien dans les musées, certains l’ayant intégré plus que d’autres.
© Le forum de la seconde guerre mondiale, des conflits contemporains et de l’actualité : la Coupole.
La table tactile, merveille de technologie, s’inscrit dans ce processus de participation du public. Le principe ? Un grand écran, horizontal, sur un support type table, à disposition dans les salles des musées, et qui permet de « jouer » avec les éléments contenus à l’intérieur, les déplacer, les agrandir, les superposer…
L’apport pédagogique est conséquent. Ainsi le visiteur peut zoomer dans une constellation, faire défiler des photos d’archives, et même, à la pointe du progrès, interagir avec l’information et la modifier.
Je touche, d’accord, mais est-ce que je comprends?
A l’image du musée d’Histoire naturelle de Lille, qui a accueilli sa première table tactile en 2011, les possibilités qu’apporte ce dispositif sont importantes et justifiables. Objet sinistre et quelque peu intimidant lorsqu’il est inanimé, osez et bougez un de ces dispositifs et vous vous retrouvez devant le R2D2[1] du musée, une sorte de table du futur, colorée et animée ! Bien que le terme précis pour ce type d’outil sur ce site soit légèrement plus barbare, à savoir « Table tangible à détection d’objet », celle-ci permet toutefois de montrer en plus grande quantité les minéraux présents dans les réserves du musée et avec une simplicité plus ou moins appréciée.
Ainsi, le musée rappelle au passage qu’il possède la plus grande collection de minéraux de France et offre une manière moins monotone, contrastant légèrement avec la muséographie de la partie de l’établissement consacrée aux pierres, de la présenter. Plus de 1000 échantillons ont ainsi été scannés et numérisés afin d’offrir au public non seulement une vue mais aussi des informations sur ceux-ci.
Car l’outil ici ne sert pas qu’à montrer, mais aussi à interagir avec les éléments. En effet, à l’aide d’atomes matérialisés via de petits palais, le visiteur est invité à composer ses minéraux de manière ludique et intelligente. Les scientifiques apprécieront et se conforteront, les novices s’amuseront ! Après une enquête[2] réalisée à la suite de la mise en service de cet outil, les résultats ont été plutôt positifs, la table étant bien accueillie et utilisée par le public, mais parce qu’étant probablement à l’échelle du musée, qui ne reçoit pas la fréquentation du Louvre par exemple.
La Coupole, centre d’Histoire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais, est un autre exemple intéressant d’utilisation de la table tactile. Les divers parcours qu’ils proposent autour de la Seconde Guerre Mondiale sont jalonnés de différents dispositifs techniques de médiation. Bunker à l’extérieur, Futuroscope[3] à l’intérieur, la Coupole nous immerge dans l’univers de 1939-45 grâce à divers dispositifs contextualisants. L’utilisation de table tactile ici est assez différente de celle vue précédemment.
En effet, on peut ici accéder à des images d’archives, qui ont été numérisées, et qui n’auraient probablement pas pu être montrées dans un autre contexte. Fidèles à l’ambiance et au sujet, on peut donc faire défiler des photographies et documents de guerre, avec possibilité de zoomer sur des détails. Le principe aurait pu être pertinent si les gens ne s’étaient pas intéressés plus au dispositif qu’au contenu…
On a pu ainsi observer le public, enfant comme adulte, « s’amuser » à zoomer sur des photos et à les « envoyer de l’autre côté de l’écran » sans se soucier plus que cela du fait qu’ils « jouaient » avec des images de camps de concentration… Et là, judicieusement placée dans la salle, une bouffée d’air frais « humain », matérialisée par un surveillant, vient gentiment et avec diplomatie faire remarquer à la personne qu’en effet, ce n’est pas un jouet et qu’elle était en train de manipuler des témoignages de souffrances. Ainsi en général, l’attraction s’arrête, tout le monde descend et se dirige vers la sortie…ou vers le prochain « manège ».
Le concept de table tactile, comme tout usage du numérique, reçoit un très fort soutien du ministère de la culture depuis quelques années, et on peut voir chaque jour son fort potentiel et les possibilités qu’il développe et permet. Une plus grande accessibilité à un nombre d’informations toujours croissant, un usage et un rapport ludique, participatif, en accord avec la société moderne et technologique…
Mais le débat demeure au sein même des professionnels, peut-on tout transmettre par le biais des technologies ? Leur usage est-il toujours judicieux, adapté ? Quant on voit une table tactile utilisée par dix personnes et qu’on en observe cent autours qui n’y ont pas accès, peut-on parler de révolution de médiation ? Ou quand elle permet de rendre « ludique » la consultation d’images de guerre, ne peut-on pas craindre un intérêt pour l’outil plutôt que pour le contenu ? Est-ce vraiment incontournable pour attirer toujours plus de monde dans les musées ?
A l’heure des pixels et du numérique, j’ai, pour ma part, simplement envie de m’installer dans un coin de musée et « reposer » mes yeux sur une bonne vieille toile de Monet…
Julie Minetto
[1] Petit robot de la saga futuriste et de science-fiction Star Wars
[2] Par le laboratoire d’étude Geriico, université de Lille.
[3] Parc d’attraction du Poitou, basé sur l’image et les technologies cinématographiques

Des assassins aux Invalides
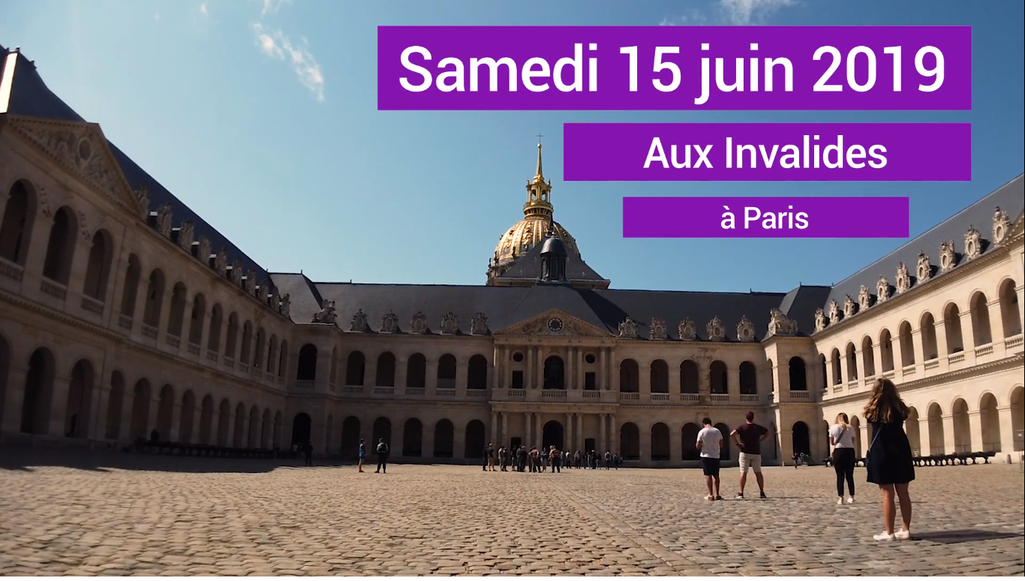
L’expérience Assassin’s Creed a été accueillie à trois reprises par le Musée de l’Armée à l’Hôtel national des Invalides. À elles seules, les deux premières éditions (vacances de Toussaint et de Noël 2018) ont réuni plus de 11 000 participants. Il s’agit là d’un jeu immersif basé sur l’univers d’Assassin’s Creed, un des jeux vidéo phares d’Ubisoft. L’agence Cultival, spécialisée dans la médiation culturelle, s’est chargée de l’élaborer à leurs côtés. Par le biais de cet « escape game » à demi-ciel ouvert, les participants découvrent ou redécouvrent le lieu, ayant même accès à des parties habituellement interdites au public au cours du jeu. Celui-ci, après les explications et modalités énoncées, leur laisse 1h30 pour venir à bout de leur mission et ainsi parcourir ces bâtiments historiques en renouvelant leur regard. Seuls ou accompagnés, ils errent guidés par leurs smartphones (un pour deux, maximum), et force est de constater que le collectif est plutôt préféré …
Attendez. Et si on présentait tout ça autrement … ?
Signe distinctif de participant facilitant l’accès à l’Église du Dôme © Emeline Larroudé
« Dans le tombeau de l’aigle,
Caché sous un autre ciel
Sur lequel les anges veillent
Le fruit défendu attend »
L’année 2018 a vu renaître un conflit historique : celui des descendants d’assassins et de templiers (ou serait-ce les rosicruciens du XXIe siècle ?). Une première vague a vu plus de 11 000 d’entre eux s’affronter, bizarrement un peu avant la Toussaint succédant à la fête des morts … Coïncidence ? De mi-juin à début juillet 2019, ils ont lancé une nouvelle offensive, toujours empreinte de discrétion, à l’ombre de nombreux regards, dans les coulisses de l’Hôtel national des Invalides. Guidés par les astres tant solaires que lunaires, de nuit comme de jour, ils se sont mobilisés pour percer un des secrets les plus énigmatiques de Napoléon 1er : l’emplacement de la Pomme d’Eden. Héritée de la Première Civilisation, on lui prête des pouvoirs inestimables qui auraient, par ailleurs, servis à l’empereur … La détenir reviendrait alors à avoir accès à une puissance incommensurable.
Mais, n’y a-t-il pas là comme un petit problème ? Rien ne vous titille ?

Vues intérieures de l’Eglise du Dôme © Emeline Larroudé
Cette deuxième version est, indéniablement, romancée. Elle mêle fiction et réalité si bien que sa lecture en est floue : comment prendre la mesure de cette porosité ? Qu’est-ce que le lecteur doit vraiment prendre en compte ? C’est peut-être là toute l’ambiguïté de cette expérience. « Enquête très stimulante, mi-historique, mi-fiction », nous dit Le Parisien. J’irai plus loin encore. Trois niveaux de lecture sont possibles : ce qui relève de l’univers Assassin’s Creed créé par Ubisoft ; ce qui relève de l’adaptation de l’univers Assassin’s Creed au lieu et à son histoire ; ce qui relève de l’histoire du lieu. Une fois ce constat établit, comment les distinguer de fait ? L’exercice semble bien ardu. S’il ne paraît pas nécessaire d’avoir déjà parcouru le dit jeu-vidéo pour avoir envie de participer, le faire, et réussir la mission à temps, les amateurs peuvent avoir certaines clés de compréhension supplémentaires qui manqueront aux participants lambda (symboles, univers, … et plus largement ce qui relève de la citation du jeu, notamment AC II ou encore AC Unity). Comment donc cette visite peut-elle alimenter sa culture personnelle lorsque, malgré le bon temps passé et l’attention portée aux différentes énigmes, l’on ne sait pas ce que l’on doit vraiment en retenir ?
Arrêtons-nous sur la devise des Assassins : « Rien n’est vrai, tout est permis ».

Hôtel national des Invalides, et modalités de jeu sur l’application dédiée © Emeline Larroudé
Qui plus est, qui sont ces assassins et templiers des temps modernes ? A l’inverse des institutions culturelles prônant généralement le « tout public » à tel point qu’elles finissent parfois par ne s’adresser à personne, le game design s’attache véritablement à cette question. Il propose alors des projets pertinents qui touchent le public visé, déterminé bien en amont, au lancement. Ici, même si l’expérience est ouverte à tous, il semblerait que le public visé soit plus particulièrement celui des jeunes adultes voire adolescents, adeptes de jeux-vidéos mais pas seulement. Pour résumer, le type de public qui se fait rare dans ces institutions culturelles qui n’arrivent pas à le mobiliser et ne savent comment l’attirer. L’univers emprunté, la durée de l’expérience, le niveau de difficulté des différentes énigmes … Tout est pensé pour eux. Le cadre « ludique », cependant, nuit lui aussi à l’apprentissage. Globalement, le but de ces joueurs est de gagner (c’est aussi le but des organisateurs), qu’ils soient bons ou mauvais perdants. Mais cette quête de la réussite amène parfois à privilégier l’efficacité, la rapidité, à l’attention qui ne se porte alors que peu sur le contenu quant à lui toujours ambigu.

Vues extérieures de l’Hôtel national des Invalides © Emeline Larroudé
Pourquoi, cependant, l’objectif serait-il d’apprendre ? Ne pourrait-on pas se contenter de la venue de milliers de personnes qui, peut-être, ne s’étaient jamais rendues en ce lieu auparavant, voire ne s’y étaient jamais intéressées ? Ces visiteurs, conquis par l’expérience, s’y rendront peut-être à une autre occasion pour tenter de percer ses véritables mystères … Soit. A cet égard, le score de plus de 11 000 participants en seulement deux sessions est remarquable. Par ailleurs, le fait que le Musée de l’Armée ait accueilli trois fois l’expérience est significatif : la plupart des séances (limitées à 20 personnes, mais proposées toutes les demi-heures environ) ont affiché complet, ce qui témoigne d’un engouement réel. Soulignons cependant que, si c’est là le résultat attendu (à savoir de nouveaux visiteurs conquis qui auraient moins de scrupules à pousser les portes du lieu une prochaine fois), malgré une bonne expérience, ludique, ce but est rarement atteint par les organisateurs. Pourquoi ? Peut-être parce que la visite classique n’est pas en mesure de leur apporter les sensations promises, elles, par un escape game ou un de ses cousins, et donc perd de l’intérêt pour eux.
Quoi qu’il en soit, l’expérience a le mérite indéniable d’être singulière et de conquérir les cœurs des participants, primo-visiteurs pour la plupart, qui s’en souviennent comme d’un moment très agréable et qui y associent le lieu, devenant décor 4D du jeu.
Voir la vidéo :
Emeline Larroudé
#museedelarmee
#cultival
#assassinscreed
#experienceassassinscreed
#escapegame
#ubisoft
Liens internet :
https://www.musee-armee.fr/accueil.html
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur notre chaîne youtube
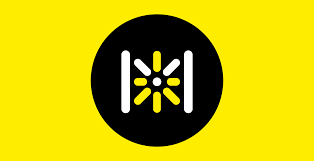
Développer un outil en 3 jours...
La médiation muséale est un travail de longue haleine : établir un axe, le développer, le défendre, le tester, l’intégrer au musée etc. Comment s'imaginer la création d'une dizaine de prototypes d'outils de médiation, en moins de 36 heures ? Le concept Museomix est tout simplement une machine !
En un peu moins de trois jours, environ 150 participants et coachs, (créatifs, développeurs, médiateurs, community manager..) développent un peu plus d'une dizaine de projets de médiation. Chaque équipe s'approprie un musée, des collections, mais surtout avec les nouvelles technologies (mises à leur disposition). Le dernier Museomix s’est déroulé au musée gallo-romains de Lyon Fourvière, les19, 20 et 21 octobre 2012.
De nombreux espaces furent proposés auxparticipants, les incitant alors à s'en approprier et à imaginer une idée porteuse et novatrice.
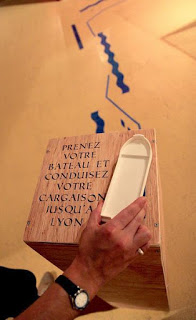
Crédits : Quentin Chevrier
L'année 2013 va être une année novatrice pour Museomix qui se déroulera dans pas un musée mais six ! Dont quatre en France, un au Canada et un en Angleterre. Notre master organise celui qui se déroulera au Louvre-Lens. C'est pourquoi notre petite équipe de M1 a participé activement à l'édition 2012, qui fut pleine de découvertes et de rencontres. J'ai eu la chance d'intégrer l’une des équipes de participants; se fut une course marathonienne afin de mettre en place notre prototype.
Avec mon équipe, nous nous sommes penchés sur la partie du musée qui retranscrit l'importance de Lyon, comme lieu incontournable du commerce méditerranéen (France/ Espagne/ Italie). On y trouve des amphores, des stèles, et mosaïques témoignant de l'activité marchande. Nous avons alors imaginé un voyage interactif et participatif. Ce parcours permettait aux visiteurs de toute âge de découvrir, le commerce du vin à travers ses différentes étapes : de sa production en Espagne à sa consommation à Lyon. Quelques contraintes temporelles et spatiale nous ont été imposés, en effet la médiationne devait pas dépasser une durée de 7 à 8 minutes et nous devions nous adapter à la scénographie de l'exposition temporaire, mise en place au préalable dans le musée.
Le parcours commençait avec l'entrée dans l’espace du commerce en Méditerranée, au milieu des amphores et des inscriptions. Sur une borne repose un petit bateau. Un texte d’accueil invite le visiteur à le saisir et le faire cheminer le long d’un parcours au sol, au milieu des collections, simulant la mer Méditerranée et le Rhône. Arrivé à la première borne, il fallait déposer le bateau sur le dessus et une bande son débutait alors. La voix du Dieu antique Bacchus retentissait et plongeait le visiteur au cœur du quotidien, des enjeux et des aléas du transport maritime. Il le guidait vers les prochaines étapes du voyage : passer d’une borne à l’autre et avancer dans sa découverte.
Pour pouvoir avancer, le voyageur devait réaliser une épreuve, sous forme de manipulation intégrée à la borne. Chaque manipulation le mettait dans la situation d’un marin au cours d’une navigation et l’amenait, par le fait, à s’immerger dans les pratiques de l’époque (Exemple : souffler pour symboliser la navigation à la voile, tirer sur une corde pour comprendre le halage sur le Rhône, verser le contenu des amphores dans un réservoir de stockage, etc.).
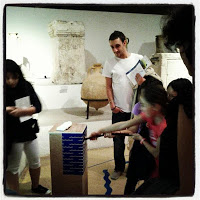
Crédits : Quentin Chevrier
A chaque étape les événements étaient inspirés des objets de la collection qui l’entourait (mosaïques, amphores, sarcophage de charpentier, stèles, dolium…). Le bateau lui servait de fil conducteur, tout au long du parcours entre les bornes et donc retraçait le voyage de Tarragone à Lyon. Il servait également de déclencheur pour la bande son (avec un capteur RFID et Arduimo). Cet outil de médiation a été imaginé pour évoluer avec la mise en place d'un dispositif lumineux. Les objets exposés pourraient s'éclairer au moment où l'histoire les citerait. L'espace serait ainsi moins éclairé et donc plus immersif et le visiteur pourrait plus facilement relier les objets à l'histoire.
Cette approche ludique du commerce en méditerranée, a beaucoup plu au jeune public, car le fait d'intégrer une manipulation physique dans ce dispositif, les questionne et incite leur curiosité.
La création et surtout la mise en place de cet outil ne fût pas facile, en effet à la fin des trois jours il n'était pas totalement opérationnel : quelques petits problèmes techniques, comme la miseen place du dispositif électronique sur les bornes, mais cela reste un prototype.
Néanmoins, cet outil de médiation est en cours de développement au musée, afin de devenir un réel outil de médiation à temps plein.
Agathe Gadenne

Éco-conception numérique : réalité ou utopie ?
Les enjeux soulevés par le développement durable sont fondamentaux et liés à l’avenir de notre société. Sans pessimisme accru ou alarmisme militant, on peut affirmer que les dégradations de notre environnement naturel remettent en cause le futur de notre civilisation, tout du moins dans sa forme actuelle.
Le milieu expographique cherche à agir pour limiter drastiquement son empreinte écologique sur les écosystèmes et la santé des individus, mais prend-il réellement en compte l’impact numérique dans cette équation ? Quel rôle jouent les nouvelles technologies numériques caractérisées par une très grande rapidité d’évolution ? Ce qui était nouveau il y a un an, est déjà dépassé en termes de puissance, de fonctionnalité et d’esthétique graphique. Et le renouvellement continue des produits ne va pas sans générer des coûts élevés. Par ailleurs, la gestion, le développement et la maintenance de ces dispositifs dans les expositions représentent un coût humain et donc financier important pour les institutions muséales. Est-ce le levier qui pourrait leur faire prendre en compte l’impact écologique de l’utilisation du numérique ?
Image d'intro : Exposition numérique 'Venise Révélée' au Grand Palais Immersif (Paris) - Photo de C. Favreau (19/10/22)
Des solutions
Pour pallier l’impact écologique de l’actuelle utilisation en masse des dispositifs et contenus numériques dans les expositions, la Bibliothèque nationale de France (BnF) en 2011, tout comme Universciences un an auparavant, ont créé un guide de recommandation concernant la scénographie et le développement durable. Il explique la notion d’éco-conception qui « consiste à intégrer l’environnement dès la phase de conception des produits, qu’il s’agisse de biens, de services ou de procédés, selon une approche globale et multicritère » (p.9). L’objectif de la démarche est de diminuer autant que possible les impacts environnementaux des expositions sur leur cycles de vie, sans remettre en cause les critères de performance, de qualité, de coût et de délais fixés par l’institution. Il s’agit de penser la nécessité, la durabilité, sinon la réutilisation et l’ergonomie de chaque dispositif utilisé, que cela concerne les vitrines, l’éclairage, les dispositifs numériques, les cartels ou tout autre élément de l’exposition. Lors de l’éco-conception d’une exposition, le but recherché est finalement d’optimiser l’utilisation de matière première, ainsi que la consommation énergétique des dispositifs. Pour le numérique, cela se traduit par le choix de technologie qualitative afin de faire durer l’utilisation le plus longtemps possible, le choix de matériaux recyclés idéalement, tout en prêtant attention à la consommation d’énergie du dispositif. Les choix doivent se réfléchir au-delà de la salle d’exposition. Par exemple, analyser le cycle de vie d’un ordinateur depuis les mines chinoises pour extraire les composantes des batteries aux décharges à ciel-ouvert du Congo. En effet, l’éco-conception ne se limite pas à l’exposition seule, mais se pense avant, pendant et après cette dernière. En élargissant le regard sur la chaine opératoire d’une exposition, il est possible de faire des choix responsables en privilégiant les circuits courts, et quand cela n’est pas possible, en préférant une entreprise acheminant ses produits par bateaux plutôt que par avion par exemple. La pratique du commerce équitable d’une entreprise est aussi très impactant. Autant de choix qui limiteront l’impact carbone du dispositif choisi, et qui s’appliquent au numérique comme à l’entièreté des choix muséographiques et scénographiques.
Des actions
Cependant, l’impact du numérique sur l'environnement ne se limite pas à l’utilisation seule d’un dispositif, la production et le stockage sur support numérique participe également activement à la pollution et à la destruction des écosystèmes. L’impact écologique des centres de données et des hébergeurs web est d’importance. Pour pallier cela, l’entreprise CarboAcademy, par exemple, met en avant le terme de « green computing » comme mode d’emploi de réduction de l’impact environnemental des équipements informatiques. La mise en veille ou hors tension des appareils y est clairement mise en avant, tout comme la prolongation du cycle de vie des appareils électroniques. Le « green computing » c’est aussi optimiser la consommation énergétique du site internet de l’institution muséale, en limitant l’utilisation de vidéo ou GIF, et en diminuant le poids des images. C’est aussi limiter la production de contenus (documents, photos, vidéos) dont le stockage est aussi énergivore, ainsi que d’en limiter les innombrables copies faites « par sécurité ». Plus concrètement, 288 milliards de mails sont envoyés chaque jour dans le monde et chaque envoi équivaut en moyenne à laisser une ampoule allumée pendant 24 heures. Si nous pouvons tous facilement agir sur cet exemple avec une utilisation plus rationnelle de la fonction « répondre à tous », ou bien en se désabonnant à des listes de diffusion ne nous concernant pas directement, etc., quelle politique de sobriété numérique un musée peut-il mettre en place en gestion interne tout comme en communication ? En l’occurrence, opter pour un hébergeur vert peut énormément impacter à la fois la consommation du musée mais peut aussi inciter les autres hébergeurs web à fonctionner aux énergies renouvelables et à avoir une meilleure gestion de leurs déchets. Pour exemple, l’hébergeur IONOS s’engage sur ces principes écologiques. Le type de datacenter choisi peut aussi se faire selon cette même ligne directrice. Les serveurs virtuels notamment, proposent un fonctionnement actif – et donc énergivore – uniquement lorsque qu’ils sont utilisés. Cet état de veille automatique réduit la consommation d’énergie. Des serveurs mutualisés existent aussi, si le site d’un musée n’a pas besoin d’un serveur au maximum de ses capacités en continu, et pour éviter de gaspiller de l’énergie, il est possible de partager ses serveurs avec d’autres institutions.
Mais dans les faits …
Cette liste non exhaustive d’actions et de solutions proposées ici – et ne se limitant finalement pas aux dispositifs numériques seuls – est malheureusement encore trop peu prises en compte par les directeurs d’institution, collectivités, conservateur, muséographes, scénographes, régisseurs, artisans, etc… qui ont tous leur part de responsabilité écologique. Malgré les solutions existantes, les musées et centres d’expositions accusent un sérieux retard en la matière. Autant nationales qu’internationales, petites et grandes structures confondues, rares sont celles qui stipulent une prise en compte de l’impact écologique de la présence de numérique dans leurs expositions. Certaines se disent tout de même sensibles à la problématique en cherchant le réemploi de dispositifs ou matériaux d’anciennes scénographies… L’urgence climatique n’ayant jamais été aussi pressante, une telle passivité est déconcertante et interroge. Pourquoi les musées ne prennent-ils pas leur part de responsabilité écologique ? Pourquoi les collectivités ne les incitent-elles pas à mener des actions concrètes et impactantes ? Cela ne peut pas être par manque de financement puisque la réduction de l’impact environnemental va couramment de pair avec une réduction des coûts énergétiques. Le blocage tient peut-être alors au manque de temps pris à réfléchir sur le confort routinier de chacun, peut-être trop ancré.
Néanmoins, l’éco-conception numérique, bien que peu réalisée pour le moment, est un sujet qui prend sa place dans les conférences, séminaires, tables rondes et autres regroupements de professionnels des expositions. Ces derniers ont finalement conscience de l’urgence à ce que les musées – et autres centres d’expositions – prennent leurs responsabilités écologiques à tous les niveaux, mais cependant, peinent encore à identifier par où commencer se changement, et comment le réaliser.
Coline Favreau
Pour aller plus loin :
- Guide d’éco-conception Universicences : https://www.universcience.fr/fileadmin/fileadmin_Universcience/fichiers/developpement-durable/_documents/guide_eco_conceptFR.pdf
- OCIM : https://ocim.fr/lettre/eco-concevoir-une-exposition/
#éco-conception #numérique #impact environnemental #exposition

En réaction aux censures et vandales : le musée virtuel
Après les attentats de Charlie Hebdo, que nous avons évoqués dans deux articles sur le blog (ici et là), l’exposition Femina, la réappropriation des modèles qui devait se tenir à Clichy-la-Garenne du 25 janvier au 26 avril a pris fin début février, soit juste après son inauguration.
Silence de Zoulikha Bouabdellah © Gallerie Anne de Villepoix
Musées et expositions subissent fortement l’actualité depuis janvier 2015...
Tout est parti d’une œuvre de l’artiste franco-algérienne Zoulikha Bouabdellah, Silence, qui était devenue trop sensible pour certains. Silence questionne la place des femmes dans la religion par 28 paires d’escarpins disposées dans des trous faits à 28 tapis de prière. Après les attentas de janvier, la thématique abordée est apparue susceptible de causer d’éventuels incidents irresponsables. Pour soutenir Zoulikha Bouabdellah, toute l’exposition a été décrochée.
Plus récemment c’est le musée irakien de Mossoul qui a souffert. De très nombreuses œuvres ont été violemment détruites par Daesh, vidéos à l’appui. Mais si le monde de l’art, de la culture (avec le monde entier) s’indigne et souffre de ce que vivent les musées et les expositions, il essaie aussi de trouver des solutions.
Privée de toute visite l’exposition Femina ? Pas si sûr. Détruites et destinées à être oubliées à jamais les œuvres du musée de Mossoul ? Peut-être pas. Car si les musées réels, physiques sont touchés par toute cette actualité, ce n’est pas le cas des musées virtuels. Et ce sont eux qui naissent dans de tels moments et redonnent un souffle d’espoir à la culture.
L’exposition Femina qui voulait mettre en valeur la création artistique féminine se visite désormais en ligne. Avec une vue à 360° vous pouvez vous déplacer dans les salles de l’exposition, du rez-de-chaussée à l’étage et pouvez admirer les œuvres qui étaient présentées. Cette mésaventure n’empêchera surement pas le cycle d’expositions sur les femmes artistes commencé par la Galerie Les filles du calvaire de continuer pour s’achever avec Et les autres minorités dont les dates ne sont pas encore connues.
Les œuvres du musée de Mossoul, quant à elles, reviennent peu à peu à la vie, grâce à la création d’un musée virtuel, d’une plateforme où chacun peut participer pour recréer en 3D les œuvres détruites. Malgré leur destruction physique, elles revivent ainsi sur nos écrans et pourront peut-être un jour à nouveau exister de façon matérielle.
Capture d’écran de l’entrée de la visite virtuelle de Femina, la réappropriation des modèles.
Le musée virtuel comme réaction
Dans de telles circonstances, le musée virtuel prend un nouveau sens. Non seulement il permet de rendre les œuvres accessibles au plus grand nombre mais surtout, c’est une réaction face à l’actualité.
Une exposition ne peut pas se faire car l’une de ses œuvres est trop sensible ? Qu’à cela ne tienne ! S’il est compliqué, sans soutien, de la maintenir visible dans le lieu prévu, la faire vivre et revivre de manière virtuelle est un moyen pour l’artiste, de continuer à partager son travail, ses réflexions. C’est une manière de répondre à cette pression et ces craintes. Précisions que Silence n’a pas été créée en réaction aux attentats de janvier. L’œuvre a pris un sens nouveau avec l’actualité. Cette résonance participe de sa force, de son intérêt et de sa pertinence.
De la même manière, le Project Mossoul est une arme contre Daesh et son souhait de détruire tout un pan de l’héritage culturel mondial. Détruire des œuvres ne détruit pas toutes leurs traces, tous les souvenirs qu’elles ont laissées. Et grâce aux avancées technologiques, à la modélisation 3D, ces œuvres continuent à vivre et pourront à nouveau voir le jour. Plus que cela, ce projet de musée virtuel collaboratif pourrait aussi permettre de reconnaître et suivre les objets pillés et revendus.
Modélisation 3D du mihrab de la mosquée Banat Al Hasan © ruimx
Bien entendu, les musées virtuels comme les musées réels ne sont pas protégés de toutes les menaces. La cyberattaque qui a frappé TV5 Monde dernièrement le montre bien. Le virtuel n’est pas exempt de toute menace. Mais, dans de telles situations, c’est tout de même un beau soutien que le numérique offre aux musées.
Aénora Le Belleguic-Chassagne
A consulter : - http://sisso.fr/vv/femina/#/salle_femina_1/
- http://projectmosul.org/# Musée virtuel# Actualité# Réaction

Et de la mort je vis les visages. In Flanders Fields, Ypres.
Le Musée In Flanders Fields de Ypres (Belgique) a délibérément choisi de montrer l'impact de la guerre sur les vies humaines et le paysage. Parti pris courageux qui a nécessité un important travail muséographique et scénographique. L'exposition permanente se décline en quatre parcours complémentaires et entremêlés proposant au visiteur une vue d'ensemble sur le sujet. Les axes chronologique, thématique et personnel (témoignages) sont complétés par un parcours réflectif. C'est ce dernier que je vais tenter d'analyser ici. Prenant la forme de quatre immenses tipis de béton, ces espaces sont disséminés à la croisée des parcours tout au long de la visite.
Nommés, faute de mieux, balises-totems par le musée, ces îlots m'ont plus fait penser à des béances provoqué par la guerre. Je rapprocherai ces espaces singuliers du travail artistique de Jochen Gertz sur les monuments aux morts de 14-18 et sur la Shoah. Je pense aussi aux deux "voids" du musée Juif de Berlin. Si l'on choisit d'entrer, dans la première balise, on peut voir des photographies en noir et blanc ainsi que les négatifs. Celles-ci présentées dans de petites vitrines éclairées insérées un peu partout dans les murs. Ces photographies nous montrent des cadavres de soldats allemands exécutés à Ypres. La force de ces images réside dans la posture des cadavres maintenus artificiellement assis à l'aide de mains d'hommes bien vivantes.
Le visiteur assiste, malgré lui, à une mise en scène d'un corps exécuté comme trophée. Au contact de l'image l'espace devient oppressant. L'impression d'étouffement s'accentue par les effets conjugués de la petitesse des vitrines, de l'artificialité de leurs lumières et de l'action de voir à laquelle nous sommes conviés de réfléchir. Cette réflexion sur le regard sera posée dans chaque balise, déclinée et déclenchée par une action différente.
Balise une et trois, Flanders Fields (c) Anne Hauguel
Dans la troisième balise, le visiteur doit lever la tête. Par ce mouvement, il peut voir, suspendus, tel des visages flottants, des portraits en noir et blanc. Une nuée d'oiseaux immobile et silencieuse : les gueules cassées nous regardent d'en haut. Comme si leurs stigmates, infligés par la guerre, révélaient la puissance fascinante de celle-ci. Comme si, prenant la place de Dieu, la guerre faisait de ces hommes marqués, ses anges monstrueux. Tout en ne pouvant détacher son regard, le visiteur est amené, par le geste et par l'espace, à interroger cette fascination.
Dans la quatrième et dernière balise, le visiteur cherche où regarder et ce qu'il doit voir. Soudain un reflet, le regard plonge et découvre au sol, comme s'il se penchait au dessus d'une tombe ouverte, un squelette étendu sur un lit terreux. Cette photographie en noir et blanc est reflétée par une vitre au dessus d'elle ; la mort se regarde dans un miroir. Et nous, humains, nous regardons la mort se regarder, mais celle-ci, ne nous regarde pas.
Void, bâtiment Libeskind, Musée Juif, Berlin, (c) Anne Hauguel
 Ces quatre balises fonctionnent par des moyens conjugués pour déclencher la réflexion chez le visiteur. Celui-ci doit mouvoir son corps et chercher l'image. Image qui lui montre la mort et la défiguration. L'espace de monstration est pensé comme un lieu de confrontation avec l'image et sa nature horrifique. Ce face à face nous demande d'interroger notre humanité et la mortalité de notre condition. Ces lieux nous appellent à une réflexion dont l'objet est la sacralité de cette humanité que la guerre met littéralement à mort. Cette réflexion, si elle peut être discursive peut aussi se faire sans langage, par le corps et les sensations qu'il subit dans ces espaces singuliers. Ces quatre balises empruntent au même registre que les deux salles vides, les "voids" du bâtiment Libeskind au Musée Juif de Berlin. Etnotamment de cet espace triangulaire et sombre, dans lequel on est amené à entrer avec des gens que l'on ne connait pas, et qui vous dépossède un instant de votre humanité pour vous plonger dans un monde sans langage, vide de sens.Pour penser l'impensable le Flanders Fields fait le choix de la frontalité et de l'action. Ainsi, confronté à la mort, en se déplaçant, le visiteur fait l'expérience de l'horreur indicible. Ici, l'acte de voir est si bien pensé par la muséographie et la scénographie, que le parcours échappe au débat stérile qu’entraîne toujours avec lui un espace strictement voyeuriste.
Ces quatre balises fonctionnent par des moyens conjugués pour déclencher la réflexion chez le visiteur. Celui-ci doit mouvoir son corps et chercher l'image. Image qui lui montre la mort et la défiguration. L'espace de monstration est pensé comme un lieu de confrontation avec l'image et sa nature horrifique. Ce face à face nous demande d'interroger notre humanité et la mortalité de notre condition. Ces lieux nous appellent à une réflexion dont l'objet est la sacralité de cette humanité que la guerre met littéralement à mort. Cette réflexion, si elle peut être discursive peut aussi se faire sans langage, par le corps et les sensations qu'il subit dans ces espaces singuliers. Ces quatre balises empruntent au même registre que les deux salles vides, les "voids" du bâtiment Libeskind au Musée Juif de Berlin. Etnotamment de cet espace triangulaire et sombre, dans lequel on est amené à entrer avec des gens que l'on ne connait pas, et qui vous dépossède un instant de votre humanité pour vous plonger dans un monde sans langage, vide de sens.Pour penser l'impensable le Flanders Fields fait le choix de la frontalité et de l'action. Ainsi, confronté à la mort, en se déplaçant, le visiteur fait l'expérience de l'horreur indicible. Ici, l'acte de voir est si bien pensé par la muséographie et la scénographie, que le parcours échappe au débat stérile qu’entraîne toujours avec lui un espace strictement voyeuriste.
Ophélie Laloy
Merci à Anne Hauguel pour ses photographies
Si vous souhaitez poursuivre la réflexion sur les conditions de monstration de l'indicible : In Flanders Fields Museum - Site web du musée
DIDI HUBERMAN Georges, L'image malgré tout, Les Editions de Minuit, Paris, 2004.
GERZ Jochem, La question secrète. Le monument vivant de Biron, Acte Sud, Paris, 1999.# "Grande Guerre"# Morts#In Flanders Fields Museum

Et si on exposait des oeuvres dans des conteneurs?
C’est le projet lancé par l’entreprise L’Atelier Pandore, située sur Strasbourg et spécialisée dans la valorisation du patrimoine historique, qui réutilise d’anciens conteneurs pour valoriser des collections de musées dans les rues strasbourgeoises, permettant ainsi une accessibilité plus grande à la culture.
Des boîtes originales
Ces « boîtes de Pandore » de 18m2, qui sont en réalité d’antiques conteneurs maritimes réexploités en espaces muséographiques, investissent l’espace public en présentant et faisant vivre des œuvres venant d’une exposition d’un musée local ou faisant référence à la région. C’est ainsi qu’un des conteneurs, qui a renfermé l’exposition Post Mortemdu 17 septembre au 30 octobre dernier, est placé dans le quartier de Koenigshoffen, où des vestiges de nécropole romaine ont été découverts l’année dernière. Produite par l’Atelier Pandore cette expo présente des copies de ces objets romains et met en avant les rituels humains post-mortem.

Exposition Post Mortem dans le quartier de Koenigshoffen, source : Coline Gutter.
Visibles uniquement en extérieur, ces installations répondent aux critères de conservation des collections par la prise en compte des conditions de température optimale, d’hygrométrie et de luminosité, notamment par la mise en place d’une façade vitrée et d’un auvent.
Démocratiser la culture
Le premier objectif de la mise en place de ces installations est de démocratiser la culture en amenant l’art dans la rue et en touchant une population plus éloignée à la fois géographiquement et socialement, des musées. C’est pourquoi le quartier Koenigshoffen, qui se situe en périphérie de Strasbourg, a été choisi.
Ces « boîtes » cassent ainsi les codes muséographiques des institutions classiques en aspirant à une démarche plus moderne et accessible. Pour autant elles ne se présentent pas comme des musées mais davantage comme un outil de mise à disposition des musées, aussi disponible pour tout autre organisme qui souhaite démocratiser et partager sa culture et savoirs.
« La boîte de Pandore est un sachet de thé. Elle diffuse simplement un élément culturel dans une population de façon temporaire. Chacun est libre de la croiser, de s'en inspirer ou d'apprendre de son message ». - L’Atelier Pandore
La première exposition intitulée Athènes Cronenbourgqui s'est déroulée en 2018 dans l’écoquartier La Brasserie à Cronenbourg, a permis d’identifier un réel enthousiasme autour de ces boîtes. En effet, les habitants qui découvraient quatre « boîtes » au pied de leur immeuble ont pu profiter d’animations permettant de les fédérer autour du « Vivre ensemble ».
Néanmoins la boîte du quartier de Koenigshoffen n’est aujourd’hui encore qu’un prototype qui permet de « tester » les retombées en matière de conservation des objets, avant de pouvoir faire voyager le conteneur dans la région.
Qu’est-ce que L’Atelier Pandore ?
Dirigées par Anatole Boule, archéologue de formation, les missions de l’Atelier Pandore s’axent essentiellement sur la mise en valeur du patrimoine historique. Il propose des services de démonstration avec ces fameuses boîtes de Pandore, transformées au Port du Rhin, misent à disposition par la vente ou la location, et qui sont adaptables selon les envies de l’institution. Ainsi cette dernière est libre de choisir l’emplacement, le type de public, la médiation voulue autour de la « boîte ».
Par ailleurs la réalisation d’expositions et d’animations grâce à des partenariats avec graphistes, scénographes ou designers est aussi au cœur des réalisations de l’atelier.
Enfin l’entreprise propose aussi des conseils et études pour trouver des solutions, afin de répondre ensemble à des problématiques de volonté de valorisation d’un patrimoine historique.

Exposition Athènes Cronenbourg dans l‘écoquartier de La Brasserie, source : atelier-pandore.fr.
Retrouvez l’Atelier Pandore sur Facebook.
Image de couverture : Exposition Athènes Cronenbourg dans l‘écoquartier de La Brasserie, source : atelier-pandore.fr.
Tiffany Corrieri
scenographie #accessibilite #strasbourg

Et si vous étiez un moine du XIIème siècle ?
Parmi le riche patrimoine vendéen, on compte de nombreuses abbayes dont celle de Nieul-sur-l'Autise qui se distingue par un personnage important : Aliénor d'Aquitaine. Cette dernière a offert sa protection aux moines en faisant transformer l'abbaye Saint-Vincent en abbaye royale en 1141.
La mise en valeur de ce patrimoine joue moins sur la conservation du bâtiment que sur le fait de faire vivre le patrimoine médiéval par de nombreuses activités de médiation. Après une présentation générale et une visite des bâtiments conventuels, le visiteur change de bâtiment par le jardin et arrive à la maison Aliénor, demeure du XIXème siècle transformée en espace muséographique où règne la nouvelle technologie.
© www.chateaux-story.com
Si le son et les écrans sont présents dans tous les espaces du site, c'est à la maison Aliénor que la médiation est la plus efficace. Le visiteur déjà présent sur le site depuis près d’une heure, peut ainsi prolonger sa visite en continuant à apprendre grâce aux supports ludiques. Après une animation de figurines en 3D projetées sur une bibliothèque, le visiteur arrive dans un espace où de grandes chaires rouges équipées d'écran permettent d'explorer les espaces de l'abbaye, reconstituée virtuellement telle qu'elle était au XIIème siècle.
On pourra d'abord regretter le nombre restreint de place par rapport à l'espace précédent où une dizaine de personnes pouvait sans problème assister à l'animation. Ainsi, à la fin de la projection sur la bibliothèque, il n'y a pas de place pour que chacun puisse participer à cette immersion virtuelle, surtout à la pleine saison. Certains attendent leur tour, d'autres s'installent pour suivre à plusieurs, certains passent leur chemin.
Pourtant cette animation, qui tient autant du jeu vidéo que de la reconstitution permet une immersion dans la vie conventuelle du XIIème siècle. Le scénario est assez simple et efficace. Le visiteur se glisse dans la peau d'un chanoine surpris par un orage et qui se réfugie dans l'abbaye Saint-Vincent le temps d'une nuit. Ce visiteur va pouvoir parler à chaque moine pour découvrir son rôle mais également explorer la réplique d’un monastère du XIIème, tant par ces espaces que par son mobilier. Une carte permet d'identifier les pièces qu'il reste à explorer avant de pouvoir partir.
A l'occasion, les moines répètent des éléments de l'histoire de l'abbaye tout en faisant le point sur leurs fonctions au sein du monastère. Au delà de cet apprentissage de la vie conventuelle, de la gestion du temps et des rôles de chacun, le visiteur est replongé dans l'espace qu'il a quitté un peu plus tôt. Ces espaces ne sont plus des lieux d'exposition dédiés à la sculpture romane ou à la musique mais des lieux de vie monastique : les sculptures du cloître sont complètes, le dortoir a des lits et le réfectoire est ressorti de terre.
L'animation se présente comme un jeu mais ne propose pas d'énigme à résoudre, c'est une simple ballade, un moyen de passer du temps sans trop le perdre mais qui ne propose pas de véritable challenge à l'usager autre que de passer par toutes les pièces. La prise en main du jeu est simple : un joystick à droite, un bouton d'action à gauche. La durée est en moyenne de 15-20mn.
L'expérience montre toutefois que certaines personnes ne finissent pas le jeu. La carte n'est peut-être pas suffisamment mise en avant et l'espace oublié peut-être trop reculé pour avoir envie de retraverser toutes les pièces, même rapidement, pour voir l'animation de fin. On peut aussi évoquer un manque de temps, l'abbaye dispose en effet de nombreux éléments de médiation sur divers thèmes qui constituent un programme trop dense pour une seule visite. Enfin la présentation manque peut-être un peu de fond pour quelqu'un qui aurait déjà bien compris le système de fonctionnement du couvent.
Cette phase immersive par le biais de la visite virtuelle est donc une bonne tentative de médiation sans pour autant être une réussite totale. Pour un néophyte en matière d'abbaye cela sera très intéressant et notamment pour les enfants que la visite virtuelle et la manipulation de l'outil informatique attire.
On peut regretter l'absence de remise à zéro du jeu ainsi que le manque de challenge pour le visiteur. Cela pourrait être comblé par l'extension du jeu, avec un niveau supérieur par exemple, dont le but serait d'aller chercher les espaces précisément avec des check points dévoilant des bonus stimulants. Cela permettrait à un public plus averti, qui ne rechigne pas à jouer, de bénéficier lui aussi d'une médiation ludique.
Coralie Galmiche
Explorons les Monuments Nationaux avec OFabulis !
Vous avez peut-être entendu parler cette année d'OFabulis, le jeu vidéo qui propose une enquête dans les Monuments Nationaux. Dévoilé en juin 2014 pour Futur en Seine, la version finale est sortie le 18 septembre dernier. Ayant simplement entendu parler de ce jeu sur mon fil d'actualité twitter, je n'avais pas eu l'occasion d'y jouer jusqu'aux vacances de fin d'année.
Tout d'abord, qu'est-ce qu'OFabulis ?
Pour ceux qui ne connaissent pas Ofabulis, il s'agit d'un jeu vidéo créé par l'association du Centre des monuments nationaux, du Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines, de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et de la société Emissive. Le jeu se présente à la fois comme un « point & click » (un jeu d'aventure où le joueur résout des énigmes en cherchant avec la souris les indices parmi l'environnement) et un « MMORPG » (un jeu de rôle massivement multijoueurs).
Plus concrètement, le point & click induit une trame sous forme d'enquête, pour tenir le joueur en haleine quand le choix du MMORPG permet à l'utilisateur de créer un avatar, de choisir sa classe et de jouer en collaboration avec d'autres joueurs pour avancer plus rapidement.
Nous pouvons ainsi choisir entre 4 classes, chacune pouvant obtenir des indices différents. Une fois notre compte créé, nous sommes invités à poursuivre une enquête à travers plusieurs monuments français, de la Basilique de Saint-Denis au Mont Saint-Michel en passant par la Villa Savoye. On avance ainsi dans le jeu en trouvant des « clés » pour accéder aux « portes de légende » qui emmènent dans d'autres monuments ou dans des mondes parallèles (les mondes « insaisissables »), sur lesquels se base notre enquête.
Le jeu vidéo mélange 3D, utilisée pour les personnages, 2D pour les décors (il s'agit de photographies en plongée, qui donnent de façon très satisfaisante une impression de 3D) et de captures vidéos, pour les interactions avec les personnages non joueurs (« PNJ »).
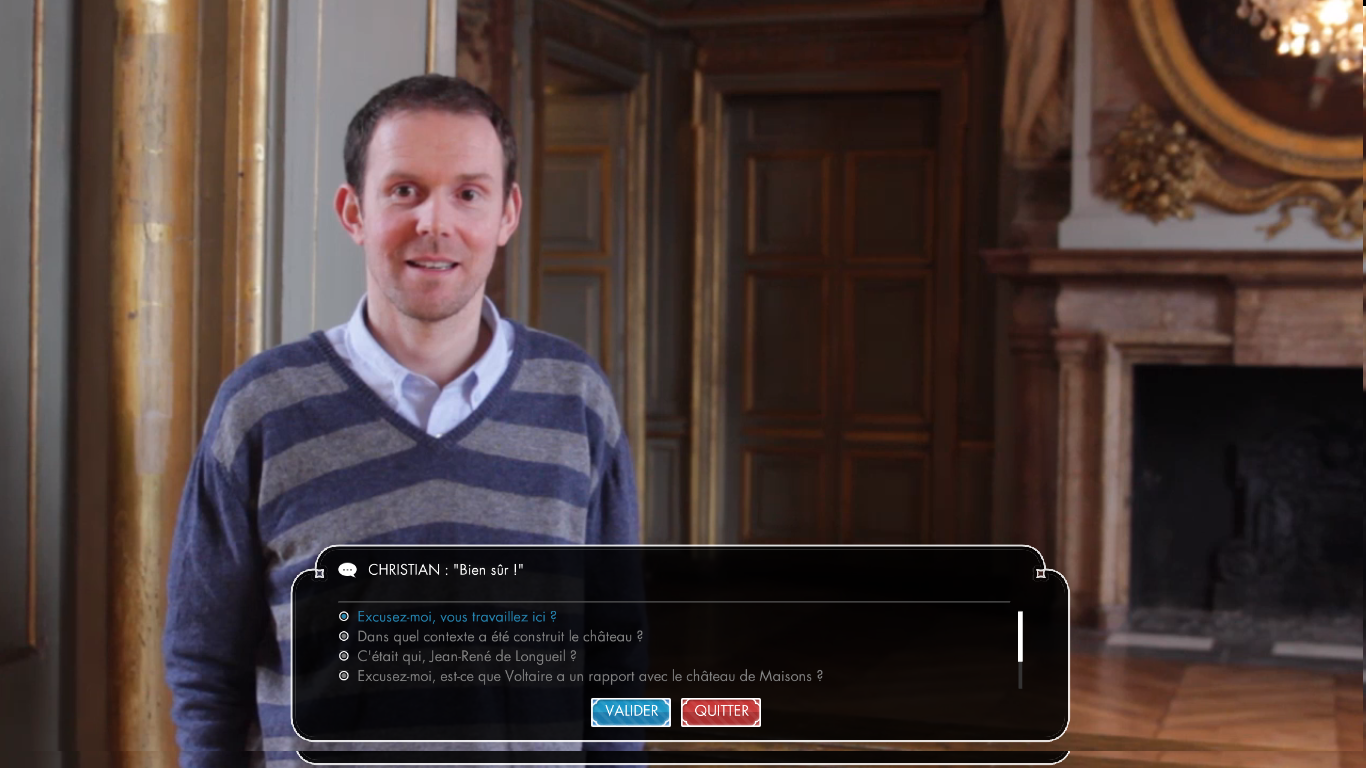
PNJ- guide du Château de Maisons-Laffitte @OFabulis
Quel est l'intérêt de ce jeu ?
OFabulis croise les genres, il utilise les codes du MMORPG : le jeu de rôle massivement multijoueurs n'est pas toujours envisagé sérieusement et n'est pas toujours le mode privilégié pour un serious game dans le domaine de la culture. Voir une initiative culturelle qui marrie jeu vidéo et patrimoine est donc assez rafraîchissant, d'autant plus que le dispositif fonctionne.
Les interactions avec des personnages non joueurs (PNJ), que l'on trouve souvent dans les jeux de rôle, permettent ici de donner les contenus et les indices pour élucider les énigmes. Le fait de pouvoir jouer en groupe pour résoudre des énigmes sur l'histoire de monuments permet une expérience en plus. Nos choix orientent l'avancement de l'intrigue et le jeu présente plusieurs fins possibles.
De plus, qui n'est pas tenté par une enquête mystérieuse au sein d'un ancien lieu de souvenir ? Ce scénario offre une solution plutôt efficace pour intéresser les publics et nous inviter à nous immerger dans une visite virtuelle des monuments nationaux. Nous sommes obligés de récupérer des informations sur les sites et l'histoire pour avancer et trouver les clés, de ce fait en avançant dans l'intrigue, nous incorporons des connaissances sans nous en rendre compte.
Les contenus concernent les monuments, leur histoire mais aussi celle de personnages connus liés à ces derniers, comme par exemple le lien entre le Château de Maisons-Laffitte et Voltaire. Parallèlement, l'exploration de ces monuments qui ont eu une importance dans l'histoire de France donne l'occasion de combler ses lacunes sur celle-ci.
Encore au Château de Maisons-Laffitte, pour trouver la porte de légende, il faut résoudre une énigme sur les ordres architecturaux (les ordres des colonnes doriques, ioniques, corinthiennes..).
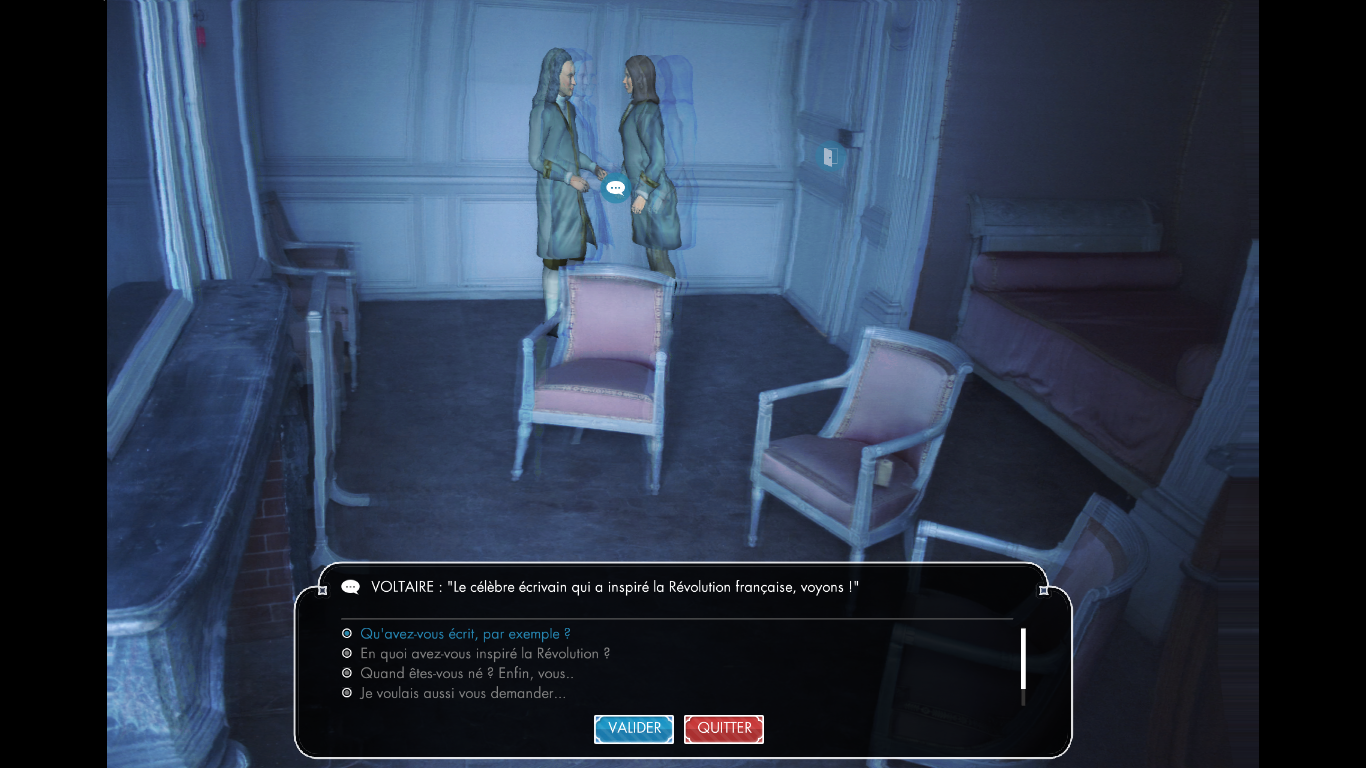
PNJ - Voltaire au Château de Maisons-Laffitte @OFabulis
La masse de contenus que le jeu déploie est assez importante, tout en étant large : les dialogues avec les PNJ par exemple, contiennent des informations très élémentaires concernant certaines époques mais aussi des savoirs plus pointus, le tout condensé dans un dialogue, la somme d'informations qu'un PNJ peut divulguer est donc dense. Cela devient plus compliqué d'interagir pour trouver l'information qui nous intéresse et les dialogues deviennent par la même occasion parfois longs et laborieux.
De plus, les énigmes proposées sont parfois relativement compliquées, et il est possible de rester un certain moment à chercher dans un endroit la clé pour passer dans le lieu suivant. Néanmoins, ces difficultés sont diminuées par le jeu en groupe, qui permet d'avoir plus d'informations (puisque chaque classe a accès à des indices différents), mais aussi de pouvoir s'appuyer sur les connaissances personnelles des autres joueurs.
Si vous jouez seul, l'onglet « partage », qui permet de discuter avec les autres joueurs, pour demander de l'aide pour trouver les clés par exemple, deviendra vite votre meilleur ami, tout comme votre navigateur internet.
Malgré ces difficultés, le jeu est assez prenant et cela nous pousse à persévérer, les difficultés ne sont donc pas forcément décourageantes.

Panthéon @OFabulis
En conclusion, l'enquête est donc une solution plutôt efficace pour intéresser les publics et nous sommes invités à nous immerger dans le scénario du jeu. Cela prouve aussi que ce genre de format pour une initiative peut fonctionner, et ouvre donc la possibilité vers d'autres projets de ce type.
C'est néanmoins un jeu qui se joue en devant prendre des notes pour se souvenir des indices pour trouver les clés potentielles, et si possible en groupe.
Maintenant, il ne reste plus qu'à vous lancer !
N.P
Ofabulis est téléchargeable gratuitement sur internet à cette adresse :
http://www.ofabulis.fr/telecharger.php
#monuments nationaux
# serious game
# numérique

Faites vos Jeux ! Le Musée Olympique de Lausanne
De passage à Lausanne, je ne pouvais manquer le musée le plus connu et le plus visité de la ville. Après deux ans de travaux, le Musée Olympique a rouvert ses portes le 23 décembre 2013 avec trois niveaux consacrés à l'exposition permanente et un niveau pour les expositions temporaires.
Crédits photographiques : CIO
Situé dans un environnement exceptionnel, surplombant le lac Léman, le musée et son parc attire irrésistiblement le visiteur ; de plus le site internet du musée promet une expérience inédite dans un musée totalement ancré dans le XXIe siècle.
Le Musée Olympique de Lausanne n'est pas le seul musée consacré aux valeurs de l'olympisme : il existe même un réseau d'une vingtaine d'établissements à travers le monde. Cependant, celui-ci reste le plus important : en effet, Lausanne a été choisie par le Baron Pierre de Coubertin pour représenter les valeurs de l'olympisme et pour héberger le CIO (Comité International Olympique).

Le parc du Musée Olympique : Les footballeurs, Niki de Saint Phalle – Crédits photographiques : LT
L’exposition permanente : 3 thématiques
Aprèsavoir payé un droit d'entrée plutôt salé (14 euros), je découvre le parcours proposé : trois niveaux, trois thématiques : le monde olympique, les jeux olympiques et l'esprit olympique.
Le premier niveau propose un panorama sur l'incarnation de l'olympisme dans notre société ; l'évolution des jeux, de la Grèce antique à Pierre de Coubertin puis de la création des comités nationaux olympiques à l'engagement des villes hôtes au niveau de l'architecture, des produits dérivés, et des cérémonies d'ouverture. En entrant dans le premier parcours, je suis saisie par la présence d'écrans dans toutes les pièces : les projections, les vidéos explicatives et les bornes numériques sont omniprésentes. Puis je comprends rapidement que le musée a peu de contenu matériel à exposer dans cette partie du musée et qu'ils doivent donc compenser avec beaucoup de contenu multimédia. Malgré cela, ce premier niveau est très chargé : aucun pan de mur n'est laissé vierge et l’information est partout.
Après avoir apprécié une belle collection de toutes les affiches des Jeux Olympiquesqui montrent l'évolution du graphisme selon les pays, j'accède au deuxième niveau qui, selon les dires du musée, est le cœur de l'expérience olympique. Cette partie présente les grands champions olympiques, l'évolution des disciplines et des programmes des Jeux Olympiques d'hiver et d'été. Cette fois-ci, les écrans de toutes tailles côtoient les tenues sportives des grands champions. Le visiteur peut également toucher différents types de revêtements de sol, de semelles et d’équipements selon les sports. Plusieurs bornes numériques sont également à disposition pour rechercher des vidéos d’archives : la base de données contient plus de 1000 séquences pour permettre au visiteur de chercher et de visionner ses moments olympiques préférés. Après un rapide tour d’horizon des Jeux Paralympiques et des Jeux Olympiques de la Jeunesse, je me dirige vers le dernier niveau ; l’esprit olympique.
Ce dernier parcours propose une découverte des entraînements, des régimes alimentaires des sportifs olympiques et de la vie au village olympique. Le quotidien des athlètes est présenté à l’aide d’une vingtaine de bornes numériques qui proposent des témoignages de champions sur leur vie sportive.Les repas des jeux olympiques sont présentés en vitrine sous forme de reproduction en plastique et exposés à la manière des sampuru japonais. Le parcours de l’esprit olympique se termine par un spectacle audiovisuel à 180° sur les valeurs du sport et par une très belle collection de toutes les médailles des Jeux. Un espace est aussi consacré à des exercices d’équilibre, de concentration mentale ou encore de réactivité pour semettre dans la peau des sportifs, espace très ludique et pris d’assaut par les familles. Par ailleurs, des jeux ponctuent tout le parcours de l’exposition permanente ; des quizz sur des bornes numériques ou encore des boîtes noires où l’on peut enfoncer sa main pour deviner quelle torche ou quelle médaille olympique se cachent. L’exposition permanente se termine par un réel podium des Jeux de Sydney 2000 où chaque visiteur peut se faire prendre en photo sur la plus haute marche : le musée a vraiment su répondre à la fois aux attentes des enfants et des adultes.
En sortant de l’exposition permanente et avant de me diriger vers l’exposition temporaire, je réfléchis à tout ce que je viens de voir, et à l’expérience d’un « musée du XXIe siècle » que l’on me proposait. Pendant ces deux heures passées dans les trois parcours, je me suis beaucoup amusée, mais cela ne m’a pas donné matière à réfléchir ; avec tous les jeux et les expériences du parcours, je me suis parfois plus sentie dans un parc d’attractions que dans un musée. Cependant, le musée fourmille de bonnes idées en matière de scénographie et d’outils numériques, malgré une trop forte omniprésence du multimédia de mon point de vue. De plus, la grande hétérogénéité des publics pose une difficulté au musée ; quel discours adopter pour parler tant aux passionnés de sport qu’aux simples curieux ? L’établissement relève ce défi haut la main avec des contenus ni trop basiques ni trop techniques et assez intéressants pour capter l’attention de tous.
Enfin, ce qui m’a le plus dérangé dans l’exposition permanente, c’est l’aspect prosélyte du discours du musée ; les valeurs olympiques sont érigées en paroles saintes et aucun des drames qui se sont déroulés lors des Jeux Olympiques ne sont évoqués ne serait-ce que pour rendre un hommage (décès de certains athlètes, massacre de Munich au JO de 1972, attentat des JO d’Atlanta 1996). Pourtant ces événements font bel et bien partie de l’histoire des Jeux Olympiques.
L’exposition temporaire : Courir après le temps
(du 05 juin2014 au 18 janvier 2015)
Affiche "Courir après le Temps" - Crédits photographiques : CIO
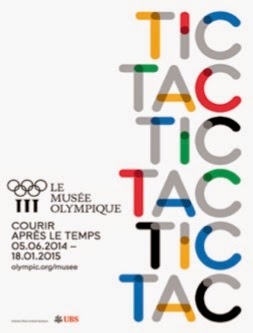 Je décide de terminer ma visite par l’exposition temporaire « Courir après le temps ». L’espace d’exposition est plus calme et moins bondé que le parcours permanent. L’exposition est organisée en neuf thématiques autour de l’évolution de la notion du temps dans le sport à travers les âges, tant au niveau social, artistique et technologique. Le parcours de l’exposition m’a semblé très bien pensé : à la place de choisir un parcours chronologique sur l’évolution de la notion de temps, les concepteurs ont préféré découper en neuf différents types de temps. Au fil des espaces, j’ai donc pu découvrir entre autres le temps cyclique, le temps linéaire mais également le temps de l’athlète et le temps sportif.
Je décide de terminer ma visite par l’exposition temporaire « Courir après le temps ». L’espace d’exposition est plus calme et moins bondé que le parcours permanent. L’exposition est organisée en neuf thématiques autour de l’évolution de la notion du temps dans le sport à travers les âges, tant au niveau social, artistique et technologique. Le parcours de l’exposition m’a semblé très bien pensé : à la place de choisir un parcours chronologique sur l’évolution de la notion de temps, les concepteurs ont préféré découper en neuf différents types de temps. Au fil des espaces, j’ai donc pu découvrir entre autres le temps cyclique, le temps linéaire mais également le temps de l’athlète et le temps sportif.
Par rapport aux espaces de l’exposition permanente, le contenu multimédia ne prend pas le pas sur le discours de l’exposition et les explications sont rigoureusement scientifiques et compréhensibles malgré la difficulté d’expliquer la notion de temps. Des objets exposés illustrent très bien les propos tenus : une copie conforme en 3D du Mécanisme d’Anticythère pour illustrer la notion de temps pendant les Jeux Antiques, de très belles chronophotographies de Marey pour découper le mouvement des athlètes, ou encore différentes machines qui ont chronométré les épreuves durant les Jeux Olympiques modernes. L’exposition est également ponctuée de photographies évoquant la performance des sportifs, la notion de record mais également des photofinish (photographie de lignes d’arrivée où il est impossible de déterminer à l’œil nu quel athlète l’a franchie en premier). Le contenu multimédia est moins ludique avec des bornes numériques diffusant des interviews d’artistes, de philosophes et de scientifiques sur la notion de temps, et avec des projections de très belles vidéos : « le temps de l’attente » et « le temps du départ » entre autres.
L’exposition se termine sur une œuvre de l’artiste Michelangelo Pistoletto, L’Etrusque. Cette sculpture placée face à un miroir est censée représenter le temps linéaire ; le passé, le présent et le futur.
Malgré un discours de propagande qui érige les valeurs olympiques sur un piédestal qui m’a quelques fois un peu dérangée, je vous conseille de ne pas manquer ce musée si vous êtes de passage à Lausanne ne serait-ce que pour la scénographie soignée et la multiplicité des outils numériques. De plus, vous vous amuserez très certainement dans l’exposition permanente et vous apprendrez beaucoup dans l’exposition temporaire qui est très bien conçue. Cependant, si l’aspect commercial de ce musée et les Jeux Olympiques vous rebutent, profitez du magnifique parc et dirigez-vous vers le Musée de l’Elysée (Musée de la Photographie) qui est situé juste au-dessus du Musée Olympique !
LT.
#olympisme
#sport
#multimédia
Pouraller plus loin :
http://www.olympic.org/fr/musee : Site internet du Musée Olympique
http://www.olympic.org/fr/content/le-musee-olympique1/decouvrir/presse/dossiers-de-presse/dossier-de-presse-courir-apres-le-temps/ : Dossierde presse de l’exposition Courir après le Temps

File ta bobine à La Manuf'
Le récit d’une aventure humaine et technologique, à renfort d’énergie et de fils
C’est avec un très grand plaisir que j’ai participé à l’édition Museomix Nord 2015. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Museomix est un rassemblement de 3 jours, pendant lesquels des personnes d’horizons divers et variés revisitent un musée en proposant des idées neuves, parfois un peu loufoques, souvent futuristes et généralement participatives et interactives. Le but ? Repenser le musée, le recentrer sur l’expérience du visiteur, en repoussant les barrières technologiques, pour innover et le rendre toujours plus attractif.
Du 6 au 8 novembre, La Manufacture de Roubaix (alias La Manuf’) a accueilli une cinquantaine de museomixeurs dans ses locaux. Ce musée, qui prend place dans une ancienne usine de textile, présente une très belle salle des machines, allant du métier à tisser médiéval (reproduction du XIe siècle) à une machine de la fin des années 1990. Chaque machine est sublimée par un jeu de lumières sur les multiples fils qui se déploient tels des rideaux autour d’une scène. Et les couleurs des bobines donnent parfois à l’ensemble un aspect d’arc-en-ciel.

@Ndgh59
Mais revenons à nos moutons… ou plutôt à nos bobines. Laissez-moi vous présenter notre équipe des Embobineurs et notre prototype File ta bobine !
Pendant ces trois jours, j’ai fait partie de l’équipe des Embobineurs en tant que communicante, au côté de Céline (coach bien-être et santé), Manon (archiviste méticuleuse), Gautier (graphiste de la mort), Charlotte (médiatrice bricoleuse), Pierre (fabricant menuisier) et Alex (DJ codeur de l’extrême).

@FileTaBobine
Nous avons eu la volonté de tisser du lien entre le passé et le présent, entre le visiteur actuel du musée et l’ouvrier de l’usine, entre l’Homme et la machine. Pour cela, nous avons choisi de nous installer en début de parcours afin d’emmener le visiteur dès le début de son expérience muséale.
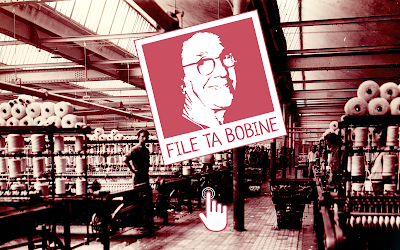
@FileTaBobine
A travers une installation faite de fils et de tissus, notre prototype propose au visiteur de devenir Suzanne l’ouvrière, la petite Philomène, Yahya l’ouvrier immigré, Israël le patron ou le jeune Alfred. Grâce à un écran tactile, chaque visiteur choisit le profil d’un de ces anciens acteurs de l’usine. Il accède ensuite à une photo d’époque.
Grâce à une webcam, son visage vient s’incruster dans celle-ci. Une carte d’ouvrier s’imprime, et donne des informations complémentaires au visiteur : caractéristiques physiques, origine, adresse, année d’embauche, profession, observations du chef du personnel, machine attribuée dans le parcours d’exposition.

@FileTaBobine
Par la suite, le visiteur effectue sa visite avec sa carte d’ouvrier. Il peut alors se confronter à la machine sur laquelle il aurait travaillé s’il avait été ouvrier à l’époque. A la fin de son parcours, s’il le souhaite, le visiteur vient accrocher sa carte d’ouvrier sur l’installation. Il s’insère ainsi dans un tissu de visiteurs actuels du musée et d’anciens acteurs de l’usine.

@FileTaBobine
Et sinon, concrètement, les trois de jours de Museomix, comment ça se passe ?
J1
Après un accueil sympathique, une distribution de tote bag et de badges (dont un magnifiquement tricoté), nous avons eu le droit à une visite guidée de La Manuf’, suivie de la présentation des partenaires : La Piscine de Roubaix, l’Ecomusée de Fourmies, les Archives du Monde du travail de Roubaix, Holusion, Tri-D, et TXRobotic.
Ensuite, sur des thématiques prédéfinies, les museomixeurs inscrivent des mots, des idées grâce à des post-it. Une fois ce grand brainstorming effectué, chacun pose son badge devant la thématique qu’il préfère, et un bingo géant permet de constituer les équipes, qui se compose de 7 personnes : un coach, un expert en contenus, un graphiste, un médiateur, un communiquant, un codeur, et un fabricant.
Le reste de la journée permet de réfléchir et d’échanger en équipe autour de ce sujet. Le temps passe alors très vite. Beaucoup d’idées se succèdent, s’entremêlent. L’équipe s’approprie le sujet, une trame commence à prendre forme, un scénario utilisateur apparait et, ensemble, nous validons notre idée de prototype pour la présenter plus tard en plénière.

@Ndgh59
J2
Le deuxième jour, une fois les rôles précisés, la phase de réalisation commence. Une liste de course est établie pour réaliser notre prototype. Un compte Twitter spécifique devient notre relais de communication, à grand renfort de photos. Une partie de l’équipe se lance dans la fabrication d’une maquette afin de se confronter aux contraintes techniques de la future réalisation.
L’un code, un autre définit l’identité visuelle… pendant qu’un dernier part récolter des informations dans les archives. La rédaction s’initie. Nous discutons, rigolons… La fatigue commence aussi à se faire sentir. Vient ensuite le moment de créer une vidéo pour présenter notre idée le soir en plénière. Après le dîner, certains membres de l’équipe commence à scier, viser et peindre, pendant que les autres continuent à coder, rédiger, photoshopper…
J3
Après quelques heures de sommeil vient le troisième et dernier jour. Un seul mot d’ordre : foncer ! A peine arrivé, chacun saute sur les pinceaux, les ciseaux, l’agrafeuse, la scie sauteuse, la perceuse et plusieurs d’entre nous attaquent le montage et la mise en place de la structure. Pendant ce temps, le codeur et le graphiste continuent leurs travaux respectifs.
La pression monte, l’équipe ne s’arrête pas. En début d’après-midi, nous réalisons un crash test avec les organisateurs et l’équipe du musée. Cela permet de faire le point sur l’accompagnement et la médiation des futurs visiteurs. Le codeur se confronte aux bugs et problèmes techniques de dernières minutes.
Et tout d’un coup, il est déjà 16H et les premiers visiteurs arrivent. Commencent alors les explications, la médiation, les échanges, les derniers réglages… Tout se passe dans la bonne humeur. Nous sommes très contents d’avoir réalisé tout cela en 3 jours, malgré la fatigue ; et les sourires des visiteurs nous le rendent bien.

@MuseomixNord
Comment en savoir plus ?
Je vous invite vivement à consulter les comptes Twitter de chacune des équipes de Museomix Nord pour découvrir tous les prototypes, et je remercie toute l’équipe de @MuseomixNord et de@LaManufRBX pour cette aventure intense, pleine d’énergie, d’idées, de bonbons et d’innovation !
@FileTaBobine @rrroubaix @TextileFutur @MiniJacquard @EnTrame @Industructibles
Nadège Herreman
Vous pourrez aussi par la suite retrouver les fiches de tous les prototypes sur le site de Museomix : http://www.museomix.org/les-prototypes/
#Museomix
#Innovation
#Prototype
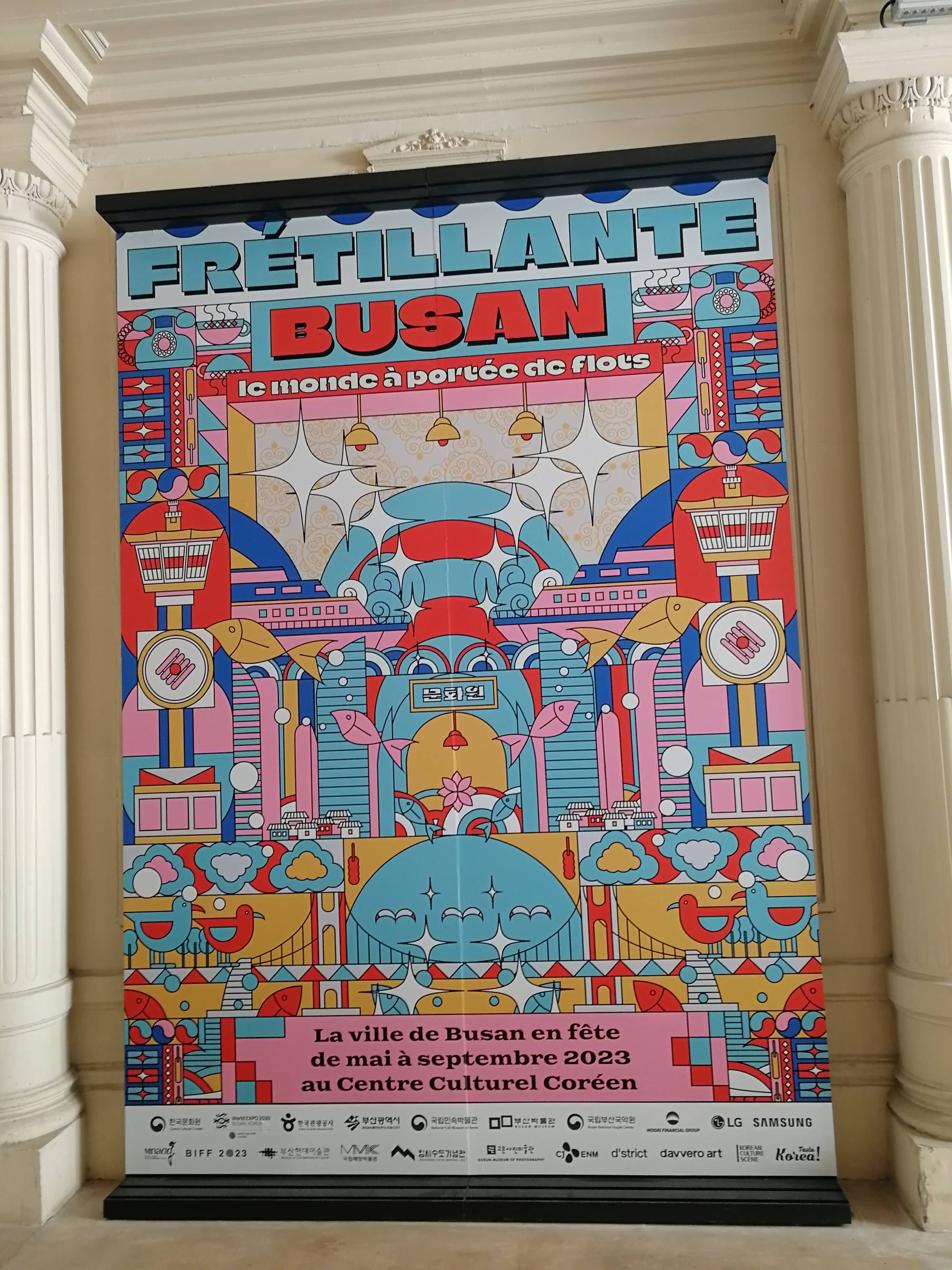
Frétillante Busan, le monde à portée de flots au Centre Culturel Coréen de Paris
Comment mettre en lumière Busan, candidate à l’Exposition Universelle de 2030 ?
En 2021, la Corée du Sud a inscrit la ville de Busan comme candidate à l’Exposition Universelle de 2030 auprès du Bureau International des Expositions. Depuis, dans cette optique, de nombreuses actions sont menées par le gouvernement sud-coréen pour promouvoir la ville de Busan par-delà les frontières.
Busan est une ville au sud-est de la péninsule ; elle abrite un port international d’importance. Le choix de cette ville est essentiel et souligne l’ouverture du pays vers l’extérieur : un choix politique, économique et culturel. Sa situation géographique est essentielle face à la mer, élément que le visiteur peut observer dès son arrivée.
De mai à septembre 2023, le Centre Culturel Coréen de Paris a relevé un challenge : mettre en lumière et présenter Busan dans le cadre d’une exposition temporaire.
La technologie au cœur du parcours de visite
La construction du parcours de visite prouve au visiteur que la Corée est une puissance moderne et innovante. Busan nous est présentée comme une ville entre tradition et modernité grâce à de nombreux dispositifs numériques disposés dans les espaces d’exposition et particulièrement au rez-de-chaussée.

Vue de l’exposition ©CM
Un paravent dans sa symbolique est un écran ou un passage entre les différentes temporalités et les espaces.
Un « paravent digital » est l’un des premiers éléments qui accueille le visiteur. Le paravent permet à la fois de dissimuler la suite de la visite et en même temps de donner envie d’aller plus avant et de le contourner, pour partir à la découverte de l’exposition, de Busan et de la Corée. La scénographie s’inspire de l’habitat traditionnel coréen en reprenant un élément de mobilier incontournable de la vie quotidienne, comme j’ai pu en admirer au Musée Guimet dans la collection coréenne.
Cet élément du mobilier coréen est constitué de cinq écrans ou cinq tableaux virtuels animés, fruit du travail de l’artiste Kim Jaewook. Ce dernier a brossé un portrait moderne de Busan et de ses principaux monuments de manière atemporelle. Le visiteur est invité à s’asseoir pour prendre le temps d’admirer ces paysages digitaux. Il peut y découvrir l’identité bien spécifique de la ville, une géante composée de plus de 3 millions d’habitants. Constituée de 15 arrondissements, elle était, pendant un moment, considérée comme la capitale de la Corée.
L’art au centre de l’exposition
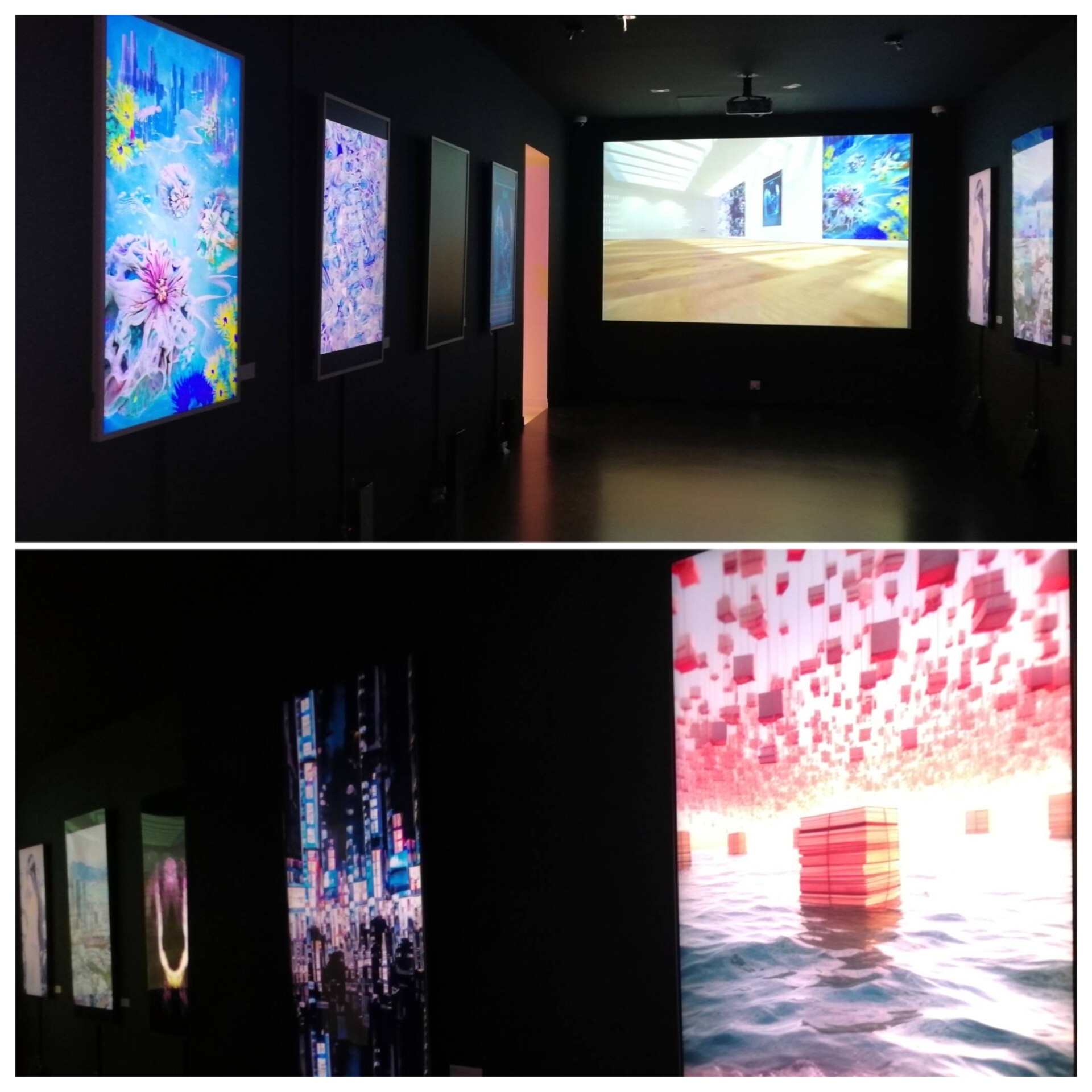
Vues de la salle « Busan à l’heure de l’intelligence artificielle » ©CM
Le paravent, une fois contourné, ouvre alors une perspective sur un second espace dédié au monde virtuel dans la salle d’exposition suivante. Ce sont cette fois des NFT « Non Fungible Tokens » qui investissent la salle. Les œuvres digitales de huit artistes sont accrochées sur les murs, toutes inspirées par des ambiances de la ville de Busan. L’écran du fond est différent car il représente une véritable mise en abime de la salle.
Les artistes coréens, américains et français, sollicités par le Centre Culturel Coréen Agoria, Booyasan, Bosul Kim, CSLIM, Ivona Tau, JuneK, HyeGyung Kim et Sasha Stiles proposent des compositions artistiques numériques.
Pour poursuivre le parcours, le visiteur traverse une « AR Photozone » une zone conçue pour être filmée grâce à la réalité augmentée. Ce dispositif permet au visiteur de voyager en Corée virtuellement et d’immortaliser ce moment en publiant les images capturées sur les différents réseaux sociaux avec les hashtags appropriés.
Ces espaces du rez-de-chaussée, restent placés sous le signe du numérique et démontrent que la Corée est un pays à la pointe de la technologie. La revendication est très nettement marquée et cela transparaît dans la muséographie choisie. Le visiteur découvre une exposition « culturelle et mémorielle ».
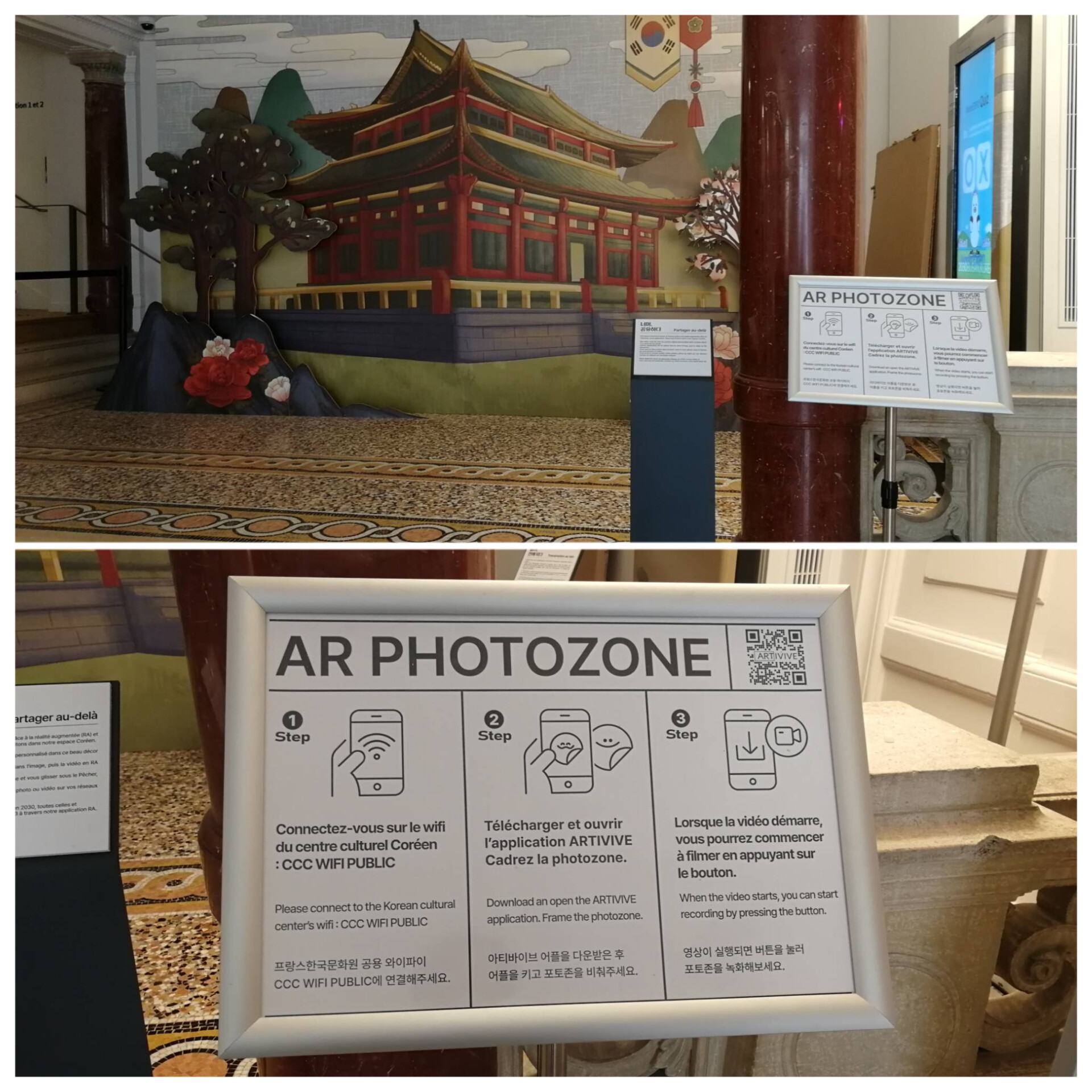
Vues de l’AR Zone (zone en réalité augmentée) ©CM
Une immersion dans la Corée des années 50 grâce à la reconstitution
Le Centre Culturel Coréen a également opté pour le parti pris de la reconstitution afin d’immerger le visiteur dans la Corée d’autrefois. De nombreux objets ont été collectés par l’équipe pour recréer des espaces aux ambiances uniques bien loin de la Corée d’aujourd’hui incarnée par la K-pop. Au rez-de-chaussée, c’est un café/salon de thé qui a été reconstitué à l’identique. Vinyles, vieux livres et magazines d’époque ont été rassemblés dans cet espace pour recréer l’ambiance du lieu. Certains professionnels de l’équipe ont contribué à cette collecte d’objets anciens en y ajoutant leurs effets personnels : le collectif est au service du pays, de la nation. Ce café a même été ouvert une dizaine de jours pour faire découvrir les saveurs de Busan.

Vue de l’exposition ©CM
A l’étage, le visiteur peut entrer dans le célèbre café « Mildawon ». Ce café est caractéristique de l’époque de la Guerre de Corée, période tragique de l’histoire marquée par un exode important de réfugiés vers la ville portuaire de Busan. Dans cette deuxième plus grande ville de Corée s’est alors développée toute une vie artistique et culturelle et notamment grâce à ces cafés/salons de thé. Au cours de cette période sombre de l’histoire, ces lieux ont permis à la population de se réunir et de s’adonner à des activités artistiques et créatives, d’où l’importance de reconstituer ces endroits symboliques où le visiteur va pouvoir déambuler comme s’il se trouvait un peu chez lui grâce aux objets présentés dans un lieu familier, un salon.

Vues de l’exposition © CM
Une mise en exergue des traditions et de la vie quotidienne : une exposition sociale

Vues de l’exposition © CM
Au sein de l’exposition, les vitrines et les cartels sont mis en parallèle avec des photographies d’archives, des écrans, des images projetées qui représentent la réalité des conditions de vie des Coréens : dans les usines, la réparation des bateaux au port par les femmes. Les objets visibles dans les vitrines sont mis en lien avec leur fonction et surtout leur lieu de fabrication.

Vues de l’exposition © CM
Frétillante Busan est une exposition à la présentation dynamique. Les panneaux qui abordent l’art culinaire coréen sont introduits aux visiteurs de manière originale : les bols, les récipients, les coupelles sont accrochées en relief, les plateaux de table sont quant à eux fixés à la verticale. Cela donne aux visiteurs une perspective déroutante.
La thématique de l’alimentation et des ressources halieutiques est mise en valeur avec des dispositifs avec des témoignages de travailleurs projetés sur écrans. La scénographie permet de rendre vivants les objets disposés et les coquillages dans les récipients, à travers les reportages proposés sur les écrans.
Une exposition caractéristique du Soft-Power coréen
La Corée du Sud connaît aujourd’hui une popularité accrue notamment grâce au phénomène hallyu ou vague coréenne et grâce à l’industrie de la K-pop. La péninsule est connue internationalement à travers le monde dans d’autres domaines tels que le cinéma ou encore la gastronomie. « Portée par les succès industriels de Samsung, LG ou Hyundai à partir des années 1990, la Corée du Sud a rejoint les « dragons asiatiques » et gravi les échelons du capitalisme mondial. En cinquante ans, ce territoire considéré comme l’un des pays les plus pauvres du globe est passé au rang de onzième puissance économique mondiale, balayant la planète de son irrésistible soft power. »(Le Nouvel Observateur, 2019)
Les actions menées pour promouvoir Busan dans le cadre de sa candidature à l’Exposition Universelle de 2030 offrent l’opportunité à la Corée de rayonner encore davantage et de diffuser un certain Soft-Power par le biais d’expositions comme Frétillante Busan, le monde à portée de flot. Le pays du matin clair veut montrer au monde qu’il est devenu une puissance mondiale à la suite du miracle économique. « En 1910, quand l’Empire colonial japonais annexe la Corée, c’est à Busan qu’il amarre et débute sa conquête. Captive pendant trente-cinq ans, la ville se modernise malgré elle. Jusqu’à l’indépendance, en 1945, ses habitants sont privés du droit de parler leur langue et sont forcés d’abandonner leurs noms au profit de patronymes nippons. Les industriels d’Osaka ont même essayé de leur interdire de porter du blanc – la couleur traditionnelle des vêtements – pour écouler un stock embarrassant d’étoffes colorées. »(Le Nouvel Observateur, 2019)
La Corée souhaite également partager des nouvelles valeurs modernes écologiques, se placer en avant-garde, en prônant une exposition qui se veut moins polluante, tout en alliant adroitement les nouvelles technologies.

Vues de l’exposition © CM
Loin d’être une exposition figée sur le passé ou centrée sur la modernité, l’objectif muséal ici est de mettre en exergue la force, la volonté et le dynamisme d’un petit pays incarné par la ville de Busan, qui a su tirer les enseignements du passé pour se tourner vers l’avenir même si, à travers l’agencement de certaines salles l’exposition reste encore traditionnelle. Le visiteur reste également encore un peu passif et n’interagit pas toujours par le biais de dispositifs multimédias.
Pour autant, cette Corée au puissant Soft-Power ne renie pas son passé et fait écho dès le début du parcours à sa présence à l’Exposition Universelle de Paris en 1900 avec son pavillon coréen qui permit pour la première fois de faire connaître la péninsule coréenne au public français. L’ouvrage Li Chinécrit par l’auteure Shin Kyung-Sook développe plus avant le début des relations franco-coréennes et revient sur la vie du premier diplomate français en Corée : Victor Collin de Plancy.
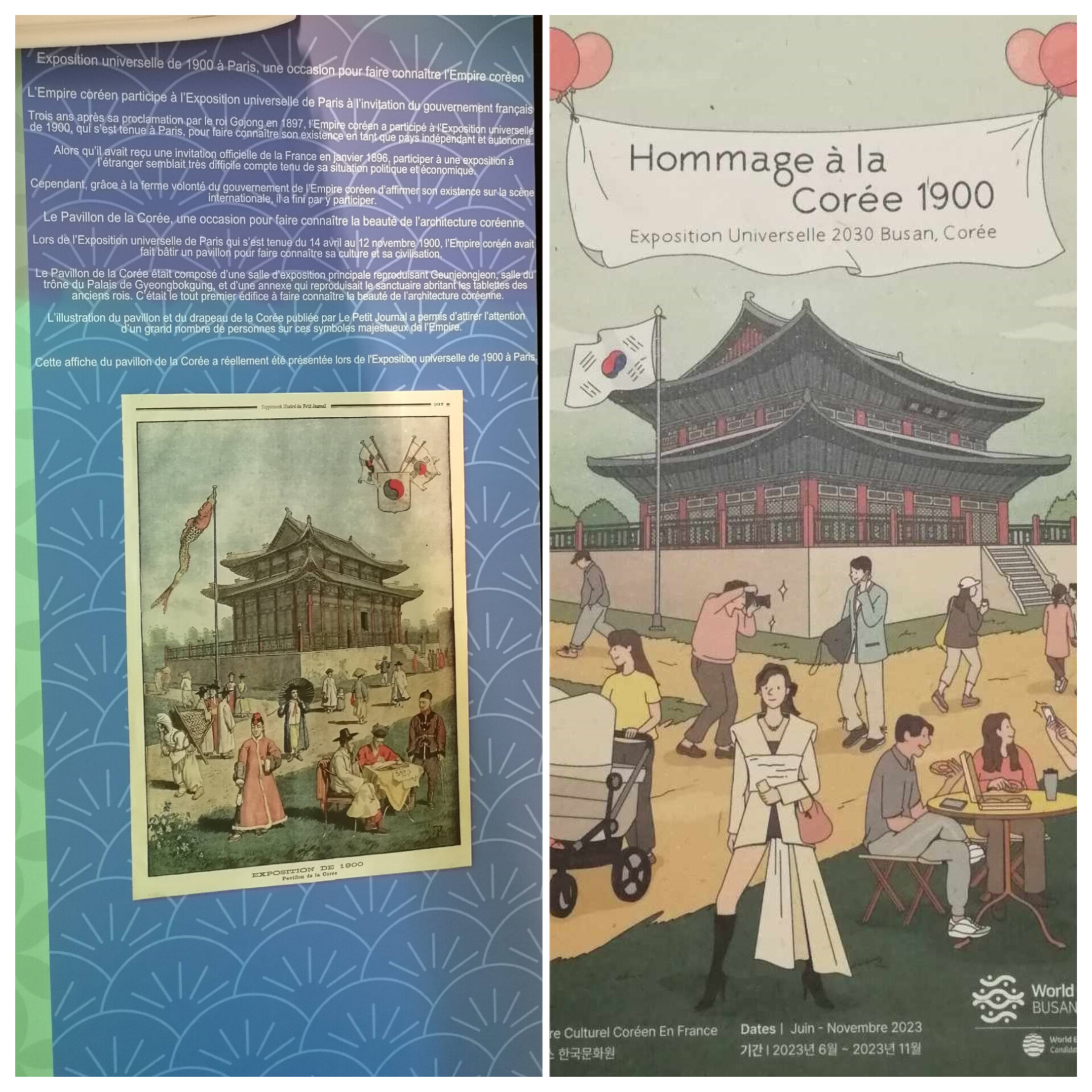
Affiche originale du pavillon de la Corée en 1900 et nouvelle affiche « Hommage à la Corée 1900 » ©CM
Millie CHIRON
Pour en savoir plus :
-
https://www.coree-culture.org/modification-de-date-fretillante,5591
-
https://french.korea.net/NewsFocus/Culture/view?articleId=233223
-
https://www.nouvelobs.com/voyage/20191029.OBS20416/a-la-decouverte-de-busan-l-enigme-sud-coreenne.html
-
https://flickr.com/photos/dalbera/48576138417/in/album-72157625713760989/
-
Shin, Kyong-Suk (2010). Li Chin. Editions Philippe Picquier, 576pp (Picquier Poche).
-
Min Jin Lee (2022). Pachinko. Editions Harpercollins, 640pp (Poche).
#worldexpo2030 #Busan #Corée

Goya, une expérience de l'écoresponsabilité du palais des Beaux-Arts de Lille
À l’heure où le développement durable est au cœur des préoccupations, le Palais des Beaux-Arts de Lille propose pour la première fois une exposition écoconçue. L’ensemble est un dialogue entre œuvres picturales et cinématographiques plus contemporaines, s’inspirant de la vie du peintre. Et au cœur de cette exposition, deux toiles Les Jeunes et Les Vieilles du peintre espagnol Francisco Goya, que l’exposition décadre.
Image de couverture : Expérience Goya, atrium du Palais des Beaux-Arts © Marion Blaise
L'écoconception d'une exposition
Le développement durable est, selon l’INSEE, « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». L’enjeu est un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Répondre à ces trois problématiques, c’est le défi que s’est lancé le Palais des Beaux-Arts de Lille pour sa nouvelle exposition temporaire Expérience Goya. Soucieux de l’environnement, le musée souhaite maîtriser son impact environnemental et avoir une portée sociale forte.
La scénographie des expositions temporaires entraîne généralement de gros coûts financiers et environnementaux pour un temps court. Pour cette exposition, au moins 70% de la scénographie de la manifestation sera réutilisée pour les deux ou trois prochaines expositions temporaires du musée. C’est du moins ce qui est expliqué aux visiteurs dans un espace-couloir limitrophe à l’exposition.
Si les expositions temporaires sont souvent propices au transport d’œuvres dans le monde entier, l’Expérience Goya limite cette pratique. Les deux œuvres phares de l’exposition, Les Jeunes et Les Vieilles viennent des collections du Palais des Beaux-Arts tout comme la série d’eau forte Les Caprices, dont quatre-vingts planches sont conservées dans les réserves. Seulement deux tableaux ont été transportées par avion. Les prêts sont réalisés avec des pays très proches de la France comme la Belgique, l’Allemagne et l’Espagne. Le musée met en place cette volonté nouvelle de créer des expositions avec des musées voisins, en gardant toujours la qualité scientifique et esthétique comme principales préoccupations.
La volonté de médiation s’exprime à travers l’écriture des cartels. Ceux ne sont pas des cartels classiques qui sont proposés, comprenant le titre et la description de chaque œuvre, mais des cartels qui entrent dans un véritable parcours, celui de la vie et de l’œuvre de Goya. Cette proposition répond à l’enjeu social donnant le maximum de clés de compréhension aux visiteurs : contexte historique, contexte de réalisation de l’œuvre, réflexion du peintre.
Pour l’Expérience Goya, la musique, avec les ambiances sonores composées par Bruno Letort spécialement pour l’exposition et la projection vidéo sont utilisées consciemment, appuyant l’expérience du visiteur sans éclipser les peintures et les dessins présentés. Le numérique, bien présent dans l’exposition, dans la rotonde et sur les deux écrans géants au début et à la fin de la visite, engendre une pollution importante au même titre que le transport des œuvres ou la construction scénographique. Le Palais des Beaux-Arts de Lille utilise consciemment cet outil, comme support de compréhension pour le visiteur, mais somme toute uniquement sur trois grands écrans et sans dispositifs numériques tactiles moins collectifs. L’éclairage fort présent et nécessaire dans cette scénographie de l’ombre sublime les deux toiles, pièces maitresses du musée, dans une mise en scène finale qui clôt l’exposition en mettant à hauteur de visiteur et dos à dos ces toiles que l’habitué du musée ne voit que côte à côte et en hauteur.
Goya
L’exposition Expérience Goya invite à une plongée dans la vie de l’artiste. Deux œuvres, Les Jeunes et Les Vieilles, permettent de concentrer à elles seules l’histoire et la vie du peintre. Centrales dans le propos, elles ne sont pourtant présentées qu’à la fin, décadrées, dos à dos dans une salle circulaire.

Expérience Goya au Palais des Beaux-Arts de Lille © Marion Blaise
Francisco Goya est né en 1746 à Fuendetodos. Il épouse en 1773 Josefa Bayeu et de 1775 à 1792, la série des cartons de tapisserie pour la Manufacture Royale. En 1780, Goya est élu à l’académie royale des Beaux-Arts de Madrid. Il devient alors portraitiste de la noblesse espagnole et le peintre de la chambre du Roi en 1789.
En 1792 Goya devient sourd et cet incident marque un véritable tournant dans ses œuvres. En 1797 la série d’estampes Les Caprices est imprimée, dévoilant son regard sur la société espagnole. Dali réinterprète ces Caprices, en 1977, exagérant les symboliques posées par Goya. La scénographie de l’exposition permet aux visiteurs une lecture comparée des deux séries.

Expérience Goya au Palais des Beaux-Arts de Lille © Marion Blaise
En 1808, Goya assiste à la guerre d’Indépendance d’Espagne, en décembre, Madrid se rend à Napoléon. Peintre du roi, Goya réalise des portraits de la famille de Charles IV, ce dernier étant contraint d’abdiquer avec Napoléon.
Témoin de cette période de guerre, Goya en retranscrit l’horreur dans ses peintures qui représentent des scènes funestes et macabres. La folie des asiles lui inspire la série d’eaux-fortes Les Désastres de la guerre. Au Palais des Beaux-Arts, les murs mauves et l’ambiance sonore lourde retranscrivent parfaitement l’atmosphère de la vie de l’artiste que l’on découvre au fil de l’exposition.
Bien après sa mort, Goya continue d’influencer de nombreux artistes, des cinéastes s’appuient sur des œuvres, ou des évènements de sa vie. Une dizaine d’extraits de films sont présentés au début et à la fin de l’exposition. Des extraits des fantômes de Goya, de Milos Forman en 2006, de Goya à Bordeaux, de Carlos Saura en 1999, de Mr. Arkadin, de Orson Welles en 1955, de Goya, l’hérétique, de Konrad Wolf en 1971 et de Passions, de Jean-Luc Godard en 1982, introduisent l’exposition pendant dix minutes. Cette dernière se conclut par d’autres extraits, plus sinistres, à l’image du propos, tel que Le Gasanova de Fellini, de Frederico Fellini en 1999, Tale of Tales, de Matteo Garrone en 1955, et qu’Il était une fois dans l’ouest, de Sergio Leone en 1982. En Espagne, les récompenses de cinéma sont d’ailleurs surnommées les Goyas.
« Maintenant je ne crains plus les sorcières, ni les esprits, ni les fantômes, ni les géants fanfarons, ni les poltrons, ni les malandrins, ni aucune classe de corps, je ne crains rien ni personne exceptés les humains… » Goya, avant 1789.
L'immersion
Outre l’ambiance sonore et des murs sombres évoquant la vie difficile du peintre, le musée propose aux visiteurs une immersion gratuite dans la vie de Goya dans l’atrium. Nous concluons sur cette véritable introduction à la vie de Goya, une rotonde qui de fait ouvre l’exposition. Sur l’extérieur de cette rotonde, une frise circulaire retrace en quarante dates la vie de Goya, la vie des deux toiles Les Veilles et Les Jeunes que possède le musée, et l’influence contemporaine de Goya notamment sur des peintres et des cinéastes. En son intérieur, la rotonde immersive propose à presque 360 degrés une expérience des tableaux du peintres.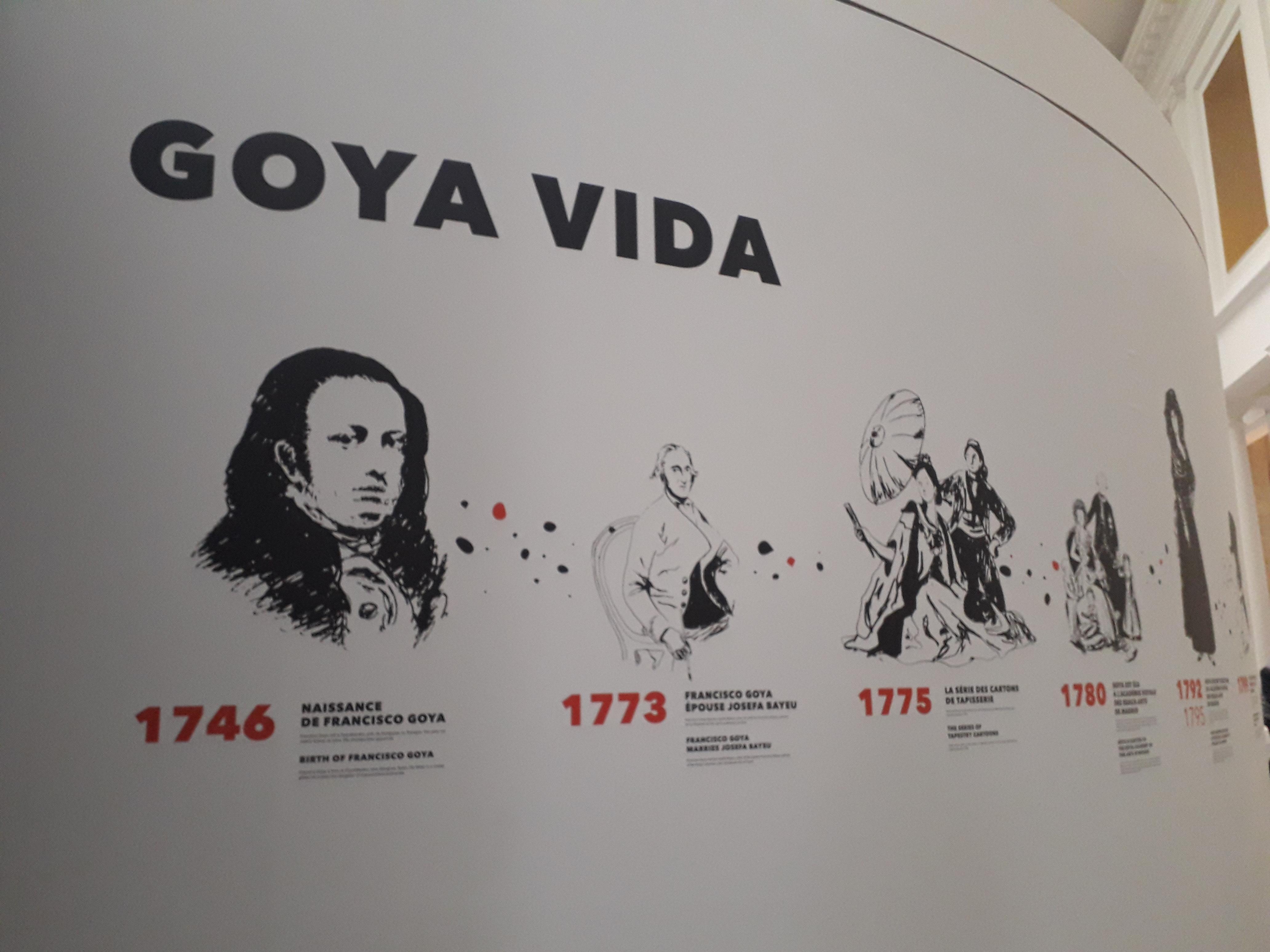
Expérience Goya, atrium Palais des Beaux-Arts de Lille © Marion Blaise
Entourés de tableaux dont certains s'animent (les yeux bougent...), le visiteur est assis dans une pièce recréant un atelier de peintre. Les tableaux sont présentés par fragments dans le but d’une meilleure compréhension et donnent le ton : celui des expressions qui retranscrivent l’effroi, ce qui introduit bien les Caprices.

Expérience Goya, salle immersive, Palais des Beaux-Arts de Lille © Marion Blaise
Pour aller plus loin :
EXPERIENCE GOYA / Agenda - Palais des Beaux Arts de Lille
Guide du Palais des Beaux Arts de Lille
#Ecoconception #Goya #Roman scénographique

Jeanne D'Arc 2.0
En plein cœur de Rouen, à quelques mètres de la cathédrale, est implanté l’Historial Jeanne d’Arc.

Jeanne Susplugas à l’Ardenome: un voyage au cœur du cerveau
Parcours de l'exposition
Wall Drawing de Jeanne Susplugas © Elise Franck
Light House III de Jeanne Susplugas © Dou
Je finis mon parcours de visite, à l'étage, sur la mezzanine avec une vue d’ensemble sur toute la première salle.
Un poétique patchwork d'images et de références
Flying House de Jeanne Susplugas, avec le Playmobil comme référence à l’enfance © Elise Franck
In my brain de Jeanne Susplugas, avec la reprise par endroit du graphisme “Bitmoji” © Elise Franck
Zoom sur I will sleep when I’m dead, une déambulation cérébrale en réalité virtuelle
Pour aller plus loin:
#artcontemporain
#jeannesusplugas
#realitévirtuelle

Klimt à l’Atelier des Lumières : S’émerveiller là où on ne s’y attend pas
S’immerger dans un univers parallèle, s’émerveiller devant des images grandioses qui nous enveloppent, s’abandonner au son d’une musique puissante, sentir vibrer les basses au creux de son ventre, se laisser envahir par une foule d’émotions… Vous aussi vous êtes en quête de ces sensations ?
UN ESPACE POUR RÊVER
Gustav Klimt, Serpents aquatiques II (Les Amies), 1904-1907, huile sur toile, 80 x 145 cm, Collection privée, Photo © Akg-Images/Erich Lessing
ENTRÉE DANS LE TEMPLE DU NUMÉRIQUE
Poetic_Ai © Ouchhh
Hundertwasser, sur les pas de la sécession viennoise © Culturespaces / Eric Spiller
Je profite de ces deux vidéos d’introduction pour découvrir l’espace. À l’intérieur d’une « black box », des tablettes interactives sur socle invitent le visiteur à choisir des images extraites de la projection de Klimt et de les projeter sur les murs de la pièce. Comme souvent lorsqu’il s’agit de matériel numérique manipulé par un grand nombre, certaines tablettes ne fonctionnent plus et cette tentative de médiation sans explications apporte finalement peu d’intérêt vis-à-vis de la projection principale. À proximité, une seconde « black box » est recouverte de miroirs prolongeant l’espace et des images projetées à l’infini. Cette fois, je commence réellement à ressentir les symptômes de l’immersion m’impacter. Je perds mes repères et me laisse submerger par le mouvement des couleurs. Lorsque les murs redeviennent progressivement noirs, je m’empresse de sortir de cette pièce pour découvrir le programme Klimt et amplifier l’expérience sensorielle qui commence à s’emparer de moi.
Réserve aux miroirs infinis © Culturespaces / Eric Spiller
SURPRISE PAR L’ENNUI
Et là… surprise !
Projection Gustav Klimt © Laurence Louis
VOYAGE AU CŒUR DE LA MATIÈRE
« Colours x Colours » - Studio de l'Atelier des Lumières © Culturespaces
© Colours x Colours Thomas Blanchard/Oilhack
LE NUMÉRIQUE REMPLACERA-T-IL LES ŒUVRES D’ART ?
Laurence Louis
#AtelierDesLumieres
#Klimt
#Immersion
Pour en savoir plus :
14,5/13,5/11,5/9,5 €
Prolongations jusqu’au 6 janvier 2019
Du lundi au jeudi de 10h à 18h.
Nocturnes les vendredis et samedis jusqu'à 22h et les dimanches jusqu'à 19h
https://www.atelier-lumieres.com/fr/home
1 NAIVIN Bernard, « Klimt à l’Atelier des Lumières, ou la peinture à son état ectoplasmique » publié sur le blog AOC, le 20 août 2018, disponible sur https://aoc.media/,consulté le 10 novembre 2018.
L'action culturelle sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux se sont imposés comme l’un des moyens privilégiés de communication, d’information, de diffusion ou de promotion des musées. Le nombre de followerset de partages a de nombreuses vertus rajeunissantes : il redynamise l’image, popularise, modernise… La présence du musée sur les réseaux sociaux le rend tout de suite plus cool. L’image est sauve (ouf !).
Les institutions culturelles peuvent aussi se servir de ce formidable outil numérique pour se concentrer sur l’une de leurs missions principales : la démocratisation culturelle ! Mais oui, qui mieux que les réseaux sociaux pour remplir cette mission dans ce cas où la seule barrière d’accessibilité serait l’accès à une connexion internet ? Ils sont accessibles par tous, pour tous, presque partout, à n’importe quel moment et quelle qu’en soit la durée.
Éclairons tout de suite un point, il ne s’agit pas de substituer la visite in situ mais plutôt de compléter, de varier l’expérience du musée et de donner envie aux personnes de venir dans l’institution. Sur les réseaux sociaux l’institution culturelle va pouvoir susciter l’intérêt, piquer la curiosité des « socialeurs » sans pour autant les écraser sous le poids de l’exactitude scientifique et historique. Car, pour reprendre Michel Serres, une fois que « petite poucette » est intéressée, elle ira chercher le savoir, la connaissance scientifique par elle-même. Elle ira peut-être même chercher ce savoir au musée, lieu de connaissance et de science mais aussi lieu de délectation et d’enrichissement. Et ces deux derniers points peuvent lui paraître beaucoup moins évidents.
Sur les réseaux sociaux, il s’agit de mener des actions culturelles pour et avec les publics. Twitter, Facebook, Snapchat… c’est aussi interférer avec la vie quotidienne des gens, partager un moment, se rencontrer. Le musée peut sembler plus proche, plus accessible quand il n’y a pas la barrière de la billetterie et que les personnes peuvent directement et instantanément s’engager dans les actions culturelles proposées. Car les institutions doivent aussi rencontrer le visiteur, sans filtre, pour ainsi provoquer un enrichissement, une acculturation.
Tout repose sur l’idée du participatif. Il faut laisser les gens s’approprier un contenu, ne pas vouloir le contrôler (ce qui inévitablement briserait le charme). Aller du participatif au collaboratif voilà un bel objectif pour des musées qui sont avant tout un service public (nous avons tendance à l’oublier un peu trop souvent).
Voici un focus sur trois exemples d’actions culturelles menées par des institutions qui présentent plus d’un intérêt :
Les live-tweet
En 2015, à l’occasion de l’exposition Le roi est mort, le château de Versailles a retracé sur Twitter les derniers jours de Louis XIV tels qu’ils se dérouleraient à notre époque. L’action permetde mettre l’accent sur l’anecdote et de révéler la petite histoire, peut-être plus méconnue que la Grande. Maïté Labat, chef des projets multimédias au Château explique sur France 24 : « On s’est demandé comment on aurait raconté cette histoire si Louis XIV était mort aujourd’hui. Et de fait, Twitter s’est rapidement imposé, notamment comme première interaction avec les internautes, car c’est un outil qui favorise et crée le dialogue permanent avec le public. » Car le visiteur s’empare de l’histoire et peut la moduler, se l’approprier par ses commentaires, ses retweets. En voici un exemple publié sur France 24. Il s’agit d’un commentaire de @velkounette à l’annonce du départ de Madame de Maintenon de Versailles, l'une des favorites du Roi Soleil, le 30 août : "Je confirme ! Je l’ai vue dans le RER tout à l’heure !".
Retweet "Le roi est mort" © EPV
Mais cette initiative n’est pas isolée et en 2014 le Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux fait office de précurseur avec la création du compte Facebook d’un poilu, Léon Vivien. Durant cinq mois, des publications ont couvert la vie quotidienne du soldat jusqu’à sa mort comme si Facebook existait en 1914. Cette action permet non seulement de valoriser les collections du musée avec la publication de photographies mais permet aussi à près de 65 000 personnes de revivre une partie de l’histoire.
Le « tracking des habitants », dispositif de la Halle aux sucres de Dunkerque
Partager son circuit dans la ville, voilà ce que propose la Halle aux sucres aux Dunkerquois et plus globalement aux habitants des Hauts-de-France. Chaque personne peut ajouter et partager son trajet quotidien sur une carte interactive via une application mobile développée par Orbe. Pour cela rien de plus simple. Il suffit de se géo-localiser, d’enregistrer son circuit quotidien et de le partager sur une carte interactive qui devient alors le réseau de tous ces chemins entre croisés.L’habitant est acteur et pas uniquement consommateur du lieu culturel. Bémol : Comment donner envie aux habitants d’utiliser un outil pour trace ret partager leurs chemins quotidiens ? Le dispositif participatif a du mal à prendre l’ampleur souhaité puisqu’il dépend entièrement des Dunkerquois qui ne l’utilisent tout simplement pas. Cela vient peut-être du nom très peu accrocheur de l’application : « tracking des habitants ». Oui, nous pouvons le dire, ça fait peur. Surtout, cette action pose la question de la limite des dispositifs participatifs quand les habitants ont du mal à s’en emparer. C’est peut-être ce qui résulte de la démarche de faire quelque chose pour les gens mais sans les gens…
"Tracking des habitants" © Orbe
Le Rijkmuseum sur Youtube
C’est la plateforme qu’a utilisé le Rijkmuseum pour annoncer sa réouverture en 2013. La vidéo est une opération de communication certes. Mais c’est aussi une action culturelle hors-les-murs aussi surprenante qu’inattendue. Dans un centre commercial d’Amsterdam, les gens qui faisaient tranquillement leurs courses sont pris à partie et emmenés dans une histoire folle de voleur au XVIème siècle. Il s’agit de mettre des personnes en action autour d’une rumeur, de l’anecdotique et ce grandeur nature. Nous pouvons facilement imaginer que ces personnes vont avoir envie d’aller au musée ensuite. Qu’ils regarderont certaines œuvres plus attentivement car ils auront rencontré les personnages au hasard d’une session shopping, auront vécu une expérience palpitante et que les œuvres feront partie de leur histoire. Onzehelden zijn terug ! (Nos héros sont de retour !)
https://www.youtube.com/watch?v=a6W2ZMpsxhg
D’autres initiatives sont courantes notamment sur Instagram avec des jeux concours ou la proposition aux publics de choisir les œuvres des expositions comme l’a fait le Columbus Museum of Art en 2013. Les institutions culturelles sont aussi présentes sur Snapchat comme le LACMA (Los Angeles) qui utilise ce réseau avec beaucoup d’humour et invite les visiteurs à s’amuser avec les collections.
M.D.
#réseauxsociaux
#participatif
#actionculturelle
Pour en savoir plus sur les live-tweet : http://www.france24.com/fr/20150901-france-chateau-versailles-mort-louis-xiv-twitter-exposition-leroiestmort
Pour en savoir plus sur l’utilisation de Snapchat par le LACMA : http://www.club-innovation-culture.fr/en-rejoignant-snapchat-le-lacma-incite-son-public-a-jouer-avec-sa-collection/
Pour en savoir plus sur la Halle aux sucres: http://lartdemuser.blogspot.fr/2017/09/la-halle-aux-sucres-histoire-dun.html

L'Hôtel de la Marine : une expérience de visite immersive
Place de la Concorde à Paris : la gigantesque esplanade, bien qu’envahie par le dense trafic parisien, reste un des lieux les plus emblématiques de la capitale. Sur cette place, dans l’hôtel particulier jumeau de l’actuel Hôtel de Crillon, vient de s’ouvrir au public un monument dont la gestion a été confiée au Centre des monuments nationaux (CMN) : l’Hôtel de la Marine. Daté du XVIIIe siècle et très rarement ouvert au public, ce lieu a été le témoin de siècles d’Histoire, aujourd’hui relatés aux visiteurs par un parcours dans des reconstitutions de décors d’époque et agrémenté de dispositifs numériques innovants.
Un destin mouvementé
C’est la Ville de Paris qui, souhaitant rendre hommage au roi Louis XV, entreprend de faire construire une place royale monumentale dans la capitale, organisée autour d’une statue équestre du monarque. Ange-Jacques Gabriel, premier architecte du roi, se voit confier la tâche.
Le bâtiment est érigé à partir de 1757 et il est décidé dès 1765 d’y installer le Garde-Meuble royal (ancêtre de l’actuel Mobilier National), et ce jusqu’en 1798. Ses intendants, Pierre-Elisabeth de Fontanieu puis Marc-Antoine Thierry de Ville d’Avray, sont chargés de l’aménagement du bâtiment et de la conservation du mobilier et des arts décoratifs de la collection royale, mais aussi des bijoux de la couronne et des armes d’apparat. Ils étaient également en charge de l’aménagement des résidences royales et de l’entretien du mobilier.
En 1776, le peuple avait la possibilité, à certains moments de l’année, de venir y admirer les collections royales. C’est le premier « musée des arts décoratifs » de Paris.

Salle à manger de l’Hôtel de la Marine © V.E.
Après une longue réflexion et la menace pendant un temps de sa privatisation, il est décidé en 2017 de restaurer l’hôtel et de lui redonner ses éléments d’origine des XVIIIe et XIXe siècles. Les peintures d’origine ont été mises au jour en retirant les multiples couches de peinture qui s’étaient succédées au fil des siècles, jusqu’à une vingtaine par endroits.
Les décorateurs chargés du projet, Michel Carrière et Joseph Achkar, ont eu pour mission de reconstituer le mobilier de l’hôtel en s’aidant des 900 pages de l’inventaire du lieu. Ils ont identifié les éléments qui ont été conservés, et cherché des équivalents chez les antiquaires pour ce qui a été perdu. Plus habitués aux commandes pour des particuliers qu’aux monuments historiques, ils n’ont pas hésité à ajouter des objets du quotidien pour donner aux appartements un aspect « habité ».
Les travaux ont duré cinq ans, et le monument a été inauguré le 10 juin dernier. Il compte en plus d’un parcours permanent de visite un espace d’exposition temporaire, un restaurant, un café et une librairie-boutique.
Le bâtiment accueille aussi des bureaux disponibles à la location, dans lesquels se sont installés le siège de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, ainsi qu’une antenne de la Fédération internationale de football (FIFA).
Une muséographie classique mais enrichie par une visite sonore
Le parcours de visite et la muséographie sont assez classiques, le visiteur va de pièce en pièce et se laisse guider à travers des reconstitutions de décors d’époque, comme dans la plupart des châteaux et monuments historiques. Mais la présence de nombreux dispositifs numériques de médiation permet à l’Hôtel de la Marine de se démarquer et de proposer une visite plus riche.

Visiteurs dotés d’un « Confident » © V.E.
Un casque connecté nommé « le Confident » est remis à chaque visiteur avant le début de la visite. Il a été conçu en partenariat avec le Studio Radio France, dont les équipes sont spécialisées dans le son binaural et la narration immersive. Ce ne sont pas moins d’une centaine de personnes qui se sont investies dans ce projet, dont le tournage a eu lieu au Château de Rambouillet : plus de soixante comédiens, une vingtaine de musiciens ainsi qu’une équipe de production de vingt personnes. Les scenarii de ces parcours ont été imaginés par Didier Laval, Anne Carles et Karine Chaunac. Il constitue le fil rouge de la visite, sans lui, elle perdrait une grande partie de son intérêt puisqu’il n’y a aucun cartel ou support de médiation dans les salles.
Le visiteur doit d’abord faire son choix parmi trois parcours : « Voyage dans le temps », « En famille » ou « Le Siècle des lumières ». Puis la visite commence automatiquement, le casque détecte chaque mouvement du visiteur jusqu’à la direction de son regard, afin de le guider à travers les salles. Après un petit temps d’adaptation, il se laisse donc porter par le son. Ambiances sonores, musicales, scènes jouées par des comédiens se succèdent et invitent le visiteur à s’imaginer des personnages déambulant dans les reconstitutions qu’il a sous les yeux. Ainsi, il peut mieux saisir les préoccupations de l’époque et l’ambiance qui devait régner dans ces lieux au quotidien.
L’utilisation du son binaural rend la visite très immersive. Par exemple, un personnage peut nous interpeller dans notre dos, et il suffira de se retourner pour l’entendre de face.
Ce mode de visite a tout de même quelques inconvénients : le casque isole les visiteurs de leur environnement et de leur entourage. Certaines personnes font sonner des alarmes et ne s’en rendent même pas compte ! Difficile alors pour les agents chargés du gardiennage des salles de se faire entendre.
Précisons que la visite est accessible aux personnes sourdes ou malentendantes, certes sous une autre forme moins captivante : une web-application disponible sur smartphone ou sur des tablettes fournies à l’entrée. Cette interface propose une visite complète en langue des signes.
Un parcours mettant les dispositifs numériques à l’honneur
Dans les salons de réception, marquant la dernière partie du parcours, relevons cinq dispositifs numériques innovants permettent au public d’approfondir ses connaissances de manière plus théorique, mais toujours dans des formes originales.



Miroirs dansants © V.E. Galerie des portraits © V.E. Table des marins © V.E.
-
Les Miroirs dansants : plusieurs miroirs-écrans numériques rotatifs reconstituent les évènements qui ont pris place dans l’Hôtel de la Marine au fil des années, notamment les grands bals du XIXe siècle.
- La galerie des portraits : sur ce paravent s’animent des portraits de personnalités importantes pour l’histoire du monument. Interprétés par des comédiens, des dialogues permettent de mieux comprendre qui ils étaient et les relations qu’ils entretenaient.
- La table des marins : il s’agit d’une grande table ronde dotée d’un planisphère animé au centre. Différents écrans tactiles sont disponibles, sur lesquels les visiteurs peuvent choisir une expédition navale menée par la France. Une fois le navigateur sélectionné, on peut suivre son itinéraire sur le grand planisphère au centre, tout en écoutant le déroulé de l’expédition dans son casque.

Table de l’urbanisme © V.E.
- La table de l’urbanisme : un grand écran présentant un panorama vidéo de l’histoire de la place de la Concorde et de ses deux hôtels particuliers

L’Hôtel de la Marine à la loupe © V.E.
- l’Hôtel de la Marine à la loupe : il s’agit d’un plan de coupe de l’Hôtel animé par des silhouettes dont on entend les dialogues directement dans les Confidents. Ce grand écran illustre le déroulé d’une journée type au sein de l’Hôtel de la Marine.
Ce sont donc des dispositifs très modernes qui rendent la visite plus mémorable pour le public.
Quelques points à soulever
Toutefois, malgré la modernité des dispositifs de médiation, quelques bémols sont à apporter : le besoin de s’adapter aux contraintes du bâtiment existant implique parfois peu d’espace pour la circulation des visiteurs, ce qui pourrait s’avérer gênant en cas de forte affluence. C’est malheureusement un inconvénient que l'on retrouve fréquemment dans les monuments historiques, du fait qu’ils n’aient pas été créés à l’origine pour recevoir des visiteurs.
Autre point plus problématique pour le confort de visite : aucune assise n’est proposée au public durant toute la durée du parcours, long tout de même d’environ deux heures. Cela peut être fatiguant en particulier pour les personnes âgées ou les femmes enceintes.
Dernier point : il est important d’être conscient de la provenance des financements qui ont permis ces importantes restaurations. Ces travaux de réhabilitation ainsi que la mise en place de dispositifs numériques coûtent cher, et c’est par le biais de certains partenariats que le CMN a pu assumer de telles dépenses. En effet, Philippe Bélaval, le président du CMN, a indiqué que sa restauration n'avait "quasiment rien coûté aux contribuables" puisque moins de 10% de son coût de 130 millions d'euros a été supporté par l'Etat, le reste étant autofinancé (par la location de d’espaces professionnels notamment) ou soutenu par le mécénat à hauteur de 20 millions d’euros.
Parmi les accords de mécénat les plus importants citons la fondation Al Thani, organisme gérant la collection privée de la famille royale du Qatar. En échange d’une participation financière conséquente, celle-ci se verra disposer à partir de l’automne 2021 d’un espace d’exposition de 400m2 au sein du monument pour une durée de vingt ans. Ainsi, l’Hôtel de la Marine s’ajoute à la liste de plus en plus longue de lieux culturels français tissant des liens avec le gouvernement du Qatar. Le Qatar ne compte ni parti politique, ni force d’opposition, et cet état a bâti sa fortune économique sur des énergies non renouvelables (pétrole et surtout gaz). C’est aussi le pays le plus émetteur de dioxyde de carbone par habitant au monde. Un choix de mécène peu cohérent avec notre époque marquée par le réchauffement climatique.
Après quatorze ans de débats, sept ans de chantier, 135 millions d’euros de travaux, c’est un nouveau lieu qui ouvre ses portes à Paris, rendant accessible un hôtel particulier resté jusqu’ici très secret. Les Parisiens et les touristes du monde entier peuvent ainsi profiter de la vue sur de nombreux monuments parisiens et sur la Place de la Concorde réservée jusqu’à présent aux quelques privilégiés fréquentant le Palace le Crillon.
L’Hôtel de la Marine veut devenir un véritable lieu de vie au cœur du quartier de la Concorde avec ses espaces de restauration et ses cours intérieures accessibles gratuitement.
A voir :
Documentaire en replay sur Arte.tv sur le chantier de restauration : https://www.arte.tv/fr/videos/084723-000-A/hotel-de-la-marine-renaissance-d-un-palais/
#monumenthistorique #paris #médiationnumérique
L'odyssée Museomix : une quête vers l'innovation !
Le week-end du 19, 20, 21 octobre 2012 a eu lieu la seconde édition de Museomix, au musée Gallo-Romain de Lyon-Fourvière. Nous avons eu la chance, dans le cadre de notre projet de master, de participer à cette expérience innovante.
©Quentin Chevrier
Pendant trois jours Museomix a investi les lieux, sélectionnés par les organisateurs suite à sa candidature. Cet évènement invite des professionnels et amateurs du monde culturel, artistique et technologique à repenser le musée et les méthodes de médiations par le biais des nouvelles technologies. A chaque équipe de projet de concevoir un prototype. Cette édition a été améliorée sur plusieurs points : une participation active en ligne des internautes et une semaine de présentation des créations au public suivant le dimanche d’ouverture.
Dès leur arrivée, les museomixeurs ont suivi une visite guidée afin de découvrir les différents espaces de remixage. Chacune des dix équipes s’est formée autour d’un thème, constituée au minimum : deux créatifs, un community manager, un développeur, une personne chargée du contenu et un médiateur.
Agathe Gadenne s’est impliquée dans l’équipe qui remixait l’espace du commerce méditerranéen. Après la définition du projet en groupe, la recherche du contenu et du discours, elle s’est appliquée à la conception de scénographie, du graphisme et au suivi web (réalisation du site et participation en ligne).
« En intégrant une équipe, j’ai découvert intensément le conceptMuseomix. J’ai adoré rencontrer et travailler avec des personnes de tous horizons. Ma seule déception est due aux problèmes techniques qui ne nous ont pas permis de finaliser le prototype. »
Elisa Bellancourt a participé au développement de la médiation à travers la conception de la trame et du parcours des visites. Elle a collaboré à l’écriture de l’introduction de l’évènement et à la mise en place des installations de médiation. Elle a également créé un outil de médiation répondant au nom de Cléo 3000, un robot venu de 3012 expliquant la volonté de Museomix.
«J’ai eu la chance de travailler avec des professionnels créatifs et motivants. Ce qui m’a amusé c’est d’enregistrer l’introduction et le discours de Cléo, et de savoir que ma voix résonne encore dans les lieux. »
.jpg)
©Quentin Chevrier
Camille Françoise s’est associée au pôle médiation en réalisant des visites guidées et une partie de la signalétique du musée. Ses missions ont surtout été d’ordre organisationnelle en participant à l’écriture de l’introduction de l’évènement, à l’installation des outils de médiation et à la diffusion de la communication (badges invités, invitations pour l’ouverture, dossiers de presse).
« C’était une superbe expérience ! Quoi de plus agréable que de voir le musée revivre ? Je suis très heureuse d’avoir pu y participer et y être utile. J’ai rencontré des gens très imaginatifs et sympathiques. Malheureusement c’était trop court ! »
Margaux Geib a, quant à elle, travaillé dans les pôles Tech-shop et Fab-lab, dédiés aux prêts du matériel technologique et au graphisme. Elle a aidé à la conception du programme visiteur et du plan des installations dans le musée.
« Ca a été pour moi une expérience unique qui m’a permis de me réaliser et de m’inscrire au sein d’une équipe d’organisation. Je résumerai ces trois jours enquelques mots : partage, générosité, envie. »
Au terme de cette aventure originale, nous nous sommes enrichies. Notre envie de créer un musée vivant est encore plus forte, tout comme notre volonté de nous investir dans la réalisation de notre projet de master.
Agathe Gadenne, Camille Françoise, Elisa Bellancourt, Margaux Geib
Pour plus d’informations : Museomix - Site officiel
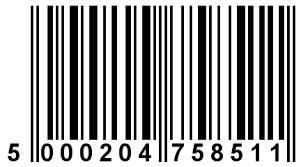
L’art aux codes barres !
De nos jours les nouvelles technologies prennent de l’ampleur et participent de plus en plus à la médiation des musées. Elles servent à favoriser l’ouverture de ces lieux à un plus large public ainsi qu’à faciliter la compréhension de certaines œuvres ou expositions. C’est une nouvelle forme de participation publique permettant deréduire la distance entre les visions dites ‘‘expertes’’ et celles dites ‘‘profanes’’.
En effet, les Smartphones, tablettes tactiles ou autres sont devenus des outils de la vie quotidienne, ils sont pratiqués et utilisés de tous avec une grande facilité. Les faire participer dans les musées a pour but de favoriser la compréhension générale en transformant un public uniforme et indifférencié en un public composite et pluriel capable de s’informer et de réaliser sa propre analyse des œuvres. Impliquer le public dans les musées est l’une des principales envies et recherches des futures médiations.
L’un de ces outils est de plus en plus visible dans notre quotidien ainsi que dans les institutions culturelles. Cet outil est le QR-code ou plus communément appelé flashcode. C’est lors de ma visite de l’exposition « Roulez, carrosses »au musée des Beaux-Arts d’Arras que j’ai pu remarquer qu’une grande majorité des salles en possèdent.
Un flashcode est un code barre en 2D permettant grâce à un téléphone équipé d’un lecteur ‘‘code QR’’ de lire son contenu ouvrant alors un lien sur l’appareil (informations, explications, vidéos, etc.).
La lecture des codes dans l’exposition nous envoie à chaque fois, grâce au lien, à une vidéo commentée qui explique le contenu de la salle où l’on se trouve mais aussi des explications sur les différentes œuvres qui y sont présentées. Il peut y avoir plusieurs dans la même salle si plusieurs espaces y sont proposés comme dans la salle 1 où l’on découvre la ville d’Arras à travers le temps mais aussi les débuts et la naissance des carrosses.
Au fur et à mesure de la visite, les flashcodes nous apportent des contenus extérieurs et supplémentaires qui enrichissent l’exposition et nous aident à mieux se l’approprier et la comprendre. Ils la rendent abordable et interactive ce qui donne une nouvelle vision des œuvres et des salles présentées au public. On peut ainsi découvrir les débuts de la ville d’Arras, l’histoire des carrosses de leur ‘‘naissance’’ en passant par les différentes fonctions qu’ils peuvent avoir, de leurs différentes formes liées aux époques et nouvelles techniques de construction mais aussi en nous permettant de voir l’intérieur de ceux-ci.
Les flashcodes offrent un avantage au musée, en effet, en rattachant les œuvres aux médias numériques, une infinité de possibilités s’ouvre … Cela peut servir à intégrer la genèse d’une œuvre ou même y apporter un contenu supplémentaire de l’artiste grâce à des liens ouvrant sur des interviews, des vidéos (comme lors de l’exposition Roulez, carrosses) mais aussi à des textes ou même des liens vers d’autres œuvres ou artistes ou expositions créant un dialogue, un échange. Les visites deviennent alors plus vivantes, plus ludiques (pour les enfants et surtout les adolescents) mais aussi plus accessibles.
M.G.L
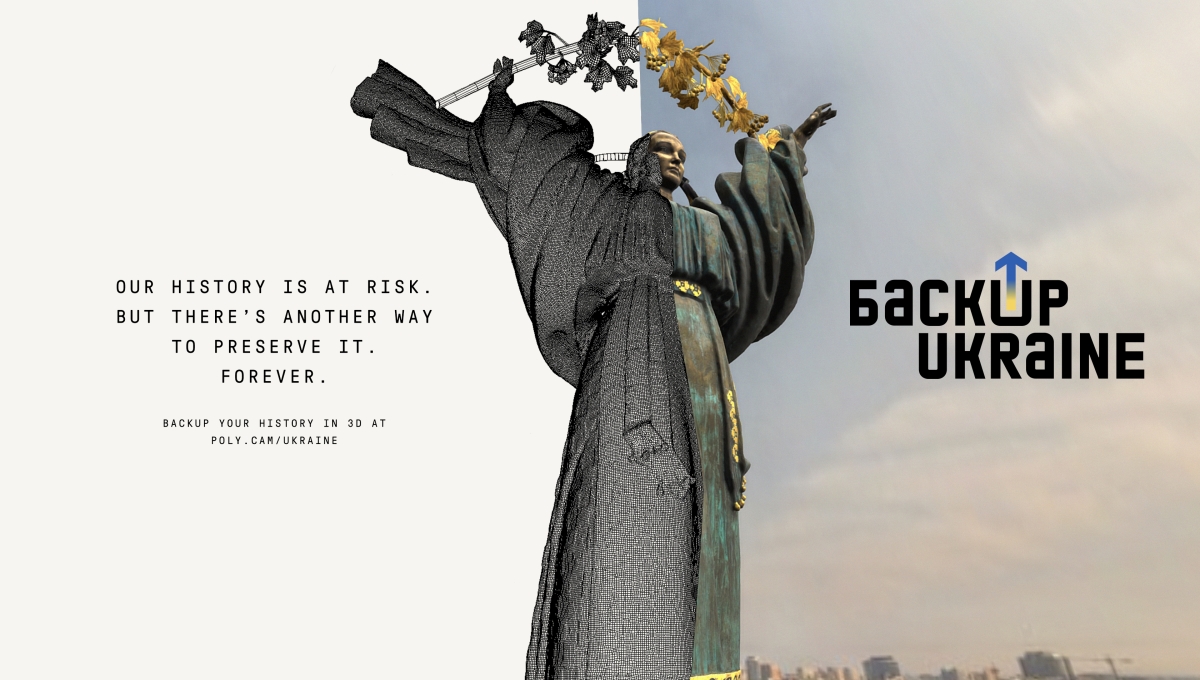
La 3D, à la rescousse du patrimoine ukrainien
Patrimoine. Culture. Victime, elle aussi des conflits. "Le moyen le plus rapide d'effacer l'identité nationale d'un peuple est de détruire son patrimoine culturel » disait Tao Thomsen, directeur créatif de Virtue Worldwide et co-créateur de Backup Ukraine.
Image de la campagne Backup Ukraine © Polycam and the BackUp Ukraine project
Éviter que son patrimoine ne parte en fumée, disparaisse sous les bombardements russes et pouvoir le transmettre aux générations futures, voilà ce qui a motivé le projet Backup Ukraine, traduit par la sauvegarde de l’Ukraine. Le projet a dû se mettre en route rapidement pour garder la mémoire des lieux car au 27 mai 2022, c’était déjà selon le ministère Ukrainien : « 367 crimes de guerre contre le patrimoine culturel du pays […], dont la destruction de 29 musées, 133 églises, 66 théâtres et bibliothèques et un cimetière juif centenaire ».
Une initiative participative
Backup Ukraine initié par l’agence VICE, Virtue Worldwide en avril 2022 s’est associée à Blue Shield Danemark, un organisme visant à protéger les sites culturels, et à la Commission nationale danoise pour l’UNESCO. Ce projet est mené en étroite collaboration avec l'initiative de sauvetage d'urgence du patrimoine ukrainien et le Musée national de l'histoire de l'Ukraine. Il s’agit d’une archive numérique qui a pour but de recenser le patrimoine matériel ukrainien grâce à des modélisations 3D.
Le temps pressant, l’outil a été développé de manière à ce que tous les Ukrainiens volontaires ayant un smartphone puisse apporter leur pierre à l’édifice via une application nommée Polycam.Celle-ci est mise à disposition pour le projet par ses développeurs qui sont également partenaires. Pour prendre part à cet appel à participation, les volontaires remplissent un formulaire pour recevoir une autorisation des autorités ukrainiennes. L’usage de la technologie ne s’est pas encore répandu, la plateforme compte entre 30 à 50 participants actifs en août 2022, soit 6000 contributions, ce qui est compréhensible au vu de la situation : en avril 2022, un ukrainien sur six a dû fuir son foyer et cinq millions ont quitté leur pays selon les Nations Unies.
Cet outil repose sur la photogrammétrie, ou technologie LiDAR consistant à créer des modèles 3D détaillés à partir de plusieurs photographies, prises sous différents angles. Cette technologie prend en compte un calcul de distance et de taille de l’objet pour assembler les images et former un modèle. 100 à 250 images, voilà le prérequis pour concevoir une représentation 3D réaliste. Le surplus contribue à améliorer la qualité et la précision des conceptions. Pour aider les volontaires à réaliser ces captures, l’application propose un tutoriel, tout en invitant les usagers à ne pas se mettre en danger.
Les numérisations sont liées à un emplacement qui est automatiquement retranscrit dans la base de données de l’archive, à l’abri des bombardements. Les numérisations sont sous licence Creative Commons 4.0 et seront partagées avec l’UNESCO et les musées partenaires du Blue Shield. Le site Polycam recense les scans, ainsi qu’une carte permettant de situer les lieux numérisés, contribuant ainsi à l’efficacité du projet et limitant les doublons.
Le projet a pris de l’ampleur grâce à l’accessibilité de l’application, ce qui a favorisé, en parallèle de la numérisation des objets de musées et du patrimoine matériel ukrainien, la préservation d’objets moins monumentaux, des objets du quotidien, ordinaires mais importants dans la vie des habitants et leur histoire. Le choix des objets numérisés pose donc la question de ce qui est important culturellement pour la population.
Au-delà de documenter les objets culturels, Polycam est également utilisé pour rendre compte de la destruction des monuments, et des objets culturels pendant la guerre.
Une sauvegarde difficile de sites
Les bâtiments d’envergure sont plus difficiles à reconstituer, et leur numérisation est donc moins réalisable par la population civile puisqu’il faut se munir d’un drone, ceux-ci n’étant pas toujours autorisés, surtout en temps de guerre.

Scan 3D de l’Église de Pyrohochtcha, à Kiev, construite à l’origine en 1132 © Polycam, the BackUp Ukraine project, Courtesy Maxim Kamynin / Licence : Creative Commons 4.0
Il s’avère que la modélisation des surfaces brillantes et transparentes est également compliquée, puisque ces textures sont difficilement interprétables par l’algorithme de l’application.
Au-delà du côté technique, la photogrammétrie en lieu de confit est dangereuse et donc peu praticable dans les points centraux comme Kiev qui regroupe un certain nombre de lieux culturels majeurs du pays comme la cathédrale Sainte-Sophie classée à l’UNESCO.
A terme, en fonction de la qualité des modélisations, celles-ci pourront être utilisées à des fins de reconstruction, notamment celles des sept sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO pour leur importance culturelle et donc en théorie protégés par la loi. Les modèles peuvent également donner matière à des projections dans un espace physique ou fictif notamment via la réalité virtuelle et la réalité augmentée permettant d’explorer le lieu, à défaut de pouvoir le reconstruire.
Des initiatives qui se multiplient
L’Ukraine n’est pas la seule à avoir lancé des initiatives dans ce sens, celles-ci se développent dans les territoires en conflit comme la Syrie où une quinzaine de chercheurs syriens accompagnés de la start-up française Iconemont été formés à la photogrammétrie. En février 2015, en Irak, l’artiste iranienne Morehshin Allahyari s’est engagée dans la reproduction en impression 3D des sculptures détruites à Mossoul par les djihadistes de Daech. La 3D permet ainsi d’envisager une autre voie contre la destruction et l’oubli engendrés par la guerre.
Loona
Pour en savoir plus :
- https://poly.cam/ukraine
- https://www.instagram.com/backup_ukraine/?hl=fr
- https://edition.cnn.com/style/article/ukraine-uses-3d-technology-to-preserve-cultural-heritage/index.html
#GUERRE UKRAINE
#SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
#NUMÉRISATION 3D

La cabine de mesure à la Cité internationale de la dentelle de Calais
Dans l’optique d’une nouvelle mise en valeur des collections de la Cité internationale de la dentelle et de la mode de Calais, les universités locales, ULCO, l’Université du Littoral Côte d’Opale, et LISIC, le Laboratoire d’Informatique Signal et Image de la Côte d’Opale, offrent aux visiteurs la possibilité de se glisser dans les plus belles pièces de collection en dentelle grâce à leur surprenante cabine.
« Passeport personnalisé de mensuration » recto-verso
© DR Cité Internationale de la dentelle de Calais
Osez vous-y mesurer !
Cette cabine, qui est en réalité un scanner géant, parcourt de ses rayons lumineux le corps des visiteurs qui auront osé ôter leurs accoutrements du quotidien pour que puisse s’effectuer la prise de leurs mensurations. Mensurations à partir desquelles sera créé leur avatar qui revêtira, au gré de leurs envies, les costumes d’une rareté exceptionnelle, répertoriée dans la base de données prévue à cet effet.
Si la cabine est innovante, elle en effraye plus d’un dont la pudeur ne saurait être surpassée. En effet, pour que s’exhausse le rêve de devenir modèle pour parures extraordinaires de dentelle, il faut braver ses complexes et accepter d’entrer en sous-vêtements dans cette cabine de mesure. Pourtant, la personne en charge de l’accueil vous rassure en insistant sur le fait qu’aucune image n’est visible depuis son poste, qu’elle ne voit à son écran qu’une silhouette bigarrée dénuée de détails.
L’expérience n’est pourtant pas si intimidante, les cabines d’essayages sous-entendent bien, en général, qu’il est possible de se dévêtir à l’abri des regards. Le principe est le même. Et la suite est tout à fait appréciable. (Bien que les avatars ne soient pas toujours le parfait reflet de la réalité, en atteste un des membres du personnel du musée qui trouvait que les fesses de son avatar étaient plantureuses au regard de ses courbes véritables. Et pour ce qui requiert de ma propre expérience, elle a dû être renouvelée une deuxième fois car mon avatar avait plus des allures de Schwarzenegger que d’une jeune femme qui est bien loin d’être une adepte du bodybuilding !)
Une fois l’avatar créé, il est répertorié dans une base de données. Undispositif est installé non loin de la cabine où il est nécessaire de taper le numéro identifiant, délivré sur le passeport attestant de votre passage dans la cabine, pour que votre double apparaisse à l’écran. Ce dispositif n’est pas irréprochable : le temps de charge est long, l’écran tactile manque de réflexes et il est nécessaire d’appuyer avec insistance pour que l’opération fasse suite. Lorsque notre avatar est prêt, que nous avons convenu de la couleur des yeux et des cheveux, nous avons l’opportunité de parcourir la garde robe numérisée et de choisir les ouvrages qui nous ont marqués lors de notre visite, ou que nous trouvons tout simplement à notre goût, dans le cas où nous testions la cabine avant la visite. Grâce à cette invention, il n’est plus nécessaire de s’impatienter durant la mise en place de la crinoline : les robes se cliquent en un coup de pouce !
Peut-être aura-t-on eu l’idée de placer sa tête au sommet d’un buste dans le reflet d’une vitrine et on se sera admiré, s’imaginant au XVIIème siècle parmi les marquis et les marquises. Ou peut-être aura-t-on profité du dispositif au sein du parcours de visite où l’on peut placer sa tête dans l’orifice prévu à cet effet et pris une photo nous projetant quelques instants à l’écran dans les jupons d’une autre époque.
Avec un peu d’imagination, il est tout à fait possible de se voir revêtir les œuvres de la Cité de la dentelle, mais la cabine, elle, promet une expérience à long terme, contrairement aux dispositifs disséminés tout au long du parcours de visite. Bien qu’il soit pour l’instant impossible de retrouver son avatar sur le site indiqué, un projet de conception de visite virtuelle est sur le point de voir le jour. Dans la veine des « SIM’S », le célèbre jeu de rôle où l’on crée son personnage et sa vie virtuelle, la Cité internationale de la dentelle permettra bientôt à nos avatars de se promener à l’instar des SIM’S dans leur monde virtuel, au musée virtuel de la Cité de la dentelle. Mais elle permettra aussi de revêtir les plus beaux costumes et de devenir créateur de mode en assemblant les échantillons numérisés disponibles sur la plate-forme depuis notre domicile. Et ce sera surtout l’occasion d’interagir avec d’autres avatars, créant ainsi une énième communauté virtuelle, qui elle, sera liée par l’intérêt commun de la mode et de la dentelle.
Cette innovation, qui s’inscrit dans l’ère numérique actuelle, est révolutionnaire du point de vue du visiteur, à qui l’on offre la possibilité de manipuler les collections mais surtout à qui l’on donne l’illusion de les revêtir. La cabine de mesure est également innovante d’un point de vue scientifique car cette base de données permet de présenter les collections sans les abîmer.
Cependant, si l’idée est probante, le rendu laisse à désirer. Les pixels, faussant les courbes des avatars et la coupe des costumes, nous rappellent que la vitesse de l’évolution des nouvelles technologies est certes ahurissante, mais elle est loin de la perfection à laquelle nous aspirons qui devrait calquer avec justesse la réalité. Nonobstant ces défauts numériques, l’application est intéressante dans l’idée d’exporter chez soi l’avatar et la collection au-delà du musée grâce au passeport personnalisé de mensurations. Malheureusement, l’adresse indiquée sur le passeport est invalide. Il n’est pas non plus possible, pour l’instant, de « se retrouver » depuis le site du musée.
Cependant, la rubrique « Monde communautaire » du site de la Cité de la dentelle, vous met en haleine quant à cette prochaine visite virtuelle du musée que vous pourrez effectuer avec votre avatar que vous trépignez d’impatience de retrouver. Une sortie « imminente » qui nous fait durer le suspens au risque d’en décupler les attentes et peut-être d’en décevoir certains.
Katia Fournier
Le déshabillé au musée, une innovation osée !

© Nordlittoral
Inaugurée en septembre 2011 à la cité internationale de la dentelle et de la mode de Calais, la cabine de mesures 3D vous examine sous toutes les coutures ! Grâce au principe de numérisation, elle crée un avatar à l'image des mensurations du visiteur. Connecté à la cabine, l'ordinateur modélise et affiche la silhouette. Une fois sortie de la cabine, le visiteur peut personnaliser son profil grâce à une tablette située non loin de là. Il pourra ensuite déambuler virtuellement dans le musée, enfiler, assembler les pièces de collections exposées à sa guise. Cette innovation est présentée comme un outil de médiation, un moyen de rendre accessible les collections textiles tout en les préservant. L'objectif est de poursuivre un lien entre l'institution et le visiteur une fois qu'il a quitté les lieux. Toutefois, ce n'est pas une franche réussite pour cette innovation et nous tentons de comprendre pourquoi...
Accessible sur certains sites web de musée, les visites virtuelles permettent en principe d'inciter l'internaute à venir visiter l'institution. Étonnamment ici, on parcourt virtuellement le musée après y avoir mis les pieds ! L'accent mis sur les outils de communication pour offrir une bonne visibilité à cette innovation laisse à penser que l'on a souhaité faire de cette cabine un évènement pour inciter à visiter le musée. Proposition attractive, notamment auprès des jeunes publics, la cabine pourrait peut être permettre d'atteindre l'objectif du nombre de visiteurs espéré depuis l'ouverture récente du musée. Curieusement, la cité internationale de la dentelle n'a pas fait de cette nouveauté phare un élément incontournable de son parcours.
En effet, la novation de la cité de la dentelle prend place... dans le hall du musée. Endroit étrange pour implanter une innovation technologique ! La machine nécessitant la présence d'un personnel qualifié et en l'occurrence des agents d'accueil explique peut être l'insertion de la cabine si près de l'entrée. Le fait que la cabine ne soit pas intégrée au parcours muséographique constitue un problème majeur. L'innovation est utilisée uniquement comme un gadget et ne vient en aucun cas renforcer le propos scientifique. Pensée a posteriori mais surtout indépendamment du parcours, elle semble naufragée dans le hall.
Concurrencée, la cabine de mesure 3D a du souci à se faire. Où ? Au sein même de la cité de la dentelle! Une cabine d'essayage est déjà présente au sein de l'espace permanent. Celle-ci prend également la forme des nouvelles technologies. Renvoyant au traditionnel dispositif de fête foraine, le visiteur place sa tête entre un vêtement et un accessoire de son choix et prend une photographie. Contrairement à la cabine de mesure 3D, le visiteur se voit immédiatement. S'il le souhaite, le visiteur s'envoie les photographies par mail. La possibilité d'utiliser la cabine d'essayage à plusieurs et sa simplicité explique en partie le succès de ce dispositif auprès des publics, contrairement à la cabine de mesure 3D.
Effectivement, la cabine 3D ne remporte pas le succès escompté. Ce constat observé à l'intérieur de l'institution révèle de nombreux défauts. Cette nouvelle technologie est régulièrement en panne. Techniquement encore, le scanner demande une position statique si ce n'est robotique du corps. Il arrive fréquemment que les parties du corps du visiteur se confondent. Ne vous vexez pas donc si votre avatar ressemble à un hybride !
Si l'on tend vers un musée de plus en plus participatif, se déshabiller fait rarement partie des actions quel'on réalise au musée ! De ce fait l'expérience est donc dédiée aux adultes et aux mineurs munis d'une autorisation parentale. Tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec son corps pour se mettre en sous vêtements comme l'ont fait récemment les trois mannequins au musée d'Orsay pour la marque Etam. Rassurez-vous, vous n'êtes pas au milieu du musée mais bien dans une cabine matérialisée par une boxqui est toutefoisnon fermée en hauteur. Vous entendez donc les conversations extérieures et l'agent d'accueil qui vous indique comment positionner votre corps. Bien que cette dernière ne perçoive qu'une silhouette sur son écran, elle vous parle tandis que vous êtes en sous-vêtements...Le fait de se déshabiller est un réel frein pour tester cette cabine.
Dommage que cette innovation soit un échec. Ouverte en 2010 la cité de la dentelle nous a toutefois conquis par le parcours muséographique à la fois thématique et chronologique. Nous avons été ébloui par la scénographie contemporaine révélant la finesse, la transparence de la dentelle et la pesanteur, l'aspect "brut" des métiers à tisser Leavers. Entre l'absence totale ou l'utilisation à outrance des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) dans l'espace muséal, il apparaît nécessaire d'utiliser ses nouveaux outils à bon escient. Modifiant notre rapport au musée et aux objets, les nouvelles technologies sont encore trop souvent une transposition sous une autre forme, un autre support de ce qui existe déjà. Elles sont toutefois à considérer comme des outils innovants, acteurs du musée d'aujourd'hui et de demain.
Rachel Létang

La Chambre des visiteurs : acte 2
Ayant profité des congés de Noël pour retourner dans ma terre natale normande, je suis allée visiter la fameuse « Chambre des visiteurs » au Museum d’Histoire naturelle de Rouen. Il fallait quand même voir le résultat, tant mon premier article à ce sujet m’avait posé de questions.
Petit résumé de l’initiative

Visuel du site © http://www.lachambredesvisiteurs.com/
Un manque de communication
Première constatation : rien à l’extérieur du Museum n’indique qu’à l’intérieur on puisse trouver une exposition d’œuvres choisies par les visiteurs. Aucun texte à l’accueil ne parle de l’initiative dont résulte l’exposition, pas de signalétique non plus. J’ai donc demandé où était la salle dans laquelle je pourrais trouver ce petit bijou participatif. « Au premier étage du Museum, en haut des escaliers à droite. » Ni une, ni deux, je gravis les quelques marches qui me séparent de la fameuse exposition, j’arrive au premier. Au second, j’entends un « brouhaha » phénoménal, mais ici, personne. Je franchis la porte de la « chambre » que je cherche, et tombe sur le texte de présentation de l’exposition.
Photo du texte de présentation de l'exposition © Chloé Méron
Une exposition classique
Vue d'ensemble © Chloé Méron
Bibliothèque © Chloé Méron
« À moitié »
C.M
#mbarouen
#commissariatparticipatif
#exposition

La gouverneure du roi des Français sur Instagram
Les réseaux sociaux, et Internet en général, sont une merveilleuse mine de contenus accessibles du bout des doigts, dont l’approche peut être la vulgarisation scientifique, qu’ont choisi Charlie Danger, Docteur Nozman, ou encore… Stéphanie Félicité du Crest, comtesse de Genlis.
@felicitedegenlis
Madame de Genlis a tout l’air d’une Instagrammeuse comme les autres : biographie soignée et ponctuée d’emojis, un feed* harmonieux et du contenu scientifique. Les stories* ne sont pas en reste, puisqu’on y trouve régulièrement des tutos pour petits et grands pour fabriquer sa maquette d’une fortification Vauban ou son globe terrestre en papier. Un petit détail différencie pourtant Félicité de Genlis : elle est légèrement au-dessus de la moyenne d’âge de ses collègues, à 275 ans.
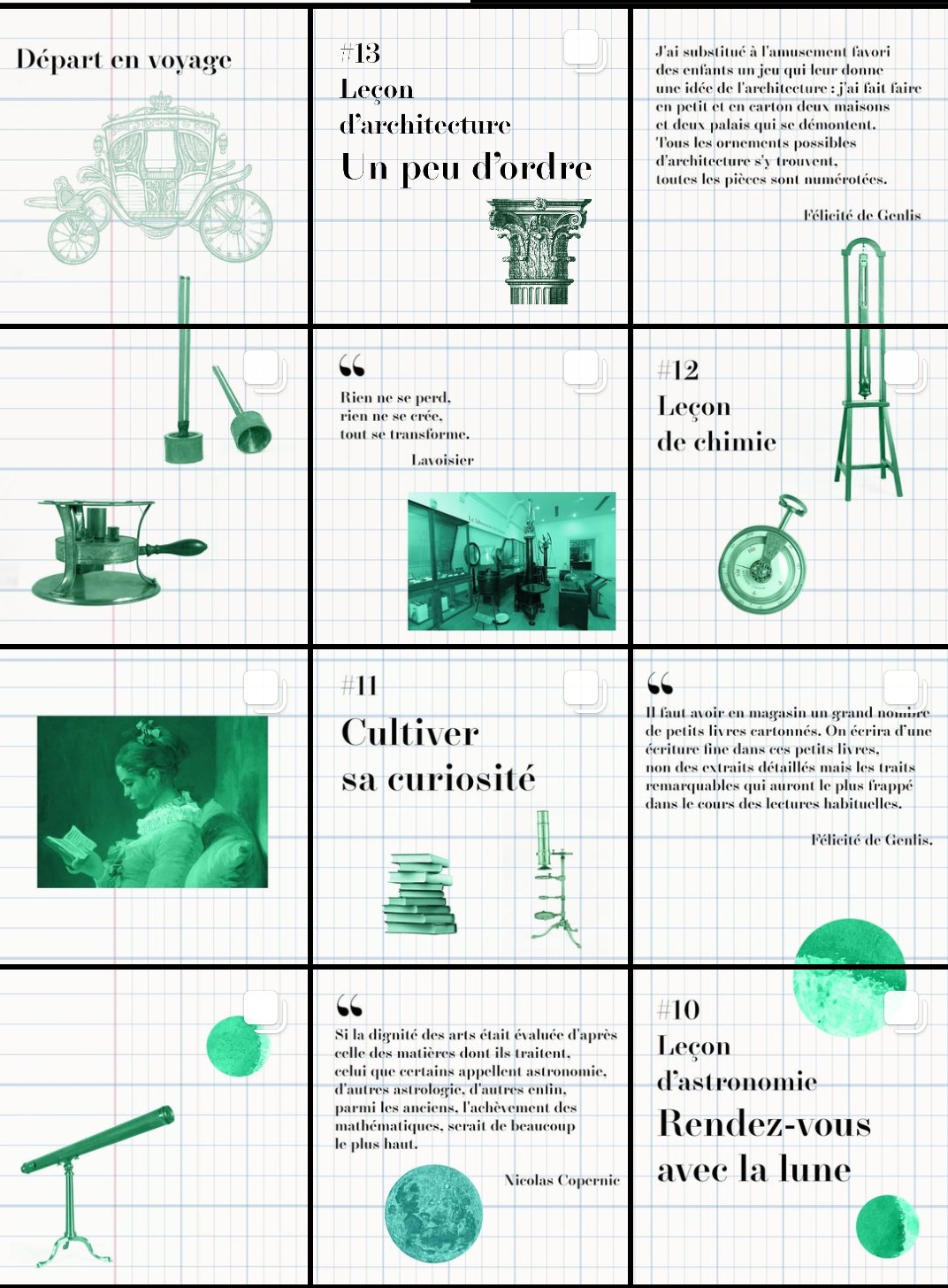
Capture d’écran du compte Instagram
En effet, notre neuf fois trentenaire nous parle depuis l’Ancien Régime, où elle fut la gouverneure des enfants de la famille d’Orléans, dont Louis-Philippe, futur roi des Français. Elle était alors chargée de leur éducation et grande amatrice de la pédagogie active, méthode d’enseignement rendant l’élève acteur de son propre apprentissage. C’est alors naturellement que le musée des Arts et Métiers a décidé d’adopter le même parti pris pour l’exposition qui lui a été consacrée du 16 octobre 2020 au 27 juin 2021, mais qui n’a malheureusement comptabilisé que trois semaines d’ouverture aux publics. Pensée autour de nombreux dispositifs manipulables mais aussi numériques, l’exposition Top modèles. Une leçon princière au XVIIIème siècle s’inscrit alors dans la lignée de madame de Genlis. Du fonctionnement d’un laminoir à celui d’un moule pour les tuyaux de plomb, les visiteur⋅euse⋅s tout comme ses élèves pouvaient s'immerger au cœur des ateliers d’artisans, grâce à des modèles regorgeant de précisions et de détails.
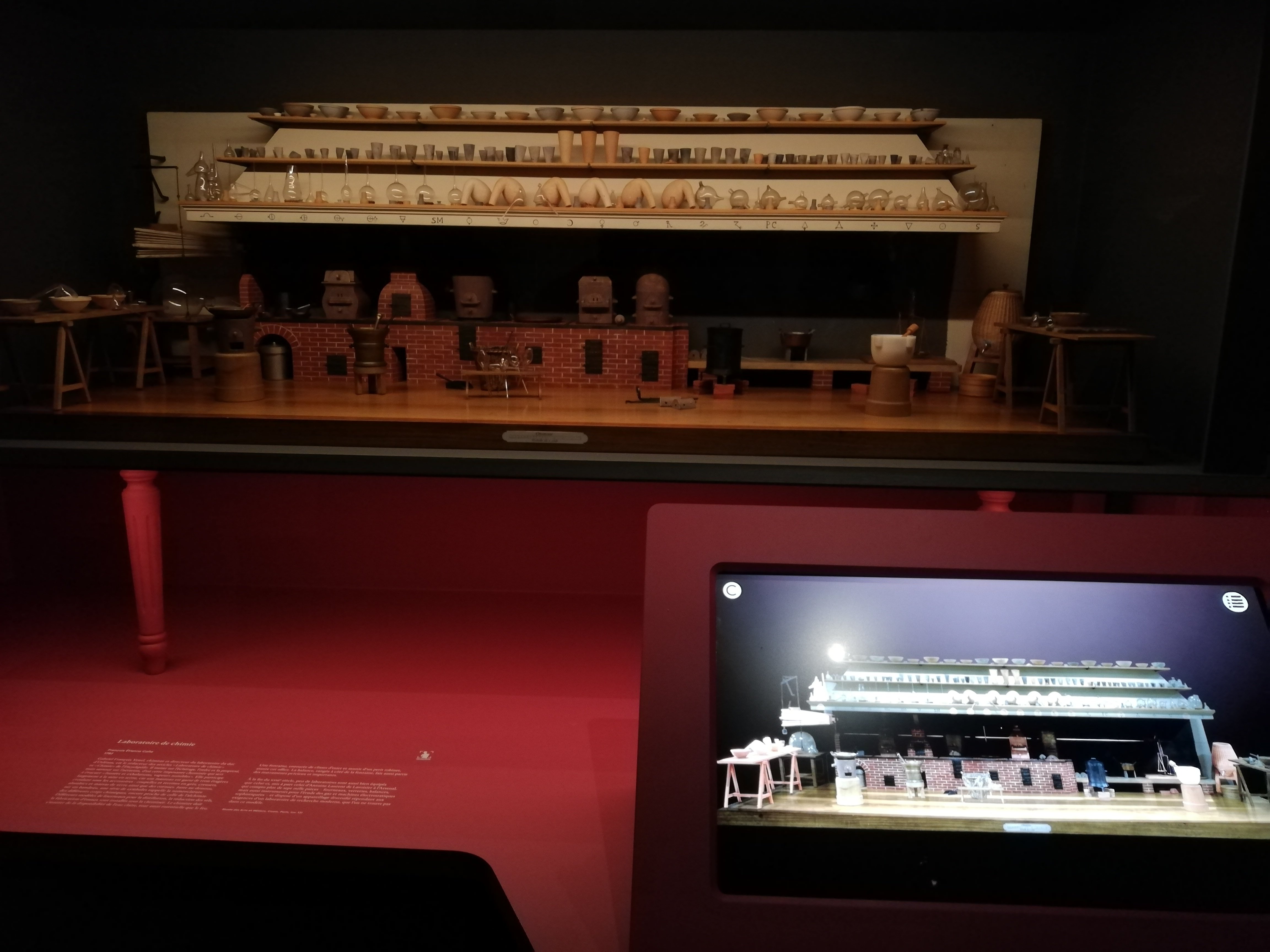
Modèle de l’atelier de chimie et dispositif numérique associé / Jade Garcin
Cette exposition, alors pensée pour être découverte les yeux grands ouverts et du bout des doigts, ne s’est cependant pas contentée d’un unique médium pour exister, et s’est jouée des contraintes liées à la fermeture des musées pour se repenser constamment. Le compte Instagramen est un premier exemple, avec notamment ses nombreux renvois vers le blog…
Apprendre à Bellechasse
Le blog fut le premier né de cette déclinaison de médias d’exposition. Pensé pour être une plateforme éducative, ce site internet partage des activités et leçons scientifiques pour petits et grands. Leçons d’astrologie, de géographie, de botanique… mais aussi création de son propre mobile céleste ou réalisation de sa maquette de fortification Vauban sont au programme. En commençant par la leçon, on découvre des contenus pensés pour aller à l’essentiel, agréablement illustrés par de l’iconographie des plus belles bibliothèques ou des plus beaux musées, comme la bibliothèque Mazarine ou le Rijksmuseum. On y (re)découvre de nombreux savoirs, pour enfin s’amuser et créer avec. Les contenus présents sur notre écran sont au plus proche de ce qui existe entre les murs du musée des Arts et Métiers, mêlant apprentissage et jeu, tout comme l’était pensée l’exposition avec ses différents dispositifs et son application de réalité augmentée.
Nous sommes accueillis au Pavillon de Bellechasse - virtuellement -, comme le furent les enfants royaux, selon la même pédagogie appréciée de madame de Genlis. Et si l’exposition cherchait à séduire un public familial, l'on peut ici imaginer que ce sont les parents en mal d’activités pour leurs enfants qui ont été charmés.
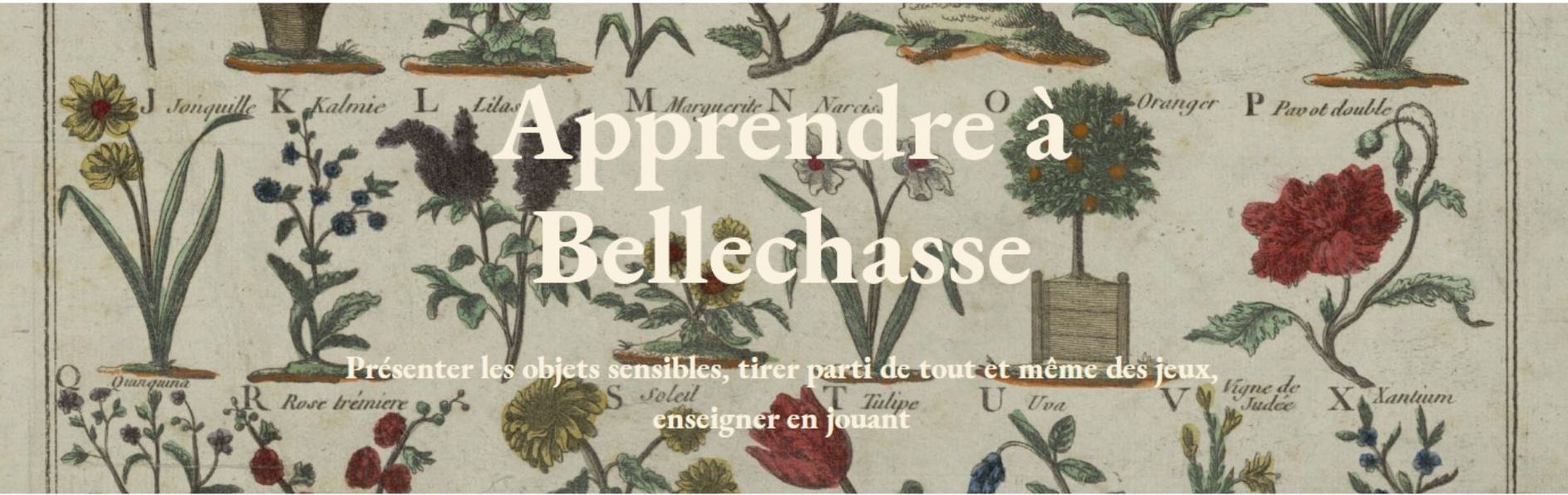
Bannière du blog / Musée des Arts et Métiers
Des manips au numérique...
Félicité de Genlis était convaincue que l’on pouvait apprendre en toute occasion, et de quelque manière que ce soit. En relevant les défis apportés par la fermeture d’une exposition sur la quasi-totalité de sa période d’ouverture prévue, le musée des Arts et Métiers s’est prêté à un exercice créatif de redéfinition des limites d’une exposition. Celle-ci s’est alors muée en un support transmédia, allant à la rencontre des publics de manière rassurante, en restant fidèle à son propos.
Pour autant, il n’était pas question de prétendre pouvoir pallier la fermeture des musées en répliquant exactement tout ce qu’une exposition aurait pu proposer. De lieu de sociabilité, on passe à l’intimité d’un foyer et à la limitation par la taille d’un écran. Les échanges, qui auraient pu se faire entre visiteur⋅euse⋅s ou avec les médiateur⋅ice⋅s n’ont pu se faire une place dans cet univers virtuel.
Cet univers est par ailleurs contraint par les algorithmes, notamment celui d’Instagram, bien souvent critiqué depuis quelques années pour la difficulté que peuvent avoir certains comptes d’être vus, même par leur abonné⋅e⋅s. Ce choix de réseau social permet néanmoins une présentation dynamique et synthétique où l’utilisateur·ice est d’autant plus libre du temps qu’il·elle accorde aux publications, puisqu’il·elle peut décider de les enregistrer pour y revenir à un autre moment de la journée, sans se perdre dans le flux de la plateforme. Enfin, le format blog, en diffusant les contenus sans permettre de réelles interactions, ne rejoint malheureusement pas entièrement les premières ambitions de l’exposition, démontrant une nouvelle fois que si une exposition peut se développer par la transmédialité, elle est bel et bien un médium à part entière, avec ses propres contraintes et opportunités.
Feed : enchaînement des photos et vidéos publiées sur un compte Instagram
Stories : publications éphémères de 24h, sous la forme de photos ou vidéos
#Numérique #Sciences #Médiation

La Grande Guerre se rapproche de vous
Le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux propose des web-visites qui permettent à un public, notamment étranger, de bénéficier d’une visite au sein des collections permanentes sans avoir à se déplacer.
Il existe actuellement trois variantes de web-visites au sein de ce musée, toutes accessibles via un logiciel de visio-conférence et accompagnées d’un médiateur. Les web-visites sont différentes de par leur médium qui varie de la tablette au robot télécommandé, mais également par l’expérience de visite, à la fois pour le public mais également pour le médiateur.
Pour en savoir plus :
Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube
Samantha Graas
31 juillet 2017
#histoire #mediation#robot
La Halle aux Sucres, histoire d'un troisième lieu
La Halle aux sucres est une institution atypique qui regroupe en son sein le Learning center villes durables, l’Agence d'urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque, le Centre de la mémoire urbaine d’agglomérationainsi que l’Institut national spécialisé d’études territoriales. Toutes ces organisations sont liées à l’urbanisme dans un lieu résolument mis sous le signe de l’architecture, dès son entrée pensée par Pierre-Louis Faloci. A l’origine, le bâtiment était une grande halle qui servait à transformer la betterave en sucre. Aujourd’hui il est évidé et coupé en deux. Ne restent dans la nouvelle construction que les murs extérieurs. Ce nouveau lieu très moderne métamorphosé illustre le lien passé-présent-futur qui est central pour la Halle aux sucres.
L’entrée du site © Daniel Osso
Elle est également porteuse d’un regard ouvert sur l’international : en effet l’exposition du Learning center esquisse les différentes manières d’appréhender l’urbanisation dans le monde. Elle insiste sur ce qui se fait actuellement et les répercussions que cela pourrait avoir pour demain. Elle évoque différentes problématiques actuelles comme le transport, l’eau ou l’environnement et questionne les manières de faire et les problèmes actuels en essayant de montrer que des solutions existent.
Dunkerque est une ville parfaite pour porter ces enjeux, puisque la ville n’a eu de cesse de se renouveler au niveau urbain. On peut citer comme exemple magistral, l’opération dynamo de 1940, où la ville s’est elle-même inondée grâce à ses wateringues [1] pour résister aux assaillants nazis. Par ailleurs, un film de Christopher Nolan portera cette histoire sur grand écran cette année [2]. Cette opération a profondément changé la ville et son urbanisation en quelques heures seulement, faisant de Dunkerque une ville mouvante.
Le terme anglo-saxon de Learning center est utilisé pour désigner la double fonction du lieu : centre de ressources avec quantité d’ouvrages sur l’urbanisation, espace de vie chaleureux et lieu d’apprentissage porté par l’exposition.
L’exposition pensée par la muséographe Agnès Levillain, de la société Sens de Visite, se tient sur trois étages et repose sur les problématiques sociales, environnementales et économiques que soulève l’urbanisme. Pour que le visiteur s’interroge elle le rend actif, mobilise tous les sens avec la possibilité de sentir et d’entendre les différents bruits de la ville.
Dispositif sonore sur les bruits de la ville © MélineSannicolo
Elle évoque par exemple les différentes manières de se déplacer en ville, en montrant divers exemples de transports et de couloirs routiers. Ainsi on apprend qu’au Brésil des routes sont réservées aux bus, coupées du reste de la circulation. On peut voir les grandes autoroutes américaines remplies de voitures ou le développement des cyclistes dans le nord de l’Europe. Bien plus, elle laisse une grande place au numérique et aux médias participatifs. Il est d’ailleurs dommage que ceux-ci soient sous-exploités, un manque de témoignages empêche de les rendre lisibles. En effet, les contenus dépendent des visiteurs et utilisateurs de l’application [3] du musée, or peu d’entre eux fournissent des vidéos et photos pour rendre les médias participatifs, en témoignant sur leur ressenti de la ville.
Par exemple un dispositif interactif propose aux habitants de dessiner le chemin qu’ils font tous les jours dans la ville de Dunkerque sur l’application : aller à l’école ; s’arrêter pour prendre des croissants ; aller au boulot ; etc. Il montrerait les différentes manières de se déplacer dans la ville avec différents trajets proposés. Malheureusement ce dernier n’est pas actif, car peu d’habitants font leur « tracking » [4]. Cette absence de témoignages peut s’expliquer par le manque de visibilité de l’application dans la ville et par le côté anxiogène de la notion de « tracking ».
L’exposition se lit facilement avec des illustrations immenses et de la data vision. Enfin les exemples utilisés sont saisissants, entre dimension locale et internationale, insistant sur le fait que les enjeux d’urbanisme sont les enjeux de tous.
Un quatrième étage est destiné à l’exposition temporaire « Villes réelles, villes rêvées ». Son côté artisanal avec les cartels écrits à la main et la scénographie en carton, lui donne un certain charme et n’enlève rien à son propos scientifique sur les villes utopiques. Des jeux et des livres sont disséminés dans toute l’exposition incitant à y passer la journée.
Entrée de l’exposition temporaire © Annaëlle Lecry
La Halle aux sucres est donc un tiers lieu, c'est-à-dire un lieu hybride sur l’urbanisme, à la croisée du centre de documentation, du lieu de vie et de l’espace d’expositions qui s’implante parfaitement dans son territoire.
Océane De Souza
#Urbanisme
#Dunkerque
http://testweb.halleauxsucres.com/: le site du musée
https://www.urbanisme.fr/: pour en savoir plus sur l’urbanisme
[1] "Ensemble des travaux de dessèchement des pays situés au-dessous du niveau de la mer, dans le nord-ouest de la France, en Belgique et aux Pays-Bas." Dictionnaire Larousse
[2] http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=240850.html
[3] http://itunes.apple.com/fr/app/la-halle-aux-sucres/id1063723812?l=en&mt=8
[4] Suivre le chemin d’une personne pour analyser son comportement, notion de marketing à la base.

La Machine à contes du Musée Dauphinois
Sur ce blog Muséomix nous est bien connu. Si plusieurs de nos articles l’ont déjà évoqué, cette fois nous vous parlons d’un dispositif né à la suite de l’édition de 2013. Pour cela, allons au Musée dauphinois ; ce musée de société situé à Grenoble est sensible depuis longtemps au patrimoine oral dont la mise en exposition n'est pas sans difficultés. C’est pourquoi le musée avait souhaité en faire une des thématiques de l’édition Muséomix accueillie dans ses murs. Une équipe, les « blablateurs », a produit un prototype de « machine à contes » pour faire écouter des contes, faire comprendre leurs mécanismes et surtout en récolter.
Aujourd’hui la machine à contes, c'est un dispositif numérique dans une sorte d'alcôve dans lequel les visiteurs entrent et peuvent écouter un conte, en créer grâce à un jeu qui permet de comprendre et d’explorer les ressorts narratifs qui sous-tendent les contes et enfin enregistrer un conte. Le jeu consiste à inventer un conte à plusieurs en suivant des étapes indiquées par le dispositif.
La façade de l’alcôve dans lequel se trouve le dispositif (crédits : C. R.)
Le cartel interpellant les visiteurs et expliquant le dispositif (crédits : C. R.)
Vidéo du Musée dauphinois expliquant le fonctionnement de la machine à contes : https://www.youtube.com/watch?v=x6gETf8Mpkc
Le Musée dauphinois a décidé d’en faire un dispositif pérenne au sein de son exposition longue durée Gens de l’Alpe, consacrée à la vie en montagne. Ce projet a pu être mis en œuvre en remportant l’appel à projet « services culturels numériques innovants » lancé en 2015 par le Ministère de la culture.
Le prototype a été conçu en trois jours (conformément aux conditions d’un Muséomix) mais la conception et réalisation du dispositif pérenne a duré plus de deux ans et a mobilisé de nombreux partenaires. La notion d’équipe et de travail partagé par plusieurs corps de métiers s’est retrouvé tout au long du projet, du prototype Muséomix à la réalisation finale. En effet, de nombreux partenaires ont participé, le musée bien-sûr, le pôle innovation de la direction de la culture et du patrimoine, le service de la lecture publique, le Centre des Arts du Récit (scène conventionnée d’intérêt nationale dédiée aux contes et conteurs) ainsi que France Bleu. A ceux-ci s’ajoute l’agence SètLego de Marseille a fait le développement numérique du projet et sa scénographie, puisque le dispositif prend place dans une alcôve conçue sur mesure.
Cette liste témoigne de l’intérêt suscité par ce projet et par la thématique du patrimoine oral et des contes, qui a rassemblé des institutions qui ne se croisent pas forcément.
Vue du dispositif dans son alcôve (crédits : C. R.)
La Machine à contes s’appuie sur le travail de Charles Joisten, ancien conservateur du Musée dauphinois qui a collecté et retranscrit de très nombreux contes alpins. La conception du dispositif a donc naturellement commencé par un choix de contes, effectué par Alice Joisten et Jean Guibal, directeur du musée au moment de la conception. Ils ont ensuite été interprétés par deux conteuses qui se les sont appropriées tout en restant fidèles aux retranscriptions de Charles Joisten. Enregistrés dans les studios de France Bleu, les contes ont nécessité un important travail technique sur le son.
Le reste du contenu a ensuite été créé à partir des contes : il a fallu d’abord faire le nuage de mots, développer le jeu et enfin les outils d’enregistrement et de gestion des contes enregistrés.
Pourquoi pérenniser ce dispositif ? Quel intérêt pour le musée ?
Celui-ci souhaitait mettre en valeur le patrimoine oral des contes, et le numérique constituait le bon un outil pour construire un module de mise en exposition des contes. Cela permet aussi de les faire entendre dans un contexte proche de leur « environnement naturel », c’est-à-dire par la voix d’un conteur et non par la lecture d’un livre comme c’est souvent le cas.
Mais la machine à contes n’a pas seulement pour but la simple écoute d’aller au-delà en faisant comprendre le fonctionnement des contes et en donnant la possibilité d’enregistrer un conte existant, ou inventé. En effet poursuivre la collecte de ce patrimoine oral est un objectif que le musée s’est fixé en créant cet outil. Les visiteurs ne peuvent enregistrer de contes qu’une fois qu’ils ont écouté, afin de s’assurer qu’ils aient bien compris la démarche. Si l’équipe du musée juge que le conte enregistré a sa place dans la machine à contes, il intègre le corpus des « contes d'ici et d’ailleurs » et les visiteurs pourront l’écouter.
J’ai rencontré Patricia Kyriakides, chargée de la médiation au Musée dauphinois à l’été 2018, nous avons échangé autour de la Machine à contes et de retour sur expérience deux ans après la mise en place du dispositif.
Selon elle, si le jeu consistant à inventer un conte marche bien auprès du public, elle n’est pas complètement satisfaite de l’utilisation actuelle du dispositif car il y a peu d’écoutes et d’enregistrements. Dans la situation actuelle elle a l’impression que le dispositif ne remplit pas ses objectifs, à savoir faire comprendre ce qu’est un conte et surtout en collecter. Je pense cependant, que les visiteurs sont sensibilisés à la thématique et que s’il ne faut pas s’en contenter, on ne peut considérer que c’est un échec.
En conclusion Patricia constate que le dispositif est compliqué s’il n’est pas accompagné. C’est pourquoi elle souhaite améliorer la médiation autour de la machine à contes, en faisant des ateliers, des formations avec les enseignants, en accueillant des scolaires. L’avenir du dispositif passera donc par davantage d’accompagnement et de médiation.
Cet échange nous rappelle que si les dispositifs numériques donnent parfois l’impression qu’ils peuvent fonctionner tout seuls, qu’ils seront automatiquement attractifs pour les visiteurs car numériques, ils ne peuvent bien souvent se passer de médiation.
En revanche ne laissons pas cette conclusion en demi-teinte faire oublier que les dispositifs numériques sont des outils précieux pour mettre en exposition et peuvent permettre de renouveler notre approche d’une thématique, comme ici la culture orale.
Merci encore à Patricia Kyriakides, responsable de la médiation au Musée dauphinois d’avoir accepté de répondre à mes questions et pris le temps d’échanger autour de la machine à contes.
Bethsabée Goudal

La mécanisme d’Anticythère a son médiateur particulier
Un outil spécial pour un objet spécial
Le mécanisme d’Anticythère, ça ne vous dit rien ? Votre esprit se remplit d’un grand point d’interrogation ? Si je vous précise qu’il s’agit d’un mécanisme de calculs scientifiques tout droit venu de l’an 87 avant Jésus-Christ, vous commencez à prendre peur ? Et si je vous propose de vous l’expliquer, en tenant compte des aspects historiques, scientifiques, astronomiques et mécaniques, ça vous tente ? Non, et c’est normal. Il est toujours un peu effrayant de tomber nez à nez avec une machine inconnue au nom compliqué dont l’aspect à tendance à vous faire croire que vous ne pourrez jamais la comprendre. Et pourtant, il existe l’outil de médiation parfait pour nous aider à percer les secrets de la machine d’Anticythère, ou du moins essayer.
L'outil de médiation © M. T.

Le principe de l’outil
Le tableau de bord pour activer les mouvements de la caméra et l’écran qui retranscrit en direct les images. © M. T.
La vitrine est encastrée, l’objet n’est visible que par une seule face, et son support est assez conséquent. En effet il est maintenu dans un bloc rectangulaire qui n’aide pas à le rendre visible. Cela est certainement dû à des problèmes de conservation et de fragilité. Mais pour rendre cet objet plus accessible, en terme de lisibilité, un système de caméra mobile a été installée, elle circule sur deux plans : elle tourne autour de l’objet sur un axe horizontal, mais aussi sur un axe vertical.
Les images de la caméra sont retranscrites en direct sur un écran à côté de la vitrine. Une table de contrôle est à disposition du visiteur en dessous de la vitrine : elle permet de faire pivoter la caméra. Six positions sont préenregistrées, ce sont les plus intéressantes au niveau de l’observation de l’objet. Mais le visiteur peut aussi faire pivoter librement la caméra en utilisant la sphère sur l’écran tactile. Il peut aussi activer un zoom, pour observer les nombreux détails de l’objet, mais celui-ci étant numérique, la qualité n’est pas excellente.
Un petit élément vient tout de même perturber la lecture de l’objet, il s’agit d’engrenages qui viennent se dessiner sur la face visible de la vitrine. L’objet étant déjà petit et le mécanisme de la caméra assez gros, on ne comprend pas pourquoi des roues crantées viennent s’installer dans le champ de vision. Cet élément uniquement décoratif n’apporte rien et trouble la compréhension de l’objet pendant un instant.
Un outil de médiation stratégique
En soi, cet outil ne diffuse pas d’informations, il permet juste de constater les prouesses techniques et l’esthétique de l’objet. Mais surtout, il éveille la curiosité. En effet, une fois que l’on s’est bien amusé avec, on se demande quand même à qui est destiné cet objet et quel est son rôle : il éveille la curiosité. Il permet une autre forme de médiation avec les autres supports de l’espace. On peut donc apprendre avec plaisir que ce minuscule objet est le plus ancien mécanisme à cran que l’on ait trouvé et que c’est un mécanisme de calcul qui se base sur l’année solaire et l’année lunaire égyptienne. Il traduit un phénomène cyclique en prenant le mouvement des astres comme fondement. Le mécanisme d’Anticythère est « la synthèse des connaissances astronomiques et du savoir-faire mécanique de son époque ». Ainsi nous pouvons aussi apprendre ses 16 fonctions. On peut se demander pourquoi l’écran et la vitrine ne sont pas côte à côte, ce qui oblige à ne regarder que l’un ou l’autre, mais cela a aussi un autre intérêt : ceux qui ne sont pas attirés par le fait de manipuler le tableau de contrôle peuvent quand même suivre l’action et découvrir l’objet en restant à une certaine distance.
Cet outil de médiation est donc intéressant car il valorise l’esthétisme et la technique, par le biais de la technologie, pour susciter chez le visiteur une curiosité favorisant l’envie de découvrir cet objet. L’espace dans lequel il est présenté résulte d’un partenariat entre la Fondation nationale de la recherche scientifique hellénique, le Musée national archéologique d’Athènes, le projet de recherches sur le Mécanisme d’Anticythère et la manufacture horlogère Hublot de Genève. Il a également été placé sous la tutelle de la délégation permanente de la Grèce auprès de l’Unesco.
Mélanie TOURNAIRE
Des infos sur l'expo et sur l'intrigante machine ici
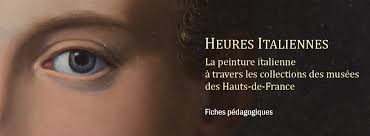
La peinture moderne à l’heure du XXIe siècle…
Depuis un an et demi, le site de l’association des conservateurs des musées du Nord-Pas de Calais, Musenor, propose à ses internautes une exposition virtuelle intitulée « La Renaissance italienne dans les musées du Nord-Pas de Calais ».
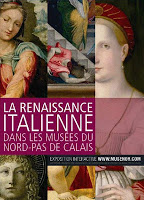
© Musenor
Ce dispositif numérique et interactif n’est pas une première pour cette association, un même projet avait déjà été mis en œuvre dans le cadre de l’exposition « La peinture nordique de 1400 à 1550 dans les musées du Nord-Pas de Calais». Le site Internet de Musenor étant, à l’origine, une base de données, ces expositions virtuelles lui donnent un caractère plus vivant et plus accessible.
Une énième exposition sur l’art de la Renaissance italienne vous direz-vous ? N’a-t-on pas déjà tout vu ? Tout compris ? Exposé toutes les œuvres remarquables ? Est-ce seulement une autre manière de présenter ces peintures au public ? Pourtant, il est indéniable que cette exposition apporte de nouvelles choses tant au niveau de la médiation des œuvres montrées que du contenu même de cette présentation.
Créer une exposition uniquement pour des internautes est un concept encore assez récent, il est donc intéressant d’en soulever les avantages. Bien sûr, il y a d’abord les bénéfices d’internet : la très grande accessibilité permet à n’importe qui dans le monde de parcourir cette présentation, l’exposition peut alors jouir d’une diffusion internationale. Ce procédé peut également toucher un public qui ne va pas habituellement au musée, appelé le public empêché, que ce soit pour des causes physiques ou morales (éducation…).
Par le biais du site web, les « internautes visiteurs » entrent dans l’exposition de chez eux, via leur ordinateur. Les adolescents ou jeunes adultes sont ainsi possiblement plus touchés. Ajoutons que ce dispositif est gratuit. Enfin, et surtout, il permet de présenter une exposition regroupant soixante-quatorze œuvres de neufs musées différents : cette réunion de peintures n’aurait pu avoir lieu physiquement. En effet, les tableaux présentés sont extrêmement sensibles aux variations d’hygrométrie et de température et ne peuvent être déplacés et réunis pour une exposition. Pour autant, l’enthousiasme d’une si grande accessibilité facilitée pour tous ne doit pas faire oublier qu’il faut, avant toute chose, que le public vienne sur le site de Musenor pour arriver à cette page spécifique.
L’exposition en elle-même est lisible et agréable. L’ « internaute visiteur » retrouve les repères spatiaux d’un musée classique, il se balade ainsi dans un couloir ou dans une rotonde (suivant l’un ou l’autre des deux parcours proposés : chronologique ou thématique). De même, le regroupement de tableaux en séquence, autour d’une période ou d’un thème est clair dès le premier coup d’œil. Toutes les œuvres sont de dimensions proportionnelles, ainsi une fois encore, le visiteur repère en un clin d’œil les différences d’échelle : chose notable car cela fait souvent défaut dans les présentations photographiques d’œuvres.
Le contenu scientifique se décompose en quatre niveaux de lecture : de l’information générale à la précision scientifique. A première vue, l’internaute découvre une galerie d’images proposant des repères très généraux (ni cartel, ni localisation). Ensuite, il clique sur les titres des parties pour faire apparaître des textes introductifs. On regrette d’ailleurs que ces encadrés cachent les tableaux qui constituent leur sujet et peut-être l’absence de texte de conclusion. Si le visiteur souhaite en apprendre davantage sur une œuvre, un clic sur la miniature le conduira à une page dédiée à la peinture (une fiche, une œuvre). L’image y est plus grande (et un outil loupe pourra encore la grossir), il y trouve enfin le cartel de l’œuvre et une notice simple. Pour finir, d’ici l’internaute a accès à une analyse détaillée qui décompose la peinture, mais également à son historique et à sa mise en relation avec d’autres œuvres.
Cette exposition virtuelle est donc tout à fait appréciable sur différents plans, la création d’une exposition irréalisable, une accessibilité et une diffusion décuplées ou encore une adaptabilité à différents publics suivant leurs attentes d’éducation ou de connaissance. Néanmoins, on regrette que plusieurs manipulations nous paraissent peu intuitives : la loupe est cachée en bas à droite de la « page œuvre » et le retour à la galerie générale est également peu visible. Enfin, il aurait été souhaitable que les concepteurs aillent encore plus loin dans le multimédia, pourquoi pas un possible dispositif audio, un parcours enfant ou des animations…
Cécile MASSOT
« LaRenaissance italienne dans les musées du Nord-Pas de Calais »
Partenariat entre l’Association des Conservateurs des musées du Nord-Pas de Calais et l’Institut National d'Histoire de l'Art

La transformation digitale au service de la démocratisation culturelle?
Depuis une quinzaine d’années, le numérique s’est implanté dans le domaine de la culture. Les premiers services numériques ont été créés dans les musées et de nombreuses initiatives ont vu le jour dans un esprit d’expérimentation et d’innovation. Aujourd’hui, le numérique dans la culture a atteint un « âge de raison ». Il est temps de faire le bilan sur plusieurs années d’expérimentations tout en continuant à être attentif à ce qui se fait dans les autres domaines et à explorer les possibilités du numérique qui semblent infinies.
La définition de la transformation digitale varie en fonction des domaines qu’elle concerne. Pour une organisation, la transformation digitale désigne le processus qui consiste à intégrer pleinement les technologies numériques dans l'ensemble de ses activités. La transformation digitale d’un musée concerne alors l’ensemble de ses services, des ressources humaines au développement culturel en passant par la conservation.
Pour une institution culturelle, la transformation digitale inclut des mutations en interne à commencer par un changement dans les missions octroyées aux services numériques. Jusqu’alors, les établissements culturels regroupent l’ensemble des compétences digitales dans un seul service ou en une seule personne selon les capacités de la structure. Or, avec la transformation digitale, chaque service d’une institution culturelle est amené à utiliser les technologies numériques sans pour autant en avoir les compétences. Dans cette logique, les services numériques tendent de plus en plus vers un décloisonnement de leurs compétences afin d’accompagner l’ensemble du musée. Il joue un rôle de facilitateur auprès des autres services.
Les mutations induites par la transformation digitale concernent également la diversification des collaborations avec des partenaires technologiques. Le Google Cultural Institute, La fondation Orange, Dassault system et autres startup de la French Tech sont autant de partenaires technologiques envisageables pour une institution culturelle. Outre la mise à disposition de compétences numériques de façon gratuite, ce type de partenariat permet aux institutions culturelles de participer à des projets de très grandes envergures et d’acquérir une visibilité grand public. Pour les entreprises technologiques, un partenariat avec une institution culturelle répond à des enjeux d’image et de visibilité.

Numérisation en gigapixel d’une robe des collections de la Cité de la dentelle et de la mode à l’occasion du projet #WeWearCulture de 2017 du Google Cultural Institute et réalisation d’une exposition virtuelle © GOOGLE CULTURAL INSTITUTE
Le projet We Wear Culture inauguré par le Google Cultural Institute en juin 2017 regroupe des centaines de partenaires culturels dans le monde. En France, les partenariats ne sont pas établis uniquement avec les institutions de grandes envergures. Si le château de Versailles et les Arts Décoratifs sont partenaires, le Google Cultural Institute a également travaillé avec la Cité de la dentelle et de la mode de Calais. Ces partenariats se traduisent par la création d’expositions culturelles, la numérisation des collections ou la réalisation de vidéos à 360°. Ce type de partenariat peut être une réelle opportunité pour les structures de taille moyennes à condition que la communication en soit assurée. En effet, si aucun élément de communication in-situne renvoi aux actions culturelles numériques de l’institution, ces dernières peuvent passer inaperçues.
Aujourd’hui, la transformation digitale peut permettre de résorber la fracture numérique entre les grandes institutions culturelles disposant d’un service numérique et les plus petites structures. Quels que soient les moyens financiers dont dispose la structure, l’enjeu est le même pour tous. La diversité des partenariats gratuits et l’utilisation de fonctions gratuites telles que les réseaux sociaux permettent aux musées de différentes envergures d’émerger sur la toile. La gestion de ces outils demande des moyens humains dont les structures ne disposent pas forcément. En revanche, le personnel peut plus aisément suivre une formation et établir un calendrier de publication sur les réseaux sociaux. Il s’agit bien plus d’une question de volonté et d’innovation que de moyens financiers.
Avec le numérique, les lieux de culture s’hybrident et se réinventent. Les formes et les pratiques changent. C’est le cas par exemple des Micro-Folie dont les deux premières ont vu le jour en janvier 2017 à Sevran et en juin 2017 à Lille. Inspirés des Folies du Parc de La Villette conçues par l’architecte Bernard Tschumi, ces lieux culturels sont organisés autour de trois modules : le Musée numérique, le café Little Folie et l’Atelier (sur le modèle d’un mini FabLab). De nombreuses institutions culturelles sont partenaires du Musée numérique permettant ainsi la diffusion d’œuvres majeures du patrimoine. Il s’agit d’un lieu de vie et de rencontres, pour valoriser les initiatives locales mais aussi stimuler la créativité et l’innovation autour de la coopération et l’échange des savoirs.

Micro-Folie de Lille inaugurée en juin 2017 : musée numérique © Maison folie Moulin
Le numérique répond à des enjeux d’action culturelle et de démocratisation de la culture. Les dispositifs numériques provoquent des changements dans la nature des relations entre le musée et son public. Le visiteur devient de plus en plus acteur de sa visite et a la possibilité de répondre aux initiatives citoyennes insufflées par le numérique.
Les notions de plaisir et de délectation qui définissent le musée sont davantage assumées par les lieux culturels à travers le numérique. L’hybridation des lieux de culture, l’élargissement des pratiques culturelles et la diversification des supports technologiques sont autant de mutations provoquées par la transformation digitale au service de la démocratisation culturelle.
M.D.
En savoir plus sur le projet We Wear Culture :
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/project/fashion
En savoir plus sur les Micro-Folie :
https://lavillette.com/micro-folie/
Merci à Maïté Labat pour nos précieux échanges.
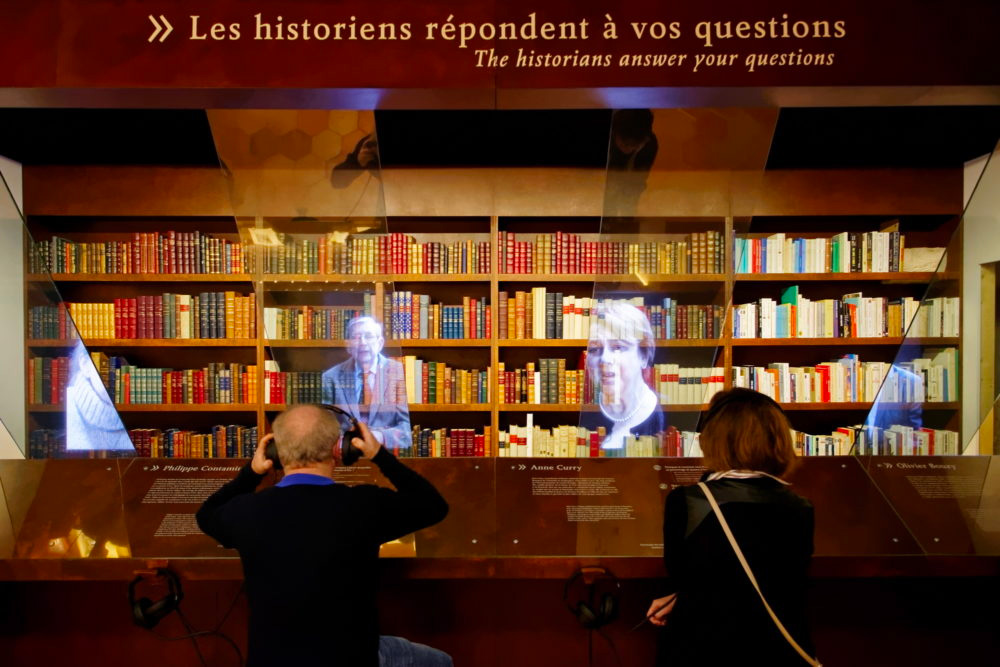
La transmission à l’épreuve des technologies innovantes dans les musées
La transmission des connaissances est l’une de missions principales des musées. Différentes méthodes ont donc été imaginées, testées, améliorées et parfois abandonnées afin de mieux s’adapter aux attentes des visiteurs. Le livret de salle et la visite guidée par un conférencier spécialiste restent classiques, presque universels.
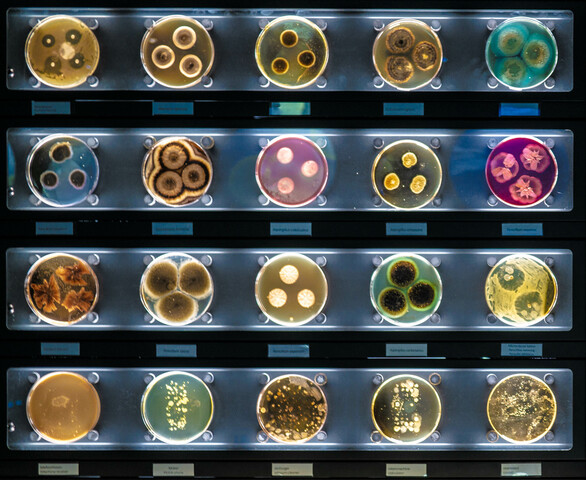
La vie des mondes microscopiques
© Yann Caradec, Exposition permanente, Musée Micropia, Natura Artis Magistra Zoo, Amsterdam, 2019.
Micropia, c’est quoi ?
L’objectif pédagogique du lieu
Dans le ventre de la bête
A la recherche des microbes
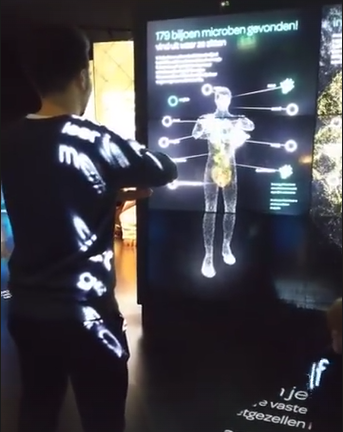 |
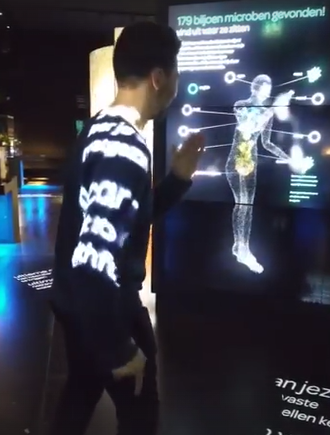 |
© Tiphaine Schriver, Exposition permanente, Musée Micropia, Natura Artis Magistra Zoo, Amsterdam, novembre 2021.
Observer l’invisible

© Tiphaine Schriver, Exposition permanente, Musée Micropia, Natura Artis Magistra Zoo, Amsterdam, novembre 2021.

© Tiphaine Schriver, Exposition permanente, Musée Micropia, Natura Artis Magistra Zoo, Amsterdam, novembre 2021.
Un retour à la réalité tardif
Passer à côté
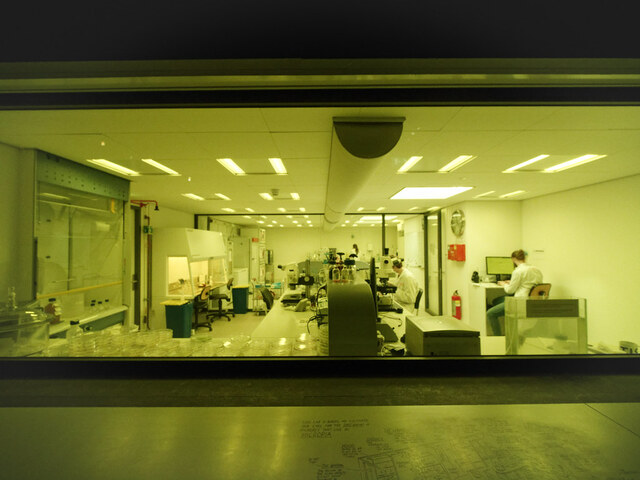
© Eric de Redelijkheid, Exposition permanente, Musée Micropia, Natura Artis Magistra Zoo, Amsterdam, avril 2019.
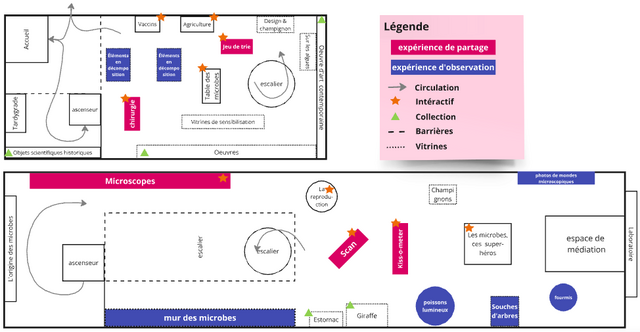
Schéma de l’exposition permanente, par Tiphaine Schriver, octobre 2024.
Encadré “Pour en savoir plus”
- Lieu : Micropia, Plantage Kerklaan 38-40, 1018 CZ Amsterdam, Pays-Bas
- Visite : 1 200m² sur 1 étage et 1 rez-de-chaussée
- Tarif : Entre 8,75€ et 17,50€. Gratuit pour les moins de 13 ans, détenteurs de la Museumcard, carte Icom ou la VriendenLoterij VIP Card.

LE PARLAMENTARIUM de Bruxelles – une visite ultra-connectée
Nous voici à Bruxelles, dans le quartier des institutions européennes, composé de ses grands bâtiments tout en verre dont l’ambiance dénote du reste de la capitale.
Agora Simone Weil © Justine Faure
Au cœur de ce quartier, l’immense esplanade Solidarnosc et l’agora Simone Weil, permettent de joindre les différents bâtiments, en dehors des grandes artères de circulation routière. Au milieu se trouve l’accès à deux espaces d’expositions entièrement gratuits pour tous : la Maison de l’Histoire Européenne et le Parlamentarium. Intrigué par le contenu et la présentation de ces espaces j’ai visité celui dont le nom ma paraissait le plus farfelu.
Le Parlamentarium, qu’est-ce donc ? Un mélange entre le parlement et un planétarium ?
Audio-guide (boitier numérique) © Justine Faure
Qualifié de « centre parlementaire pour visiteurs d’Europe », il prend place à l’intérieur de l’un des bâtiments du parlement européen de Bruxelles. Contrairement à la Maison Européenne qui, elle, raconte l’histoire du continent, le Parlamentarium retrace la création du parlement européen et de la politique européenne depuis les deux Guerres Mondiales et jusqu'à aujourd’hui.
Dés son entrée, le visiteur passe un premier sas où « bienvenue » est énoncé presque simultanément dans les différentes langues de l’union européenne.
L’accueil se poursuit par la prise en main d’un audio-guide qui s’avère être un véritable compagnon de visite. Disponible dans les vingt-quatre langues officielles de l’union européenne, avec une adaptation possible pour les personnes malentendante et malvoyante, il permet une large accessibilité à l’exposition.
Composé d’une oreillette et d’un petit écran, il est un outil de médiation à part entière. Un système de trois symboles permet de guider le visiteur pour utiliser l’appareil. Equipé d’un capteur, il suffit de positionner le petit écran sur l’un des symboles pour l’actionner.
Un « I » qui permet de donner des informations, une clef qui permet de déverrouiller les écrans tactiles et un smile qui correspond au parcours enfant.
Positionnement de l’audio-guide sur un symbole pour activer la médiation numérique © Justine Faure
En fonction des salles, les informations données peuvent être orales ou bien visuelles sous forme d’images et de textes. Il n’y a que très peu, voir pas du tout de texte au sein du parcours. En effet, chaque espace comporte les symboles permettant à chaque visiteur d’actionner les informations pour comprendre la signification des images, objets et cartes exposés.
Sur trois étages d’expositions, le Parlamentarium nous propose une immersion dans l’histoire de la politique européenne.
Ecoute de l’audio-guide devant les maquettes des institutions européennes © Justine Faure
A partir de trois maquettes, le premier espace permet de comprendre les trois villes où se situent les institutions européennes : Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles. Intrigué par le contenu du parcours enfant, j’actionne le symbole pour écouter le propos. Succin et clair, il est très agréable et constructif, même plus intéressant et moins « barbant » que le propos du parcours adulte !
Fenêtres présentant l’histoire des guerres mondiales © Justine Faure
Le second espace retrace l’histoire des deux premières guerres mondiales et nous plonge dans une scénographie sombre parsemé de fenêtres, comportant des images phares de cette première moitié du XXème siècle. A chacune, il suffit d’actionner l’audio-guide pour écouter les explications. Mais, petite frustration pour les grands enfants que nous sommes : seulement 2 photos sur une vingtaine comportent le symbole du parcours enfant. Dommage car le parcours enfant s’en trouve dès lors décousu et n’apporte pas beaucoup d’explications utiles.
Table sur l’histoire de la création de l’Union européenne © Justine Faure
Le troisième espace se décline en enfilade du deuxième, avec une scénographie légèrement plus lumineuse. Au centre, par le biais de panneaux vitrés et de tables tactiles, se trouvent des informations sur la création de l’union européenne et le rassemblement des pays, et également sur les différents décrets et événements politiques.
Ligne du temps photographique © Justine Faure
Sur la droite, une ligne du temps composée de photographies, retrace l’histoire des années 1950 à aujourd’hui, évoquant les événements clefs, qu’ils soient culturels, politiques, écologiques, sociaux…
Lorsque l’on actionne l’audio-guide, nous pouvons rechercher les légendes des différentes photos par décennie. En famille, cet espace favorise les dialogues intergénérationnels et devient un support pour raconter des moments vécus par les uns et les autres.
L’espace suivant se veut un lieu de compréhension du fonctionnement du parlement et de l’élection de ces différents membres. Une maquette représente les différents partis ainsi que les différentes nationalités au sein de ceux-ci. Des bornes tactiles permettent d’aller à la recherche des députés des différents pays et d’autres permettent également de se mettre dans la peau d’un député et de donner son avis sur des questions européennes.
Enfin le dernier espace est divisé en trois activités interactives, reconnectant l’attention du visiteur.
Modules amovibles © Justine Faure
Au centre, se trouve une immense carte de l’union européenne, au sol, avec des noms de villes. Des modules amovibles sont disposés de part et d’autre de la salle. Le visiteur s’empare alors de l’un d’eux et se déplace en le poussant. Lorsqu’il passe au-dessus d’une ville, une vidéo se déclenche sur le module. Le visiteur se balade dans l’espace accompagné de son module, aux grés de ses envies. Un dispositif intéressant en fin de visite car il ravive l’intérêt du visiteur qui devient actif. Par contre l’audio-guide ne sert plus à rien si ce n’est déverrouiller l’écran. Le son des vidéos sort directement des modules et créé un environnement sonore peu agréable pour les visiteurs utilisant le dispositif en même temps.
Deux autres espaces entourent cette salle.
D’un côté une séance de cinéma panoramique nous plonge dans le fonctionnement du parlement, de l’élaboration des lois et de la conséquence de la politique européenne dans notre quotidien. L’effet visuel fonctionne bien d’autant que les visiteurs sont assis en cercle dans des fauteuils dignes de ministre, cependant le ton utilisé donne des airs de « publicité » au film mettant en évidence les valeurs de l’union européenne.
Cinéma panoramique © Justine Faure
Espace d’écoute © Justine Faure
De l’autre côté, c’est un espace davantage dévolu à la détente où fauteuils et canapés dépareillés créent une atmosphère de salon. Chacune des assises est composée d’un écran amovible qui permet d’écouter et de regarder des témoignages d’Européens donnant leur vision de l’union européenne. Cet espace plutôt chaleureux isole néanmoins chaque individu devant des écrans.
Pour une fin d’exposition sur l’union européenne, j’aurais imaginé un dispositif qui rapproche les publics et les invitent au dialogue, car les précédentes salles interactives qui ont rendu acteur le visiteur ne favorisent pas la rencontre des publics dans une dimension participative !
En définitive, le Parlamentarium offre un mode de visite singulier où toutes les informations passent par le numérique. Ce système est tout à la fois un facteur d’isolement des publics pendant la visite, mais permet également une grande accessibilité et variété de publics.
Justine Faure
#numériqueaumusée
#visiteinteractive
#parcoursconnecté
#parlementeuropéendebruxelles
Pour aller plus loin :
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/bruxelles/parlamentarium

Le City-trip immobile au Pavillon de l’Arsenal La nouvelle maquette numérique
Qui n’a jamais rêvé de survoler Paris, surplomber tous les quartiers de la capitale, voir toujours plus, explorer la ville dans sa totalité? Le city-trip immobile est maintenant possible au Pavillon de l’Arsenal.
Qui n’a jamais rêvé de survoler Paris, surplomber tous les quartiers de la capitale, voir toujours plus, explorer la ville dans sa totalité ? Le city-tripimmobile est maintenant possible au Pavillon de l’Arsenal. Ré-ouvert le 14décembre 2011, la nouvelle exposition permanente du Pavillon de l’Arsenal, lieu chargé d’exposer l’histoire urbanistique et architecturale de la capitale, intègre une gigantesque maquette numérique « Paris, métropole 2020 », créée par le Pavillon en partenariat avec Google et JC Decaux.
Ce projet de 37m² règne en maître des lieux dans le hall. Aménagé sous la forme d’un patio et centré par rapport à la mezzanine, il cohabite parfaitement avec l’architecture des lieux. Au total, ce sont 4 pupitres tactiles multipoints, 17 ordinateurs, 48 écrans LCD basse consommation, donc 48 Google Earth synchronisés, cent millions de pixels et mille mètres de câbles, qui rassemblent 1300 projets en 2D ou en 3D. Absolument impressionnant, ce dispositif haute technologie, conçu sur le principe cartographique du logiciel Google Earth, procure une expérience interactive unique, ludique et pédagogique. Sur le site internet, vous pouvez admirer la vidéo de l’installation de la maquette. En une minute quarante-cinq, celle-ci montre en accéléré les quelques jours de montage et la complexité du matériel utilisé, nécessitant de s’armer de techniciens expérimentés et d’informaticiens ingénieux.
Ce projet multimédia permet au Pavillon de l’Arsenal de dépasser les limites géographiques de l’ancienne maquette en carton, précédemment à cet emplacement, qui ne reprenait que le centre « construit » de Paris. Actuellement, ce sont plus de 12 000 km² du territoire métropolitain que l’on survole d’un doigt, de 15m à 50km d’altitude, permettant de traverser « les grands territoires de projets en mutation, les nouveaux ou futurs réseaux de transport et les architectures emblématiques de la ville de demain ou déjà en construction dans la métropole parisienne ». L’utopie n’est pas de mise, l’ensemble ne reprend que les projets déjà pourvu d’un permis de construire.
Cette première mondiale donne donc la possibilité unique de présenter simultanément l’existantet le futur d’une agglomération sur Google Earth, pour découvriraujourd’hui les quartiers de demain : voir en 3D les projets de la Philharmonie, des Halles, la fondation Louis Vuitton pour la Création, … . Au travers d’une “navigation libre ou thématique”, elle propose des visites guidées (bientôt disponibles), thématiques – architecture, urbanisme, transports- ou par recherche libre. Facilement manipulable et étonnamment fluide, il faut cependant prendre le temps de comprendre son fonctionnement car le doigté n’est ni celui du MACbook, ni celui connu de Google Earth. Le zoom, l’inclinaison, et la rotation nécessite une dextérité particulière comme de retourner chaque fois en bas de l’écran pour utiliser les flèches et icônes de l’option en question.
Cet outil, permettant bien des surprises, paraît cependant encore bien incomplet. Les principaux bâtiments et monuments y sont déjà modélisés (de la même façon qu’une bonne partie des villes de New-York et de San Francisco l’ont été faites), mais beaucoup de travail attend encore la communauté d’internautes de Google Earth pour lui assurer un ensemble harmonieux et cohérent. Fort heureusement, il a été conçu pour être « constamment et simplement complété et actualisé » car c’est bien un outil commun aux acteurs qui façonnent notre lieu de vie. Terrible challengede rassembler tous les projets d'architecture et d'urbanisme en cours d'élaboration pour donner une pré-vision complètement unifiée.
Ses concepteurs ont la volonté que cet outil soit « accessible à tous, jeunes, étudiants, parisiens et franciliens, professionnels français ou étrangers ». Il ne l’est cependant pas totalement car, certainement par soucis de pureté, il manque de clarté : les noms des rues et des arrondissements ne sont malheureusement pas indiqués, ce qui ne rend pas évident l’orientation. Les fiches techniques sont elles aussi bien inégales dans leurs informations. On trouve parfois une date, parfois une photo, parfois un texte informatif sur le projet, mais bien souvent, elles sont en attente de traitement.
L’application « Paris, métropole 2020 » sera bientôt téléchargeable pour vivre cette expérience chez soi, bien installé dans son divan. La question qui se pose est : qu’offre-t-elle de plus au Pavillon de l’Arsenal ? Sa force première est bel et bien les différents points de vue qu’offre son emplacement. Sa taille monumentale en fait aussi l’élément agréable qui permet de s'accouder à la balustrade de lamezzanine pour se laisser guider par un autre utilisateur, qui mène la barque un étage plus bas.
Cette innovation technologique questionne, comme bien d’autres, l’utilité qu’offrent de tels outils. Pour le moment, ce sont surtout les fantasmes de la transposition des supports qu’elle révèle, s'avérant des limites plutôt qu'un avantage. Le manque de contenu induit cette envie technophile d’attirer, de surcroit avec des grands partenaires tels que Google et JC Decaux. Cette technologie avant-gardiste devrait avant tout être conçue comme un élément de médiation permettant une meilleure accessibilité au contenu. Ne serait-est pas nécessaire d’y amener le jeu pour que les plus petits découvrent et apprennent eux aussi en s’amusant ? Des animations ou diverses vidéos lui permettraient d’acquérir l’ensemble des possibilités et des opportunités du multimédia, complémentaires à l’exposition permanente, réalisée de panneaux traditionnels et exposée sur les murs du Pavillon de l’Arsenal.
Clara Louppe

Le jeu, un outil à réfléchir au service de la culture

La carte virtuelle du jeu et les Pokéstops. © Gaël Weiss / Frandroid
Pokémon GO, à l’aube d’une nouvelle ère de la ludification
« En plus d’offrir des occasions de coprésence, voire de rencontres, un jeu comme Pokémon Go met en avant, par les points d’intérêt où chaque joueur doit impérativement se rendre, le patrimoine culturel et bâti des villes, tels que certains monuments, des fresques d’art urbain, des sculptures ou des bâtiments dotés d’un intérêt historique particulier. Le jeu vidéo devient dès lors une médiation culturelle qui permet de se représenter différemment, de façon plus visible et consciente, les formes et les lieux qui composent la ville. »1
« Depuis longtemps, les jeux ont inspiré ceux qui souhaitent transférer leurs effets dans le non-jeu, qu’il s’agisse du jeu de Go, pour initier à la stratégie militaire, les badges des scouts pour récompenser et signifier un statut, ou les programmes de fidélité basés sur les points de vol aérien. »3
Promenades numériques
« Dans cette promenade en web immersif, on est en marche, et on se balade, on peut explorer – y’a une carte – y’a un côté un peu chasse au trésor, un peu safari urbain. »5
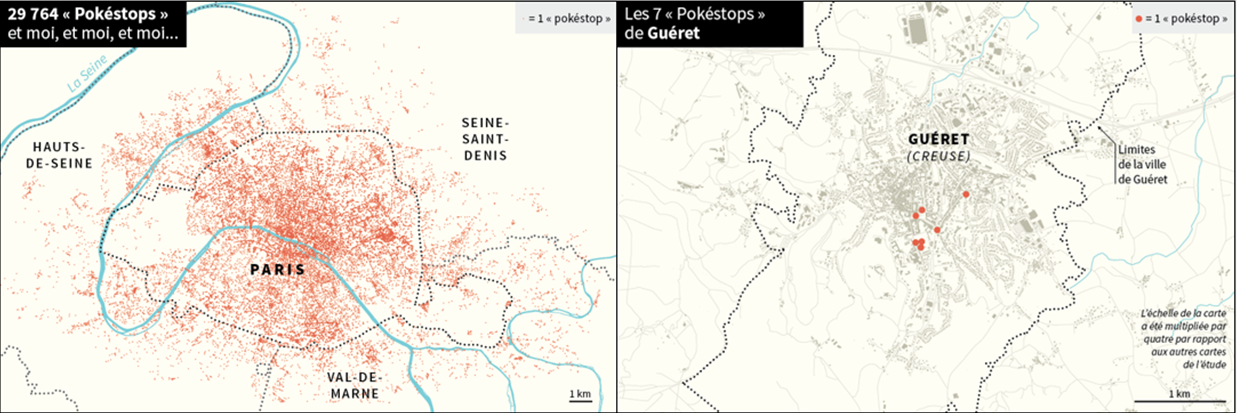
Laurie Crozet
#Pokémon
#Ludification
#Promenadenumérique
Liens utiles :
- https://plus.lesoir.be/53839/article/2016-08-08/pokemon-go-une-chance-pour-les-villes-plus-quun-probleme
- Witt, C. Scheiner & S. Robra-Bissantz (2011), “Gamification of Online Idea Competitions: Insights from an Explorative Case”, Ed. H.-U. Heis, P. Pepper, B.-H. Schlingloff, & J. Schneider, Informatik schafft Communities; Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Series of the Gesellschaft fuer Informatik p.1.
- Marache-Fransisco, E. Brangier (2015), “Gamification and human-machine interaction: a synthesis", Ed. P.U.F., Vol 78, Le travail humain, p.9.
- https://promenadenocturne.withgoogle.com/fr/panorama
- Lambert, J. Julia, J. Deramond (2015), « La ville en live. Itinéraires numériques et artistiques à travers le patrimoine urbain », Etudes de Communication, Vol 45, Pratiques d’espace. Les médiations des patrimoines vers la culture numérique ?, p.8.
- J. de Bideran (2016), « L’augmentation du patrimoine urbain, une exploration informationnelle », Ed. P.U.F., n°3, Sciences du design, p.3.
- Soja (2009), « La ville et la justice spatiale », Justice spatiale | spatial justice, n°1 http://www.jssj.org/article/la-ville-et-la-justice-spatiale/
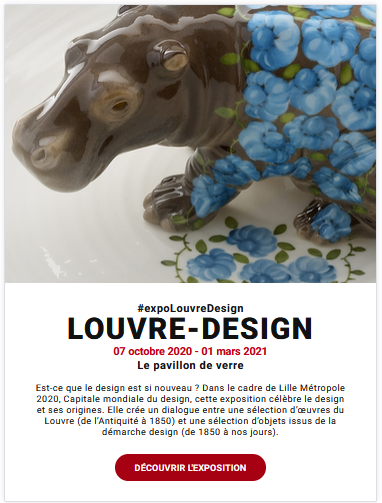
Le numérique comme lien social ? Visite à distance d’une exposition au Louvre-Lens
Avec la crise qui subsiste depuis plus d’un an, les musées ont dû s’adapter et revoir leur programmation. Nombreuses sont les expositions qui ont été annulées ou reportées. Cependant, la technologie s’est avéré être un outil non négligeable pour garder le contact avec les publics. Retour sur expérience et rencontre avec Marie Gord, médiatrice culturelle au Louvre-Lens.
Une offre culturelle vaste
Les visites à distance ne résultent pas seulement de la crise sanitaire, cette dernière a certes servi d’amplificateur mais elles préexistaient. Au Louvre-Lens, des visites à distance ont déjà été mises en place pour faciliter l’accès aux publics empêchés. De façon ponctuelle, le musée organise avec l’aide d’un robot, de la fondation Orange, des visites à distance pour les écoles isolées sur le territoire, pour les publics fragilisés, sous main de justice, hospitalisés, ou en EHPAD. Citons aussi les réseaux sociaux qui permettent de réaliser des lives avec leurs publics sur des formats très hétérogènes et généralement de courte durée.
En tant que publics, il est parfois compliqué de se retrouver dans la diversité de l’offre numérique des musées notamment par le vocabulaire utilisé. En fonction des offres, la terminologie n’est pas la même : visite guidée à distance, visite en visioconférence, visite en ligne, visite virtuelle, etc. Très floues, ces notions ne rendent pas bien compte de l’offre et de ce qu’elles contiennent réellement. Est-ce que la visite est réalisée par un médiateur ? Est-ce qu’elle est en direct avec une interaction possible ? Le numérique étant un médium souple, les possibilités de conception sont nombreuses. Sans compter que la diversité de cette nouvelle offre numérique résulte également des moyens techniques, humains et financiers de chaque institution. Cette nouvelle offre numérique pourrait se définir comme suit : « L’accès à un dispositif faisant appel à des moyens techniques et numériques divers et variés permettant aux publics de visiter et de découvrir un lieu. Cette appropriation d’un savoir ou d’un patrimoine ne peut se faire qu’ex situ, depuis chez soi et en dehors du cadre muséal ou institutionnel ».
Parmi les mesures déclenchées par le gouvernement, le télétravail est devenu une règle et les outils permettant de réaliser des visioconférences sont devenus familiers auprès de nombreux employé·e·s. Hybrides entre réseaux sociaux et outils de bureautique, des dispositifs tels que Zoom, Teams se sont vus attribuer d’autres missions. En effet, les institutions culturelles telles le musée Préhistoire de Nemours (Ile-de-France) ou le Musée du Textile et de la Mode à Cholet se sont saisies de ces logiciels de bureautique pour garder du lien avec leurs publics et le succès est au rendez-vous.
Le numérique comme lien social
Lié au contexte sanitaire, ce genre d’offre numérique présente deux objectifs. Premièrement, il s’agit de maintenir le lien avec les publics fréquentant régulièrement les institutions culturelles. Le Louvre-Lens a d’ailleurs orienté son offre à distance vers le public familial en proposant des ateliers plastiques à réaliser à distance et en direct. Deuxièmement, pour Marie Gord, le numérique s’avère être un outil très intéressant pour se familiariser avec le monde des musées. C’est un premier pas vers la culture qui se fait depuis chez soi et de manière rassurante.
Visite à distance au Louvre-Lens : mon expérience personnelle
J’ai donc voulu m’essayer à cette nouvelle pratique culturelle en visitant à distance l’exposition du Louvre-Lens, Louvre-Design. Dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale mondiale du design, l’exposition propose de s’immerger au travers de collections et d’objets hétéroclites pour comprendre les origines du design. La visite est réalisée en direct sur Teams par un·e médiateur·trice du musée. Gratuite, elle ne dure que 45 minutes. Pour l’équipe du musée, la politique tarifaire doit également s’appliquer à cette nouvelle offre. la gratuité des visites à distance est en cohérence avec la gratuité d’accès pour tous à la Galerie du temps lorsque le musée est ouvert

2004 Hella Jongerius (production : manufacture de Nymphenburg), Bowl with hippopotamus, céramique peinte à la main © Porzellan Manufaktur Nymphenburg
La réservation en ligne
L’expérience commence sur le site internet lors de la réservation du billet. Pour chaque visite à distance le nombre de connexion (équivalent à des places) est limité à 6 personnes par session. Une fois la réservation accomplie, un mail est envoyé afin de la confirmer. Le nombre de place limité garantit un confort, non pas seulement du visiteur·e puisqu’iel est à distance, mais bien des deux médiateur·trice·s nécessaires au bon fonctionnement du dispositif.
La veille de la visite, l’e-billet est envoyé sur la boite mail contenant un lien de connexion, des modalités comme l’heure de connexion ainsi que quelques conseils pour profiter de l’expérience au maximum.
La connexion internet
Même si le numérique peut s’avérer être un outil formidable, il n’est pas sans faille. Des problèmes de connexion peuvent survenir et mettre en péril la visite à distance. C’est un problème qui a été anticipé par le Louvre-Lens qui a eu, le jour de ma visite, un disfonctionnement sur le réseau. Un mail m’a été envoyé pour me prévenir de la situation et m’indiquant de la marche à suivre.
Selon Marie Gord, qui a participé à plusieurs reprises à la mise en place de la visite à distance, le versant technique de tout dispositif numérique, surtout s’il nécessite une connexion internet, implique un risque, une panne de réseau ou un dysfonctionnement du matériel. En tout cas, il faut anticiper des problèmes pour prévenir ces risques.
Les collections à l’écran
Etant une adepte des visites dites classiques en contact direct avec les collections, j’avais quelques réticences pour une expérience en ligne. Mais, si le rapport aux collections n’est pas le même, la visite en ligne n’enlève rien à la qualité du discours tenu. Peu présenté visuellement à l’écran, il laisse place aux collections. Bien entendu, le parcours a été pensé et plusieurs tests ont été nécessaires requis pour trouver le meilleur moyen de présenter les collections en direct sans qu’aucun élément ne vienne perturber la qualité de l’image. L’équipe a procédé à différentes prises de vues à plusieurs moments de la journée pour attester du rendu visuel des collections à l’écran (reflet du soleil sur les vitrines, tailles des objets, éclairages artificielles, positionnement de la caméra, résonnance, wifi, etc.).
Quant au caméraman, qui s’est présenté au début de la visite, il a pris soin de réaliser des mouvements de caméra lents afin d’éviter un décrochage de l’image. Les objets sontbien mis en valeur, avec des zooms. Le positionnement de la caméra a été pensé en amont et les plans sur les objets ont été pris avec leur cartel.

Capture d’écran de la visite à distance au Louvre-Lens
Louvre-Design ©Edith Grillas
L’interaction avec le public
Pour mettre en place ces visites à distances, deux médiateur·trice·s sont nécessaires pour maintenir le bon fonctionnement du dispositif. Le·a premier·ère se pose en réalisateur·trice et assure le backup, modère les commentaires que peuvent laisser les publics. Tandis que l’autre mène la visite guidée. A propos du matériel, une tablette avec connexion, un pied et un support pour la fixer, un micro Bluetooth sont nécessaires. Et bien évidemment un logiciel de bureautique comme Zoom, Teams ou autre.

Capture d’écran de la visite à distance au Louvre-Lens
Louvre-Design ©Edith Grillas
Quant aux publics, une fois l’outil appréhendé et le stade de l’inconnu dépassé, ils prennent vite leurs habitudes de visiteurs curieux, posant des questions (ou non, chaque visiteur a sa propre personnalité) soit en direct ou via l’espace de discussion. Alors, même si le lien social peut être maintenu entre le⋅a médiateur·trice et son public par l’entremise des questions, le lien entre les différents individus que constitue un groupe de visite à l’ordinaire peut se faire difficilement, voire est impossible. Or, une visite guidée n’est pas une sorte d’entre-soi. Les visiteur⋅e⋅s se rencontrent, échangent, discutent, rient, partagent des anecdotes. Et c’est cette richesse apportée par les publics que les visites guidées prennent une saveur singulière.
Durant la visite à distance, il m’est arrivé que la connexion internet soit interrompue pendant quelques secondes, perdant alors une partie du discours tenu. C’est ce genre de problème qui pouvait me freiner.
Pour conclure, les institutions muséales ont su faire preuve de rapidité et d’ingéniosité pour garder le lien avec ses publics. Cette prise de décision ne découle pas seulement d’un besoin exprimé par les publics de retourner dans les musées, mais également du souhait des professionnel·le·s de la culture de simplement faire leur travail avec passion et conviction.
La diversité de ces nouvelles offres numériques permet à chaque public d’y trouver son compte. Mais quel(s) profil(s)s de public s’inscrivent aux offres à distances ? Des habitué·e·s qui voient dans cette programmation une manière de poursuivre leurs activités culturelles pré-Covid ? D’autres publics, surtout éloignés de la culture ? Est-ce plus difficile d’évaluer un projet quand les publics sont absents des espaces muséographiques ? Et question plus globale, ancrée dans les préoccupations culturelles de notre temps : le numérique contribue-t-il réellement à diffuser une culture pour tous ?
Edith Grillas
#Exposition #Numérique #Expérience de visite

Le numérique, nouvel espace de rencontre avec le patrimoine
La numérisation des données dans la recherche scientifique s'accélère depuis la seconde moitié des années 1990 et les ressources en ligne se multiplient: retenons par exemple la bibliothèque numérique de la BNF, Gallica, mise en ligne en 1997 qui a lancé un programme de numérisation de ses collections entre 2017 et 2021. La pratique de l'inventaire numérisé a donné lieu à une multiplication de services de valorisation et de médiation des collections dans l'espace numérique.Cette évolution des pratiques muséales est soutenue par le service des collections des musées de France avec la création de la base de données Joconde en 1995. Depuis 2006, l'Institut National d'Histoire de l'Art (INHA) a numérisé plus de 22 000 documents1 sur son site (https://bibliotheque-numerique.inha.fr/) et a mis en œuvre dès 2001 la base de données RETIF (répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises) qui recense plus de 14 000 peintures italiennes réalisées entre le XIIIème siècle et 1914 conservées en France dans les musées et institutions publiques2. Ce sont 43 bases de données en tout qui sont produites par l'INHA et recensées sur une métabase : Agorha (https://agorha.inha.fr/inhaprod/jsp/portal/index.jsp). L'espace numérique apparaît ainsi comme un formidable terrain de jeux permettant de renouveler les pratiques dans la recherche scientifique. Cette course effrénée vers la numérisation du patrimoine culturel, textuel comme iconographique, permet la création de nouveaux dispositifs de monstration, de transmission, de valorisation et d'appropriation des savoirs : c'est véritablement un nouvel espace muséal, tout en codes et en pixels qui se bâtit de jour en jour.
Interroger le média exposition
Cette nouvelle stratégie de valorisation des collections ouvre d'abord la question de la légitimité de l'exposition (physique) en tant que stratégie de monstration et de valorisation d'une collection.Nous avons déjà mentionné la base Joconde. Le bureau de la diffusion numérique des collections du service des musées de France et les musées participants ont permis de regrouper plus de 600 000 notices thématiques en plus de proposer des parcours thématiques et des expositions virtuelles3. Plus récemment, nous observons qu'en France comme à l'étranger les musées développent des projets numériques de grande ampleur : les initiatives se multiplient. Retenons pour exemple le site Images d'Art, inauguré en 2015 et lancé par la Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais (RMN-GP) qui rend accessible plus de 500 000 images d'œuvres d'art à partir de son fonds photographique4. Le 2 mai 2016, la Galerie Nationale du Danemark annonce le projet de mettre en ligne sa collection: le 29 novembre 2019, la plateforme voit le jour avec déjà 40 000 œuvres numérisées accessibles à tous et libres de droit. Puis en janvier 2020, c'est au tour de Paris Musées. Comprenant 14 musées et sites de la ville de Paris, parismuseescollections.paris.fr recense aujourd'hui plus de 300 000 œuvres de leurs collections5. Or, en ce qui concerne la Galerie Nationale du Danemark, seulement 1% de sa collection est montrée au public sur une collection qui comprend au total 250 000 œuvres6. Alors peut-on parler de nouvelle muséographie ̶ d'une muséographie numérique ? ̶ ou doit-on parler uniquement de médiation numérique? D'autres institutions de taille plus modeste se lancent dans ce projet en s'appuyant sur la plateforme Google Art and Culture fondée en 2011: le musée de Quimper par exemple a commencé à mettre à la disposition du public une centaine de reproductions numériques de sa collection7. Bousculant les repères spatiaux-temporels propres au musée, la numérisation des collections implique une nouvelle géographie des collections visibles sur des support-écrans. Le rapport à l'objet en est également changé : la relation écranique à l'artefact ne permet ni d'en apprécier l'échelle ni d'en apprécier la corporéité mais le média numérique offre une appropriation individuelle des savoirs plus importante. Il est aussi utile de souligner que la consultation numérique des œuvres permet des rapprochements impossibles à créer dans une salle d'exposition.

Page d'accueil du site avec les collections numérisées du groupe Paris Musées (mars 2020) © Paris Musées
La démocratisation culturelle à portée de clics?
La numérisation des collections semble impliquer une monumentalisation de l'empreinte numérique des musées : il l'oblige à miser sur sa capacité à investir l'espace numérique pour accroître son taux d'attraction. Si l'objectif de conservation par la centralisation des données est intrinsèque au process de numérisation du patrimoine, elle se double d'un objectif de démocratisation culturelle par le libre accès à cette base de données. Or, il pourrait ne s'agir que d'un leurre: un leurre par la précarité du support numérique qui ne cesse d'évoluer et de rendre les supports obsolètes mais un mirage démocratique également par l'ampleur des moyens humains et financiers à mobiliser pour les institutions. Alors, cette stratégie de numérisation ne vient-elle pas intensifier les écarts de visibilité entre les institutions? Le site Image d'Art revendique son rôle social et éducatif en affirmant compléter les sites pédagogiques Histoire par l'Image (https://histoire-image.org/) lancé par la Réunion des musées nationaux et les ministères de la Culture et de l’Éducation Nationale, puis Panorama de l'art créé par la Réunion des musées nationaux-Grand Palais (https://www.panoramadelart.fr/)8. Toutefois, toutes les institutions ne disposent pas de moyens financiers assez conséquents pour développer des outils aussi pointus tout en gardant une liberté totale sur le contenu éditorial. Sophie Kervan et Marie-Christine Feuteun, respectivement conservatrice du musée des Beaux-Arts de Quimper et assistante de conservation, ont numérisé une centaine d'œuvres du musée, gratuitement, sur la plateforme Google arts and culture sans qu'il y ait d'ayant droit sur les images. Toutefois elles précisent que «Google nous a demandé d’axer les premières expositions [virtuelles] sur la Bretagne.»9. La valorisation numérique des collections a bel et bien un coût. La Galerie Nationale du Danemark a pu mettre au jour son projet avec un don de 1,6 million d'euros de la Fondation Nordea10. En terme de médiation numérique, les grandes institutions aux budgets colossaux demeurent de fait les plus innovants: le musée d'Orsay dispose par exemple de 150 000 euros par an pour l'édition de contenu numérique (sans les supports) alors qu'en 2018, d'après le Ministère de la Culture, seulement la moitié d'entre elles disposaient d'un site Web indépendant (c'est-à-dire géré par le musée lui-même).11 La démocratisation culturelle est donc bien dépendante des budgets alloués à chaque institution et des moyens financiers et humains dont elles disposent.

Page d'accueil du site avec les collections numérisées de la Galerie Nationale du Danemark (mars 2020) © SMK
Un musée-image
En plus de soulever la question du modèle économique d'une numérisation patrimoniale, cette dynamique de virtualisation des collections nous interroge également sur sa capacité à permettre un accroissement significatif des visiteurs dans le musée en lui-même: cet outil numérique est-il efficace dans la diversification de son public ? En 2013, le Rijkmuseum a fait sa réouverture après une période de rénovation de dix ans et après avoir lancé un an auparavant le Rijksstudio, site qui permet de recenser la collection du musée. Cet outil de médiation et de valorisation des collections recouvre un enjeu communicationnel important. En effet, nous savons que le Rijksstudio a attiré 15 millions de visiteurs pour 200 000 comptes créés sur le site. Mais ce public constitue-t-il une nouvelle cible pour le musée? Dans un rapport publié en 2019 intitulé «L'expérience du musée enligne. Entre communication et médiation», Jean-Thibaut Couvreur, consultant en ingénierie culturelle, démontre que le public qui se rend peu au musée est aussi un public peu familier des outils informatiques: «64% de ceux qui ne sont jamais allés au musée fréquentent peu les réseaux sociaux. Les non-visiteurs peu familiers du numérique constituent la catégorie la plus éloignée de l'offre muséale, qu'elle soit «physique» ou «numérique». » affirme-t-il12. Cet espace numérique à conquérir apparaît plus comme un capital à développer pour pouvoir se démarquer des autres musées à une échelle internationale. Le site Images d'Art, en ayant collaboré avec de nombreuses institutions muséales françaises et en proposant une traduction du site en anglais, s'affirme comme un média participant au rayonnement des musées français à travers le monde13. Les murs du musée deviennent partenaires d'un musée-image, d'un musée-imagé. Les institutions françaises cherchent à s'affirmer dans un paysage culturel hautement concurrentiel. Le communiqué de presse de Paris Musée le montre bien en ne manquant pas de souligner que cette initiative de centralisation des données en accès libre est un enjeu international puisque Paris Musée est «la première institution française», après le Rijkmuseum à Amsterdam ou le Metropolitan Museum à New York, à selancer14.
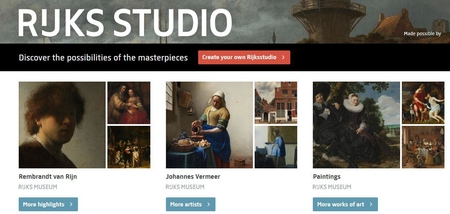
Page d'accueil du site Rijksstudio (mars 2020) © Rijksmuseum
La mémoire patrimoniale dans sa voie numérique s'organise ainsi de façon à servir un but commercial, scientifique, éducatif, un but de sauvegarde également dans la mesure où ces stratégies se sont mises en place conjointement à l'informatisation de la pratique de l'inventaire des collections muséales. Bref l'écosystème numérique dans le champ de la culture active le fantasme d'un support unique de mémoire. Alors, si une nouvelle géographie des savoirs est à l'œuvre, peut-on imaginer une patrimonialisation de documents numériques ?
E. B.
Pour aller plus loin : Régimbeau Gérard, «Du patrimoine aux collections numériques: pratiques, discours etobjets de recherche», Les Enjeux de l'information et de la communication, 2015/2 (n° 16/2), p. 15-27. URL : https://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2015-2-page-15.htm
#patrimoinenumérique
#museevirtuel
#collectionnumerique
1 Johanna Daniel, «Ce que le numérique apporte à la recherche en histoire de l'art», Le Quotidien de l'Art, Editionn°1819, 24 octobre 2019, [En ligne] <https://www.lequotidiendelart.com/articles/16315-ce-que-le-num%C3%A9rique-apporte-%C3%A0-la-recherche-en-histoire-de-l-art.html (consulté le 16 mars 2019). La bibliothèque numérique del'INHA est à consulter à cette adresse : bibliotheque-numerique.inha.fr
2 INHA. Répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises. [En ligne]<https://www.inha.fr/fr/recherche/le-departement-des-etudes-et-de-la-recherche/domaines-de-recherche/histoire-des-collections-histoire-des-institutions-artistiques-et-culturelles-economie-de-l-art/repertoire-des-tableaux-italiens-dans-les-collections-publiques-francaises-retif.html (consulté le 16 mars 2020).
3 Ministère de la Culture. Diffusion numérique. [En ligne] <https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Professionnels/Les-collections/Diffuser-les-collections-des-musees-de-France (consulté le 16 mars 2020).
4 «Le site Images d'art et ses 500 000 images d'œuvres inauguré par la ministre Fleur Pellerin», Club Innovation &Culture France, 14 octobre 2015, [En ligne] <http://www.club-innovation-culture.fr/images-dart-500000-images-oeuvres-ministre-fleur-pellerin/ (consulté le 16 mars 2020).
5 A l'heure où nous consultons le site: https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr
6 «La National Gallery of Danemark SMK reçoit un don de 1,6 millions d'euros pour lancer un vaste programme dediffusion de sa collection», Club Innovation & Culture France, 3 mai 2016, [En ligne] <http://www.club-innovation-culture.fr/national-gallery-denmark-smk-don-diffusion-libre-collection/ (consulté le 16 mars 2019)
7 Pierre Jubré, «Quimper. Google numérise les collections des beaux-arts», Ouest France, 30 juin 2019, [En ligne] <https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-google-numerise-les-collections-des-beaux-arts-6423279 (consulté le 16 mars 2020).
8 «Le site Images d'art et ses 500 000 images d'œuvres inauguré par la ministre Fleur Pellerin», Club Innovation &Culture France, art.cité
9 Pierre Jubré, «Quimper. Google numérise les collections des beaux-arts», Ouest France, art.cité.
10 «La National Gallery of Danemark SMK reçoit un don de 1,6 millions d'euros pour lancer un vaste programme dediffusion de sa collection», Club Innovation & Culture France, art.cité.
11 Marie Frumholtz, «Numérique et musée : le leurre de la démocratisation», Le Quotidien de l'Art, 16 janvier 2020,[En ligne] <https://www.lequotidiendelart.com/articles/16901-num%C3%A9rique-et-mus%C3%A9e-le-leurre-de-la-d%C3%A9mocratisation.html (consulté le 16 mars 2019).
12 Ibidem
13 «Le site Images d'art et ses 500 000 images d'œuvres inauguré par la ministre Fleur Pellerin», Club Innovation & Culture France, art.cité
14 Hervé Hillard, «14 musées de Paris donnent un accès numérique gratuit à 150 000 œuvres », Ouest France, 9 janvier 2020, [En ligne] < https://www.ouest-france.fr/culture/musees/14-musees-de-paris-donnent-un-acces-numerique-gratuit-150-000-oeuvres-6682510 (consulté le 16 mars 2020).

Le planétarium : zoom sur un outil de la Culture scientifique
Équipements particulièrement impressionnants, les planétariums sont des outils importants de la culture scientifique. Appuyés sur une expérience immersive et émotionnelle forte, ils s'inscrivent dans un environnement singulier, qui demandent une médiation particulière.
Les mutations technologiques ont apporté de nouvelles façons de vivre les expériences scientifiques et ont augmenté l’attrait pour ces outils scientifiques de médiation. De nombreux projets de création ou de renouvellement sont d’ailleurs en cours, comme à Douai, ou Strasbourg.
Image de couverture : © Tiffany Corrieri
Actuellement en apprentissage au Forum départemental des Sciences, j’ai échangé avec André Amossé, responsable de l’équipe médiation, qui m’en a dit plus sur ce qu’est un planétarium et sur la médiation associée.
Petit historique de l’observation des étoiles
Avant de se pencher sur l’histoire succincte des prémices du planétarium, il convient de définir le sens de ce mot : en français le mot planétarium désigne à la fois l’instrument de visualisation du ciel comme le lieu où cet appareil est implanté.
Ici, il sera question de s’intéresser au système qui permet de simuler le ciel.
A quoi sert un planétarium ?
Simuler l’observation du ciel étoilé à un moment et à un endroit donnés, telle est la mission des planétariums. Ils se différencient des observatoires par leur capacité de visualisation du ciel et permettent une démonstration de l’évolution de ce dernier au gré du temps sans avoir les contraintes météorologiques (ciel nuageux). Leur particularité est de proposer un point de vue interne et terrestre de la voûte céleste.
Pendant une séance de planétarium au Forum départemental des Sciences, le public peut admirer le ciel du moment vu depuis n’importe quel autre endroit de la Terre, visualiser tous les phénomènes astronomiques (rapprochements planétaires, phases de Lune, éclipses…) quelles que soient la position géographique, la date et l’heure sur une période de 5000 ans entourant notre époque.
La volonté de représenter le ciel et de montrer ses phénomènes cycliques existe depuis longtemps. Déjà à l’Antiquité des tentations de modélisation de ces mouvements ont été pensés, comme avec le planétarium d’Archimède. Mais c’est vers le milieu du XVIIe que le principe de fonctionnement des planétariums d'aujourd'hui trouve son origine. Plutôt que d’avoir un point de vue extérieur à la voûte céleste pour observer le ciel de façon réaliste et terrestre, un point de vue depuis l’intérieur de cette voûte est adopté.
C’est ce que propose Le Globe de Gottorp, un globe de 4m de diamètre, dans lequel il était possible d’entrer pour contempler un ciel étoilé. Il existe une copie de ce dernier, le Globe céleste d’Atwood, à Chicago qui fut à l’origine de la genèse des planétariums modernes.

Une réplique du Globe de Gottorp construite en 2005. © Wikipédia
Afin d’avoir une représentation de qualité du ciel étoilé, le premier planétarium moderne est créé en 1913 avec un système opto-mécanique (définit plus loin) par l’entreprise allemande Zeiss. Lors de l’exposition universelle de 1937, est construit le premier planétarium français, installé depuis 1952 au Palais de la Découverte à Paris.
La loi de décentralisation dans les années 80, qui valorise la diffusion de la culture en région, encourage la création de structures de culture scientifique sur l'ensemble du territoire national. L’association ALIAS voit le jour et acquis son premier planétarium itinérant en 1991. Elle change de nom pour Forum des Sciences en 1996, lors de la construction de l’actuel bâtiment, pensé avec l’implantation d’un planétarium fixe (le Forum des Sciences, est départementalisé en 2006 et s’appelle désormais Forum départemental des Sciences).

Construction du dôme du planétarium du Forum départemental des Sciences à Villeneuve d’Ascq en 1996. © Forum départemental des Sciences
Décomposition d’un planétarium : mécanique, numérique ou hybride ?
Le choix de renouveler le système ou de créer un nouveau planétarium dépend de l’équipe et de son projet culturel, mais aussi de la tutelle et des financements accordés. Ainsi, suivant la volonté de privilégier une représentation fidèle du ciel ou de s’appuyer davantage sur les spectacles, plusieurs configurations de salles et de systèmes sont possibles.
Un planétarium est composé d’une salle, qui est surmontée d'un dôme et dans laquelle se trouve un système de projection piloté depuis un pupitre. Le FDS détient une salle de 130 places avec un projecteur central et un dôme de 14m de diamètre.
Une salle, un dôme et des projecteurs
La salle circulaire est composée de sièges pour admirer la voûte, et peut se décliner en 2 configurations : une salle avec des sièges disposés en un cercle de 360° à plat, permettant d’exploiter l’entièreté du dôme, ou bien inclinés sur une plateforme et agencés en demi-cercle, comme une salle de cinéma pour profiter d’une vue unidirectionnelle vers la voûte. Dans cette configuration, seule une partie du dôme est exploitée.
Suivant la disposition de la salle, le dôme sphérique peut également être incliné ou non.
Enfin, le système de projection est lui aussi étroitement lié à la modularité de la salle car son choix dépend de ce que l’on souhaite valoriser.
Le système opto-mécanique est le dispositif initial des planétariums. Il intègre un projecteur, situé au centre de la salle, composé de systèmes mécaniques et de combinaisons optiques offrant une représentation du ciel visible depuis la Terre.

Système opto-mécanique du planétarium du Forum départemental des Sciences affichant le positionnement des étoiles pour une représentation la plus fidèle du ciel étoilé. © Tiffany Corrieri
Les projecteurs de diapositives, démocratisés dans les années 50-60, finissent par équiper les planétariums, montrant des éléments plus complexes et lointains géographiquement comme les galaxies, la lune et ses cratères, les planètes etc. Ils permettent ainsi de changer de point de vue, de ne plus seulement s’appuyer sur une vue terrestre. Leur disposition tout autour du dôme permet de constituer un paysage en 360°, les fondus apportant un effet de mouvement. Des scénarii sont alors pensés pour faire adhérer les plus jeunes, amenant à la réalisation de séances enregistrées sous forme de spectacles.
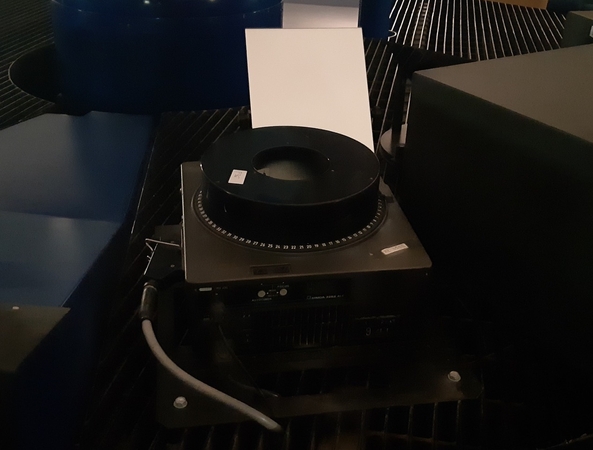
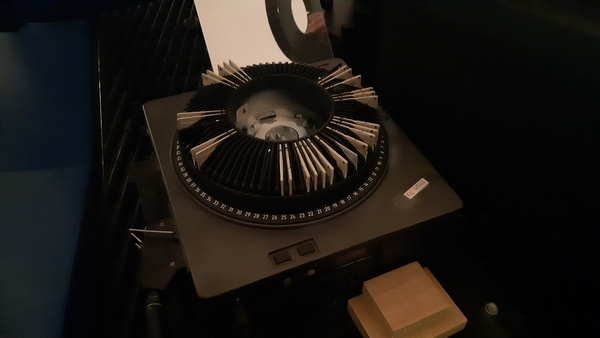
Dispositif de diapositives © Tiffany Corrieri
Puis, l’avènement du numérique dans les années 2000 a renversé la manière d’utiliser le planétarium et sa médiation. Les projecteurs numériques, qui intègrent la vidéo, apportent une dimension immersive à la salle qui se doit d’être semi-orientée et donc inclinée. Cette dimension numérique apporte de la profondeur et plus de possibilités en ce qui concerne les séances de spectacles : elle vise l'émerveillement à travers la simulation de voyage dans l’espace et la vidéo en relief, comme il est possible de le voir à la Coupole d’Helfaut.

Dispositif de projection du planétarium de la Coupole d’Helfaut : des projecteur vidéos sont intégrés sous le dôme (petits emplacements noirs) pour une projection en relief. La salle est orientée et inclinée. © Jérôme Pouille
Toutefois, même si un système favorise un type de salle et vice-versa, il est possible d’associer les deux mécanismes en formant un système hybride qui permet de lier la qualité d’un ciel étoilé rendu possible par l’opto-mécanique et la facilité pédagogique du numérique. Néanmoins, comme ce dispositif demande une orientation 360° - et une salle plate -, il peut demander des contraintes scénaristiques. Ainsi pour le confort du public, le Forum départemental des Sciences a opté pour le parti-pris de ne pas représenter physiquement les personnages qui discutent entre eux : seule une partie des visiteurs pourraient les apercevoir, l’autre devrait se retourner et pourraient ne pas profiter correctement du spectacle.
Dans tous les cas, le système est contrôlé depuis un pupitre par le biais d’un logiciel que le médiateur ou le régisseur pilote.

Le pupitre de commande du planétarium du FDS © Tiffany Corrieri
La configuration initiale du planétarium du Forum départemental des Sciences est celle d’un système opto-mécanique accompagné par des projecteurs de diapositives et de deux vidéoprojecteurs qui ne recouvrent cependant pas tout le dôme. Au vu de l’aspect obsolète de ce système de projection (les projecteurs de diapositives tombent souvent en panne, il devient rare de retrouver un même équipement de remplacement), si l’équipe avait l’opportunité de changer ce dernier, elle opterait pour une hybridation.

La salle plate du planétarium du Forum départemental des Sciences avec le planétaire optique au centre, des sièges disposés en cercle et un dôme de 14m de diamètre. © Tiffany Corrieri
Qu’en est-il des planétariums itinérants ?
Les planétariums itinérants, qui font leur apparition dans les années 70, ont évolué en même temps que les planétariums fixes. L’évolution de leur technologie suit celle des grands formats, à la différence que les mécanismes sont miniaturisés pour favoriser leur transport et que les projecteurs de diapositives ne sont pas utilisés.
Le premier planétarium itinérant du FDS était composé d’une structure en aluminium sur laquelle était tendue une toile. Cette structure soutenait un parapluie pour former le dôme sur lequel était projeté le ciel. Il demandait environ 2 heures de montage contre 30 min maximum pour une structure gonflable, aujourd’hui proposée avec une projection numérique. Au vu du succès de cet outil, le FDS possède à l’heure actuelle 4 exemplaires de ce dernier.
Suite à la démocratisation numérique, les producteurs ou les emprunteurs de planétariums peuvent être de nature différente : associations, club ou sociétés astronomiques, établissements nationaux (Universcience et Musée de l’air et de l’espace), collectivités (CCSTI: Forum départemental des Sciences, universités: Jardin des Sciences, muséums: Paléospace l’Odyssée etc). À ce jour l’Association des Planétariums de Langue Française (APLF) répertorie une soixantaine de planétariums fixes et encore plus d’itinérants en France.


Les planétariums itinérants du Forum départemental des Sciences sont composés d’une structure gonflable et d’un projecteur vidéo. © Forum départemental des Sciences
Quelle médiation dans un planétarium ?
La dimension émotionnelle d’une séance, encouragée par la configuration hors du commun d’un planétarium, possède un impact nettement plus grand sur le public, que tout autre dispositif de médiation.
Il convient donc que le fonctionnement de la médiation dans un planétarium est propre à chaque structure. À la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, des spectacles sans médiation physique ont longtemps été majoritairement proposés. Au Forum départemental des Sciences, toutes les séances de planétariums sont accompagnées par un.e médiateur.trice. Une séance, traite d’un thème particulier et peut être composé d’un spectacle, mais aussi des moments d’échanges et de visualisation du ciel du moment.
Cette médiation peut être entreprise par une personne extérieure à la structure, notamment lors de séances in situ ou externe, comme lors de prêts de planétariums itinérants où les emprunteurs ne détiennent pas forcément les compétences pour animer une séance. Dans ce cas, il est souvent question de bénévoles d’une association, sollicités pour l’occasion sur la durée d’emprunt de l’outil. Ces personnes sont alors formées par l’équipe de médiation du planétarium, à l’utilisation du matériel.
Les difficultés
Du fait de contraintes propres à la structure, la médiation dans un planétarium se différencie d’une médiation d’une exposition qui se réalise sur le terrain. La capacité d’accueil d’une salle de planétarium implique pour le ou la médiateur.trice de parler seul.e face à un large public. De plus, la nécessité d’être dans l’obscurité pour observer le ciel, induit que la médiation se réalise dans le noir et implique ainsi davantage une transmission d’informations qu’un véritable échange. Pour pallier à cela, ce dernier se réalise plutôt en début de séance, de sorte que les thématiques abordées suscitent le questionnement, l’étonnement et provoquent des échanges en fin de séance.
La réalisation d’une séance de planétarium
La production de séance de planétarium peut être réalisée en interne comme en externe.
À savoir qu'aujourd'hui, les fabricants de planétariums se spécialisent dans la distribution, voire la production de films et de séances de spectacle. Les intervenants et la gestion de projet dépendent ainsi des financements et des ressources humaines de la structure. Il est parfois possible qu’existe une équipe dédiée à la production avec un.e chargé.e de production, un.e graphiste, un.e compositeur.trice qui renforcent l’équipe de réalisation, composée d’un.e réalisateur.trice en poste, comme à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris. Néanmoins les méthodes de travail sont souvent similaires.

Etapes de réalisation d’une séance de planétarium au sein du Forum départemental des Sciences © Tiffany Corrieri
La réalisation d’une séance de planétarium au Forum départemental des Sciences s’appuie sur la possibilité et les limites matérielles définies par le dispositif opto-mécanique accompagné de projecteurs de diapositives et des possibilités limitées des vidéoprojecteurs.
Elle commence par la proposition de thèmes en lien avec la thématique de saison culturelle afin de garder une cohérence et faire résonner les expositions présentées, quand cela est possible.
La note d’intention
Comme tout nouveau projet, une note d’intention est rédigée avec les titres, objectifs, sous-objectifs, une présentation du contenu et les cibles touchées. Les séances présentées s’adressent principalement au plus de 6 ans, à l’exception du “Petit ciel étoilé” ; les plus petits peuvent être réticents à être dans le noir, il est moins facile de réaliser une médiation qui leur est destinée. Ces présentations suivent les cycles des programmes scolaires, de la grande section de maternelle au lycée ; la plus grande limite d’âge recommandée pour commencer une séance, est donc de 12 ans.
Le scénario
Une fois que la note d’intention est validée, le scénario qui indique les textes et l’histoire à raconter, est réalisé en interne ou en externe et met en forme le cahier des charges pour la réalisation audio et visuelle. Il n’y a pas d’appel à scénariste pour ne pas être trop axé sur l’expérience cinématique, mais davantage être dans la théâtralisation, le storytelling lors des échanges entre les personnages et ainsi les sortir du cadre orienté.
Le cahier des charges
Il présente les contraintes et les volontés de réalisation en termes de visuels (intention graphiques, visuels utilisés) et d’audio (intention de la bande son, bruitages) de l’équipe projet.
La réalisation audio
Cette partie est soit réalisée par un prestataire qui suit le cahier des charges fourni avec les contraintes et volontés (comme les visuels à présenter par exemple) ou est produite en interne. Elle est par la suite validée par le responsable scientifique et pédagogique.
Au FDS, les prestataires, choisis par le biais d’un appel d'offres, sont souvent des compagnies de théâtre pour l’enregistrement audio.
Une fois la bande son réalisée avec les voix des comédiens enregistrées, il est possible de programmer les visuels adéquats.
La réalisation visuelle
Les diapositives et les vidéo projecteurs qui offrent une utilisation limitée - par la délimitation de la fenêtre de projection, il n’est pas possible d’exploiter l’entièreté du dôme - sont la forme de visuels possibles au FDS, c’est pourquoi ce dernier collabore avec un.e illustrateur.trice (il est question d’un infographiste en interne pour le planétarium de Dunkerque) pour mettre en image les personnages quand il s’agit d’un spectacle. Puis, la coordination des images avec l’audio et la simulation du ciel, réalisée par un.e médiateur.trice via un programme, est directement effectuée depuis le simulateur astronomique.

Production d’une séance de planétarium avec le logiciel SkyExplorer © Tiffany Corrieri
Il faut à minima prévoir un an pour la réalisation d’une séance de planétarium de A à Z. Le budget moyen étant de 30 000 à 40 000 euros pour une séance comportant un spectacle enregistré. La dernière production pour une séance LSS (Lhoumeau Sky-System) -destinée aux planétariums itinérants- au FDS a coûté seulement 12 000€ car elle ne demande pas de faire appel à un illustrateur : la couche numérique permet une plus grande liberté visuelle et technique. À savoir que l’animation d’un planétarium demande un coût significatif en termes de fonctionnement, par l’utilisation de ressources matérielles et humaines.
Enfin, la médiation d’un planétarium peut-être complétée par un équipement numérique connecté comme des boîtiers interactifs qui permettent au public de répondre aux questions du.de la médiateur.trice, à l’instar de la Coupole d’Helfaut.

Des boitiers interactifs intégrés aux sièges permettent une interaction avec le public © Jérôme Pouille
Pour correspondre aux attentes d’expérience du public et compenser l’obsolescence technologique (il devient compliqué de trouver des projecteurs de diapositives pour remplacer les anciens) de nombreux planétariums traditionnels se convertissent vers les nouvelles technologies numériques, parfois partiellement. Néanmoins cela dépend du temps et des financements accordés : les nouvelles productions numériques coûtent chères et les compétences recherchées particulières. Si l’effort n’est pas entièrement porté sur la partie spectacle, la médiation physique pèse alors sur la balance en termes d’expérience du public.
Je remercie André Amossé et son équipe pour son expertise et sa disponibilité.
Tiffany Corrieri
Pour en savoir plus :
-
Les séances de planétariums du Forum départemental des Sciences
-
Esquisse pour une histoire des planétariums de Philippe Malburet dans Les Cahiers Peiresc, numéro 9, 2008
-
Les planétariums : des musées scientifiques en effervescence, La Lettre de l’Ocim, 2006
-
Les planétariums en pleine révolution, La Cité de l’Espace, 2018
#planetarium #sciences #ccsti
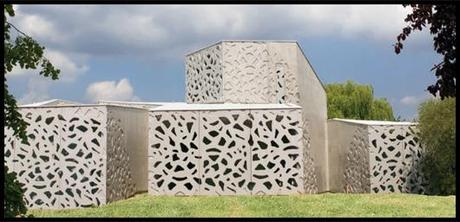
Le voyeurisme au LAM
Lors de ma dernière visite au LAM (Musée d’Art Moderne) à Villeneuve d’Ascq, alors que je me promenais tranquillement entre les œuvres de la collection d’art brut, j’ai surpris un homme penché sur le mur, en train de regarder quelque chose qui semblait le passionner, il observait à travers une ouverture.

Crédits : A.Vázquez
Immédiatement je me suis interrogée, de quoi pouvait-il bien s’agir ? Est-ce que cela valait la peine d’attendre mon tour pour regarder ? Et malgré moi, la curiosité l’a emporté et j’ai du attendre…
Il s’agissait d’un dispositif assez curieux, un petit écran qui doit faire environ11 pouces encastré dans le mur où sont diffusées des images, en boucle, sur la vie et les œuvres des artistes, leurs maisons qui sont imprégnées par la personnalité des « créateurs » qui sont exposées dans cette salle.
Images qui nous montrent la perception particulière, voire « tordue », qu’ils ont de la réalité. Ce qui me laisse penser que c’est un parti pris pour compléter le discours du musée. Ce courant artistique qui a toujours été vu comme dérangeant, ce qui renforce notre désir de regarder.
Et c’est justement de cette condition humaine que se sert cet outil de médiation. On voit quelqu’un penché sur cet espèce d’observatoire et on se sent tout de suite intrigué par ce qu’il y a derrière, cela nous intrigue et on veut absolument savoir de quoi il s’agit !

Crédits : A.Vázquez
Et d’autant plus lorsque on y regarde, et on a l’impression d’être le seul au monde à avoir cette chance, d’aller aussi loin dans l’intimité des créateurs. Grâce à cela, en assimilant l’information on comprend mieux la façon dont ils s’expriment à travers leur œuvres.
Même si ce n’est pas un dispositif très sophistiqué, et surtout pas très novateur, car cela fait quelque temps que l’on joue avec le voyeurisme, même sous la simple forme d’un effet visuel en s’appuyant sur les axes de vision. Je trouve qu’il accomplit bien son objectif de transmettre l’information nécessaire à la visite, mais surtout il est capable d’attirer l’attention. Et le mieux est qu’il y en aun autre pour les plus petits, aucune génération ne reste éloignée de cette expérience qui nous donne de l’information.
Contrairement au dispositif le plus courant qu’on peut trouver dans une exposition, c'est-à-dire un écran posé en plein milieu de la salle, ou au mieux dans un coin tranquille avec des petits bancs auxquels la plupart du temps on prête à peine attention. Celui-ci nous interpelle d’une façon subtile mais infaillible.
A. Vázquez

Les expositions, sanctuaire des selfies ?
Pour vous, qu’est-ce qu’une bonne exposition, qu’elle soit artistique, scientifique, culturelle ou historique ?
Certains répondront que c’est la qualité de contenus qui fait une bonne exposition, d’autres parleront des connaissances acquises et des émotions ressenties.
Pourtant, dans les expositions temporaires et les salles de collections permanentes des musées, beaucoup de visiteurs ne semblent se préoccuper que de la possibilité de se mettre en scène pour capturer le meilleur « selfie » à partager sur leurs réseaux sociaux.
Le selfie est une pratique devenue tellement commune à travers le monde que le mot a été inscrit en 2013 dans les Oxford Dictionnaries puis en 2014 au Petit Robert français. L’emploi du mot serait exponentiel, ayant d’ailleurs augmenté de 17.000% entre 2012 et 2013, d’après l’entreprise Oxford.
Pour réussir un selfie, il faut une luminosité et un angle de vue avantageux. Mais surtout, l’environnement permet de créer une atmosphère et de raconter sa propre histoire. Les expositions sont donc devenues un espace idéal pour assouvir ce besoin de paraître. Aujourd’hui, impossible de parcourir un lieu culturel ou touristique sans se heurter à un selfie stick. Dans certains musées, le phénomène est devenu tellement viral qu’il a été interdit, pour préserver la sécurité des visiteurs et des œuvres, à l’exemple du Château de Versailles et du MoMA à New York.
Des défenseurs du selfie avancent plusieurs aspects positifs à cette pratique : l’effet de mode permet à certains d’aller dans des lieux qu’ils ne fréquentaient pas jusqu’alors, de découvrir l’art autrement, de s’approprier l’histoire et le patrimoine ou encore de s’impliquer dans l’œuvre. Pour eux, ça peut être un moyen de découvrir autrement. Jill Carlson a d’ailleurs précédemment publié un article sur les atouts des selfies sticks en visite (sur le blog L’art de Muser: http://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1229-le-musee-ne-vous-tend-plus-la-perche?highlight=WyJzZWxmaWUiXQ== )



©Instagram
Sur ces trois selfies, l’artiste est parfois référencée en légende, le titre de l’œuvre n’apparaît jamais complètement, mais plutôt évoqué (« The infinity room is always amazing »)
Yayoi Kusama, Infinity mirrored room – The souls of millions of light years away, 2013.
Pourtant à observer ces visiteurs préoccupés par leur image, je me demande sincèrement en quoi s’inquiéter de la bonne tenue de ses cheveux plutôt que d’observer l’œuvre en arrière plan correspond à une quelconque réappropriation de l’art. Les angles de vue comme les pauses sont quasiment identiques entre les visiteurs. La mise en scène avantageuse compte plus que le sens donné à la photographie, voire parfois à la visite même. C’est autant amusant que troublant d’aller sur les réseaux sociaux et de trouver en multiples exemplaires quasiment la même photographie publiée par autant d’utilisateurs. La créativité s’exprime-t-elle dans la prise de vue ? Rien n’est moins sûr à observer l’homogénéisation qui répond aux effets de mode.



©Instagram
Différents selfies pris dans l’œuvre Inside the horizon, 2013 de Olafur Eliasson.
Seul le lieu est identifié, primant ainsi sur l’œuvre.
La conquête du cliché parfait a déjà causé des accidents, où les visiteurs peu attentifs ont endommagé, voire détruit des œuvres d’art.
L’exemple le plus connu est certainement la chute d’une femme sur un piédestal créant un effondrement en chaîne de plusieurs socles dans l’espace 14th Factoryà Los Angeles en 2017. Le coût total des dégâts est alors estimé à 200 000$.
En 2017 également, au Hirshhorn Museum and Sculpture Garden à Washington, un touriste a perdu l’équilibre en se photographiant dans l’installation de l’artiste Yayoi Kusama, Tout l’amour éternel que j’ai pour les citrouilles.Le coût d’une seule citrouille est estimé à un million de dollars…
Et malgré cela, les selfies sont de plus en plus incités par les grandes institutions, qui créent des hashtags et des concours de selfies. Une journée internationale du selfie dans les musées a même été mise en place, particulièrement relayée sur les réseaux sociaux à l’exemple d’Instagram (#museumselfieday). Le selfie devient un moyen de promotion du lieu, une nouvelle stratégie marketing cherchant à toucher un public jeune (les générations Yet Z, ou Millennials).
Aux États-Unis, des « musées » sont créées uniquement pour offrir aux visiteurs des espaces attractifs et originaux pour se prendre en photo, le Museum of Ice Cream en tête.


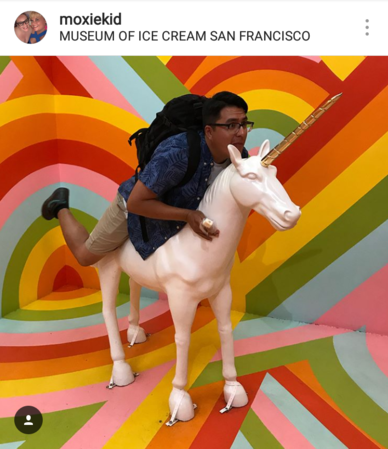
©Instagram
Museum of Ice Cream, Rainbow Room.
En Europe, les installations artistiques monumentales sont souvent mises en valeur dans les outils de communication afin d’inviter les visiteurs à venir s’y faire photographier.
L’intérêt artistique, historique, technologique ou scientifique passerait-il après le gain de visibilité ? À quand une étude de la photogénie des installations ?
Même si heureusement, chacun est libre de ses actes et ses choix le reflexe du selfie pour chaque instant insolite ou extraordinaire devrait être davantage interrogé. L’instant présent, pleinement vécu et nourri d’émotions manque de succès face à la concurrence des apparences.
Chloé Maury
#selfiemuseum
#moiaumusée
http://www.mac-s.be/fr/123/Selfie-au-musée
NB : Les photographies ci-dessus sont uniquement des captures d’écran de profils publics sur Instagram. Les structures visitées sont toujours identifiées, à défaut du nom de l’œuvre servant d’environnement au selfie ou de l’artiste.
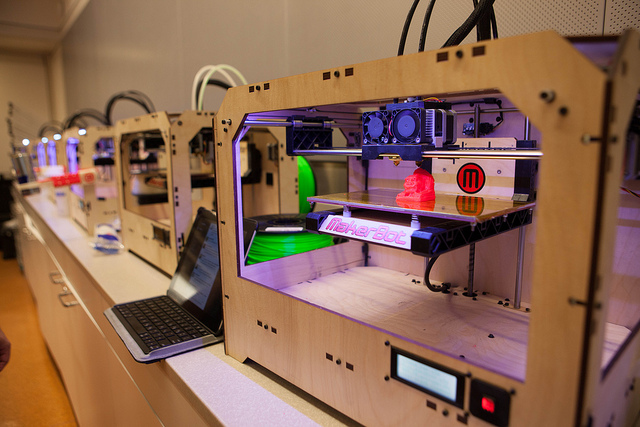
Les fablabs : la créativité à portée de main
Avez-vous déjà entendu parler des fablabs ? Si ce n’est pas le cas, il est temps d’y remédier ! Votre cerveau grouille d’idées mais il vous manque le matériel et les compétences pour les prototyper ? Découvrons ensemble un aperçu des multiples possibilités qu’offrent ces ateliers créatifs, autant pour les bidouilleurs curieux que pour les entrepreneurs et les institutions culturelles.
Un fablab, qu’est-ce que c’est ?
Peut-être l’aurez-vous deviné, le terme fablab est la contraction du mot anglais fabrication laboratory. L’histoire commence en 2001 aux Etats-Unis sur l’initiative d’un professeur du Massachussetts Institute of Technology avant de se développer partout dans le monde quelques années plus tard. En France, c’est en 2009 à Toulouse que s’implante l’un des premiers fablab, appelé Artilect.
La volonté est de permettre à chacun de tester rapidement des idées, d’expérimenter et de fabriquer soi-même des objets à partir de machines que l’on ne pourrait pas se payer individuellement. Pour ce faire, ces laboratoires disposent tous d’un matériel de base : une imprimante 3D, une découpeuse vinyle, une découpeuse laser et une fraiseuse numérique CNC. Certains développent des spécialités comme l’artisanat textile, la biologie, l’aéronautique, les drones, etc.
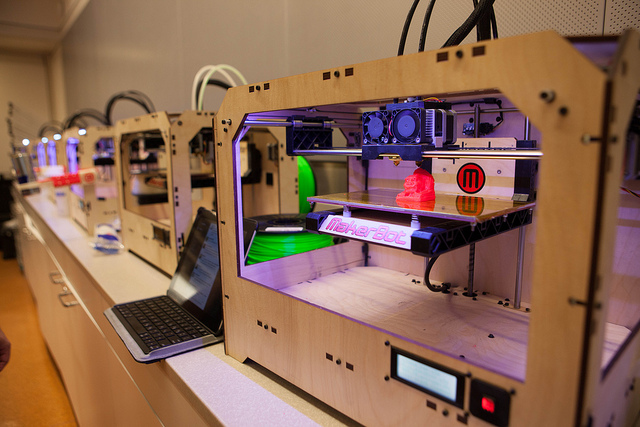
Imprimantes 3D au fablab de Pérouse, image téléchargée sur https://www.tommasobori.it le 15/11/2019
On y prône également l’entraide et le partage des compétences. Travailler dans un espace collectif, c’est aussi rencontrer des personnes d’horizons différents, stimuler sa créativité et faire évoluer son savoir et savoir-faire. Un accompagnement personnalisé est aussi tout à fait possible pour développer un projet.
Que peut-on y fabriquer ?
Autant d’objets que votre imagination et le matériel le permet ! À partir d’un fichier informatique, créez un meuble, une pièce de remplacement pour votre machine à laver, une maquette d’architecture, un moule, un circuit imprimé, un jeu de société, un robot ou encore une prothèse articulée. Sont aussi à votre disposition des open sources, c’est-à-dire des plans d’objets réalisés par d’autres utilisateurs partout dans le monde pour les reproduire soi-même dans n’importe quel fablab. Une fois l’idée testée, la production en série se fera cependant en dehors du fablab.
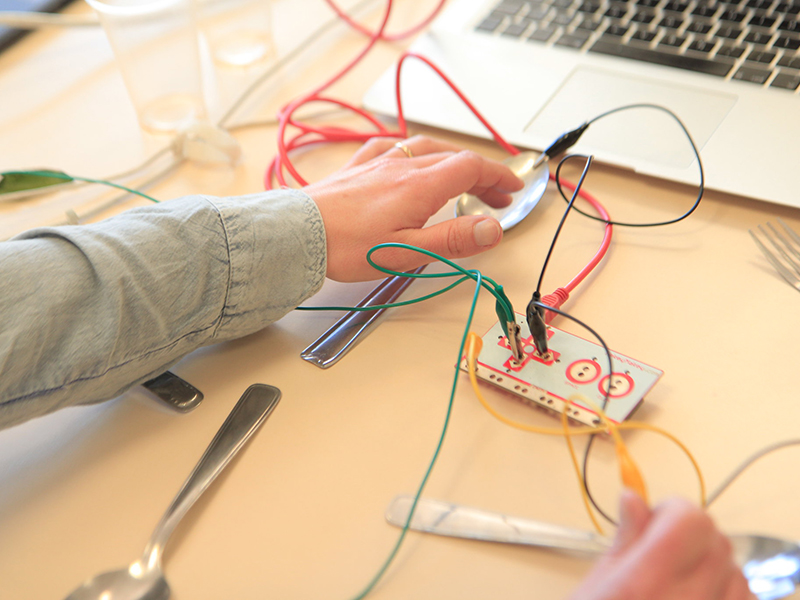
Un Piano Graphique MakeyMakey créé à La Fabulerie, un des fablabs de Marseille, image téléchargée sur https://lafabulerie.com/ le 15/11/2019
Que peut-on y faire ?
Outre tester le matériel et fabriquer des objets, les fablabs proposent généralement d’autres activités. On peut notamment participer à diverses formations, wokshops, afterworks… Ils peuvent également se rendre mobiles et être impliqués dans des événements ponctuels : fête de la science, salons de robotique et de jeux vidéo, Muséomix, etc.
À qui s’adressent-ils ?
Du grand-père bricoleur en passant par un étudiant, un artiste, un designer, un informaticien, ou un bidouilleur du dimanche, tous les âges et métiers y sont représentés ! Les start-up et jeunes entrepreneurs fréquentent particulièrement ces lieux pour passer plus rapidement du concept au prototypage d’une idée.
À quel prix ?
Quel intérêt pour les musées et le secteur culturel ?
Trop souvent en manque de moyens, les musées et autres structures culturelles peuvent trouver dans les fablabs l’opportunité de faire parler leur créativité ! Pourquoi ne pas y tester le prototypage de manips, de dispositifs de médiation, de mobilier d’exposition, de techniques de conditionnement ou d’applications numériques ?
Certains musées possèdent d’ailleurs leur propre fablab, on parle alors de muséolabs.
Peut-être avez-vous entendu parler de la Louvre Lens Valley ? Cet espace situé à deux pas du Louvre Lens fut inauguré en août dernier. Il accompagne principalement les jeunes entrepreneurs au développement de projets concrets par le biais de la culture avec le musée du Louvre Lens comme terrain d’inspiration et d’expérimentation. Elle accueille aussi d’autres publics, comme des élèves de l’École de la 2e chance d’Artois qui ont participé au projet « Makers de l’Art ». Au sein du fablab, ils ont conçu et fabriqué un kit d’aide à la visite pour les visiteurs du Louvre Lens (voir article détaillé sur le sujet ici).

Exemple d’un prototype fabriqué par les élèves de l’école de la seconde chance pour le projet « Makers de l’art » © Laurence Louis
Citons également le Carrefour Numérique ², le fablab de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris où il est possible de participer à des ateliers pour apprendre à se servir d’outils de fabrication numérique en compagnie de médiateurs, de répondre à des appels à projets, de découvrir de nombreuses ressources partagées, d’assister à des conférences ou tout simplement de franchir les portes gratuitement pour voir ce qu’il s’y passe et échanger avec les « makers ».
Au tiers lieu Le Multiple à Toulouse, le décor de l’exposition photographique LIFE ON MARS – DAVID BOWIE a entièrement été réalisée dans un fablab, ce qui aura permis de la mettre sur pied en moins de trois mois grâce aux multiples compétences, partenaires et ressources matérielles mises en communs.
Au muséolab du centre Erasme près de Lyon, on collabore avec les musées pour imaginer les expositions de demain. Pour le musée Barthélémy-Thimonnier d'Amplepuis, ils ont imaginé une mappemonde immersive et interactive reliée à l’application Google Earth où le public peut se promener dans divers endroits du monde, notamment dans un igloo lors d’une exposition sur les inuits.
Et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres ! Vous aussi cela vous donne des idées ? Alors n’hésitez pas à découvrir le fablab le plus proche en parcourant une carte interactive du monde entier sur https://www.makery.info/labs-map/, vous serez surpris de l’ampleur du phénomène !
Laurence Louis
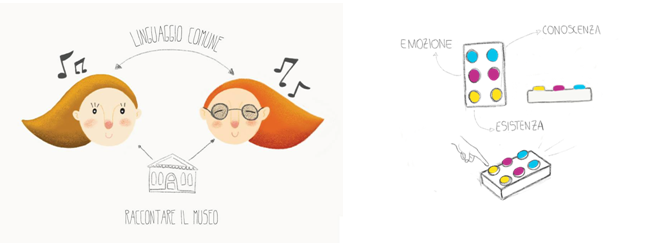
Les galline innamorate de Museomix Bologna
C’est au Museo Tolomeo de Bologne que s’est déroulée la première version de Museomix Italia du 11 au 13 novembre 2016. Situé au cœur de l’institut des aveugles Francesco Cavazza, le Museo Tolomeo a ouvert ses portes au public en janvier 2015.
Pendant trois jours, trente-cinq personnes venant de tous les horizons et aux compétences variées, se sont retrouvées au sein du museo. Leur mission : créer des dispositifs originaux pour que la visite du musée puisse se faire en autonomie. Le contexte : jusqu’à présent un médiateur accompagne toujours les visiteurs dans la salle unique du musée qui présente l’évolution des machines du XXème siècle pour lire et écrire le braille. C’est une salle sombre, étrange même, qui propose de développer un point de vue différent sur la ville de Bologne. Il faut admettre qu’il est particulièrement difficile de s’y retrouver sans les explications de Fabio Fornasari, conservateur.
Lancement de Museomix : une dynamique de groupe s’installe. Guidés par les managers d’entreprise, les groupes se forment. Je fais partie des galline innamorate, littéralement les poules amoureuses, autant vous dire tout de suite que je préfère ce nom aux muche sexy (vaches sexy). Puisque le Museo Tolomeo veut être un musée qui parle, qui interpelle, les poules amoureuses ont pour objectif de créer un dispositif autour du thème du son. Pour comprendre, pour apprendre, il est nécessaire d’écouter, d’entendre. C’est dans ce contexte que la TOLOCOMANDO est née. Inspirée de la forme du domino à six points, matrice du braille, la télécommande invite le visiteur à appuyer sur l’un de ses six boutons sensoriels. Chaque bouton émet un son en lien avec l’un des trois thèmes abordés par le musée. La connaissance est évoquée à travers deux boutons sur la lecture et l’écriture. La ville et la carte permettent d’aborder le thème de l’existence alors que des sons relatifs au conte et à la musique parlent de la sensibilité, de l’émotion. Chaque son oriente le parcours du visiteur dans la salle.
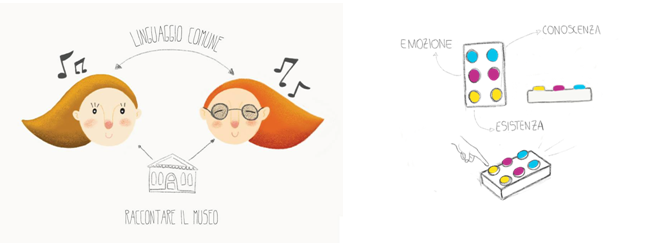
Illustrations explicatives du concept de la tolocomando réalisées par nos graphistes © Elena Della Rocca – Gummy Illustrations
La question centrale de ce museomix a été sans aucun doute celle de l’accessibilité. Il fallait imaginer des prototypes accessibles aux voyants comme aux non-voyants. Mais rendre ces dispositifs accessibles à tous n’était pas le but car travailler autour du son exclut forcément les personnes malentendantes. Quant à notre public cible, Hoëlle Corvest, chargée de projet accessibilité public handicapé visuel de la Cité des Sciences et de l’Industrie, nous a beaucoup aidés. En répondant à nos questions, en nous prodiguant de nombreux conseils et suggestions, Hoëlle nous a permis d’adapter la justesse de nos propositions de prototypes au public visé.
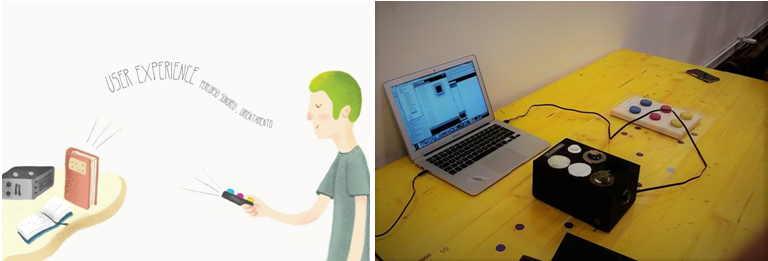
© Elena Della Rocca – Gummy Illustrations, Aperçu final de la tolocomando © M.D.
Ces trois jours se sont déroulés dans une dynamique de travail et de production inébranlable. Tout va très vite, peut-être trop vite. Les idées fusent et il me semble que nous ne prenions pas assez le temps de nous poser des questions fondamentales sur le sens des prototypes que nous voulons créer. Ce qui crée parfois une certaine frustration. Pourquoi créer une tolocomando ? Quel est le message ? Est-ce réellement une idée originale ? Certes, le but de museomix n’est pas de repenser le musée mais de le remixer et nous ne disposons que de trois jours pour créer nos prototypes. Nous n’avons pas le temps de nous interroger autant mais cela se ressent aussi sur la pertinence des propositions.
Enfin, Museomix Bologna c’est également une expérience humaine hors norme. C’est arriver dans une ville étrangère, sur un lieu inconnu avec un objectif précis. C’est pouvoir produire avec des personnes motivées et impliquées durant trois jours rythmés par les rencontres. Et pour finir, se dire que finalement, j’ai été capable de le faire, d’aller jusqu’au bout et de créer un prototype qui fonctionne.

Les « galline innamorate » © Michela Malvolti
M.D.
http://www.museomix.org/it/prototypes/tolocomando/
#museomix
#museomixbo
#tolocomando

Les guides numériques de visite: outils révolutionnaires sans limite?
Le 29 août 2018, la Cité du Vin franchit un cap : elle accueille son millionième visiteur !
Portée par la Fondation pour la culture et les civilisations des vins, cette institution bordelaise, inaugurée en juin 2016, offre une expérience autour du vin et s’intègre parfaitement dans le paysage de l’œnotourisme local et international. Proposant une programmation culturelle riche et variée (exposition temporaire, atelier de dégustation, conférence, visite guidée thématique…), le parcours permanent reste le cœur de visite dans ce bâtiment à l’architecture singulière. Le billet d’entrée à 20 € donne accès à ce parcours ainsi qu’au belvédère. Une dégustation d’un vin au choix est également comprise dans le billet, lors de la visite au belvédère qui surplombe la ville de Bordeaux.
Le parcours de la Cité du vin de Bordeaux
D’une surface de 3 000 m², le parcours permanent se veut « immersif, sensoriel et attractif1 » et justifie son prix d’entrée par la technicité numérique des 120 productions audiovisuelles et plus de 10 heures de contenu. La Cité du vin est un exemple représentatif de ce qui se fait aujourd’hui en matière de nouvelles technologies et de dispositifs numériques.
Le compagnon de voyage (c) Fanny Davidse
Un guide numérique est fourni, ainsi qu’un casque. Ressemblant à un smartphone, ce compagnon de voyage fait l’interface entre les dispositifs numériques et le visiteur. Son utilisation est simple : sur chaque dispositif, l’appareil doit être positionné devant un sigle identifiable tout au long du parcours. L’émission d’un bip sonore dans le casque confirme la connexion entre l’appareil et le dispositif et permet l’accès au contenu sur l’écran tactile : son de la vidéo, retranscription du texte, iconographie, information textuelle supplémentaire, consigne de fonctionnement du dispositif…

L'accessibilité au public jeune et au PMR (c) Fanny Davidse
L’interface de ce guide numérique facilite l’accessibilité à différents publics. Les contenus sont disponibles en 8 langues pour s’adapter aux visiteurs internationaux. Si le texte physiquement présent n’est traduit qu’en 3 langues, une traduction écrite en cinq autres langues est disponible sur le guide numérique. Le public en situation de handicap peut bénéficier d’un contenu en « langage facile à lire et à comprendre », d’une audiodescription ou bien d’un sous-titrage en fonction de ses besoins. Et pour les enfants à partir de 8 ans, l’appareil propose une sélection des modules dans l’espace permanent pour créer un parcours personnalisé et ajuste le niveau de langage à ce public jeune.

Le flux important de visiteurs devant un dispositif (c) Fanny Davidse
La connexion entre l’appareil et le dispositif est un réflexe à adopter à chaque changement de dispositif pour pouvoir bénéficier de l’expérience la plus complète. Elle contraint donc le visiteur à chercher ce sigle avant même de comprendre devant quoi il se trouve, et créé un problème de gestion des flux de personnes. Il faut savoir se frayer un chemin entre les visiteurs pour accéder au sigle car leur positionnement dans l’espace n’est pas toujours accessible une fois que 2 ou 3 personnes se trouvent devant le dispositif. De plus, l’interaction entre les visiteurs est minime et cela se ressent dans le déplacement des gens à travers l’espace : pas de regard directionnel, une occupation de l’espace désorganisé, des stationnements aux mauvais endroits. Le compagnon de voyage aurait-il tendance à créer une bulle autour du visiteur ? Avec un flux important de visiteurs, cela peut engendrer des problèmes de circulation dans l’espace.
Quant à la répartition dans l’espace, le parcours est composé de 19 modules numérotés, qui sont répartis sur 6 séquences. Pour chaque module, un dispositif général est décliné en plusieurs exemplaires avec différents contenus. Que ces dispositifs soient sensoriels, interactifs, immersifs ou audiovisuels, le principe de connexion de l’appareil au dispositif s’applique. Toutefois, quelques dispositifs n’utilisent pas le compagnon de voyage : soit le sigle n’est pas présent car le dispositif est considéré comme autosuffisant, soit la connexion se fait sans fournir de contenu. Concernant ce dernier point, il arrive à plusieurs reprises que des dispositifs disposent du sigle mais une fois la connexion effectuée, quasiment rien ne se passe sur l’appareil. En effet, il arrive qu’une simple consigne sonore oriente le visiteur vers le dispositif (« veuillez suivre les consignes à l’écran »), ou que la bande sonore d’une vidéo provienne directement du dispositif et non pas de l’appareil par le biais du casque. Ce changement d’utilisation peut surprendre le visiteur et devenir déconcertant.

La vue, l’odorat et l’ouïe sont stimulés sur ce dispositif (c) Fanny Davidse
Par ailleurs, la démultiplication du contenu présent dans l’espace, sur les dispositifs et sur l’appareil peut créer un effet d’accumulation. Cette surcharge intellectuelle risque de perdre le visiteur pendant sa visite, ne sachant plus quoi lire, regarder, écouter, sentir ou toucher. Une sélection plus précise du propos et des informations communiquées augmente l’intérêt que porte le visiteur à sa visite.
En conclusion, la Cité du vin profite de l’innovation technologique actuelle pour mettre en place un appareil sophistiqué, qui sait s’adapter à de nombreux publics. Toutefois, ce compagnon de voyage a des limites pour sa bonne prise en main par le visiteur.
Fanny Davidse
[1] Termes employés par la Cité du vin
#numérique
#médiation
#patrimoine

Les images sont-elles réelles ?
La modélisation 3D est parfois utilisée sur des sites patrimoniaux. Grâce à elle il devient possible de reconstituer le lieu tel qu’il était plusieurs siècles auparavant. Mais à quel point ces reconstitutions sont-elles fidèles à la réalité ?
Photographie drone de l’abbaye de Saint-Germer-de-Fly, Art Graphique & Patrimoine, 2025
Un bâtiment peut subir de grandes modifications au fil du temps. Une abbaye moyenâgeuse peut être détruite entièrement ou partiellement puis reconstruite à l’identique ou non. Nous ne voyons alors que l’état actuel de l’abbaye sans connaître son évolution. C’est pour cette raison que la modélisation 3D est parfois utilisée sur des sites patrimoniaux. Grâce à elle, il devient possible de reconstituer le lieu tel qu’il était plusieurs siècles auparavant. Mais à quel point ces reconstitutions sont-elles fidèles à la réalité ? Intéressons-nous à l’exemple de l’abbaye de Saint-Germer-de-Fly pour laquelle j’ai travaillé pour répondre à cette question.
La méthode de réalisation d’une reconstitution 3D
Sur ce projet, le modèle 3D est construit à partir des scans laser et des prises de vue en drone de l’abbaye effectuées en 2023 par l’entreprise Art Graphique & Patrimoine. L’objectif était de faire un modèle au XVIIIe siècle et un autre au XIVe siècle permettant de voir l’évolution architecturale du lieu. Pour représenter l’abbaye à ces périodes, les modélisateurs et les graphistes travaillent de concert avec un historien, Anthony Petit. Ce dernier leur apporte des sources textuelles et iconographiques sur le bâtiment pour corriger les défauts de l’abbaye numérisée. Après plusieurs allers-retours, la reconstitution achevée ne peut être parfaite puisque tout n’est pas présent dans les sources. Les lacunes documentaires sont bien souvent inévitables et des choix de représentation sont faits. Par exemple la façade de l’abbaye, était composée de deux tours au XIVe siècle mais elles ont été détruites pendant la guerre de Cent Ans. Il n’en reste aucune trace, mais il faut bien la représenter. La façade était probablement ornée de sculptures, mais le choix a été fait de la neutraliser dans sa représentation. C’est-à-dire qu’elle est modélisée le plus sobrement possible pour ne pas interpréter le bâti à sa guise et ainsi tromper le visiteur.

Reconstitution de la façade de l’abbaye de Saint-Germer-de-Fly, Art Graphique & Patrimoine, 2025
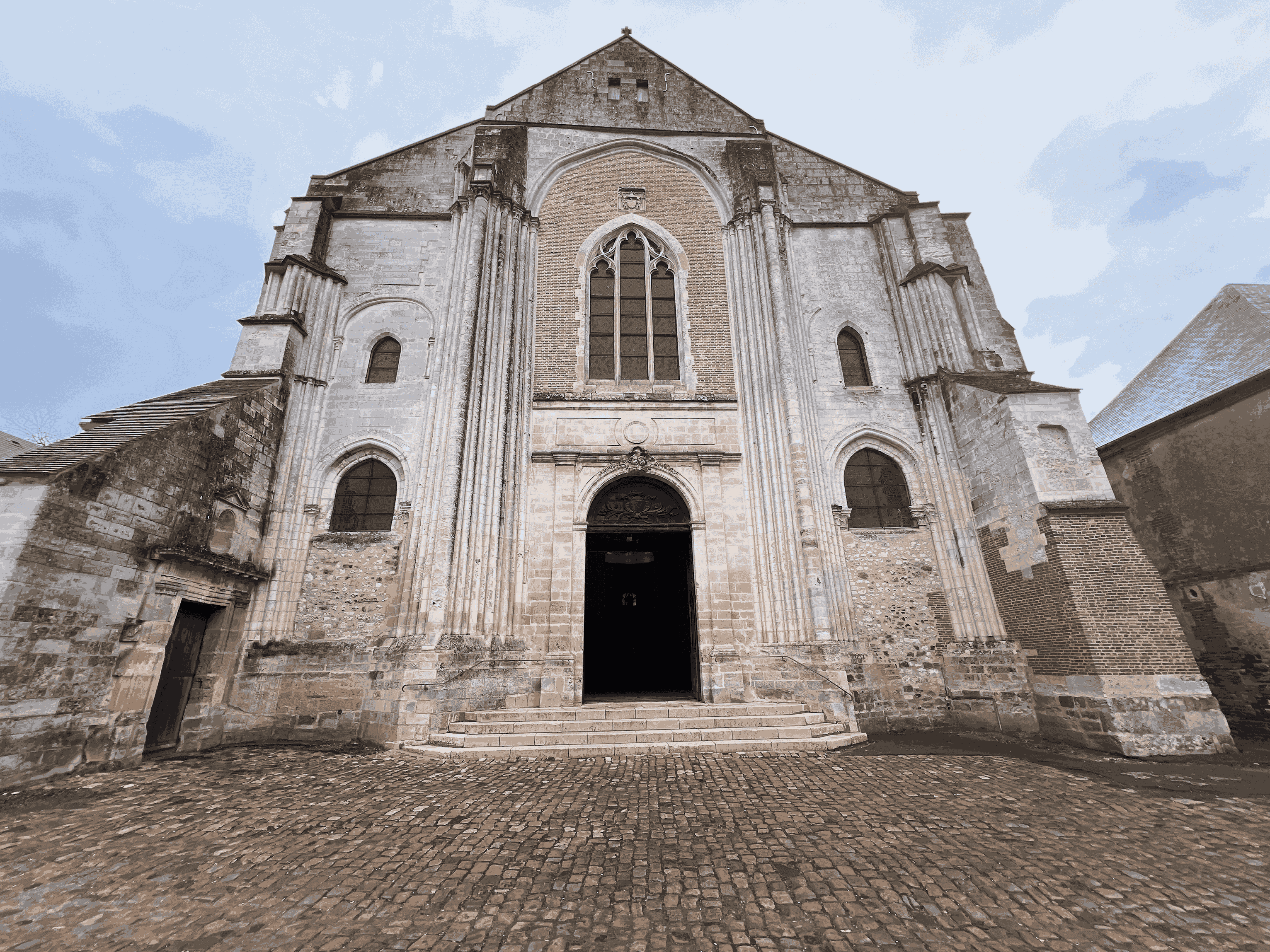
Photographie de la façade de l’abbaye de Saint-Germer-de-Fly, Mathis CHOCAT, 2025
Cette façon de représenter l’abbaye crée des biais dans la perception du visiteur. Une personne qui n’est pas connaisseuse de ce type d’architecture prendra pour argent comptant ce qui lui est présenté comme étant une reconstitution. Il faudrait exprimer cette incertitude dans la reconstitution, mettre en évidence les éléments neutralisés. C’est possible de le dire directement au visiteur dans un texte ou une capsule audio liée à la modélisation, mais c’est au risque d’alourdir le discours et de rendre confus les utilisateurs. Pour y remédier et faire comprendre intuitivement au visiteur cette incertitude, on peut mettre ces éléments en transparence.
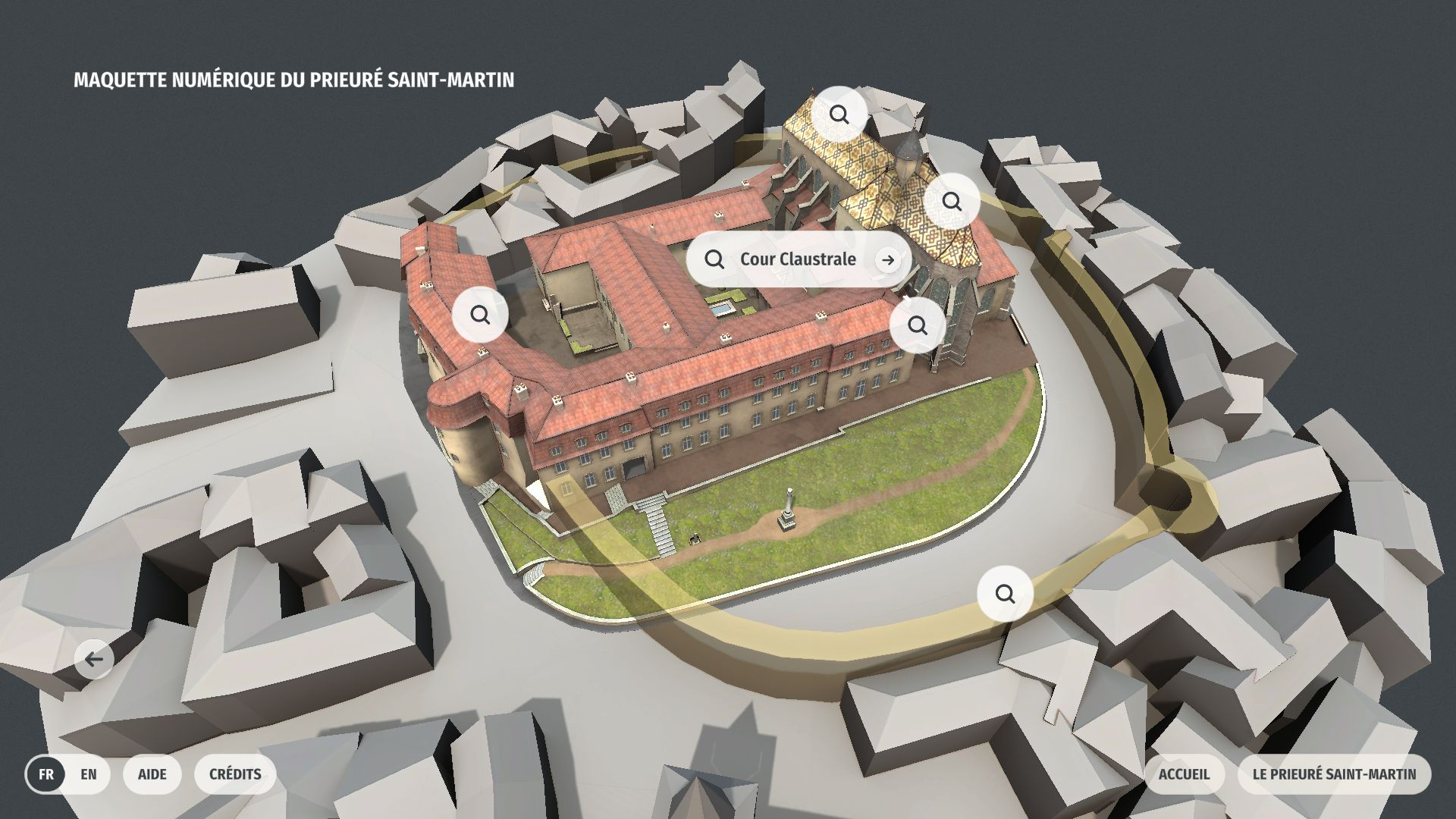
Reconstitution du prieuré Saint-Martin d’Ambierle, AGP, 2025
La réalisation d’un modèle 3D d’un bâtiment encore visible pose déjà beaucoup de questions, mais c’est encore plus difficile pour des édifices disparus. Les sept merveilles du monde antique ou encore la bibliothèque d’Alexandrie ont été de nombreuses fois modélisées en se basant sur le peu de sources qui en parlent, mais jamais leurs images ne pourront être exactes. Pourtant, cela forge un imaginaire et crée des certitudes chez ceux et celles qui les verraient pour la première fois et les considéreraient comme des représentations fidèles.
Mathis CHOCAT
#modélisation #patrimoine #reconstitution
Pour aller plus loin :

Les musées dans nos oreilles : les podcasts au musée et sur les musées
Naissance et gloire du podcast
Le podcast-audioguide
Les podcasts de conversation : intimité et regards croisés




De gauche à droite : © Ausha ; © Podcastics ; © Stitcher ; © Anchor
Les podcasts documentaires : la science mêlée au récit
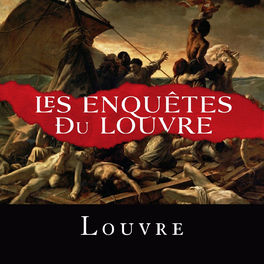


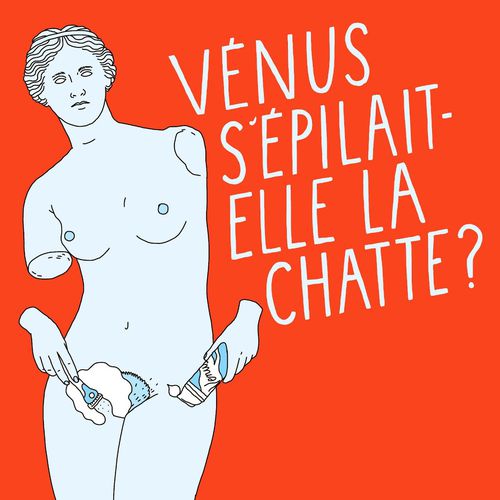
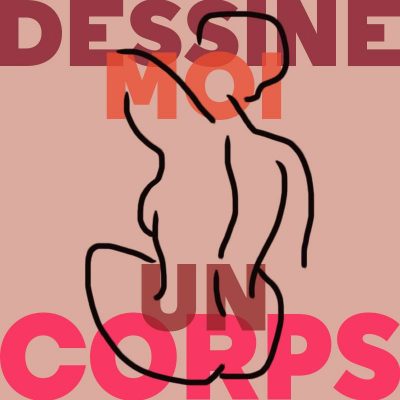
De gauche à droite : © Deezer ; © Centre Pompidou ; © Musée de l’Homme ; © Acast ; © Anchor
Les podcasts de fiction : cultiver l’imaginaire


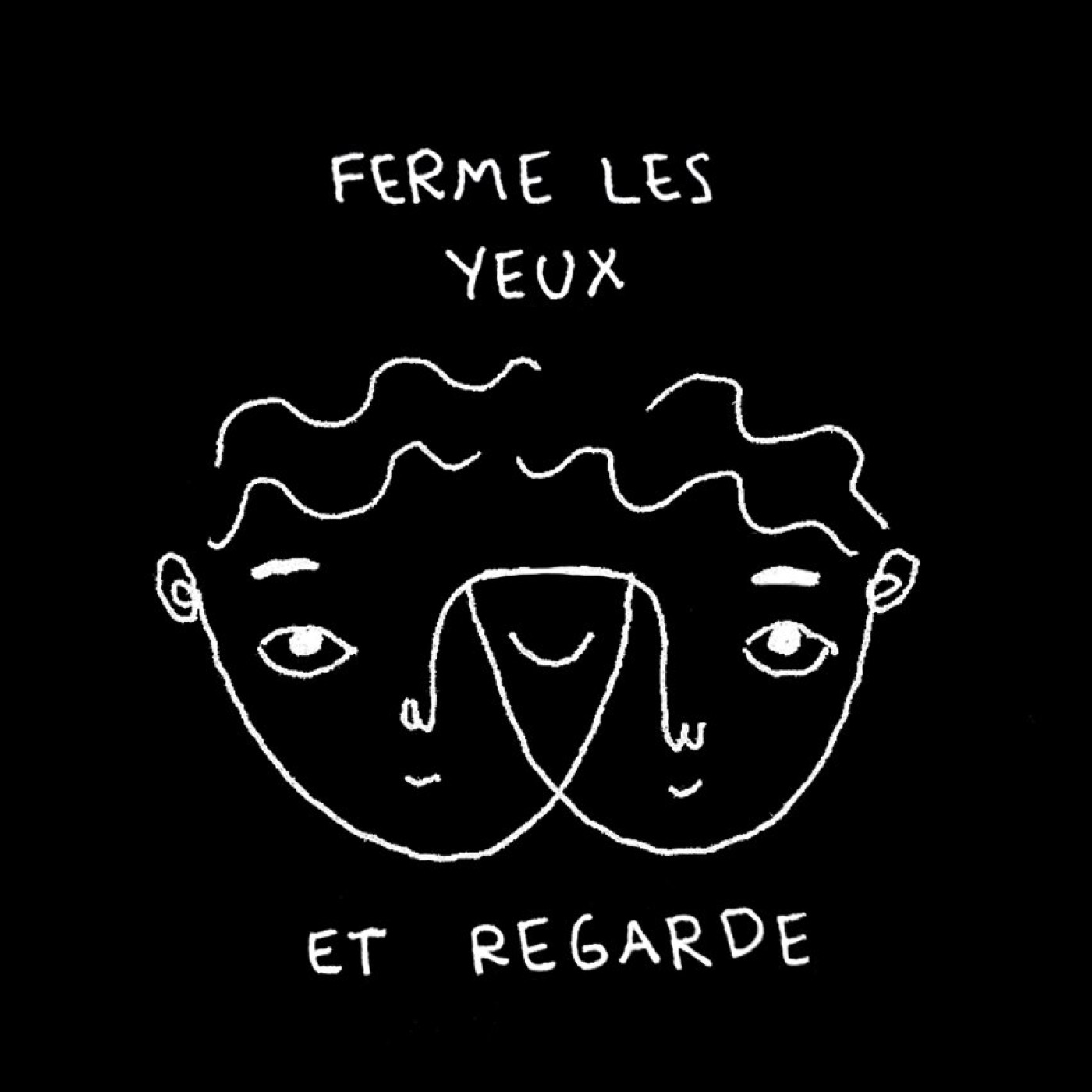

De gauche à droite : © Arte Radio ; © Centre Pompidou ; © Ausha ; © Les petits M’O
Quelques références

Les tables tactiles : un outil de médiation maîtrisé ?
Les nouvelles technologies sont aujourd’hui prises d’assaut par les établissements culturels. En effet comment pourraient-ils y échapper s’ils veulent adapter leur discours à la génération des « digital natives» ?
©Rachel Létang
Car le musée, à l’écoute de son public, se trouve aujourd’hui face à des visiteurs dont une grande part de la communication se fait par un intermédiaire technologique. L’intérêt suscité pour ces nouveaux outils devient alors un argument de poids pour leur acquisition. Mais peut-on réellement compter sur cette attirance du public, somme toute éphémère, envers la nouveauté ?
Afin d’assurer la pérennité de ces installations coûteuses, les propositions se doivent d’être forte, en ne limitant pas ces outils au simple rang d’attraction. Notons également qu’en interrogeant les questions de patrimonialité, le musée ne peut pas contribuer à enfermer son public dans un seul mode de communication mais permettre de s’ouvrir à ce qui est autre ou autrement. Le musée à un rôle à jouer à la préservation et au développement de la convivialité. Comment ces nouvelles technologies et en particulier les tablettes tactiles peuvent elles s’inscrire dans cet objectif ? Particulièrement intéressantes comme objet de médiation et de pédagogie elles ne doivent pas se substituer au contact humain et accentuer l’enfermement individuel face à l’écran, seul source d’information.
La mise en espace adaptée d’une tablette numérique au sein d’un parcours muséographique est essentielle à la valorisation de l’échange et du dialogue. Un bel exemple d’intégration peut être actuellement vu à la cité de la Villette au sein de l’exposition Gaulois, une expo renversante. Les activités proposées sont ici multiples et ne se limitent pas au seul dispositif numérique. Celles-ci prennent place de façon à ne pas entraver le dialogue tout en laissant libre cours à une déambulation intéressante pour un public familial.
La séquence de la fouille au laboratoire se présente sous la forme de six pavillons indépendants qui proposent aux visiteurs de découvrir, par le biais d‘ateliers, de jeux multimédias et traditionnels, la véritable vie des Gaulois. Dans quatre de ces pavillons se trouve une table tactile, l’activité présentée permet de révéler des informations par le biais d‘un jeu attrayant ou d’un dispositif interactif. L’enfant, tout à fait à l’aise avec l’écran et ses fonctionnalités s’approprie très vite la manipulation de celui-ci et aime se retrouver dans la position de guide pour ses parents.
Cette mise en confiance avec l’objet lui permet d’être réceptif aux informations qu’il divulgue. La manipulation fictive des objets est intéressante pour l’apprentissage, notamment par le sentiment d’appropriation qu’elle développe. Le rôle des parents reste ici primordial pour une utilisation adaptée, parfois pour la compréhension de l’exercice, mais également pour que celui-ci ne soit pas exécuté de façon systématique, ce en privilégiant la manipulation au contenu. Les informations acquises par l’usage de ces tablettes sont en adéquation avec le support dont la présence se trouve légitimée.
Mais insistons sur la mise en espace de ces tables numériques qui sont ici entourées d’activités aux formes diversifiées. Les informations acquises entrent en dialogue par la suite avec d’autres supports de médiation, créant ainsi un parcours qui alterne les activités et éveille la curiosité des enfants. La circulation au sein du parcours fonctionne et l'accès aux tables tactiles n'est pas embouteillé. Si celles-ci permettent ici de privilégier l’apport de connaissance à un public spécifique, elles ne peuvent pourtant se substituer à des jeux plus traditionnels, comme le démontre le succès du Qui-est-ce en bois représentant les amphores gauloises; un jeu qui fait appel à la description, à l’analyse et au dialogue spontané et qui permet aux enfants de sortir un peu leur tête des écrans.
Camille Savoye
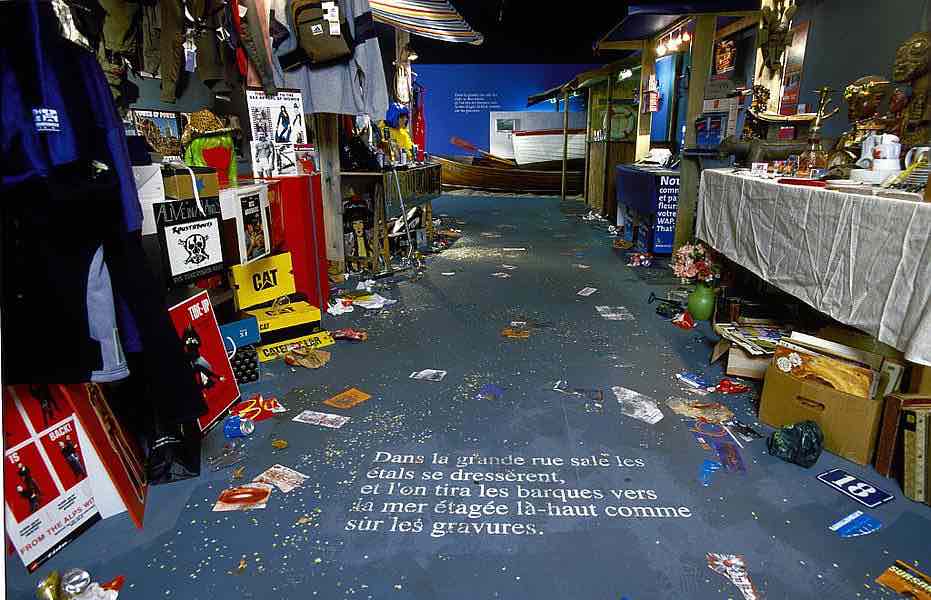
Ma mère en photo avec un prix Nobel
La fausse Une de journal du Nobel Peace Center. Voici ci-dessous un souvenir familial datant d'un peu moins d'un an. Nous étions allées avec Madame ma Mère au Nobel Peace Center de la ville d'Oslo. Une exposition temporaire pour les enfants portait sur la vie de Fridtjof Nansen, Prix Nobel de 1938, racontée par un petit personnage appelé Masika.
Voici qu'à la fin du parcours se présentait Nansen, lui même, grandeur nature en carton pâte, et qu'il nous était proposé de poser à ses côtés pour immortaliser l'instant. Ma mère s'est exécutée, et la simili une de journal, dont il vous est ici proposé une reproduction, est apparue aussitôt fraîchement imprimée.
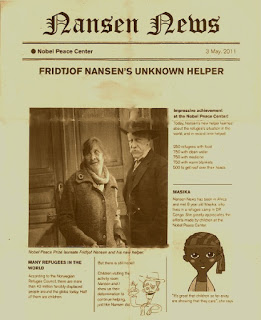
(c) Nobel Peace Center
Un souvenir qui étend le lien avec l'exposition
L'avantage de ce genre de dispositif est tout d'abord d'avoir encore des informations sur l'exposition une fois la visite passée. En effet, on peut retrouver sur ce tract-souvenir quelle était la personne présentée, quel était le personnage qui nous guidait dans l'espace, quelle était la situation des réfugiés alors, et ce que Nansen avait fait pour eux de son vivant.
Tel un résumé de l'exposition, il pourrait même devenir un document d'archive personnel. Il y a aussi sur le côté droit les scores réalisés à un jeu situé juste en amont de la prise de vue, consistant en un lancer de palets qui correspondaient à des montants d'aides offertes pour les réfugiés. Il pourrait y avoir à redire sur ce mélange de jeu et de moralité, mais cette fausse première page permet ainsi de se rappeler une expérience à l'intérieur du musée, de recontextualiser le déroulement de la visite, et donc faire appel à la mémoire par des biais plus multiples et plus sensibles.
Le visiteur sur un autre écran que la caméra de surveillance
La facilité de capture de l'image des visiteurs pour les intégrer dans le processus de l'exposition semble bien n'en être qu'à ses débuts. Après des premiers essais plutôt du côté du parc d'attraction que du musée de connaissances, la multiplicité des usages maintenant amène à ce que chacun puisse y trouver son compte. On se rappelle des premiers clichés, les bras par dessus tête, criant d'épouvante dans un petit wagonnet.
Bien cher était le résultat pour que cet instantané se retrouve matérialisé entre les mains, et puis de toutes façons, il était difficile de trouver l’intérêt d'avoir une photo floue de soi avec les traits révulsés. Mais il y avait pourtant une sorte de fascination à découvrir sur un écran sa propre personne dans une situation totalement ubuesque. Soudainement, on devenait à notre tour un personnage sur l'écran, au milieu d'un décor vu tant de fois dans des fictions.
L'essor des nouvelles technologies continue d'ouvrir de nouvelles perspectives pour que le visiteur se retrouve de l'autre côté du miroir, et qu'il soit partie prenante des contenus qui lui sont proposés. On peut citer à titre d'exemple l'exposition La grande illusion au Musée d'ethnologie de Neuchâtel en 2001 où les visiteurs pouvaient amener deux clichés et où un médiateur-bidouilleur sur place se chargeait avec un logiciel de faire apparaître un visage mêlé des deux. L'image de ce mélange obtenu était alors un moyen d'illustrer une partie de l'exposition qui portait sur l'illusion de la réalité, elle permettait de donner corps à un concept tout en étant davantage évocateur puisque appuyé sur la propre image des visiteurs.
C'est aussi la proposition de l'exposition Des transports et des hommes, ouverte en juillet 2011 à la Cité des Sciences. Au début du parcours, le visiteur peut se faire prendre en photo, être « mappé » et se retrouve aussitôt incrusté sur le tableau vidéo de Pierrick Sorin à bord d'un des nombreux modes de transport dont parle ensuite l'exposition. Une manière ludique d'impliquer, de faire en sorte de concerner par ce qui est ensuite présenté.
Connaissance ou communication ?
On peut tout de même se demander si ce genre d'intervention du numérique ne tient pas plus du gadget que de l'outil muséal. Est-ce que demander aux publics de poser dans un décor de carton est le meilleur moyen de faire passer un message envers Nansen, les réfugiés ou la paix dans le monde ? Là-dessus, le doute est davantage de mise.
Jody Herrero-Beconnier
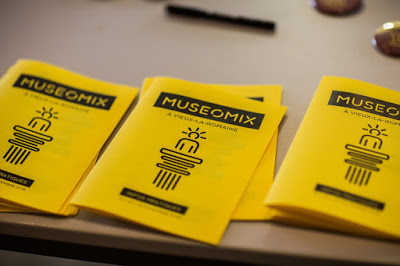
Mon premier Hackathon
La frénésie ‘Muséomix’ a commencé pour moi le vendredi 11 novembre à 9 heures tapantes autour de croissants, cafés, jus de fruits et goodies. J’étais encore loin d’imaginer à quoi aller ressembler mon week-end, notamment parce que je ne savais pas précisément dans quoi je m’étais engagée ! On m’avait parlé d’un événement pour réinventer le musée et je n’avais pas voulu fouiller les archives du site internet pour garder un effet de surprise.
Source : AG+ Studio
Me voilà donc au milieu d’une foule en liesse, où chacun trépigne en donnant l’impression de déjà savoir ce qu’il veut faire. Il n’y a pas de temps à perdre. Le café est à peine avalé qu’on organise déjà deux groupes pour visiter la structure ! Le premier part examiner le musée en compagnie du directeur. Il nous annonce la couleur dès le début : le musée archéologique de Vieux-la-Romaine manque de renouvellement et d’attractivité alors plus on est créatif, plus on propose des projets fous, plus nous serons soutenus ! S’amuser et profiter sont presque des devoirs !
L’ambiance est posée. Pourtant pendant la visite chacun suit poliment et prend note à la manière d’un cours magistral… Finalement il va falloir encore un peu de temps pour se libérer ! Mais qu’importe c’est déjà le moment de visiter « l’usine à inventer » ! Les ‘ingénieux’, qui sont là pour nous épauler dans tout ce qui touche aux technologies du Fab Lab, nous énumèrent tout un tas d’outils, dont la plupart semblent encore incongrus pour un musée. Il va vraiment falloir commencer à se lâcher ! Justement pour partir à la recherche de notre imagination, bien cachée ce matin-là, nous commençons un brainstorming géant, autour de cinq grandes thématiques. Armés de post-it multicolores et de stylos, nous voici la trentaine de participants, fourmillant d’un tableau thématique à l’autre, écrivant à tout va des mots-clés et répondant aux post-it précédents. Chacun y va de son commentaire ou sa blague. Toute idée, aussi farfelue qu’elle soit, se doit d’être exposée à tous !
Les groupes se forment en fonction des affinités thématiques et des compétences de chacun. Un petit pins permet de distinguer chaque savoir-faire : médiateur, bricoleur, designer, communicant, scientifique ou codeur. Une compétence par équipe est nécessaire à la réalisation de chaque projet. Enfin, le marathon créatif peut commencer... Les heures suivantes n’étaient que des discussions dynamiques autour de l’imagination d’un sujet, d’un dispositif et comment le mettre en place. Exposer ses idées et les confronter aux points de vue des autres n’est finalement pas si évident, surtout quand certains ne préfèrent pas entendre d’autres opinions que la leur.
En définitive, nous nous sommes accordés pour concevoir deux petits parcours se construisant autour des vitrines et textes de l’exposition permanente du musée. Le visiteur se munit soit d’une tesselle de céramique soit d’une coquille d’huître, et part à la recherche de son réemploi dans l’Antiquité, cherchant des indices dans l’espace d’exposition. Par des jeux d’interaction, de renvois lumineux et d’indices il peut reconstituer un pot en céramique, jouer à la marelle antique (jeu de plateau dont les pions sont constitués de tesselles) et participer à la construction d’une route romaine. Le principe est identique pour les coquilles d’huîtres : le visiteur doit trouver comment recycler ce déchet (très important en Normandie du fait d’une très grande consommation d’huîtres à l’époque) et finalement, il est invité à poser sa coquille sur un chantier de construction d’un sol. Les parcours sont libres mais interactifs et conviennent aux adultes comme aux enfants. Le musée est au cœur du dispositif pour inciter à s’approprier les espaces et y être attentif.

Table de travail du groupe Les Vieux Débris lors de la conception du parcours céramique
Source : C. Maury
Après les débats, c’est le début de la conception matérielle et les premiers problèmes techniques ressortent ! Sous le stress, l’excitation et l’effervescence chaque contrariété prend des proportions excessives ! C’est aussi ça l’expérience Muséomix : se maîtriser, s’adapter aux autres, organiser son temps et apprendre à mieux communiquer. Le bouillonnement créatif nous fait perdre toute notion de temps et même d’environnement. Le monde extérieur n’existe plus. On pense Muséomix, on mange Muséomix, on dort Muséomix ! Les journées sont intenses par leur longueur et productivité et finalement le soir en quittant l’équipe, il y a presque un vide.Les trois jours s’enchaînent avec la rapidité d’un éclair, et finalement dimanche arrive déjà. L’après-midi les visiteurs sont invités à tester les prototypes et donner leur avis. Eux aussi vivent une drôle d’expérience: partir visiter des sites archéologiques avec un parapluie transformé en GPS ou construire une voie romaine avec des coquilles d’huîtres, ce n’est pas ce à quoi on s’attend lorsque l’on choisit de visiter un musée archéologique ! Mais d’ailleurs la surprise est meilleure... J’entends certains visiteurs dire qu’ils ne trouvent plus l’archéologie ennuyeuse et trop éloignée de notre société… et ça c’est gagné !

Alliance de nouvelles technologies avec l'archéologie
Source : AG+ Studio
Après plus de trois heures de test avec un vrai public, le musée referme ses portes. C’est l’heure du bilan. On nous annonce que le dispositif pour lequel je me suis donné corps et âme sera certainement pérennisé. Quelques détails devront être repensés pour être parfait, mais le directeur semble confiant. Sur les cinq projets, seul le notre se voit récompensé de la sorte !
Nous fêtons cette réussite autour d’un dernier verre et les petits fours de la soirée de clôture. L’aventure s’achève déjà… Je ressens comme une sorte de nostalgie et en même temps un soulagement… Enfin la pression peut redescendre. C’est aussi à ce moment là que je réalise que je viens de vivre une expérience intense, humaine et riche où l’innovation est au cœur de toute pensée.Je n’avais jamais eu l’occasion de rencontrer autant de gens aux parcours si différents et pourtant unis dans un objectif commun, qu’était ici la rénovation de l’expérience muséale, je n’avais pas non plus eu l’occasion d’exercer ma créativité de telle manière et en si peu de temps, et surtout c’était la première fois que j’avais autant de moyens (tant matériels qu’humain) pour m’accompagner dans un projet d’invention. Finalement les délires peuvent parfois devenir cohérents et concrets !

Présentation du prototype des Vieux Débris en plénière
Source AG+ Studio
En partant, un de mes coéquipier me lance : « On se voit au prochain hackathon ! » Quoi ? C’est quoi ce charabia ?! Et lui de m’expliquer qu’un hackathon c’est l’événement qui vient de se terminer… C’est un processus de création soutenu pour concevoir par équipes de nouveaux dispositifs, ou réinventer une structure. Décidément je ne savais vraiment pas dans quoi je m’engageais en participant à Muséomix !
CM
#Museomix
#Vieux-la-Romaine
#LesVieuxDébris
#Hackaton
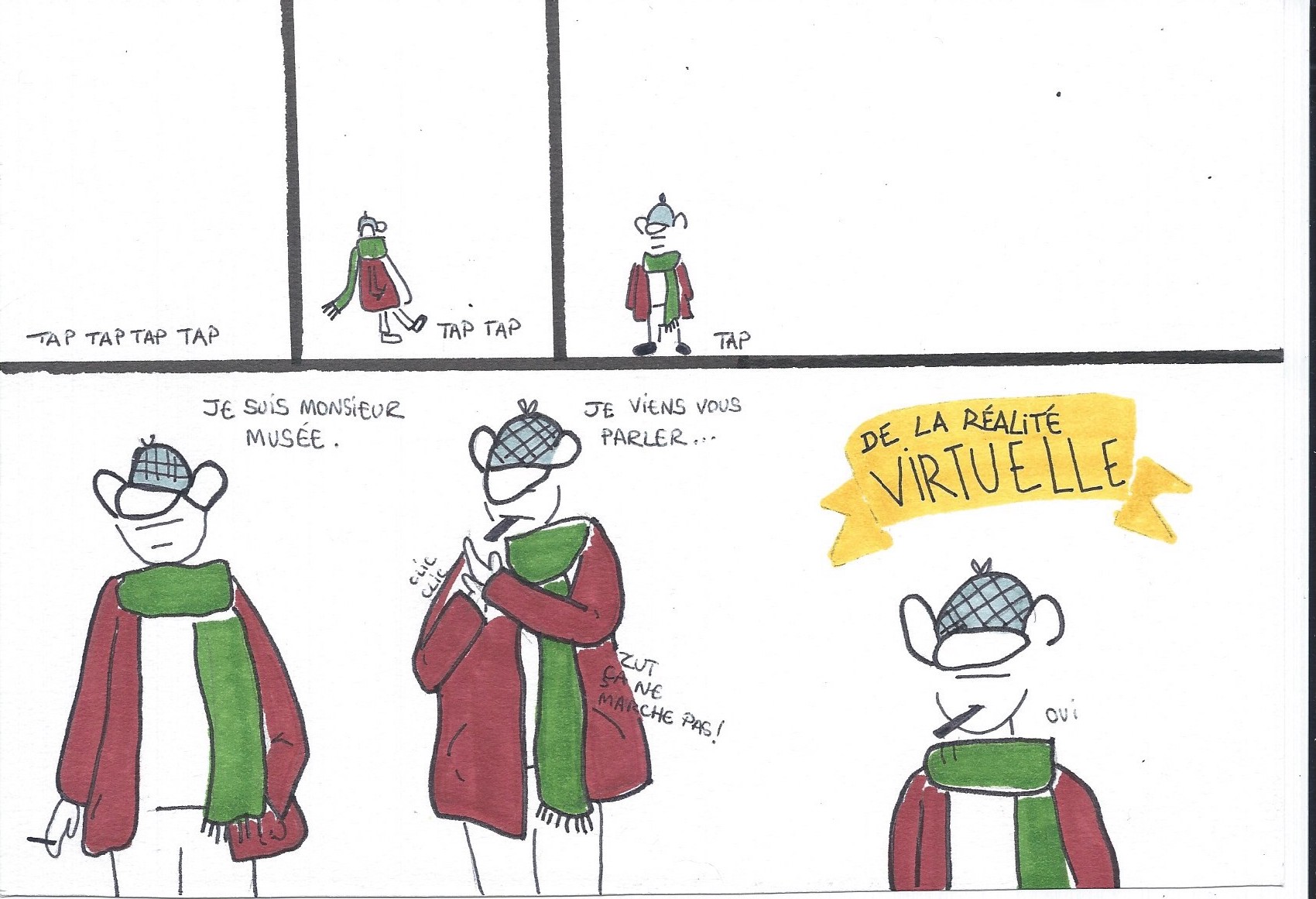
Monsieur Musée vient vous parler de la réalité virtuelle
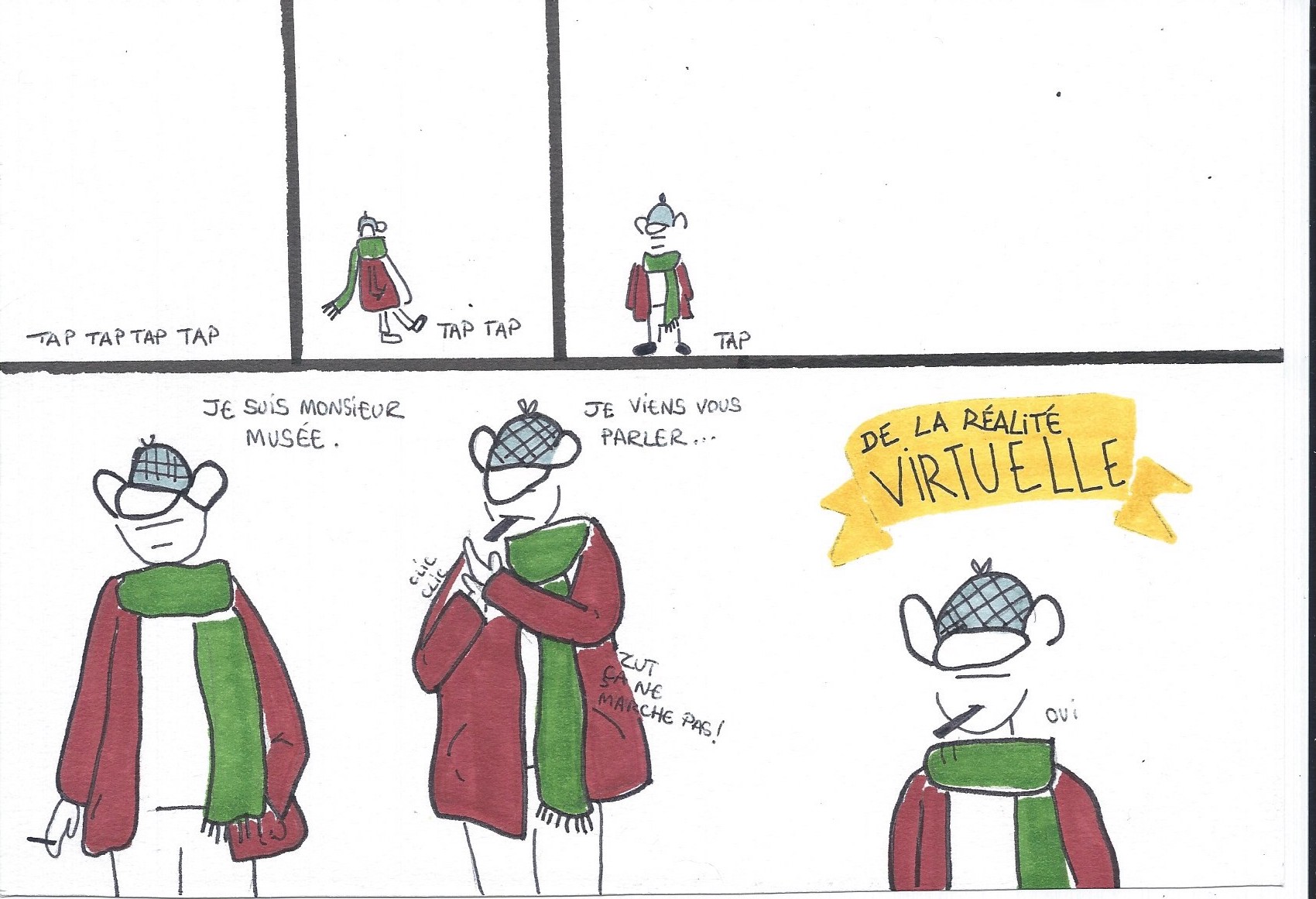
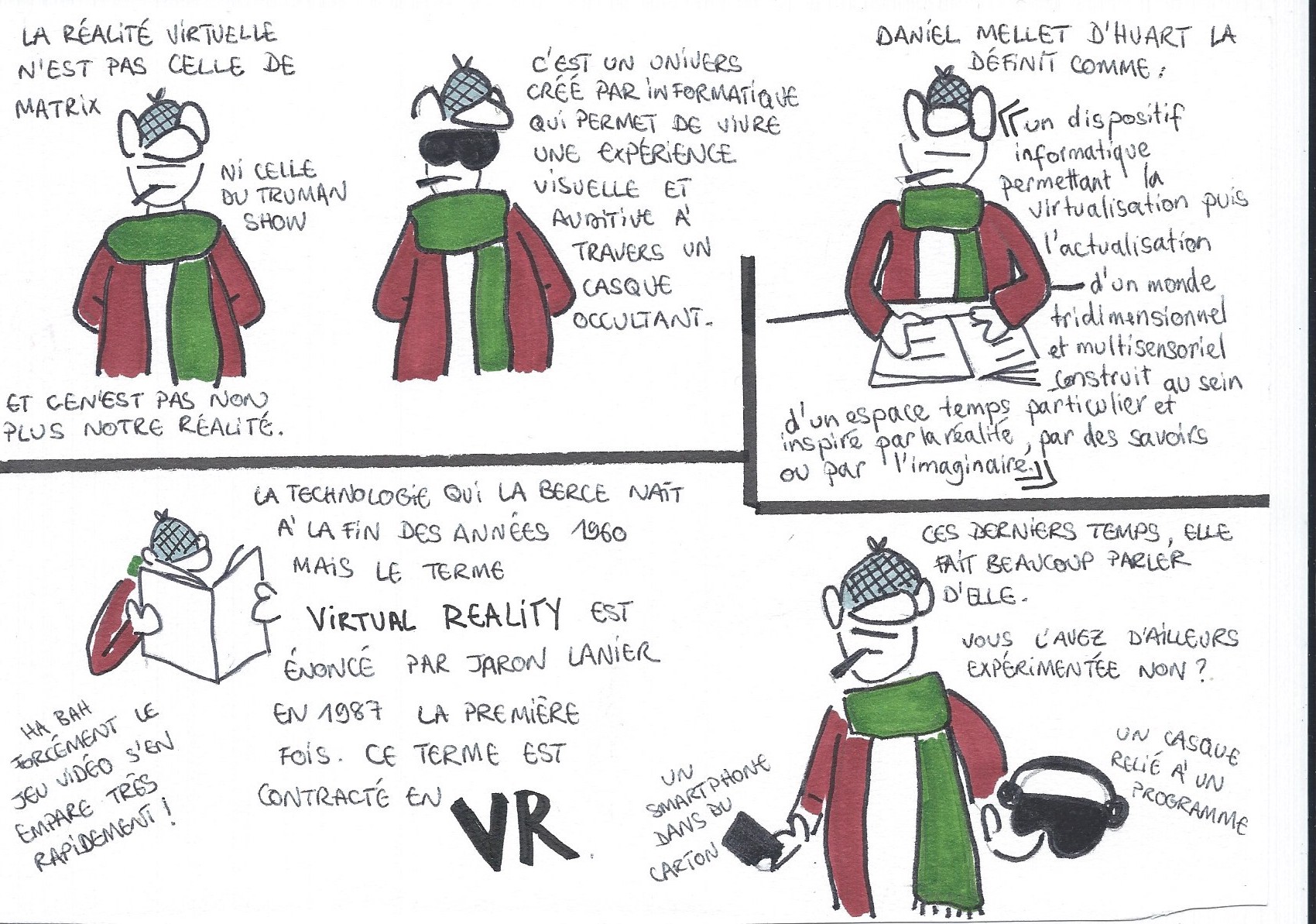
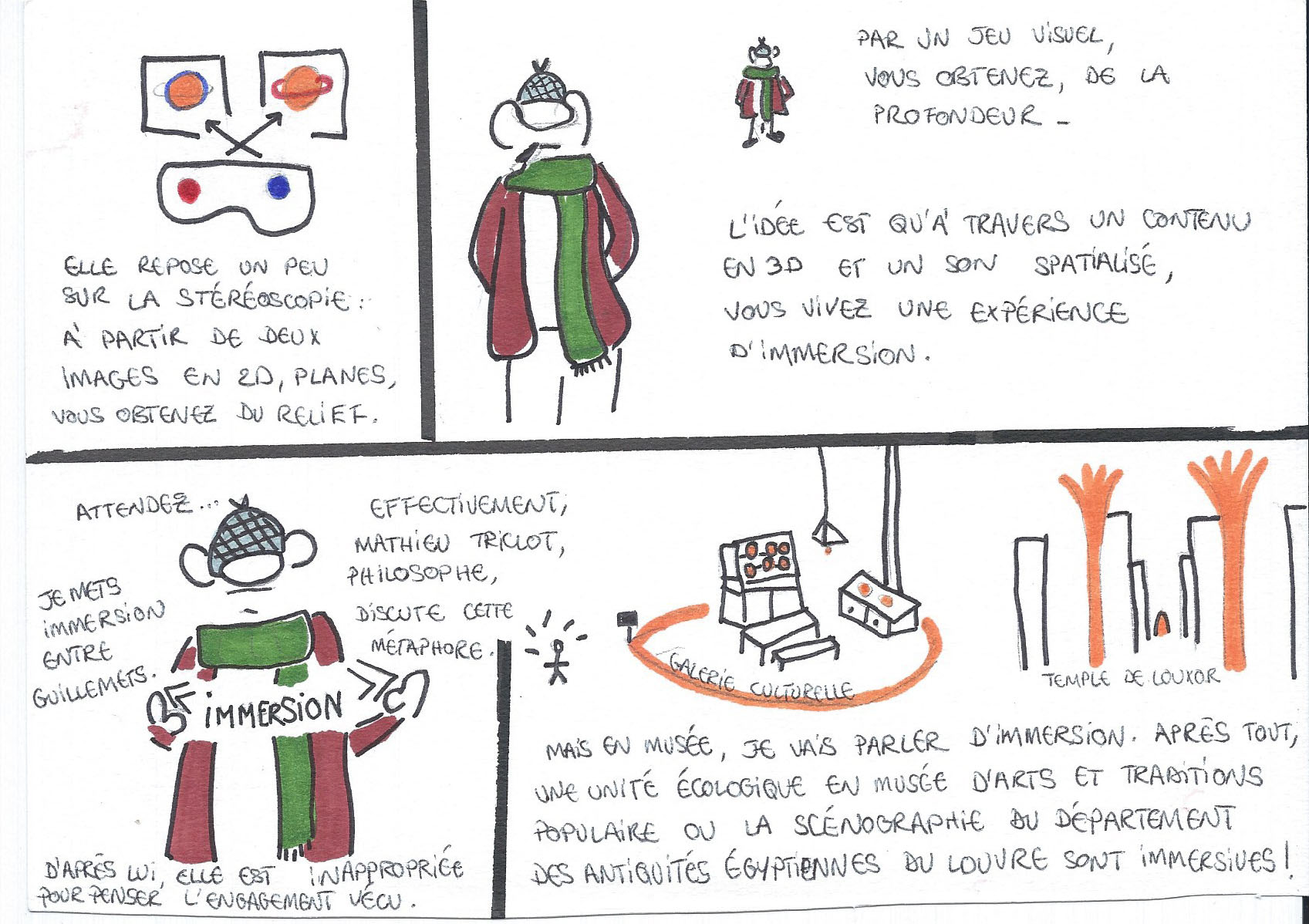
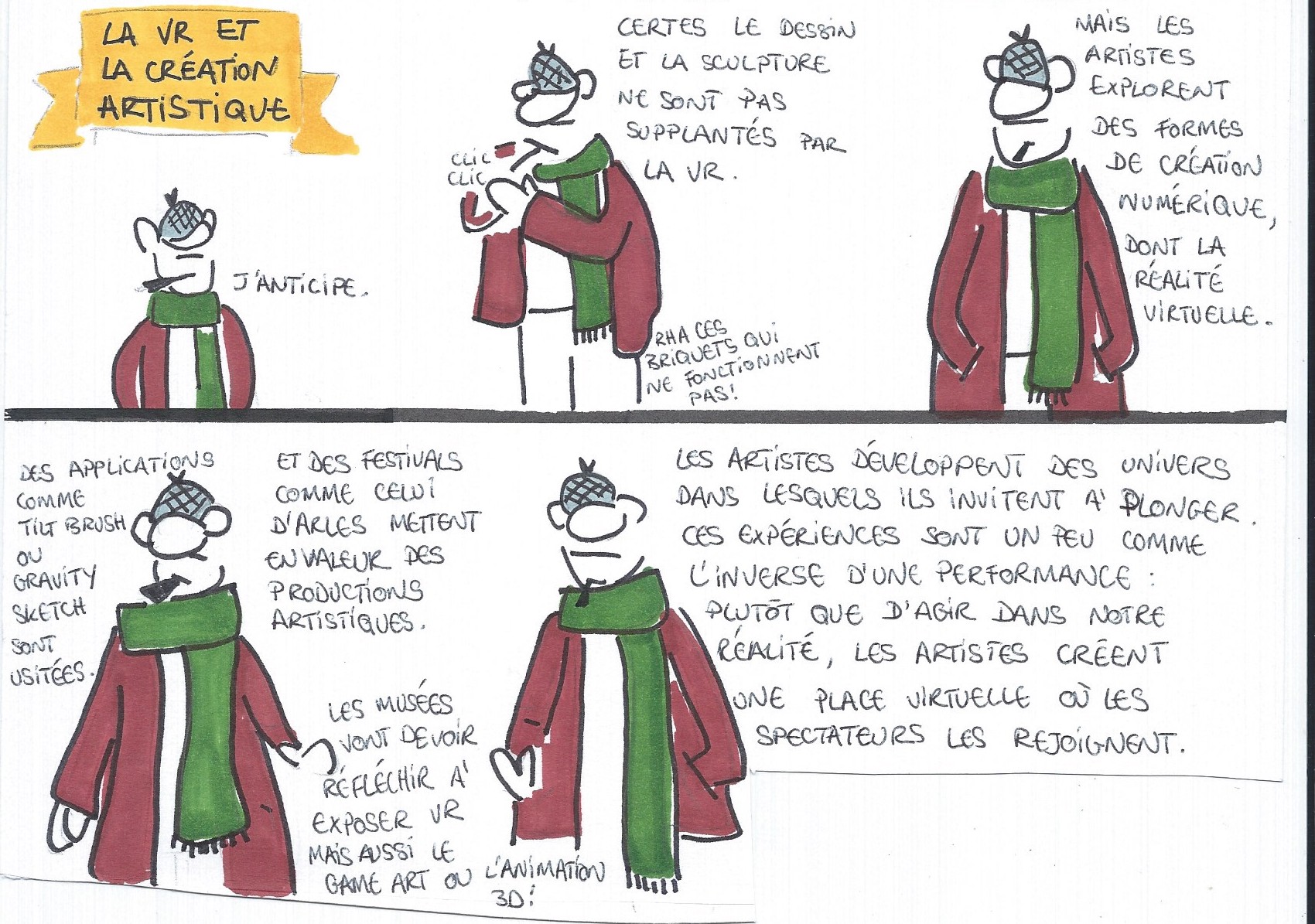

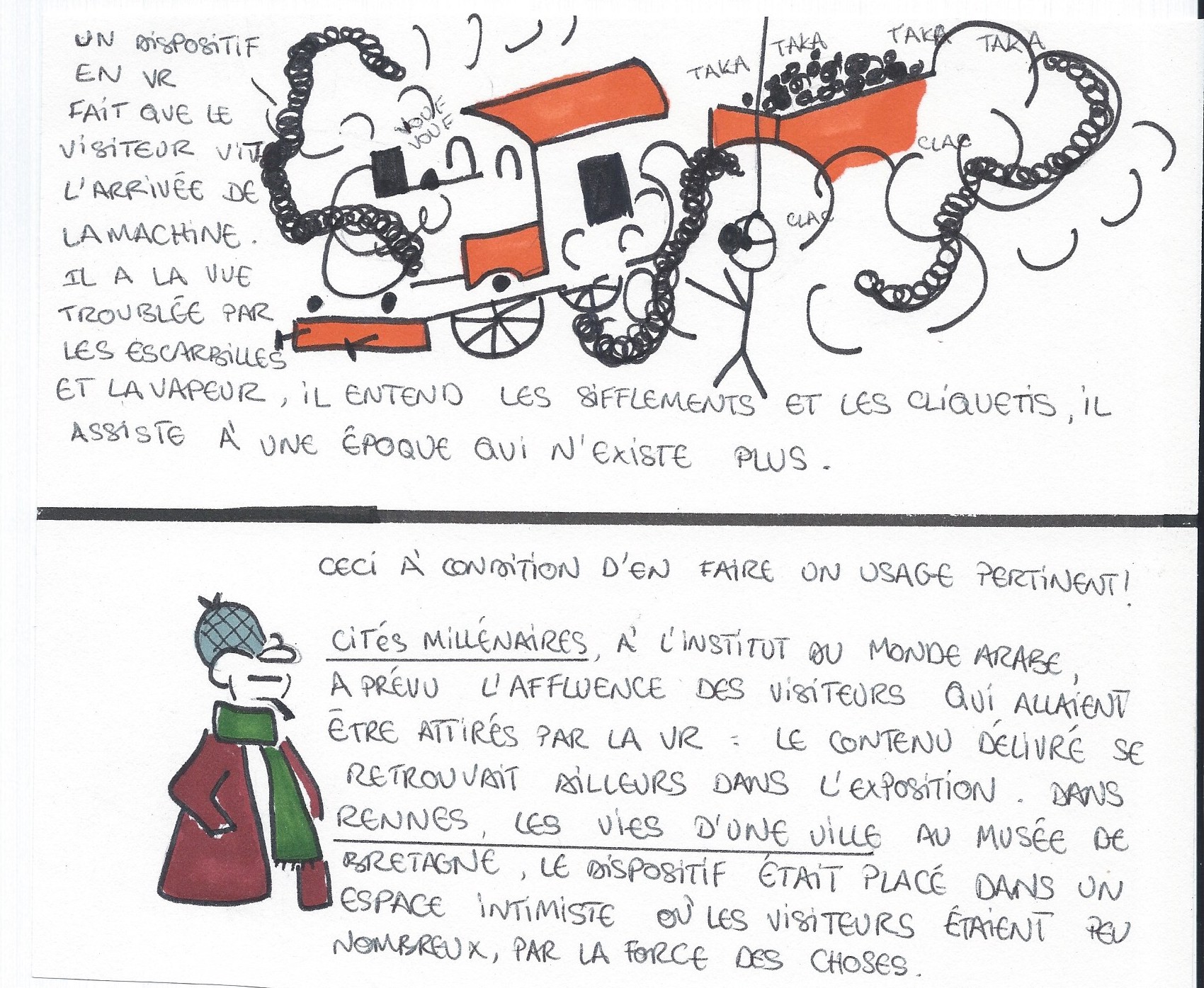

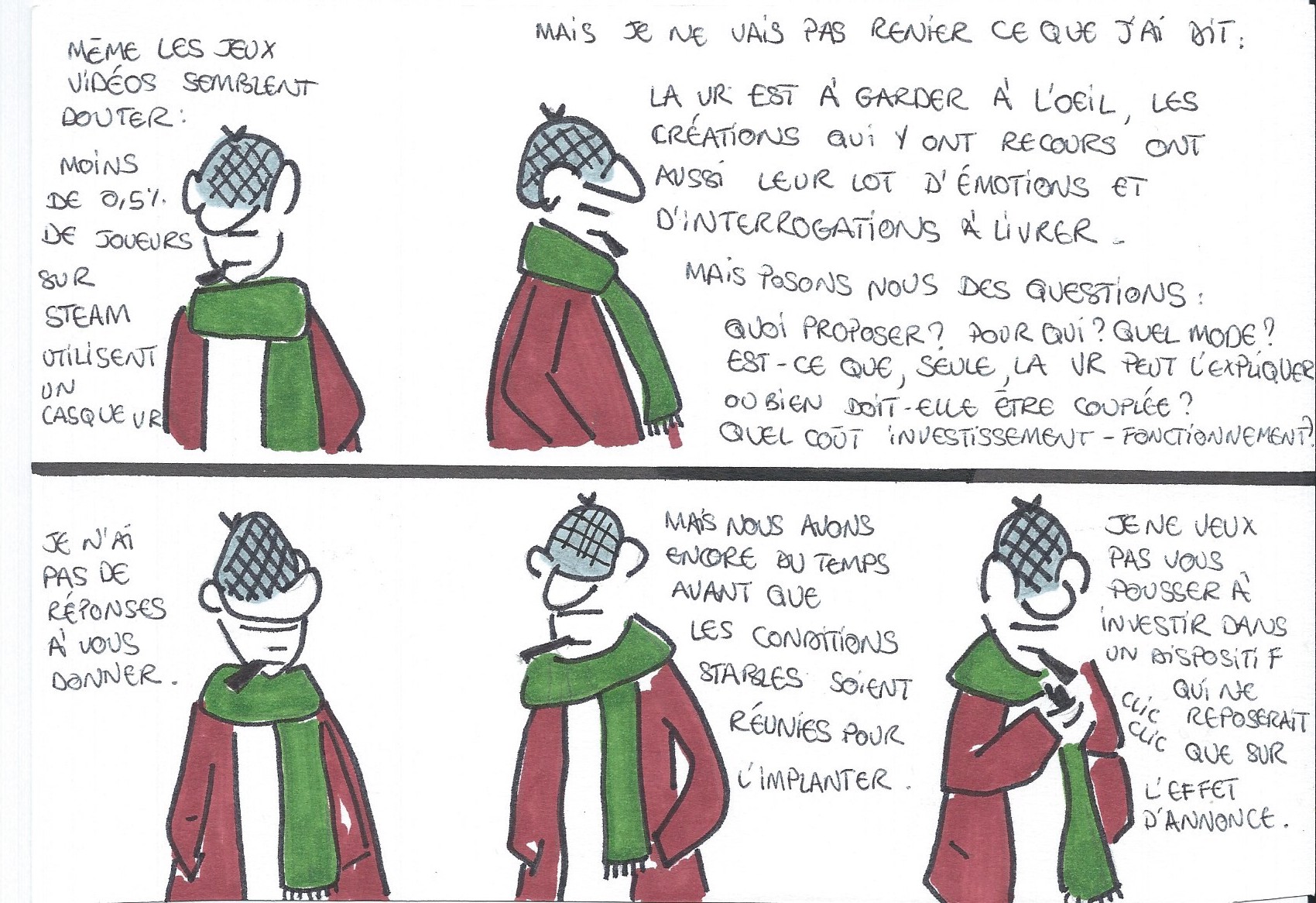

©CC
Coline Cabouret
#immersion
#virtualreality
#virtuel
Pour en savoir plus :
- https://www.canardpc.com/362/la-verite-vr (réservé aux abonnés ou dans toutes les bonnes bibliothèques)
- https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/03/02/la-realite-virtuelle-en-six-questions_455855639_454085996.html
- https://www.lemonde.fr/pixels/visuel/2018/04/06/la-longue-marche-de-la-realite-virtuelle_552815448_454085996.html (dossier VR)
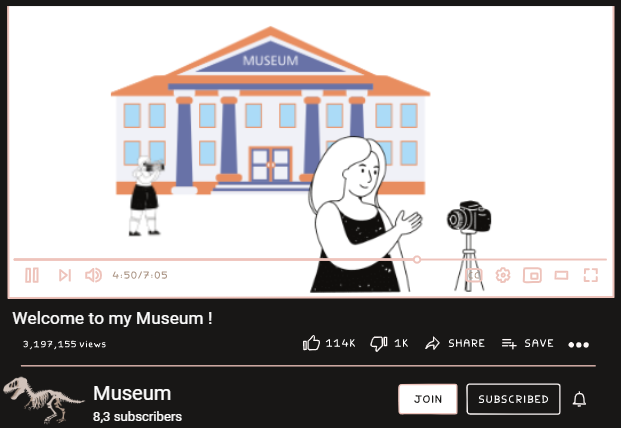
Musées scientifiques et YouTube : je t’aime, moi non plus
Image d'intro : ©M.T
Le YouTube des musées scientifiques
De nombreux musées scientifiques possèdent leur propre chaîne YouTube. Celle du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris ouvre en 2017 et compte aujourd’hui 17 800 abonnés. Y sont postés des rediffusions de conférences, des podcasts, des interviews ou de courtes vidéos en lien avec les expositions. C’est le même type de contenu pour la Cité des Sciences et de l’Industrie (créée en 2006 avec aujourd’hui 36 000 d’abonnés) ou le Musée des Confluences (créée en 2015 avec aujourd’hui 1 470 d’abonnés). Ces chaînes YouTube sont un lieu de stockage de vidéos institutionnelles qui sont souvent relayées sur d’autres réseaux sociaux comme Instagram, Twitter ou leur site internet.
Rares sont les musées qui publient des contenus spécifiques à la plateforme. YouTube a ses propres langages et codes, popularisés par les youtubeurs : une vidéo rythmée grâce au montage, de nombreuses références à la culture internet (des chansons, des memes, …) et une relation entre vidéastes et public qui se veut sincère et authentique, en somme, des codes qui tranchent avec des formats télévisuels.
Voici deux exemples de musées qui reprennent ces codes : le musée de Minéralogie de Mines ParisTech ouvre sa chaîne YouTube en 2016 et compte aujourd’hui 1 980 abonnés. La chaîne sert principalement de stockage mais une websérie sort du lot : « Histoire de Cailloux ». En 2017, la première vidéo sort : pendant 1 minute et 44 secondes, Didier Nectoux nous parle de la Sépiolite à travers des anecdotes. 82 épisodes passionnants, vus par 100 à plus de 1 000 personnes. Le second exemple est le Muséum d’Histoire Naturelle de Neuchâtel qui ouvre sa chaîne en 2016 et compte aujourd’hui 412 abonnés. La websérie « Collections Bestiales », créée en 2017, présente des naturalisations des collections du muséum. Ces vidéos correspondent parfaitement aux contenus spécifiques de YouTube, bien réalisées et très comiques (et je ne dis pas cela parce que j’y suis en stage !).
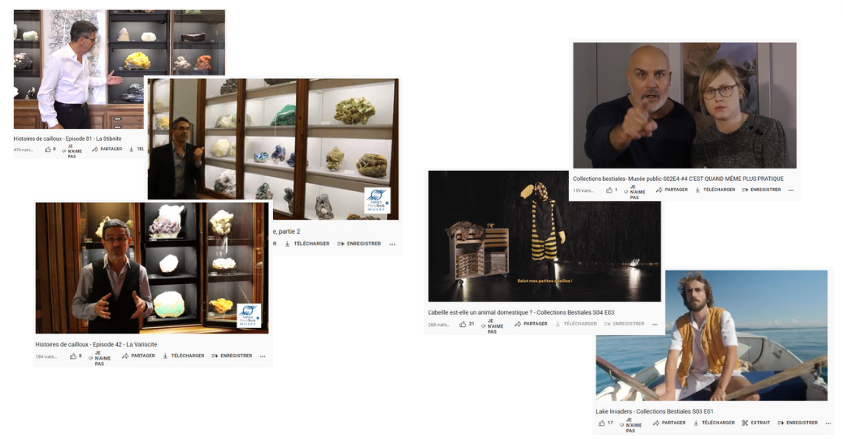
Captures d’écran de la Websérie Histoire de Cailloux (à gauche) ©MINESParisTech et de Collections Bestiales (à droite) ©MHNN
Des collaborations avec des youtubeurs
Les collaborations de youtubeurs avec le Louvre sont sans doute les meilleurs exemples. En 2016, le Louvre décide de collaborer avec 3 youtubeurs, Nota Bene, Axolot et Le Fossoyeur de Films. Ces formats ayant particulièrement bien marchés, le Louvre continue avec 5 autres youtubeurs. Aujourd’hui, ce sont 19 youtubeurs français ou britanniques qui ont réalisé en tout 28 vidéos, certaines ont fait plus de 700 000 vues. Collaborer ainsi est pour les institutions l’occasion de toucher un jeune public, voire de désacraliser l’image des musées, des sciences et des arts. Pour les youtubeurs, cela permet de gagner en crédibilité auprès de leur audience. Ce système de collaboration est souvent unidirectionnel, c’est l’institution qui commande aux youtubeurs.
Concernant les musées scientifiques, peu d’exemple existe. En 2009, Universcience lance la chaîne YouTube « Le Blob, l’extra-média » avec aujourd’hui presque un million d’abonnés. « Infox ? Riposte ! » est une série créée en collaboration avec le youtubeur Thomas Gauthier de la chaîne du même nom. Le Youtubeur Léo Grasset, de la chaîne DirtyBiology a collaboré avec le Louvre et avec le musée des Confluences à Lyon pour promouvoir une de leur exposition.
Somme toute, peu de collaborations existent, pourquoi ? Est-ce par méconnaissance réciproque : les youtubeurs ne se sentiraient pas légitimes et n’oseraient pas aller vers les institutions culturelles. Et de l’autre, les musées manqueraient de budget ou manquent d’intérêt et les médiateurs des musées pourraient craindre de se faire remplacer.
Est-ce que ces collaborations amènent de nouveaux publics ? Nous avons peu de recul sur cette question, une raison de plus pour que les institutions ne s’y engagent pas. En effet, youtubeur est un métier à part entière, l’investissement d’un musée sur cette plateforme en vaut-il la peine ? Vue l’énorme concurrence sur YouTube, il est compliqué de percer sans de gros investissements financiers et humains comme le Louvre.
Pour résumer, les chaînes YouTube des musées scientifiques servent principalement de stockage de vidéos institutionnelles, mais certaines institutions cernent le concept de la plateforme et s’y essayent. D’autres institutions optent pour une autre méthode : la collaboration avec des youtubeurs-vulgarisateurs scientifiques.
Je terminerai par une sélection de vidéos à voir :
« Que diriez-vous d'un os dans le pénis ? - Collections Bestiales #1 » du muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel ©MHNN
« La science des mythes (DirtyBiology et C'est une autre histoire) » de la collaboration entre le musée du Louvre et les youtubeurs DirtyBiology et C’est une autre histoire ©MuséeduLouvre
Enfin, la meilleure pour la fin, la youtubeuse Valentine Delattre de la chaîne Science de Comptoir qui vous fera enfin aimer la géologie. Je rêve de voir une de ses vidéos dans une exposition !
« Ivre, Elle Lèche Des Cailloux (Pour Une Bonne Raison) » ©SciencedeComptoir
Mélanie TERRIÈRE
Pour en savoir plus :
- Document recensant les « 350 chaînes YouTube culturelles et scientifiques francophones à découvrir et partager »
#YouTube #vulgarisation #muséescientifique #youtubeur
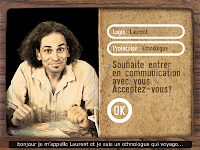
Muséo ou l'accessibilité multimédia
C'est presque enfoncer une porte ouverte que de rappeler l'opportunité en terme de renouvellement que représente aujourd'hui pour les musées et établissements culturels l'essor des NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication). D’abord essentiellement tournés vers la communication, ces outils multimédia deviennent de plus en plus un enjeu de la médiation comme le montre le développement croissant dans les institutions des visioguides et des tables tactiles. Comment alors concevoir l’usage des NTIC dans un parcours Muséographique et les adapter aux besoins des publics ? Muséo est une proposition d’alliance entre médiation culturelle et nouvelles technologies.
© Signes de Sens
Muséo ? Kesako ?
Conçu par l'association « Signes de sens » qui œuvre pour l'accès à la culture et aux savoirs pour les personnes sourdes, Muséo est un dispositif de médiation multimédia destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Il s’appuie sur la force iconique de la langue des signes françaises (LSF) mais est accessible à tous grâce à des sous-titres et une voix off. Présenté dans le cadre des appels à projet « services numériques culturels innovants » du ministère de la culture et de la communication (culture labs), Muséo a été appliqué en décembre 2010 au musée du Quai Branly.
Il s’articule en deux phases : une visite interactive des collections à l’aide d’un Ipad et des ateliers multimédia de 15 à 20 minutes. Sur l’écran des tablettes Ipad, un comédien sourd utilisant la LSF interprète un « ethnologue » et invite les enfants à découvrir, à travers des vidéos explicatives et des quizz, les populations des quatre continents. Dans les trois ateliers (« matières », « paysages » et « vidéo ») la technologie multitouch1 est privilégiée. Les enfants réinvestissent ce qu’ils ont découvert en recréant par exemple un paysage, en déplaçant sur un écran des personnages, des éléments... Lors de l’atelier « vidéo», les enfants fabriquent un objet grâce à un logiciel de commande à distance et se voient eux-mêmes en direct «incrustés» dans le film. Enfin, il est proposé à ce jeune public de créer de nouveaux signes LSF enregistrés avec une webcam.
Du bon usage de la technologie
L’intérêt de la démarche de Muséo est d’envisager l’emploi des outils multimédia sous l’angle de l’accessibilité. Il s'agit d'accéder à la culture grâce à une pédagogie entièrement visuelle, comme le rappelle "Signes de sens" dans ses objectifs. L'emploi de supports multitouch permet à l'utilisateur une forte interaction avec les contenus, une immersion. Les concepteurs militent pour une prise en compte du « handicap » comme source de réflexion et d'innovation et non un frein. L'accessibilité est d'ailleurs ici l'accessibilité à tous, halte à la ghettoïsation des pratiques !
La considération des besoins des publics sourds est un point de départ à de nouveaux usages amenés à se diffuser. Il est véritablement porteur et stimulant d'envisager les NTIC comme vecteurs de nouvelles pratiques culturelles et sociales avec leurs spécificités propres. L'écueil est trop souvent pour les musées celui de la transposition d'anciens médias aux nouveaux. Un cartel numérique est-ce vraiment pertinent ? Utiliser un Ipad pour utiliser un Ipad ne semble pas suffisant. « Signes de sens » propose de replacer le public au cœur de la médiation en saisissant et développant les opportunités des NTIC et notamment celle de l'interactivité et de la complémentarité entre différents types de supports. Le Web 2.02 n'est d'ailleurs pas oublié de Muséo et de ses créateurs qui ont d'ailleurs mis au point un réseau social en LSF « elix ».
© Signes de sens
Le dispositif Muséo est un échelon précieux dans la réflexion actuelle sur la place des nouvelles technologies dans les musées comme outils et même créateurs de médiation. Comment articuler contenu et supports dans un contexte multitouch ? Le risque étant pour certains établissements de noyer le message dans un tout-ludique tactile où la technologie ne vaudrait que pour elle-même.
Le concept élaboré par "Signes de sens" vaut pour son intention de pérennité, d'évolution et de transmission. Il doit être conçu en complète collaboration avec le musée auquel il apporte son expérience technique et sa connaissance des publics. Il propose de penser l'accessibilité -via les NTIC- en amont des projets et non de l'ajouter a posteriori. Muséo est à n'en point douter une étape importante dans le cadre des enjeux de modalités de transmission et de médiation aujourd'hui, c'est en tout cas un projet des plus stimulant et enthousiasmant, à faire connaître de toute urgence !
Noémie Boudet
1 Le multitouch ou multipoints est une technologie d'interaction humain/ordinateur qui permet à un utilisateur de contrôler un logiciel grâce à une surface tactile., par le seul contact des doigts.
2 On désigne par « Web 2.0 » l'évolution des pratiques internet vers la création et surtout le partage de contenus par et entre internautes notamment par le biais de réseaux sociaux.

Museomix à la Manufacture des Flandres : vivre le musée différemment
Le dimanche 8 novembre 2015, la 3e édition de Museomix Nord prenait fin. Les museomixeurs laissaient leurs prototypes entre les mains de l’équipe de la Manufacture de Roubaix et retournaient à leur quotidien, loin de l’euphorie de l’événement.
Museomix, depuis 5 ans,c’est trois jours, 72 heures, un musée, 6 équipes et des esprits en ébullition. L’objectif ? Créer un prototype de médiation innovant qui parle à tous. Comment ? Les museomixeurs disposent d’un grand nombre d’outils : découpe laser, imprimantes 3D, hologrammes, tablettes, écrans, rétroprojecteurs, matériel informatique et bien sûr du bois, de la peinture et une menuiserie est mise à notre disposition. Toutes les conditions sont réunies pour qu’il n’y ait aucune limite à notre créativité.
Pour commencer, les museomixeurs visitent la Manufacture ou plutôt le Musée de la mémoire et de la création textile de Roubaix. Des métiers à tisser de toutes époques sont mis en mouvement sous nos yeux. De la pédale, à la machine à vapeur jusqu’à l’électricité, de la navette à la lance ou encore du jacquard au système informatisé, le musée nous propose de découvrir l’évolution de l’industrie du textile. Une fois les marques prises dans les lieux, les équipes se forment autour de 6 grandes thématiques dont Tissu / tissage ; Métier(s) ; Mémoire/patrimoine ; Le futur /demain/ innovation ; Maillage/ territoire ; Collecter /connecter / recycler et Usine/machine, celle vers laquelle je me suis tournée.
© C.B.
Du fil au motif
Un coach, un médiateur, un chargé des contenus, un codeur, un graphiste et enfin une bricoleuse (moi !) se regroupent autour des mots Usine et Machine pour se lancer dans une journée de discussions, de débats mais surtout d’échanges d’idées du Jacquard. Inventé en 1801 par Joseph Marie Jacquard, le Métier Jacquard permet la réalisation de motifs de façon automatique. Pour cela, les métiers sont équipés d'un mécanisme qui sélectionne les fils de chaîne grâce à un programme inscrit sur des cartes perforées. Basées sur un système binaire, les cartes jacquard vont permettre de créer des motifs allant du simple losange au plus complexe des ornements. Aussi fascinant que soit ce procédé, son fonctionnement est difficile à comprendre, d’avantage du fait que tout se passe au sommet des machines, c’est-à-dire à quelques mètres au-dessus de nos têtes.
La volonté d’expliquer le métier Jacquard au public fédère l’équipe. Dès le samedi matin, les débats reprennent sur la forme que prendra notre prototype et plusieurs pistes apparaissent. Pourquoi ne pas présenter le Jacquard à travers le son ? En effet, l’orgue de barbarie produit de la musique en utilisant un procédé mécanique qui fonctionne à l’aide de papier perforé comme le jacquard. Autre idée ? Le visiteur actionnerait un métier jacquard virtuel à l’aide d’un système permettant d’interagir par la reconnaissance de mouvements. Des problèmes de réalisation technique surviennent rapidement et rendent ces idées non réalisables.
Un visiteur aux commandes
Ce que nous souhaitons absolument retrouver dans notre futur outil de médiation est la manipulation du visiteur. Nous considérons que pour faire comprendre le procédé du jacquard au public, ce dernier doit réaliser son propre motif en actionnant lui-même le système jacquard. Nous pensons alors à ramener la partie supérieure du métier à tisser à hauteur du regard du visiteur afin que ce dernier puisse le manier.
Avec l’aide d’un ancien travailleur du textile, nous réfléchissons au mécanisme à mettre en place et le concept prend forme au fil des échanges et des croquis. En parallèle, le contenu explicatif s’élabore entre la graphiste la médiatrice et la chargée du contenu. Logo, vidéo de présentation et tweeter se mettent également en place pour présenter à tous La mini-jacquard. À la fin de la journée les plans définitifs sont réalisés, les mesures sont décidées et la liste des matériaux est rédigée avec l’aide du menuisier. Le principe du prototype sera donc de soulever les fils désirés grâce à des crochets qui seront introduits dans les trous supérieurs de la machine et de la carte jacquard. Une fois les fils disposés, il suffit de passer la navette entre ceux-ci et le motif apparaîtra peu à peu.
 © C.B.
© C.B.
« Merci, j’ai enfin compris ! »
 © C.B.
© C.B.
Le troisième et dernier jour est consacré à la construction de la « mini jacquard » et à la réalisation graphique des contenus. Scier, percer, coller, clouer, visser, petit à petit le jacquard prend forme et des tests sont régulièrement réalisés pour s’assurer de la faisabilité du prototype. Cette dernière journée est une course contre la montre, dès 14h, les prototypes doivent être disposés dans le musée et être prêts à passer au crashtest.Nous devons régler les derniers détails et préparer nos discours pour l’arrivée du public.
L’installation se fait rapidement, c’est à cet instant que certains problèmes techniques apparaissent : un fil pas assez tendu ou encore des aiguilles difficiles à manipuler. Mais nous n’avons plus le temps d’y remédier car dès 15h les visiteurs affluent. Toute l’équipe se transforme alors en médiatrice afin de présenter le fruit de ce marathon créatif, passionnant et exigeant. Le public est attentif, il nous écoute, pose des questions, manipule et quel plaisir d’entendre « Merci, j’ai enfin compris ! ».
C.B
Pour en savoir plus :
http://www.lamanufacture-roubaix.fr/
#Museomix
#Roubaix

Muséomix Kids au Musée de la Chartreuse de Douai
Des enfants créent leur médiation : le Tableau interactif animalier
Mesdames Messieurs, Museomix ! Ce marathon muséal créatif de trois jours a lieu une fois par an : des adultes viennent réinventer le musée, armés d’imagination et de café (beaucoup de café). Partout dans le monde, des musées participent à cet événement. Partout dans le monde, des musées participent à cet événement. En France la communauté « Museomix Nord », constituée par des passionné-es, permet l’organisation depuis 2014 d’un marathon Museomix dans un musée du nord de la France. (site de Museomix Nord)
Et depuis 2015, Museomix Nord a décidé d’impliquer des enfants ! S’il est compliqué de les faire participer pendant trois jours à ce rythme fou, on les convie à réinventer le musée à leur sauce, le temps d’une après-midi. Bien souvent ils et elles réalisent, en 3 heures et sans café, un prototype digne de ceux que les adultes présentent à la fin du marathon.
Les jeunes participants de Muséomix Kids et leurs parents ont découvert cet événement gratuit grâce à la communication sur les réseaux sociaux du musée, et des articles dans la presse locale. Ils et elles avaient entre 6 ans (âge minimum d’inscription) et 13 ans. Ils et elles ont investi le musée le 9 novembre 2019.
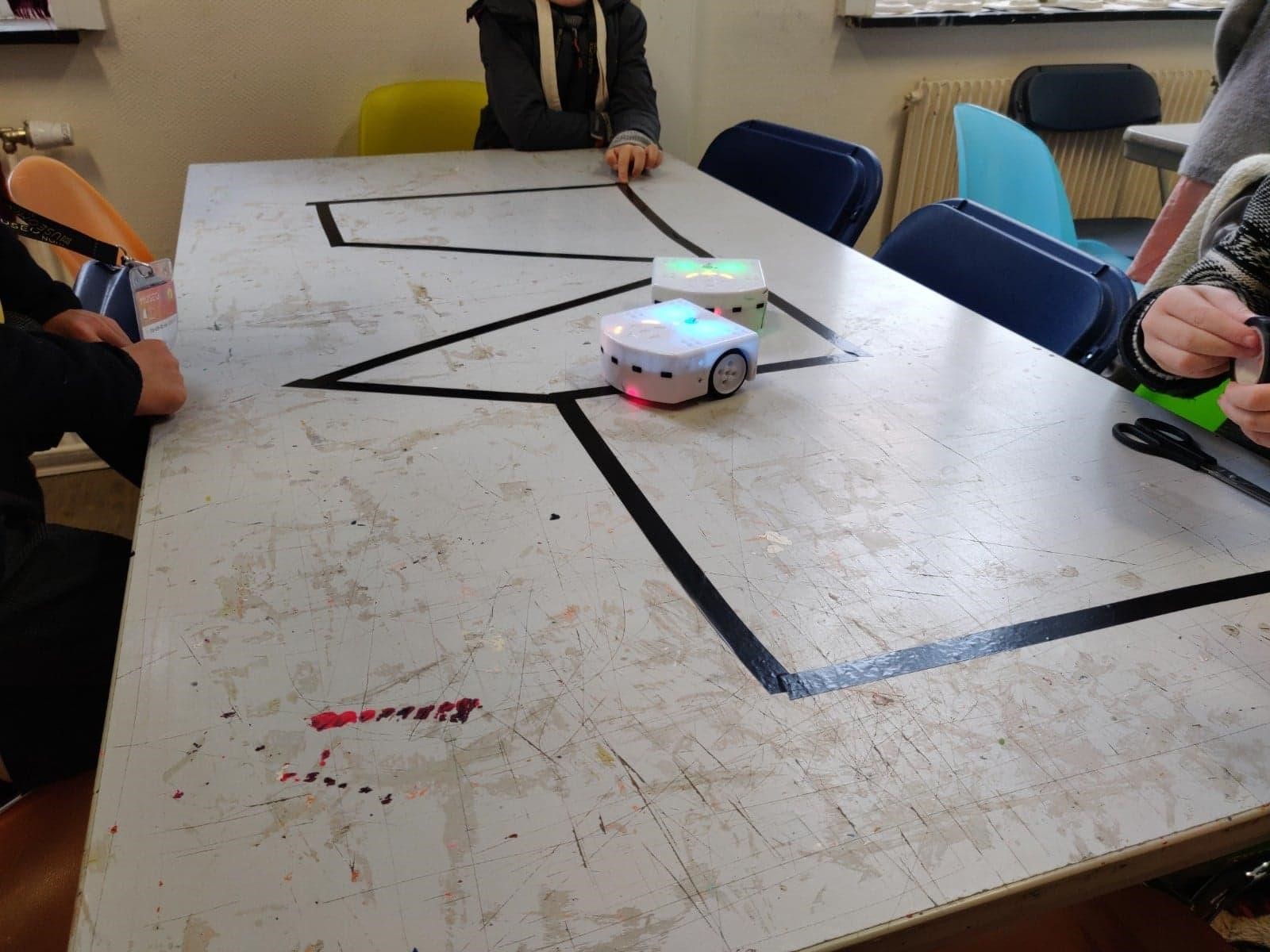
Thymio II, robot en open source pensé pour l'initiation des enfants à la robotique. © M. Q.
Pour Museomix Kids, les organisateur-rices mettent à disposition des enfants du matériel varié (des logiciels et des robots, des crayons et du carton…), des animateur-ices et le musée lui-même. Alors qu’est-ce qui fait la réussite d’une médiation inventée par des enfants ? Voici la recette !
Dans ce cas précis :
- Un musée : le Musée de la Chartreuse de Douai ;
- Deux animatrices ;
- Trois enfants (de 6 à 13 ans) ;
- Un concept : Les enfants ont proposé une idée : celle d’entendre le bruit des animaux que l’on retrouve dans le parcours de la Chartreuse de Douai. A partir de cette proposition, ils ont imaginé un tableau interactif, que l’on retrouve à la fin de la visite. L’idée serait d’avoir une application (par exemple), qui proposerait tous les animaux du musée et les cris associés. L’enfant sélectionnerait ceux qu’il souhaite garder en mémoire, en les glissant dans un tableau paysage, qui abriterait sa sélection unique, et qu’il pourrait conserver après la visite (en envoyant un lien par mail). Le paysage qui abriterait les animaux ne serait pas un tableau du musée, mais des tableaux prévus spécialement pour cette médiation. On pourrait imaginer mettre à disposition plusieurs paysages au choix.
Pour réaliser le prototype de cette médiation dans votre musée, puisque les prototypes sont en open source, il vous faut :
- 3 enfants motivés (survoltés parfois)
- Un grand carton
- Du papier
- Des feutres, crayons, etc
- Des attaches parisiennes
- Des pinces croco (petites, pas celles pour démarrer la voiture)
- Un ordinateur avec le logiciel MakeyMakey et le contrôleur
Etape 1 : Allez voir dans le musée quels animaux sont représentés.
Etape 2 : Dessinez avec les enfants les animaux qu’ils souhaitent voir apparaître dans le tableau final, sur des feuilles, et découpez les animaux. Conservez de côté (précieusement !).
Etape 3 : Dessinez le paysage sur le carton, coloriez (si les enfants décident d’ajouter des moyens de transport, suggérez de remplacer les voitures par des vélos !).
Etape 4 : Trouez le tableau-carton aux endroits où vous voulez mettre les animaux, trouez les animaux (les dessins, bien-sûr) ; fixez les animaux au tableau-carton grâce aux attaches parisiennes.
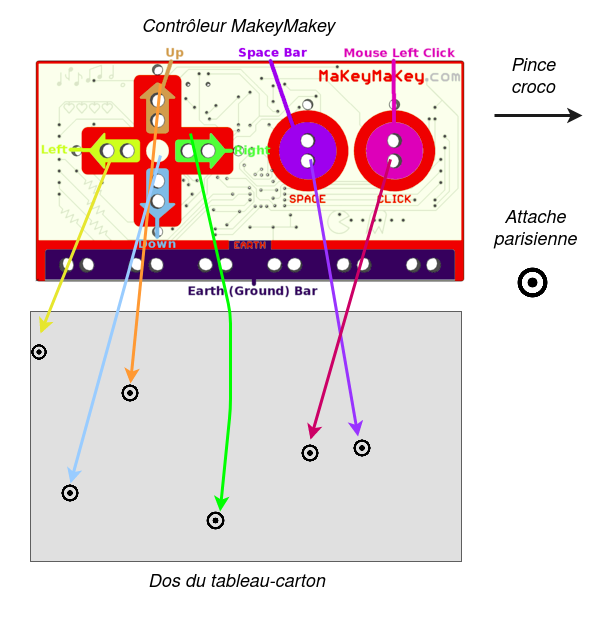
Schéma © M. P.
Etape 5 : Attachez les pinces croco d’un côté aux attaches parisiennes (au dos du tableau-carton), et de l’autre au contrôleur, lui-même connecté à un ordinateur.
Avec le logiciel MakeyMakey, programmez les sorties du contrôleur pour que chaque action (touche espace, haut, bas, etc) provoque le bruit de l’animal à laquelle la pince croco concernée est reliée.
Etape 6 : Attrapez la pince croco qui sert d’entrée d’électricité, touchez une attache parisienne : le corps est conducteur d’électricité, et le bruit de l’animal résonne dans les galeries du musée !
Il ne reste plus qu’à aller présenter aux museomixeurs adultes les prototypes réalisés avec nos petites mains.
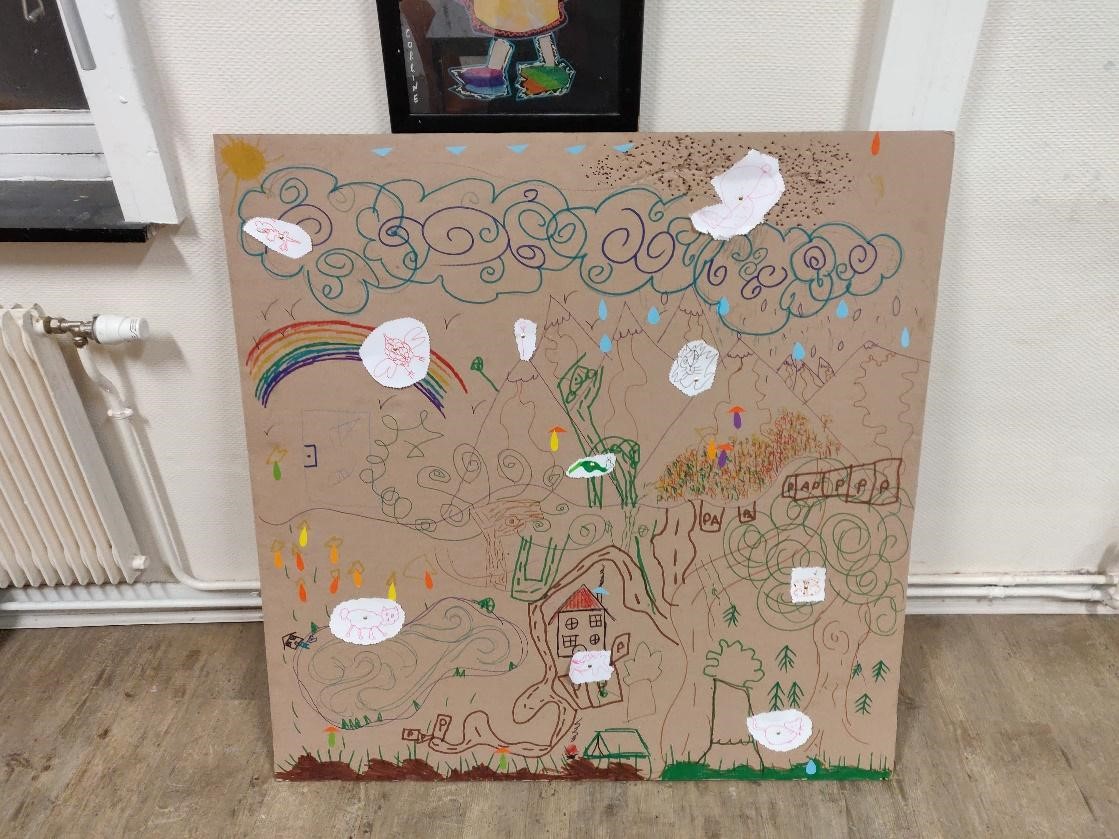
Le tableau final ! © M.P
Cette expérience amusante et enrichissante pour les enfants leur permet de regarder autrement le musée, et de les rendre acteurs et actrices de leur visite, et en plus de libérer un après-midi du week-end de leurs parents : le rêve !
Maud P.
#MuseomixKids
#Douai
#Médiation
Pour aller plus loin :
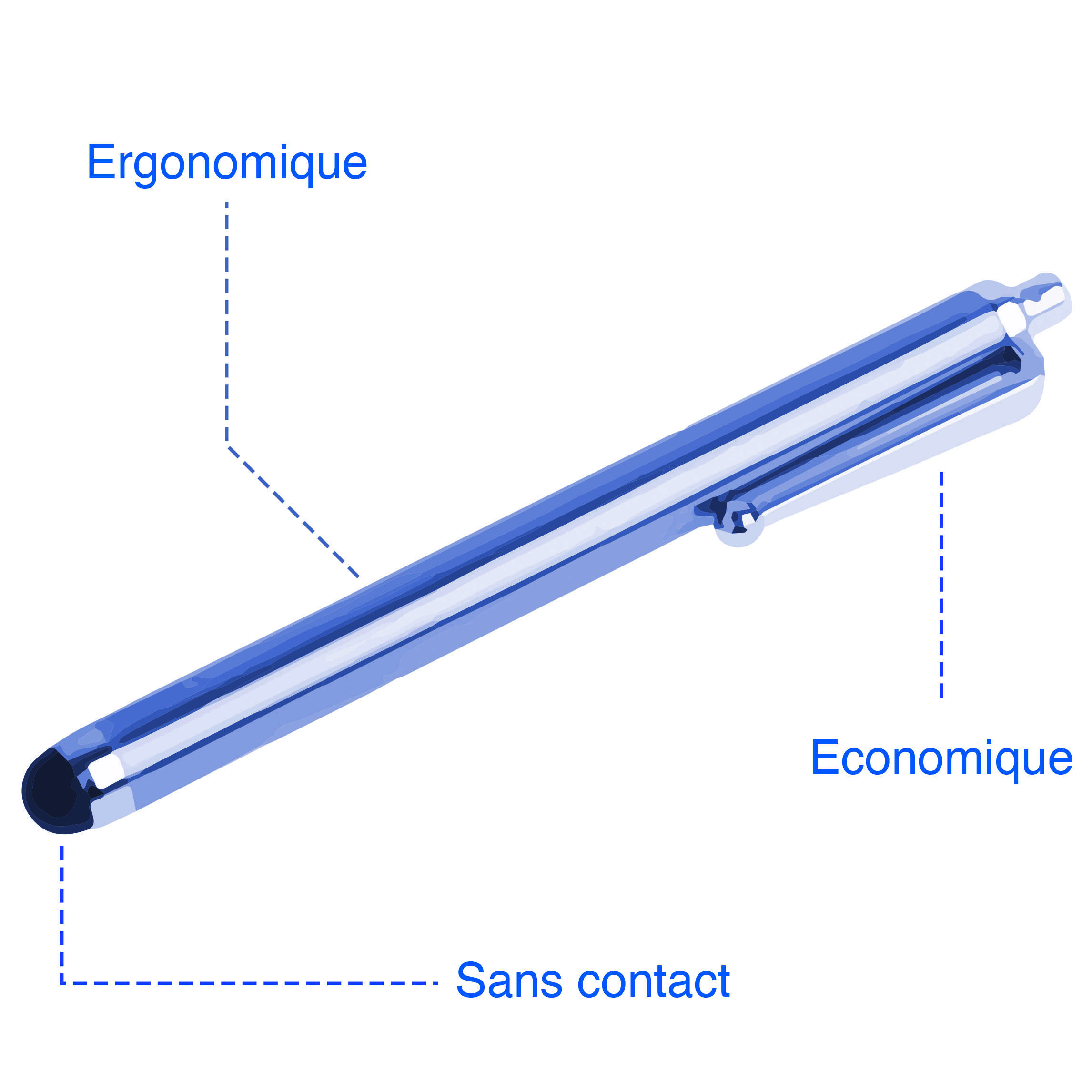
Ne pas toucher
S’adapter au moment de la réouverture, les projets déjà construits :
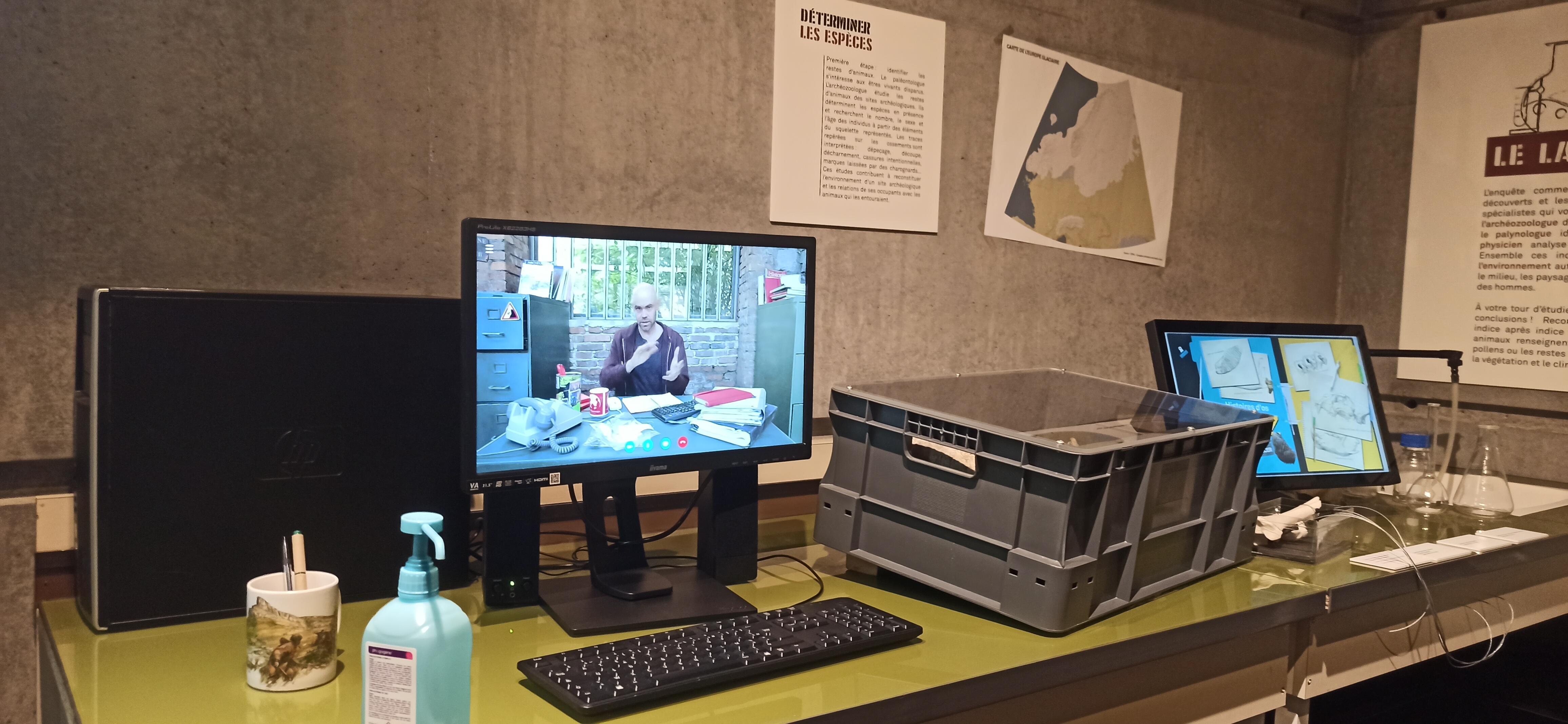

Exposition “Animaux disparus: enquête à l’âge de glace” - Musée départemental de Préhistoire de Solutré ©Juliette Dorn
Le nouvel accessoire indispensable ?
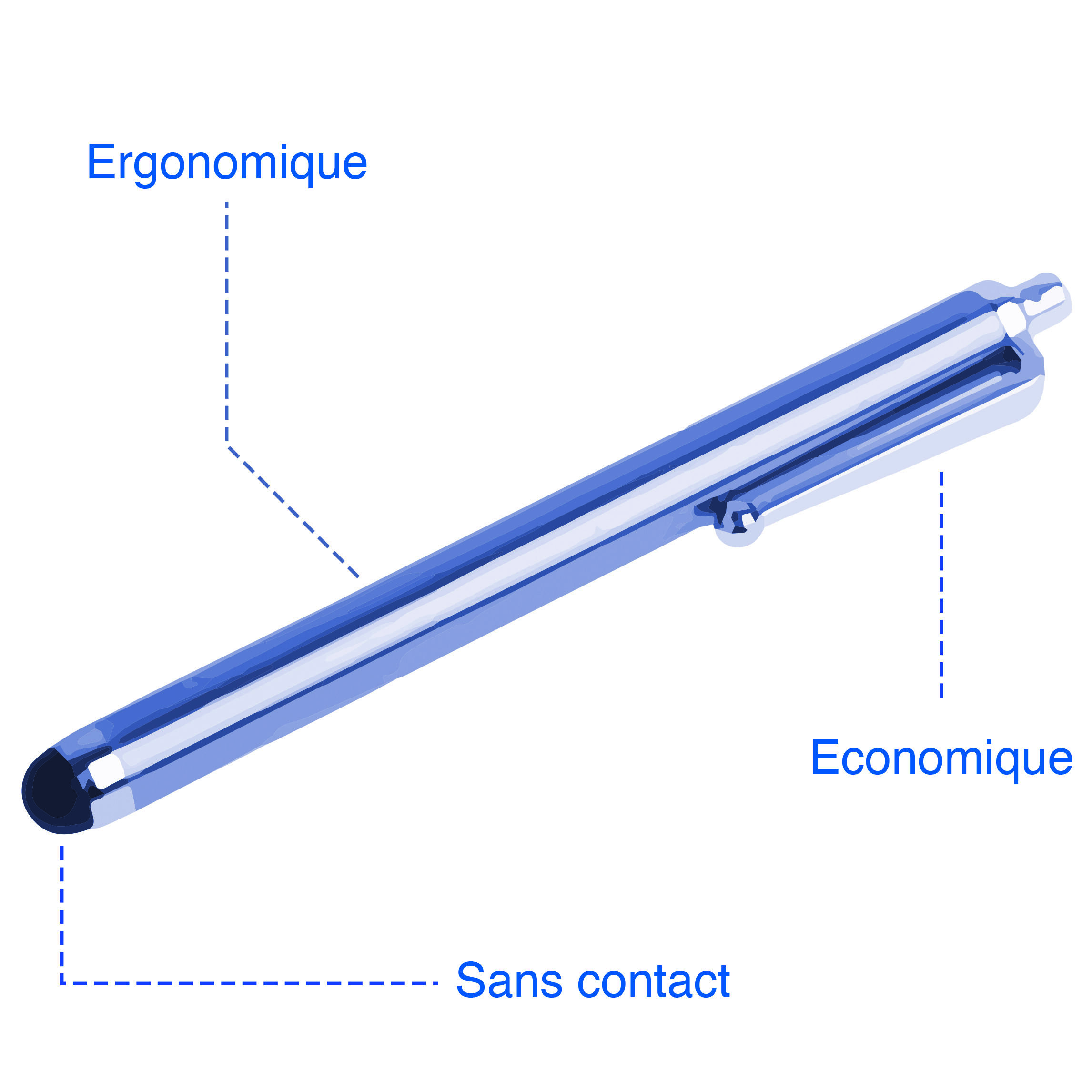
Illustration ©Juliette Dorn
Hors service


Pour des économies de stylet , ce pictogramme “toucher avec le coude” du plus bel effet à Citéco. Un exemple de dispositif sonore à Confluence et son étiquette “ne pas toucher”. photos ©Juliette Dorn



Panneaux de l’exposition “Tous super” ©Jérémy Antonio et Elodie Martini
Préparer une future réouverture : quel avenir pour les manips de contact?
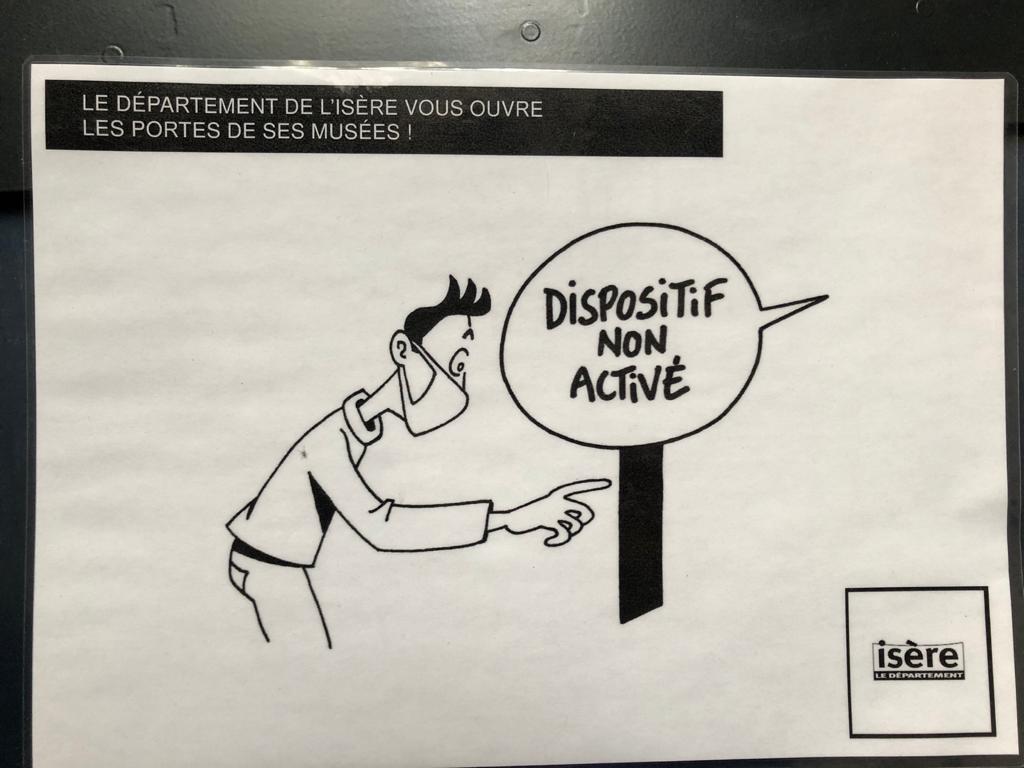

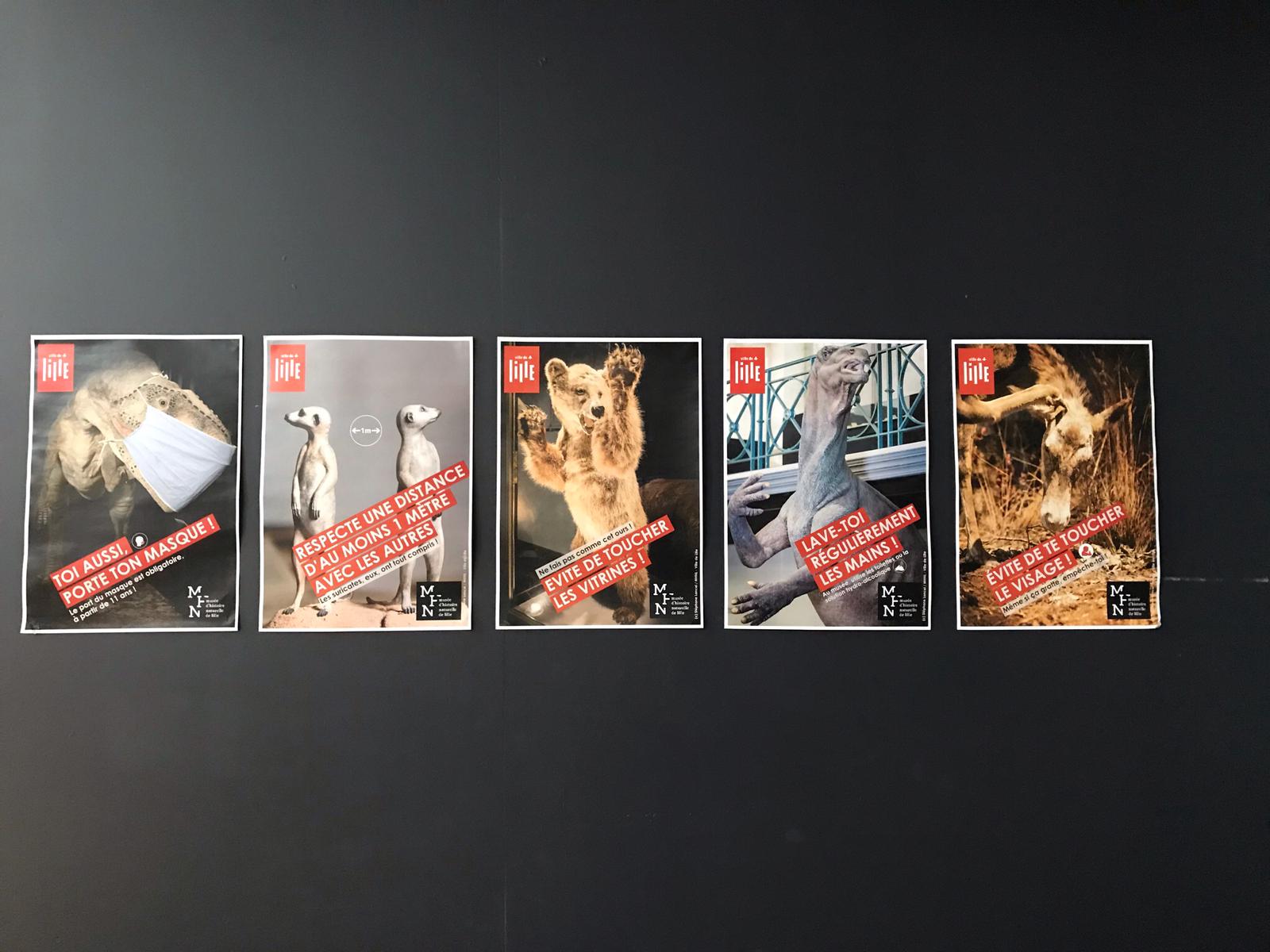
Pictogramme de mise hors service au Vaisseau ©Margot Coïc
Panneau dans les musées du département de l’Isère ©Charlène Paris
Affiches du protocole sanitaire du Muséum d’Histoire Naturelle de Lille ©Anaïs Verdoux
Pour aller plus loin :
- Quelques solutions pour les multimédias
- Une observation internationale des pratiques muséales post-confinement
- Démarche #Nepas d’Omer Pesquet

Nintendo voit double !
A l’instar des études comparatives des instituts de consommation, au banc d’essai aujourd’hui : la Nintendo 3DS ! Dans le cadre d’une exposition itinérante dont on soupçonne un profil quelque peu promotionnel, la console portable s’avère rejoindre les dispositifs d’exposition. Dans la catégorie Innovations Technologiques : quand un produit de consommation devient un moyen d’exposition…
©Arrêt sur l’Image Galerie-Canal Com
La firme japonaise de jeux vidéo a proposé à la célèbre agence de photographes Magnum de soumettre à trois non moins célèbres de ses membres l’expérimentation inédite de la console portable pour la capture de photos 3D. Après avoir été présentés à Paris et à Bordeaux, Lille accueille ces jours-ci les « clichés » de Martin Parr, Gueorgui Pinkhassov et Thomas Dworak.
La particularité de la console, véritable gadget d’innovation technologique, repose sur ses deux écrans dont un est tactile. Quant à l’effet 3D, il est obtenu grâce à l’intégration de trois appareils photo numériques : un, à l’intérieur et deux autres à l’extérieur. Hélas, solidement rivées à des socles-pupitres blancs et protégées par un plexiglas, les neuf consoles sont des objets faussement manipulables.
L’originalité muséographique de ce petit appareil est qu’il joue sur les deux plans : à la fois outil de création, il se métamorphose en outil de monstration, la diffusion des photos obtenues étant impossible sur tout autre support !
Nintendo précise, par ailleurs, que l’effet 3D est ajustable grâce à un petit curseur, permettant d’augmenter ou de diminuer l’effet « afin de trouver un niveau 3D qui convienne parfaitement à vos yeux ». C’est là que le bât blesse. Tout d’abord, ne pouvant accéder à la manipulation du dispositif d’exposition, le défilement des photos est arbitrairement programmé. Or, chaque photo requiert une distance et un temps d’adaptation à l’angle de vue.
De ce fait, on peut passer à côté de l’effet escompté au profit d’une vision floue voire d’un mal de crâne, l’exclusivité de la technologie sans lunettes reposant sur la seule capacité du cerveau à séparer puis reconstituer les images. On observe donc également que tout sujet n’est pas bon à photographier, la 3D n’a aucun intérêt pour certaines photos (le portrait, par exemple), à l’image de ces films 3D qui, effet de mode, n’étaient pas destinés à en être, mais qui sous la pression des producteurs furent retravaillés. Sur ce point, Martin Parr se démarque nettement car il semble s’être parfaitement approprier la technologie, ou alors sa rhétorique photographique et son style conviennent à la 3D…
Une fois que l’effet fonctionne, il devient plaisant d’observer toutes ces photos. Contrairement à la vision au travers de lunettes, la réalité obtenue n’est pas intrusive : l’image ne sort pas de son écran. Plus subtile, elle joue sur la profondeur (jusqu’à trois strates différentes). Pour les personnes qui ont des problèmes de vision, la petitesse de l’écran étant un handicap, il vaudra mieux pour elles se rabattre sur les traditionnels dioramas…
« Déclenchant » à cette occasion une nostalgie des view-master, ces visionneuses 3D stéréoscopes qui fonctionnaient avec des disquettes, on regrette également que la console ne soit en accès libre, non pas pour tester la fonction prise de vue mais bien pour prendre le temps de s’approprier chaque image exposée. Est-ce une volonté marketing ? Cet inconfort d’utilisation aura néanmoins engendré la défaillance de deux consoles lors de notre visite : la frustration de certains visiteurs-consommateurs a entraîné ces derniers à forcer le plexiglas pour essayer de contrôler le jouet ! La personne chargée d’accueillir et de faire la médiation s’est transformée, quant à elle, en intervenante-technicienne pour désamorcer les blocages!
Il s’agit, ici, seulement d’un avant-goût du potentiel muséographique du jouet. En l’occurrence, la console, objet attractif et ludique, n’a peut-être pas sa place en tant que socle mais elle possède la capacité de s’adapter à la médiation. Si le succès est au rendez-vous, il y a fort à parier que ce joujou entre directement en concurrence avec Apple au sein des musées : il est, en effet, prévu en Mars 2012 que le Louvre remplace ses audio guides avec ces consoles Nintendo 3DS. Affaire à suivre…
Aurélie Leclercq

Odyssée Sensorielle : expérience sensorielle, sensationnelle ou sensible ?
Après cinq années de préparation et de tournage dans le monde entier, l'Odyssée Sensorielle a ouvert ses portes en octobre aux jardins des plantes sous les espaces de la grande galerie de l’évolution. Annoncée comme une exposition-événement qui plonge le visiteur au cœur de la nature en éveillant ses sens, relève-t-elle de l'exposition ou seulement de l'expérience ?
intro : Salle « Évasion du Grand Nord » ©Aimé Sonveau
Attraction des nouvelles technologies
L’Odyssée Sensorielle a pour objectif de transporter le public dans un voyage au « cœur du monde vivant ». Le mot « cœur » est révélateur d’une volonté de jouer sur les émotions en mobilisant les sens plutôt qu’une volonté d’immersion totale jamais véritablement atteinte. Pour tenter d’y parvenir, les concepteurs associent au visuel sons et odeurs. Une promesse qui a le don d’attirer le public de tout horizon. Les images sont projetées sur des murs majestueux qui encerclent complètement ou en partie le visiteur.
Le parcours en huit salles montre les animaux, les insectes voire même les bactéries à l’état sauvage. En descendant sous la galerie de l’évolution vers l’Odyssée Sensorielle, deux textes invitent le visiteur à se laisser porter par ses sens pour faire place à son ressenti. La promesse est séduisante et attire sans aucun doute le public par son aspect inédit. Mais est-ce vraiment une exposition qui transmet des savoirs à son public ou plutôt un spectacle immersif qui donne à voir de belles images ?
Avant même d’entrer dans l’espace d'exposition, le visiteur fait face à une situation familière, celle de la file d’attente pour une attraction. La queue s’allonge tandis qu’un écran décompte les minutes avant le prochain « départ ». Mais de quel départ s’agit-il ? Celui du voyage sensoriel ou celui du dernier manège à la mode ?

Entrée de l’exposition ©Aimé Sonveau
Si la projection n’est plus si novatrice au vu des expositions « spectacles » comme celles de l’Atelier des Lumières, elle attire toujours de plus en plus le public avide de numérique. Bien plus que l’ambiance sonore qui reste elle aussi courante, le summum de la nouveauté réside dans le développement de fragrances qui s’associent aux images et au sons pour créer une ambiance totale. La promesse est plus ou moins tenue selon les salles. Sûrement parce que les odeurs plus subtiles du froid ou de l’air marin ne font pas le poids face aux masques qui couvrent le nez et la bouche de tous les visiteurs. à cela. s’ajoute un manque d’interaction avec le visiteur qui pourrait par exemple s’attendre à être écholocaliser par une chauve-souris dans la troisième salle.
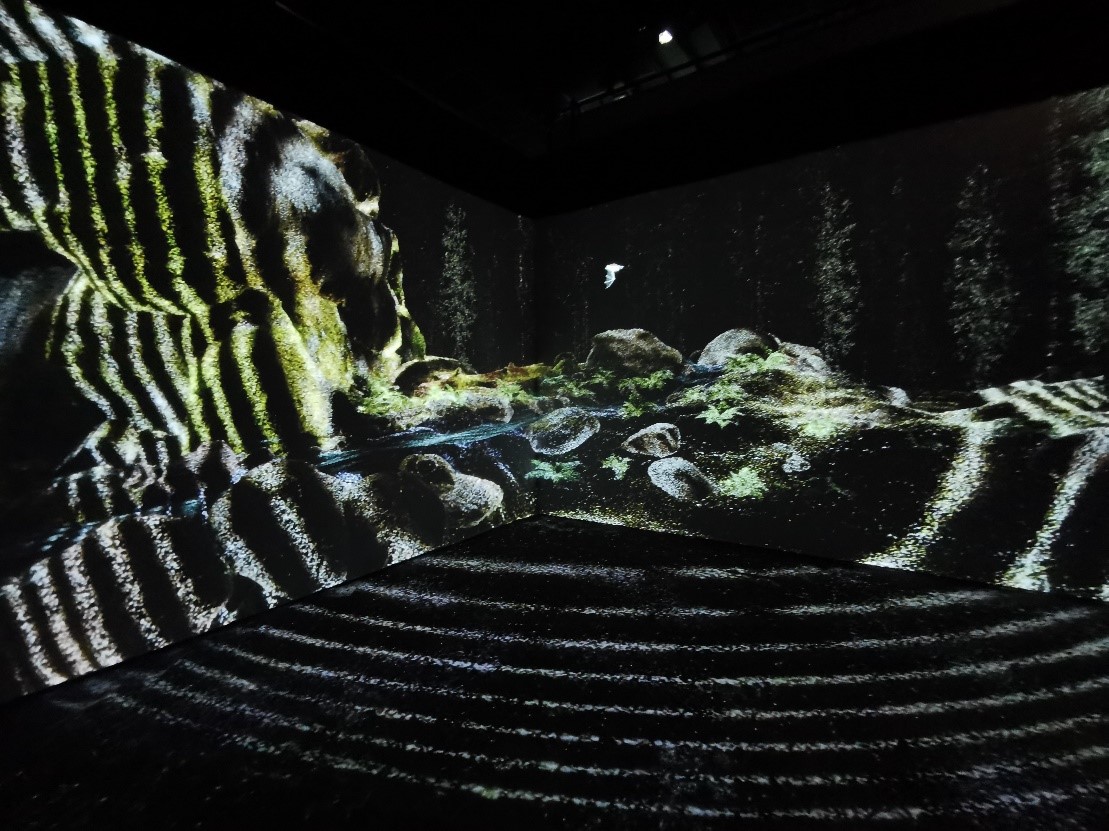
Salle « Sur la piste de l’écholocalisation » ©Aimé Sonveau
Au-delà de déceptions techniques, l’immersion dans la nature n’est pas totalement assurée par le visuel, notamment lorsque le visiteur se retrouve face à des insectes filmés sur fond noir plutôt que dans leur environnement naturel. En ces temps de surenchères techniques et technologiques pour rendre l’expérience de plus en plus esthétique et sensible, l’immersion semble un mode de communication privilégié, mais qu’apporte-t-il au propos de cette exposition et comment le conjuguer avec les autres partis pris ?
Ni textes, ni signalétiques ?
Le support textuel accompagne traditionnellement les expositions permettant ainsi de dérouler un discours scientifique, aborder un sujet selon un axe spécifique à l’exposition, questionner. À première vue, l’Odyssée Sensorielle abandonne les classiques textes de salles, cartels et éléments de signalétique. Ces derniers apparaissent parfois subtilement dans les projections telles que les lucioles qui se dirigent toutes vers la suite du parcours. Finalement le visiteur découvre en fin de parcours que l’ensemble des supports de textes sont rassemblés dans la salle qui évoque le voyage. Pour autant, l’absence de texte est-il synonyme d’absence de propos ?

Salle « L’océan, du récif corallien à la pleine mer » ©Aimé Sonveau
Si le propos n’est pas explicité par des textes de salle ou des cartels, il apparaît en partie à travers l’expérience même. Lorsque le texte d’introduction assure que « l’essentiel est perceptible par [n]os sens », le visiteur est invité à se faire confiance, à faire confiance à son instinct (animal). Il peut comprendre beaucoup sans forcément que ce soit dit et le dispositif mise sur les observations du visiteur tout en faisant naître la curiosité. L'esthétisation de la nature à travers les prises de vue tend à effacer l’urgence climatique dans laquelle nous sommes. Seuls les plus observateurs le remarquent avec la couche que porte un cachalot dans sa mâchoire ou lorsque, dérivant sur des morceaux de banquise, le public voit, entend et ressent chaque vibration de la glace qui s’effondre. À l’inverse des expositions traditionnelles où le visiteur est bombardé d’informations à chaque salle, ici l’information se fait attendre. L’homme veut ce qu’il n’a pas. L’absence de texte a donc deux effets : celui de ne pas déranger l’expérience sensorielle du visiteur mais aussi de faire naître sa curiosité. Sensible aux images et aux ambiances face auxquelles il s’émerveille, des questions émergent tôt ou tard durant l’expérience : quel est cet animal ? Pourquoi a-t-il ce comportement ? Où vit-il exactement ?
Retour d’exploration

Salle « Retour d’exploration » ©Aimé Sonveau
Les observations et les questions qui ont pu naître durant l’expérience trouvent réponses dans la salle Retour d’exploration qui clôture l’exposition. Elle concentre les textes de salles, les cartes indiquant où les images ont été filmés, les noms des animaux que le visiteur a pu observer. Si tout est rassemblé dans une même et unique salle, cela reste néanmoins lisible grâce à la fresque qui orne les murs et le jeu de lumière qui compartimente chaque partie de cette fresque.
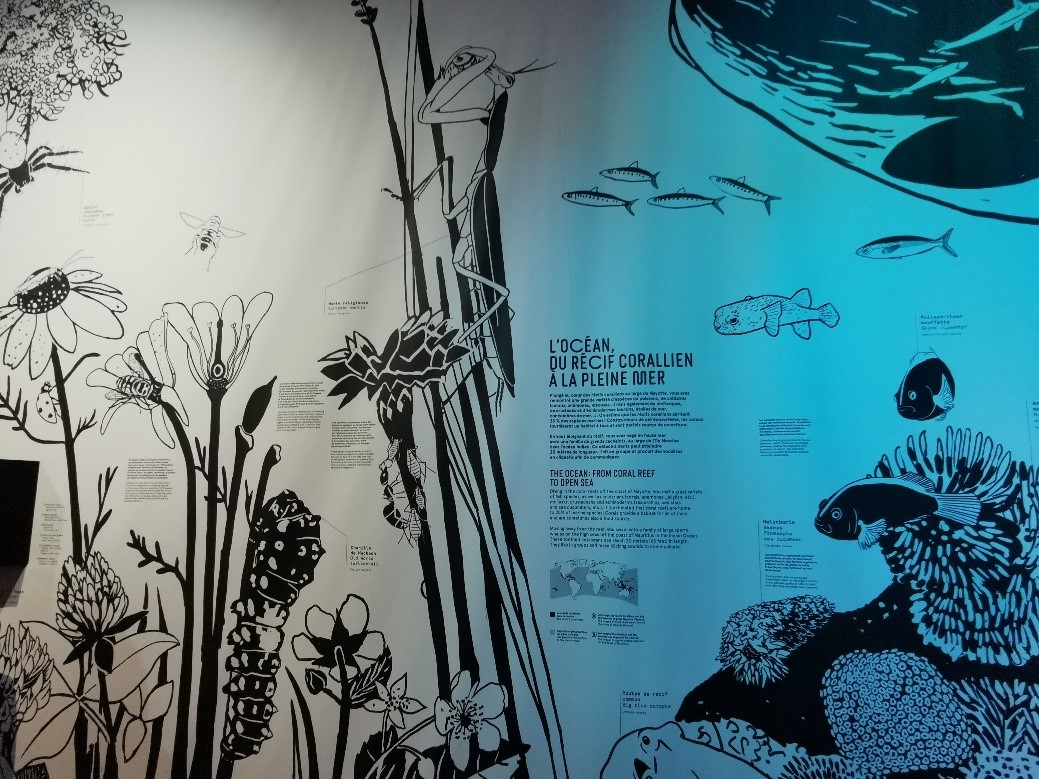
Salle « Retour d’exploration » ©Aimé Sonveau
Cette concentration d’informations dans la salle « Retour d’exploration » s’inscrit dans la continuité de l’immersion sensorielle puisqu’elle permet au public de continuer ses observations. Il y a très peu de chances que le visiteur lise tout mais il peut piocher ce qui l’intéresse.
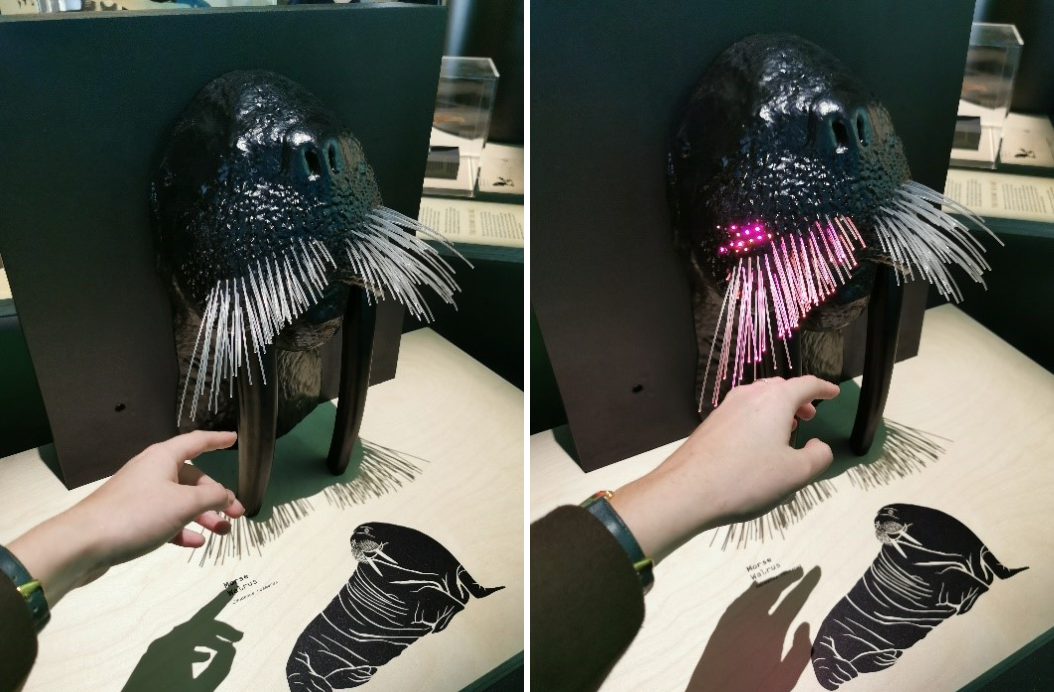
Salle « Retour d’exploration » ©Aimé Sonveau
Après l’expérience sensorielle, le visiteur peut ici faire l’expérience des sens du monde animalier. Au centre, une table propose de nombreux dispositifs permettant de découvrir comment voient, entendent, sentent, et ressentent les animaux croisés au cours de la visite. Ci-dessus, les moustaches du morse s’illuminent lorsqu'il détecte un objet devant lui. La sensibilité de l’animal est ainsi matérialisée et rendue visible.
L’Odyssée Sensorielle reste une exposition. La connaissance est transmise d’un point de vue sensible dans un premier temps à travers l’expérience immersive. Puis elle est offerte en fin de parcours dans un format plus classique de textes dans la salle Retour d’exploration. Cette dissociation de « l’œuvre multimédia » et du propos laisse la place à l’émotionnel. Susciter l’émotion chez le visiteur le rend plus curieux et disposé à aller chercher les informations mis à sa disposition. Le dispositif numérique prend alors tout son sens.
Aimé Sonveau
Pour aller plus loin :
#ExpositionImmersive #Sensorielle #JardinDesPlantes
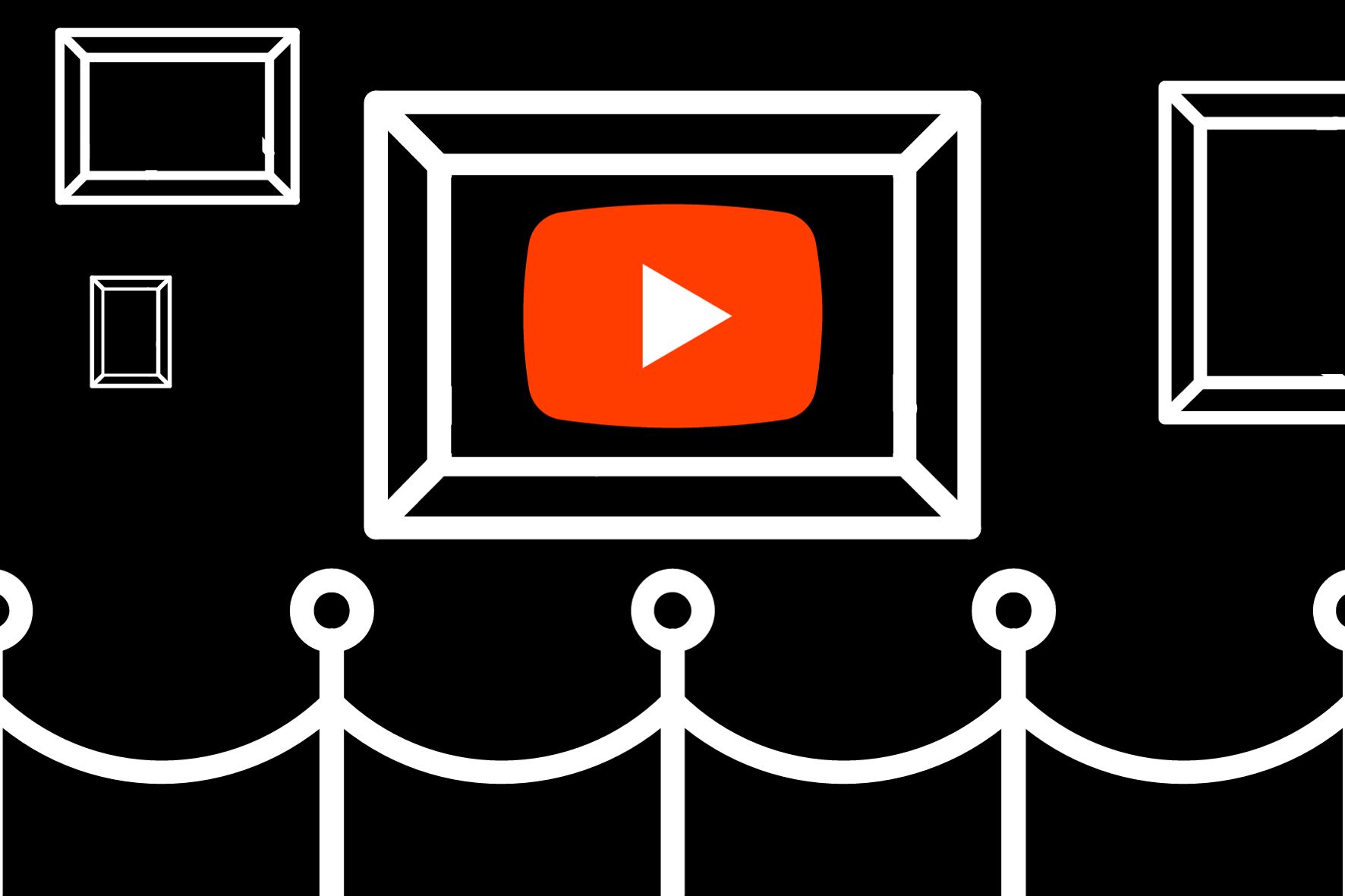
Où sont les musées sur Youtube ?
L'art, l'histoire et la culture sont-ils vraiment à portée de clic ? Partons à la découverte de quelques initiatives !
Youtube en quelques chiffres :
- YouTube est le 2eme site le plus visité au monde derrière Google.
- 40 millions de Français utilisent YouTube chaque mois.
- YouTube Shorts enregistre 50 milliards de vues par jour dans le monde.
- En moyenne, les utilisateurs de YouTube y passent 27h26 par mois, ce qui en fait la 2eme plateforme sociale en termes de temps passé par mois, derrière TikTok (33h38).
- Les 15-24 ans passent 1h08 par jour en moyenne sur YouTube.
Emma Levy
Pour en savoir plus :
- Appoline Reisacher, Chiffres YouTube : les statistiques à connaître en 2023, 13 novembre 2023

Patrimoine en danger oui, mais n’oublions pas les humains !
Palmyre est sûrement l’un des exemples les plus emblématiques et médiatisés des destructions de sites antiques par l’Etat islamique. C’est à travers des recherches sur ce sujet qui m’intriguait autant qu’il m’attristait, que j’ai été amenée à comprendre les enjeux géopolitiques et la complexité de la situation en Syrie.
Pour vous remettre rapidement en tête les évènements qui ont eu lieu, voici un court récapitulatif de la situation depuis 2015.
Le site antique de Palmyre et sa ville moderne, Tadmor, sont devenus depuis mai 2015 le décor d’une bataille impliquant le régime syrien de Bachar El-Assad, Daech et l’Occident.
La première bataille entre le régime syrien de Bachar El-Assad et les djihadistes de Daech prend fin lorsque l’Etat islamique prend le contrôle de Palmyre, le 21 mai 2015. Dès lors, plusieurs éléments du site sont détruits au cours des mois : deux mausolées antiques, la statue du Lion d’Athéna… Des vidéos de ces destructions sont mises en ligne sur Internet. En parallèle, le site entier a été miné par les djihadistes.
Fin août 2015 marque une périodede destructions massives avec la destruction du temple de Baalshamin, du temple de Bel, ainsi que de sept tours funéraires. Puis c’est le tour de l’Arctriomphal et de quelques colonnes, vestiges qui, au contraire des temples, n’avaient aucune connotation religieuse. Mais lors de cette première bataille de Palmyre, il n’y a pas que le patrimoine qui est détruit : 25 soldats syriens sont exécutés dans l'amphithéâtre de la cité antique et Khaled Assad, ancien directeur des antiquités et des musées de Palmyre, est décapité. Le site reste aux mains des djihadistes près de dix mois jusqu’au 27 mars, lorsqu’après 20 jours de combat Palmyre est reprise par le régime de Bachar El-Assad. On croyait le site de Palmyre « sauvé » mais Tadmor et le site sont repris par Daesh le 11 décembre 2016.
11 décembre 2016 – soit trois jours avant l’ouverture de l’exposition « Sites éternels - de Bâmiyân à Palmyre » auGrand Palais à Paris. Je me suis donc précipitée pour voir cette exposition, qui n’a duré qu’un mois (du 14 décembre 2016 au 9 janvier 2017).
Rendre compte de la situation de péril de ces sites est essentiel. C’est un sujet actuel, un sujet sensible et il est importantque ce patrimoine de l’humanité soit accessible à tous. J’en profite d’ailleurs pour souligner et approuver la gratuité de cette exposition, bien que celle-ci soit d’une durée très limitée, ainsi que sa mise en place grâce à la collaboration entre le Louvre et le Grand Palais et avec l’aide de Iconem, start-up française qui numérise le patrimoine grâce à des drones.
On ne peut faire abstraction de ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce fut cependant le cas dans l’exposition Mésopotamie du Louvre-Lens, où n’est évoquée à aucun moment la situation actuelle du Proche Orient, bien que le musée soit réquisitionné pour accueillir les œuvres en péril provenant de cette partie du monde….

Carte 1 : les sites du Patrimoine mondial culturelde l’UNESCO (814 sites récences en 2016)

Carte 2 : parmi ces sites, 37 sont actuellementen péril mondial selon l' Article 11(4) de la Convention[1]
L’exposition commence par un sas sombre avec une première projection qui indique les emplacements des sites du patrimoine mondial culturel puis plus particulièrement des sites en périls dans le monde. Puis sont présentés les quatre sites de l’exposition : Khorsabad, Palmyre, la Grande Mosquée des Omeyyades de Damas et le Krak des Chevaliers. Sur le mur de droite, est expliqué très simplement et rapidement la situation actuelle de ces sites, l’engagement de la France et de l’UNESCO dans la sauvegarde de ce patrimoine. C’est ici, que l’on trouve la seule allusion aux êtres humains avec une évocation des djihadistes et leurs destructions, appuyer par une vidéo d’explosion et de destruction diffusées par Daesh.
Si cette exposition a déjà le mérite d’exister, je trouve néanmoins que l’accent n’a pas assez été mis sur les conditions géopolitiques actuelles en Irak et en Syrie. Penser au patrimoine, c’est une chose, essentielle certes, mais n’oublions pas les humains. Pourquoi l’Etat islamique détruit ces sites ? Comment ces sites sont-ils instrumentalisés aussi bien par Daech que par les régimes en place ? Ne doit-on pas au minimum évoquer aussi les civils qui souffrent et meurent dans cette partie du monde ?
Quel intérêt pour l’Etat islamique de détruire ces sites ?
Pour Daech, seul le présent compte et cequi est antique et surtout tout ce qui est antérieur aux fondements de leur idéologie religieuse exclusive est considéré comme impur et donc doit être détruit. L’Etat Islamique dispose même d’une unité spéciale, appelée Kata’ibTaswiyya, qui a pour mission cette destruction du patrimoine culturel. Ils connaissent la valeur de ce patrimoine : la revente d’œuvres archéologiques sur le marché noir est la principale source de financement des terroristes, après le pétrole.[2]
De plus, en faisant des ruines de Palmyre un usage politique, Daech augmente encore sa présence médiatique et son audience auprès de la communauté internationale et occidentale et ainsi cherche à provoquer afin internationaliser le conflit.
Daech n’est pas seul à utiliser Palmyre comme atout politique et symbolique. Il en va de même pour le régime de Bachar El-Assad qui utilise la reprise de Palmyre du 27 mars 2016 pour améliorer son image sur la scène internationale, se montrant comme allié de l’occident dans la lutte contre le terrorisme. Il ne faut cependant pas oublier que Bachar El-Assad est le leader d’un régime autoritaire, responsable de la mort et de l’emprisonnement de milliers de personnes en Syrie.
Bachar El-Assad utilise également la reprise de Palmyre afinde montrer son implication dans la sauvegarde du patrimoine syrien et de l’humanité, auprès de l’Occident. Cependant, une fois encore, le régime de El-Assad n’est pas irrépréhensible dans la destruction de Palmyre. En effet certaines parties du site, telle que la partie sud-est de la nécropole, auraient été pillées par le régime syrien, en 2014, soit avant l’arrivée de Daech sur le site, lorsque Bachar El-Assad a repris Palmyre aux rebelles[3].
Je comprends que ce soit diplomatiquement compliqué à assumer pour un musée national mais tout de même, ne pas expliquer le pourquoi du comment de la situation qui amène à la destruction de ces sites est pour moi une erreur. Comment sensibiliser le grand public à la sauvegarde du patrimoine mondial si on omet les causes ?
N’est-ce pas le rôle du musée du XXIème de s’engager ?
Si je critique ce « manque d’humains » dans l’exposition, c’est parce que ce sujet me tient très à cœur et j’attendais de cette exposition de me donner de nouveaux éléments de compréhension de la situation. Malheureusement, ce ne fut pas le cas.

Projection des vestiges détruits de Palmyre, l’Arc triomphal©Méline Sannicolo
Cependant pour terminer, j’ai tout de même trouvé admirable la prouesse technologique et la scénographie de la salle principale de l’exposition, crée par Sylvain Roc et Nicolas Groult. La salle est composée de deux rangés de colonnes. Quatre fausses colonnes antiques à tambours ont été montées et sur chacune est racontée l’histoire d’un des sites. Quatre autres colonnes, incomplètes moins hautes présentent des objets. Au sol les ronds beiges incrustés dans la moquette rendent compte des colonnes manquantes. Les scénographes ont ainsi souhaité reconstituer un temple et nous plonger dans le cœur des sites antiques.
La technologie immersive est captivante : avec ses projections sur les quatre murs nous entourant. Chaque site est présenté en image, combinant dessins ; plans d’architecture ; photographies d’archives, images de synthèse et pour finir lesmodélisations 3D qui transportent un instant au Moyen Orient. Les images des sites actuels montrent à la fois l’état des sites avant et après les destructions qu’elles ont pu subir. Ces images sont si imposantes, si hautes, que nous sommes comme écrasés par le poids du patrimoine de l’humanité, face auquel nous sommes bien peu de chose. L’immersion est complétée par la diffusion de musique orientale.

Projection des vestiges détruits dePalmyre©Méline Sannicolo
Cette exposition est une belle opportunitépour voir ces sites en « grandeur nature », c’est très impressionnantet bien réalisé. Le patrimoine y est bien présenté et permet de rendre compte de l’importance de ces vestiges, cependant un peu d’explication sur la situation géopolitique et les hommes acteurs de la destruction aurait été la bienvenue.
Méline Sannicolo
[1] « Biens du patrimoine culturel et naturel qui sont menacés de dangers graves et précis, tels que la menace de disparition due à une dégradation accélérée, […]; l'abandon pour des raisons quelconques ; un conflit armé venant ou menaçant d'éclater ; les calamités et cataclysmes […]. Le Comité peut, à tout moment, en cas d'urgence, procéder à une nouvelle inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate. ».
[2] Eugènie Bastié. D'Hatra à Palmyre, les destructionsdes sites antiques par Daech continuent [en ligne]. Le Figaro, publié le31/08/2015.
[3] Maurice Sartredans l’émission de Jean Lebrun. Palmyre, Venise des sables sur France Inter, le5 avril 2015.

Pied-il ? Vos pas au musée...
Les musées investissent de plus souvent dans des outils de médiations mobilisant les sens : odorat, ouïe, vue, toucher. Des artefacts sont reproduits pour permettre au public de créer un lien avec l’objet, découvrir un de ses aspects, ses détails, de véritables outils
peuvent même parfois être touchés et les manipes manuelles connaissent un grand succès en particulier dans les musées scientifiques. Mais les mains peuvent être porteuses de germes et rendre frileux les musées à la suite de la covid 19. Quand est-il de leurs cousins, les pieds ? Souffre-douleur des visites muséales, peuvent-ils devenir des alliés ?
Marcher dans l’art
Certaines œuvres d’art demandent un engagement du corps : en jouant avec la sensibilité des pieds, premiers explorateurs du monde physique, l’artiste imprime son œuvre à travers la peau du visiteur.
Au Japon notamment, enlever ses chaussures relève d’une pratique culturelle, de respect et de politesse, pour éviter de salir les sols et de marquer la différence entre l’intérieur et l’extérieur. Au musée d’art de Teshima sur l’île de Taoshima, l’île musée du Japon, cette séparation intérieur / extérieur est floutée par l’œuvre permanente Matrix de Rei Naito, créée en 2010. Dans ce bâtiment en forme de goutte, le visiteur déchaussé entre dans un dôme blanc ouvert sur le ciel et évite les gouttes d’eau apparaissant sur le sol lisse légèrement pentue. Le silence du lieu est rempli par le chant calme de la nature et les gouttes d’eau qui ruissellent, grossissent, finissent en flaques et disparaissent. L’espace invite à déambuler, laisser les gouttes vivre, méditer, se reposer. L’apaisement et la proximité avec l’instant présent s’installent. La séparation intérieur / extérieur n’existe plus.

© Licence creative commons, Matrix by Ryue Nishiazwa in Teshima Art Museum, Taoshima, 12 mars 2011
Les membres de TeamLab Planets et TeamLab Borderless de Tokyo vont encore plus loin dans les sensations décuplées par nos voûtes plantaires. Nouveau musée d’art numérique faisant intervenir le corps dans l’art, leurs dispositifs sont plébiscités par le public connecté et leurs réseaux sociaux. Les salles sont des œuvres digitales interactives géantes réalisées par différents artistes où ni chaussures ni chaussettes sont les bienvenues.
Au TeamLab Planets basé à Toyosu Tokyo, tantôt, une pièce est recouverte du sol au plafond de coussins rebondissants, tantôt, elle est remplie de centaines de guirlandes lumineuses se reflétant dans les miroirs recouvrant la salle. Entre les moments d’euphories et d’émerveillements, les pieds traversent de longs couloirs sombres et noirs les préparant aux prochaines sensations. Peu à peu, un pédiluve incontournable apparaît, et plus loin, l’eau commence à monter. Il faut relever ses vêtements au-dessus des genoux. L’eau blanchâtre est trouble : le dégoût d’imaginer les objets flottants provenant des milliers de participants journaliers est balayé par un savant spectacle. Des carpes stylisées et multicolores tournent autour des individus, explosent en fleurs de cerisier s’ils osent passer sur une carpe, le tout en rythme sur des compositions sonores originales. À la sortie, des agents veillent à donner des serviettes individuelles. Des bancs permettent de se sécher et de lire pour les rares curieux le cartel explicatif, toujours exposés après l’expérience.
Contrairement à Teshima, où une place est faite à la nature, à la médiation et où les photos sont interdites, depuis 2018, TeamLab Borderless à Tokyo exploite le numérique et sa force visuelle engloutit les réseaux. L’usage du corps devient sensationnel. Les espaces de calme où sont exposés les uniques outils de médiations que sont les cartels, sont disponibles entre chaque salle, mais voient surtout passer à la chaîne des visiteurs notifiant peu les cartels. Visiter Teamlab demande de réserver des jours en avance : ce succès économique et médiatique montre l’appétit du public pour l’interactivité et l’usage du corps, quoi qu’il touche. Cependant, le manque de médiation et d’information concernant la collecte, la conservation et l’interprétation de ce nouveau patrimoine numérique ne permet pas encore de classer ce lieu parmi les musées au sens de l’ICOM.

© Tiphaine Schriver, Teamlab Planets, Tokyo, mai 2024
En Europe, le centre d’architecture danois a réussi à marier l’aspect méditatif, sensible et pédagogique des sensations plantaires avec son exposition Irreplaceable landscapes de 2019 dédiée à quatre projets d’architecture sur des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. En marchant déchaussé sur la reproduction échelle 1 d’une partie d’un toit en paille, le visiteur ressentait à travers son corps la fragilité et la puissante de ces sites, traduire dans cette architecture. En marchant ou en s’allongeant sur ce toit, le piquant et la résistance des milliers de pailles rassemblés se ressentait à travers les vêtements. Des projections des paysages de la mer du Nord, des sons d’oiseaux et de vagues étaient diffusées tout autour.

© Rasmus Hjortshøj, Irreplaceable Landscapes, Dansk Arkitektur Center, Copenhague, 2019
Les bâtiments muséaux sont eux-mêmes des œuvres, des terrains à découvrir déchaussés. Noémie Boudet analysait en 2012 les visites guidées pieds-nus multisensorielles de la piscine de Roubaix. Ces visites offrent le temps “d’apprécier la texture du sol, la différence de température” et sont un “prétexte pour découvrir La Piscine et son [1]”. A première vue déconcertantes, ces visites jouant avec les sens et menées par des professionnels convainquent même les plus réfractaires. Treize années après, le succès des médiations de la Piscine ne sont plus à prouver.
Le sol : un terrain pour l’apprentissage
La scénographie, porteuse de sens, peut s’amuser à enrichir le discours muséographie en travaillant les sols.
La première salle du Musérial au Fort des Dunes à Dunkerque projette un court-métrage sur l’histoire de la mer du Nord. Surprise : le sol de la salle, d’une matière proche des sols amortissants de parc pour enfants, a les courbes de dunes, comme si le visiteur était sur le bord de la mer. Le sol est mou, couleur sable. Chaque petite dune peut devenir une assise et des bancs sont installés. Pour les visiteurs arrivés au musérial depuis la terre, cela permet de localiser le musée sur son littoral et de donner un contexte.
Au musée Moesgård, situé à Aarhus au Danemark, l’espace est consacré à la période historique de 500 av. n. è. et 800 de n. è., raconte les perturbations du mauvais temps sur l’agriculture et les paysages danois. Cet espace symbolise également une tourbière. Les pieds s’enfoncent de quelques centimètres, l’équilibre est vite retrouvé, et les visiteurs comprennent que les objets qui les entourent ont été retrouvés dans cette terre, alors gorgée d’eau et difficilement exploitable. Au centre, la tourbière révèle le corps momifié de l’Homme de Grauballe, le corps des tourbières le mieux conservé au monde grâce à la composition de sa terre.
Enfin, le sol peut faire vivre des expériences et apprendre. SPARKOH !, musée descience à Mons en Belgique a une plaque vibrante sur laquelle il faut se mettre debout pour ressentir des séismes de plus en plus fort. Au 30ème anniversaire de la Maison de la Brique à Saint-Martin-d’Aubigny, un parcours sensoriel extérieur invitait à se déchausser pour reproduire le “marchage”, une technique ouvrière passée. En foulant les pierres, l’eau s’imprégnait de manière homogène dans la fosse de pourrissage. Grands et petits foulaient sur la fosse différents matériaux de l’univers de la brique, découvraient ce lieu et cette
technique, le tout, en un parcours sensoriel et pédagogique. Un sentier similaire de 1600
mètres a été développé au Préhistomuseum de Flémalle, en Belgique. Le parcours pieds nus situé dans la forêt déjà très apprécié des visiteurs a été complété en 2023 de 17 expériences sensorielles telles que marcher sur différents matériaux naturels, écouter le vent secouant les feuilles, sentir les plantes, raconter des histoires sur l’origine de la Terre...
Le sens de la marche
Employer le pas et le pied de manière différente de leur fonction habituelle de déplacement dans une exposition peut donc se révéler porteur de sens, émerveiller et redynamiser la visite. Dans ces exemples, l’expérience du sol est profondément liée à l’environnement naturel et permet de renouer avec la sensibilité de cette partie du corps qui nous relie à la Terre.
Un contre-exemple, peut-être révélateur de l’efficacité du lien pied / nature, et de l’importance de l’objectif artistique ou pédagogique de son usage, est celui de la Villa Carmignac, à Porquerolles, en France. L’exposition intérieure se visite pieds nus. Le but : créer une proximité et être plus détendu selon le directeur. Initiative originale et amusante au début, cela ne suffit tout de même pas à combler la distance entre le visiteur et les œuvres contemporaines. Les longs cartels, le manque de bancs pour profiter des vues sur le jardin, et le nombre de médiateurs, bienveillants, aussi nombreux que les visiteurs une après-midi de vacances scolaires, n’aident pas. La pierre fraîche du sol reste lisse et monochrome tout au long du parcours intérieur. A son terme, il n’y a plus qu’à remettre ses chaussures.

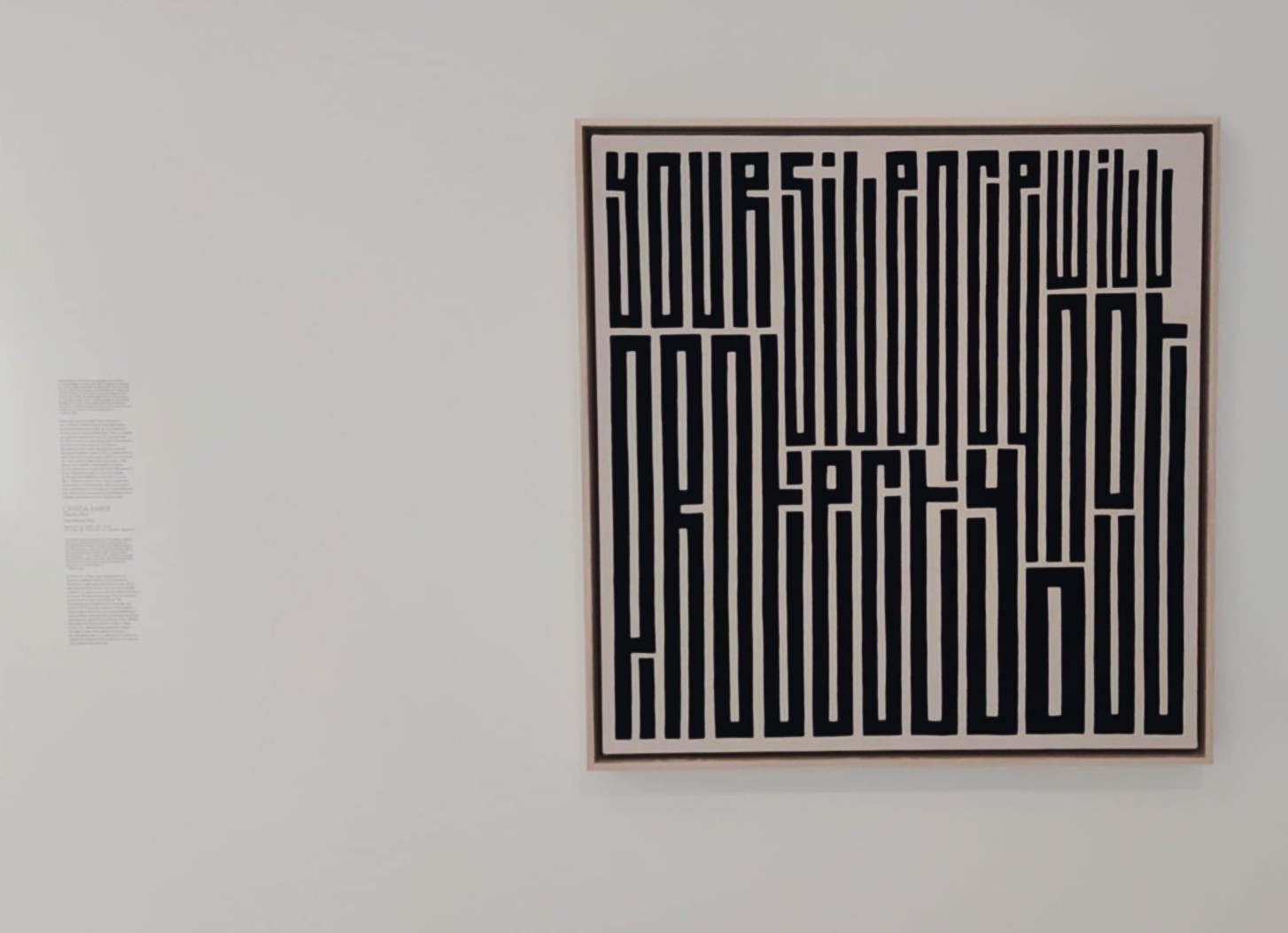

© Tiphaine Schriver, Exposition The Infinite Woman, Villa Carmignac, Porquerolles, octobre
2024
Tiphaine Schriver
[1]Voir l’article “La Piscine, championne de médiation”, rédigé par Noémie Boudet, publié le 28 octobre 2012, sur le blog L’art de Muser ↩
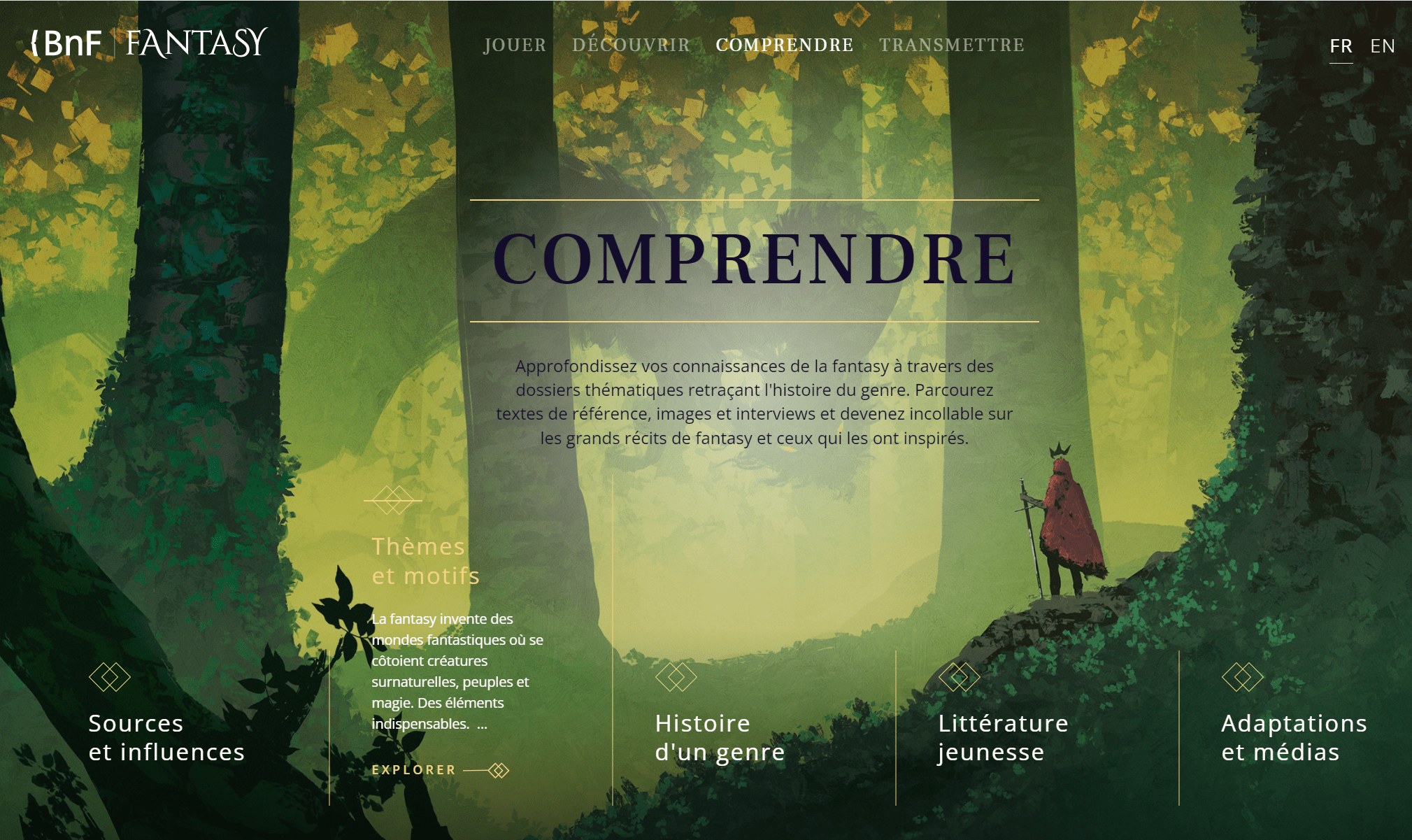
Pourquoi créer des expositions virtuelles ?
Depuis les premières expositions numériques, les Éditions multimédias de la BnF ont pour double objectif d’augmenter son audience en multipliant les canaux par lesquels les collections sont diffusées, et de proposer une version plus pérenne de ses expositions temporelles in situ. Alors que Gallica apparaît en 1997, les expositions virtuelles ne constituent pas une simple mise en ligne des collections, mais proposent un point de vue, un propos sur les ressources de l’institution.
Image d'intro : Capture d’écran de « Fantasy, retour aux sources » © Anato Finnstark, BnF / Éditions Multimédias
Dans un article sur l’histoire des expositions virtuelles de la BnF, Arnaud Laborderie met en lumière deux périodes qui montrent une évolution profonde de ces éditions numériques. De 1997 à 2017, le propos muséographique est axé principalement autour de la valorisation des collections et des contenus scientifiques. A partir de 2017, les Éditions multimédias de la BnF ont cherché à répondre aux besoins et usages des usagers en terme d’expérience utilisateur. « Il s’agit d’un changement d’approche : en plaçant le visiteur au centre du processus de conception, on passe d’une logique de collection à une logique d’usage. C’est un renversement de perspective pour un site web qui n’est plus conçu en fonction des contenus que l’on voudrait développer mais en fonction des usages que l’on souhaiterait proposer à l’utilisateur » (Arnaud Laborderie, 2020, p.6). Certaines caractéristiques des expositions virtuelles restent cependant des invariants, notamment la volonté de s’adresser à un public enseignant, en proposant une variété de supports pédagogiques, et ce même si les derniers sites créés par l’institution visent un public plus large.
Comment se visite une exposition virtuelle de la BnF ?
Au-delà de leur évolution chronologique, les expositions virtuelles proposées par la BnF sont variées et induisent des comportements différents de la part des usagers. Certaines approches peuvent parfois s’hybrider au sein d’un même site-exposition. Parcourons leurs atouts et leurs inconvénients...
Suivre jusqu’au bout le parcours d’un catalogue-exposition :
Certaines expositions numériques se présentent sous la forme d’une transposition numérique d’un parcours d’exposition physique. Ce « double numérique » peut avoir été retravaillé, mais il propose un parcours linéaire, avec un découpage clair en séquences (« en images »), des galeries d’images, ainsi que des extraits illustrés du catalogue (« arrêt sur... »), des focus sur certains thèmes de l’exposition (« gros plans ») et des éléments de repères à destination des publics scolaires comme une chronologie, des notions clés…
Avec « L’art du livre arabe » (2001), transposition numérique d’une exposition présentée à la BnF en 2001-2002, le propos scientifique est mis en avant par un parcours se voulant à la fois accessible et complet. Le site se consulte de façon linéaire en suivant le défilement latéral ou en faisant des pas de côtés grâce aux hyperliens renvoyant à d’autres ressources du site.
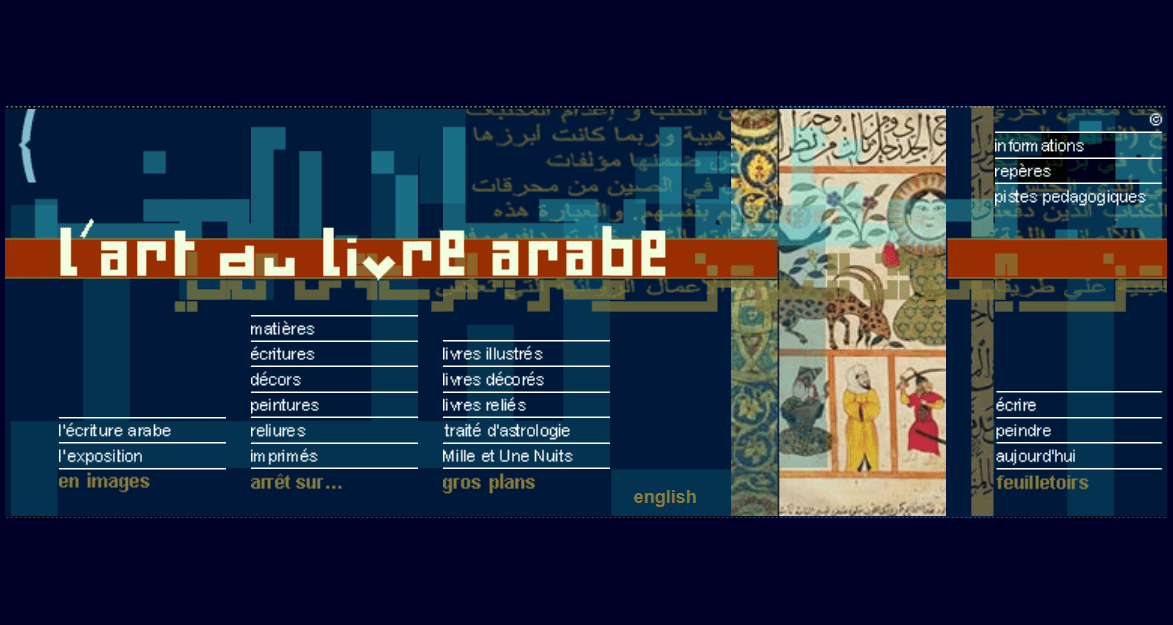
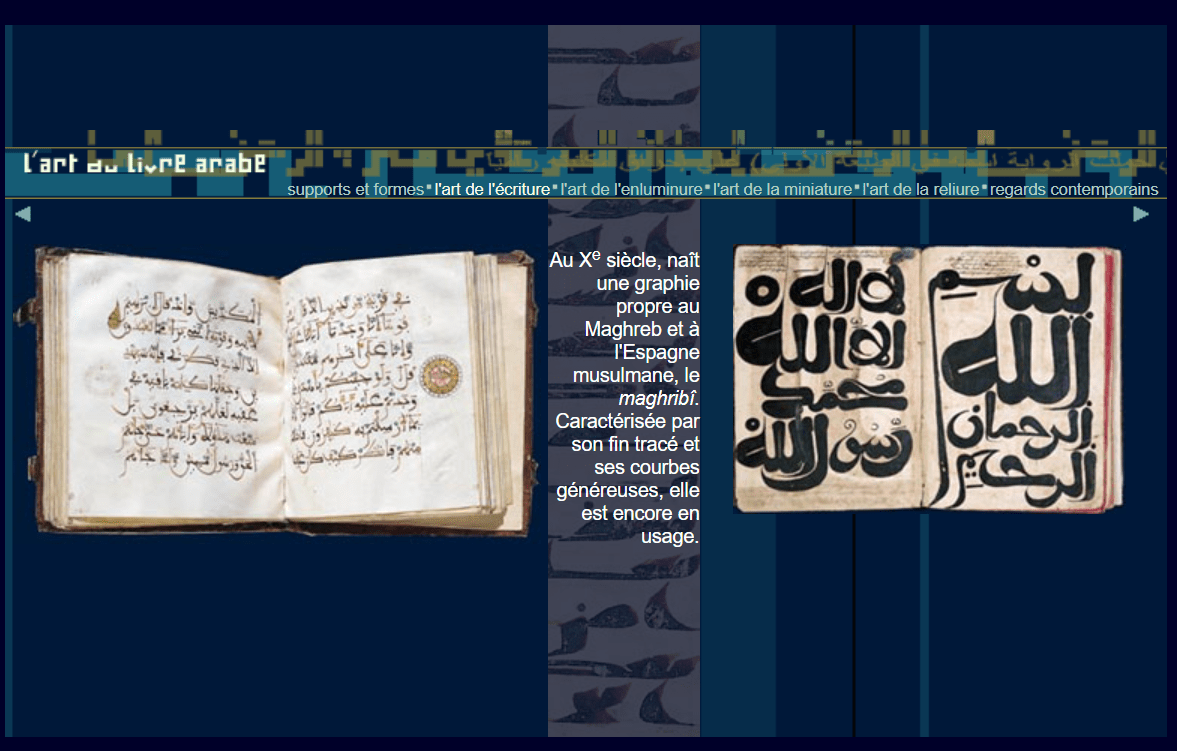
Captures d’écran de l’exposition virtuelle « l’art du livre arabe », http://expositions.bnf.fr/livrarab/index.htm © BnF / Éditions Multimédias
Avantages :
- conserver la mémoire d’une exposition et de son accrochage.
- synthétiser de façon claire des points de repères sur un sujet.
- proposer aux publics ne pouvant se déplacer sur place une sorte de compensation.
Inconvénients :
- les images apparaissent parfois comme de simples illustrations d’articles, et non comme des objets exposés.
- les textes sont souvent trop longs pour être lus sur un écran d’ordinateur ou téléphone, où le temps d’attention est réduit par les nombreuses sollicitations parasites possibles.
- le déplacement linéaire n’est pas intuitif sur les équipements numériques, ils sont plus adaptés au format livre…
Picorer ou dévorer une encyclopédie numérique :
Dans de nombreux cas, les expositions virtuelles de la BnF empruntent à l’encyclopédie. Plus ou moins développées, certaines constituent même des « sites-ressources » vouées à être enrichis progressivement (« Les Essentiels de la littérature », « Passerelle », « les arts du cirque »…). D’autres sans avoir une volonté d’exhaustivité créent à travers un réseau d’hyperliens une constellation de contenus produits par la bibliothèque. Certains intègrent une barre de recherche, ce qui représente un budget conséquent.
Avec « les essentiels de la littérature », les entrées possibles dans les contenus sont multipliées : on peut se promener dans une chronologie, effectuer une recherche dans le moteur interne du site, choisir une entrée thématique, se laisser séduire par les nombreuses images d’illustrations, qui, d’un clic, nous amènent à de nouveaux contenus…
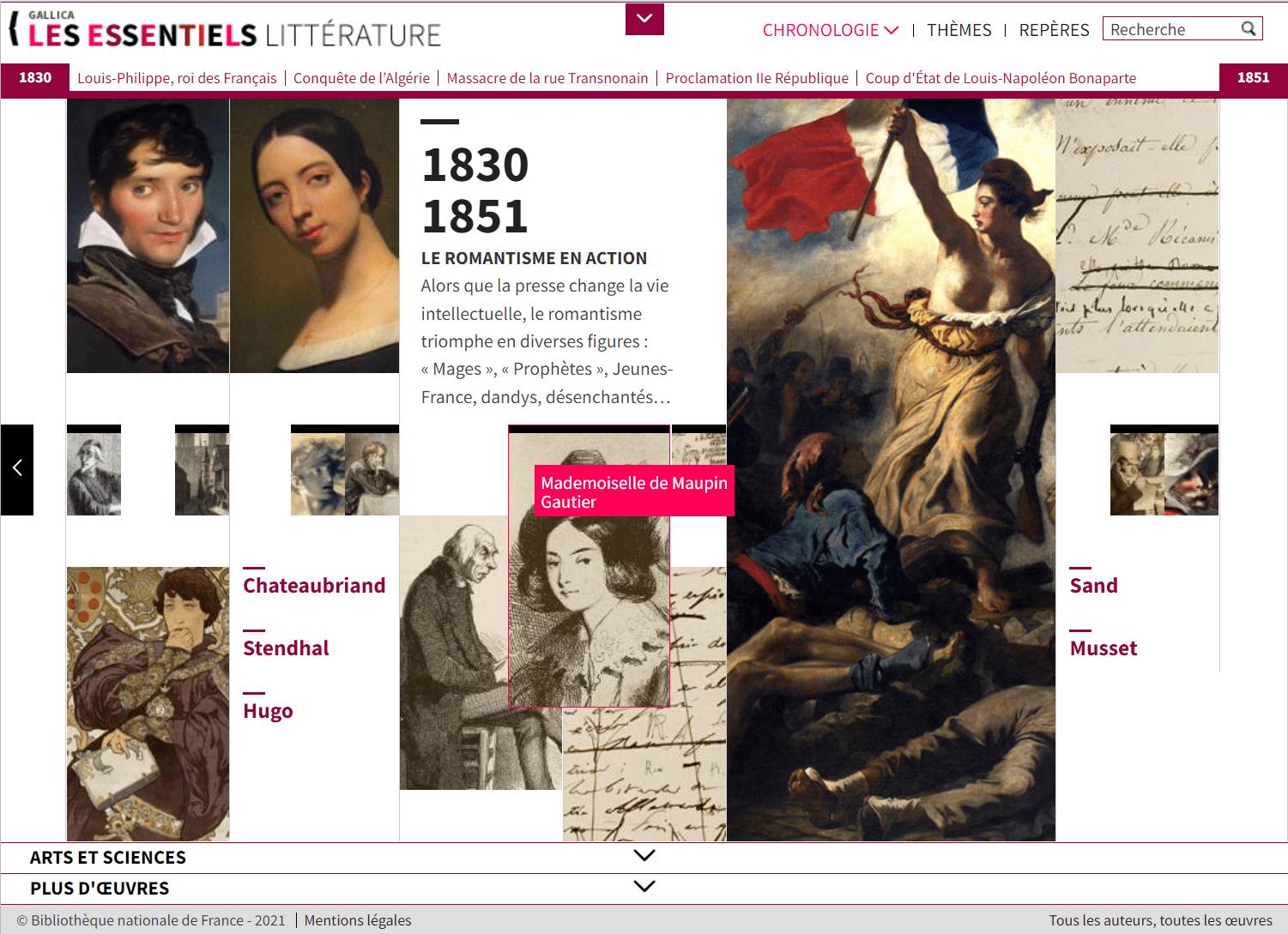
Captures d’écran de l’exposition virtuelle « Les Essentiels Littérature», https://gallica.bnf.fr/essentiels/ © BnF / Éditions Multimédias
Avantages :
- une base de données dense, riche, tout en restant accessible.
- plus facile à consulter qu’une encyclopédie papier, elle peut s’adapter à différentes méthodes de recherche et de déambulation numérique…
Inconvénients :
- il est facile de se perdre dans l’arborescence complexe…
- il s’agit d’une approche centrée uniquement sur la dimension pédagogique, au détriment d’autres approches des collections (ludique, esthétique...).
Lire, écouter, regarder… les livres et articles enrichis :
La présentation numérique des collections est propice à l’enrichissement du propos par des ressources de nature variée. La BnF a par exemple proposé des « livres augmentés » permettant de consulter un ouvrage dans son intégralité, en associant texte écrit, lu, et explications. Sur la capture issue d’Au Bonheur des dames, des mots surlignés et des astérisques cliquables ouvrent des « post-its » de définitions ou d’éléments de contextualisations. Les icônes carrées autour du texte ouvrent des illustrations d’époques, issues des collections numérisées. Dans Candide, d’autres types d’enrichissements sont explorés, notamment la carte interactive qui permet visuellement de comprendre le parcours des personnages au fil de la lecture et de se représenter différemment la chronologie du livre.
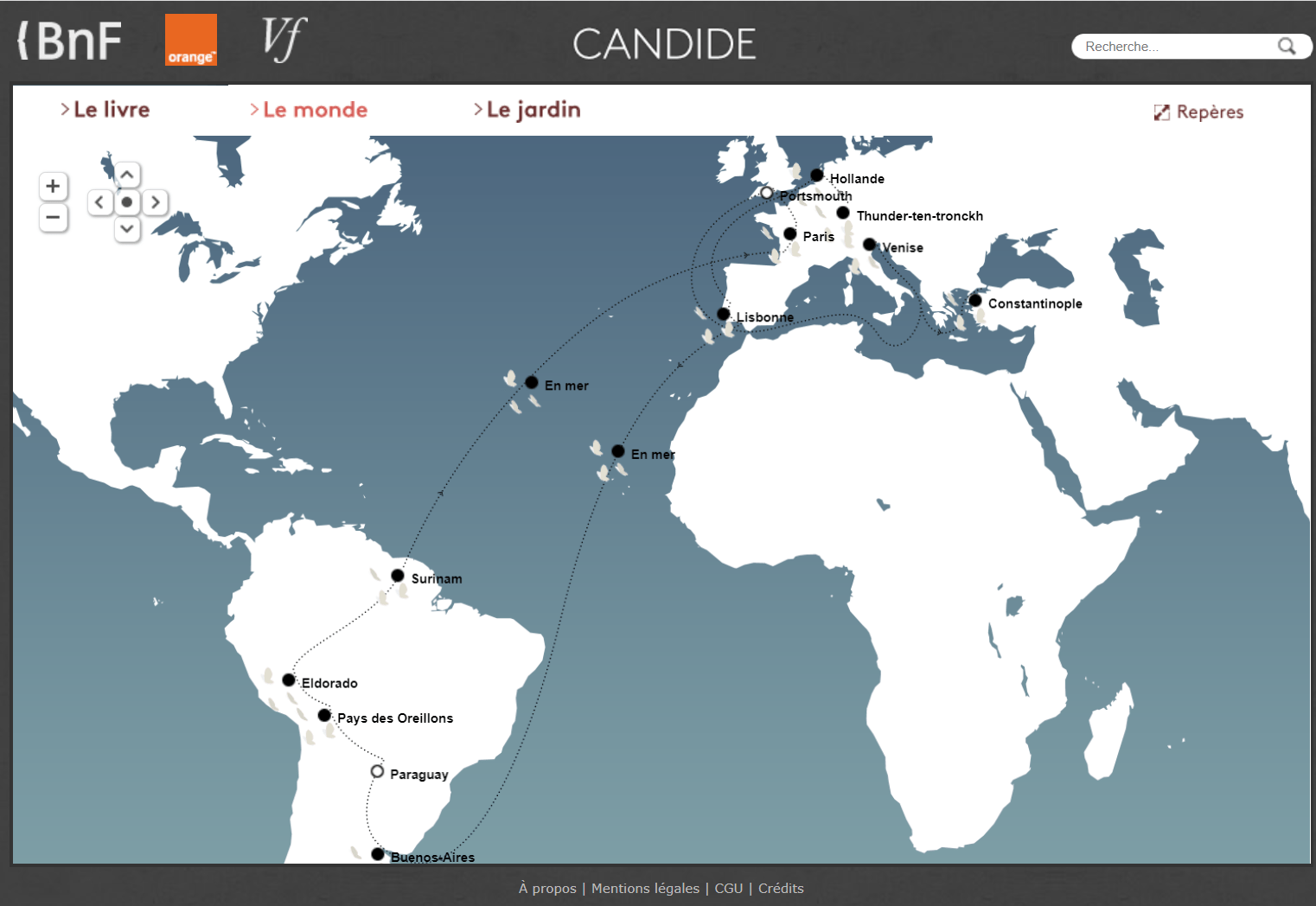
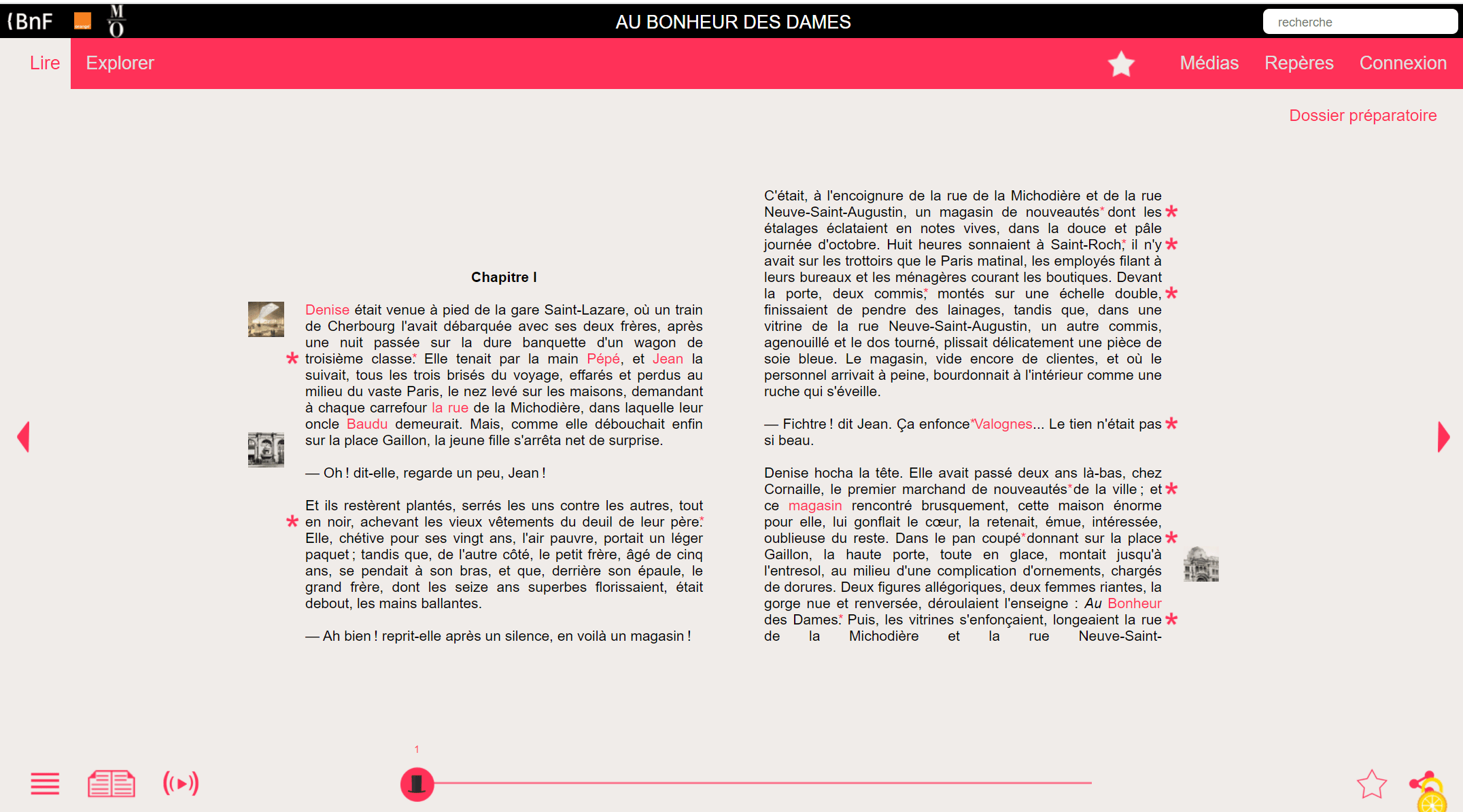
Captures d’écrans des livres augmentés « Candide » et « Au Bonheur des dames », © BnF / Éditions Multimédias
Au-delà de la contextualisation des ouvrages mis en valeur par la BnF, certaines expositions virtuelles profitent de ce format numérique pour proposer d’autres modes de valorisation des collections, plus interactifs ou vivants. L’exposition « Nadar » propose notamment des exemples de mises en voix d’extraits d’articles d’époques et de lettres, évitant la simple reproduction d’un document d’archives.
Ecouter la lecture d’extrait d’articles et de lettres, exposition virtuelle « Nadar », © BnF
Avantages :
- s’approprier les ouvrages et les objets de collections par d’autres biais.
- contextualiser un texte qui peut paraître obscur.
- permettre des rapprochements de contenus qui seraient plus compliqués sans le numérique.
- rendre des collections plus vivantes et accessibles.
Inconvénients :
- risque de brouiller le propos en proposant trop de contenus.
- risque de manque de lisibilité sur la page.
Scroller les histoires à dérouler
Arnaud Laborderie définit la notion de scrollytelling, qui inspire la démarche de récents sites : « ce mot valise composé de l’anglais scrolling (défilement) et storytelling (mise en récit) désigne une manière de narrer les histoires sur le web dont la spécificité est d’incorporer des contenus multimédias (textes, images fixes et animées, sons) de façon très fluide, grâce à des effets d’interface en parallaxe [NDR : c’est-à-dire que certains éléments graphiques ne se déplacent pas à la même vitesse que celle du défilement de la page, donnant une impression de mouvement et de volume] ». Concrètement, cela se traduit par des animations grâce à de faux effets 3D, rendant l’expérience plus immersive tout en exploitant une interface défilante à laquelle l’utilisateur est habitué par les réseaux sociaux.
Dans « Fantasy : retour aux sources », trois parcours sont proposés en scrollytelling, qui correspondent à des approches de la fantasy à partir de questions de société : religion, genre et écologie. Ce format permet d’enchaîner de façon fluide et dynamique des éléments de nature différentes : images issues de films et de séries, illustrations de livres, citations…
Capture vidéo de la navigation dans l’exposition virtuelle « Fantasy : retour aux sources » © BnF / Éditions Multimédias.
Cette navigation permet également d’agrandir les images et de permettre des rapprochements surprenants. Dans « Paysages français. Une aventure photographique 1984-2017 », le défilement permet d’introduire les images, puis de leur laisser place nette, et crée une relation esthétique aux photographies sur un mode plus contemplatif. Les images photographiques dialoguent librement, se répondent sur l’écran.
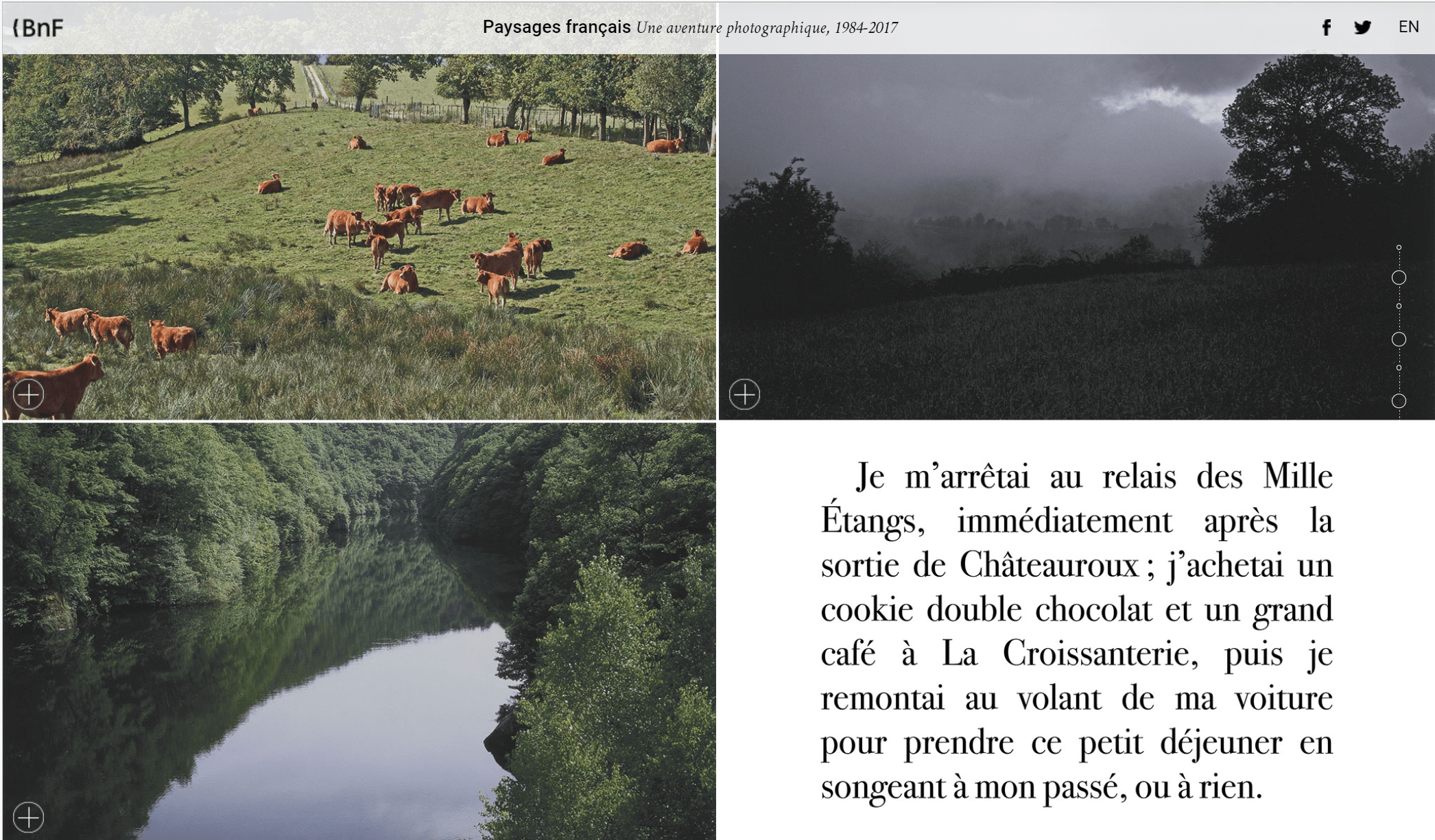
Captures d’écran de l’exposition virtuelle «Paysages français. Une aventure photographique 1984-2017 » BnF - Paysages français : Une aventure photographique, 1984-2017 © BnF / Éditions Multimédias
Avantages :
- grande fluidité du parcours.
- exploitation de tous types de contenus dans un enchaînement plus libre que dans une exposition physique.
- synthétique, lisible, tout en donnant des possibilités pour approfondir.
- le visiteur qui cherche une expérience esthétique peut se contenter d’apprécier les images, sans ouvrir les fenêtres de textes.
Inconvénients :
- le parcours est linéaire, sans laisser à l’usager des chemins alternatifs, même s’il est possible de l’accélérer en ne cliquant pas sur les images.
- l’importance première donnée aux images peut rebuter le visiteur qui cherche plutôt des explications.
Déambuler dans les salles d’expositions :
Certaines expositions virtuelles prennent le parti de reproduire de façon mimétique une exposition physique, en simulant le déplacement dans l’espace grâce à une interface similaire à celle employée par Google Street View. Dans le cas de la BnF, il n’existe pour le moment qu’un seul exemple de ce type : « Ruines », exposition monographique de Josef Koudelka. Les circonstances de cette exposition (fermeture des lieux culturels) peut alors expliquer le choix de cette transposition de l’expérience de déplacement, afin de donner une idée de la scénographie, et de l’accrochage des œuvres dans le parcours d’exposition.
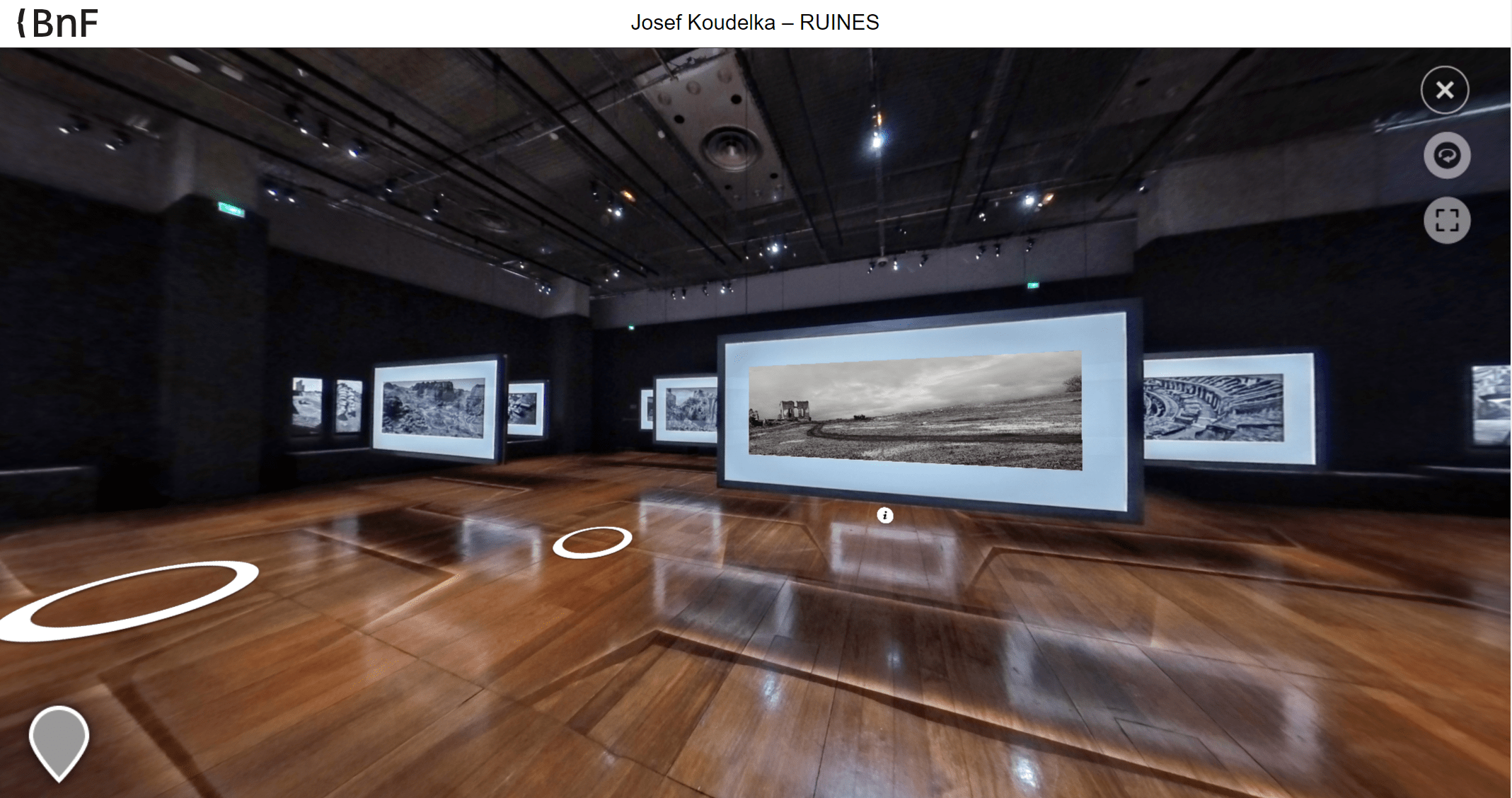
capture d’écran de la visite virtuelle « Ruines. Josef Koudelka » http://expositions.bnf.fr/koudelka/ © Josef Koudelka, BnF / Éditions Multimédias.
Avantages :
- permettre de donner une idée de l’exposition physique quand il n’est pas possible de s’y rendre (distance, circonstance du covid, temporalité courte de l’exposition).
Inconvénients :
- les vues à 360° déforment légèrement les images et peuvent troubler le regard.
- la navigation n’est pas forcément intuitive et ne donne pas forcément envie d’aller jusqu’au bout du parcours.
- la visite virtuelle n’apporte rien de plus par rapport à l’expérience de visite in situ en termes de contenus.
Qui consulte les expositions virtuelles de la BnF ?
Le rapport d’activité 2020 de la BnF indique que le domaine des éditions multimédias a enregistré 5,5 millions de visites. Ceci peut d’après eux s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment la fermeture des écoles lors du confinement et la nécessité pour les enseignants de proposer des outils afin d’assurer une continuité pédagogique. Ce sont les sites à vocation pédagogiques, comme les Essentiels de la littérature qui sont les plus fréquentés, avec 1,2 million de visite, ce qui correspond à une augmentation de 41 % par rapport à l’année précédente. Cependant, la hausse de la fréquentation peut également s’expliquer par les actions de communications vers un public plus large, au-delà du public scolaire.
En 2020, l’étude de Philippe Lombardo et Loup Wolff, Cinquante ans de pratiques culturelles en France a permis pour la première fois de disposer d’éléments concernant la nature des usagers des expositions numériques. Leurs analyses suggèrent que les publics des expositions virtuelles ont un profil relativement similaire aux publics des expositions in situ (les plus diplômés, les catégories socioprofessionnelles supérieures et les plus âgés sont les plus susceptibles de fréquenter ces équipements). Par ailleurs, plus de la moitié des publics virtuels se rendent également in situ, et cette fréquentation physique est très largement supérieure à la fréquentation numérique. 9,7 % des 9234 répondants de l’étude de 2018 disent avoir, dans les 12 derniers mois, « fait une visite d’une exposition virtuelle / d’un musée virtuel ». A titre de comparaison, ils sont 24 % à avoir « fait une visite d’un site patrimonial in situ ». On peut toutefois remarquer que l’association d’exposition et de musée virtuel n’est pas forcément claire pour la personne interrogée, aucun de ces termes n’étant clairement définis et pouvant donc se prêter à des interprétations variées.
Dans le cadre du colloque « Les Publics de la Culture à l’Ère du Numérique » tenu Angoulême les 2 et 3 décembre 2021, Marie-Laure Bernon a présenté l’avancée de sa recherche portant sur « les publics des expositions en ligne » à partir des expositions de la BnF. Prenant pour point de départ l’enquête de Lombardo et Wolff, elle en a analysé plus finement les résultats en se concentrant sur les expositions virtuelles, et mené des entretiens avec des répondants de l’étude qui avaient accepté d’être recontactés ultérieurement. Si cette étude est encore en cours, Marie-Laure Bernon a pu présenter trois premiers « profils types » de visiteurs numériques se dégageant de son étude qualitative.
« Le spécialiste des expositions d’arts visuels » : amateur d’arts visuels (photo, peinture), il ne voit pas l’intérêt de faire des visites en ligne qui reproduisent la visite vécue sur place. Il recherche davantage un supplément d’information, une médiation particulière qui complète une expérience in situ. Il oppose souvent l’expérience de la rencontre directe avec les œuvres avec la visite en ligne qui suppose une mise à distance particulière.
« Le cultivé amateur de numérique » : il recherche une expérience « différente » qui exploite les potentiels technologiques de la visite en ligne : zoom sur les œuvres, visite en immersion 3D, radiographie… Il a une vision plus positive d’internet que le premier profil, et y voit un « outil supplémentaire au service de la connaissance de l’art ». Il ne cherche pas qu’une information, mais s’intéresse à d’autres approches des collections : approche ludique, sociabilité numériques… Sa pratique est solitaire, et plus courte que celle d’une visite sur place (20 minutes maximum).
« Le visiteur de bonne volonté culturelle » : faisant référence à l’expression de Pierre Bourdieu, Marie-Laure propose un troisième profil qui se caractérise par un sentiment de manque d’un bagage culturel qu’il « devrait » avoir. Les contenus qui l’intéressent sont plus hétérogènes (sciences et technique, histoire, et non plus simplement les beaux-arts). Cette pratique correspond à un temps quotidien, au contraire de la visite d’expositions qui sont plus exceptionnelles. Il s’agit parfois d’ailleurs de se préparer « en amont d’une visite ardue ». Cette approche s’inscrit parfois dans un accompagnement lié à la parentalité.
Ces quelques idéaux-types ne sont pas exhaustifs, d’autant que les visiteurs scolaires ne sont pas encore évoqués, mais permettent d’identifier quelques traits des visiteurs d’expositions virtuelles. Il s’agit dans tous les cas d’une expérience différente de ce que l’on recherche sur place, soit qu’elle vienne la compléter en termes de contenus, soit qu’elle la prépare, soit qu’elle apporte un contrepoint amusant, original... Elle semble se définir en creux par rapport au contact physique à l’institution.
Une exposition virtuelle de la BnF apporte-t-elle vraiment quelque chose de « plus » qu’une visite classique ?
Compte-tenu des profils des visiteurs, il semble que les expériences de visites les plus intéressantes sont celles qui tiennent compte des spécificités de la visite numérique : temps plus court, possibilité de sauter d’un contenu à un autre par les hyperliens, habitude de « scroller » pour naviguer… La BnF semble l’avoir compris en proposant des activités plus interactives et ludiques depuis 2017, à travers le scrollytelling, les articles augmentés d’autres ressources comme la vidéo, absente des premières expositions virtuelles… Mais également à travers des jeux : l’exposition virtuelle « Fantasy » de 2019 proposait en effet en guise d’introduction un véritable jeu vidéo fonctionnant à la manière des visual novel dans lesquels le joueur agit par des choix de réponse multiples. Sans valoriser directement des objets des collections, l’approche ludique permet une immersion du visiteur dans le royaume d’Istyald, univers de fantasy, et d’en faire comprendre, sans avoir à les expliquer, ses éléments clés et ses enjeux (un univers en danger à sauver, ses créatures, ses objets à pouvoirs…).
Le jeu semble également être une transposition du « seuil », de la pièce d’introduction d’une exposition physique. Pour mettre le visiteur dans une autre disposition et le préparer à l’exposition, il s’agit de proposer une expérience marquante, ce qui est fondamental avec un support numérique pour lequel le temps d’attention du visiteur est largement réduit par les différentes sollicitations dont il peut faire l’objet.
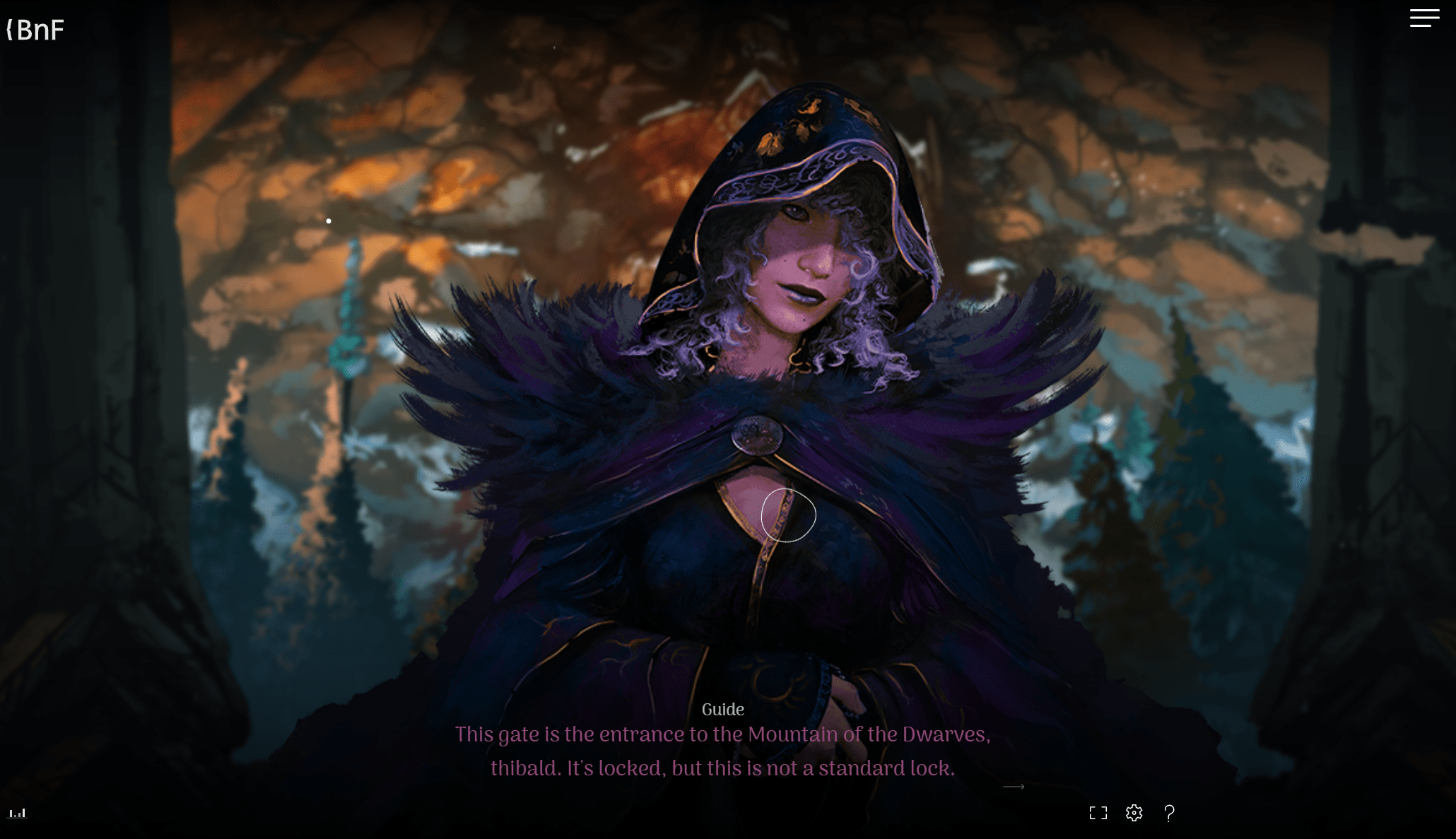
Capture d’écran du jeu Le Royaume d’Istyald issu de l’exposition virtuelle « Fantasy : retour aux sources », © Anato Finnstark, BnF / Éditions Multimédias.
La disparition de certains usages…
Il faut toutefois noter que, parmi les expositions virtuelles créées par la BnF depuis 1997, quelques-unes ont disparu ou sont devenues partiellement inaccessibles : en effet, avec l’obsolescence des sites utilisant Adobe Flash Player depuis janvier 2020 se pose la question de la pérennité de ses expositions. Les expositions virtuelles donnent l’impression d’être une version « éternelle » d’une exposition physique, mais nécessitent en réalité une importante maintenance. Les expositions numériques demandent en effet de l’entretien, une adaptation des technologies, qui passe parfois par la migration d’un contenu d’un support à un autre, mais aussi des espaces de stockage conséquents pour les héberger… Interrogés en mars dernier, Matthieu Canto et Sophie Guindon (Directeur de projet et chargée de projet, éditions multimédias, BnF) évoquent notamment la « Bibliothèque numérique des enfants », un des succès de la BnF, aujourd’hui inaccessible, ou encore « Arthur », sur lequel enseignants et scolaires travaillaient encore jusqu’à sa mise hors-ligne brutale. Afin de mieux anticiper ce type de difficultés, mais également de mieux valoriser cette quantité de ressources, la BnF travaille actuellement à un portail qui permettrait de présenter de façon plus pérenne et ergonomique les contenus des sites les plus anciens. Selon Matthieu Canto, « Il y a actuellement un gros travail éditorial mené sur le fonds documentaire représenté par ce volume de contenu, pour arriver à le représenter sous un format plus cohérent et plus accessible pour les différents publics, entre autres pour le public enseignant». Le département des Éditions Numériques souhaite également anticiper l’obsolescence possible de ses sites, accepté comme une donnée et en privilégiant la migration de contenu au fait de maintenir ces sites actifs. « Cinq ans en général, c'est la durée de vie d'un site. Il faut réussir à réfléchir à des façons de produire des sites sans qu'ils deviennent forcément pérennes. Ces sites peuvent être produits pour un but précis, par exemple en lien avec une exposition ou un événement particulier, et le contenu de ces sites peut aussi être réfléchi pour être intégré dans un corpus documentaire plus large, qui lui serait pérenne. ». Ce futur portail sera mis en ligne en avril 2023, et sera enrichi au fil des mois par les contenus des expositions virtuelles précédentes.
Sources :
Arnaud Laborderie, « Les expositions virtuelles de la BnF de 1998 à 2020. Retour sur vingt ans de pratiques de médiation en ligne », Culture & Musées [En ligne], 35 | 2020, mis en ligne le 01 juin 2020, consulté le 04 décembre 2021. URL : http://journals.openedition.org/culturemusees/5187
Marie-Laure Bernon, « Quels publics pour les expositions en ligne ? Prolonger l’enquête « Pratiques culturelles 2018 » », Communication scientifique lors du colloque « Les publics de la culture à l’ère numérique », les 2 et 3 décembre 2021 à Angoulême.
Philippe Lombardo et Loup Wolff, « Cinquante ans de pratiques culturelles en France », Ministère de la culture, 2020. consulté le 04 décembre 2021. URL : https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/L-enquete-pratiques-culturelles
Bibliothèque Nationale de France, Rapport d’activité 2020, extrait concernant la médiation en ligne : https://www.bnf.fr/fr/rapport-dactivite-2020-la-mediation-culturelle-en-ligne
Entretien avec Matthieu Canto (BnF, directeur de projets, éditions multimédias) et Sophie Guindon (Chargée de projets multimédias, cheffe de projet sur Fantasy – retour aux sources) réalisé par Sandrine Courroye et Sibylle Neveu le 12 mars 2021.
En savoir plus :
L’association Mêtis organise de janvier à mars 2022 un cycle de Rencontres Muséo sur les expositions en ligne, dans un format hybride présentiel-distanciel. https://metis-lab.com/2021/11/17/rencontres-museo-idf-les-expositions-en-ligne/
E.B., « Le numérique, nouvel espace de rencontre avec le patrimoine », L’art de Muser, 2020 : http://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2050-le-numerique-nouvel-espace-de-rencontre-avec-le-patrimoine-2
B.O., « Zoom sur les expositions virtuelles », L’art de Muser, 2021 : http://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2040-zoom-sur-les-expositions-virtuelles?highlight=WyJleHBvc2l0aW9ucyIsInZpcnR1ZWxsZXMiLCJleHBvc2l0aW9ucyB2aXJ0dWVsbGVzIl0=
#expositions virtuelles #BnF #visite virtuelle

Quand le musée fait son ciné
Filmer pour partager des moments de vie, avec un téléphone portable ou une caméra à main, est un moyen d’expression et de partage familier. Mais filmer au sein d’un musée est une liberté nouvelle.
Grâce au concours d’une professeure de terminale et de l’équipe du Palais des Beaux-Arts de Lille, toujours prête pour de nouvelles aventures, nous avons proposé à des lycéens de participer à une expérience-test. Il s’agissait d’accompagner les élèves pour imaginer un petit synopsis, écrire un scénario puis filmer leur histoire au P.B.A. puis d’organiser une visite de repérages au Palais des Beaux-Arts.

©D.R . PBA
Au lycée, lors d’un atelier, nous avons travaillé nos imaginations, acquis des techniques d’écriture filmique, puisé dans nos souvenirs, nos émotions, nos cultures, pour faire naître des idées, suivant ce que nous inspirait le Palais des Beaux-Arts. Puis, nous avons dramatisé nos idées, nous les avons mises en scène à l'écrit, afin d’en faire de courts récits. Enfin, les participants volontaires, nous ont raconté le début de leurs histoires de musée. De la danse contemporaine pour traduire les émotions, jusqu’aux parties de cache-cache destinées à faire vivre les espaces, en passant par les parents qui perdent leurs enfants dans les galeries.
Le jour des repérages au P.B.A., toute la classe est là. Les jeunes visiteurs promènent leur regard sur le Palais des Beaux-Arts comme s’ils le découvraient. Ils mesurent toute la majesté du bâtiment néo-classique, les perspectives, les enfilades, la magistrale rotonde...
Glissant dans les galeries, ils effectuent méthodiquement leur repérage, évaluant les sources de lumière, déterminant leurs cadres, enregistrant les bruits… Sans complexes, nos réalisateurs prennent des poses, plissent les yeux, pour mieux imaginer. Ils testent sur leurs portables le rendu des formes, des volumes, des matières et des couleurs, discutent des émotions qu’elles traduisent et qui racontent un fragment de leur aventure.

©M.R.
Nous manquons de temps, la lumière faiblit trop vite en ce mois de janvier. « Il y a trop de choses à voir ! » Les équipes décident revenir pour tourner en plein jour. Alors, profitant des quelques minutes restantes, avant la fermeture, les cinéastes s’abandonnent enfin à l’atmosphère du musée. A pas feutrés, ils s’assoient sur un banc, côte à côte, s’allongent dans les escaliers de la rotonde, se fondent dans le décor pour mieux le contempler.
Créer une aventure avec l’institution les a conduits à développer de nouveaux liens. Ce jour-là le musée, devenu source d’inspiration, leur a offert un rôle de créateur, d’acteur de leur relation avec lui et avec ses collections, le premier rôle.

©M.R.
Murielle Richez
En savoir plus :
Festival Musées (em)portables http://www.museumexperts.com/musees_em_portables/presentation/
Pour participer à celui de cette année : http://www.museumexperts.com/musees_em_portables/inscrire/Films:
« Aux hommes de demain », Inti-Julian Espinosa Franco, Musée de la résistanceet de la déportation de Besançon. Premier prix 2012. https://www.youtube.com/watch?v=d94gnWARl1M
« Seconde Vie » Georges Petit & Romain Vuillermet, au Musée desautomates, La Rochelle. Prix de l’humour 2014. https://www.youtube.com/watch?v=pIkGlxE3rYo
+ sur http://www.museumexperts.com/musees_em_portables/video/
#médiation
#jeune
#portable

Quand les technologies s'invitent au musée
Les années 2010 furent marquées par leur lot d’innovations technologique et numérique à l’instar du paiement sans contact, du développement des drones, de la voiture sans conducteur, des objets connectés, des casques de réalité virtuelle, de l’intelligence artificielle, etc. Elles n’ont d’ailleurs pas tardé à entrer dans les musées à travers les tables numériques, les applications de visite, les casques de réalité virtuelle, etc.
Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que les musées et autres structures culturelles s’en soient emparés tout en questionnant nos rapports avec ces dernières et leur impact sur le quotidien. En cette fin de décennie, on peut noter l’ouverture de structures dédiées aux arts et aux technologies comme la Gaîté Lyrique en 2011, ou des cycles de rencontre entre art, ingénierie et science du Forum Vertigo au Centre Pompidou depuis 2017, en passant par la création de Némo la Biennale des arts numériques en 2015. Comment ces évènements culturels et scientifiques interrogent-ils ce bouleversement technologique de nos modes de vie ?
Créer une nouvelle expérience pour le visiteur
Les nouvelles technologies contribuent d’abord à offrir une expérience originale au musée soit par la mise à disposition de nouveaux outils de médiation et de visite soit par l’utilisation de technologies pour interroger le corps du visiteur dans l’espace.
La réalité virtuelle (VR) grâce à des casques, permet de s’immerger complètement dans une œuvre, un environnement, une atmosphère. Ce dispositif assez contraignant oblige cependant le visiteur à s’isoler ce qui n’est pas convivial. Néanmoins les musées contournent cette contrainte grâce à des aménagements adéquates. En 2019, le Musée du Louvre a décidé de plonger ses visiteurs dans le plus célèbre tableau du monde La Joconde. Cependant cette expérience n’était accessible qu’à la fin du parcours et disponible uniquement sur réservation. Le Mons Memorial Musuem propose une expérience inédite de VR. Ce dernier a produit quatre courts-métrages relatant différents moments de la libération de 1944. Ce dispositif se veut immersif car les visiteurs sont isolés dans des cabines individuelles.

En tête-à-tête avec la Joconde, Expérience de réalité virtuelle au Musée du Louvre. ©Emissive
La réalité augmentée permet de renouveler l’approche des œuvres et du patrimoine grâce à une ergonomie nouvelle. Cela donne aux visiteurs un accès à davantage d’informations de façon ludique. Cette technologie offre aussi la possibilité de reconstituer une ambiance disparue, c’est le cas avec le dispositif HistoPad disponible au Palais des Papes, au château de Chambord ou à la Conciergerie. Le visiteur est projeté dans une époque révolue mais au réalisme saisissant.
La numérisation du patrimoine en 3D offre quant à elle de nouvelles possibilités aux musées et autres lieux de patrimoine. Elle donne accès à des lieux inaccessibles ou détruits. En 2018 l’exposition Cités Millénaires (voir l’article d’Armelle Girard) de l’Institut du Monde Arabe apportait la possibilité de ressusciter des cités mythiques du Moyen-Orient grâce à leur numérisation 3D. Cette technique est de plus en plus utilisée dans le cadre de la conservation préventive de sites soumis à des risques. En 2016, c’est l’institut culturel de Google qui propose aux internautes de visiter virtuellement les châteaux de la Loire depuis leur domicile. Pour ce faire, le géant du numérique s’appuie sur sa technologie de Street View qui permet de naviguer facilement d’espace en espace. En donnant accès à des détails ou pièces non accessibles en visite in situ, il s’agit d’une découverte originale pour les amateurs de monuments historiques.

Vue de l'exposition Cité millénaires, Voyages virtuels de Palmyre à Mossoul à l'IMA. ©Naël Boustany
L’intelligence artificielle (I.A.), permet de créer des visites toujours plus inédites et personnalisables. D’abord entrée par les coulisses du musée, l’I.A. est utilisée lors de restauration d’œuvres d’art, voire de création d’œuvres inédites (The Next Rembrandt). Au contact des visiteurs, l’I.A. devient une sorte de médiateur. La technologie du chatbot de la société Ask Mona, permet au visiteur de devenir acteur de la visite grâce à l’interaction avec une I.A. via l’application Messenger de Facebook. Quant au Smithsonian de Washington, il s’est doté en 2018 de Pepper le robot humanoïde de la société SoftBank Robotics qui interagi au quotidien avec les visiteurs. Sa mission est de donner envie de découvrir le musée et en partageant des informations avec le public intrigué par ce nouveau compagnon de visite.
L’approche technique et pragmatique : le rôle des musées de sciences face aux nouvelles technologies
Les nouveautés technologiques et numériques étant quasi quotidiennes, la programmation scientifique et culturelle des musées de sciences accompagne les visiteurs dans la compréhension pratique de ces changements et leurs conséquences sur le quotidien.
Dès 2012 le musée des Arts et Métiers ouvrait une exposition temporaire intitulée Et l’Homme … créa le robot. Le visiteur était accompagné par deux animatronics Robbix et Robbixa qui performaient dans l’espace. L’exposition voulait revenir sur l’histoire de l’automatisation et de la robotisation en montrant le passage de la reproduction des gestes humains par les automates à l’apprentissage des robots rendu possible avec l’intelligence artificielle. Le parcours chronologique donnait un aperçu de l’évolution du rôle du robot de la sphère de l’industrie à la sphère domestique.
Dans cette lignée, la Cité des Sciences et de l’Industrie a ouvert en avril 2019 un espace d’exposition permanente s’intitulant Robots qui interroge la robotique contemporaine (qui a évolué depuis 2012) et les conséquences des robots et autres objets connectés dans notre vie quotidienne. Le parcours propose aux spectateurs, de rencontrer le robot humanoïde Pepper qui fait office de médiateur puisqu’il explique lui-même ses composants et son fonctionnement. Le choix de proposer cette thématique en exposition permanente montre bien l’importance de donner la possibilité à chacun d’apprivoiser et de comprendre ces nouvelles technologies.
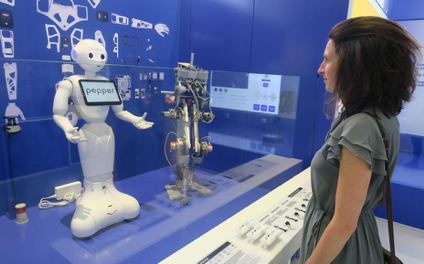
Le robot Pepper de l’exposition Robot à la Cité des sciences et industrie de Paris. ©Marie Briand-Locu.
En 2018, le Palais de la Découverte dédie une séquence de son parcours permanent à l’Informatique et Sciences du numérique. Le parcours aborde les fondamentaux de l’informatique tels que les données, les algorithmes et les langages informatiques. Puis évoque les recherches actuelles autour des méga données (Big Data), les robots et l’I.A. Pour terminer sur les technologies abouties qui sont ou pas encore entrées dans notre quotidien comme l’imagerie médicale de Fluid de la société Therapixel ou le Li-Fi de la société Lucibel. L’exposition permet de faire le point de façon pratique et technique sur les concepts informatiques en constante évolution et perfectionnement. Une visite virtuelle de cet espace est disponible gratuitement depuis le site internet du Palais de la Découverte.
En 2018 le Quai des Savoirs, en coproduction avec le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, propose la version itinérante d’une exposition autour de la question du transhumanisme. S’intitulant #HumainDemain, elle se propose de faire découvrir des progrès techniques et scientifiques dans le domaine du corps et de la santé : prothèses, implants, greffes qui peuvent améliorer nos performances, mais aussi notre rapport au quotidien grâce à l’I.A. et aux objets connectés. L’exposition se veut participative, elle propose au visiteur de désigner son innovation préférée, de s’interroger sur l’éthique de cette dernière et de devenir acteur de son futur développement.

Vue de l’exposition #HumainDemain au Quai des Savoirs. ©Thierry Pons
La maîtrise et la compréhension des sciences du numérique et de l’informatique devient, dans notre société en mutation, aussi importantes que de comprendre les mathématiques et les sciences de la vie. Les musées de sciences sont des vecteurs de transmissions de ces connaissances nécessaires pour évoluer dans la société numérique de demain.
L’approche esthétique et artistique : entre entertainment et propos convaincant
Les structures et musées exposant des collections type beaux-arts se sont aussi emparés des nouvelles technologies, soit dans la manière d’exposer les œuvres soit en les questionnant à travers des expositions.
Dans le premier cas il s’agit d’expositions immersives qui répondent de plus en plus à une demande croissante de ce genre d’évènement ou entertainement. L’Atelier des Lumières (voir l’article de Laurence Louis) ouvert en avril 2018 surf sur cette vague du numérique en proposant un spectacle multimédia à partir d’œuvres d’artistes iconiques. Pour cela, la société Culturespaces qui gère l’espace s’appuie sur une technologie spécifique AMIEX® (Art & Music Immersive Experience). Cette dernière permet de coordonner à grande échelle des milliers d’images et de sons de haute qualité en utilisant des projecteurs laser connectés par fibre optique. Les avancées technologiques contribuent la découverte d’œuvres souvent trop difficiles à déplacer. Démocratisation culturelle ou simple spectacularisation des œuvres, telles sont les visions qui s’opposent autour de ces évènements. Par la manipulation et l’animation des images, le visiteur est davantage un spectateur devant un show immersif qui s’offre à lui.

Vue de l’exposition Van Gogh, la nuit étoilée à l’Atelier des Lumière. ©Culturespaces-E.Spiller.
Toujours dans cet esprit d’exposition immersive, l’évènement teamLab à la Grande Halle de la Villette en 2018 présentait aux visiteurs une création originale Au-delà des limites, avec laquelle ces derniers pouvaient interagir. Les créations numériques projetées, grâce à la même technologie de projecteurs surpuissants, sont autonomes et se modifient en présence des visiteurs et de leur interaction avec cet environnement.

Vue de l’exposition TeamLab Au-delà des limites à la Grande Halle de la Villette. ©Eric Valdenaire.
Dans le second cas, il s’agit d’aborder les thèmes de société liés aux nouvelles technologies et à leur esthétique à travers des expositions artistiques. Les Rencontres photographiques d’Arles en 2018 ont invité le photographe Matthieu Gafsou a présenté son travail. L’exposition s’intitulait H+, elle explore l’esthétique déroutante du transhumanisme. Ici aucune explication n’est donnée sur les technologies transhumanistes, c’est l’esthétique qui vient questionner le visiteur sur des sujets comme la fugacité de l’existence humaine.
En 2018, l’exposition Artistes et Robots au Grand Palais a connu une importante fréquentation. L’institution s’est voulue moderne en exposant pour la première fois de sa programmation les arts de « l’imagination artificielle » c’est-à-dire l’art robotique, génératif et algorithmique. Son parti-pris était d’interroger l’influence des nouvelles technologies sur la création artistique. Avant tout l’exposition pose la question controversée de savoir si les robots et autres intelligences artificielles peuvent remplacer les humains et donc les artistes. Or, ces dernières sont davantage examinées comme des nouveaux outils pour les artistes qui leur donnent la possibilité d’aller plus loin dans leur travail artistique. Par ce biais, il est expliqué que les machines à l’aube des années 2020, ne sont pas encore capables de créer seuls des œuvres. La créativité humaine est toujours nécessaires pour imaginer des œuvres dotées de sensibilités et de subjectivités.

Stelarc, red Re-Mixed : Event for Dismembered Body, de l’exposition Artistes et Robots au Grand Palais. ©RWRM
A travers le prisme de l’art, les expositions et évènements évoqués plus haut, enrichissent le débat autour de l’entrée des nouvelles technologies dans notre quotidien. Ils offrent la possibilité aux visiteurs de s’éveiller à ces sujets de société. En attendant de nouvelles inventions, les artistes et les musées ont encore de belles années devant eux et de quoi nous surprendre encore.
Axelle Gallego-Ryckaert
#technologies
#musées
#robots

Quand réalité virtuelle rime avec culturel
Du jeu vidéo, à la médecine en passant par la publicité, la réalité virtuelle touche tous les domaines et le monde muséal est loin d’être en reste. Si on recense de nombreuses expériences de réalité virtuelle dans les musées ces deux dernières années, il s’agit souvent d’expérimentations à l’occasion d’événements temporaires. Le but de cet article n’est pas de proposer une liste exhaustive des différents dispositifs de réalité virtuelle proposés par les institutions culturelles, mais de s’interroger sur les gains et les limites que peut avoir ce type d’expérience pour ces lieux.
Pour commencer, je dirais que le grand intérêt de la réalité virtuelle pour une institution culturelle tient en deux mots, INNOVATION et IMMERSION. L’innovation technologique, encore et toujours, est un très bon moyen pour dépoussiérer une image un peu vieillotte d’un musée. Entre nous, proposer des expériences innovantes permet de détourner le regard du visiteur (et surtout des médias) des espaces permanents, surtout quand ceux-ci n’ont pas bougé depuis 20 ans. Alors un musée à la pointe de la technologie, c’est un très beau coup de pouce pour l’image! Et il faut dire que la réalité virtuelle est un terrain fertile pour toutes les institutions qui veulent affirmer leur position de « musée innovant ».
Avec la réalité virtuelle, les musées proposent aux utilisateurs une expérience immersive dans des lieux ou des espaces temps inédits. L’immersion, c’est véritablement la plus-value de la réalité virtuelle. En recréant et restituant virtuellement des lieux, des espaces, des personnages historiques ou des espèces animales disparues, les musées permet au visiteur de découvrir ce qu’il n’aurait jamais connu en dehors de la réalité virtuelle. C’est aussi proposer une expérience inédite, une exploration virtuelle du réelle à travers des points de vues privilégiés et surréalistes. C’est enfin, affirmer le musée comme un lieu de délectation et d’innovation.
Alors outil de communication ou médiation culturelle ? Les expériences de réalité virtuelle muséales peuvent tour à tour porter les deux casquettes selon l’utilisation que l’institution en fait. La réalité virtuelle peut être une ambassadrice d’un musée aussi efficace qu’une bande annonce avec ce petit quelque chose en plus qui tient de l’expérience.
Ces expériences de réalité virtuelles s’inscrivent dans la programmation du lieu culturel et sont mises en place en parallèle d’une exposition, d’une commémoration ou de l’ouverture d’un espace. Le château de Versailles, en partenariat avec la Fondation Orange, propose une expérience de réalité virtuelle à l’occasion de l’exposition « Visiteurs de Versailles ». L’expérience intitulée « Vivez Versailles » est une immersion dans le Versailles de Louis XIV, en 1686. L’utilisateur suit le cortège de l’Ambassade de Siam et croise sur son chemin l’architecte Jules Hardouin-Mansart, domestiques, nobles et bourgeois avant de se retrouver devant Louis XIV en personne. Cette expérience didactique et historique arrive à point nommé pour palier à l’absence totale de dispositifs interactifs dans l’exposition…

« Vivez Versailles », aperçu de l'expérience Ambassade de Siam, 1686 © EPV / Make Me Pulse
La réalité virtuelle peut aussi répondre à des enjeux d’accessibilité. Si l’expérience virtuelle n’a pas vocation à remplacer une visite in situ, elle peut permettre de rendre accessible des espaces qui ne le sont pas dans la réalité. Bien sûr, cette accessibilité est toute virtuelle mais elle a le mérite de proposer une découverte et une immersion lorsque certains espaces ne sont pas accessibles aux PMR. Si l’expérience de réalité virtuelle est diffusée gratuitement, elle peut alors s’adresser à l’ensemble des lieux et des personnes qui possèdent un équipement de VR, dans toutes les régions du globe.
Alors sur le papier, la réalité virtuelle au musée peut paraitre une expérience géniale. Et elle peut réellement le devenir si le l’institution culturelle arrive à élucider la question de l’installation in situ. Car la VR c’est plutôt encombrant. Il faut au minimum un casque, deux manettes, deux capteurs, sans conter l’ordinateur qui fait fonctionner l’ensemble. Alors, il faut de la place et surtout du personnel pour accompagner le visiteur dans l’expérience, sans parler de la question de la maintenance.

Cabinet de Réalité Virtuelle au Museum national d’Histoire naturelle © MNHN - A. Iatzoura
Certains musées ont dédié une salle à la réalité virtuelle. C’est le cas du Museum national d’Histoire naturelle de Paris et son cabinet de réalité virtuelle, première salle dédiée à l’expérience dans les musées français. Il s’agit d’une expérience pédagogique qui délivre un contenu scientifique sur l’ensemble des espèces animales et végétales. Si l’institution a résolu la question de l’installation, elle a aussi résolu la question du coût. Ne nous mentons pas, la VR à un coût élevé qui tient parfois plus à sa mise en place sur site qu’à la conception globale de l’expérience. Car les partenariats et mécénats ne sont pas rares entre lieux culturels et fondations ou autres partenaires technologiques.
Nul doute, la réalité virtuelle, par ses propositions innovante et immersive, est un outil très intéressant pour la démocratisation culturelle. Mais avant de se lancer dans un tel projet, gardons en tête que l’expérience présente aussi quelques contraintes techniques qui, à ce stade des expérimentations, sont loin d’être élucidées.
Pour un tour du monde des expériences de réalité virtuelle dans les institutions culturelles : http://www.club-innovation-culture.fr/tour-monde-expos-visites-realite-virtuelle/

Quelle place pour le métavers dans les musées de demain ?
Et si le musée de demain n’avait plus de murs ? Avec le métavers, la visite devient immersive et accessible à tous, de partout. Dernière ces belles belles promesses, quels défis techniques, éthiques et financiers limitent encore le déploiement de ces « nouvelles façons d'exposer ».
Depuis quelques années déjà, les musées explorent la réalité virtuelle pour enrichir leurs offres. Reconstituer le passé, étendre l’accès au patrimoine, briser les murs géographiques… En bref, des innovations aux multiples avantages. Mais entre défis techniques, éthiques et financiers, la démocratisation du musée virtuel reste un projet encore loin d’être universel.

Image générée par une IA - Pixabay
Ajustez le casque de réalité virtuelle sur votre nez et laissez-vous embarquer dans un monde virtuel immersif où les frontières du réel se floutent. Le musée du Quai Branly, le Museum national d’Histoire naturelle, le MusiX... certains musées investissent déjà dans la création d’expériences en réalité mixte ou virtuelle. Toutefois, cette pratique reste relativement rare. Si ces innovations offrent des perspectives inédites pour les musées et le public, pourquoi leur usage n’est-il pas déjà démocratisé ? Quels défis éthiques, techniques et muséographiques constituent-ils ?
Un patrimoine culturel à portée de clic
Le patrimoine culturel européen est particulièrement riche et diversifié, mais reste souvent inaccessible à une large partie de la population. Numériser ces œuvres et les intégrer dans des espaces virtuels permet d’étendre l’accès à ce patrimoine au-delà des murs des musées. D’une part, cela permet de s’affranchir des dimensions du bâtiment, ouvrant la possibilité d’explorer des collections et des mises en scènes – presque – sans fin. En plus de dépasser les contraintes spatiales qui limitent leurs expositions, le virtuel permet de reconstituer des lieux historiques disparus ou altérés et de resituer le visiteur dans un contexte particulier. Dans son sous-sol, le musée de Libération de Paris a recréé le parcours d’un journaliste qui rencontre le Colonel Rol-Tanguy et son équipe, caché dans ce poste de commandement souterrain en 1944. Le visiteur déambule et interagit avec des personnages virtuels créés à partir de scènes des archives. Cette reconstitution fidèle et immersive permet de rendre les événements appartenant au passé plus tangibles et mémorables.
Pour aller plus loin : avec ces avancées technologiques, les visiteurs peuvent « voyager » dans le temps et l’espace. Par exemple, des reconstitutions en réalité virtuelle permettent de se balader dans des sites historiques dans leur état d’origine. Sous le parvis de Notre-Dame de Paris, « Éternelle Notre-Dame » entraîne le visiteur dans les différentes étapes du chantier : de sa construction aux réparations actuelles. Équipé d’un sac à dos/ordinateur et d’un casque occultant, le visiteur se déplace, voit et entend les rues de Paris il y a 850 ans. Ainsi, replacer les œuvres dans leur environnement original ou dans des scénarios historiques favorise une compréhension plus riche et transversale.
Visiteurs en immersion face aux plans de la Cathédrale. Éternelle Notre-Dame - © Orange/Émissive - 2021
En démocratisant l’accès au patrimoine à travers les mondes virtuels, la visite devient possible aux personnes qui, pour des raisons géographiques, économiques ou physiques, ne pourraient pas se rendre dans les musées. Cela recèle un potentiel important, notamment en termes d'élargissement de l’audience et de promotion d’une véritable égalité d’accès à la culture. De plus, la création de musées virtuels pourrait ouvrir de nouvelles perspectives de coopération culturelle entre les pays. Si ces perspectives sont, en théories, enrichissantes et réjouissantes ; qu’en est-il de l’usage ? Pourquoi ces technologies si prometteuses n’ont-elles pas passé la porte de tous les musées ?
Des défis à relever et des écueils à éviter
Bien que les possibilités offertes par les musées virtuels soient nombreuses, les challenges restent nombreux. L’un des enjeux majeurs concerne la souveraineté culturelle et numérique. En effet, les musées souhaitant numériser leurs œuvres dépendent souvent de plateformes technologiques étrangères pour héberger leurs contenus. Cette appartenance pose certaines questions. Qui est propriétaire des métadonnées associées aux œuvres numérisées ? Qui garantit leur conservation à long terme ?
L’éthique de la représentation culturelle est également un enjeu de taille. Numériser des œuvres d’art ne se limite pas à une simple reproduction technique, cela implique aussi des choix de représentation. En effet, une fois modélisées il est possible de jouer sur de multiples paramètres pour moduler l’aspect de l’œuvre. Or, certains objets de culte ou œuvres anciennes possèdent une signification particulière pour les communautés concernées. Leur numérisation, et encore plus leur modification dans un environnement virtuel, pourraient être perçues comme une forme d’appropriation ou de dénaturation.
La question de l’usager dans le métavers muséal
Il est essentiel de réfléchir à la question de l’usage. Il faut nécessairement penser à inclure différents groupes sociaux et culturels, surtout dans un monde où la fracture numérique persiste. Ces musées virtuels ne doivent pas devenir des espaces réservés à une élite technologique, mais doivent être adaptés à tous les publics. Enfin, un autre enjeu réside dans le coût et l’accès aux technologies nécessaires. Aujourd’hui, les équipements de réalité virtuelle sont encore onéreux et peu ergonomiques. Les casques actuels sont souvent lourds et inconfortables, ce qui peut entraver la durée et l’expérience visiteur. Si les progrès technologiques continueront de perfectionner ces outils, il est probable que le coûts renforce la scission entre les musées disposant des moyens de développer ces technologies, et ceux qui n’en auront pas les capacités.
Les musées virtuels sont encore loin d’être universels, et chaque projet doit être adapté aux spécificités des œuvres, des publics et aux besoins des institutions. Mais lorsqu’ils sont bien réalisés, ces dispositifs peuvent offrir des expériences spectaculaires et marquantes, qui redéfinissent la manière dont nous percevons et interagissons avec le patrimoine. L’œuvre numérisée ne fait pas, à elle seule, une expérience muséale. Penser le parcours visiteurs, la mise en scène et la muséographie reste primordiales. L’équilibre entre l’innovation technologique et le respect des valeurs culturelles reste encore à réfléchir.
Loraine ODOT
#métavers ; #immersion ; #expériencevisiteurs

Qui a dit que les technologies n'avaient pas leurs places dans un musée ? Projecteur sur un prototype de médiation muséale !
Les preuves sont là, les visiteurs d'uneexposition prennent plus le temps de lire les textes du début de l'exposition qu'à la fin (cf : Noémie Drouguet et André Gob, Muséologie).
L'équipe Troadeus
© Quentin Chevrier
Comment faire alors lorsque les œuvres ne sont pas toutes faciles d'accès sans médiation comme au musée gallo-romain de Lyon Fourvière ? Cette question nous offre deux types de possibilités : un système de médiation avec un guide conférencier (option qui malheureusement reste coûteuse) ou la mise en place de solutions interactives qui absorbent l'attention des visiteurs par d'autres moyens.
Museomix propose de joindre l'utile à l'agréable ! Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas : il s'agit d'un travail collaboratif, un brain-storming culturel et scientifique pour créer des nouvelles médiations au sein des musées grâce aux innovations technologiques. C'est dans cette ébullition d'idées qu'est né le projet de l'équipe Troadeus qui « remixe » la célèbre Table Claudienne.
Elle tient son nom de l'Empereur Claude qui prononça un discours en l'an -48 avant Jésus-Christ dans le but d'intégrer les notables de la Gaule dite Chevelue au sénat romain. Le texte a été retranscrit sur cette imposante table en bronze en mémoire de la générosité de Claude. Cette œuvre, pièce magistrale est pourtant difficile d'accès. En effet, elle est écrite en latin ce qui a priori peut sembler rébarbatif pour le visiteur non-latiniste. L'inscription gravée est lisible mais incompréhensible si le visiteur n'est pas latiniste et le cartel très long. Autrement dit, cette œuvre malgré son apport évident à l'histoire nécessite un type de médiation spécifique pour le public qui, jusqu'à présent, passait devant sans vraiment la comprendre.
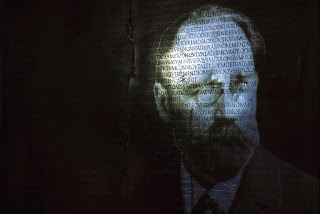
Emile Zola appparissant sur la table claudienne
© Quentin Chevrier
L'équipe Troadeus, composée de sept membres, travaille surun projet commun afin de mettre en valeur cette table avec la mise en place d'un prototype de médiation muséale. Il s'agit d'intégrer le visiteur à une expérience immersive en lien avec le discours politique qui, d'une part est le sujet de la table et qui, d'autre part, peut s'affilier avec les discours politiques d'aujourd'hui.
L'équipe prend le parti de jouer avec la déambulation du spectateur et de créer une interaction entre ce dernier et cette plaque de bronze.
Lorsque le visiteur marche dans le musée, il déambule pour voir les œuvres. La Table Claudienne est placée au bout d'une allée depuis laquelle on perçoit la table depuis une bonne dizaine de mètres. De loin, cette plaque intrigue et suscite un questionnement. Il approche alors et le prototype prend le relais pour attirer le visiteur plus près et provoquer un échange. On entend une voix en latin récitant le texte de Claude et donnant aussi un aspect vivant à cette langue morte.
Chaque pas en direction de la table déclenche dessus (grâce à une kinect située sous le discours en bronze) l'apparition d'une projection d'une figure politique ou historique associée à l'une de ces phrases phares. Martin Luther King se dévoile avec une phrase de son discours « I have a dream » plus il disparaît trois pas plus loin pour laisser poindre Emile Zola, faisant lui-même référence à son engagement politique. Des discours forts sur des thèmes d'intégration, d'altérité issus du19ème et 20ème siècle qui reflètent des problématiques similaires au discours de Claude.

Explication du projet de la Table Claudienne
© QC
D'un point de vue technologique, le tout fonctionne assez simplement, la kinect détecte les mouvements et les positions du visiteur. Elle les transmet ensuite à un programme MAX/MSP (ici réalisé par le développeur du groupe) qui envoie l'ordre au vidéo-projecteur d'envoyer les différentes diapositives en fonction d'où il se trouve. Il s'agit donc d'un prototype qui utilise une technologie combinée assez simple, mais qui demande toutefois de bonnes connaissances en développement informatique. Bien sûr ce prototype neremplace pas la lecture du cartel ou même la présence d'un médiateur mais elle intrigue le visiteur et provoque son arrêt.
Le seul point faible de ce prototype réalisé en 3 jours par l'équipe Troadeus participant à Museomix, c'est que le temps ne leur a pas permis de réaliser un système capable de gérer un groupe de visiteurs. La kinect détectant trop d'informations à la fois venant de différents endroits. Il était difficile pour le prototype de fonctionner normalement à cause de l'afflux massif de personnes venant découvrir toutes ces innovations, afflux qui ne correspond pas à la fréquence de visite normale. Cependant, il faut noter qu'avec un brin de temps supplémentaire, le problème est facile à résoudre.
Ce dispositif devait initialement rester une semaine dans le Musée gallo-romainde Lyon-Fourvière, sera finalement resté près de trois semaines, du fait de son succès.
Un grand merci à Franck Weber, artiste sonore et membre de l'équipe Troadeus, qui a fait face à mon ignorance en matière de développement de programme et qui a pris le temps de répondre à mes questions.
Camille Françoise

Second life, les musées au virtuel
Ce n'est plus un secret : l'explosion des réseaux sociaux sur le net, Facebook et Twitter en tête, a offert aux musées de nouvelles clés en matière de communication. Dans certains cas, par exemple en lorgnant du côté de la très active vie numérique du Muséum de Toulouse, nous pourrions même parler de formes de médiation inédites. Il y a déjà de cela quelques années, en pleine découverte du jeu en ligne Second Life, certains musées un peu avant-gardistes ont fait le choix plus radical de se forger un « double » dans ce monde virtuel. Petite revue de troupe de ces « cyber museum »...
Le musée de l'Holocauste
©Second Life
Second Life, c'est un peu le monde où vous et moi, incarnés par des ympathiques avatars, sommes libres de faire ce que l'on veut : se téléporter à l'autre bout de la carte en un clin d'œil, se déplacer en marchant, courant ou volant, et même marcher sous l'eau sans risquer la noyade, bref, le lieu de tous les possibles. S'il est avant tout présenté comme un jeu vidéo, il sert également de réseau social, puisqu'il est possible d'échanger avec tous les autres avatars rencontrés sur notre route en temps réel, et de créer nos propres évènements dans le jeu à tout moment.
Pour ceux qui seraient prêts à vivre l'expérience de manière un peu plus approfondie (c'est-à-dire pécuniaire) on peut alors s'acheter une petite île et construire ensuite sur son terrain tout ce que l'on y souhaite. Les habitants de Second Life ne manquent généralement pas d'imagination : beaucoup ont créé de toutes pièces de nouvelles villes aux architectures expérimentales, souvent impraticables dans la réalité. C'est notamment sur cette idée de pouvoir tester l'intérêt et la faisabilité decertaines initiatives avant de les lancer dans la réalité que Second Life aconnu un réel engouement à la fin des années 2000.
The Exploratorium, le musée des sciences de San Francisco, a été le premier musée à s'être lancé dans l'aventure en 2006. Comme d'autres qui ont suivi ce modèle, l'idée était de reconstruire le bâtiment du musée dans le monde virtuel, et d'en montrer une partie des collections. Dans la plupart des cas, les musées se reconstruisent en tout ou pour partie à l'identique ; la logique de la reconstruction très fidèle a été poussée à son paroxysme par le Staaliche Kunstsammlungen de Dresde, dont la visite virtuelle du musée est entièrement recréée dans un graphisme qui reste tout à fait convaincant, malgré le fait qu'il ne faille pas non plus vous attendre à une qualité de l'image digne d'un vrai jeu vidéo sur Second Life.
De vraies ambitions pédagogiques ont été révélées sur les différentes îles de ce monde et il est même possible pour notre avatar de prendre des cours dans des écoles virtuelles : les musées ne sont pas en reste dans ce domaine, et délivrent peu à peu des informations sur leurs collections, leurs expositions, proposent des démonstrations... Ainsi le réseau des musées municipaux de Rome, Musei in Comune, est-il très présent sur Second Life, après avoir fait le choix d'acheter des terrains virtuels en vue d'y présenter leurs expositions temporaires, moyen ingénieux d'en conserver la trace et de faire vivre / revivreà un public ces manifestations trop éphémères.
Autre lieu, autre choix : le musée de l'Holocauste de Washington nous propose, comme dans un jeu d'aventure traditionnel, de cliquer sur différents documents éparpillés dans ses salles d'expositions afin de reconstituer au fur et à mesure la Nuit de Cristal du 9 au 10 novembre 1938, nous immergeant peu à peu dans un décor et une ambiance propres à nous faire ressentir au plus près l'horreur du pogrom juif.
Façade de la Dresden Gallery
© Second Life
Beaucoup d'autres initiatives seraient à signaler, et notamment le fait que beaucoup de musées virtuels, véritables créations d'utilisateurs de SecondLife, se sont multipliés, preuve de la dynamique artistique engrangée par ceux-ci. Petit inconvénient : en lançant une recherche dans la grande base de données du site, au mot « musée », sans précision particulière, vous netrouverez guère que toutes ces créations, ne sachant d'ailleurs plus trop discerner qui pourrait être issu d'un musée « réel ».
Il faudra vraiment préciser votre recherche pour espérer obtenir des résultats probants, et encore ! Si vous recherchez le musée de Dresde, inutile de recopier son intitulé allemand à rallonge, vous ne le trouverez pas : un modeste Dresden Gallery fera l'affaire. L'interface n'est pas non plus très simple, on peut facilement se lasser d'évoluer avec son avatar dans ce monde où l'image met du temps à se charger. Pour les moins patients, beaucoup de vidéos de visites ont été postées sur Youtube, et je ne peux que vous conseiller de regarder celles du musée de Dresde, vraiment très complètes.
A vous présenter tout cela, on est tout de même en droit de se demander ce que cette présence virtuelle peut vraiment apporter, tant au visiteur qu'au musée. Peut-on considérer cela comme un vrai outil de médiation ? Second Life met en exergue la démarche de musées faisant à l'origine un choix fort de visibilité : être présent sur Second Life demande du temps et de l'investissement, est aussi révélateur de mode d'expérimentations original, avec parfois une vraie adaptation du discours au virtuel.
Avoir la possibilité de visiter le cybermusée avant de se déplacer concrètement dans le lieu, avec la chance de n'avoir aucun autre visiteur dans la salle, de pouvoir s'approcher des tableaux, font que les utilisateurs de Second Life peuvent assez bien préparer leur visite, en repérant les lieux de manière inhabituelle. Ceci dit, la qualité des informations délivrées y est le plus souvent minime. Lorsque des visites guidées virtuelles sont proposées, comme sur la reconstitution de la Rome Antique ou un chantier de fouilles non loin d'une pyramide de Kheops pixellisée, la pertinence du contenu peut alors rivaliser avec le simple plaisir visuel du « repérage des lieux ».
Mais quant au reste, il me semble que le chemin est encore long avant d'aboutir à une réelle médiation dans ce domaine des musées sur Second Life, et qui ne sera peut-être pas parcouru avant longtemps. En effet, si la plateforme du jeu a connu un âge d'or en 2006/2007, au point qu'une bonne partie de la campagne présidentielle française virtuelle de 2007 se soit jouée sur SecondLife, les activités et la dynamique du site semble aujourd'hui en constante perte de vitesse et les musées présents sur SecondLife ne le précisent même pas sur leur site internet. Que faire quand la communication entre notre monde réel et sa recréation virtuelle semble coupée ?
Lucie Rochette

Silence, il s'expose
L’exposition « Silence » part du postulat que le silence est rare dans nos sociétés modernes et sur-stimulantes : tout bouge et évolue, les moyens d’accaparer l’attention se multiplient, notamment par le biais des courriels, réseaux sociaux et autres - « Ding ding ! » applications aux notifications infernales rappelant à l’ordre les utilisateur.ices.
Il faut traiter immédiatement la notification, consulter ou faire glisser hors du champ de vision la petite icône, sous peine de la voir longuement trôner dans un encadré angoissant, « barre des tâches », de l’écran. A contrario, ce qui demande un effort et un peu de courage, c’est d’activer le mode avion.
L’habitude facile, pourtant dommageable, est de continuer ainsi même dans une exposition smartphone parasite en poche, au lieu de s’ancrer autant que possible dans le présent, et de s’avancer vers une expérience inconnue. Cette exposition fait exception : écouteurs sur la tête, le.la visiteur.euse est immergé.e dans le silence.
« Silence » (Cité des sciences et de l’industrie, Paris) a l’ambition d’être une exposition immersive, vous amenant à expérimenter le silence sous différentes formes, avec un fort objectif méditatif. A l’aide d’un dispositif binaural généré en temps réel et d’un casque, vous évoluez individuellement dans l’espace de l’exposition, selon vos envies. Un système de captation de la position de chacun assure un parcours sonore individualisé.
Le but principal est d’explorer les multiples facettes du silence, qu’il soit perçu comme un refuge, une absence ou un espace d’introspection. Le scénario d’exposition se décline en 6 modules, décomposant le sujet (voir Plan). L’ensemble est conscrit entre une introduction et une conclusion décisives, comme des sas sensibles et par lesquels les visiteur.ices peuvent s’ancrer dans l’expérience.
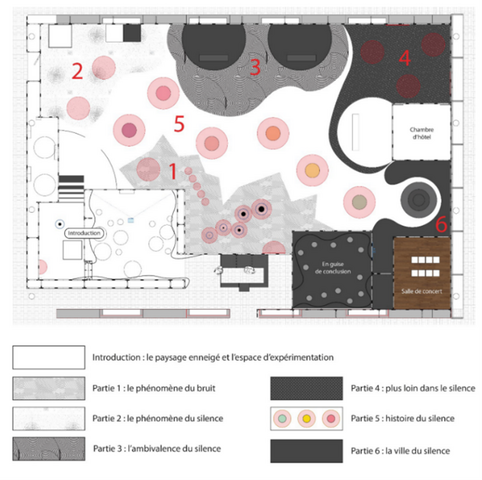
Plan, Dossier enseignants de l’exposition Silence. © Cité des sciences et de l’industrie, Paris.
Ce premier temps est une familiarisation avec le sujet et le type d’approche, laissant à chacun.e la possibilité de s’habituer au dispositif auditif. Dans une salle aux revêtements cotonneux, l’image d’un paysage blanc est projetée, doucement animée par la neige tombant en continu. Ayant pris place sur les assises, vous écoutez la voix accompagnatrice expliquer le déroulé de l’exposition et la diffusion particulière du son en accord avec les déplacements.
Vous évoluez maintenant au centre de l’exposition, avec d’un côté le phénomène du bruit et de l’autre, celui du silence. Complémentaires, ces deux sections accès sur l’aspect physique interrogent l’intensité du son et l’existence du silence absolu ; en réduisant au maximum le bruit extérieur par exemple, vous expérimentez la chambre anéchoïque, une salle d'expérimentation dont les murs et le plafond sont totalement absorbants aux ondes sonores ou électromagnétiques. Mais observerez-vous pour autant un silence parfait ? C’est le battement de votre cœur que vous entendez ?
Après avoir abordé les oppositions silence/bruit, vient l’ambivalence du sujet : le silence est-il constamment une source de bien-être ? En s’appuyant sur deux exemples d’isolement, l’un délibéré et l’autre subi, le module traite de la relation du silence avec l’être humain, ses liens positifs comme négatifs sur son développement psychique.

Vue de la salle introductive. © N Breton-EPPDCSI
Plus prégnant encore, le silence volontaire anime un module voisin. Dédiée à l’expérience de Sara Maitland, isolée sur une île déserte pendant quarante jours, le module s’intéresse au potentiel d’introspection quasi-métaphysique de ce son et ses conséquences sur la conscience humaine.
Dans une approche historique, une section propose quelques exemples où le bruit et le silence ont marqué les sociétés à des périodes différentes, telles qu’à l’époque antique via l’Odyssée d’Homère, la période contemporaine, ou plus immémorial, durant le Big Bang, un cataclysme cosmique imaginé par tous et toutes comme bruyant. La reconstitution de ces scènes, sous forme de saynètes audio créées pour l’occasion, vous transporte dans ces moments clé ; comme lors des bombardements pendant les guerres mondiales ou lors d’une journée immaculée de bruit dans un cloître médiéval.
Enfin, le silence est contextualisé dans les environnements urbains modernes, notamment via la construction d’espaces significatifs tels que la chambre d’hôtel et la salle de concert. Sous quelles formes le silence existe-t-il dans ces lieux ? Quels refuges silencieux face à la pollution sonore omniprésente ? L’intégration de productions artistiques célèbres (l’œuvre musicale 4’33 de John Cage, et le poème Ma vie n’est pas de Rainer Maria Rilke) interroge également le bruit en tant que matière inspirante.
Enfin, le module conclusif prévoit une rencontre sonore méditative avec Niklaus Brantschen, jésuite et maître zen, qui partage ses réflexions sur les effets guérisseurs du silence, les bienfaits de la méditation, et la perspective d’un silence qui « relit et guérit ». Les mêmes assises qu’à l’introduction vous sont proposées pour pouvoir sereinement clôturer ce voyage et ouvrir les perspectives de l’« après-visite » du.dela visiteur.euse.
Captiver avec des sons et des silences
Conçue par le Musée de la Communication de Berne, l’exposition a précédemment ouvert ses portes en Suisse en 2018 sous le titre de « Sounds of Silence », en tant que premier grand projet depuis la réouverture de l’institution en août 2017.
L’utilisation de la technologie du son binaural, loin d’être un gadget de l’exposition, modèle une expérience réaliste en permettant de recréer l’effet d’une écoute naturelle en 3D, comme si le son provenait de l’environnement réel. En utilisant des microphones placés à la hauteur des oreilles humaines, cette technique capture les sons en tenant compte de leur direction et de leur distance. Cette diffusion réaliste s’adapte aussi en temps réel aux déplacements du public, faisant de chaque parcours une expérience unique.

Vue de l’ambiance graphique, Silence. © N Breton-EPPDCSI
Notons également que ce dispositif audio, allié à des vidéos et images d’environnements (paysage enneigé, forêt, mur d’une cellule, vue urbaine nocturne etc.) est entièrement chargé de médiatiser les contenus. Si ce choix peut paraître risqué, trop monotone, il permet de conscrire l’attention du public. Celui-ci, absorbé par le réalisme de la production, prend connaissance de la variété de formes dans la trame auditive : récits d’un point de vue externe racontant notamment l’histoire de l’ermite Christopher Knight ayant choisi de vivre sans contact humain pendant 27 ans, l’interprétation du poème de Rilke, reconstitutions, texte de création lyrique portant sur l’expérience de l’absence de stimuli (la « torture blanche »), vulgarisation scientifique, etc. Plus largement, un bel équilibre est respecté entre les propos et leurs incarnations, notamment avec des exemples parlants et compatibles avec le format audio, respectant le principe d’immersion.
L’effort muséographique pour attiser l’attention des visiteur.euses est soutenu par un design intérieur minimaliste, clair et calme, ayant reçu le IF Design Award 2020. Les choix de n’exposer aucun objet et de dissimuler à la perfection l’équipement technologique façonnent une expérience visiteur intuitive et favorisent la construction d’un paysage sonore. Au-delà d’espaces reconstituant des environnements précis tels qu’une cellule d’isolement ou la forêt, est appliqué un langage visuel qui éclaire les contenus plus abstraits ; lignes graphiques, torturées dans divers sens, associations, formes, et rythmes, évoquent les propagations d’ondes sonores, ou au contraire, des vides indiquent leurs absences.
Tout.e seul.e, ensemble
« - Tu ne te sens pas trop isolée avec ce casque ?
- Hein ? Qu’est-ce que tu dis ?
- Non rien laisse tomber… »
En fin de parcours, en retirant l’équipement de vos oreilles, vous aurez l’impression de renouer avec les autres, et plus spécifiquement avec vos accompagnant.es. En réalité, c’est le bruit et l’agitation environnants que vous rejoignez. Vos semblables, eux, ne vous ont jamais vraiment quitté. Ils étaient juste-là, à côtés, attentifs.
En principe, le dispositif audio utilisé comme seul principe de visite fait craindre une expérience isolante. Ici, la technologie mobilisée fait sens avec le sujet présenté et soutient une démarche réflexive, resserrée sur l’individu et sa manière de gérer le silence. En poussant vers un retour à soi, contrôlant les stimuli proposés, le dispositif permet un moment de méditation, vécu de manière plus ou moins simultanée, qui trouve une résonnance particulière en chacun.e. L’isolement du casque permet donc de créer cette bulle personnelle, et de traiter du silence de manière immersive.

Vue du module « ambivalence du silence », Silence. © N Breton-EPPDCSI
Enfin, la dimension poétique de cette mise en silence réside dans le partage simultané – ou presque, des expériences, et ce, sans piper mot. Les espaces étant rattachés à des pistes audio précises, vous partagez avec les inconnu.es avoisinant.es les mêmes contenus. Asseyez-vous ici, à côté de cette personne pour apprécier l’histoire racontée ; à quel moment de la piste en est-elle ? Pouvez-vous le deviner en observant ses réactions ou sa gestuelle ? Comment ressent-elle cela ? Tente-t-elle de deviner vos pensées en retour ? Ces divagations s’établissant, vous expérimentez une autre facette du silence, qui ne figurait peut-être pas au synopsis de l’exposition, qui est celle du silence vécu en relation, par une attention et une imagination propre à chacun.e.
Romane Ottaviano
Exposition crée par le musée de la Communication, Berne.
« Sounds of Silence » du 7 novembre 2018 au 7 juillet 2019.
Actuellement à la Cité des sciences et de l’industrie, Paris.
« Silence » du 10 décembre 2024 au 31 août 2025.
Pour aller plus loin :
https://youtu.be/wQQHZcbHKdA
2018 | Museum of Communication | Bern - usomo
|
#ExpositionSilence #ExpositionImmersive #binaural |

Silence… BIG BANG !
Ambiance feutrée rouge. Alignement de sièges cosys. Ecrans plats. Présentation des « acteurs ». Générique…Non nous ne sommes ni au cinéma, ni au théâtre, mais bien dans l’un des dispositifs muséographiques du PLUS. Le Palais de l’Univers et des Sciences de Cappelle-la-Grande pousse lexicalement le rapprochement en intitulant cette installation multimédia « le théâtre du Big Bang ». Appellation quelque peu spectaculaire, mais qui, finalement, concorde parfaitement avec l’ambiance de l’exposition permanente et sa promesse de voyage au cœur de l’Univers !
© droits réservés
L’expérience interactive, la réplique phare
Le synopsis du guide de visite nous prévient : « une quarantaine d’expériences interactives » nous attendent tout au long du parcours. Ainsi, les écrans et les manettes se dupliquent. Tout le monde peut regarder et manipuler, en d’autres termes participer. La nouvelle technologie s’invite donc dans cet équipement culturel, sans malheureusement réussir à vaincre son ennemi : la panne a en effet la fâcheuse manie de se dupliquer elle-aussi !
Dans le « théâtre du Big Bang », tout fonctionne. Hubert Reeves, Marc Lachièze Rey et François Bouchet, astrophysiciens et cosmologues de renom, sont nos interlocuteurs privilégiés. Ils nous expliquent le Big Bang, en effaçant petit à petit la part de mystère que revêtent des termes comme la température de Planck, le quark ou encore le fonds diffus cosmologique.
Multiplicité de plans et d’écrans ou l’invention du travelling humain
Ici ce n’est pas la caméra qui effectue un travelling circulaire, mais bel et bien le visiteur. A l’aide d’un siège rotatif, il est amené à suivre le film projeté tour à tour sur trois écrans différents. Du spectateur passif, nous passons au spectateur actif voire même sélectif. En effet, le film ne se contente pas de passer d’un écran à l’autre. Quelquefois, les écrans se complètent : soit l’astrophysicien se présente sous différents profils selon les écrans, soit un schéma ou une photographie appuie ses propos sur un autre écran, soit les deux ! De plus, un fond sonore, fait de bruits sourds et généralement puissants, amènent le visiteur à s’immerger totalement dans cette présentation du temps zéro de notre Univers.
Bien sûr, il serait évident de rétorquer que toute la partie sonore ne pense pas aux visiteurs sourds. En réalité, le PLUS a développé de nombreux équipements pour les personnes souffrant de handicaps, notamment des maquettes tactiles pour les malvoyants. Ici, deux écrans, certes plus petits, viennent s’ajouter aux trois autres. L’un montre la vidéo présente sur les écrans principaux, l’autre la traduit en langue des signes française. Malheureusement, ces spectateurs perdent ce qui pour moi fait tout l’intérêt de ce dispositif, et marque sa différence avec une vidéo classique : le choix d’un spectateur actif !
Le hors-champ
Mais l’éveil ne s’arrête pas là. Les murs de cet espace de projection sont volontairement sectionnés par endroit afin d’ouvrir la perspective et de proposer une interaction entre le film et d’autres modules. Il se peut, en effet, que le visiteur-spectateur n’est pas entièrement compris l’information donnée par des spécialistes au langage et à la formulation quelque peu soutenus (c’est effectivement mon cas). Alors, pas de panique ! La scénographie l’incite à se diriger vers des modules expliquant et complétant la vidéo suivant différentes présentations plus ou moins attractives : un élémentaire tableau sur les particules élémentaires, une maquette du satellite Planck lancé en 2009 pour dévoiler les secrets du Big Bang, une BD rétro-éclairée sur la découverte du fonds diffus cosmologique, pour n’en citer que quelques-uns.
Ce dispositif conserve tout de même un paradoxe. La difficulté de comprendre une théorie aussi complexe que celle du Big Bang pourrait être augmentée par cette nécessité, toutes les deux minutes, de changer d’orientation, d’écran et d’interlocuteur. Mais dans un sens, cela rejoint l’idée du modèle cosmologique qu’est le Big Bang : c’est-à-dire un univers toujours en expansion, et donc non statique !
Alors, nos yeux, sortes d’électrons libres, se déplacent dans cet espace, pour finalement suivre une trajectoire aléatoire propre à chacun !
Marion Monteuuis
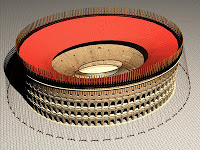
Tous les chemins mènent à Rome
"Nous voici à l’intérieur du majestueux amphithéâtre de Rome. Qu’est-ce-qui nous attend dans ce nouveau monument que Titus va inaugurer ? Des espèces animales inconnues venues de tout l’Empire ? Un spectacle de gladiateurs ? La tribune impériale est vide, l’arrivée de l’Empereur doit être imminente. L’ambiance est survoltée et plus une seule place n’est libre dans les gradins. Des rumeurs disent qu’ils peuvent contenir jusqu’à 75 milles personnes. La chaleur n’arrange rien à la foule, il est midi et pas une seule ombre pour nous protéger du soleil. D’un coup, un bruit continu et sourd se fait entendre, comme un roulement venant du ciel. Des cordes se tendent au-dessus des gradins, à plus de 48 mètres de hauteur, et petit à petit des bandes de velum se déroulent et ne laissent qu’un ovale ouvert sur l’arène centrale. Enfin de l’ombre ! Des bruits de cornes retentissent, l’Empereur Titus s’installe et annonce l’inauguration de l’amphithéâtre. Le spectacle peut commencer. "
Figure 1. Modélisation du Colisée© Université de Caen
Malheureusement … ce récit n’est pas réel. Je n’ai jamais eu l’occasion de vivre un spectacle de gladiateurs à l’intérieur du grand Colisée de Rome. C’est mon imagination, aidée par une reconstitution virtuelle de la Cité antique de Rome, qui vient de vous transporter au 1er siècle de notre ère. Vous pouvez vous aussi la découvrir sur votre ordinateur grâce au site internet à l’initiative de l’Université de Caen.
Une équipe composée de chercheurs en histoire et histoire de l’art, ERASM, ont pour mission la modélisation et la mise en ligne d’une visite virtuelle de la cité antique de Rome depuis 1994, à partir du plan-relief de l’architecte Paul Bigot. Ce dernier, grand prix de Rome en 1900, l’a conçu entre 1930 et 1940. Une des deux reconstitutions1, faite par l’architecte, de 70m² a été léguée à l’Université de Caen à sa mort. Cette maquette en plâtre², à l’échelle 1/400°, a été réalisée à partir des recherches recensant l’état de la cité impériale à l’époque de Constantin au IVème siècle. Un partenariat a été mis en place depuis le 10 mars 2010 avec le Projet « Rome Reborn », de l’Institut pour les avancées technologiques dans les sciences humaines de l’Université de Virginie aux Etats-Unis, afin de mutualiser leurs recherches.En plus de la plateforme de visite virtuelle, le site web dédié à cet outil recèle de nombreuses explications. La globalité du projet est abordée, de la naissance de l’idée de la modélisation de la cité antique de Rome aux différentes phases permettant la modélisation d’un lieu.
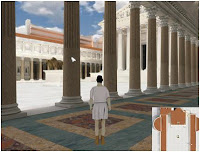
Figure 2. Le personnage dans la visite virtuelle© Université de Caen
A l’aide d’un petit personnage et de sa souris, la découverte interactive des monuments antiques se fait en toute facilité. L’immersion est totale et on se prend à imaginer les rues bondées d’habitants, tout comme les bruits et les senteurs. Cette impression est corroborée par une modélisation de qualité qui, sans avoir un écran des plus sophistiqués, permet de visualiser de manière précise et claire des détails architecturaux. De plus, on retrouve sur le site une liste des monuments majeurs de la cité qui permet un accès direct à des informations, des images, voir des vidéos, concernant chacun d’entre eux.
Un des aspects qui a fait la renommée de la plateforme de visite virtuelle est l’importance donnée au contenu scientifique. Tous les textes prennent pour sources les recherches des plus grands spécialistes de l’antiquité romaine, des rapports de fouilles archéologiques, ainsi que des traductions de textes anciens du latin et du grec. Cette accumulation de savoirs depuis des années sur Rome a permis d’inscrire dans la visite virtuelle de nombreuses explications sur les techniques de constructions, les matériaux utilisés mais aussi sur les activités qui avaient lieu dans ces monuments.
La visite virtuelle de la cité antique est un outil qui peut être utilisé à des fins pédagogiques notamment dans des cours de niveau collège, ou Rome et son Empire font partie du programme d’histoire. L’atout de cette utilisation est de pouvoir illustrer des cours de manière ludique, en apprenant des bases d’architecture et d’histoire. Elle permet aussi de faire découvrir la modélisation aux élèves, ainsi que l’apprentissage du matériel informatique.
Aujourd’hui, les innovations technologiques font des merveilles… et en faisant cette visite virtuelle de Rome, je me prends à rêver d’une reconstitution virtuelle complète de l’Empire Romain.
Laura CLERC
1 La deuxième est exposée au Musée du Cinquantenaire à Bruxelles² Elle a été classée monument historique en 1978

Un audio-guide au coeur des oeuvres
Si la plupart des musées ont tendance à opter pour les nouvelles technologies, le Petit Palais a préféré conserver un instrument plus classique : l’audio-guide. Si son aspect peut paraître désuet de nos jours, je fus surprise par les nombreux avantages qu'offre cet outil.
Simple et maniable, il est accessible à tous, ce qui est très appréciable. Facile d’utilisation, l’audioguide se présente comme une petite télécommande avec un écran digital, des touches numériques et fonctionnelles.
Quelques points négatifs sont à relever. A mi-chemin seulement de ma visite, l’audio-guide m’indiquait déjà un faible niveau de batterie. Deux choix se posèrent à moi : accélérer ma progression et ne m’attarder que sur les œuvres indiquées ou retourner à l’accueil en redemander un. Mon choix fut vite fait étant donné tout le chemin déjà accompli !

Crédits : Emilie Etienne
A l’heure où les nouvelles technologies investissent les musées, il est étonnant de pouvoir encore observer ce genre d’outils semblant sorti d’un autre temps ! Dans beaucoup de structures culturelles, ce sont les Iphones et Nintendo DS ou encore les tablettes tactiles qui accompagnent le public. De ce fait, si cet audio-guide peut convenir à un public averti peu habitué aux nouvelles technologies, il peut paraître à la limite de l'obsolescence aux yeux des plus jeunes qui vont facilement s’en détourner.
Si l’audio-guide ne remplacera jamais un guide-conférencier, il offre tout de même quelques atouts. Comme c’est agréable de pouvoir visiter une exposition sans contrainte d’horaire et de contempler les collections sans avoir à suivre un groupe.Tenu par deux narrateurs principaux, le discours est très vivant et dynamique notamment grâce à l’intervention régulière des conservateurs du musée.
Plus besoin de faire des allers et retours entre le tableau et le cartel. Ces professionnels présentent une description claire des tableaux agrémentées, dans certains cas, d’un fond sonore. Ces exposés sont parfois complétés par les citations du peintre et un rappel du contexte social et historique dans lequel il s’inscrit.A mon sens, certaines informations manquent cruellement : le courant artistique ou encore le repère chronologique. Tout en me remémorant mes connaissances en Histoire de l’Art, un rappel des caractéristiques de la peinture impressionniste ou du courant réaliste aurait été souhaitable. En cela, une fois encore, le jeune public et les néophytes sont exclus. Les propos tenus semblent ne s’adresser qu’à une audience avisée qui souhaite peut-être compléter ses connaissances.
Après ma visite, peu habituée à l’audio-guide, j’ai été convaincue de son utilité et le recommande vivement malgré les quelques remarques évoquées. Voici enfin terminé le parcours où on se contente de contempler sans comprendre était d’usage. Grâce à lui, l’œuvre prend vie et le visiteur devient spectateur de l’instant immortalisé par l’artiste.
Emilie Etienne
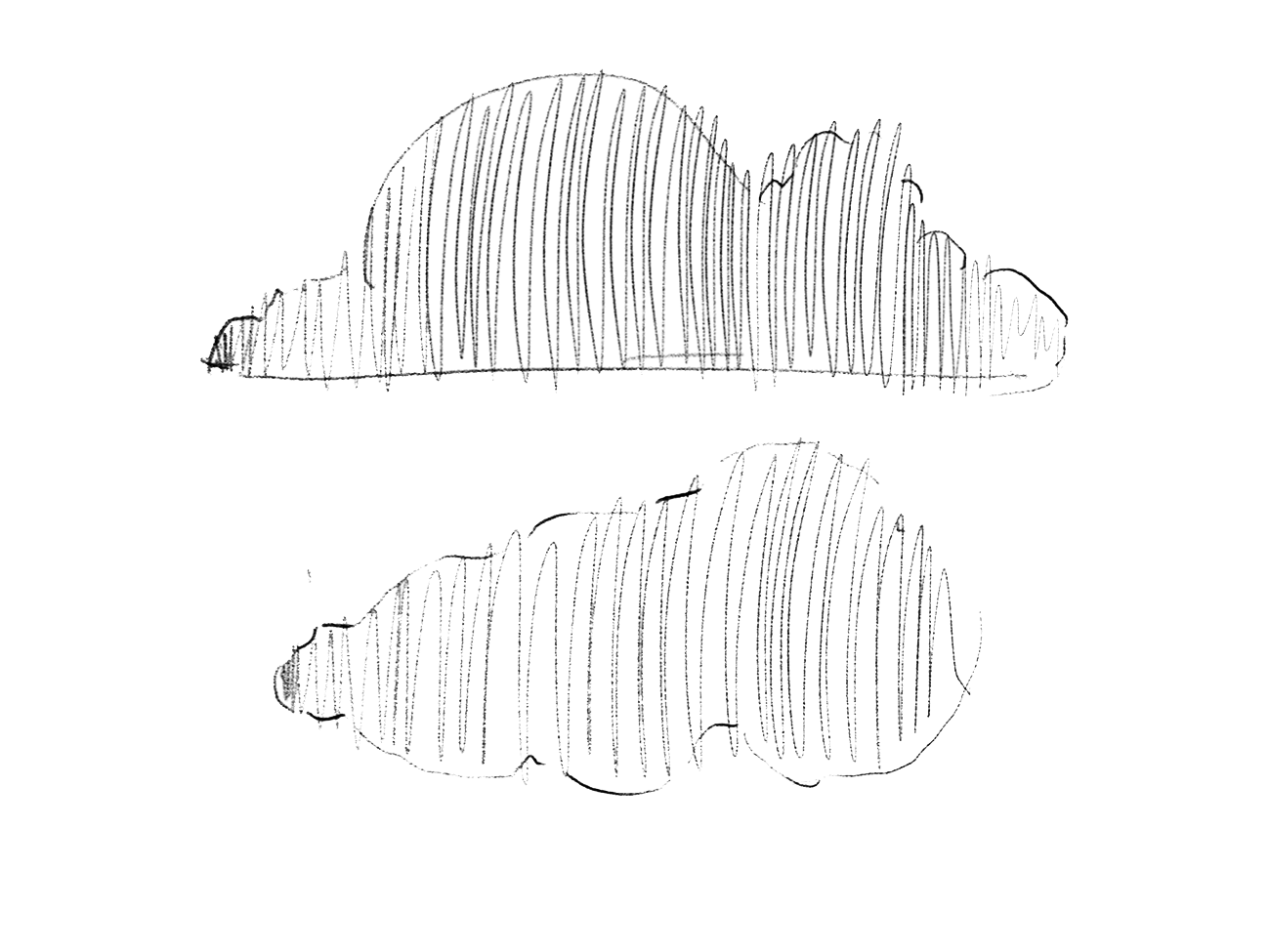
Un musée virtuel de Gaza
Un collectif d'artistes Gazaouis se regroupe au MuCEM afin d’échanger autour de leur nouveau projet : SAHAB, la création d’un musée virtuel de Gaza. Dans une ville ou il n’y a pas de musée (et bien d’autres institutions manquent à l’appel), cet échange relance l’espoir et l’engagement de créer un lieu de culture pour une population qui en est privée de par la guerre en Palestine.
Les Gazaouis au MuCEM
Le MuCEM à Marseille a été inauguré en 2013 suite à la nomination de la ville “Capitale Européenne de la Culture”. De par ce titre, une multitude d’actions culturelles, et surtout de chantiers de rénovations ont eu lieu à Marseille : construction du dit musée, rénovation complète du Musée d’Histoire de Marseille et construction de l’Ombrière miroir du Vieux-Port. En soi, une somme d’argent colossale pour redynamiser la 2e ville de France, et en faire le poumon culturel du bassin méditerranéen.
Revenons au MuCEM. En ses murs, un endroit dédié aux échanges entre professionnels et scientifiques, incubateur de bonnes idées : le MuCEMLab. Situé au Fort Saint-Jean, c’est un espace consacré à la recherche et la formation. Y prennent place des cours et des conférences, des séminaires de recherche, des journées d’études et des colloques ouverts aux chercheurs, aux étudiants, mais aussi à tout public curieux d’y participer.
Présentation du projet au MuCEMLab ©AP
Le mercredi 1er juin, j’ai pu assister à la présentation d’un projet : SAHAB, le musée des futurs de Gaza.
Actuellement en résidence à la Cité internationale des arts à Paris, le collectif HAWAF (Mohamed Bourouissa, Salman Nawati, Mohamed Abusal et Sondos Al-Nakhala) se retrouve au MuCEM et nous fait part de la situation à Gaza : c’est un territoire sous blocus et embargo, ou toute construction physique n'échappera pas à la destruction par bombardement. C’est une ville isolée du monde. Il n’y a aucune institution culturelle, ni de musée physique. Pourtant, la topographie et l’histoire de la ville sont très intéressantes : c’est une ville historique, une ancienne plaque tournante du commerce eurasien depuis les anciennes civilisations. Sous terre, se cache un nombre incalculable de trésors. Gaza s’étend sur 365km² pour 2 millions d’habitants, qui s'intéressent à leur histoire.
Dans ce contexte particulier, une grande scène artistique contemporaine émergente existe pourtant (dont fait partie le collectif HAWAF) et propose des projets innovants, avec une forte volonté de transmission d’un héritage culturel mis à mal depuis des décennies de guerre.
D’après les artistes, c’est la rencontre de l’art et de la culture populaire qui est le meilleur moyen pour développer une société, le musée étant le garant du maintien et du rayonnement de cette culture.
Revenons à notre collectif… Le projet qu’il porte a été initié par l’Institut français, implanté à Gaza depuis 1989. Cet institut accompagne la scène artistique en proposant des échanges et des résidences en France. C’est un projet qui se veut heureux, en contraste avec la situation à Gaza. L’envie principale est de parler de la ville, et de créer un projet fédérateur qui dépasse le noyau dur des artistes.
SAHAB, le musée virtuel
C’est de ces envies que la décision de créer un musée numérique et virtuel a émergé. Il ne pourra pas être détruit physiquement et demandera un budget beaucoup moins élevé. Les outils nécessaires sont à disposition, ainsi que le savoir-faire : les Gazaouis, dispersés dans le monde de par les migrations, ont pour habitude de travailler avec des outils numériques. Les artistes ont également une formation d’art numérique.
SAHAB, le nom du projet signifie “le nuage”. Il porte la même signification que CLOUD en anglais, et est donc lié au numérique. De plus, un nuage dans le ciel appartient à tous. L’idée de construire un musée nuage est née.
Sa forme suivra le principe de la sédimentation : comme une strate, y sera présenté le passé et le présent de l’histoire de la ville. Chaque ligne de cette strate représente une histoire singulière.
Sahab, un musée virtuel ©AP
Qu’est-ce qui est important dans ce projet ?
Pour commencer, un mot : isolement. C’est leur lutte principale. Les populations sont isolées du monde. Ensuite, la notion de communauté : ils souhaitent la recréer, et la rendre visible. “Rebuild the community… Throught the immaginary museum !” disent-ils.
Après de multiples discussions avec la Cité des Arts, la discussion tourne autour des collections qu’un musée virtuel peut posséder. S’en dégagent 4 pistes : des collections plutôt archéologiques ? Folkloriques ? D’art moderne ? D’art contemporain ?
Un éco-musée de Gaza ?
Les collections autour du folklore ont provoqué le plus d’engouement. Partir de l’histoire des habitants et des objets qu’ils possèdent pour constituer une collection et permettre de créer un lien entre les communautés et le musée. Cela n’est pas sans rappeler l'avènement du musée des ATP au bois de Boulogne.
De plus, à Gaza, il y a un mélange entre les gazaoui et les Palestiniens des autres villes qui ont apporté une culture différente. Il y a donc un terreau et une richesse culturelle populaire extrêmement riche.
La première exposition pourrait être “What it means to have a museum in Gaza ?”, soit “Qu’est-ce que cela représente d’avoir un musée à Gaza ?”. C’est une collecte à partir d’enfants et ado de Gaza en leur posant cette même question.
Des réflexions sont menées notamment sur l’intégration des enfants dans ce processus de création : peut-être en ayant des jours dédiés pour eux dans le musée virtuel ? Un coin interdit aux adultes ?
De fait, l’envie principale est de stimuler l’imagination et de continuer à rêver : “Et si on avait… Et si on avait… Et si on avait…” se posent sans cesse les artistes. C’est un musée imaginaire, mais qui s'ancre dans la réalité. Celle des Gazaouis.
Les habitants possèdent chez eux des trésors à valoriser ©AP
Un projet similaire avait vu le jour en 2015, le “Palestinian Museum”. Cependant, il fut énormément critiqué dès son inauguration car il n’y avait aucune collection, et que cela avait coûté une somme d’argent considérable avec son architecture monumentale. La première exposition portait également sur des interviews en format numérique car le musée était fermé à ce moment-là. Il y a peu de nouvelles de ce musée depuis. C’est l’avantage de vouloir créer un musée virtuel, c’est l’affranchissement envers le bâti. Des liens sont tout de même tissés entre différentes structures du Proche-Orient autour de ce projet.
Y ont eu lieu des coopérations entre des musées parisiens comme Orsay et L’Institut du Monde Arabe. Le projet SAHAB est un héritier de ce mouvement qui n’a pas réussi à donner fruit, et pour cause. Pour le moment.
De ce constat est né le projet d’une deuxième exposition : faire part de tous les essais de création de musée en Palestine, bien nombreux entre 1992 et 2002.
Pour l’économie du projet, des pistes sont déjà avancées : le collectif répond à des appels à projet, compte sur des subventions pour son développement, et prévoit de créer une économie autour des nft et des tokens. Cependant, avec la chute de ces derniers ces dernières semaines, il est difficile d’imaginer une économie durable autour de cette monnaie.
Pour finir, la question principale reste la façon d’intégrer des habitants de Gaza et de la diaspora palestinienne à ce projet. Pour rappel, l'électricité est disponible quelques heures par jour, et l’accès à internet non systématique. Les artistes répondent que, de toute manière, quand rien n'existe, tout est possible. C’est un projet qui donne l’opportunité à la rencontre de quelle que soit sa nature. Un musée virtuel fait sens. Surtout quand, de par la guerre qui ravage des pays et l’immigration qui s'ensuit, il est plus facile de connecter les communautés du monde entier plutôt que de se rendre à Gaza pour visiter un musée.
Des actions dans Gaza, “online/offline” ©AP
Alexis
Pour en savoir plus :
Il y encore peu d'informations sur ce projet. À venir !
#patrimoine #société #numérique

Un panorama sans horizon
D’extérieur, le Panorama XXL de Rouen peut interroger. Quel est donc ce cylindre bleu vif de trente mètres de haut ? Posté sur les quais de la Seine, il peut surprendre et se confond avec les clochers d’églises ou de la cathédrale. Implanté depuis 2014, il est ancré dans le paysage, certains Rouennais l’oublient, y sont habitués. Pour d’autres, sacrilège !
Depuis longtemps, les quais de Rouen ont été un lieu prisé par les artistes, et en particulier par les peintres. Pissarro, Corot, Monet, entre autres, ont tiré de la Seine des œuvres mémorables...Il n’était donc pas surprenant de voir une fois encore l’art prendre ses quartiers sur ces quais de Seine.
Le Panorama XXL de Rouen est un lieu d’exposition temporaire pour accueillir les œuvres de l’artiste Yadegar Asisi, d’abord prévu pour 5 ans, le projet a été prolongé de 2 ans. Certaines personnes l’ayant toujours connu dans le paysage indiquent qu’ils n’imaginent pas la ville sans son Panorama. Ce dernier a amené de vives réactions. Des pétitions ont circulé dans la ville pour la destruction ou le déplacement du panorama, prenant comme arguments son coût financier et l’aspect peu esthétique du lieu.
Image de couveture : Panorama XXL de Rouen © Jeandavid Blaise
L’artiste à l’origine du Panorama XXL à Rouen est Yadegar Asisi. Autrichien, il est architecte et diplômé de peinture de l’Académie des Arts de Berlin où il vit. Dans son art, l’artiste aime utiliser les nouvelles technologies et créer en mélangeant les styles. Couleurs, pigments et perspective sont au cœur de ses œuvres. C’est en 2003 qu’il commence à créer ses panoramas, d’abord exposé en Allemagne, à Leipzig, Dresde et Berlin, il expose à Rouen depuis 2014.
Mais le panorama XXL ce sont aussi des recherches scientifiques et méticuleuses. Pour créer ses toiles, Asisi effectue un long travail de recherches en se rendant sur place où il réalise des séances photos dans le décor envisagé pour son œuvre future (en Amazonie, sur le mont Everest, ou en Australie par exemple). Il essaie absolument de recréer la réalité avec des détails historiques, architecturaux. Entouré de son équipe de 15 assistants il retravaille ses images sur ordinateur avant l’impression sur les toiles qui mesurent 3000 mètres carrés.
Si les panoramas de Yadegar Asisi sont une innovation par leur technique mêlant art, technologie et science, ceux-ci sont loin d’être les premiers dans l’histoire. Ce genre artistique était incontournable au XIXe siècle. C’est le peintre Robert Barker qui, en 1787, peignit un grand tableau circulaire, exposé dans une rotonde, créant ainsi le premier panorama. Les premiers sont exposés en Ecosse. Les thèmes sont variés. En France, les panoramas apparaissent vers 1800 à Paris, à l’initiative de James Thayer un armateur américain. Les rotondes présentent des vues de Paris, ou bien l’évacuation de Toulon par les Anglais en 1793.
Avant d’entrer véritablement dans l’œuvre, le visiteur a une courte exposition sur ce qu’il va découvrir. Des clés de compréhension sur le processus de création de l’artiste, de la technique. Pour la dernière exposition, « La cathédrale de Monet, l’espoir de la modernité » représentant la place de la Cathédrale au moment où Claude Monet l’a peinte, la première salle d’exposition se consacre à un bref historique du mouvement impressionniste, à Claude Monet et sa série Cathédrales. Le visiteur découvre ensuite des témoignages audios et vidéos de Yadegar Asisi pendant la réalisation des toiles, le travail avec son équipe ainsi que des esquisses.
Ces salles précédent l’immersion véritable permettent aux visiteurs de connaître le contexte général, puis de se consacrer pleinement au panorama, d’admirer simplement l’œuvre sans se poser de question. Il n’y a à l’intérieur aucun cartel, aucune explication. Libre, le visiteur peut s’approcher au plus près de l’œuvre, il se demande souvent si c’est une photographie ou une peinture tant les détails sont précis.
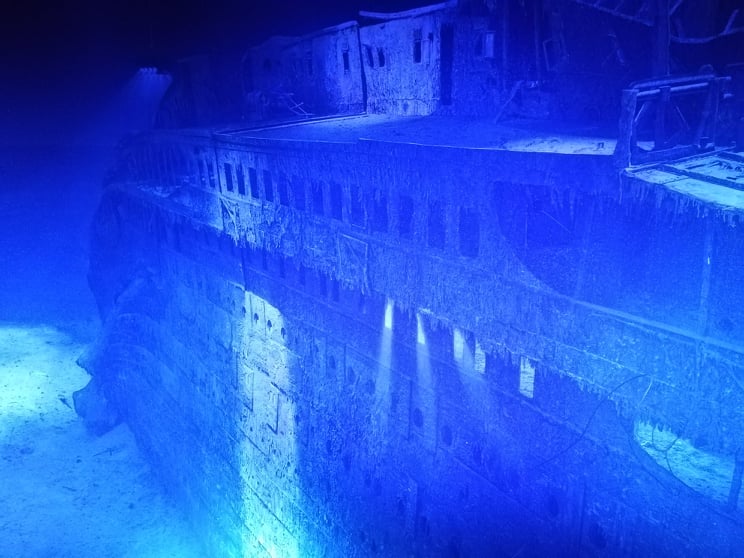
Intérieur du Panorama pendant l'exposition "Titanic les promesses de la modernité", 2020 © Alexia Thieriot
La médiation est très intéressante, avec du son et de l’image, le visiteur rentre à plusieurs niveaux dans l’œuvre, et le dispositif offre des vues globales à 360°. Les sujets abordés sont divers, c’est une des richesses du lieu. Pour les paysages naturels comme l’Amazonie par exemple, la lumière baisse en fonction du jour et de la nuit et le bruit change en même temps. La nature se réveille, accompagnée du bruit des animaux, du vent, des plantes, cela permet d’entrer dans la forêt et de se fondre dans le décor. La conception même de l’exposition amène des sensations physiques de hauteur, de vertige et de profondeur de champ : dans l’Amazonie la visite se déroule du sol à la canopée, au Moyen-Age on passe des rues pavées à l’aiguille de la cathédrale au fur et à mesure où l’on monte les étages de la tour centrale.
Il y a eu deux sujets spécialement sur la ville de Rouen, une volonté de l’artiste de « participer à l’identité de la ville », de la connaître différemment. C'est une vision nouvelle sur cette ville d'art et d'histoire. Monet devant « sa » cathédrale, et Jeanne d'Arc partant au bûcher interpellent le visiteur de manière très intime partageant leur fascination ou leur abnégation.

L'intérieur du Panorama pendant l'exposition "La Cathédrale de Monet, l'espoir de la modernité", septembre 2021 © Jeandavid Blaise
L’aventure du panorama a pris fin le 18 septembre dernier, déjà renouveler pour deux ans, la ville n’était plus en mesure de financer l’installation. Il est actuellement en train d’être démonter et ses matériaux devraient être entièrement recyclés.

Démontage du Panorama XXL sur les quais de Rouen, octobre 2021 © Alexia Thieriot
Marion Blaise
Pour en savoir plus :
https://www.asisi.de/en/homepage
#toile #numérique #expérience
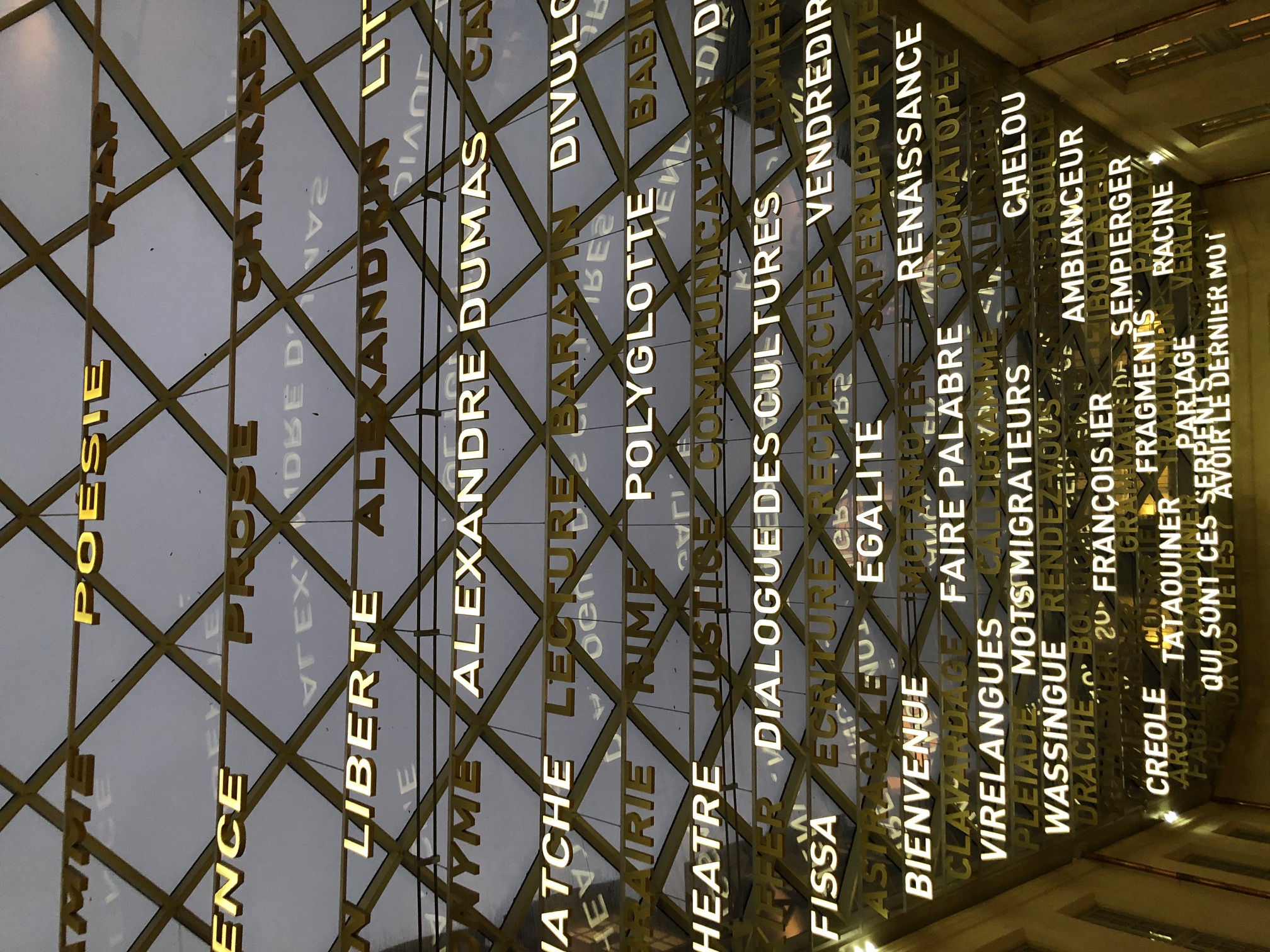
Un voyage en francophonie
« Cette Cité n’est pas un musée, c’est une institution culturelle profondément originale. C’est la première fois que, dans notre pays, une institution culturelle est consacrée à cet objet patrimonial et culturel qu’est la langue française », Elysée (Paris, octobre 2023).
Un territoire emblématique de l’histoire littéraire ?
Au centre d’une ville de 10 000 habitants telle que Villers-Cotterêts, dans l’Aisne, un imposant château se dresse. Riche d’histoire, ce fut le lieu où François Ier, en 1539, signe une ordonnance imposant l’usage du français dans les documents officiels, administratifs et juridiques. Cette signature généralise dès lors la propagation du français sur le territoire. Ancienne demeure royale transformée par Napoléon en dépôt de mendicité puis en maison de retraite en 1889, ce château subit plusieurs dégradations et tombe en désuétude, jusqu’à totalement être abandonné en 2014. Depuis 2018, lorsque le Président de la République Emmanuel Macron annonce son réaménagement, ce château de 23 000m2 reprend vie au cours de cinq années de travaux afin de devenir la Cité internationale de la langue française. Ce chantier titanesque est inauguré le 30 octobre 2023 comme site culturel dédié à la francophonie. La région Hauts-de-France est le terreau d’écrivains tels qu’Alexandre Dumas - le musée Alexandre Dumas se situe à Villers-Cotterêts - Jean Racine, Jean de la Fontaine, Paul Claudel ou encore Jules Verne, Marguerite Yourcenar, non évoqués dans la salle d’introduction dédiée à l’attractivité du pays du Valois. L’enjeu est sans doute moins de devenir un carrefour régional, même si cette dimension se trouve évoquée en préambule du parcours, que d’offrir une vision de la riche dimension internationale de la francophonie.
Lorsque le visiteur pénètre dans le hall d’accueil, il trouve à sa gauche la billetterie à laquelle est accolée une petite salle d’exposition temporaire. Sur sa droite se trouve une librairie-boutique, un café-salon de thé et, en face, des salles de réunion et un auditorium. Des locaux sont aménagés pour l’accueil des chercheurs dans le domaine linguistique, des studios pour des résidences d’enseignants, d’intellectuels et d’artistes. Situé au premier étage du logis royal, entre interactivité et ludisme, le parcours permanent en trois sections se répartit en quinze salles, et est précédé d’une salle d’introduction présentant le château et son territoire.
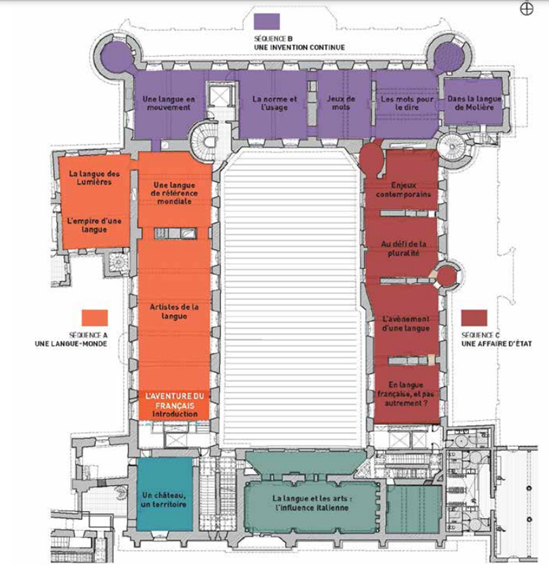
Plan de visite du parcours permanent de la Cité internationale de la langue française, au premier étage du Logis royal du château de Villers-Cotterêts ©SB
Projet politique, contenu scientifique, expérience numérique ?
« Premier lieu dédié à la langue française, par le cinéma, l’écriture, la littérature, le théâtre », Rima Abdul Malak, ministre de la Culture.
Le parcours permanent de la Cité offre une immersion complète au cœur de la langue française. Emmanuel Macron souhaite mettre à l’honneur et faire honneur, dans ce « château de la francophonie », aux figures essentielles que sont les écrivains, les comédiens, les traducteurs, les professeurs, en bref, ceux et celles qui, constamment, transmettent et font vivre le français. L’ambition de la Cité est d’expliquer, échanger et nourrir les recherches autour de la manière dont la langue française s’est formée et se formera.
Dans la séquence « Une invention continue », des dispositifs numériques sont présentés comme « La leçon d’orthographe » animée par les humoristes Arnaud Hoedt et Jérôme Piron. Linguistes de formation, ils trouvent que les Français sont peu exigeants, non pas avec leur propre orthographe ou celle des autres, mais avec l’orthographe elle-même. Ici, il ne s’agit pas de juger la langue, mais bien l’orthographe. La frontière entre l’orthographe et la langue elle-même est fine. Mais l’orthographe n’est pas la langue, l’orthographe c’est l’écriture de la langue. Sur un écran positionné face au visiteur, les deux humoristes énoncent un mot prononcé d’une seule façon mais avec deux propositions d’orthographe (par exemple, « mécanique » et « méchanique »). Quelques secondes sont laissées au visiteur pour se placer à gauche ou à droite de l’écran, en fonction de son choix. Puis la réponse correcte est donnée. Aucun score n’est attribué et aucun jugement n’est appliqué, seulement une histoire de l’étymologie. À la question « est-ce que ça se dit ? », Arnaud et Jérôme répondent invariablement « oui, tu viens de le faire ». Leur objectif à travers ce dispositif est alors de dédramatiser les fautes commises, et de pouvoir améliorer son orthographe par le jeu. Pour ces deux linguistes, la simplification de l’orthographe serait un nivellement par le haut à tout problème d’orthographe car les personnes ne feraient pas moins bien, mais mieux. Cette dictée un peu particulière décomplexe vis-à-vis des exigences de ce type d’exercice, et permet de souligner avec malice les incohérences et exceptions qui constituent la norme de la langue française. Ce dispositif, qui donne à voir les subtilités de la langue française, peut s’adresser à tout public, enfant, adolescent, comme adulte, car c’est un soutien pour découvrir, apprendre, ou améliorer, sa grammaire. Néanmoins, ce dispositif manque le défi de la traduction en une autre langue pour les étrangers ne parlant pas ou difficilement la langue française, afin que ces derniers puissent toutefois participer au jeu.

« La leçon d’orthographe » proposée par Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts, ©S.B.
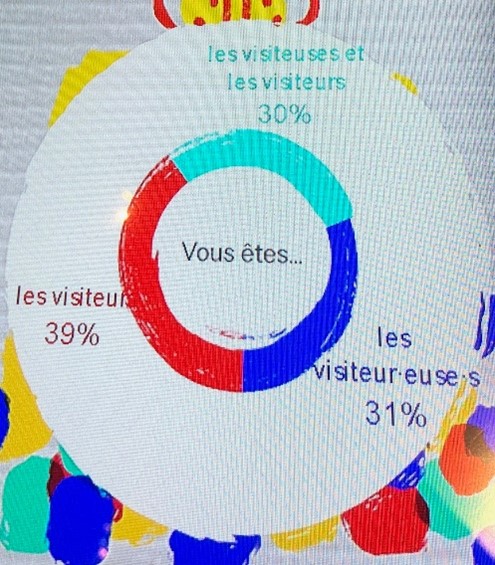
Un autre exemple de ce dispositif : « Vous êtes… les visiteurs, les visiteuses et les visiteurs, les visiteur.euse.s ? » Réponses en date du 16 novembre 2023. ©S.B.

Expressions idiomatiques francophones, section « Une langue de référence mondiale », Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts, ©François Nascimbeni (AFP).
Et par-delà la France ?

Les cartes de Frédéric Bruly Bouabré, 1991-2007, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts, ©S.B.

Le dôme des mots voyageurs, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts, © Franck Levasseur.
Et après ?
« La langue française unit, permet de partager un passé mais aussi de vivre au présent et d’inventer un avenir commun », Marie Lavandier, présidente du Centre des monuments nationaux.
Le sujet de la langue est pour le moins sensible, quand est envisagée la langue française comme langue coloniale. En comparaison, il peut sembler querelle de chapelle de s’attarder sur la langue au prisme de l’orthographe, de la langue inclusive, du genre, mais c’est le parti-pris de cet article. Chaque modification de l’orthographe fait l’objet de tribunes enflammées, et chaque entrée dans le dictionnaire de l’Académie française provoque de nombreux désaccords. Le ciel de mots est déjà un acte politique en choisissant des mots de dialecte, patois, des régionalismes, des mots récemment entrés dans les dictionnaires. À titre d’exemple, le mot « wassingue », un régionalisme du Nord signifiant « serpillère », ne relève pas d’un français académique, et les habitants des autres régions de France n’ont pas connaissance de ce vocabulaire. Ceux qui utilisent le mot « wassingue » argueront que ce mot est français, car venant d’une région française, les Hauts-de-France, même si ce mot francisé est emprunté au flamand « wassching » ("action de laver »).
Entre vocation éducative, culturelle et artistique, ce lieu ambitionne de devenir un pilier majeur de la diffusion et la préservation de la francophonie à travers le monde. Modernité oblige, interactivité et immersion sont au rendez-vous. À l’image d’une langue française caractérisée par sa diversité, vivifiée et réinventée en permanence, les dispositifs numériques devront ne pas manquer d’être réactualisés au fil des générations. Même si des contenus comme dans la salle des humoristes font date par leur exemplarité, certains contenus devront être réactualisés. La question de la maintenance et du renouvellement du contenu se posera à terme.
Article publié sur https://www.litteraturesmodesdemploi.org/ ; https://www.litteraturesmodesdemploi.org/carnet/cite-internationale-de-la-langue-francaise/
#Langue ; #francophonie ; #culture
Pour en savoir plus :
La faute de l’orthographe, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, TEDxRennes ; https://www.youtube.com/watch?v=5YO7Vg1ByA8
Podcastics, La Cité internationale de la langue française. Découverte d’un nouveau lieu culturel au château de Villers-Cotterêts ; https://www.podcastics.com/podcast/episode/la-cite-internationale-de-la-langue-francaise-263587/
Radio France, Cité de la langue française : le français, éternel enjeu politique ; https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/france-culture-va-plus-loin-l-invite-e-des-matins/cite-de-la-langue-francaise-le-francais-eternel-enjeu-politique-7556097
Une Faune de Museomixeurs au musée d’Histoire Naturelle
Mais qui sont ces personnes surnommés « Museomixeurs » qui investissent nos musées? Toute cette agitation peut paraître étrange dans ces lieux habituellement si calmes.
Crédits photographiques : Museomix Nord
Pourtant, ils sont là pour vous divertir et vous surprendre. Le principal acteur de cette aventure est « Museomix ». Cette association s’est donnée pour mission de rassembler, du 7 au 9 novembre 2014 et dans sept musées partout dans le monde, une véritable faune d’acteurs muséale (scientifiques, communicants, muséographes, artistes…) et du numérique (développeurs, codeurs, ingénieurs..) afin de créer, expérimenter et proposer aux visiteurs de nouveaux dispositifs de médiations. Etudiants et professionnels de tous horizons se regroupent, sans se connaître, avec pour objectif de proposer un prototype de médiations aux visiteurs. Durant ces trois jours, les maîtres mots sont : création, innovation et plaisir.
Alors pour vous donner une petite idée de cette arche de Noé de l’expérimentation muséale, je vais vous parler de ma propre expérience au Museomix Nord qui a eu lieu au musée d’Histoire Naturelle de Lille. Ce sont près d’une soixantaine de personnes qui ont été choisies pour redonner vie aux animaux et fossiles de la collection du musée d’Histoire Naturelle de Lille. Tout comme les espèces exposées, nous venons tous d’horizons différents. Selon un critère de classification basé sur la diversité, nous avons été divisées en groupes de 7 personnes : un communicant, un médiateur, un chargé des contenus, une graphiste, un codeur, un fabriquant et une facilitatrice, afin de faire face à l’appétit exigeant de nos prédateurs : les visiteurs. Par acclimatation, le croisement de nos compétences va donner naissance à un projet hybride dont l’accomplissement est un prototype de médiation. La question était de créer une nouvelle meute de musémixeurs capables d’attiser l’appétit du public pour le musée.
Le premier jour est la journée de l’apprivoisement des membres de mon équipe. En créant une tribu éphémère, je repère très vite qui sont les dominants des dominés, des leaders des suiveurs. Moi, étudiant dont la fonction ici est la médiation, je me fonds dans la masse paisiblement. J’écoute, j’observe avant d’agir. Car dans cette nouvelle société il faut apprendre à se connaitre. En cherchant une idée à défendre, chacun se cherche, se teste, se sent. Certains se rebellent tandis que d’autres suivent la meute en silence. Mais malgré les différences, chacun s’adapte et notre meute prend forme sous le nom des Odonautes - Un nom en référence aux odonates, une famille d’insectes qui se caractérise par ses deux paires d’ailes, son corps allongé et ses yeux composés de milliards de capteurs. Cet ordre se compose de la demoiselle et de la libellule dont nous nous sommes inspirées.
Crédit photographique : Persona
En effet, notre projet est de suivre le parcours personnalisé d’une libellule paléolithique au sein du musée. Cette odonate nous y montre ses origines, son environnement, sa chaîne alimentaire, etc. Elle informe sur son identité et son biotope. Pour se faire, nous avons eu recours à un outil innovant : la « cardboard ». Une nouvelle technologie créée par Google qui consiste à créer des lunettes stéréoscopiques. Le principe est d’avoir une réalité augmentée à l’aide de son smartphone et à moindre coût (moins de 10 $). Les dominants de la meute parlent alors de faire apparaître une libellule 3D qui interagirait avec le musée. Le visiteur la suivrait dans sa pérégrination afin d’acquérir des informations. Le reste du groupe est d’accord. J’acquiesce et la journée se termine par un repas bien mérité où chacune des meutes du Muséomix Nord demeure entre elle. L’envie de vivre ensemble est forte mais la chasse à la création est rude et ne laisse que très peu de temps aux camaraderies.
Car le deuxième jour, c’est la désorganisation la plus totale chez les Odonautes. Pour mener à bien la création de notre prototype, nous avons dû faire appel à des étudiants informatiques (Epitech de Lille) calés en programme et codage en tous genres. Malheureusement, intégrer la libellule en réalité augmentée semble plus compliqué que cela n’y parait et nous manquons de temps. Le logiciel appliqué ne correspond pas au système d’exploitation du smartphone utilisé pour la cardboard (le Nexus). Nous ne savons plus quoi faire. Alors que je dois rédiger avec la chargée des contenus pour le livret pédagogique, la confusion nous gagne. Chaque membre de ma meute avance sans savoir clairement où il doit aller. Le stress nous submerge. Les dominants ne savent plus comment agir et les autres s’isolent dans leurs tâches. Pour nous aider à survivre, la facilitatrice essaye tant bien que mal de rétablir le dialogue et l’espoir revient. Le dispositif sera « The Dragonfly Horror Show », une série B d’horreur dont l’héroïne est une terrible libellule du fond des âges, la StenodictyiaLobta. Le tournage peut alors commencer !

Affiche « The Dragonfly Horror Show » - Crédit photographique : Noémie Desard
Pour le troisième ultime jour, toute l’équipe des Odonautes se retrouve et les doutes se sont évaporés durant la courte nuit de sommeil qui a précédé. La fatigue et le stress sont toujours au rendez-vous mais la meute semble y faire face. Les vidéos se montent petit à petit, un trailer et un épisode-pilote de deux minutes vont pouvoir être accessibles au public. Bien que le système de lancement de la vidéo dans la cardboard par NFC ne se soit mis en place qu’à l’heure fatidique, je suis sur le pied de guerre à 16h pour présenter notre dispositif à la horde de visiteurs. Et la magie opère. Le jeune public abonde autour de moi afin de tester l’unique cardboard que nous avions à disposition. Il est comme une bande affamée et impatiente de nouveautés. Il se bouscule, s’impatiente et en perd même sa politesse. Il est le dernier maillon de la « chaine alimentaire » du musée. Intraitable, il n’en demeure pas moins respectueux et gratifiant envers ses congénères du maillon muséal. Dans cette « chaîne alimentaire culturelle », les visiteurs ne nous dévorent pas, non. Ils nous nourrissent et nous les nourrissons en retour. Si chacun est à sa place dans son projet Museomix, de la direction à la médiation en passant par la conception, la transmission peut donc se faire sans jugement, sans à priori et sans limites. Vivre ensemble et à l’écoute, ce n’est que la dure loi de la Culture.
Passer trois jours de travail intensif au musée d’Histoire Naturelle m’a donné le sentiment de faire partie de la collection. Museomix Nord a été finalement une exposition temporaire sur plusieurs groupes d’espèces à la durée de vie éphémère et dont le pic de (re)productionet d’activité se fait chaque année, durant trois jours en automne. Alors si vous avez aimé ou que vous souhaitez découvrir Museomix, attendez-les, ils reviendront l’année prochaine dans de nouveaux lieux, avec de nouvelles personnes et des idées toujours plus innovantes.
Persona
Pour aller plus loin :
http://www.museomix.org/prototypes/the-dragonfly-horror-show/
https://www.tumblr.com/search/odonautes
https://www.youtube.com/channel/UCSUEyKP68WaCFxWRXiNIIhg
Mots clefs :
# Museomix
# Libellule
# Nouvelles technologies

Une réalité insoupçonnée
C'est durant l'année 2006 que le projet Louvre-DNP Museum Lab voit le jour. Museum Lab, un laboratoire de musée ? Vous avez bien entendu, il s'agit bel et bien d'un « musée laboratoire ». Fruit de la collaboration entre Dai Nippon Printing (DNP) et le musée du Louvre de Paris, ce projet propose un dialogue entre une ou plusieurs œuvre(s) majeure(s) issue(s) des collections du Louvre et les nouvelles technologies numériques. En effet, Museum Lab mobilise de nouvelles formes de médiation afin de permettre une vision neuve et originale de l'accompagnement des œuvres par le numérique au service du visiteur.
© Droits réservés
Réalité augmentée... Le mot est lâché ! On l’aura compris, la technologie influe sur le comportement du visiteur et a une incidence directe sur l’expérience de visite. En outre, celle-ci expose continuellement à de nouveaux outils et à de nouvelles façons de procéder. Ainsi, après le Web 2.0 et les médias sociaux, apparaît la réalité augmentée. Trait d'union entre l'art et la technologie, l'exposition va alors au-delà de la présumée rigidité muséale en introduisant dans son programme muséographique une ouverture vers le visiteur en tant qu'acteur. Cette nouvelle réalité qui « augmente », et par là enrichit notre environnement tangible au moyen d'informations virtuelles, emmène le public vers une éveille particulière face aux objets exposés.
Il n'en fallait pas moins pour attirer un nouveau public sans doute moins habitué à la scène muséale, mais qui sera intrigué par ces différents dispositifs qui lui seront peut-être plus familiers. Cependant, il est légitime de se demander en quoi ces nouvelles technologies peuvent-elles contribuer à aider les « visiteurs-acteurs » des lieux culturels dans leur appréhension des œuvres d'art.
C'est ainsi qu'à l'occasion du Conflux Festival, « festival de l'art et de la technologie » au cœur de la trame new-yorkaise, les passants et les visiteurs deviennent les acteurs de la ville ou du célèbre MoMa. Et c'est vrai. A son insu, le MoMa accueille une exposition virtuelle et secrète. La curiosité est piquée ! Chacun des visiteurs, équipés d'un téléphone mobile de type smartphone ainsi que d'une application spécifique, a l'occasion de découvrir des œuvres en réalité augmentée parsemées sur tous les niveaux du musée. Ce genre de dispositifs permettrait au public de porter un nouveau regard sur une œuvre.
© Droits réservés
Seulement, voilà : cette gadgetisationde l'objet muséal ne repousserait-elle pas les initiés du modèle « Beaux-arts » ? Ce public dit classique ne serait-il pas poussé à déserter ces nouveaux temples du numérique ? Qu'on se le dise, cette nouvelle forme de médiation pourrait en faire fuir plus d'un. Toutefois, elle permet l'ouverture des portes de ces institutions encore perçues trop froides et trop lourdes dans l'imaginaire populaire. En effet, ces dispositifs développent l'aptitude du visiteur à « regarder », à s'immerger dans une œuvre d'une manière participative et active.
Ainsi, dans la troisième présentation du Louvre-DNP Museum Lab La Vierge au lapin, une poésie sacrée l'utilisateur met à profit son propre corps afin de s'approprier des clefs de lecture. Il y fait l'expérience de l'immersion totale tout en contemplant le tableau du Titien. La pièce dans laquelle le visiteur se trouve est bordée de trois écrans, lesquels sont animés des différents plans dudit tableau. Le visiteur-acteur est alors plongé dans l'univers de l’œuvre grâce à ses déplacements sur un marquage au sol.
Cet environnement immersif et la multiplication de ces procédés peuvent cependant avoir un effet néfaste sur le contenu exposé. Pour sûr, l'effet parc d'attraction ne peut être mis en avant ! L'intégration de NTIC doit être pensée dès le début de projets muséographiques. Le multimédia doit rester discret et mettre en valeur le discours de l'exposition et non en exergue sa fonctionnalité. Il s'agit de créer un lien entre le public et l’œuvre et par celui-ci accompagner les visiteurs dans leurs découvertes. Leur implication doit leur offrir l'occasion de se nourrir du plaisir de l'émotion suscité par la rencontre avec une œuvre d'art pour ensuite l'inciter à renouveler l'expérience face à d'autres œuvres et d'autres multimédias.
Jennifer Bouche

Une table tactile dépoussière la collection de minéraux.
Cet outil interactif, implanté au cœur de la collection de roches et de minéraux du musée de Lille, ravira tant les passionnés de sciences et de géologie que les néophytes en ces domaines.

© Tous Droits Réservés.
Albert Einstein a dit : « Il est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé ».
Il est désormais possible de faire les deux aussi aisément l’un que l’autre, grâce au nouvel outil interactif dont s’est doté le Musée d’Histoire Naturelle de Lille, une table tactile pouvant composer et décomposer les atomes dont sont constitués les roches et minéraux abrités dans la superbe collection du lieu.
Cet outil interactif, implanté au cœur de la collection de roches et de minéraux du musée de Lille, ravira tant les passionnés de sciences et de géologie que les néophytes en ces domaines.
Doté d’un système innovant, il permet de créer soi-même ses pierres précieuses et autres roches, mais également d’explorer virtuellement la collection du musée constituée de plus de 1000 échantillons.
Composée de deux écrans perpendiculaires et de palets, représentant des atomes, posés de chaque côté de l’écran horizontal, la table s’utilise comme suit : un palet représente un atome qui, placé sur l’écran horizontal, permet de découvrir les minéraux composés de cet atome. Plus l’on sélectionne de palets, plus l’on découvre les atomes qui composent les roches et minéraux que possède le Musée d’Histoire Naturelle de Lille.
Visant principalement les enfants et les adolescents, sa taille adaptée et son ergonomie permettent également aux personnes à mobilité réduite de pouvoir y accéder, facilitant ainsi l’apprentissage de tous, et ce de manière ludique et interactive, comme en témoigne Lucile, 21 ans, étudiante en Muséo-Expologie à l’université d’Arras, et venant de créer son premier rubis :
« C’est vraiment impressionnant, on peut créer des minéraux et les transformer, il suffit de tourner le palet et toutes les informations apparaissent ! ».
A voir l’enthousiasme de la jeune femme, on ne peut que constater l’utilité et le plaisir à se servir de cet outil, complément intelligent à une collection bien trop souvent négligée.
Et ce dispositif n’est pas exclusif au musée de Lille, ils sont une poignée de musées, en France, à tester ces nouvelles technologies au sein de leurs établissements, notamment à Marseille et à Aix-en-Provence où des murs interactifs, encore appelé City Wall ou City Media étant apparentés à de grands écrans tactiles utilisables par plusieurs personnes en même temps, sont intégrés à la muséographie et laissés à la disposition du public.
Nouvellement implantés au cœur des institutions muséales, ces outils attisent la curiosité des visiteurs, qui hésitent à s’en servir durant leurs visites, tendant tantôt vers l’hostilité, tantôt vers l’admiration.
Mais de plus en plus de musées s’équipent de ces nouveaux outils proposés comme un complément à la visite, ce qui séduit un nombre croissant de visiteurs, et s’avère être un compromis fort intéressant mêlant technologie et savoir.
Céline Deschamps

Une visite au Palais des Papes sans l’HistoPad ou comment apprendre l’esquive
J’entre dans la première salle de l’exposition permanente, il y a une profusion de personnes qui visitent. Presque tout le monde a une tablette devant son visage et un casque sur ses oreilles. À les voir ainsi marcher dans des sens contraires, je me dis qu’il me faudra me faufiler entre les écrans portatifs.
Pour ce retour sur mon expérience personnelle lors de la visite de l’exposition permanente, j’interroge l’expérience d’une visite sans accès au numérique. Comment circuler et apprécier sa déambulation quand tout le monde à les yeux rivés sur quelque chose que l’on ne peut pas voir ? Constat assez improbable, j’ai finalement autant regardé les visiteurs du musée numérique que les œuvres.
Image d'intro : (c) Histovery
L’HistoPad ne surchauffe pas.
Contexte : Il fait terriblement chaud en cette journée d’août 2022. La canicule est là, il est important de le noter. Elle a sans doute eu un impact sur le comportement de l’ensemble des visiteurs, la concentration ne pouvant pas être totale. Cette météo difficile a par ailleurs révélé la complexité de renouveler l’air dans les salles de l’exposition permanente. Il n’y avait pas de ventilation, même portative, pour réduire la lourdeur imprégnant les lieux. Les visages suaient et j’ai été surpris de voir les coups de chaleurs qui prenaient certains visiteurs. Cette situation interroge quant à l’adaptation des musées, notamment ceux installés dans des lieux patrimoniaux anciens, face aux épisodes caniculaires qui deviennent de plus en plus réguliers.Le confort de la visite doit désormais être pensé avec des méthodes de rafraichissement de l’air. Cette thématique mériterait un article par son importance et les questions écologiques qu’elle pose. Je me contenterai ici de renvoyer à la piste du Louvre qui utilise le réseau de « froid urbain », grâce à la Seine, pour climatiser ses salles d’expositions.
L’HistoPad est une tablette numérique développée par l’entreprise Histovery, permettant une visite augmentée dans les musées et lieux patrimoniaux. Elle se porte autour du cou et, grâce à un système de scan, propose une reproduction historique des lieux. Le Palais des Papes a intégré l’HistoPad dans son parcours permanent depuis octobre 2017. Il mise désormais sur cette nouvelle médiation numérique pour valoriser tant le lieu que les collections. Cette tablette tactile propose sept langues différentes et de multiples interactions sonores. Musiques, bruitages et commentaires rythment la visite et permettent de fournir des informations plus précises ainsi que des anecdotes historiques. Ce medium ajoute ainsi un ensemble de connaissances supplémentaires aux expôts du parcours. Grâce à la géolocalisation, la tablette s’anime automatiquement sur les 9 salles de l’exposition permanente. Sur le papier l’expérience est intéressante et, lorsque je jetais un œil par-dessus les épaules de quelqu’un, la plus-value me semblait bien réelle.

(c) Histovery
La visite, un constat de l’omniprésence de la tablette tactile.
En débutant ma visite sans l’HistoPad, qui résulte d’un choix volontaire, j’ai réalisé que la majorité des publics l’utilisaient : plus de 90% des visiteurs l’avaient en main. Au cours de mes déplacements, j’ai pu remarquer trois attitudes distinctes qui parfois se recoupaient selon les publics.
Les premiers s’arrêtaient net et observaient longuement les détails que leur proposait l’appareil, répétant l’acte à différents endroits de la salle. Parfois ils étaient en plein milieu du passage et d’autres fois devant les collections ou les textes. Il fallait alors anticiper pour les éviter, et faire en sorte de ne pas se retrouver derrière eux. La fluidité de la visite se retrouvait impactée, le temps passé devant une œuvre ou des tapisseries murales était beaucoup plus court. Les visiteurs numériques transforment le rythme de la visite lorsqu’ils sont nombreux. Il m’ fallu être régulièrement plus attentif et souvent choisir les salles en fonction même du placement de ces derniers.
Cette rupture du rythme personnel d’une visite, qui ne se retrouve pas uniquement au Palais des Papes, s’est fait ressentir plus fortement avec une autre typologie des publics. Si j’éviterai de les catégoriser à partir d’un nom animal, selon l’enquête de Martine Levasseur et Eliseo Veron de 1982, fort est de reconnaître que leurs comportements furent similaires. Certains publics marchaient presque continuellement avec la tablette devant leurs yeux. C’était les plus difficiles à esquiver. Il fallait passer tantôt à gauche ou à droite, opérer un demi-tour ou encore les contourner. L’envie m’a pris même pendant l’espace d’un instant de me faufiler sous les bras tendus, avant de me rappeler que le lieu ne se prêtait pas vraiment au Parkour. Je devais donc de nouveau attendre et, j’ai souvent ressenti le besoin de terminer l’exposition au plus vite. Peut-être n’étais-je tout simplement pas patient ce jour-là.
Enfin, le troisième type de visiteur passait plus rapidement d’une salle à l’autre. Ils consommaient les images et les informations sonores, enchaînant rapidement la visite. Les collections comme le lieu patrimonial faisaient alors l’objet d’un manque d’attention de leur part. Il y a-t-il un problème de lisibilité du lieu face à un Histopad qui offre davantage de fluidité ? Je n’ai pas remarqué en nombre ce type de comportement, peut-être une quinzaine tout au plus. Cela semble malgré tout suffisant pour interroger les comportements de certains publics. Certaines salles du musée sont impactées plus lourdement que d’autres face à la valorisation du numérique. Le parcours scénographique et muséographique est réduit à certains endroits à un strict minimum, avec peu de collections et de textes. Cette absence s’est fait ressentir plusieurs fois et, j’ai eu l’impression d’être passé à côté de la principale clé de lecture du musée.
« - Numérique ! Ils ne me regardent pas ! Ils n’ont d’yeux que pour toi ! »

(c) Histovery
Les visiteurs ainsi munis de leur tablette « à remonter le temps », dont les images ont été coconstruites avec un commissariat scientifique, ont eu accès à de très larges ressources de connaissance. Mais un point est peut-être problématique : le rapport entre le public et le lieu patrimonial même. Je n’ai perçu que peu de visiteurs qui s’attardaient sur les détails du lieu. La différence est alors flagrante entre la réalité visible et la virtualité proposée. Cette dernière est éblouissante de couleurs et de détails. Il est compréhensible que nombre de visiteurs préfèrent, même inconsciemment, la reconstitution à la réalité.
Pourtant, la première est au service de la seconde : elle permet de projeter, d’établir une autre sensibilité, un regard nouveau entre le vu et l’imaginé. La reconstitution a pour finalité d’être un liant sensible et direct qui enrichit l’espace et notre rapport personnel au savoir. Les observations de cette visite donnent davantage l’impression d’une déconnexion, même en demi-teinte, des publics avec les collections et les textes de l’exposition. Les expôts semblent presque devenir des outils complémentaires à l’HistoPad. Mais cette déconnexion touche surtout les interactions sociales entre visiteurs et médiateurs. Ces derniers n’ont fait que gérer les problèmes de pannes ou de langues. Leur rôle étaient réduit à l’utilitaire. C’est également une déconnexion entre les publics eux-mêmes. Ceux qui sont venus en groupe, qui se connaissent en dehors du musée, se retrouvent coupés de toute communication directe. Les visuels et les casques, qui transmettent sons et lumières, empêchent des discussions étendues. Ces dernières sont surtout établies sous forme de conseil ou d’injonction, en réaction à ce qui se passe sur l’écran. Cette perte momentanée d’échanges oraux individualise la visite et questionne sur ce qui est finalement retenu par les publics qui ont vécu cette expérience. L’immersion n’est-elle finalement pas supérieure au discours qui est proposé au musée ?
La critique de l’HistoPad est cependant à remettre dans un contexte bien particulier. Mon expérience ne s’établit que sur une journée, de forte chaleur et de grande affluence. C’est une expérience subjective et non une enquête préméditée des comportements des visiteurs. Je n’ai pas les capacités à étudier chaque personne que j’ai croisée et n’ai retenu qu’une infime partie des comportements aperçus. Enfin je n’ai surtout pas pu recueillir les propos des visiteurs après leur passage au musée, ce qui manque pour confirmer ou infirmer mon analyse. Il faut reconnaître que ce médium numérique apporte une vision originale et intéressante. Le fait que cette tablette n’ait aucun coût supplémentaire dans l’achat du billet est un élément important à reconnaître pour l‘accessibilité tant au numérique qu’à la connaissance. Si l’HistoPad a des limites, nul doute qu’il apporteune nouvelle expérience de visite. Je reviendrai donc au Palais des Papes prochainement, pour visiter l’exposition avec un regard nouveau et peut-être deviendrai-je moi aussi, un obstacle à esquiver.
Pour aller plus loin :
- http://www.palais-des-papes.com/fr/content/histopad-pour-tous
- CHAUMIER Serge, MAIRESSE, François. La médiation culturelle. Armand Colin, 2eédition, 2017.
- PLLISSIER Maud, RENAUD Lise, TRIQUET, Éric. Rénover l’imaginaire du tourisme culturel : stratégies communicationnelle et territoriale autour de l’HistoPad du Palais des Papes. (In) Tourismes et territoires : des milieux, des dispositifs et des hommes, 2020.
#Palaisdespapes #HistoPad #mediationnumerique

Venice Time Machine
C’est lors du mon aventure Muséomix à Lausanne que j’ai découvert l’immense laboratoire de fabrication présent sur le campus de l’université EPFL. Oui, un FabLab à Muséomix !
Scénographie lumière de l’exposition Venice Time Machine © EPFL
C’est lors du mon aventure Muséomix à Lausanne que j’ai découvert l’immense laboratoire de fabrication présent sur le campus de l’université EPFL. Oui, un FabLab à Muséomix ! Pourquoi est-ce que ce lieu a-t-il participé à un événement initialement destiné aux musées ? L’Art Lab est un lieu d’innovation qui se confronte également aux problématiques muséographiques puisqu’il met en place un certain nombre d’expositions temporaires.
Cet espace se définit comme un lieu entre art et sciences. L’exposition Venice Time Machine, montée par les chercheurs et historiens de l’université, en collaboration avec le FabLab est une réelle machine à remonter le temps dans l’histoire de Venise. L’université détient un nombre incalculable de numérisations d’archives sur la ville de Venise et elle a souhaité les présenter au public.
En apparence, le concept semble ne présenter aucun défaut. Cette simulation interactive reconstruit le passé de la ville par le biais de différentes techniques de visualisation telles que des cartes interactives en trois dimensions mais également des mises en scène muséographiques. Les moyens investis dans ce projet sont considérables. Au delà de l’aspect financier qui permet de se doter d’une masse de technologies nouvelles utilisées dans l’exposition, le travail en amont a été très important.Il se poursuit d’ailleurs aujourd’hui puisque les chercheurs ne cessent de dépouiller ces archives pour en découvrir le contenu.
Ce programme ambitieux a d’ailleurs fait l’objet d’une numérisation de ces archives, de mesure de conservation mais aussi d’organisation de cette grande masse de données. Le projet, lancé en 2013, semble aujourd’hui abouti en terme de muséographie et de scénographie. En pénétrant dans la salle d’exposition, la grande table centrale provoque un premier effet, on y découvre notamment un ensemble de témoignages de chercheurs, c’est derniers se retrouvent projetés sur les écrans apposés aux murs. Leurs visages semblent flotter au milieu d’une modélisation d’un réseau de la ville. Une atmosphère sombre mais ponctuée de faisceaux lumineux plonge le visiteur dans un espace proche de la fiction.
Venice Time Machine © EPFL
L’effet visuel est donc bien présent, mais l’ArtLab souhaite élargir son panel de visiteurs, qui est aujourd’hui trop cantonné au étudiants et chercheurs. C’est pour cette raison qu’a été mis à profit l’événement Muséomix pour repenser l’exposition. Le fond d’archives n’est pas accessible à tous de par son caractère très scientifique. Cet aspect limite réellement la compréhension du visiteur. Il s’agit également de rendre compte de la masse de données que l’université a en sa possession et qu’elle n’a d’ailleurs pas fini d’explorer.
L’équipe de museomixeurs formée de six personnes aux disciplines très différentes a dû imaginer un prototype répondant à ces enjeux. Mais comment rendre compte de la recherche scientifique tout en imaginant une interactivité qui faciliterait la compréhension du visiteur.
Après trois jours de dur labeur le projet naissant a vu le jour et s’est d’ailleurs confronté à l’avis d’un groupe d’experts et de visiteurs.
Énigmes du dispositif « La vérité est ailleurs » © A. E.
Le dispositif « La vérité est ailleurs » donne à voir la complexité de la recherche historique, mais offre également la possibilité de composer des récits singuliers, des tranches de vie de personnes réelles à partir des documents historiques. Il propose une découverte immersive et concrète dans l'histoire de Venise et de ses habitants à destination d'un public non averti.
Sous la forme d’un jeu, le visiteur se voit donner des consignes : “Retrouve Andrea qui a disparu, au travers d’un certain nombre d’énigmes et ce dans un temps limité; si tu relèves le défi, tu pourras repartir avec une copie de cette très belle bague”.
Le joueur incarne l'enquêteur, comme un chercheur qui fait des recherches historiques. Mais c'est un enquêteur ultra-connecté, qui s'appuie sur les données/datas produites parle projet, et qui sont une ressource dans laquelle puiser. Le jeu repose sur la géolocalisation de données, modélisées sur un fond de cartes existant, datant de 1808. Au fur et à mesure que le public progresse dans la résolution des énigmes, la maquette se modifie par un jeu de lumières : d’une mise en lumière totale au début, signifiant la présence d’Andrea quelque part dans Venise, puis la focale se resserre autour de lieux à l’activité d’Andrea. La spatialité de la ville rejoint celle de ses usages : où sont les marchands et lieux de commerce ? Où exerce-t-on le pouvoir ? Comment la vie économique, sociale est-elle organisée ?
Le jeu vise à amener le visiteur à se questionner : à quoi servent les données ? à chercher des indices, mais il faut les trier pour savoir où chercher… Quelles masses de données sont nécessaires pour obtenir les résultats demandés par les cinq énigmes ? Comment les chercher ? Les croiser ? Seraient-elles partielles, lacunaires, trompeuses ?
Ce dispositif ludique associe un jeu et une maquette interactive de la Sérénissime. Une application sur tablette propose une enquête et une exploration de la Cité des Doges au début du XIXème siècle. Une série de six énigmes successives nous mène sur la trace de l’orfèvre insaisissable qu’est Andrea. Quelques objets connectés et fac-similés ponctuent le parcours, unissant data impalpables et traces concrètes du passé.
Un dispositif conclusif vient donner une idée du volume global des données du Venice time project et celles qui ont été mobilisées pour mener cette enquête. C’est une invitation à aller plus loin dans la recherche.
Ainsi, les spécialistes mais également les visiteurs se prêtent au jeu malgré les dysfonctionnements du prototype par moments. Ils partagent leur expérience en revenant sur l’intrigue de l’énigme et ressortent avec la satisfaction d’avoir incarné le rôle d’un chercheur ou d’un historien le temps d’une visite. En prime, ils repartent avec la bague de l’orfèvre imprimée en 3D, ainsi qu’un passeport de l’enquêteur !
Ce dispositif a su déjouer l’aspect scientifique du fond d’archives tout en créant un lien direct entre le visiteur et ces données.
Anna Erard
#VeniceTimeMachine
#80kmdata
#EPFL
#ArtLaB
#museomixch2017
Pour en savoir plus :
http://www.museomix.org/editions/2017/lausanne
https://actu.epfl.ch/news/venice-time-machine-la-cite-des-doges-modelisee/

Versailles en direct, une alternative aux voyages scolaires ? … Peut être bien.
Initié en 2010 par le château de Versailles et soutenu par le ministère de la culture dans le cadre du programme « Services culturels innovants », la plateforme collaborative de Versailles en direct a offert la possibilité à près de 170 classes, de trois rectorats partenaires, les Yvelines, le Nord-Pas-de-Calais et la Marne de réaliser au cours de l’année 2011, des visites du site au sein même de leur école.
Ce nouveau dispositif de médiation à destination des scolaires proposé par le château de Versailles, vient s’inscrire dans le cadre d’un partenariat entre l’établissement public de Versailles et l’entreprise Orange.
Comment ça marche ?
L’avantage de cette visioconférence est la possibilité de rassembler à la fois deux classes lors d’une même séance, ce qui est très difficilement réalisable lors d’une visite sur le site avec un guide conférencier. De plus, les enfants sont en général très attentifs au dispositif et s’intéressent à cette nouvelle technologie. Ils posent énormément de questions et sont très réceptifs. La visite à distance au sein même de leur salle de classe permet aux enfants d’inclure cette séance dans un cadre de travail avec des connaissances provenant directement du château dans le respect des programmes scolaires.
Quelles sont les forces de ce dispositif ?
Le système de visite à distance favorise l’accès à la culture des élèves non familiarisés des musées, mais aussi des écoles éloignées géographiquement de la région parisienne. C’est une première pédagogique pour un établissement culturel qui ne fait qu’ouvrir le champ des possibles. Le château de Versailles travaille actuellement au développement de nouveaux thèmes de visite ; la vie quotidienne à Versailles, Versailles et l’Antique ainsi que les journées d’octobre 1789.
La visite par visioconférence a un bel avenir devant elle. La possibilité de développement du projet est tout à fait considérable et les initiateurs du dispositif espèrent étendre cette offre dans d’autres musées, mais aussi à d’autres publics. Ainsi les personnes à mobilité réduite mais aussi les milieux hospitalier, carcéral et les maisons de retraite pourraient eux aussi bénéficier de visites à distance. L’innovation au service de la culture et des visiteurs est un point d’honneur que le château de Versailles semble s’être fixé, en effet la déclinaison d’outils multimédia dans le cadre de son programme VersaillesLab est tout à fait exemplaire ; Applications I phone et Android avec géolocalisation, association au projet Google Art Project, implication dans les réseaux sociaux et sites communautaires ou encore partage de photos souvenir.
(c) droits réservés
Cet outil de médiation connaît-il des faiblesses ?
La fragilité de la technologie reste la principale faiblesse de ce type de projet. Les écoles souhaitant recevoir ce service doivent disposer d’une connexion internet au débit correct ainsi que de l’équipement nécessaire à la projection. La principale critique associée au projet de Versailles en direct, adressée lors de sa présentation au Lab du forum d’Avignon est celle de la qualité de l’image et du léger décalage sonore. Ce à quoi les initiateurs du projet répondent que le fonctionnement du dispositif était le principal objectif à atteindre et que la qualité de l’image, qui varie également selon le débit de la connexion serait améliorée par la suite.
Cette visite à distance ne remplace bien évidemment pas la visite réelle du château et des jardins. Mais elle peut se révéler être un excellent outil préparatoire ou complémentaire à l’expérience sensible.
Vanessa Vancutsem

Voter au musée !
En ces temps d’élections présidentielles et de choix de candidats représentants des programmes de vie commune, le vote lui aussi s’invite de plus en plus dans les institutions muséales.
© Free2Choose maison Anne Frank, Amsterdam
Ainsi, au Centre National de la Mer, le Nausicaa de Boulogne-sur-mer, est proposé une animation thématique « M’îles et un îles ». Elle est dédiée aux groupes scolaires de cycle 3 (8 à 10 ans) et collège. Durant une heure, les jeunes élèves sont immergés dans une aventure dont ils sont les héros. Cette animation pédagogique est développée sur le Plateau TV,où grâce à des boîtiers-réponses, les enfants peuvent donner leurs avis mais surtout voter pour la suite de leurs aventures en direct ! C’est ce qu’on appelle le power-vote.
Initialement conçue pour les conventions d’entreprises, les salons, les shows mais aussi l’enseignement et la formation, cette méthode de participation s’insère dans le paysage culturel.
À Amsterdam, c’est à la maison Anne Frank que l’on retrouve ce dispositif au travers de l’installation « Free2Choose ». Des écrans diffusent des reportages gravitant autour de la vie d’Anne Frank et sur des sujets de sociétés tels que la clandestinité, la déportation, ou encore le racisme. Le public peut réagir à des questions en relation avec ces vidéos. À vrai dire le résultat importe peu au final, car ce qui est essentiel c’est que le public prenne le temps de réfléchir et d’affirmer son point de vue en votant, puis enfin en réagissant : prise de parole, débat, discussion.
Ce principe de médiation remporte un vif succès auprès d’un public notamment qui n’est pas à l’aise avec le milieu muséal qui peut sembler parfois rigide et prétentieux. Avec le vote, une interaction directe entre le public et le contenu scientifique s’opère. En effet, ici le visiteur devient spectateur, mais aussi acteur. La quête de la réponse ou du choix du scénario permet d’augmenter la satisfaction de l’électeur, il se sent impliqué : il fait l’expérience.
Il est clair que ce procédé fait référence aussitôt à la télé-réalité et ces shows où il faut voter à tout prix pour sauver « son acteur » favori. Mais au-delà de cette référence populaire il est question de l’autonomie du public : tout en restant vigilant sur le fait que le visiteur doit comprendre et pas que s'amuser (car oui l’interactivité des boîtiers décoince la réceptivité du contenu muséal dans un esprit de divertissement), la technologie et la médiation humaine se complètent, permettant une capacité de conceptualisation supérieure aux méthodes traditionnelles (fiches synthétiques, audioguide…)
© The participatory Museum,
Nina Simon
Voter au musée, comme si on le visitait en assumant pleinement ses choix de découvertes, c’est admettre que le musée peut être participatif, peut être accessible à tous tel que le décrit la scénographe américaine Nina Simon dans son ouvrage « The Participatory Museum » : découverte, interaction, participation, collaboration, rencontre.
Bien-sûr le contenu muséal et scientifique est réalisé par des professionnels de la culture, cependant il est livré non pas à tous d’une manière figée, mais de façon ludique permettant à tout à chacun d’y venir pas à pas, selon ses acquis, ses expériences.
Cette relation de proximité et d’implication de la part du public au musée fait écho avec la création des écomusées de George Henry Rivière dans les années 60-70. Car si le public local des écomusées se sent lié avec ce dernier, le power-vote réalise une connexion entre un contenu, des visiteurs et un personnel.
Or, on le sent, ce type de médiation s’adresse particulièrement à un public qui n’a pas tous les codes nécessaires à la réception d’une exposition « classique » et qui n’est pas fidèle à ce loisir culturel. Et c’est tant mieux ! Car les musées malgré leurs efforts souhaitent depuis les années Malraux s’ouvrir à tous, ce qui est loin d’être le cas.
Cependant le power-vote ne peut s’appliquer à toute sorte d’exposition, ni à toute sorte de public. A défaut de présenter et de préparer le public au contenu, n’y a-t-il pas une perte de ce dernier ? Puisqu’il y a une interaction face à un contenu numérique, n’y a-t-il pas un danger pour le contenu physique ? Est-ce que cette nouvelle approche permettra de fidéliser un nouveau public, ou surfe-t-elle simplement sur une tendance ?
Romain Klapka

ZeVisit, la géolocalisation au service de l'évasion
Prévoyant d'aller à Londres pour un week-end, j'ai voulu préparer ma visite en amont. A l'heure du web 2.0 voire 3.0, cela semble tout à fait possible et « fun » comme on dit outre-manche. Certes je me suis déjà rendu souvent dans la capitale britannique et je connais bien la ville, ses musées et animations, mais je souhaite découvrir un nouveau quartier ou de nouvelles attractions lors de ce court séjour.
Carte des visites proposées par Zevisit.com ©
Premier réflexe : Google ! Y a-t-il, disponible en ligne, des visites qui pourraient m'orienter dans ma découverte ? Il y aurait-il une application téléchargeable pour enrichir ma toute nouvelle tablette ? Et par la même occasion capable de me diriger sur place ou de me donner des envies d'autres visites ? Réponse du fameux moteur de recherche : ZeVisit, un site internet qui nous propose des visites audio et un court texte présentant tel ou tel coin du monde, le tout accompagné de magnifiques photos. En l'occurrence pour Londres, ZeVisit propose à l'internaute/mobinaute 13 visites différentes en fonction des quartiers de la ville.
Mais d'abord, il faut s'inscrire, gratuitement, il suffit d'enregistrer son adresse e-mail et de confirmer le lien transmis par le site, manœuvre simple. Le site s'engage d'ailleurs à ne pas communiquer les références obligatoires à l'inscription, ce qui est rassurant, et l'on comprend vite que cette inscription permet surtout de partager ses expériences avec les autres utilisateurs de ZeVisit. Malheureusement peu usitée, la possibilité de laisser un commentaire peut paraître un peu superflue car les échanges entre les internautes ne se font pas, ce n'est pas un site auquel on pense lorsque l'on veut partager ses expériences de visites mais trouver de courtes et charmantes présentations de tel ou tel lieu.
Un site de partage
ZeVisit est une marque de la société VoxInZeBox qui conçoit, diffuse et promeut des contenus touristiques culturels numériques, principalement des balades audio. Dans ce domaine, on sait que l’art de raconter des histoires, de favoriser l’imaginaire, de susciter des émotions, en bref le « Story Telling » est essentiel pour captiver l’auditeur afin de conserver son attention et par extension son intérêt pour la visite.
Ainsi, l’application téléchargeable ZeVisit pour smartphone et tablettes apporte des fonctionnalités plus adaptées au potentiel du support et à la demande actuelle des mobinautes comme être géolocalisé pour connaître les balades à proximité ; écouter des balades ou les télécharger pour une écoute en mode non connecté ; gérer ses balades préférées dans ses favoris ; et rechercher une balade en utilisant le moteur de recherche intégré. Le mode Wifi ou iTunes (en fonction de vos appareils) sont nécessaires pour télécharger l’application (environ 10Mo) et en moins de 5 minutes, on peut déjà commencer à découvrir les points d’intérêts à proximité de chez soi ou de son lieu de vacances. Une application en ligne permettait déjà d’accéder à la base de données ZeVisit regroupant plusieurs milliers de contenus mêlant commentaires, interviews, archives et musiques, mais était encore loin d’exploiter les différentes possibilités offertes par la technologie du smartphone ou de la tablette.
Une expérience virtuelle ancrée dans la réalité
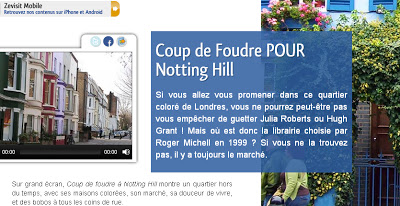
Zevisit.com ©
Parmi les 13 visites audio proposées pour la capitale britannique, j'ai choisi d'écouter celle du quartier de Notting Hill. En effet, je m'y suis déjà perdue et surtout je n'ai encore jamais eu l'occasion de me promener dans les allées du plus grand marché aux puces de Londres, qui a lieu chaque samedi matin à Portobello Road, au sein de ce célèbre quartier. Bien sûr, la guide virtuelle n'hésite pas à nous rappeler le coup de foudre à Notting Hill du libraire et de la star, tout en nous précisant bien que Julia Roberts et Hugh Grant ne seront sûrement pas là ! Impossible de passer à côté du cliché, c'est souvent le cas lorsqu'on visite un endroit inconnu, il semble nécessaire pour les guides (virtuels ou réels) de nous raccrocher à quelque chose de familier.
D'ailleurs, la guide interview même une française qui vit à Londres, Caroline, fière de nous présenter les bons plans du quartier. Elles nous expliquent entre autre combien le quartier est métissé et plein de richesses et combien la promenade entre les antiquités du marché de Portobello Road est appréciée par les londoniens et les touristes.
Finalement les conseils données dans la visite audio, proposée par ZeVisit, de Notting Hill, m'ont été utiles. Je n'ai pas eu à chercher la station de métro à laquelle je devais m'arrêter, je savais où je pouvais écouter un concert tout en buvant un délicieux thé et où aller au marché de Portobello Road pour trouver souvenirs et babioles pas chers. Même j'ai téléchargé et écouté d'autres visites disponibles pour Londres, dont des quartiers que je connais très bien, mais chacune m'ont offert de nouvelles connaissances et de nouvelles envies. Au départ, perçu comme une succession de clichés, les visites audio de ZeVisit sont des outils interactifs, « fun », pratiques et utilisables tout autour de la planète, je ne vais donc pas désinstaller cette application de ma tablette de ci-tôt !
Élisa Bellancourt
http://www.zevisit.com/
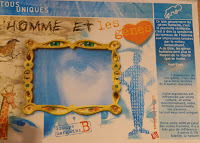
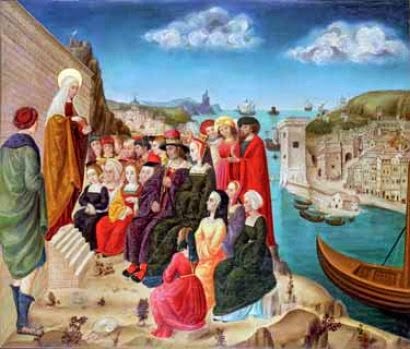



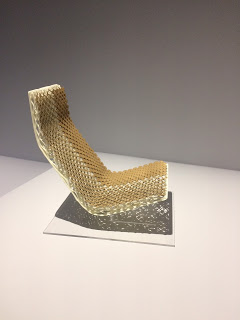


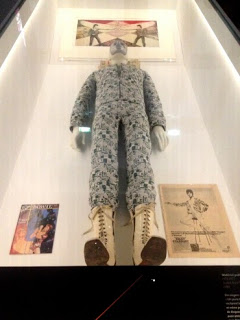
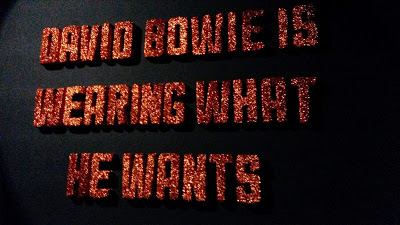
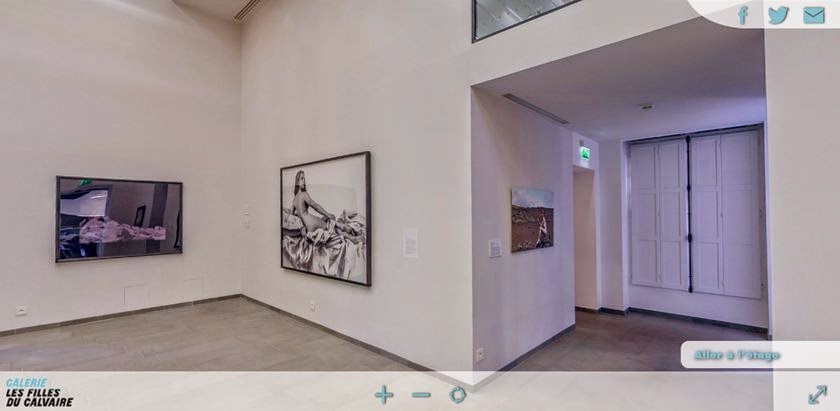

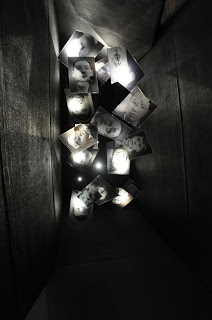
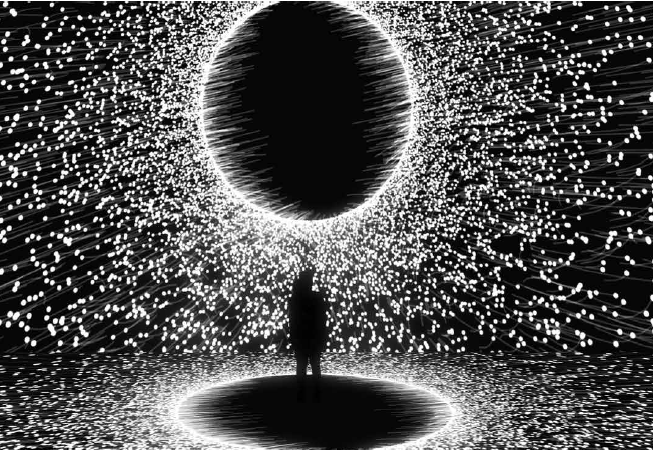









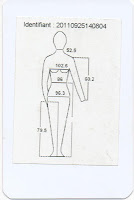
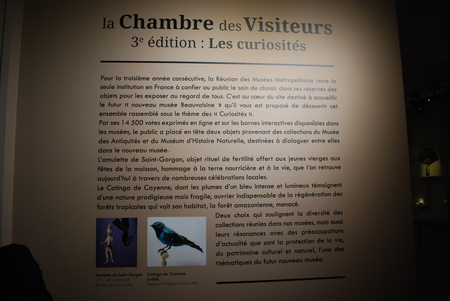

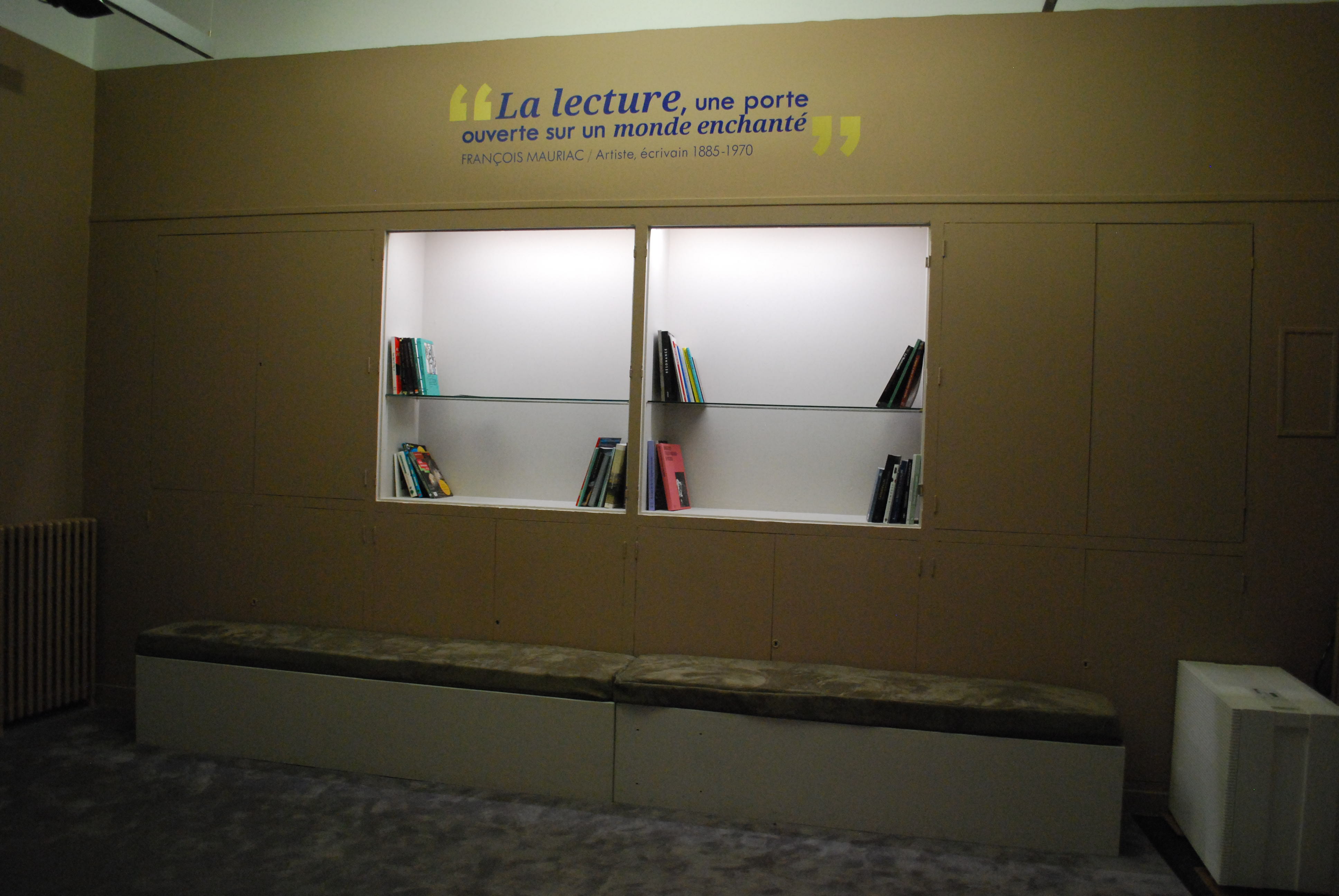






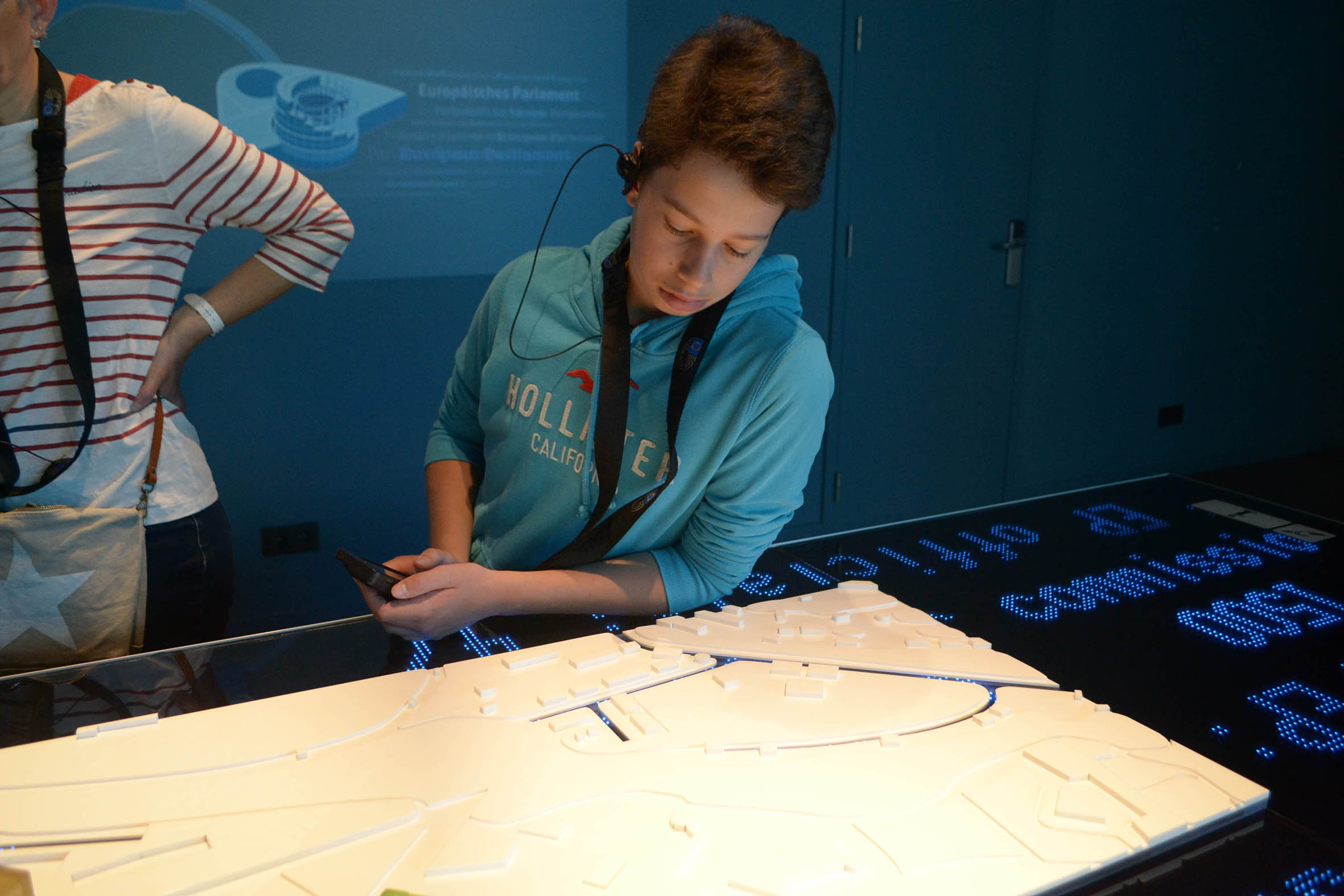






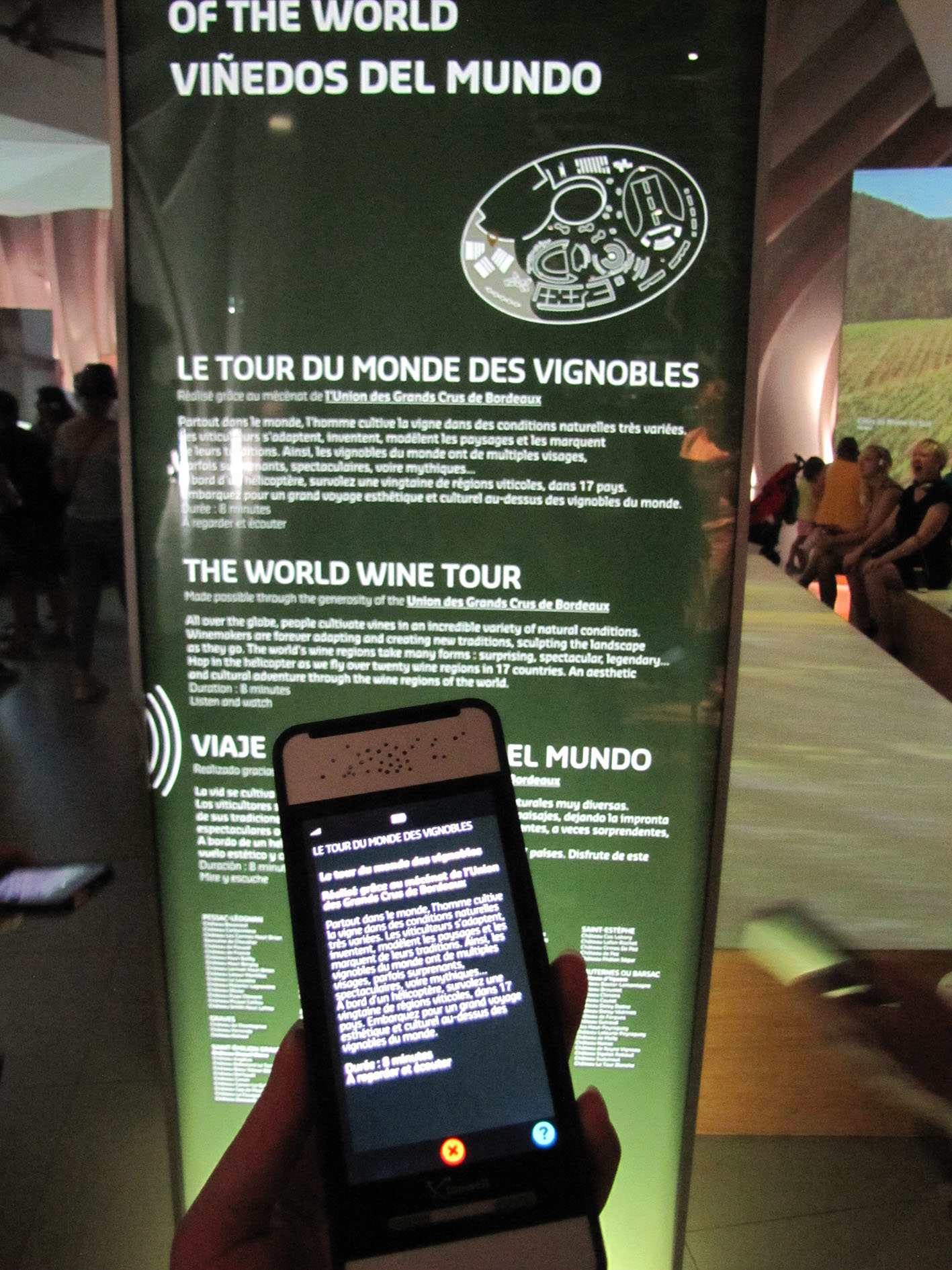





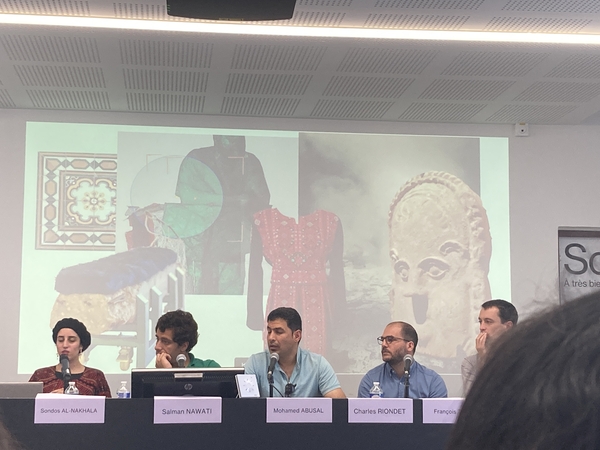

.jpg)