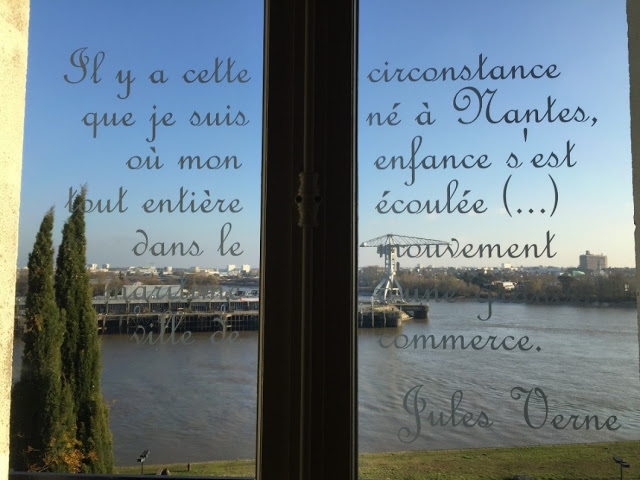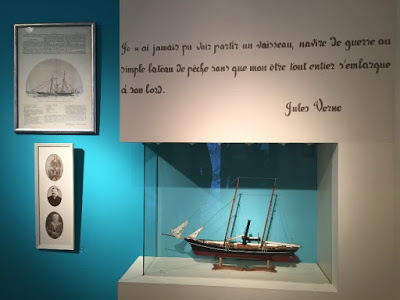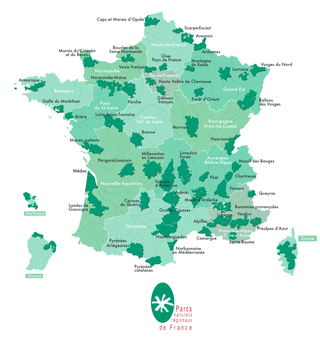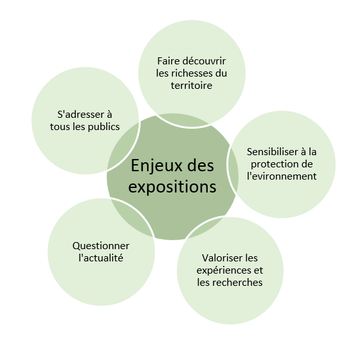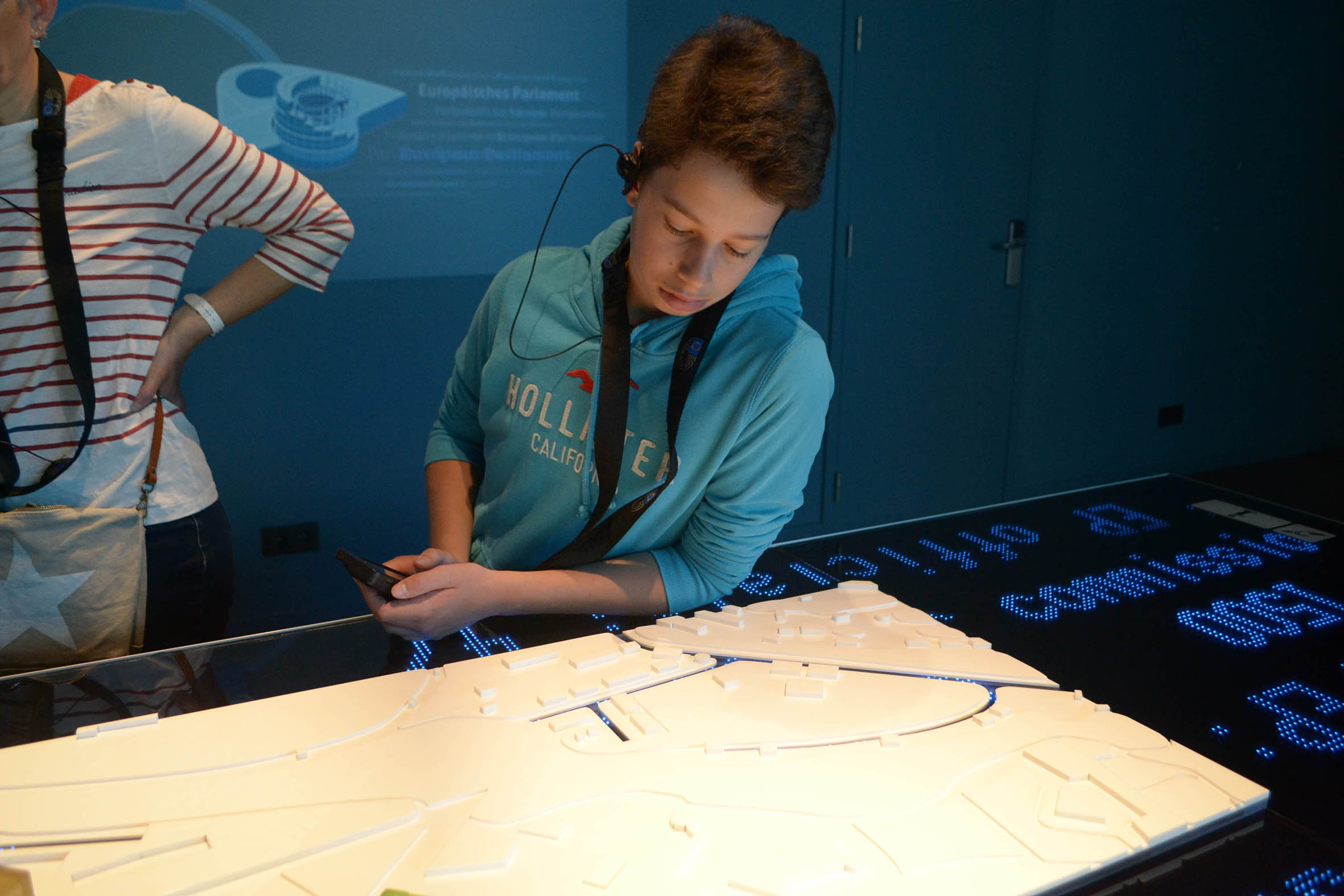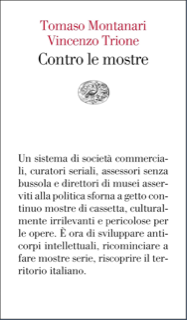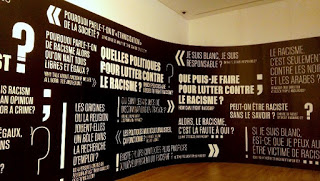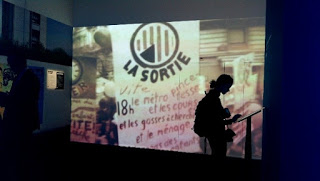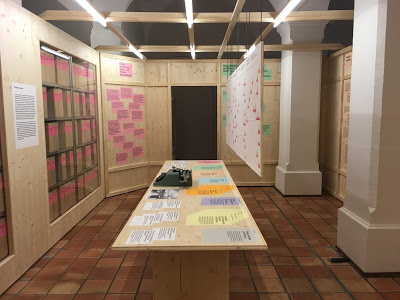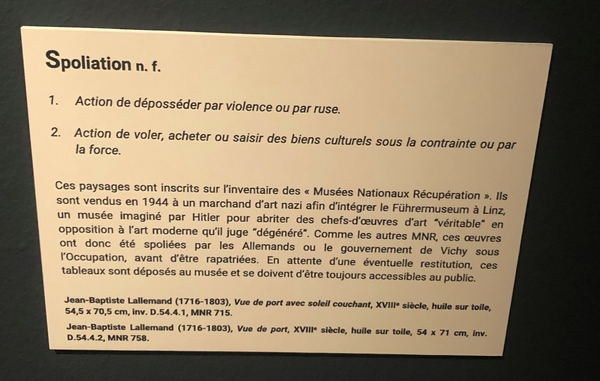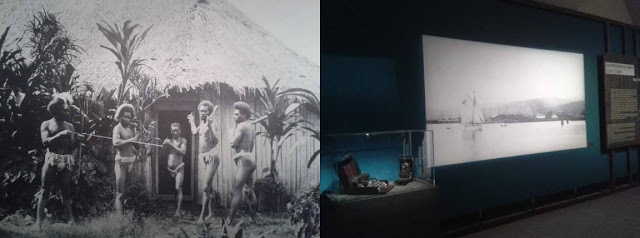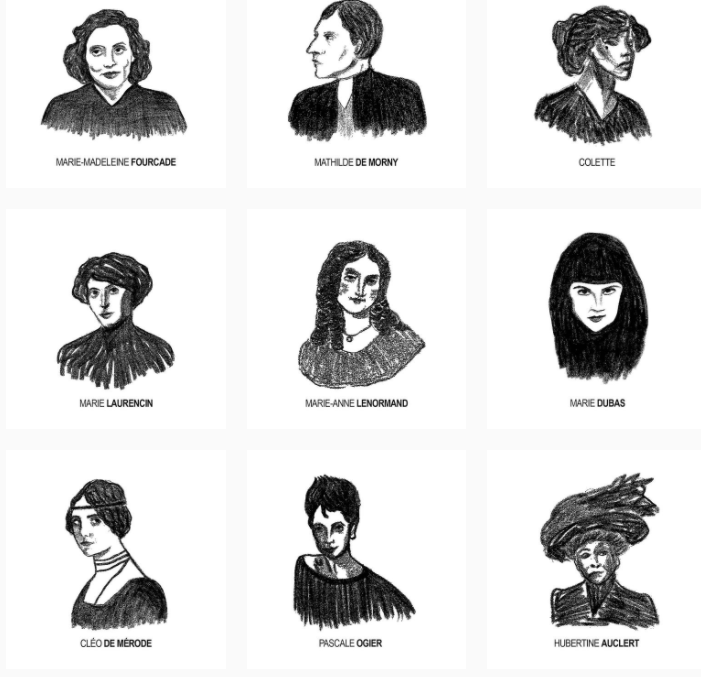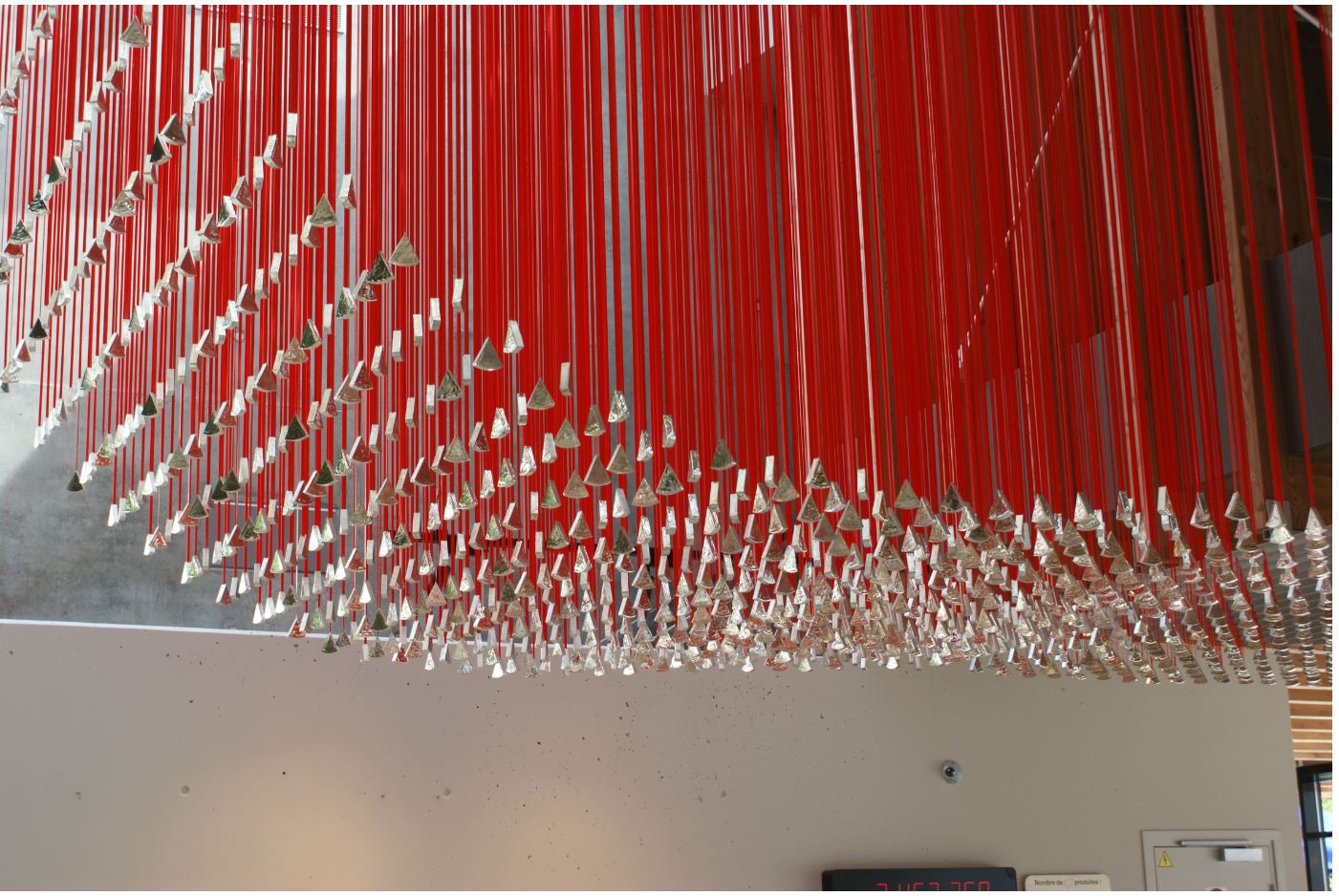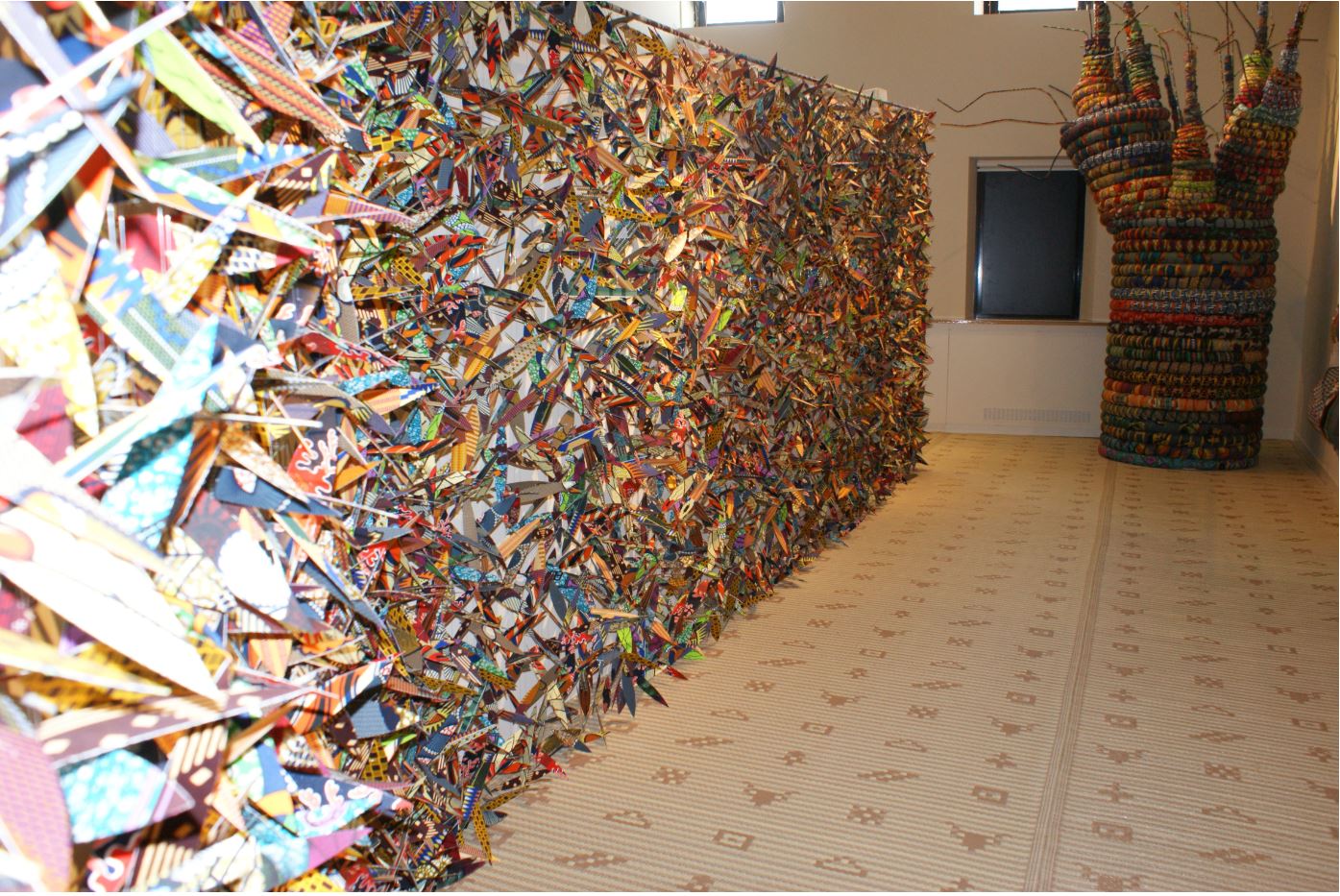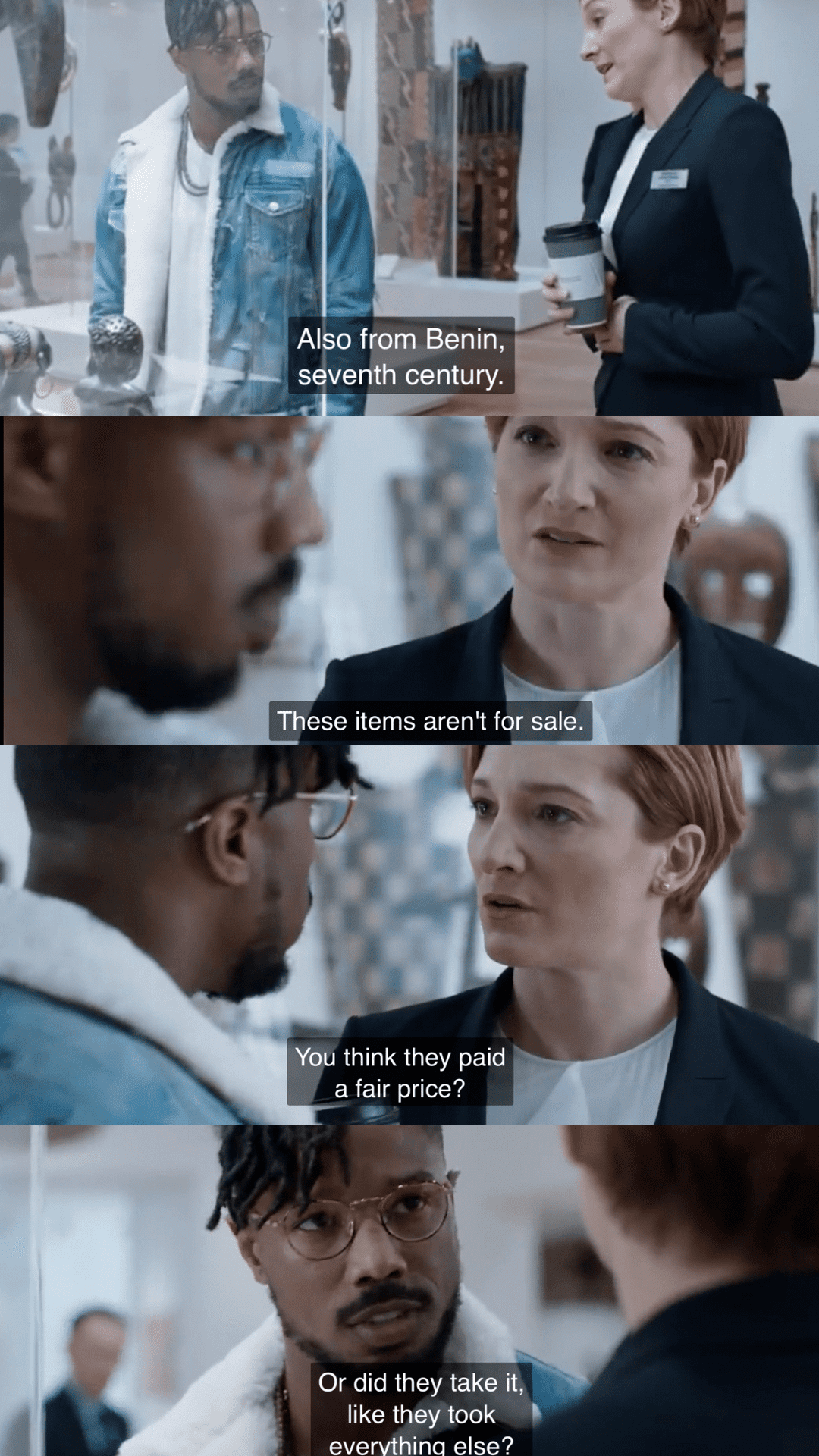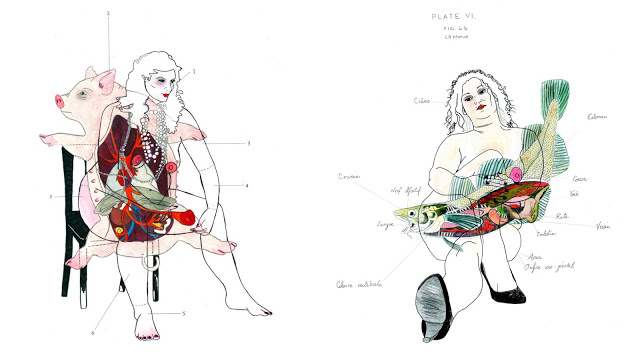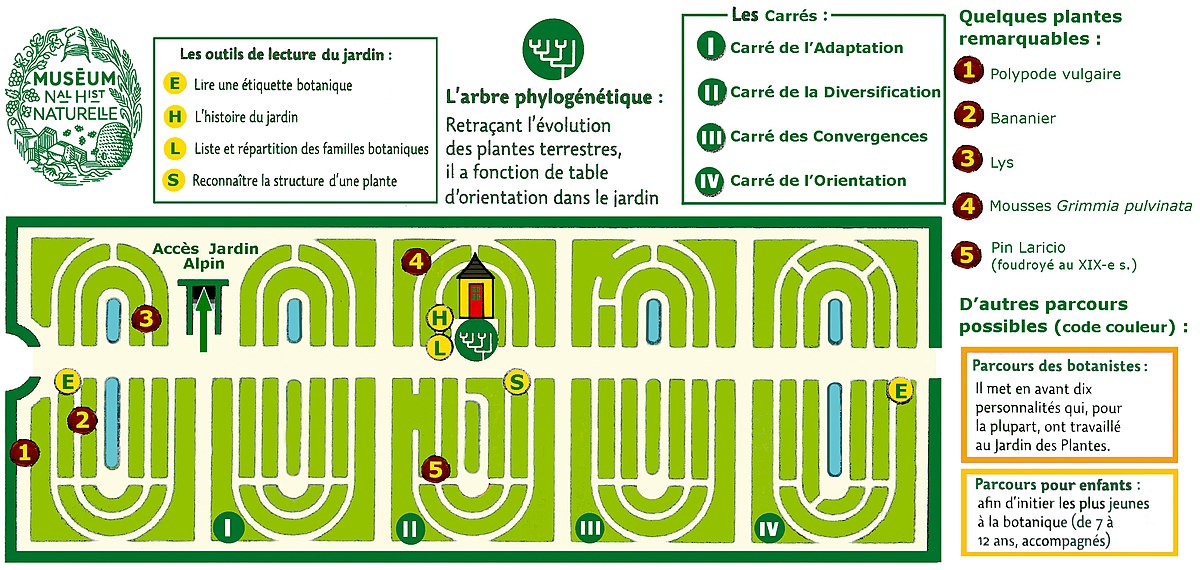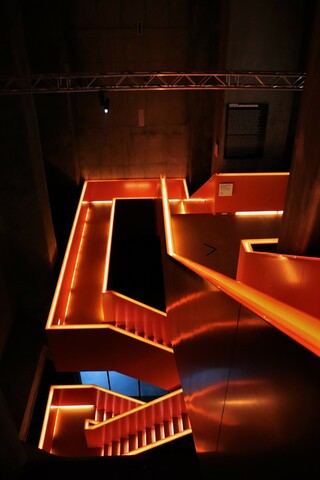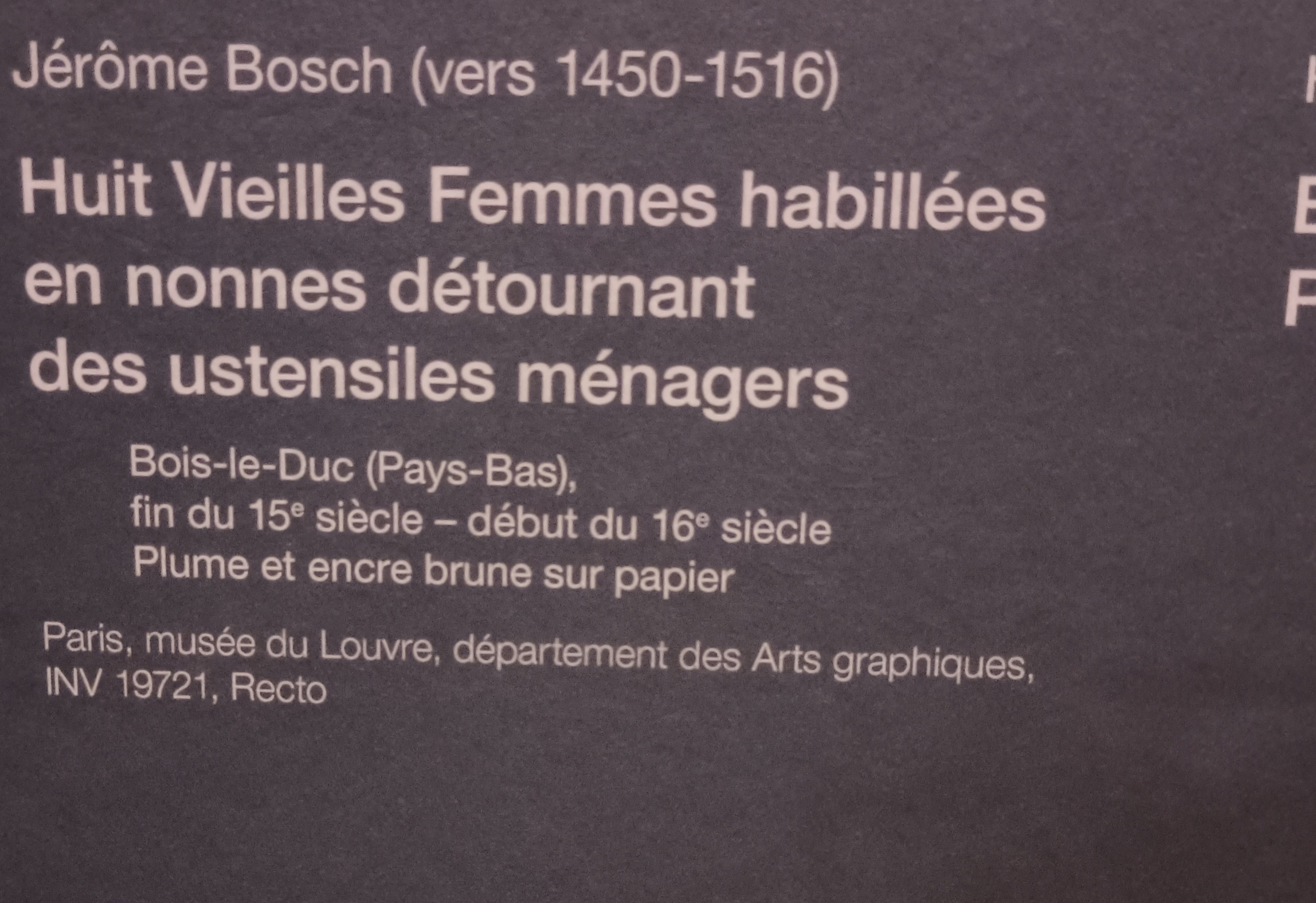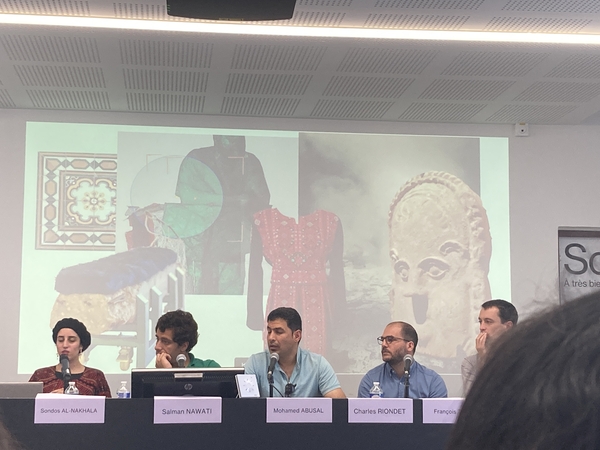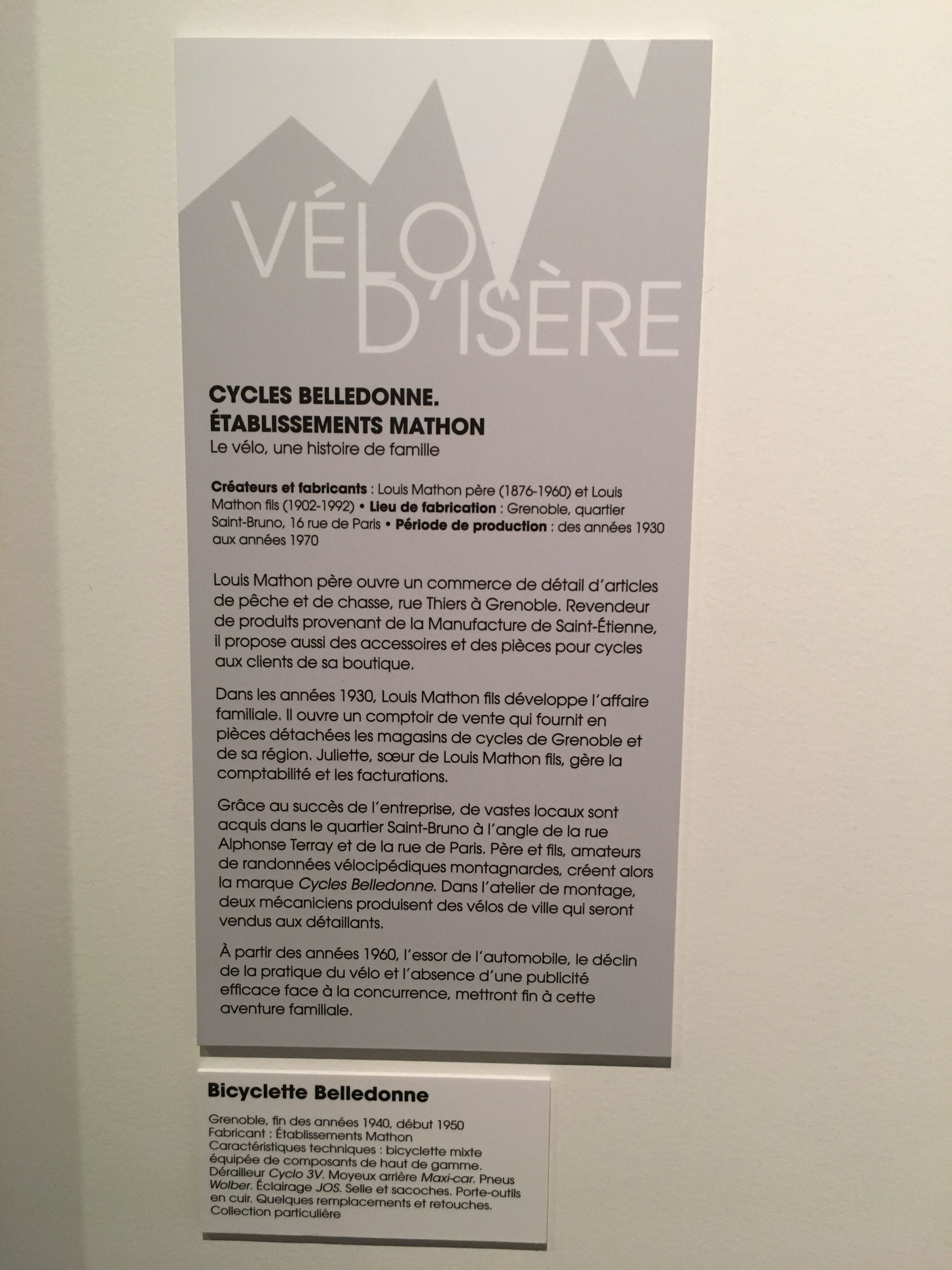Patrimoine - Société
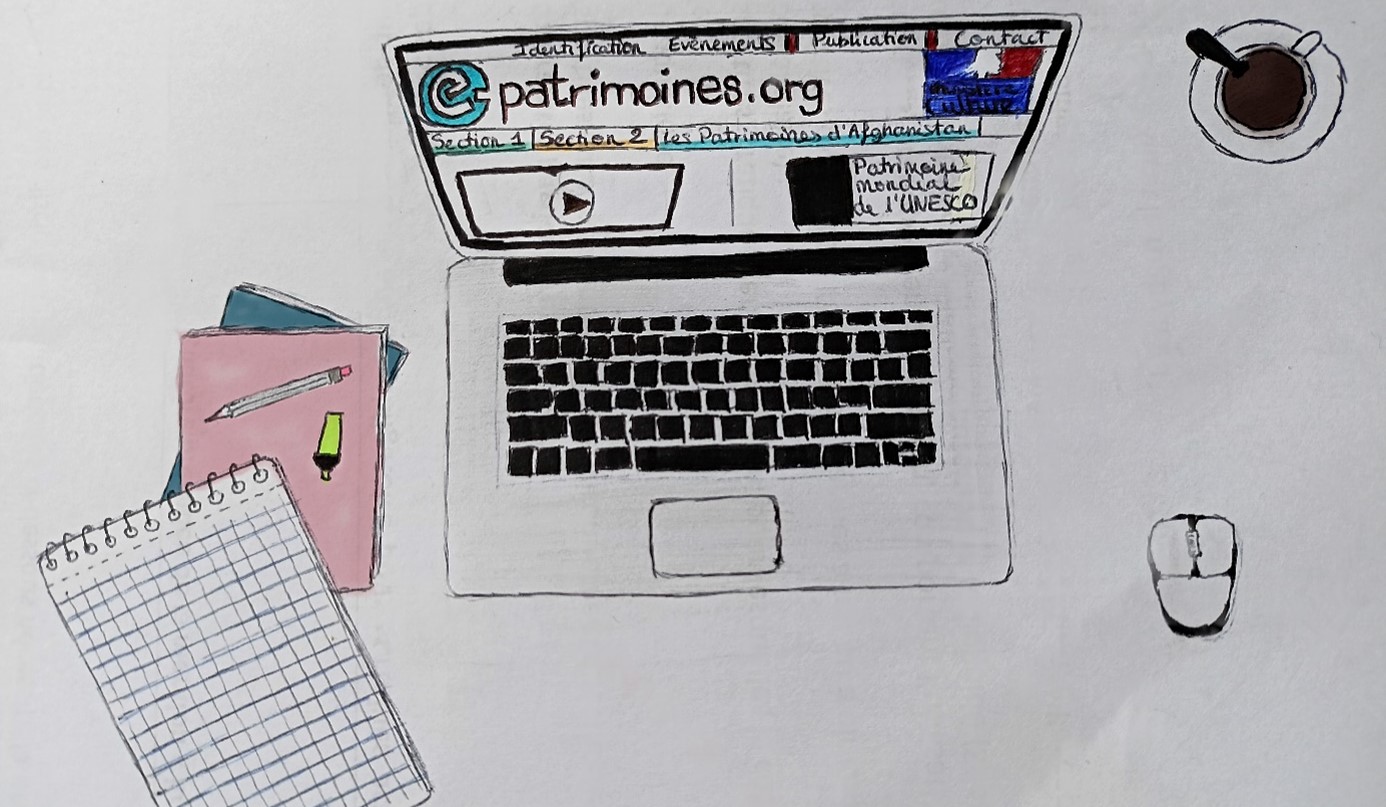
E-patrimoines.org : formations gratuites et continues dans le domaine du patrimoine matériel et immatériel
Vous souhaitez comprendre les patrimoines matériels et immatériels ? Apprendre de professionnels à votre rythme ? Ou tout simplement (re)découvrir le patrimoine francophone ? E-patrimoines.org propose des formations continues et gratuites sur le patrimoine.
E-patrimoines.org, qu’est-ce que c’est ?
E-patrimoines.org est une plateforme de formations continues et gratuites sur les patrimoines matériels et immatériels. Créée en 2011 par le Département des Affaires Européennes et Internationales (DAEI), direction générale des patrimoines du ministère de la Culture, en collaboration avec l’Agence Universitaire de la Francophonie AUF et l’Université Numérique Francophone Mondial UNFM, elle est destinée à un public francophone professionnel et universitaire dans le domaine du patrimoine. Depuis le 1er janvier 2021, le directeur général des patrimoines et de l’architecture succède au DAEI pour une nouvelle mission, le patrimoine mondial.

Liste de la Section 1 des modules disponibles sur la plateforme e-patrimoines.org. ©UNFM
Quels modules ?
17 modules sont disponibles sur la plateforme, il y en a pour tous les goûts : celui sur Les Grands Sites de France où l’on découvre ou redécouvre des sites français comme le Puy Mary dans le Cantal, saisir la diversité des corps de métier dans le module les Jardins un Patrimoine à Conserver ou encore la contribution de la France dans Le Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Un module dure entre 5 et 10 heures avec en moyenne 15 vidéos de plus ou moins 30 minutes. Par exemple, le module Trafic Illicite dure environ 6 heures pour 10 vidéos. Des événements et des colloques, dans le but de garder le lien avec les pays francophones, sont également retranscrits, le dernier en date est Conflits Armés et Patrimoine (2019).
J’ai posé quelques questions à
- Le dernier datant de 2019, prévoyez-vous de nouveaux séminaires ou colloques ?
« En octobre 2022, il y aura un séminaire à l'Ecole militaire sur l'architecture militaire » Caroline Kurhan, Responsable des patrimoines en Afrique, Département des affaires européennes et internationales, Direction générale des patrimoines, Ministère de la culture et de la communication
- Un nouveau module est-il en projet ?
« 3 modules sont en cours d’achèvement et seront lancés avant décembre 2021 :
- Les patrimoines de l’Afghanistan ;
- Le patrimoine mondial enregistré en 2016 mais complété en 2021 avec une partie sur l’élaboration d’une candidature à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial (Convention de 1972)
- Et un module sur le Gabon. »
Mon module préféré est le module 3 : Conservation Préventive. Des cours très complets allant de l’intérêt de cette discipline à la gestion des risques en s’appuyant sur des exemples concrets. Ce module va explorer en profondeur des questions très précises comme le choix de la lumière et les types d’éclairage ou le cas des climats tropicaux. Tous les intervenants, sauf un, travaillent au C2RMF (Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France) une branche du ministère de la Culture. Beaucoup de musées ont aujourd’hui leur propre centre de recherche et de conservation, des interventions de professionnels venant de ces centres seraient un bon moyen de compléter les points de vue et les méthodes de conservation préventive dans les musées.

Détails du module 3 : Conservation préventive. ©UNFM
Dans la vidéo 13 : 4-1. Lumière et éclairage muséographique – Jean-Jacques Ezrati, conservateur du patrimoine, département de conservation préventive (C2RMF), le début est consacré à la définition du mot musée qui découle sur une explication des mots scénographie, expographie et muséographie. La scénographie concerne la mise en espace, la mise en perspective, la traduction d’un discours dans les trois dimensions. L’expographie regroupe la scénographie dans le contexte de l’exposition, les règles de sécurité, l’ergonomie visuelle et sensorielle et la médiation. La muséographie dite « bis » correspond à l’expographie qui tient compte de la conservation (de ces témoins matériels).
Ce module date de 2013, or les définitions des mots scénographie, expographie et muséographie ont bien évolué depuis. Une exposition est toujours une affaire de fond (la muséographie) et une affaire de forme (la scénographie et le graphisme). L’expograhie est un terme de 1993 proposé par Desvallées pour compléter le mot muséographie. L’expographie serait “l’art d’exposer”, c’est la mise en exposition, c’est-à-dire la mise en espace et les techniques liées aux expositions (à l’exclusion des autres activités muséographiques comme la conservation, la sécurité, …)[1]. D’après l’Association des muséographes[2], dans un musée ou dans une exposition la part de la muséographie est celle qui a trait aux contenus, au scénario du parcours et aux modalités de la médiation entre un thème et des visiteurs. La scénographie concerne le traitement des espaces et des volumes, les matières, le design des mobiliers et supports physiques des collections, la mise en lumière, les décors. La question de l’actualité des informations des modules les plus anciens peut donc se poser.
Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur le site https://www.e-patrimoines.org/patrimoine/ en haut à droite dans « Identification » puis remplissez « Nouvel utilisateur ? ». Prévoyez un peu de temps, une partie motivation, expériences professionnelles et diplômes seront à développer. Après avoir complété les trois premières cases (Nom d’utilisateur, Courriel et Confirmation e-mail), vous devez cocher les modules qui vous intéressent. Rassurez-vous ce choix n’est pas définitif, vous aurez accès à tous les modules une fois votre dossier validé. S’ensuit une série de questions sur vos coordonnées, puis on vous demande où vous souhaitez suivre les cours, par exemple à domicile pour les cours en ligne, ou choisir les cours au campus de l’AUF. Le reste des questions est destiné à mieux vous connaître, votre parcours, vos motivations et vos projets.
Ça y est, votre dossier est retenu ! Félicitation, vous pouvez désormais dévorer les modules. Avant de commencer, il faut tout de même avoir une connexion Wi-Fi. Malheureusement, vos données mobiles ne vous donnent pas accès aux cours. Un peu dommage si l’on souhaite visionner les modules en extérieur ou si votre logement ne dispose pas d’une box internet.
Moodle ICOM
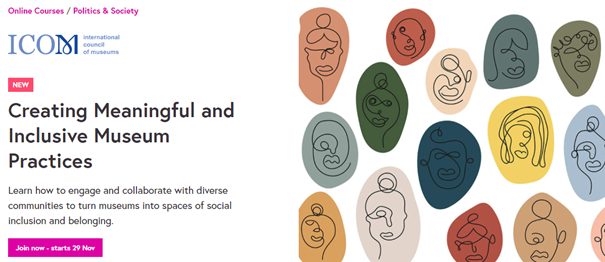
Moodle ICOM ©FutureLearn
Si cette méthode de formation vous intéresse, l’ICOM (International Council Of Museum) a créé son premier Moodle qui débutera le 29 novembre 2021 sur l’engagement et la collaboration avec diverses communautés pour transformer les musées en espaces d'inclusion sociale et d'appartenance. Ce cours est destiné aux professionnels des musées. Pour plus d’information rendez-vous sur https://www.futurelearn.com/courses/meaningful-inclusive-museum-practices
Pour en savoir plus :
- https://www.e-patrimoines.org/patrimoine/wp-content/uploads/Montage-juin-2018.pdf
- Pour toute question :
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Notes :
[1] Gob, A., & Drouguet, N. (2021). Introduction. Dans La muséologie : Histoire, développements, enjeux actuels (5e éd., p. 17). ARMAND COLIN. ↩
[2] Muséographie ? Notre approche. Muséographes (Les). Consulté le 13 novembre 2021, à l’adresse https://les-museographes.org↩
#formationgratuite #patrimoine #ministèredelaculture
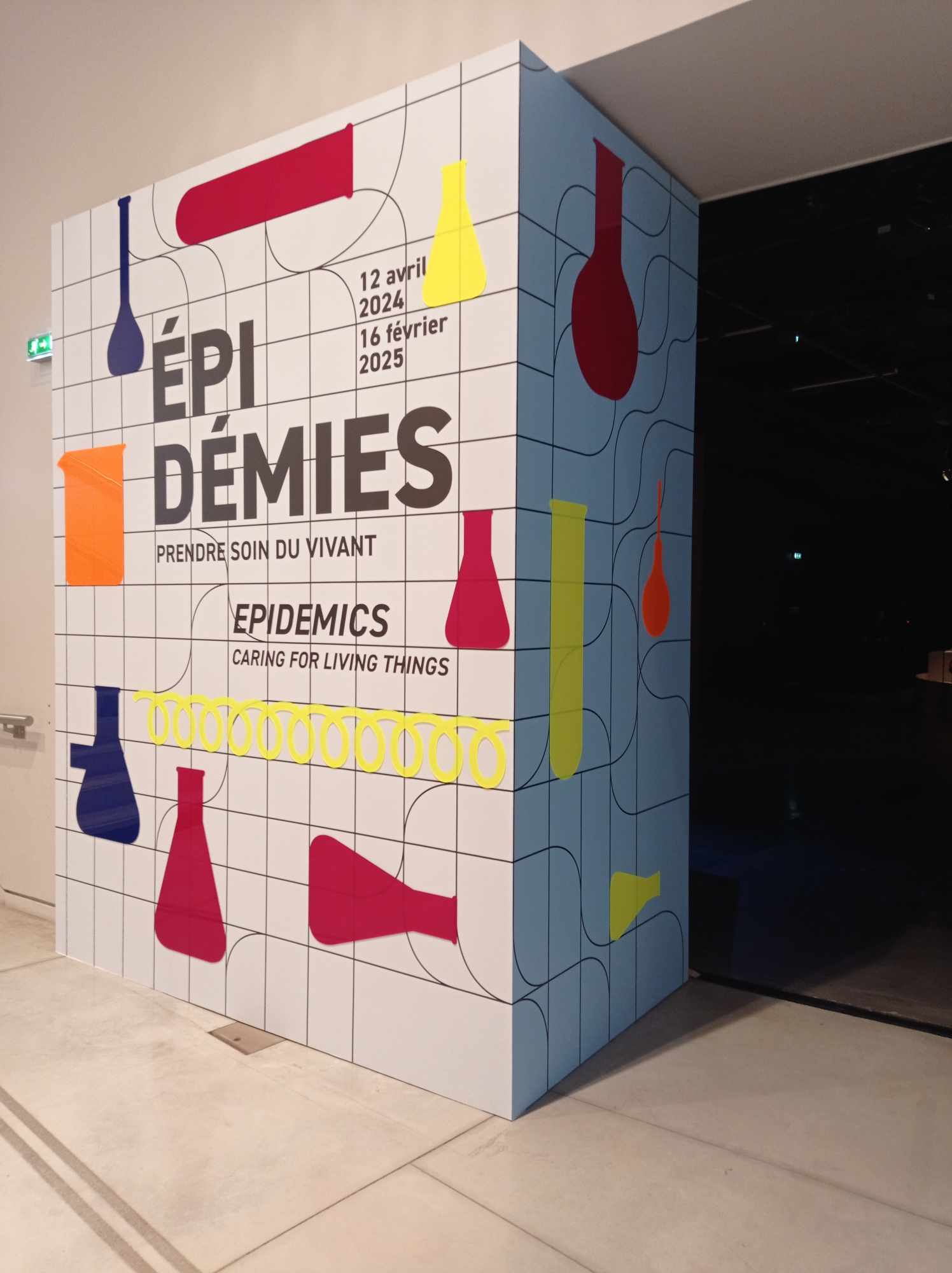
"Épidémies, prendre soin du vivant" : des découvertes qui vont vous contaminer
L’exposition Épidémies, prendre soin du vivant, ouverte du 12 avril 2024 au 16 février 2025 au Musée des Confluences à Lyon, est l'occasion de rendre visible un monde invisible. Mais cette exposition est-elle accessible pour tous ?
Entrée de l’exposition © Gaëlle Magdelenne
Les épidémies, une histoire millénaire
L’exposition Épidémies, prendre soin du vivant n’a pas pour vocation d’être simplement scientifique, son but est de donner une dimension sociale et historique aux épidémies, outre la dimension biologique. L’humanité et le monde vivant dans son ensemble ont depuis longtemps été confrontés à ces phénomènes.
L’exposition, organisée de manière chronologique, reprend les grandes épidémies auxquelles l’être humain a dû être confronté, et cela dès le Néolithique. Dès l’entrée, les visiteurs peuvent visualiser des espèces animales domestiquées par l’Homme au fil du temps. La domestication ou l’exploration du monde, en découvrant de nouveaux territoires, sont des conditions qui favorisent l’apparition et le développement de nouvelles épidémies.

Espace “Le temps des grandes pestilences” © Gaëlle Magdelenne
Chaque société s’adapte et perçoit ces phénomènes naturels de manière différente. De l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne, diverses raisons religieuses comme scientifiques sont données pour expliquer les maladies. Des mesures pour limiter la propagation sont mises en place au fur et à mesure : mise en quarantaine des malades et éloignement des cadavres, tout cela encadré par les autorités.
En plus des textes explicatifs, les visiteurs peuvent visualiser des œuvres d’art, des objets historiques, des reconstitutions mais également des vidéos et audios explicatifs pour mieux appréhender certains sujets. Chaque grande partie est représentée par une carte, reprenant les phases d'apparitions et d’expansion des épidémies ayant marqué l’humanité. Cet outil interactif montre la rapidité avec laquelle les épidémies se propagent.
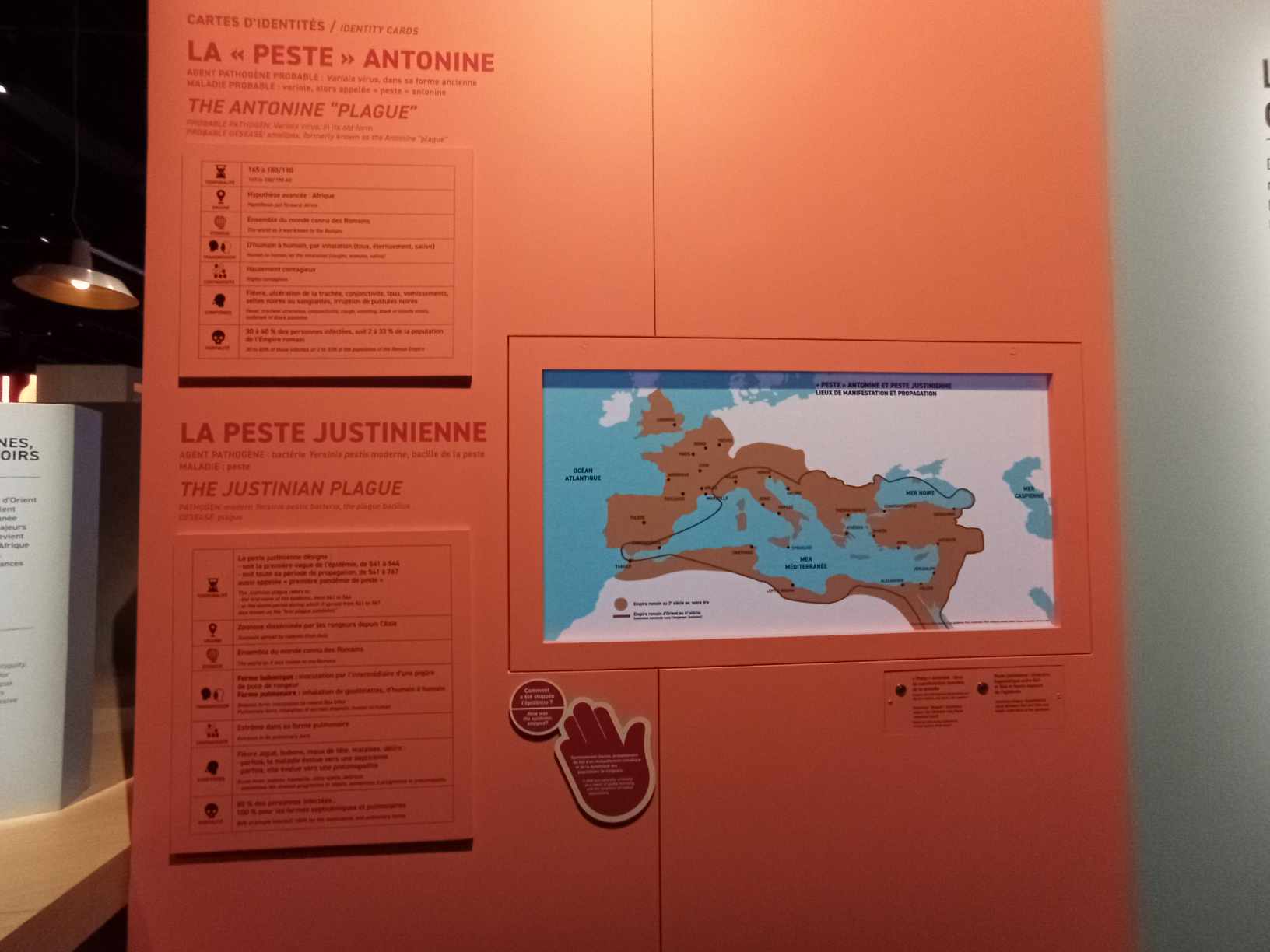
Carte interactive © Gaëlle Magdelenne
Un laboratoire de connaissance
C’est à partir du XIX° siècle que les recherches scientifiques deviennent de plus en plus importantes. Le principe de “l’hygiénisme”, reposant sur une santé publique, devient central. Les outils scientifiques, devenant plus performants, permettent de rendre visible, ce monde jusque-là invisible. Grâce à cela, les solutions médicales pour soigner tout être vivant sont de plus en plus efficaces. Les animaux pouvant être des vecteurs de maladies, l’être humain doit donc prendre en compte la nature qui l’entoure pour essayer de comprendre les épidémies et ainsi les limiter.
La fin de l’exposition confronte le public aux conséquences des actions humaines sur la nature par le biais de photographies. La perte de la biodiversité et l’intensification de l’élevage domestique entraînent une forte circulation des pathogènes entre espèces. Aujourd’hui, le but est d’analyser les pratiques reliant l’être humain et le monde vivant (santé animale et environnementale) pour mieux anticiper les futures épidémies.
Le changement de mise en espace de l’exposition marque ce tournant. Passant d’une scénographie épurée rappelant le “tracé d’un simple chemin de terre au Néolithique” à une mise en scène de laboratoire (développé par le collectif Le Muséotrope), la scénographie permet au public de comprendre rapidement l’approche que l’être humain a face aux épidémies. Vidéos explicatives, objets mis en scène, manipulations des outils scientifiques comme des microscopes (1) pour visualiser des insectes ou des bactéries… Un modèle de virus (2), celui du VIH, peut même être manipulé.

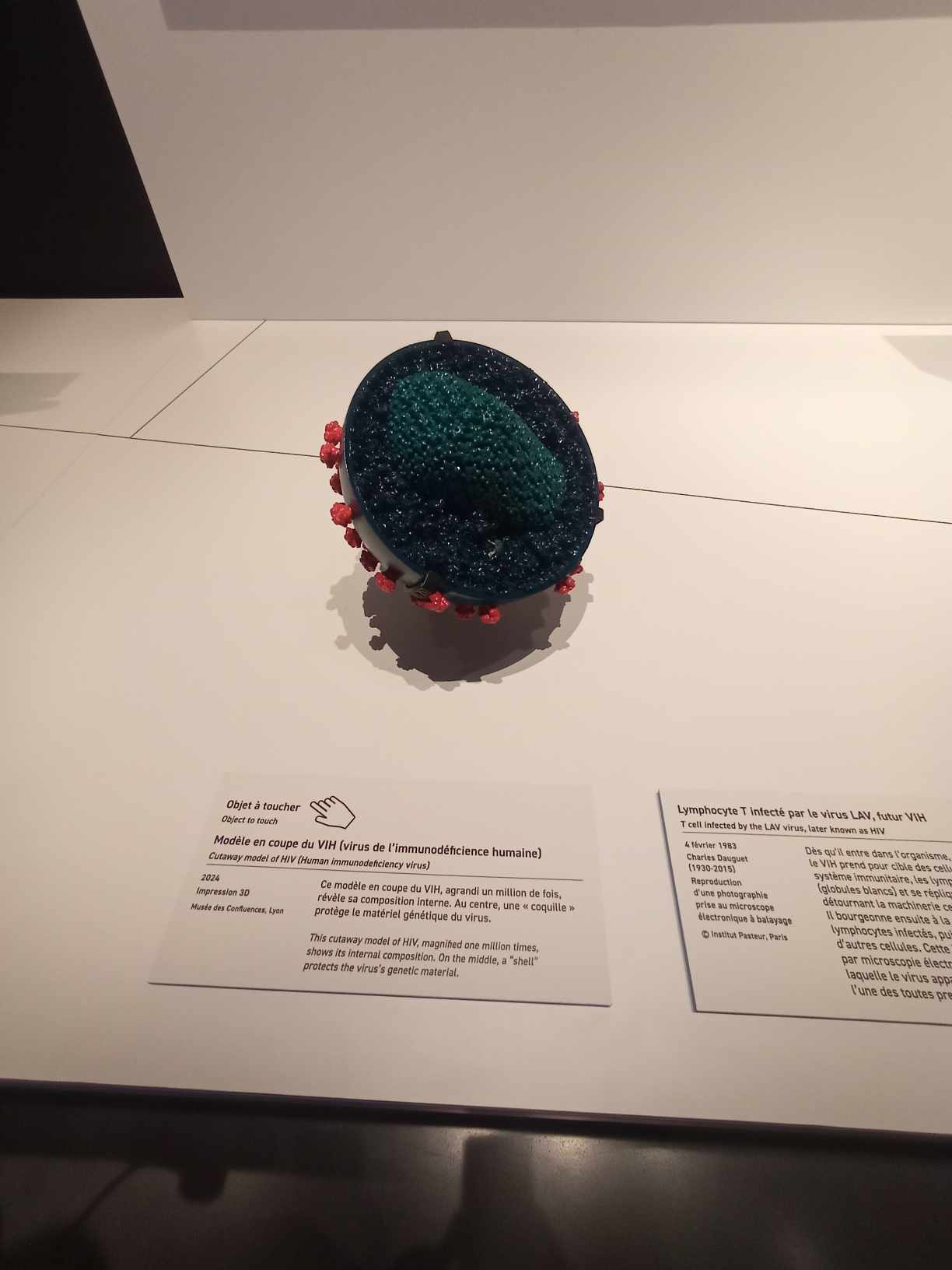
Espace “Étudier, voir, cultiver les microbes”(1) et modèle de virus à manipuler (2) © Gaëlle Magdelenne
Dès l’entrée, l’aspect scientifique du sujet est omniprésent par la présence de béchers, de fioles ou de tubes à essai en début de chaque partie. Cela peut dénoter avec l’interprétation sociale et historique voulue pour cette exposition. Les dispositifs audiovisuels et la plupart des manipulations sont en fin de parcours.
En dépit de sa complexité, l’exposition nous concerne, rappelant que les épidémies n’ont pas disparu. L’être humain est confronté à de nouvelles réalités : la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique, etc. Celles-ci doivent nous faire prendre conscience de l’équilibre précaire du monde vivant et de la nécessité de le maintenir.
Gaëlle Magdelenne
#MuséedesConfluences #epidemies #Covid-19
Pour en savoir plus :
- Site de l’exposition : https://www.museedesconfluences.fr/fr/expositions/expositions-temporaires/epidemies

« La Cité joyeuse » au Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenêt, une invitation à penser la ville autrement.
Prises de vue de l’exposition Mécanique d’une ville, les faubourgs du Mans,© - Giulia Guarino
Cinq zones ludiques pour s’approprier la ville
Activable avec des groupes ou en autonomie, cette salle de médiation, ouverte sur les espaces verts du musée, rassemble un certain nombre d’initiatives en lien avec les différentes thématiques abordées dans l’exposition Mécanique d’une ville. Organisé sous forme de carrefour urbain rythmé par des panneaux de signalétique, l’espace est divisé en cinq activités, chacune avec des intentions et enjeux différents.
« Permis de construire »
Ce premier module invite le visiteur à créer sa propre ville par le biais d’une maquette réalisée en bois. Plusieurs modes de jeu sont présentés pour guider l’enfant ou l’adulte dans la réalisation de cette ville idéale : un mode qui permet de s’approprier librement les différentes pièces et deux modes « apprenti architecte et architecte confirmé » plus poussés dans la réflexion qui propose d’aménager les quatre quartiers de la ville selon certaines spécificités : créer une cité ouvrière, un quartier avec de grandes infrastructures, une zone résidentielle et un quartier idéal. Libre à nous d’investir l’espace à notre convenance en positionnant les maisons, écoles et usines sur un schéma urbain schématisé.
Cette activité de la Cité joyeuse, nom qui n’est pas sans rappeler l’utopisme de Le Corbusier, permet d’appréhender sous un œil nouveau l’histoire et l’évolution de grandes villes industrialisées. Tournée vers le futur, cette manipulation permet de poser un nouveau regard optimiste sur la ville de demain et ses défis.
« L’île aux jeux »
Cet îlot est un lieu propice à la lecture d’ouvrages (prêts de la médiathèque municipale), au coloriage et aux jeux de société. Un memory ainsi qu’un jeu de sept familles ont été produits en interne par les équipes. Dotés d’une iconographie précise, ces jeux mettent en lumière les bâtiments phares du patrimoine manceaux. Un travail intelligent et précis qui est un très bel hommage fait à la ville.

L’île aux jeux, jeu de memory et sept famille disposés sur une table adaptée et ergonomique © - Giulia Guarino
« Faces-habitats»
Trois façades typiques sont à recomposer grâce à un puzzle aimanté à une cimaise. Cette manipulation fait un joli clin d’œil à l’architecture mancelle, visible par tout un chacun quotidiennement mais ici sublimée. Ce jeu de puzzle peut également composer des façades hybrides en créant des architectures absurdes et imaginaires.

Trois puzzles aimantés sur une cimaise carrée © - Giulia Guarino
« L’échappée mancelle » - Cimaise d’expositions temporaires
Voir et apprécier la ville autrement, voici l’intention de ce dispositif. Une grande cimaise d’exposition blanche accueille, en roulement, des expositions temporaires de photographies ou de dessins de la ville du Mans aujourd’hui. Ce projet « Art dans la ville » s’inscrit dans une stratégie culturelle plus large nommée « Objectif le Mans » dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle (CLEAC) de la ville. Ces expositions sont réalisées en co-production avec des élèves de l’école primaire ou étudiants des Beaux-arts, inspirés par des déambulations urbaines encadrées. L’accrochage qui habille actuellement cette cimaise est une exposition de dessin. Vu du ciel regroupe près d’une cinquantaine de dessins réalisés par quatre classes de cycle 2.

Cimaise de l’exposition Vue du ciel avec un cartel groupé avec l’identité de chaque enfant © - Giulia Guarino
Elle sera remplacée le 15 avril, par une exposition photo réalisée cette fois-ci par des élèves de cycle 3. Ces actions constituent pour les écoles participantes un véritable cycle pédagogique transdisciplinaire de 12 h (visite de l’exposition au musée, initiation à des domaines professionnels en lien, visite des archives municipales, séance shooting). Encadrés par un photographe professionnel, les élèves se sont essayés à la prise de vue contemporaine de leurs quartiers. Pour thème : l’humain dans la ville. Une riche restitution est attendue. Une trentaine de photos au format paysage seront exposées en un nuage d’images. Un catalogue sera tiré en édition limitée pour que chaque participant emporte avec lui ce souvenir. Un grand vernissage est également prévu à chaque investissement artistique de cette section «Echappée Mancelle ».

Test d’accrochage avant le montage de l’exposition photo « L’humain dans la ville » © - Giulia Guarino
« Le boulevard des mots »
L’installation « Le boulevard des mots », vient clôturer cet espace médiation en proposant une nouvelle expérience du livre d’or. Un pupitre met à disposition du visiteur des cartes postales du Mans et un stylo. Après avoir écrit son mot, il peut le disposer, à l’aide d’une pince, sur un mur rythmé d’avis, d’histoires, de témoignages, de dessins. Appelé livre d’or urbain, ces frises de cartes créent un inspirant nuage de mots et d’anecdotes, mêlant les âges, les genres et les origines. Participatif et incarné, dans son fond et dans sa forme, c’est une réelle inspiration pour réinventer le traditionnel et poussiéreux livre d’or de musée.

Livre d’or urbain avec station de cartes postales mises à disposition © - Giulia Guarino
Un centre d’interprétation et de sensibilisation aux questions patrimoniales et d’urbanistiques
Ainsi, la Cité joyeuse catalyse un grand nombre de très bonnes initiatives culturelles. Sous forme d’un espace d’interprétation, c’est une véritable action culturelle citoyenne tournée vers la ville et ses habitants. Activé en groupes scolaires, ce lieu de médiation est une initiative pédagogique très bien pensée qui fait vivre de façon amusante les connaissances données en classe. Cela favorise la mise en lumière et l’appropriation du territoire par les élèves.
Ces dispositifs de médiations mettent en regard l’histoire du Mans, l’appréciation et la préservation de son patrimoine architectural, l’art, la sensibilité citoyenne et la notion de vivre ensemble. Le tout réalisé en interne par des équipes dynamiques, déterminées et consciencieuses d’offrir une expérience de visite incarnée et personnelle. Ces axes de médiations font germer une multitude de réflexions stimulantes. En conclusion, allez visiter les Musées du Mans, ça vaut le coup !
Giulia Guarino
Pour en savoir plus :
#actionculturelleetcitoyenne #MuséesduMans #Mécaniquesd’uneville

« Le vent se lève » : récit d’une déambulation écologique au MAC VAL
« Le vent se lève, il faut tenter de vivre. » (Paul Valéry, Le Cimetière marin)
C’est dimanche, c’est le début des vacances : ni une, ni deux, je saute dans un train pour Paris pour me mettre à jour sur les expositions autour de l’écologie, à commencer par celle que présente le MAC VAL de mars 2020 à mars 2021. Cette expédition dominicale me réjouit d’avance : difficile de me combler davantage qu’en rassemblant les thèmes de la marche – voyage du quotidien – et de l’écologie dans une seule et même exposition.
L’exposition « Le vent se lève », dont le titre évoque l’éveil d’une prise de conscience de la crise écologique que nous traversons, est le dixième accrochage des collections du MAC VAL. A l’occasion de son quinzième anniversaire, l’institution choisit de s’ancrer dans une réflexion sur les rapports ambivalents qu’entretient l’humain à la Terre, dans une époque où les conséquences de l’entrée dans l’Anthropocène (« ce moment inaugural de l’histoire de notre planète où les activités humaines ont acquis le pouvoir d’agir sur le cours géologique de nos milieux de vie », pour reprendre les mots de Paul Ardenne1) deviennent indéniables. L’institution reste donc, par ce parti-pris thématique fort, fidèle à sa ligne d’expositions antérieures (voir Vertiges au Mac Val, Sarah Hatziraptis), toujours « en prise avec le monde ». Quatre-vingts œuvres de cinquante-deux artistes sont présentées dans cet accrochage qui s’étendra jusqu’à la fin 2021, faisant preuve d’une « collection vivante » dont les pièces, en constant dialogue les unes avec les autres, abordent la question de l’écologie sous une multiplicité d’angles et de visions croisées propices au débat et à la réflexion.
Une traversée de l’art écologique
J’entre dans un premier espace ouvert et lumineux. Le parcours, semi-directif, invite à flâner librement au gré de ce qui accroche l’œil. L’exposition s’organise autour de la question de la marche, qui fait office de fil rouge tout au long de la visite. Cette thématique est parlante pour les visiteurs puisqu’elle est le premier moyen dont dispose l’humain pour arpenter le monde. Elle permet par là même de donner une unité aux thématiques abordées dans cette exposition très dense, dépeignant des rapports au monde allant de l’émerveillement à l’inquiétude face à la destruction imminente. Le parcours entraîne le visiteur-arpenteur dans une traversée thématique mais aussi chronologique, puisqu’il confronte le temps long géologique au temps presque instantané de la technologie : le spectateur est le témoin de l’accélération du temps qui caractérise l’époque actuelle.
C’est par la géologie et l’archéologie que commence la visite, replaçant l’humain dans le contexte d’une temporalité géologique qui le dépasse et l’englobe. Les premières œuvres questionnent ainsi les traces qui subsistent, dans les couches successives du sol, du passé terrestre et des sociétés aujourd’hui disparues. Au centre du propos comme de la salle, se dresse la monumentale installation de Tatiana Trouvé, « Desire Lines » : la visite s’effectue en tournant autour de cette œuvre qui constitue le noyau de l’exposition. D’un côté de la salle est évoquée, non sans une certaine facétie, la quête perpétuelle du progrès, à travers des pièces s’intéressant aux inventions techniques de l’humanité. Sur le mur opposé, des démarches artistiques prônant le soin et la préservation d’une Terre qui constitue notre seul refuge répondent aux fictions apocalyptiques qui préfigurent les catastrophes auxquelles peut mener un progrès technologique sans limites. Au fond de la pièce, en dialogue avec le parc sur lequel ouvre la fenêtre, plusieurs œuvres questionnent et fusionnent les notions traditionnellement opposées de nature et de culture au sein de structures hybrides mêlant ressemblance formelle avec le végétal et techniques de création industrielles. Dans le même ordre d’idée, l’ensemble qui suit porte sur le paysage et son artificialité intrinsèque, en une gradation qui va de la représentation au remplacement pur et simple de la nature. En parallèle, d’autres relations possibles au monde sont explorées, du rituel à la constitution de nouvelles formes collectives de faire société dont la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, espace de lutte devenue laboratoire de nouvelles manières de vivre, est devenue le symbole. Un dernier espace est consacré à l’exploitation excessive des ressources naturelles, dont la monoculture de l’hévéa est un exemple, et aux conséquences de cette exploitation, rendues visibles par la disparition progressive d’oiseaux ou de certaines espèces végétales.
Après cette première salle aux murs blancs et lumineux, le spectateur pénètre dans une seconde salle obscure : ce fort contraste illustre l’entrée symbolique dans les profondeurs de la terre, cette zone étant dédiée aux imaginaires liés à la grotte. Spéléologue improvisé, le visiteur slalome alors entre des œuvres aux formes de stalactites, de squelettes énigmatiques et autres minéraux hybrides pour finalement remonter par une rampe en pente douce vers une autre salle entièrement dédiée à l’installation photographique et vidéo de Clément Cogitore, « Braguino ». Happé par cette œuvre immersive, le spectateur plonge dans l’univers à la fois sombre et onirique d’une communauté ayant choisi de s’installer loin des villes, au cœur de la forêt sibérienne, pour y vivre de manière autosuffisante en lien direct avec la nature.
La dernière salle de l’exposition revisite les topoï du romantisme que sont l’océan et la montagne : l’exposition s’achève ainsi sur l’installation « SWING » de Morgane Tschiember, dont la structure architecturale évoque sobrement la carcasse échouée d’une énorme baleine. La monumentalité de cette œuvre rappelle celle de l’installation de Tatiana Trouvé, que l’on aperçoit une dernière fois depuis la mezzanine avant de redescendre dans le hall, comme pour clore la visite par là où elle a commencé.
Rassembler dans une même exposition une telle diversité de thématiques, toutes constitutives du vaste champ de l’écologie, est ambitieux. Ce parti-pris semble néanmoins fructueux grâce à la fluidité de visite permise par l’ouverture des espaces et les choix scénographiques. Si aucun texte de salle n’est mis à disposition pour orienter le visiteur, les rassemblements thématiques autour desquels s’organise l’exposition sont clairs et propices aux échos entre les œuvres. Quelques recoins spécifiques sont ménagés pour matérialiser des unités thématiques, ou pour les œuvres vidéo nécessitant une plus faible luminosité, créant ainsi des ruptures de rythme dans la vaste salle. Le visiteur, novice ou chevronné quant à la question écologique, est libre de revenir sur ses pas pour confronter les points de vue et nourrir sa réflexion.
Lignes de désir : s’approprier le monde par la marche
Le choix de construire le propos en partant de la pratique de la marche comme manière de s’inscrire dans le monde et de revendiquer sa protection, plutôt que de commencer une nouvelle fois par le constat alarmant d’une destruction déjà en cours, permet de décaler le regard et d’approcher le sujet de l’écologie autrement que par un catastrophisme décourageant. Don de l’artiste au musée, les bobines monumentales et multicolores de l’installation « Desire Lines » de Tatiana Trouvé se dressent ainsi au centre de la première salle, attirant les regards où que l’on se trouve dans l’espace. Le titre, non dénué de poésie, fait allusion au terme utilisé par les urbanistes pour désigner les cheminements officieux et intuitifs empruntés par les piétons pour couper au plus court, plutôt que les itinéraires officiels prévus à cet usage. En effet, chacun des fils enroulés sur les deux-cent-douze bobines matérialise un itinéraire de promenade – un chemin de désir – traversant Central Parc, tout en évoquant plus métaphoriquement les grandes marches de l’humanité : l’installation prend ainsi la forme d’un vaste répertoire poétique.
Au-delà de sa monumentalité, l’œuvre invite le regardeur à s’approcher et à prêter attention aux détails, à devenir lui-même arpenteur et à se perdre entre les bobines pour se mettre à l’écoute des parcours dont l’œuvre porte l’histoire. Un peu au hasard, je me suis retrouvée nez à nez avec des bobines portant le nom de marches politiques, telles que la Salt March menée par Gandhi en 1930, mais aussi de dérives littéraires (celle de Borges et ses Senderos que se bifurcan) ou encore artistiques (comme celle de Francis Alÿs, artiste-arpenteur par excellence). L’œuvre Walks and all walks, qui adopte la forme d’une cartographie brodée, accompagne et complète l’installation en mettant en espace tous ces itinéraires sur un seul et même plan, à la manière d’une carte légendée. Cette invitation à la déambulation, à la création de sa propre ligne de désir par chaque visiteur, s’élargit à toute l’exposition : il en va de la relation au monde comme de l’expérience de visite, les deux s’appréhendent de manière sensible, par la marche et l’évolution du corps dans l’espace.
« La mémoire du sous-sol »
La question de la terre conçue dans sa matérialité et de la mémoire dont elle est porteuse traverse également l’exposition. Les toutes premières œuvres qui accueillent le spectateur s’intéressent ainsi à l’archéologie et à la géologie, plongeant le visiteur dans « la mémoire du sous-sol » évoquée par l’artiste Pierre Mayaux. Cette entrée en matière appelle à l’humilité : la finitude du temps humain et de ses grandes civilisations face au temps long des ères géologiques est rappelée par l’installation et la vidéo d’Ali Cherri, « Petrified / Fragments I », présentant sur une table lumineuse des fragments d’objets archéologiques provenant d’époques et de cultures différentes, mais ici assemblées pêle-mêle, décontextualisés comme pour montrer que du point de vue de la Terre, l’homme n’est que de passage et que déjà l’histoire des sociétés humaines se fond en un tout indistinct. Un crâne humain siège à l’avant du plateau, tout près du regardeur, comme pour le prendre à partie dans cette méditation aux airs de memento mori civilisationnel. L’installation « Time Capsules » de Khalil Joreige et Joana Hadjithomas, constituée de cinq carottages réalisés à Athènes, Beyrouth et Paris, va également dans ce sens. Exposés à la verticale, ces échantillons minéraux révèlent aux yeux du visiteur la succession des couches qui constituent le sol, habituellement invisible au regard : aux matières anthropiques de la surface succèdent les matériaux géologiques, mêlant notre histoire à celle de la terre. Un dessin archéologique légendé intitulé « Zig Zag Over Time » raconte, en une lecture plus poétique que scientifique du sol, un récit possible des catastrophes et régénérations dont peuvent témoigner ces prélèvements.


Vue de gauche : Ali Cherri, « Petrified / Fragments I ». Vue de droite : « Time Capsules », Khalil Joreige et Joana Hadjithomas. © Marion Roy
Cette thématique ressurgit plus loin, dans la seconde salle de l’exposition où l’expérience de visite prend des allures d’expédition spéléologique. L’installation « Acouskarstic » de Charlotte Charbonnel, reconstitution subjective d’une grotte, met l’accent sur les qualités plastiques et sonores de ce milieu souterrain. Happé par la lumière blanche contrastant avec la pénombre ambiante, par les reflets changeants des stalactites et stalagmites de verre sur lesquels s’accrochent des concrétions minérales aux formes irrégulières, et surtout par la douce ambiance sonore créée par le bruit irrégulier des gouttes d’eau tombant dans les profondeurs de la terre, le visiteur se sent vibrer à l’unisson de la respiration de la terre. En face, c’est une vision plus inquiétante du sous-sol que donne la vidéo « Si les heures m’étaient comptées » d’Angelika Markul : les images d’archive en noir et blanc retracent une expédition scientifique au cœur d’une mine mexicaine envahie par de gigantesques cristaux de sélénite. Ce milieu à la beauté fantastique, mais mortel pour l’homme, a été généré par la surexploitation du site : la vidéo, entre science-fiction et réalité, porte un regard singulier sur l’évolution naturelle des sites abîmés par l’exploitation humaine.

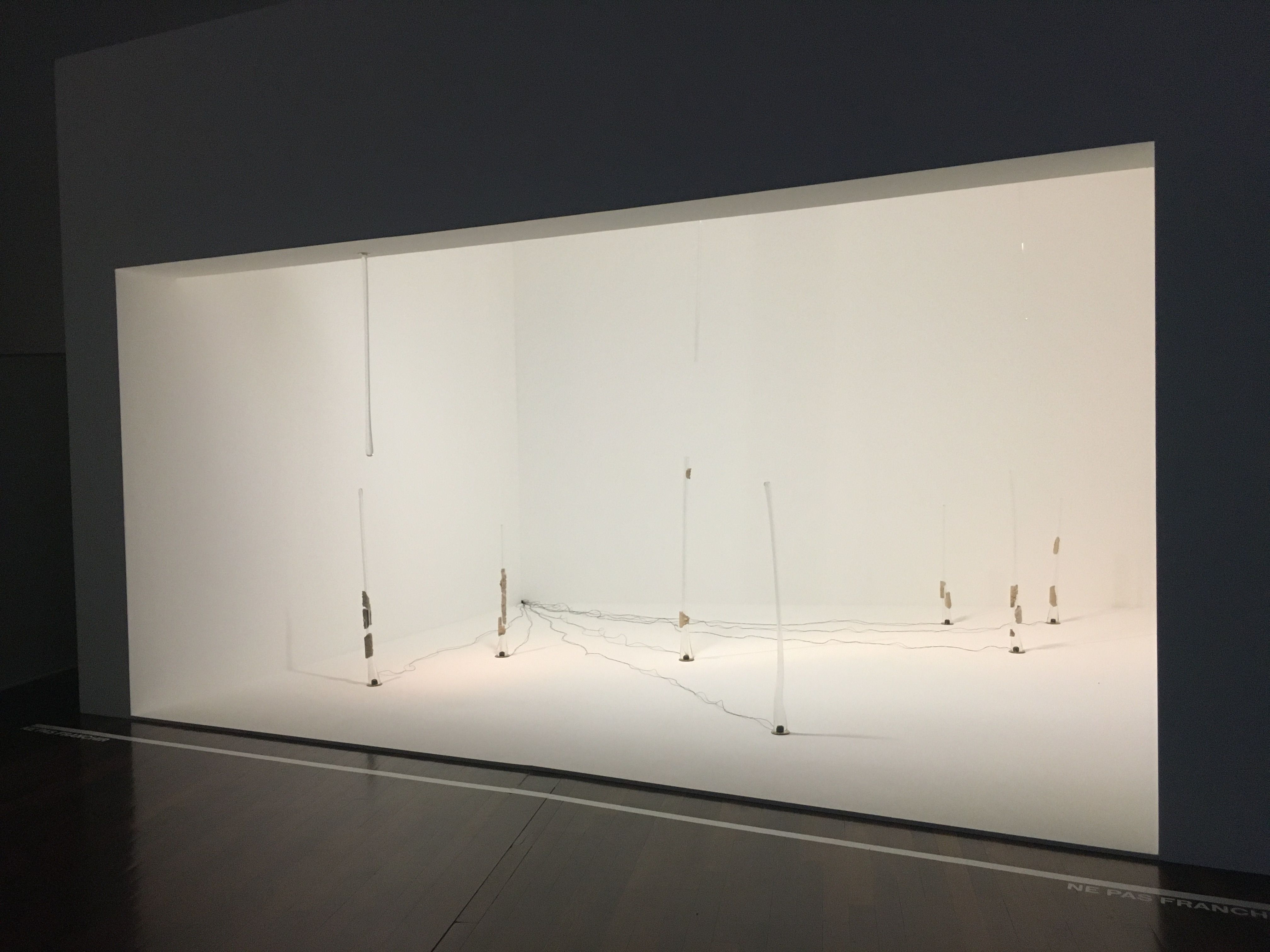
Vue de gauche : Vue de la deuxième salle de l’exposition, avec la vidéo « Si les heures m’étaient comptées » d’Angelika Markul sur la gauche. Vue de droite : « Acouskarstic », Charlotte Charbonnel. © Marion Roy
Questionner l’opposition nature/culture
L’exposition s’emploie, tout au long du parcours, à questionner la pertinence de la traditionnelle opposition entre nature et culture. Dès l’entrée dans le hall, le visiteur est accueilli par l’arbre artificiel de Pierre Malphettes, son lierre en néons verts et ses câbles électriques en guise de racines, comme si un fragment du parc du musée s’était réfugié à l’intérieur du bâtiment, témoin de la porosité entre les catégories établies par la pensée occidentale.
Au fond de la salle, plusieurs sculptures d’éléments végétaux, présentées sur un socle, incarnent cette hybridité par le contraste entre leur forme végétale et leurs matériaux constitutifs. Les tiges et les feuilles en Tergal de « Retour Sauvage », la sculpture-plante de Laurent Pernot, sont ainsi recouvertes de la cendre produite par la combustion d’ouvrages choisis parmi la bibliothèque de l’artiste. Ce retour du livre à son origine végétale témoigne de la destruction des ressources naturelles des forêts, mais aussi de la destruction de la culture liée à la diffusion des livres. En reproduisant artificiellement le cycle de décomposition/régénération de la matière organique, l’artiste court-circuite le processus naturel sur lequel se base l’existence même du végétal. Les feuilles figées de la plante synthétique sont incapables de tomber pour se transformer en humus, ce sont donc les feuilles calcinées des livres qui se décomposent à leur place : l’œuvre, à la portée symbolique forte, devient le point de rencontre où s’interpénètrent nature et culture. Le placement de ces répliques de fragments végétaux près de la fenêtre ouvrant directement sur le jardin ne doit rien au hasard : ce parti-pris scénographique établit une communication visuelle fertile entre intérieur et extérieur, entre simili-végétal et élément végétal véritable, alimentant le propos des œuvres sur la fluidité et l’interpénétration qui peuvent exister entre le naturel et le culturel.
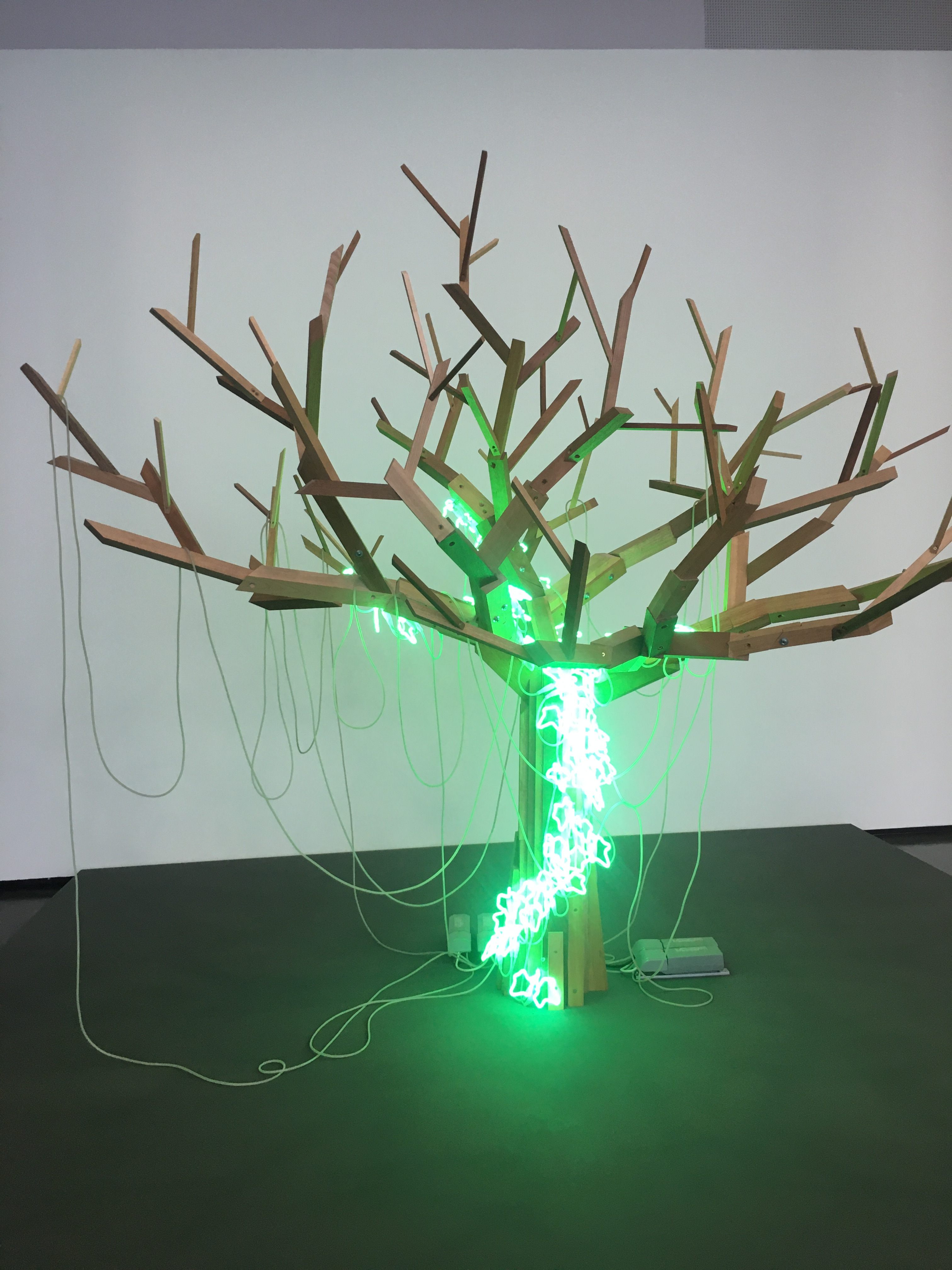

Vue de gauche : Pierre Malphettes, « L’Arbre et le lierre ». Vue de droite : Vue de l’exposition, avec la sculpture « Retour sauvage » de Laurent Pernot. © Marion Roy
C’est justement par le jardin que s’achève la visite. Plus exactement, elle s’y prolonge, puisque le jardin, ponctué de sculptures, fonctionne comme une extension de la salle d’exposition. Avant de partir, je passe par la petite hutte en brique rouge (« PANORAMA. Bell Pavilion ») qui accueille la vidéo « Animitas » de Christian Boltanski. Des clochettes japonaises en plein désert d’Atacama évoquent les âmes des personnes disparues ; leurs tintements dans l’immensité du désert appellent aussi les humains à l’humilité et au respect des écosystèmes dont dépend leur survie. Le visiteur est englobé par cette installation immersive : l’œuvre matérialise ainsi l’appartenance de l’humain à un monde auquel il participe mais qu’il ne saurait dominer, contrairement à ce qu’il aime à croire.
(voir Œuvre vidéo ou vidéo d'une œuvre ?, Sophie Delmas)
Marion Roy
#artcontemporain
#écologie
#MACVAL
Pour découvrir l’exposition (visible du 17 juin 2020 au 17 mars 2021) et les ressources mises à disposition par le MAC VAL : http://www.macval.fr/Le-vent-se-leve
1 Paul Ardenne, Un art écologique, p.12
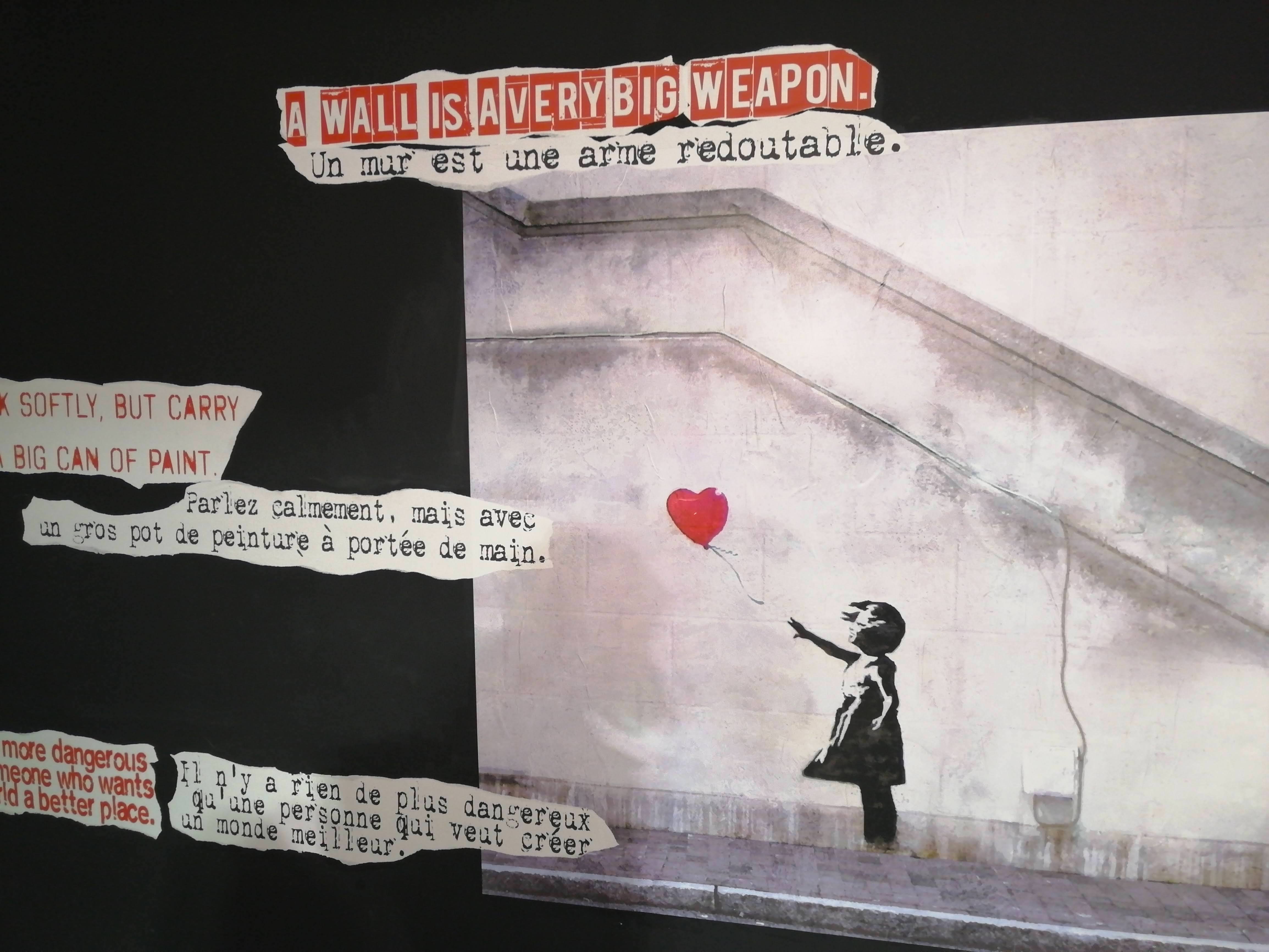
« The World of Banksy » : une commercialisation du street art
Girl with Balloon, œuvre renommée de Banksy © Nelly J.
Peut-on réaliser une exposition sur un artiste sans son accord ? C’est ce que propose « The World of Banksy », une rétrospective visible du 13 juin 2019 au 31 décembre 2020 à l’Espace Lafayette-Drouot à Paris. Développée sur un espace de 1 200m2, la manifestation présente des reproductions d’œuvres de Banksy par un collectif de street artistes souhaitant rester anonyme, ainsi que des lithographies originales issues de collections privées. Elle n’est pas à l’initiative de l’artiste et ne s’en cache pas. Un comble pour un artiste qui rejette la commercialisation de ses œuvres par le marché de l’art, dont il dénonce les excès. En effet, Banksy a choisi de n’être représenté par aucune galerie. Il gère lui-même le business de ses pochoirs, livres et films, et produit ses œuvres dans la rue afin de les rendre accessibles à tous.
Un artiste victime de son succès
Banksy, un street artiste renommé mondialement dont l’identité est entourée d’un véritable mystère. La légende raconte qu’il serait d’origine britannique, né à Bristol. Il aurait fait ses premiers pas dans le street art pendant les années 1990 en Angleterre. En utilisant la technique du pochoir, il caricature la société de consommation, le système capitaliste, la politique, l’armée, critique les injustices et s’engage également dans des causes humanitaires. Il est aujourd’hui le street artiste anonyme le plus médiatisé.
Le Royaume-Uni compte environ 80% des collections de l’artiste. On retrouve également sa trace dans les rues des villes américaines dès les années 2 000. En France, il est connu depuis 2015 pour avoir réalisé des pochoirs dans des quartiers parisiens. En hommage aux victimes de l’attentat de 2015, il réalise Bataclan en 2018. Comme d’autres œuvres, elle est dérobée en 2019. Retrouvée en Italie, elle a été officiellement rendue à la France le 14 juillet 2020.

Bataclan, un hommage aux victime de l’attentat de 2015, 2018
© Nelly J.
Banksy est contre les mécanismes du commerce de l’art. Paradoxalement, ses œuvres sont cotées à plusieurs millions d’euros sur le marché. En 2018, l’un de ses pochoirs sur toile encadré, Girl with Balloon, est adjugé vendu pour 1,2 millions d’euros. Toutefois, au moment où le commissaire des enchères valide la vente, l’œuvre s’autodétruit devant les yeux ébahis du public. Cet acte fort de Banksy marque son engagement contre la marchandisation de ses œuvres.
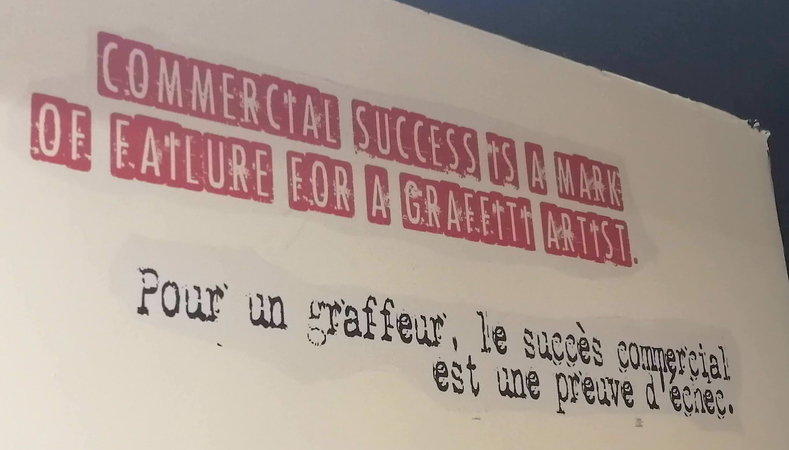
Une idéologie de Banksy
© Nelly J.
Pourtant, les villes du monde entier continuent à proposer des expositions sans son consentement ni sa participation. Banksy dénonce ainsi sur son site web les expositions au Portugal, Pays-Bas, Canada, Amérique, Arabie Saoudite, Russie, Hongrie, Roumanie, Turquie, Espagne, Italie, Allemagne, Grèce, Israël, Belgique, Suède, et en France dont celle de Paris. Au nombre de vingt-sept, elles sont affichées avec leurs prix d’entrée respectifs sous le mot « FAKE ». « Les membres du public doivent savoir qu’il y a eu une récente vague d’expositions sur Banksy mais qu’aucune n’est consentie. Elles ont été organisées sans connaissance ou implication de l’artiste. Veuillez les traiter en conséquence. », précise-t-il également sur sa page internet. La prolifération de ces expositions à but commercial peut-elle être apparentée à du vol ?
Une exposition faussement « immersive »
Malgré mes réticences envers ce commerce non éthique visant principalement à enrichir les galeries d’art, je suis allée visiter l’exposition « The World of Banksy », curieuse de la promesse d’une « expérience immersive ».
Le public est au rendez-vous. J’entre dans l’exposition par un couloir en suivant les traces de pattes de rats sur le sol, elles indiquent les sens de circulation. Banksy aime particulièrement représenter les rats dans ses œuvres. Des phrases originales de l’artiste sont apposées avec leur traduction sur les murs afin de plonger le visiteur dans son univers. « Si vous êtes sale, insignifiant et mal aimé, les rats seront votre seul modèle de référence. », peut-on ainsi lire à l’entrée de l’événement.
La visite continue par une descente au sous-sol. La scénographie met en scène des espaces citadins bétonnés. La muséographie propose des lithographies et reproductions d’œuvres grandeur nature réalisées en Amérique avec une statue de la liberté masquée. Une mise en scène qui semble rappeler les dernières actions de Banksy dans le métro londonien avec ses rats masqués ainsi que l’œuvre Cinquante ans depuis le soulèvement de 1968 à Paris exposée en face, mais sans aucun autre lien apparent puisque l’artiste n’a jamais réalisé de statue de la liberté masquée.

Cinquante ans depuis le soulèvement de 1968 à Paris, un pochoir réalisé à côté du Centre Pompidou en 2018, volé en septembre 2019.
© Nelly J.
Dans la même salle se trouvent également des pochoirs exécutés en France avec une boîte aux lettres et un poteau parisien pour marquer la distinction. Les bouches d’égouts dessinées sur le sol font également la différence entre la partie française et américaine, mais celle-ci est mince et donne l’impression de franchir l’Océan Atlantique en quelques pas. Néanmoins, je ressens plutôt un côté « galerie d’art » avec des œuvres n’utilisant que les espaces muraux de la pièce et de grands espaces pour circuler. Je ne plonge pas dans celui de la rue que la scénographie prétend donner, et qui serait à mon sens plus étriqué avec de nombreux autres accessoires. Les sols et murs trop propres ne symbolisent pas ceux du quotidien citadin. Aussi, il faut savoir que Banksy travaille sur du mobilier. Cinquante ans depuis le soulèvement de 1968 à Paris a été graffé sur un panneau autoportant. Pourquoi est-il sur un mur ? Des installations au milieu de la pièce auraient permis de mieux rendre compte de la complexité des rues citadines et de donner plus de visibilité au séquençage des espaces. De plus, les œuvres possèdent des cartels, placardés comme dans un musée Beaux-Arts, qui ne permettent pas de s’immerger dans le street art de Banksy.

Un espace franco-américain de l’exposition, « The World of Banksy »
© Nelly J.
La scénographie change ensuite pour nous transporter en Israël près du mur de Bethléem dans un paysage extérieur de guerre et de destruction. Cet espace est mieux réussi en raison de sa disposition qui permet d’être au cœur des réalisations, renforcé par la présence de sable et de débris. Néanmoins, les œuvres reproduites côte à côte ne font plus sens. Dans ce fourre-tout, seules les plus grandes attirent réellement le regard du visiteur. Pour donner une impression plus réelle, peut-être aurait-il fallu reproduire des photographies des constructions bétonnées afin de trancher avec le dessin des pochoirs ?

Reconstitution du mur de Bethléem qui sépare l’Israël et la Palestine, 2005
© Nelly J.
J’entre ensuite dans la reconstitution de la chambre du Walled off Hotel. Ce bâtiment entièrement aménagé par Banksy à quelques mètres du mur de Bethléem est une installation politique. Il ouvre officiellement ses portes au public en 2017. La reconstitution est à mon sens l’immersion la plus réussie de l’exposition. En effet, la charge modérée de contenus muséographiques s’accorde parfaitement avec le mobilier disposé, et le souci du détail ancre le visiteur dans l’espace. En outre, certains cartels sont plus discrètement installés sur des meubles.

Reconstitution d’une chambre du Walled off Hotel de Banksy,
Bataille de polochon entre un Israélien et un Palestinien, 2005
© Nelly J.
Le parcours de visite remonte ensuite à l’étage afin de découvrir les œuvres de Banksy en Angleterre, particulièrement à Londres. Une petite cabine téléphonique rouge symbolise les rues londoniennes avec des œuvres phares comme Kissing Cooper ou Pissing Gard. Toutefois, si j’admire les œuvres originales de Banksy dans le couloir adjacent, je suis encore une fois perturbée par la mise en scène plus proche d’une galerie d’art que de l’esprit street art.

Un espace d’exposition, « The World of Banksy »
© Nelly J.
En outre, certains cartels de l’exposition me paraissent douteux. Nombreuses sont les spéculations en Histoire de l’Art, et dans cette rétrospective certaines interprétations m’interpellent. Par exemple, pour l’œuvre Love Rat, on peut lire « Le rat tient le pinceau comme une demoiselle prête à être embrassée. » Je ne pense pas que l’artiste ait voulu présenter son œuvre ainsi. Il ne s’agit pas de sa signification mais d’un fantasme grotesque du rédacteur. Pourquoi une demoiselle ? Ce rat ne pourrait-il pas être de sexe masculin ? Comme d’autres dans cette exposition, cette œuvre perd son sens premier au profit de ceux qui s’en emparent. Si le street art se passe de cartels, pourquoi ne pas en faire de même au lieu d’émettre des interprétations douteuses ?

Love Rat, 2004
© Nelly J.
Une rétrospective qui ne rend pas justice à l’œuvre de Banksy
A la sortie de la manifestation parisienne, je me questionne : qu’est-ce qui peut justifier un tarif d’entrée à 14 euros ? Payer les artistes qui ont effectué les reproductions ? Les charges de la galerie, de gestion de l’événement et du personnel ?
Vous l’aurez compris. Sous ses airs de rétrospective, se cache en réalité une machine commerciale qui vise à faire des bénéfices sur le dos d’un artiste renommé susceptible d’attirer les foules. Bien entendu, la chose est plutôt aisée car l’activité de Banksy est illégale et que l’artiste anonyme ne peut porter plainte. Toutefois, il réplique en exprimant son indignation sur son site web et en taguant le mot « FAKE » sur certains bâtiments où il est exposé.
Si cette manifestation permet aux visiteurs de découvrir le street art de Banksy sans devoir se déplacer dans le monde entier, elle met en exergue une décontextualisation des œuvres. On ne saisit plus l’esprit du street art, qui s’inscrit dans un paysage particulier, enraciné dans un lieu où il fait sens. Reproduites à la suite, disposées côte à côte, les œuvres ressemblent plus à l’espace muséal d’une galerie aménagé pour satisfaire une clientèle plutôt que des contestataires comme Banksy. L’effort scénographique n’a pas été poussé à son paroxysme et n’évoque pas la réalité du street art.
Il n’y a pas de réelle reconnaissance de l’artiste. Le gérant du lieu considère que « seul le résultat final est important », non la personne qui tient la bombe ou le pochoir. Dans ce cadre, faire une exposition en utilisant le nom de l’artiste pour attirer les foules est-il honnête ? En suivant les conseils de Banksy, je traite cette rétrospective en tant que telle : une pâle copie des œuvres originales, éloignée de l’esprit rebelle du street art. En effet, je suis loin de retrouver certaines idéologies notamment la démocratisation de l’art. Sous couvert de valoriser l’artiste, les lieux cultuels s’approprient les œuvres, détournent parfois les messages originaux et font ce que Banksy réfute de faire lui-même : une commercialisation du street art.
Nelly Jacquemart
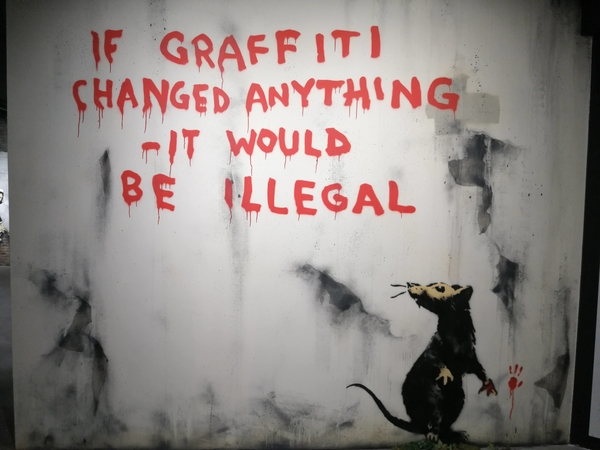
« Si les graffitis changeaient quoi que ce soit, ils seraient illégaux. »
© Nelly J.
#banksy
#streetart
#expositionparis

(Museum) space is the place : L'afrofuturisme au musée
Image d'en-tête : Alisha B. Wormsley, There Are Black People In The Future, The Last Billboard, Pittsburg, PA, 2017. Reproduction. Courtesy of the artist. © Alisha B. Wormsley
En novembre 2021, le Metropolitan Museum dévoile au public sa nouvelle period room, consacrée à l'afrofuturisme. Ce mouvement artistique, littéraire et politique, né dans les années 1950 au sein de la communauté noire américaine, trouve peu à peu sa place dans les musées. Comment exposer cette mouvance pluridisciplinaire, qui entremêle histoire traumatique, présent douloureux et futur utopique.
Passé et présent de l'afrofuturisme
Sous le label El Saturn, le musicien de jazz expérimental Sun Ra et son Arkestra produisent des albums dont les titres font rêver à d'autres galaxies : The Nubians of Plutonia (1958-59), Interstellar Low Ways (1959-60)... Dans son film Space is the place ("C'est dans l'espace que tout se passe", 1974), le chanteur propose d'acheminer la communauté noire américaine vers une nouvelle planète. A sa suite, tous les genres musicaux nés de la culture africaine-américaine (funk, techno, rap...) font germer des imaginaires spatiaux et futuristes. Dans ses récits de science-fiction écrits dans les années 1970 et 1980, l'autrice noire américaine Octavia E. Butler s'attaquent à la "brimade de l'ordre (...) le début d'un comportement hiérarchique pouvant mener au racisme, au sexisme, à l'ethnocentrisme" (A World without Racism, 2001). Dans "Lost Races of Science Fiction" (revue Transmission, 1980), elle déplore la présence marginale de personnages racisés dans les récits de SF.
Les Etats-Unis sortent tout juste de décennies d'esclavage, puis de ségrégation. La communauté noire américaine ne se sent pas chez elle dans ce pays qui l'exploite, l'isole, la violente : elle rêve d'un ailleurs, spatial ou temporel. Par la projection imaginaire, des créateur.ice.s lui dessinent un destin plus heureux. La science-fiction permet également de formaliser par la mise en récit l'expérience de cette communauté, le sentiment d'aliénation (en anglais, le mot "alien" a gardé son sens d'"étranger"), et le trauma collectif de l'exil et de l'esclavage. Les enlèvements commis par des êtres extra-terrestres rappellent le rapt et la réduction en esclavage qu'ont subi des milliers d'Africain.e.s au 18ème siècle.
Ce mouvement, avant même d'être théorisé, se diffuse dans les arts visuels, le cinéma, la mode ou encore le design. Il trouve son nom en 1993 sous la plume du journaliste culturel Mark Dery, dans son anthologie Flame Wars, The Discourse of Cyberculture : "afrofuturisme". Il est, plus que jamais, au cœur de la vie culturelle contemporaine. Il règne sur la pop culture avec des œuvres comme Black Panther (deuxième film au box-office américain en 2018, année de sa sortie) ou la musique de Janelle Monae. Il accompagne le mouvement Black Lives Matter, qui milite contre les violences policières que subissent les Noir.e.s américain.e.s. Il inspire les artistes contemporain.e.s, comme le photographe Samuel Fosso ou l'artiste pluridisciplinaire Jessica Valoris. Et depuis 2015, il trouve sa place dans les salles des musées.

Alton Abraham, Sun Ra sur le tournage de Space is the Place, 1972.
Reproduction Courtesy of John Corbett and Terri Kapsalis © Adam Abraham
Conjuguer le musée au futur
Les musées qui s'emparent du thème de l'afrofuturisme se trouvent confrontés à plusieurs problématiques. Notamment : comment exposer un mouvement né il y a soixante ans, investi par les champs littéraires, musicaux, cinématographiques, picturaux, philosophiques et politiques ? L'afrofuturisme est d'abord utilisé comme thème pour lier le travail de plusieurs artistes. C'est le cas au Museum of Contemporary Photography de Chicago, avec son exposition In their own form (avril-juillet 2018). Le musée expose treize photographes qui explorent de près ou de loin le thème de l'afrofuturisme. Ces artistes sont africain.e.s et noir.e.s américain.e.s. : en effet, l'afrofuturisme se veut un mouvement transnational, investi par les artistes d'Afrique comme celleux issu.e.s de la diaspora. Il permet de créer ou de recréer une culture commune, un horizon partagé. En cela, il s'inscrit dans la lignée du panafricanisme, idéologie qui promeut une solidarité totale entre Africain.e.s et leurs descendant.e.s exilé.e.s.
L'Institute of Contemporary Art de Londres invite en 2019 le collectif américain Black Quantum Futurism et leur projet Temporal deprogramming, composé d'une installation, de concerts et de performances qui mettent en avant la dimension militante, et notamment féministe, de l'afrofuturisme. Le nom du projet annonce la couleur : il s'agit de dé-programmer le musée, de subvertir ses codes et ses traditions. Et de le faire non pas de manière temporaire (temporary) mais temporel (temporal), de repenser la notion même de temps au musée. Ne plus seulement conserver le passé pour l'avenir, mais imaginer le futur, s'y projeter. En cela, l'évènement rappelle l'action Mining the Museum de Fred Wilson, qui en 1992 investit les collections du Maryland History Society pour questionner la place de l'histoire et de la représentation des Noir.e.s dans les institutions muséales. Il dispose des chaînes d'esclave dans une vitrine de vaisselle en métal ouvragé, vide des piédestals de leur statue... En jouant avec le discours expographique, il force les musées à affronter leur passé et leur présent raciste. Les musées ethnographiques, enrichis d'objets spoliés, ont notamment participé à légitimer la colonisation. Exposer le thème de l'afrofuturisme amène à redéfinir qui a sa place au musée, et comment les institutions montrent celleux qui étaient considéré.e.s comme "l'autre". Ou comment elles choisissent de ne pas les montrer, mais de leur offrir un espace pour qu'iels s'expriment avec leur propre voix et leurs propres images.

Olalekan Jeyifous, Shanty Mega-structures: Makoko Canal, 2015. Reproduction.
Courtesy of the artist. © Olalekan Jeyifous
Retracer l'afrofuturisme
Il faut attendre 2021 pour qu'une exposition offre une vue globale de l'afrofuturisme. Mothership : Voyage into afrofuturism, visible à l'Oakland Museum of California jusqu'au 27 février 2022, revient sur les origines du mouvement, en éclaire les figures majeures, et montre la prégnance de ce thème dans le paysage contemporain. Sur le site internet du musée, les premières phrases témoignent d'une volonté de donner une appréciation globale du mouvement, et de le rendre accessible au grand public : "L'afrofuturisme comprend beaucoup de choses. C'est le passé, le présent, le futur réimaginés à travers une perspective culturelle noire." (Afrofuturism is a lot of things. It’s the past, present, and future reimagined through a Black cultural lens.). La formulation est simple, mais elle ouvre des perspectives immenses.
Octavia Butler y est mise à l'honneur : certains de ses manuscrits annotés sont exposés, et deux salles sont nommées par les titres de ses romans. Les visiteur.euse.s peuvent monter dans une réplique du Mothership, vaisseau spatial ayant servi d'accessoire de scène au groupe Parliament-Funkadelic dans les années 1970. Un costume du film Black Panther, crée par Ruth E. Carter, trône dans l'expositon, et montre bien au public que l'afrofuturisme fait partie de son paysage culturel. Oakland, ville à forte population noire et qui a vu naitre le Black Panther Party, parait un contexte plus qu'approprié pour cette exposition.

Alun Be, Potentiality, Edification Series, 2017. Reproduction. Courtesy of the artist. © Alun Be
S'envoler au Metropolitan Museum
Comme nous l'avons mentionné, le Metropolitan Museum de New-York n'a pas attendu longtemps pour monter à bord du vaisseau et installer l'afrofuturisme au sein de ses collections. Le 5 novembre 2021, le musée ouvre au public "Before Yesterday We Could Fly : an afrofuturist period room" ("Avant hier, nous savions voler : une period room afrofuturiste") . Les conservateur.ice.s à l'origine du projet, Sarah Lawrencen et Ian Alteveer, ont avancé l'idée qu'une period room est forcément une construction fictionnelle, et qu'elle peut donner lieu à des récits politiques, supports de dialogues et de changements sociaux. Ainsi, Before Yesterday We Could Fly ne cherche pas à reproduire un intérieur selon le style d'une époque, comme dans les period room traditionnelles, mais propose un futur alternatif. Les commissaires ont invité Hannah Beachler, cheffe décoratrice de Black Panther, et Michelle Commander du Schomburg Center for Research in Black Culture pour imaginer cet espace. Beachler et Commander se sont inspirées de l'histoire de Seneca, village construit à New-York au 19ème siècle par des descendant.e.s d'esclaves, et rasé pour laisser place à Central Park. Pour se poser la question suivante : si le village n'avait pas été détruit, à quoi ressemblerait-il aujourd'hui ?
La salle est donc occupée par une maisonnette réalisée d'après les résultats de fouilles archéologiques, décorée d'œuvres anciennes comme contemporaines, d'artistes africain.e.s et noir.e.s américain.e.s. L'intérieur de la maison ne s'observe d'abord qu'à travers des ouvertures dans les murs, puis par un côté vitré, pour transmettre l'idée que l'accès au passé ne se fait que par bribes, que chacun.e doit en reconstituer son propre récit. En proposant "le passé, le présent, le futur réimaginés à travers une perspective culturelle noire", le Met n'expose pas seulement un morceau d'histoire, mais créé une œuvre afrofuturiste. Before Yesterday We Could Fly est un outil de réflexion et de dialogue sur l'histoire des Etats-Unis, la colonisation, les rapports de domination, et le rôle que le musée peut jouer dans les débats sociaux actuels.
Depuis 2011, une réplique du Mothership est exposée au Smithsonian Museum of African American History and Culture. A l'occasion de son exposition en 2018, le Museum of Contemporary Photography de Chicago a acquis trois œuvres pour sa collection permanente. Contre-culture longtemps négligée, l'afrofuturisme est considéré à présent comme un fil rouge essentiel de l'histoire culturelle des communautés noires américaines, et de l'histoire globale de l'art. Le mouvement s'inscrit dans les collections des grands musées, et ainsi gagne en légitimité. Au détriment de sa dimension subversive ?
Barbara Goblot
Pour aller plus loin :
- L'article de Kodwo Eshun, "Further Considerations on Afrofuturism", publié dans The New Centennial Review (2003)
- Le podcast Afrofuturismes, de Sinatou Saka et Vladimir Cagnolari (2019)
- La visite virtuelle de "Before Yesterday We Could Fly ; an afrofuturistic period room" au Metropolitan Museum (2021)
- Une playlist afrofuturiste
#afrofuturisme #MetropolitanMuseum #artcontemporain

5 questions pour comprendre l'open data dans les musées
Qu’elle soit big ou open, la data interroge. Notre société produit aujourd’hui de la donnée en masse et en permanence : comment est-ce que cela impacte le milieu culturel ? Un focus sur l’open data et les musées.
1. L'open data, qu'est-ce que c'est ?
L’open data, ou en français « ouverture des données », est le fait de mettre à disposition des citoyens les données publiques des institutions. Cela s’applique aussi bien aux administrations régionales qu’aux équipements sportifs municipaux, à la sncf ou aux musées nationaux. En France, le cadre légal rend obligatoire la mise à disposition des données produites dans le contexte professionnel des administrations publiques, mais chaque institution le fait à sa manière. Le but de l’open data est de rendre les données gratuites et réutilisables, et cela sans contrainte technique pour l’utilisateur. Évidemment, certaines données sont exclues de l’ouverture au public : les données sous secret légal, soumises au droit de la propriété intellectuelle ou encore celles pouvant toucher à la sécurité nationale.
L’open data est la forme numérique de l’ouverture des données : les jeux de données produits par les administrations sont regroupés en ligne, sur des sites identifiés. Attention cependant à ne pas confondre ouverture et accessibilité : quand il faut cliquer sur cinq ou dix liens internet consécutifs pour trouver le jeu de données que l’on cherche, c’est que les données sont disponibles (ouvertes), mais pas accessibles ! Aussi, militer pour l’open data, ce n’est pas seulement aller dans le sens de la mise à disposition des données pour le public, c’est aussi militer pour qu’elles soient accessibles au plus grand nombre le plus facilement possible.
Et les musées ? Pendant longtemps ils ont été exclus de l’obligation juridique de mise à disposition des données, au titre du régime dérogatoire des données culturelles selon la loi CADA de 1978. Aujourd’hui, ils sont soumis à cette obligation comme les autres administrations. En revanche, les institutions culturelles publiques ont le droit de demander une redevance pour toutes les données issues de la numérisation des collections (car c’est un processus qui peut être très coûteux). C’est la raison pour laquelle la Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais peut facturer des numérisations haute définition d’œuvres pourtant dans le domaine public (et donc soumises à l’ouverture des données). Dans les faits, les musées sont aujourd’hui libres de mettre ou non à disposition gratuite du public les données dont ils disposent, et de choisir les licences sous lesquelles ils diffusent leurs données : autoriser la réutilisation commerciale ou non, faire figurer le crédit du photographe ou seulement de l’institution, etc.
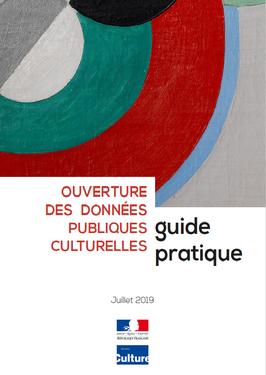
Le guide pratique pour l’ouverture des données culturelles
publié par le service de l’innovation numérique du Ministère de la Culture
2. A quoi ça sert ?
Avant toute chose, il s’agit de la transparence des administrations dépendantes de l’État. L’ouverture des données, avant d’être un moyen de diffusion des données culturelles pour valoriser des collections de musée, sert à asseoir la confiance entre les citoyens et l’État : tout citoyen a le droit fondamental d’accéder aux données produites dans l’exercice de leurs fonctions par les collectivités territoriales et par l’État. Dans les institutions culturelles, il s’agit principalement de rendre le patrimoine commun accessible à tous, en tant que service public.
De nombreux autres enjeux s’ajoutent évidemment à cette approche principale. Dans le milieu des musées, il y a bien entendu des enjeux économiques : les musées conservant des œuvres très célèbres savent que même si les données sont payantes, il y aura un public qui acceptera de payer le prix fixé par l’institution. À l’inverse, pour des musées de moindre envergure et qui ne bénéficient pas d’une grande renommée, facturer des visuels risque d’être une barrière à l’accessibilité de leurs collections. Tout est question d’équilibre, et c’est aujourd’hui une question qui se résout au cas par cas dans chaque institution. Mais quel que soit le musée, l’un des enjeux est tout simplement de diffuser des données fiables, vérifiées et sourcées sur les objets conservés. Par exemple, quand les musées de beaux-arts mettent en ligne des numérisations haute définition des œuvres, cela évite que le public accède à des reproductions faussées, notamment au niveau de la colorimétrie (il s’agit d’éviter le fameux « syndrome de la laitière jaune », du nom d’une œuvre de Vermeer dont circulent sur internet des images aux couleurs criardes).
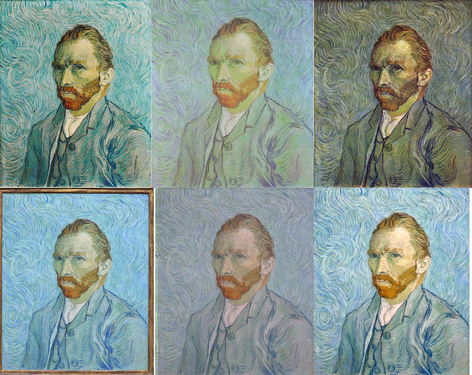
Quand l’institution ne met pas en ligne de reproduction, à quelle image se fier ?
regroupement par Sarah Stierch pour https://yellowmilkmaidsyndrome.tumblr.com/
Le propre de l’open data est d’être réutilisable par les publics : qu’il s’agisse d’une classe de primaire qui fait de l’éducation artistique et culturelle, d’une étudiante en histoire de l’art qui utilise les données pour ses recherches ou bien d’un habitant qui souhaite se renseigner sur le patrimoine local, tous bénéficient de l’accessibilité des données du patrimoine. Les données ouvertes sont librement réutilisables : l’open data favorise aussi l’innovation et ne décide pas des usages qui pourront être faits des jeux de données mis en ligne.
3. Quelle différence entre open data, open content et openglam ?
On entend plusieurs termes différents : il faut différencier open data (données ouvertes) et open content (contenus ouverts), qui ne recouvrent pas exactement la même chose. Les données, ce sont par exemple les informations d’inventaire qui accompagnent les objets de musée : date de création, date d’entrée dans l’institution, auteur, prêts dans telle ou telle institution... Et le contenu, c’est surtout la numérisation de l’objet : haute ou basse définition, 2D ou 3D pour les objets en volume, téléchargeable ou non. La plateforme Google arts and culture met par exemple à disposition du public des visuels en très haute définition des œuvres, mais ne permet pas toujours de les télécharger ni de les réutiliser : il s’agit donc de diffusion, mais pas d’open data ni d’open content, car l’image n’est pas réutilisable par les publics et reste protégée. À l’inverse, le site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France propose des versions numérisées de livres, affiches, estampes et photographies, avec les données qui les accompagnent, et permet à la fois la consultation en ligne et le téléchargement (sous différents formats au choix : texte, pdf ou image). C’est un très bon exemple d’open data dans une institution française importante.
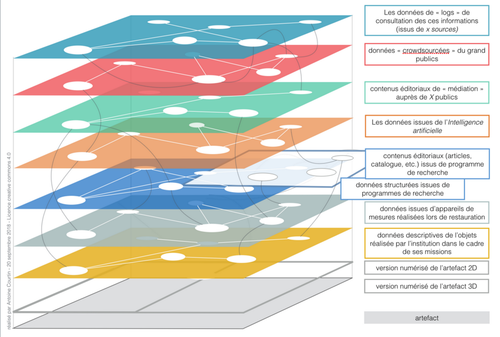
Les données des objets culturels : un mille-feuilles complexe
illustration par Antoine Courtin sous licence creative commons 4.0
L’openGLAM, c’est encore autre chose. GLAM est l’acronyme anglais de Galleries, Libraries, Archives and Museums (galeries, bibliothèques, archives et musées). Il s’agit d’un réseau d’échange et de travail pour les professionnels des milieux culturels qui défendent l’approche open data dans les institutions GLAM. L’open data culturel pose en effet des questions différentes des autres milieux : la gestion technique des images haute définition (donc des fichiers lourds), par exemple, ou encore la question des droits patrimoniaux rattachés aux images produites et diffusées.

Le logo OpenGLAM / Open Knowledge Foundation
4. Où est-ce que ça se passe ?
La base des collections des musée de France, Joconde, est hébergée sur la Plateforme ouverte du patrimoine : elle est incontournable pour l’accès aux collections des musées français quelle que soit leur typologie, et elle reverse directement les informations sur un site ministériel d’open data, « data.culture.gouv.fr ». Les musées labellisés « musée de France » sont donc invités à y déposer régulièrement leurs collections, de manière à avoir une base de données centralisée qui fasse référence.

La plateforme ouverte du patrimoine regroupe différentes bases de données culturelles françaises
5. L'open data, musée de demain ?
On entend parfois dire que le numérique cherche à remplacer les musées, mais ce n’est pas vrai : le numérique occupe une place spécifique pour chaque musée et offre des possibilités nouvelles et différentes. Se sentir menacé par la diffusion libre des données sur internet, c’est considérer que le travail fourni par les institutions se limite à présenter les œuvres et leurs cartels aux publics, mais les musées font bien plus que cela. Les musées sont des lieux de vie, de partage, d’échange, de création ; les musées sont des lieux de production et de diffusion des savoirs ; ils permettent à des communautés de se tisser, se retrouver, se pérenniser ; ils organisent un patrimoine commun qui permet de vivre ensemble, à l’échelle de la société.
Marie Huber
#opendata
#diffusion numérique
#gestiondescollections
Pour aller plus loin :
Cet article s’appuie notamment sur le travail d’Antoine Courtin
https://twitter.com/seeksanusername
Sur mon apprentissage au musée de Saint-Brieuc avec Nicolas Poulain
https://twitter.com/NicoCG70
Et sur une présentation de Camille Françoise dans le master MEM
https://twitter.com/CMFrancoise
Voir par exemple le carnet Hypothèses Numérique et recherche en histoire de l’art
https://numrha.hypotheses.org/
Et le réseau des muséogeeks http://www.muzeonum.org/wiki/doku.php?id=museogeek
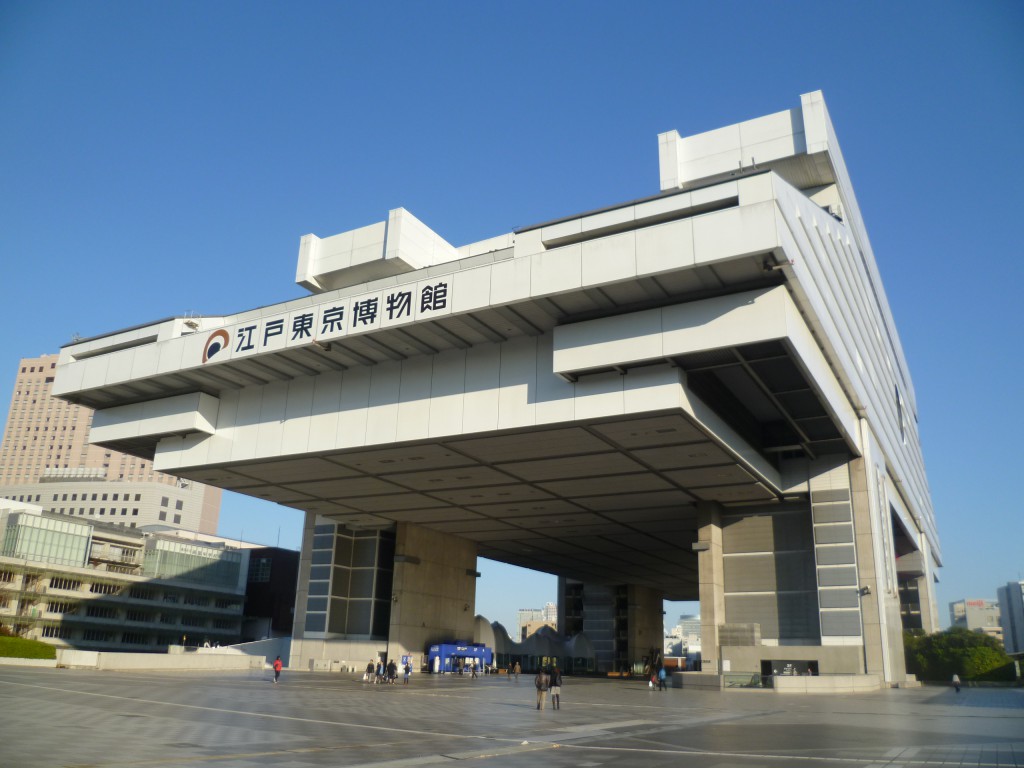
A la découverte du Musée Edo-Tokyo
Aujourd'hui, l'Art de muser s'est rendu à Tokyo et il vous propose de partir avec lui à la découverte d'un musée dédié à cette ville : le musée Edo-Tokyo ( 江戸東京博物館, Edo Tokyo Hakubutsukan).
Vue extérieure du musée. ©Sytuki
Histoire d'une ville, histoire d'un musée
Il s'agit d'un musée d'histoire situé dans le quartier de Ryogoku dans l'arrondissement de Sumida à l'est de la ville. Le sujet de son exposition permanente est la capitale du Japon depuis la période d'Edo jusqu'à l'actuelle Tokyo. L'époque d'Edo commence avec la prise de pouvoir de Tokugawa Ieyasu en 1603 après sa victoire à la bataille de Sekigahara les 20 et 21 Octobre 1600. Elle se termine avec la restauration Meiji en 1868 ; l'ère Meiji met fin à la politique volontaire d'isolement du pays et l'ouvre à la modernisation. Celle-ci se termine en 1912 avec la mort de l'empereur Mutsuhito et est suivie par l'ère Taisho marquée notamment par la Première Guerre Mondiale qui s'achève à la mort de l'empereur Taisho en 1926. L'ère Showa débute avec l'empereur Showa, plus connu en Occident comme Hirohito, et se termine à sa mort en 1989. Celle-ci est marquée par la montée du militarisme national, la Seconde Guerre Mondiale, la douloureuse défaite et la reconstruction du Japon. Commence alors l'ère d'Heisei sous le règne de l'empereur Akihito avec une longue période de paix et de modernisation pour le pays qui finit par s'imposer sur la scène internationale. Cette dernière prend fin le 1er Mai 2019 avec l'avènement de l'actuelle ère Reiwa dont le nom symbolise la « vénérable harmonie » souhaitée entre les êtres par le nouvel empereur Naruhito. Le musée d'Edo-Tokyo retrace l'évolution de la capitale depuis 1603 jusqu'à nos jours, période qui a vu l'avènement de six ères ponctuées de nombreux bouleversements sociaux, politiques et culturels.

Une vue aérienne duquartier Fukugawa Honjo après avoir été rasé par les flammes, 1945, Photographie ©Tokyo, Edo-Tokyo Museum
Son emplacement au quartier de Ryogoku ne fut pas choisi au hasard, en effet, en plus d'être un quartier populaire, il porte le nom du pont qui s'y tient depuis presque 400 ans, Ryogoku-bashi. Celui-ci enjambe le fleuve de Sumida et, d'une longueur de plus de 150 mètres, il permettait de rejoindre la province de Shimosa à l'est. Le Ryogoku-bashi fut rendu célèbre par ses nombreuses représentations au fil des siècles, certaines réalisées par de grands artistes : Kuwagata Keisai, Utagawa Hiroshige et même Hokusaï. En plus de ces éléments, le quartier de Ryogoku est le quartier des lutteurs de sumo considérés par la population comme des dieux vivants incarnés – le musée se trouve d'ailleurs à deux pas du célèbre Ryōgoku Kokugikan, stade qui accueille les tournois nationaux chaque année. Ainsi, la localisation du musée dans un quartier populaire connu de tous et très « en vue » lui permet d'assurer sa visibilité autant sur la scène culturelle que populaire. Le musée fut baptisé « Edo-Tokyo » afin de souligner l'importance de remonter le temps à la découverte des évolutions de la ville depuis plus de quatre siècles.
L'architecture, miroir du projet
Une exposition ludique au service du didactique
L'exposition permanente prend place sur deux niveaux et est divisée en deux zones : la zone Edo et la zone Tokyo. Dans la première est racontée toute l'histoire de la ville depuis l'arrivée d'Ieyasu Tokugawa à Edo en 1603 jusqu'en 1868, date à laquelle la ville a pris le nom de Tokyo. En effet, 江戸 (Edo) signifie littéralement « porte de la rivière » mais lorsque l'empereur Mutsuhito s'y installe, elle la rebaptise 東京 (Tokyo) « capitale de l'Est » afin de se distinguer de l'ancienne capitale 京都 (Kyoto) littéralement « ville capitale ». C'est un message fort puisque le Japon entre justement dans l'ère Meiji cette même année. La muséographie intègre donc cette distinction afin de permettre au public de comprendre son importance.
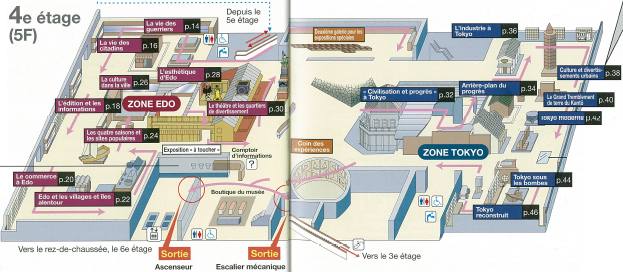
4e etage (5F), NAKANO, Yoshiro, Le Musée d'Edo-Tokyo ©Tokyo Metropolitan foundation for History and Culture, 2010, p. 4-5
Le musée propose de très nombreux dispositifs interactifs, fruits du travail des responsables du musée. C'était leur volonté d'initier le toucher et l'expérimentation chez le visiteur afin d'éviter que la visite ne soit qu'une expérience abstraite. La visite débute par la reconstitution grandeur nature du Nihonbashi littéralement « le pont du Japon ». Celui-ci « marquait le point de départ des cinq principales grandes routes qui conduisaient aux quatre coins de l'Archipel. La reproduction visible dans le musée a la même hauteur et la même envergure que l'original. Sa longueur (51 mètres à l'origine) a néanmoins été réduite de moitié » peut on lire dans le catalogue d'exposition. Ainsi, chaque année, plusieurs milliers de visiteurs l'empruntent pour partir à la découverte de la ville.

Vue sur la reconstitution grandeur nature du Nihonbashi ©Elise Mathieu

Reconstitution d'un intérieur traditionnel japonais ©Elise Mathieu
Une perspective participative forte
Cette dimension participative se traduit par différentes propositions : des reconstitutions de pièces et d'objets qui peuvent être touchés par le public. Celui-ci se voit alors proposer d'entrer dans un palanquin, de soulever des seaux lestés du même poids qu'à l'époque, de porter des paniers à légumes, de soupeser la caisse contenant des pièces d'or et même d'agiter un matoi (纏) de brigade de pompiers. En se baladant dans la partie « le commerce à Edo », il peut rencontrer la reproduction d'un étal à sushis de la fin de l'ère Edo qui lui permet de comparer les pièces de sushis exposées à celles qu'il a très probablement déjà rencontrées ultérieurement dans sa vie. Il remarque alors que le riz n'est pas blanc mais rouge, ce qui est du au vinaigre utilisé en ce temps-là. De plus, les pièces sont plus grosses qu'aujourd'hui et les poissons différents car les prises venaient uniquement de la baie de Tokyo. La zone Tokyo propose également ses reproductions avec deux types de maisons pendant l'ère Meiji : celle avec une influence occidentale et celle traditionnelle qui se font face pour une meilleure comparaison. Enfin, l'exposition comporte deux autres espaces : « l'exposition "à toucher" » et le « coin des expériences ». La première propose diverses reproductions qui, si elles sont manipulées, émettent les sons produits lors de la fabrication d'éléments artisanaux locaux. La seconde abrite une maison de l'ère Showa entièrement visitable. A condition d'enlever ses chaussures – tradition très courante au Japon afin d'éviter de salir les sols – le visiteur peut entrer dans la maison et se promener au gré des pièces. Il appréhende ainsi, sans mal, la taille, l'espace et le confort de celles-ci. La volonté du musée de créer des expériences finit par créer de la vie. Le fait de pouvoir s'amuser, parler, aller où bon lui semble en profitant des œuvres permet au visiteur de visiter ce musée comme une véritable ville.
Elise Mathieu
http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/en
#Tokyo
#Exposition
#Ludique

À qui appartiennent les objets ?

Le Trésor des Marseillais reconstitué en 3D par le MAP © MAP (UMR CNRS/MCC 3495)
Le Trésor des Marseillais et les sanctuaires panhelléniques
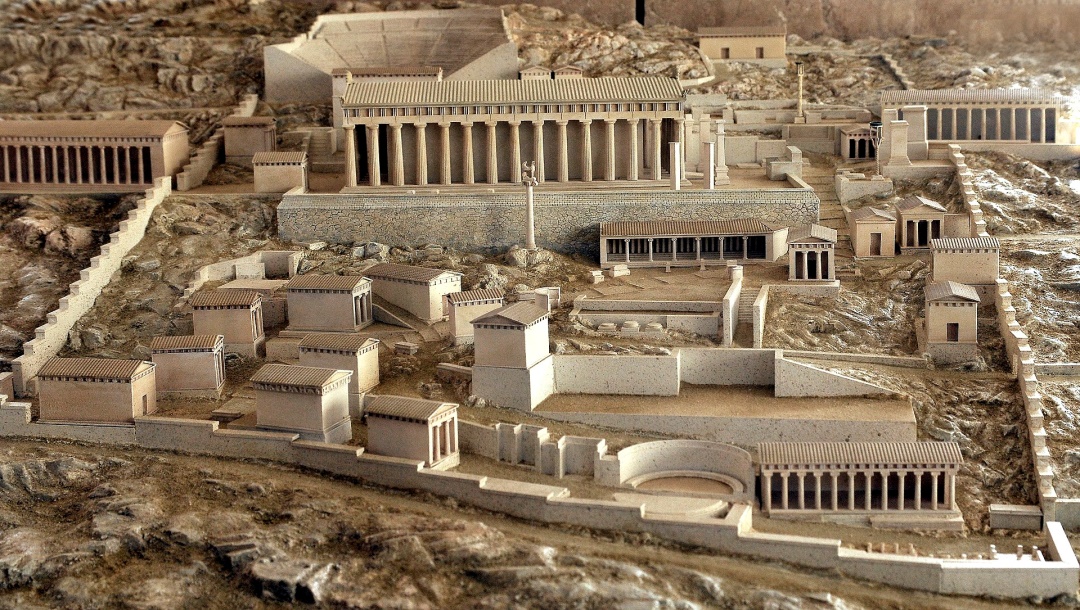
Maquette du sanctuaire d’Apollon reconstitué, exposée au Musée Archéologique de Delphes © Luis Bartolomé Marcos
Restitution, propriété et héritage culturel
Le rôle du musée et des nouvelles technologies en question
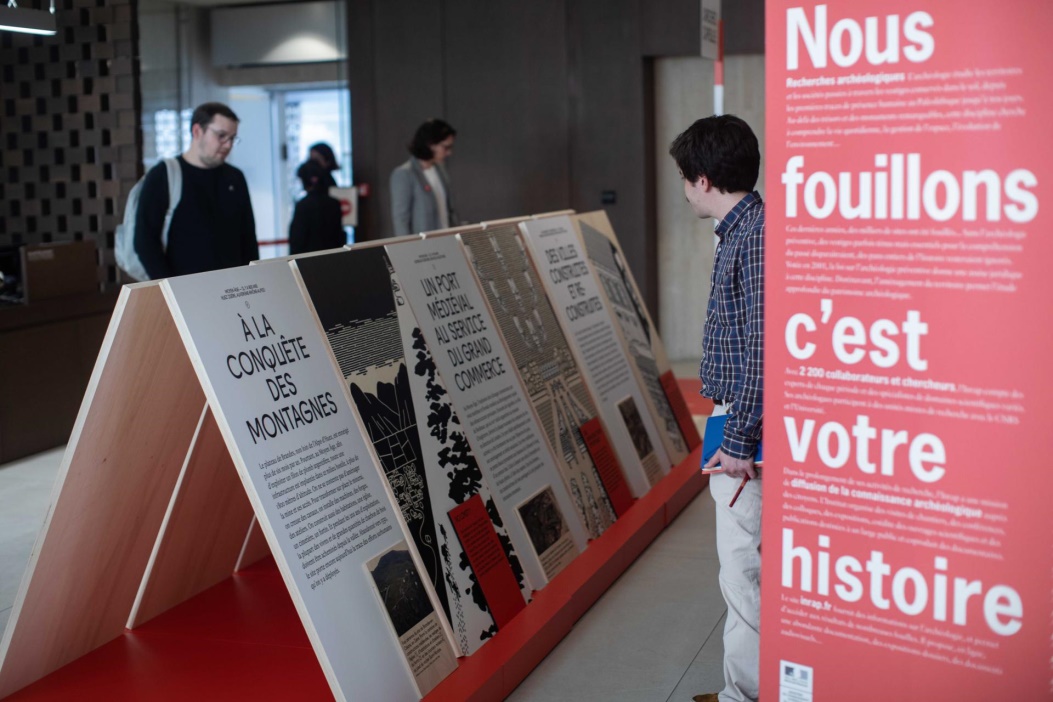
Visite de l'Archéocapsule « Archéologie de l'aménagement du territoire » au Musée de Cluny © Inrap
# Collections# Patrimoine# Héritage
Pour aller plus loin, bibliographie et sitographie thématiques…
-
Le Trésor des Marseillais et les sanctuaires panhelléniques
Colonge Victor, Le rôle des grands sanctuaires dans la vie internationale en Grèce aux Ve et IVe siècles av. J.-C, Thèse de doctorat en Histoire Ancienne, sous la direction de Nicolas Richer, Lyon, École Normale Supérieure, 2017, 900 p.
Poirier Henri-Louis et Musée d’archéologie méditerranéenne, Le trésor des Marseillais: 500 av. J.-C., l’éclat de Marseille à Delphes, Paris, Somogy, 2012, 247 p.
Centre de la Vieille Charité - Marseille, https://vieille-charite-marseille.com/archives/le-tresor-des-marseillais-500-av-j-c-l-eclat-de-marseille-a-delphes
Le Trésor des Marseillais : récit d’une expérience | Maud Mulliez, http://restauration-peinture.eu/archeologie/le-tresor-des-marseillais-experience/
-
Restitution et politique culturelle
Collège de France, Annuaire du Collège de France 2016-2017: résumé des cours et travaux : « À qui appartient la beauté ? Arts et cultures du monde dans nos musées », 117e année, 2019.
Kowalski Wojciech W., Restitution of works of art pursuant to private and public international law, Leiden, Boston, Brill, 2008, 244 p.
Prott Lyndel et O’ Keefe Patrick, « “Cultural Heritage” or “Cultural Property”? », in : International Journal of Cultural Property, no 2, vol. 1, 1992, p. 307.
Savoy Bénédicte, Sarr Felwine, Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle, 2018, 232 p.
-
Le musée et les nouvelles technologies
Martin Yves-Armel, « Innovations numériques / révolution au musée ? », in : Publications du musée des Confluences, no 1, vol. 7, 2011, pp. 117‑128.
Inrap | Archéologie et société : les Archéocapsules, https://www.inrap.fr/archeologie-et-societe-les-archeocapsules-13968 , 30 octobre 2018
Repenser le musée à l’aune de l’archéologie contemporaine, https://www.icom-musees.fr/actualites/repenser-le-musee-laune-de-larcheologie-contemporaine , 19 février 2019
(Image de couverture © Sylvie Puech.)

Agnès Varda : femme pionnière de l’émancipation féminine
Quand la réalisation cinématographique des années 1950 reste fermée aux femmes, Agnès Varda, elle, franchit ces barrières et s’impose comme modèle d’émancipation des femmes.
Agnès Varda et son histoire avec le cinéma
Devant l’entrée de la Cinémathèque française à Paris, apparaît une grande peinture murale. Une femme à la coupe au bol bicolore interpelle le visiteur. C’est Agnès Varda, cinéaste de la Nouvelle Vague, photographe et artiste contemporaine à qui est dédiée la nouvelle exposition de la Cinémathèque française Viva Varda ! du 11 octobre 2023 au 27 janvier 2024.

Peinture murale - Façade de l’entrée - Cinémathèque française ©LS
Née à Ixelles en Belgique, Agnès Varda est à la fois photographe, cinéaste et artiste. Fervente défenderesse du cinéma libre, elle devient une des cinéastes emblématiques de la Nouvelle Vague. Mêlant courts métrages et documentaires innovants, sa création se définit par un processus d’expérimentation. De 1948 à 1960, elle accompagne Jean Vilar en tant que photographe officielle du Festival d’Avignon avant de s’élancer vers l’art dès 1980. À ce titre, elle réalise une de ses œuvres maîtresses, Les Glaneurs et la Glaneuse, démontrant sa volonté de mettre en lumière des thèmes comme ceux de la pauvreté et de l’exclusion.
Appréciée pour ses œuvres cinématographiques, Agnès Varda reçoit plusieurs distinctions comme le Lion d’or, en 1985 à la Mostra de Venise avec Sans toit ni loi, la Palme d’honneuren 2015 au Festival de Cannes, l’Oscar d’honneur en 2018 par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, et bien d’autres. Elle est la seule réalisatrice à avoir reçu trois grands prix d’honneur. Agnès s’affirme comme femme cinéaste tout au long de sa carrière et s’exprime sur la place des femmes dans le milieu du cinéma. Dans la lutte pour l’émancipation des femmes dans le cinéma et dans une globalité, elle devient aujourd’hui un modèle et une pionnière dans l’Histoire du cinéma.

Portraits d’Agnès Varda - Exposition “Viva Varda !” - Cinémathèque française ©LS
Inspirations et nouveaux concepts
Viva Varda ! retrace la carrière et la vie d’Agnès Varda, en laissant le visiteur entrer dans son univers. Elle est la première exposition rétrospective de la cinéaste depuis son décès en 2019. Quelles étaient ses inspirations, ses travaux, ses engagements, ses voyages et ce qui l’a animée toute sa vie ? Vêtues de rose, les premières cimaises exposent les portraits, autoportraits, dessins - portraits d’Agnès. Comme multi-facettes, ses images et son œuvre sont imprégnées de poésie, de théâtre et de littérature, reflétant sa curiosité et son ouverture.
Agnès Varda défend le cinéma libre et le concept de cinécriture, des partis-pris exposés dans une seconde section de l’exposition. Aux côtés des scénarios manuscrits, des séquences et photographies tirées de film, d’objets de ses personnages, le visiteur est projeté dans son univers filmographique.
Pour elle, le travail de cinéaste est un jeu d’écriture, une expérimentation continue jusqu’au montage final. Elle construit des personnages féminins réflexifs, rares dans les années 1950 et se compare à Nathalie Sarraute, écrivaine franco-russe, qui écrit des portraits inconnus avant le Nouveau roman. Agnès invente, imagine des tempéraments, des situations et surtout les pensées des personnages auxquels elle donne vie. Elle accorde une grande importance à la subjectivité du personnage à travers ce qu’il perçoit, et fait de chacun d’eux des personnages à part entière, caractéristique de son cinéma. Dans la forme, elle ajoute des structures narratives par des ellipses et des chapitres. Elle renouvelle ainsi le récit et tient à y intégrer une sensibilité féministe.

Projection, extrait de Sans toit ni loi - Exposition “Viva Varda !” - Cinémathèque française ©LS
Une femme ouverte sur le monde et ses enjeux
Deux salles, l’une aux murs rouges et l’autre oranges, à l’image de sa filmographie et de ses voyages, dépeignent une autre vie d’Agnès. Celle d’une femme engagée et soucieuse des enjeux sociaux, politiques, civiques et internationaux.

Couloir de l’exposition - Exposition “Viva Varda !” - Cinémathèque française ©LS
Curieuse du monde qui l’entoure, elle porte attention à la marginalité et la pauvreté et aux mouvements sociaux auxquels elle assiste : la révolution cubaine, la jeune génération en lutte contre la guerre du Vietnam à Los Angeles, ou les mouvements pour les droits civiques américains avec les Black Panthers. Sa grande alliée est sa caméra portable qu’elle emporte durant ses voyages. Chaque rencontre, parole ou mouvement devient une image ou une séquence forte retrouvée dans la filmographie d’Agnès.
Visages, Villages réalisé en 2017 est aussi le reflet de cette ouverture. À l’issue d’une rencontre artistique avec JR, elle entame un long périple sur les routes de France dans le camion photographique de l’artiste. Tous les deux sont curieux, aiment les gens et la photographie. Dans ce film documentaire, les deux artistes échangent avec les habitants des villages, écoutent leur histoire et tirent leur portrait qui devient une peinture du paysage rural. Visages et Villages devient une œuvre double, à la fois photographique et cinématographique.
Agnès Varda : modèle de l’émancipation féminine
“J’essayais de vivre un féminisme joyeux, mais en fait j’étais très en colère. Les viols, les femmes battues, les femmes excisées. Les femmes avortées dans des conditions épouvantables. Des jeunes filles qui allaient se faire un curetage à l’hôpital et des jeunes internes qui leur disaient : pas d'anesthésie, ça vous apprendra.” Les plages d’Agnès, 2008
“Je ne sais pas à quel moment j’ai pris conscience que ce n’était pas seulement la question d’être libre mais que le combat des femmes serait collectif ou ne serait pas. Parmi les revendications, la plus urgente était le droit d’avoir des enfants ou pas” Les plages d’Agnès, 2008

Autoportrait d’Agnès Varda - Exposition “Viva Varda !” - Cinémathèque française ©LS
En 1977, Agnès Varda réalise L’une chante, l’autre pas qui illustre le combat des femmes et son évolution, pour leurs droits et leur émancipation. Le droit à l’avortement et son instauration tient une grande importance dans ce film.
Souvent interrogée au sujet de son engagement féministe, Agnès Varda fait partie des femmes ayant une notoriété qui osent s’affirmer. À la télévision, elle défend que le cinéma des femmes existe violemment et que s’il découle d'un regard et de la sensibilité d’une femme, il ne doit pas être déterminé autrement que par du cinéma. Ainsi, si le cinéma “des femmes” est perçu socialement, selon la cinéaste, il éveille une délimitation entre celui des hommes et celui des femmes.
Agnès Varda s’implique politiquement dans la revendication des inégalités hommes-femmes et de la prédominance des hommes dans le monde du cinéma. Elle intègre le Collectif 50/50 crée en 2018 dont le but est de promouvoir l’égalité homme-femme et la diversité sexuelle et de genre dans le cinéma et l’audiovisuel.
Léa Sauvage
Pour en savoir plus :
- https://www.cinematheque.fr/exposition.html
- https://www.cinematheque.fr/cycle/viva-varda-1134.html
- https://www.arte.tv/fr/videos/RC-024172/le-cinema-d-agnes-varda/
#Féminisme #Exposition #Cinéma
Antarctica, Une Odyssée en Terre Adélie
Antarctica, c’est avant tout une exposition d’images, celles de la mission du même nom. L’association Wildtouch a recruté 11 hommes, dont Luc Jacquet (réalisateur de La marche de l’empereur et instigateur de l’expédition), Laurent Ballesta, Vincent Munier et Jérôme Bouvier tous artistes-scientifiques, qui durant 45 jours sont partis sur la base de Dumont d'Urville en Antarctique avec pour objectif de récupérer des images de la faune et flore locale à travers leurs appareils.
© Laurent Bellesta
Une exposition imagée
Cette mission quis’est déroulée d’octobre à décembre 2015 était à la fois scientifique et artistique. Malgré les températures polaires, et les conditions ardues qu’impose le climat au matériel et aux hommes, ils ont réussi à faire ressortir tout un écosystème méconnu. Grâce à un équipement de plongée très performant (et très lourd, environ 90kg pour la plongée), et des appareils de capture d’images très modernes, les reporters ont eu la possibilité de filmer et photographier des espèces habituellement inatteignables.
Cette documentation sur les modes de vie des êtres sous-marins d’Antarctique est exceptionnelle. Antarctica nous fait découvrir des animaux et des plantes aux allures martiennes, si particulières que l’on peut douter parfois de leur existence. Il y a peu de textes dans cette exposition, et ceux-ci sont toujours présentés de manière très visuelle. Les informations sont écrites en couleurs, dans différentes formes, tailles, calligraphies, comme sur un tableau d’école. Cela permet d’attirer l’œil mais est parfois un peu gênant pour la compréhension. Tout est écrit au même endroit, nuisant parfois à la distinction entre les différentes données. De plus, les renseignements sont déséquilibrés : nombreuses sur les espèces terrestres puisque celles-ci sont observables depuis de nombreuses années et beaucoup moins sur les sous-marines simplement citées.
C’est par le vestiaire que commence cette fabuleuse exploration. La première pièce de l’exposition est une réplique « exacte » du lieu où se préparent les plongeurs avant de faire le grand saut. Ainsi le visiteur se glisse directement dans leur peau. Au premier regard il perçoit le poids des combinaisons et du matériel, il entend le grondement du vent au dehors, ressent même le froid qui entre par la porte fermée de la cabine. Les conditions sont optimales pour débuter l’immersion. S’ensuit dans les salles suivantes un ensemble de photos et de vidéos toutes plus magnifiques les unes que les autres.
L’essentiel est visuel, des schémas très parlants montrent par exemple les différents courants traversant les océans qui l’entourent. Mais le visiteur reste passif, il reçoit les images, ressent l’expérience mais ne la vit pas. Les vidéos sont magnifiques, les images en haute définition sont impressionnantes, le dispositif des diffusions est intéressant, aucun écran n’est posé de la même façon. Il y a toujours une scénographie autour des vidéos, faisant qu’Antarctica n’est pas une exposition de films monotones où l’on passerait d’une salle de cinéma à l’autre.
L’homme et l’animal
Ces artistes-scientifiques ne se sont pas intéressés qu’aux espèces sous-marines, les différentes espèces d’oiseaux de l’Antarctique sont évoquées pour le ciel et les manchots et phoques sont omniprésents dans chaque pièce. Ces derniers n’avaient pas peur des caméras et été très curieux. Cette proximité donne des images magnifiques où l’homme et l’animal se confrontent. L’attachement, l’affection que portent ces chercheurs à l’objet de leur travail est flagrante. Il y a un regard presque amoureux de la caméra, qui donne envie de s’attacher à ces animaux pourtant à des kilomètres de nous.
© Vincent Munier
Ce rapport Homme/Animal se retrouve aussi dans toutes les explications. Les animaux dans leurs performances de plongées par exemple sont comparés aux humains. Les textes humanisent beaucoup les créatures, renforçant l’affection par identification. Dans les images de la mère phoque qui apprend à nager à son enfant, c’est réellement une mère et un enfant qui sont observés et non des phoques.
Les enjeux climatiques
Bien que les enjeux climatiques soient le but premier de cette exposition et de cette expédition, ils ne sont pas beaucoup posés tel quels. Au détour des quelques informations, on apprend que le réchauffement climatique perturbe les courants qui menacent ainsi la biodiversité de ce continent, que la fonte des glaces, sa fragilité grandissante, menace certaines espèces. Mais le problème n’est pas forcément visible dans les images qui sont le principal contenu de l’exposition. Il y a plus une envie de faire apprécier le voyage dans ces terres, de faire découvrir et aimer cette biodiversité pour avoir envie de la protéger. Ici pas de ton moralisateur, accusateur, seulement une envie de partager l’amour de l’Antarctique, et c’est un pari réussi, notamment avec la dernière salle, sans contenu scientifique mais avec un dispositif qui en met pleins les yeux.
Photo de l’exposition sur le toit des galeries Lafayette. © O.DS
Et après ?
L’exposition qui devait être présente jusqu’au 31 décembre 2016, est prolongée à la date du 16 avril 2017. En outre, des traces de l’expédition Antarctica seront visibles dans toute la France : les galeries Lafayette diffusent des photos de l’expédition depuis le 8 novembre sur la terrasse des galeries à Paris ; de plus l’équipe présentera son projet au festival de photos de Montier-en-Der le 17 novembre, enfin sont en préparation des documentaires en collaboration avec Arte.
Océane De Souza
#Luc Jacquet
#Antarctique
#Immersion
Pour en savoir plus:
Musée des confluencesExposition AntarcticaWild touch
Antarctica du 26 avril 2016 au 16 avril 2017
Musée des confluences. 69000 Lyon
Tarifs d’entrée : prix d’une visite au musée (Plein tarif :9€ ; Tarif réduit : 6€ ; Tarif pour tous à partir de 17h00 : 6€ ; Tarif 18 – 25ans : 5€)
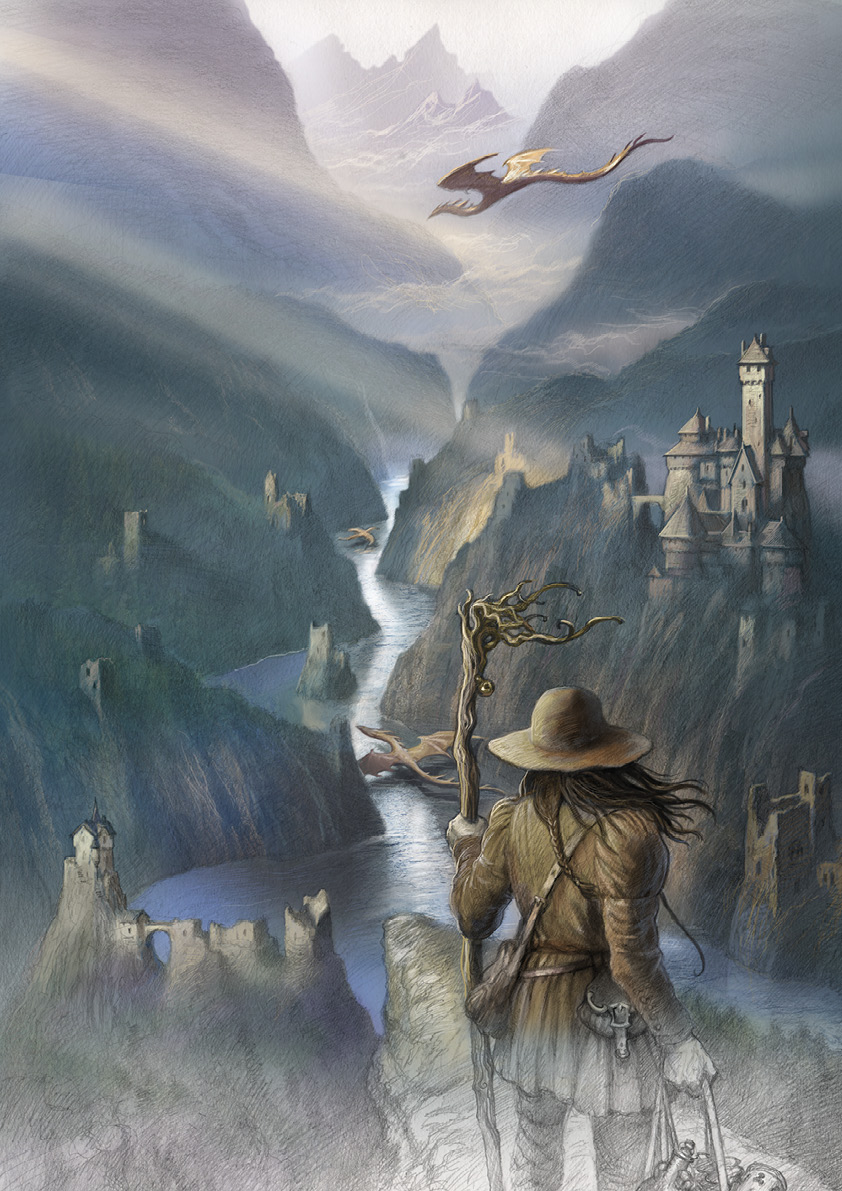
Archi-Fantastic : interpréter le patrimoine alsacien avec John Howe
L’Alsace est une région forte en patrimoine castral et religieux par le nombre conséquent de châteaux forts et édifices ecclésiastiques recensés. Cette richesse architecturale, mais aussi les paysages poétiques et légendaires de la vallée rhénane ou du massif vosgien et son grès rose, inspirent les artistes de fantasy, à l’instar de l’illustrateur John Howe.
C’est sur l’interprétation du patrimoine alsacien dans les œuvres de ce célèbre artiste d'héroïc fantasy, que repose l’exposition estivale Archi-fantastic actuellement présentée au CIAP de Guebwiller, au sein du Château de La Neuenbourg.
Pourquoi le territoire alsacien ?
John Howe, illustrateur de l’univers de J.R.R Tolkien et directeur artistique pour Peter Jackson, est né à Vancouver au Canada, et rejoint la France et plus particulièrement l’Alsace lors de son intégration à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Il découvre alors l’architecture gothique et notamment la cathédrale de Strasbourg, l’architecture castrale et le château du Haut-Koenigsbourg, les paysages vallonnés et ses vignes, ainsi que le Rhin et les mythes qui y sont associés.

Le château du Haut-Koenigsbourg © Tiffany Corrieri
Marqué par la diversité culturelle et patrimoniale de l’Alsace, l’artiste y retrouve une vision imaginaire, notamment au travers de l’architecture médiévale, qui joue un rôle prépondérant dans l’univers de John Howe, et des légendes rhénanes qu’il retranscrit dans ses œuvres. C’est pourquoi, cette exposition, composée d’une cinquantaine d'œuvres originales, mêle des créations inspirées de la Terre du Milieu mais également des dessins plus méconnus inspirés du territoire alsacien.
Réinterpréter le patrimoine et l’appliquer dans la fantasy
Afin de valoriser le patrimoine de la région, l’exposition met en avant l’interprétation de lieux emblématiques par John Howe qui reprend essentiellement des éléments architecturaux de monuments caractéristiques, telle que la cathédrale de Strasbourg qui a fortement marqué le jeune artiste lors de sa vie étudiante strasbourgeoise. Au point qu’il lui consacre un ouvrage intitulé Cathédrale dans lequel il réinterprète les diverses ornementations et motifs gothiques selon sa propre idée architecturale. Ainsi gargouilles, statues, balustrades et corniches composent un univers plein de créatures et de figures fantastiques.
Le Haut-Koenigsbourg, château-fort restauré par Bodo Ebhardt au début du XXe siècle, l’impressionne aussi. La particularité de ce château, dont la restauration s’appuie sur des études historiques et architecturales qui l'inscrit dans une dimension fantasmée de l’époque médiévale et dans la continuité de l’idée du travail de Viollet-le-Duc, est de plonger le visiteur dans l’atmosphère d’un Moyen-Âge mythique. Cette architecture médiévale correspond pleinement à des représentations symboliques et imaginaires caractéristiques de l’univers de la fantasy. C’est pourquoi ce château alsacien est présent dans de nombreuses œuvres en lien avec celles portant sur La Terre du Milieu à l’instar de Watchful peace.
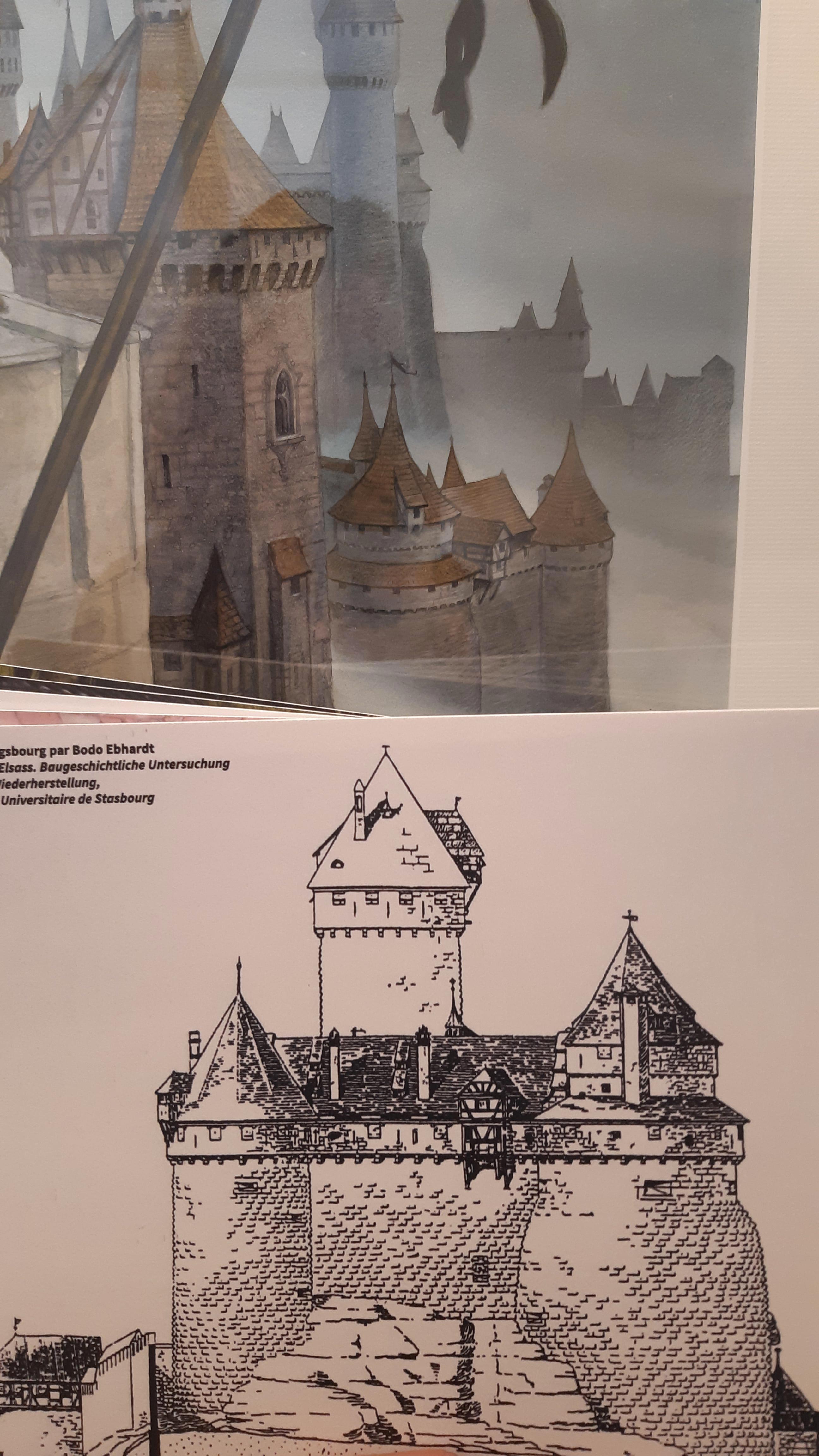
L’inspiration du bastion du Château du Haut-Koenigsbourg pour la réalisation d’une partie du château du tableau Watchful Peace © Tiffany Corrieri
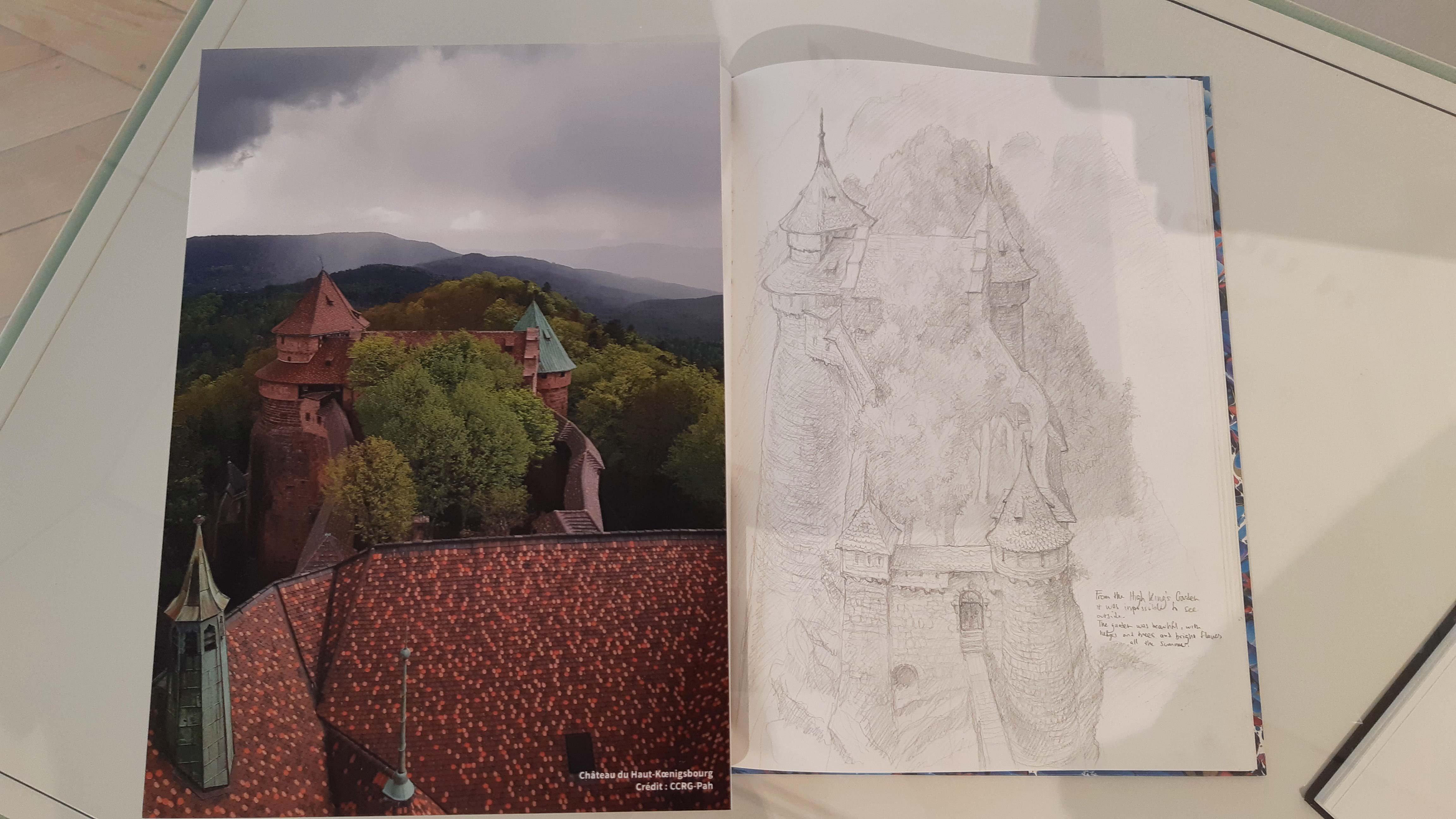
Croquis de John Howe réalisé au Château du Haut-Koenigsbourg © Tiffany Corrieri
Enfin les contes et légendes d’Alsace reflètent la féérie de la fantasy par la présence de personnages fantastiques telle la nymphe Lorelei, arpentant les bords du Rhin à la recherche de bateaux à faire couler à travers ses chants. Le tableau The Nixes peut faire référence à cette légende.
Interpréter par la médiation
Pour mettre en avant cette réinterprétation du patrimoine alsacien dans les œuvres de John Howe, des clés d’interprétations sont données aux visiteurs par le biais de médiations. Ainsi le visiteur peut comparer visuellement les éléments architecturaux des bâtiments dont l’artiste s’est inspiré, grâce à des panneaux mobiles montrant des parties des édifices en question, qui ont été repris dans les dessins de l’illustrateur.
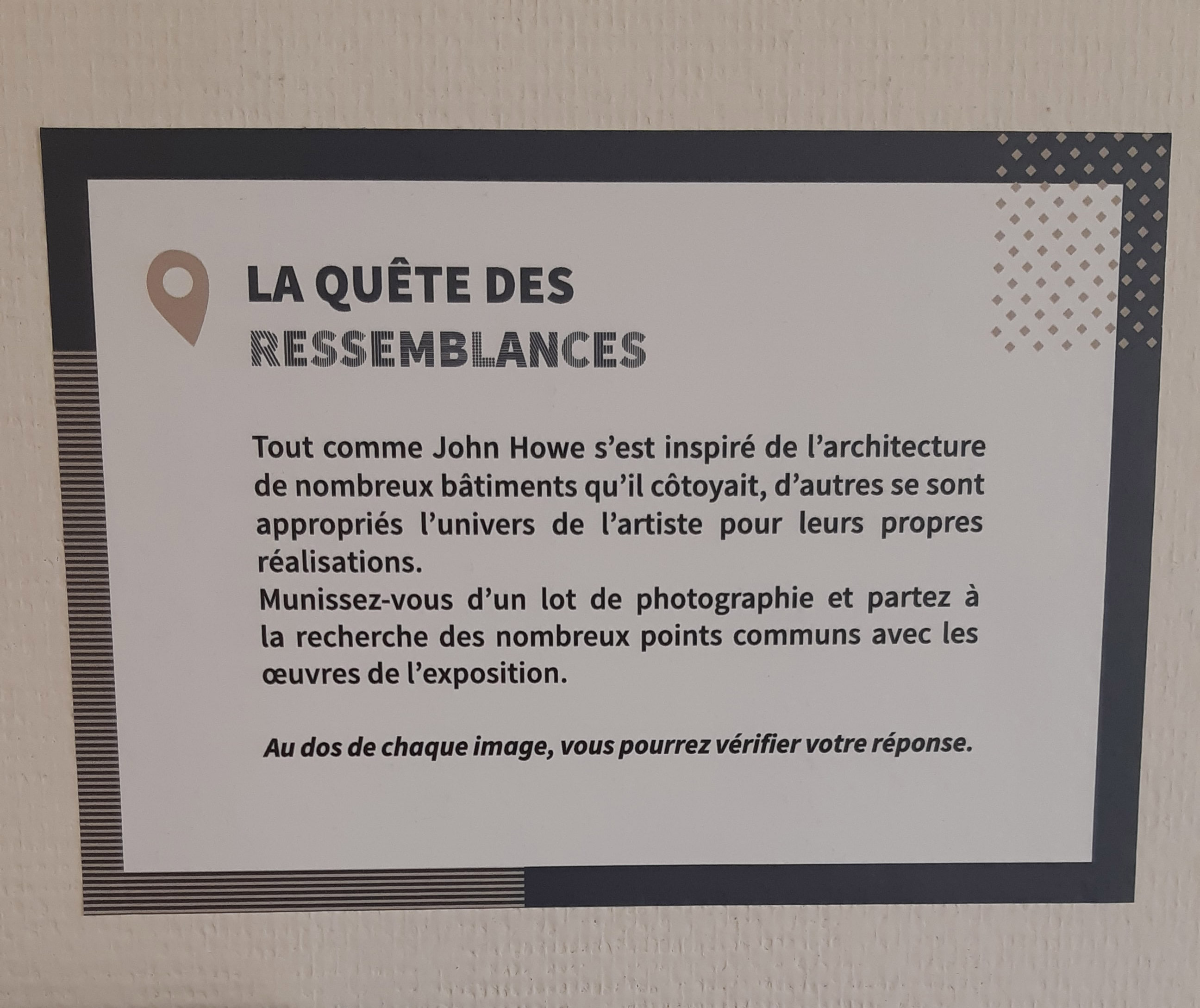

Les panneaux mobiles pour comparer les éléments architecturaux avec les tableaux © Tiffany Corrieri
De plus, une visite guidée, qui apporte d’autres visuels de comparaison, est proposée et permet de mettre en valeur les différentes interprétations que le visiteur peut retrouver au sein des illustrations de John Howe.
Cette visite et ces médiations semblent nécessaires pour comprendre la démarche de réinterprétation de l’artiste du patrimoine alsacien dans ses œuvres. En effet l'interprétation des édifices sous le prisme de la fantasy, qui s’appuie sur la recomposition et l’appropriation des bâtiments afin de les identifier à la vision de l’artiste, peut échapper au visiteur. Comme cela, l’accompagner dans la découverte des œuvres permet de lui faire découvrir des détails et correspondances qu’il n'aurait pas la spontanéité de trouver lui-même, particulièrement s'il n’est pas familier du patrimoine de la région.
Réenchanter le patrimoine castral
Cette exposition s’inscrit dans l’évènement Les Portes du Tempsqui dépasse la limite géographique du Château de la Neuenbourg puisqu’il est question de revaloriser le patrimoine castral de la vallée rhénane. Réalisé par John Howe et impulsé par la Collectivité Européenne d’Alsace, Les Portes du Temps repose sur une médiation numérique à destination des châteaux de la région.
Cette dernière s’appuie sur une application mobile qui présente une quête amorcée par une web-série, dans laquelle un alchimiste nous invite à retrouver des cristaux à travers les différents châteaux grâce à des questions, afin de débloquer des créatures magiques. Une programmation culturelle autour de ces monuments est également proposée. L’implication de l’artiste dans cet évènement et l’attachement de ce dernier à la région, se reflètent dans la réalisation d'œuvres s’inscrivant spécialement dans Les Portes du Temps, que l’on peut retrouver dans l’exposition Archi-Fantastic.
Ces médiations, qui nous apportent de nombreuses informations, ont pour but de faire gagner ce patrimoine représentatif de la région, peu connu ou reconnu par les Alsacien.ne.s, en visibilité, et de mettre en lumière ceux et celles qui protègent et rendent ces lieux vivants, tels que des veilleurs de forteresses ou des associations.
Vous pouvez retrouver le Château de la Neuenbourg sur Facebook.
Exposition ouverte jusqu’au 31 août 2021.
Tiffany Corrieri
Pour en savoir plus :
- Le site internet Les Portes du Temps
- La web-série
- Le portfolio de John Howe
#fantasy #patrimoine #interprétation

Au diable l'avarice, le PASS de Mons passe l'argent au grill
Oh l'ardu et l'ardent sujet que le Pass aborde depuis quelques années à Mons en Belgique : l'argent ! La visite d'une exposition sur ce thème était aguichant puisque partout ce thème est évoqué sans que l'on sache bien de quoi il en retourne, surtout dans les temps virevoltants que nous vivons qui ressemblent à s'y méprendre à une partie de monopoly échelle monde…
Premier constat : il faut disposer de temps devant soi pour pouvoir l'explorer car les quatre espaces qui lui sont consacrés sont bien remplis. Ce qui est tout un drame puisqu'elle se situe au milieu de neuf autres expositions toutes aussi abouties, et que l'on se retrouve bien vite dans un dilemme cornélien, l’œil rivé sur la montre pour tenter un calcul savant du temps à consacrer à chaque chose. Le site internet du lieu a bien raison d'annoncer que le mieux est de consacrer une journée entière pour sa visite. L'exposition à elle seule occupe vite pour plusieurs heures entre la dizaine de jeux, les expôts, les explications et les manipulations.
Il s’agit ici vraiment d'une exposition de contenu. Les grands adorateurs des expositions où l'objet est roi y trouveront peu leur compte.Après un large mur expliquant le contexte et les multiples jeux interactifs présents sur le parcours, la première partie explore ce qui définit l'argent, avec quatre sous-parties ayant pour titres « LIEN », « RESEAUX », « ECHANGES » et « PUISSANCE ». La deuxième salle sert de transition autour de ce qui se passe quand il n'y en a plus, ou presque, en montrant des témoignages de personnes en Argentine après le crash boursier au début des années 2000.
Des photos et des citations dépeignent un quotidien difficile, mais aussi beaucoup plus solidaire, sous une cascades de casseroles évoquant les manifestations où cet outil de cuisine faisait office de tambour de protestation. Le troisième espace explore les notions de richesse et de pauvreté, de la valeur accordée aux choses en faisant par exemple relier des parties du corps à un montant d'assurance, des métiers à des salaires, ou des tableaux avec leur côte en bourse. Enfin, le quatrième est une petite pièce noire dont les écrans se reflètent dans de multiples miroirs diffusant des extraits de films autour de « la passion de l'argent », coupé de leur bande sonore, où les expressions des personnages n'en paraissent alors que plus démesurées.
Ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'objets, mais ils se trouvent totalement au service du sens. Une vitrine, dans la première partie, montre les multiples formes que peut revêtir la monnaie : des plumes, du sel, des coquillages, des fourrures, des graines de cacao, jusqu'aux cigarettes américaines à la fin de la seconde guerre mondiale. Elle permet d'illustrer la matérialisation d'un besoin pour les échanges de nombreuses sociétés. Plus loin, on peut voir une trentaine de billets, sur lesquels on peut faire passer une loupe, illustrant ainsi la mainmise des personnes au pouvoir sur la monnaie pour écrire l'histoire de leur nation. Il y a aussi une sorte de grand rouleau actionnable où se trouvent des reproductions d’œuvres artistiques ayant joué autour de billets de banque, mimant une machine de fabrique de billets.
Un ton décalé se retrouve ainsi dans l'ensemble du parcours, abordant de manière ludique un sujet pouvant vite devenir anxiogène.
Ainsi, dans la première salle, lorsque l'on s'approche des poteaux sur lesquels sont imprimés de petites images se font entendre des extraits de chansons, comme Brel chantant « faut pas jouer les riches quand on a pas le sou », ou d'interviews « mon ami à Canyonlake, il a tout ». Cela fonctionne pour l'effet d'immersion mais on peut regretter le manque de contexte à ces paroles et ses images, qui peuvent vite devenir des bruits ne faisant éclaircir ni le sujet, ni le rapport à l'information. De même, on peut féliciter certains jeux électroniques au contenu très plaisant mais leur finalité peut vite être trouble.
Par exemple, celui où l'on doit conduire une voiture sur écran nous obligeant à choisir des publicités qui nous amènent à des dettes colossales à la fin du parcours. Un autre exemple encore plus frappant se situe dans la pièce évoquant le crash boursier de l'Argentine. Le jeu nous dit qu'il faut que l'on réussisse à tenir au moins trois jours dans un pays effondré, nous amenant à choisir, avec le maigre pécule dont nous disposons, entre acheter à manger ou acheter un médicament pour notre père malade. Voilà un jeu dont l'étude des réactions serait un trésor de sociologie, en attendant, un goût un peu amer peut venir à la bouche du visiteur-participant.
Un bémol sérieux est à souligner du côté du fonctionnement des installations : un tiers d'entre elles n'étaient pas en état de marche. Quel dommage, surtout que nombreux sont ceux en fonctionnement qui sont vraiment agréables à découvrir. On sent l'énorme travail de recherche en amont, lié à une volonté de médiation constante du propos. L'exposition en devient ainsi un brin bancale, si bien que l'on souhaiterait beaucoup que l'établissement retrouve vite des subventions à hauteur des propos qu'il propose.
Jody Herrero-Beconnier

Azzedine Alaïa, un collectionneur frénétique
Quand un couturier passionné par l’histoire de la mode accumule des pièces, l’exposition devient une rétrospective de la mode du siècle dernier !
Azzedine Alaïa, icône de la mode
C’est au Palais Galliera qu’est présentée jusqu’au 21 janvier 2024 une des plus grandes collections de pièces de mode établie par le couturier Azzedine Alaïa (1935-2017).
Née à Tunis en 1935, Azzedine Alaïa était un sculpteur du tissu. Dès les années 1980, il conquit la mode parisienne par ses habiles techniques acquises en créant pour ses clientes et par l’admiration portée pour ses prédécesseurs. Adulé de tous, ses pièces étaient significatives par leurs coupes parfaitement identifiables. Il portait une attention particulière au tombé du vêtement sur le corps de la femme, à la manière dont il épousait subtilement ses formes.
Un amoureux du savoir-faire

Exposition "Azzedine Alaia, couturier collectionneur" au Palais Galliera à Paris, janvier 2024 © EK
L’exposition « Azzedine Alaïa, couturier collectionneur » réunit près de 140 pièces appartenant à la Fondation Azzedine Alaïa. Fort d’une collection de plus de 20 000 pièces accumulées tout au long de la vie du créateur, Azzedine Alaïa collecte à partir de 1968 à la suite de la fermeture de la maison Balenciaga. Cette accumulation du couturier permet à ce jour de concurrencer les plus grandes collections des musées français. Sa passion pour l’histoire de la mode lui permet d’acquérir des pièces prestigieuses allant du début de la haute couture, au XXè siècle, et même parfois XXIè siècle. Elsa Schiaparelli, Madame Grès, Jean Patou ou encore Jeanne Lanvin figurent dans le parcours d’exposition, parmi tant d’autres.
Cette exposition, qui a lieu 10 ans après celle de la rétrospective de sa carrière, célèbre cette fois-ci la collection personnelle du couturier : des œuvres iconiques du patrimoine de la haute couture française. Azzedine Alaïa a constitué un patrimoine de la mode, en a permis sa préservation et a ainsi participé à l’élaboration de son histoire par sa transmission.
L’importance des héritages
L’exposition permet de comprendre l’importance du passé pour créer, imaginer le futur. C’est pourquoi beaucoup des pièces exposées sont indémodables, bien que fabriquées il y a plus d’un siècle pour certaines. Elles pourraient être portées par une mannequin au cours de la prochaine Fashion Week. Après une observation minutieuse, certaines techniques de plissé, de teinture ou plus globalement des coupes se retrouvent encore aujourd’hui dans l’élaboration de pièces de haute couture. Chaque créateur s’inspire du passé et de ses techniques pour élaborer une « nouvelle » tendance.

Exposition "Azzedine Alaia, couturier collectionneur" au Palais Galliera à Paris, janvier 2024 © EK
En plus de permettre l’accès à des pièces remarquables, la collection comporte aussi des noms oubliés de la scène de la mode, comme Jacques Fath ou Adrian. Ces deux couturiers ont pourtant permis, de par leurs maisons de couture, la modernisation et la glamourisation du style féminin de la première moitié du XXè siècle.
Un parcours classique, évocateur d’un temps passé
L’exposition créée par Olivier Saillard (commissaire d’exposition) directeur du Palais Galliera, et Martin Szekely (scénographe) designer, a lieu au rez-de-chaussée du Palais Galliera. Le visiteur entre dans un lieu sombre, où les seules couleurs proviennent des quelques vêtements colorés. La pénombre ne permet pas leur mise en valeur, il faut s’en approcher pour pouvoir observer tous ses détails, son état ou encore sa matière. Cette “mise en valeur” est surtout un marqueur de protection de ces pièces, habituées à l’obscurité, et qui ne peuvent rester plus de 4 mois sous une lumière de 50 lux. L’exposition suit une chronologie qui peut paraître floue si le visiteur ne lit pas le livret proposé à l’accueil. En effet, celle-ci ne présente pas ses pièces par ordre chronologique de création des maisons, mais par ordre d’acquisition par Azzedine Alaïa. Tout commence donc par Cristóbal Balenciaga et se termine par Marie-Louise Bruyère. Entre les deux, une série de mannequins statiques façonnés au niveau des hanches, de la poitrine ou encore des épaules afin de respecter le tombé de la tenue voulue par ses créateurs, et d’atténuer les marques de vieillesse du tissu. Le visiteur passe d’une tenue à une autre, d’une estrade associée à une maison à une autre, à des panneaux illustrant la vie des créateurs et ponctuant ce déplacement libre.

Exposition "Azzedine Alaia, couturier collectionneur" au Palais Galliera à Paris, janvier 2024 © EK
Le souhait d’Azzedine Alaïa était de transmettre au plus grand nombre son patrimoine après sa mort. Cette exposition, malgré une mise en valeur scénographique bien classique et sans surprise des pièces, dédiée il semble à un public connaisseur de la mode, permet la rencontre avec des créateurs et des techniques, inconnus, oubliés ou au contraire prédominants. Elle marque les esprits en permettant de se re-situer au sein de la mode et de son empire de « tendances », d’imaginer que peut-être, demain, les grands créateurs « innoveront » en réutilisant les manières de faire du début du siècle dernier et seront soucieux d’une industrie plus durable et saine.
Elise Klein
Pour en savoir plus :
- https://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/expositions/azzedine-alaia-couturier-collectionneur
- https://www.parismusees.paris.fr/fr/exposition/azzedine-alaia
#Mode #Femme #Transmission

Balade urbaine à Croix-Rousse : suivre le fil de la soie
Le musée Gadagne nous invite à découvrir l’histoire de Lyon hors de ses murs avec des balades urbaines autour de différents quartiers. Nous vous proposons un retour d’expérience sur une visite consacrée aux innovations dans l’histoire de la soie.
Métier à tisser au sein de la Maison des Canuts. Photographie : M.L.
Le musée Gadagne
Le musée Gadagne est situé dans le Vieux Lyon, quartier historique et touristique de la ville. Pour être plus précis, il faudrait plutôt parler de l’Hôtel Gadagne, un bâtiment dont l’histoire débute au XIVe siècle et qui est loué par le banquier Thomas II de Gadagne à partir de 1538, ce qui donne son nom à cet espace. Le bâtiment est progressivement acheté par la ville de Lyon à partir du début du XXème siècle. Il abrite aujourd’hui deux musées : le musée d’Histoire de Lyon (MHL) et le musée des Arts de la Marionnette (MAM). Toutefois, ce qui nous intéresse aujourd’hui n’est pas ce qui est proposé dans ces lieux mais au contraire, ce que le musée propose en dehors de ses murs.
En effet, le musée Gadagne a mis en place un programme de balades urbaines pour découvrir l’histoire du territoire lyonnais à travers plusieurs thématiques en lien avec des quartiers en particulier : « Derrière les voûtes : redécouvrez les traces de l’histoire industrielle du quartier Confluence », « Gerland – Terreau fertile de la santé : découverte d’un territoire devenu pôle d’excellence initié par la dynastie Mérieux » ou encore « Biodiversité de la voie verte ».
« Partez sur les traces de l’industrie de la soie à Croix-Rousse »

Pentes de la Croix-Rousse. Photographie : M.L.
Profitant de l’effervescence muséal de la Nuit des Musées, j’ai assisté à une balade urbaine consacrée à la fabrication de la soie, son commerce et à son influence sur le territoire lyonnais. Cette balade prenait son départ directement dans le quartier Croix-Rousse sous la statue de Joseph Marie Jacquard, personnalité majeure pour la soie lyonnaise. La médiatrice, chercheuse en histoire, introduit l’histoire du lieu et son développement : l’arrivée des soyeux, propriétaires de maison de commerce de soie et des canuts, qui vendaient leur soie à ces soyeux, qui a développé l’urbanisation du quartier Croix-Rousse. Les quartiers liés à la production de soie ont une hauteur particulière : pour pouvoir installer les métiers à tisser, chaque étage a environ quatre mètres de hauteur sous plafond. De plus, ces immeubles ont de très hautes fenêtres, assez nombreuses pour avoir suffisamment de lumière pour tisser. Si elle était intéressante, l’introduction, de trois quarts d’heure pendant lesquels nous sommes restées statiques et debout, pourrait peut-être plus dynamique dans ce contexte de « balade ». La médiatrice nous a ensuite invitées à nous déplacer dans plusieurs endroits importants du quartier, comme l’ancienne entrée du funiculaire à « un sous » aujourd’hui transformée en métro ou devant les pentes de la Croix-Rousse où ont défilé à plusieurs reprises les canuts pour réclamer plus de droits sociaux. Les commentaires de la visite sont riches : mêlant architecture, urbanisme, histoire sociale et technique, racontant une histoire transversale et illustrée sous nos yeux par le territoire que nous parcourons.

Démonstration d’un métier à tisser à bras monté avec une mécanique Jacquard. Photographie : M.L.
La visite se conclut par un court moment au sein de la Maison des Canuts. Cet ancien siège du Syndicat des Tisseurs et Similaires a été réinvesti à partir des années soixante-dix par la COOPTISS, coopérative de tissage. Nous découvrons enfin un métier à tisser à bras, annoncé pendant la balade ; il est monté avec une mécanique Jacquard (un système de carte perforée qui permet de sélectionner les fils lors du tissage afin de faciliter la réalisation des motifs, cette sélection des fils étant auparavant réalisée à la main). L’intérêt de la Maison des Canuts est d’exposer des métiers en état de fonctionnement ; une médiatrice formée nous fait une démonstration afin de nous expliquer le fonctionnement et d’observer la minutie nécessaire des gestes, de voir danser les fils avec la navette et entendre le fameux « bistanclaque », bruits successifs du métier manipulé pour le tissage. Les tissus réalisés lors des démonstrations entrent ensuite dans les collections de la Maison.

Carte perforée indispensable pour le fonctionnement de la mécanique Jacquard. Photographie : M.L.
L’histoire en balade, une bonne idée ?
Sortir de l’espace du musée peut avoir ses inconvénients : la météo n’était pas avec nous le jour de la balade et il a fallu improviser un abri. C’est aussi un type de médiation qu’il est compliqué de rendre accessible pour toutes et tous puisqu’elle implique d’être debout pendant deux heures. Et, faute de jauge réduite, nous étions une vingtaine : il était parfois compliqué d’entendre tous les commentaires de la médiatrice.
Toutefois, ce type de proposition a de nombreux avantages. Sortir des murs, c’est peut-être l’occasion de toucher un public qui n’est pas forcément à l’aise entre les vitrines et les cartels. C’est aussi nous inviter à être dynamique, ce qui met en place d’autres types d’apprentissages, sollicitant l’ouïe et la compréhension par le corps de manière générale. C’est l’occasion de faire découvrir des savoirs en s’inscrivant directement dans le territoire, d’illustrer une histoire qui devient concrète puisque nous pouvons en observer les traces. C’est aussi permettre de découvrir un espace avec un angle spécifique ou de redécouvrir les espaces fréquentés au quotidien.
En espérant que les beaux jours vous donnent aussi envie de découvrir les musées en dehors de leurs murs, vous trouverez ci-après d’autres idées de balades urbaines muséales !
Marine Laboureau
Pour aller plus loin :
- Et pour une réflexion plus approfondie sur le musée « hors les murs », vous pouvez consulter sur le blog les articles « Lire le musée hors les murs » partie 1 (https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2041-lire-le-musee-hors-les-murs-1-2) et partie 2 (https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2041-lire-le-musee-hors-les-murs-1-2)
- Musée Gadagne : https://www.gadagne-lyon.fr/gadagne/histoire-de-gadagne
- La Maison des Canuts : https://maisondescanuts.fr/histoire/
- Balade urbaine musée Sapeurs Pompiers (Lyon) - https://museepompiers.com/balades-urbaines/
- Balade urbaine Le Rize (Villeurbanne) https://lerize.villeurbanne.fr/vie-du-rize/balades-urbaines-patrimoniales/
- Balade urbaine musée de l'histoire de l'immigration (Paris) - https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2017-10/visites-hors-les-murs
- Balade urbaine musée d’Aquitaine (Bordeaux) - https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/evenement/balade-urbaine-1
- Balade urbaine musée de la Mode de la Province d'Anvers (MoMu) - https://www.momu.be/en/activities/fashion-walk-03-06
#balade urbaine #histoire de la soie #hors les murs
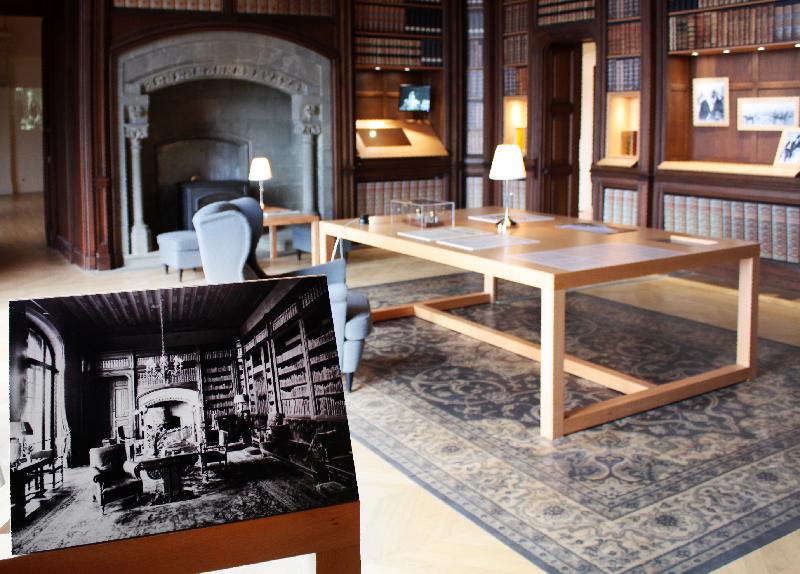
Bâtir un rêve ou comment évoquer ce qui a disparu
Le château © Cdp29
Depuis 2016, l’exposition permanente Bâtir un rêve permet de découvrir l’intérieur du château, sur les traces de James de Kerjégu. Seuls le rez-de-chaussée et le premier étage sont accessibles. La scénographie proposée par l'Atelier KLOUM évoque la grandeur du château au temps de James de Kerjégu. Ne vous attendez pas à trouver des salles richement décorées, entièrement fournies en mobiliers : la plupart ont disparu lors de la Seconde Guerre mondiale. L’évocation se fait par des objets ou du mobilier symbolique, quelques décors en citation, comme dans la bibliothèque où un tapis est reproduit et des rangées de livres factices couvrent les étagères.
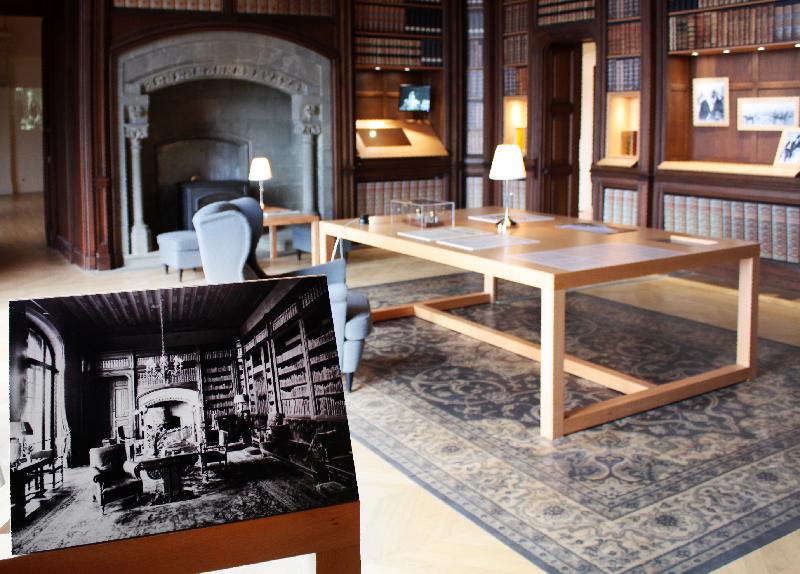
La bibliothèque © Atelier KLOUM
Il est impossible pour le visiteur de croire que ce qu’il voit est la vérité, des pupitres judicieusement placés révèlent l’intérieur de la demeure de James de Kerjégu. Ça et là, des audiovisuels nous racontent James de Kerjégu, la vie pendant la Belle Époque, la construction de Trévarez.
Dans la salle à manger, on se retrouve dans la peau d’un invité : faîtes le tour de la table, prenez place… Vous ne savez pas quels couverts utiliser ? Appuyez sur les boutons pour connaître la réponse ! Les dispositifs interactifs parsemés sur le parcours de visite illustrent les codes de l’époque, de la présence discrète des domestiques au luxe des appartements.

La salle à manger © Atelier KLOUM
A l’étage, une ouverture judicieusement placée nous dévoile les “piscines” réservées aux invités, des baignoires démesurées. Peu meublées, les salles n’en sont pas moins animées : quelques notes de musique, des extraits de films et de nombreuses conversations ponctuent le parcours.

Le grand salon © J. Lagny
Le “clou du spectacle” se situe là où on l’attend le moins : dans la pièce la plus abîmée, le grand salon. Le plafond n’existe plus, il n’y a qu’un trou béant qui permet de voir les étages supérieurs. Le sol est neuf, c’est une chape de béton. Mais, même abîmés, les murs sont de toute beauté. L’emprunt d’une tablette numérique permet de les voir reconstitués grâce à la réalité augmentée.
https://www.youtube.com/watch?v=fULTEp0ZXvE © Artefacto
Actuellement en phase de travaux, les appartements de James de Kerjégu sont en cours de reconstitution. Une partie du mobilier d’origine a été sauvegardée (lit et boiseries), mais quel sera le traitement du reste ? Comment distinguer l’authentique?

Chambre de James de Kerjégu vers 1910 © Cdp29

Vue de la chambre, Atelier d’architectes du patrimoine Le Bris – Vermeersch © Cdp29
Le concept scénographique de citation choisi par l’Atelier KLOUM rend tout à fait justice au lieu. Grâce à l’évocation par la reproduction factice (tapis, livres) ou par le mobilier contemporain empruntant à l’esthétique de celui du XIXème siècle, la scénographie ne tombe pas dans le piège de la reconstitution qu’on pourrait attendre d’un tel lieu. Les pièces dénudées laissent le visiteur imaginer la splendeur passée du lieu, grâce aux vestiges et au discret mobilier. Bâtir un rêve transmet si bien l’ambiance du château de Trévarez au début du XXème siècle, de manière efficace mais sans manquer de poésie.
J. Lagny
#domainedetrévarez
#epcccheminsdupatrimoineenfinistère
#patrimoine
#belleépoque
Pour en savoir plus :
EPCC Chemins du patrimoine en Finistère - Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
02 98 26 82 79
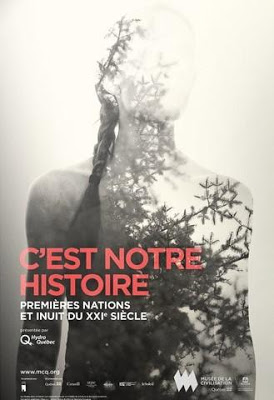
C'est notre histoire !
C’est notre histoire, Premières Nations et Inuit du XXIe siècle, ce titre de l’exposition permanente du Musée de la civilisation de Québec sur les Autochtones du Québec est lourd de sens. Il porte haut et fort que l’histoire des Premières Nations et des Inuit est celle, certes des Autochtones du Québec, mais aussi de tous les Québécois. L’exposition raconte l’histoire des peuples autochtones du Québec, plus de 12 000 ans, elle aborde l’histoire coloniale française et anglaise. Elle explique comment l’histoire partagée entre Européens et Autochtones a transformé les modes de vies et les cultures traditionnelles. Elle montre également comment ces peuples vivent aujourd’hui, les traditions qu’ils ont su sauvegarder et développer. Enfin, elle présente les enjeux sociaux et politiques liés à la décolonisation. L’exposition repose avant tout sur la parole de différents Autochtones, des téléphones rouges disséminés dans la salle permettent de faire entendre leurs voix sur les différents événements. Des vidéos d’interview accompagnent le visiteur et des œuvres d’art contemporain transmettent autrement leurs récits. La force de cette exposition repose sur le fait qu’elle a été créée en collaboration avec les principaux concernés. Une grande importance a été accordée à la parole des nombreux participants autochtones au processus de création.
Affiche de l’exposition C’est notre histoire © Musée de la civilisation
C'est notre histoire et le Temps des Québécois
Le Temps des Québécois, l’autre exposition de référence du musée, qui vient de se refaire une petite beauté, parle du Québec depuis les premières nations jusqu’aux enjeux de notre monde contemporain. Elle s’appuie essentiellement sur une muséographie d’objets mettant en valeur les artefacts faisant du sens pour les Québécois.
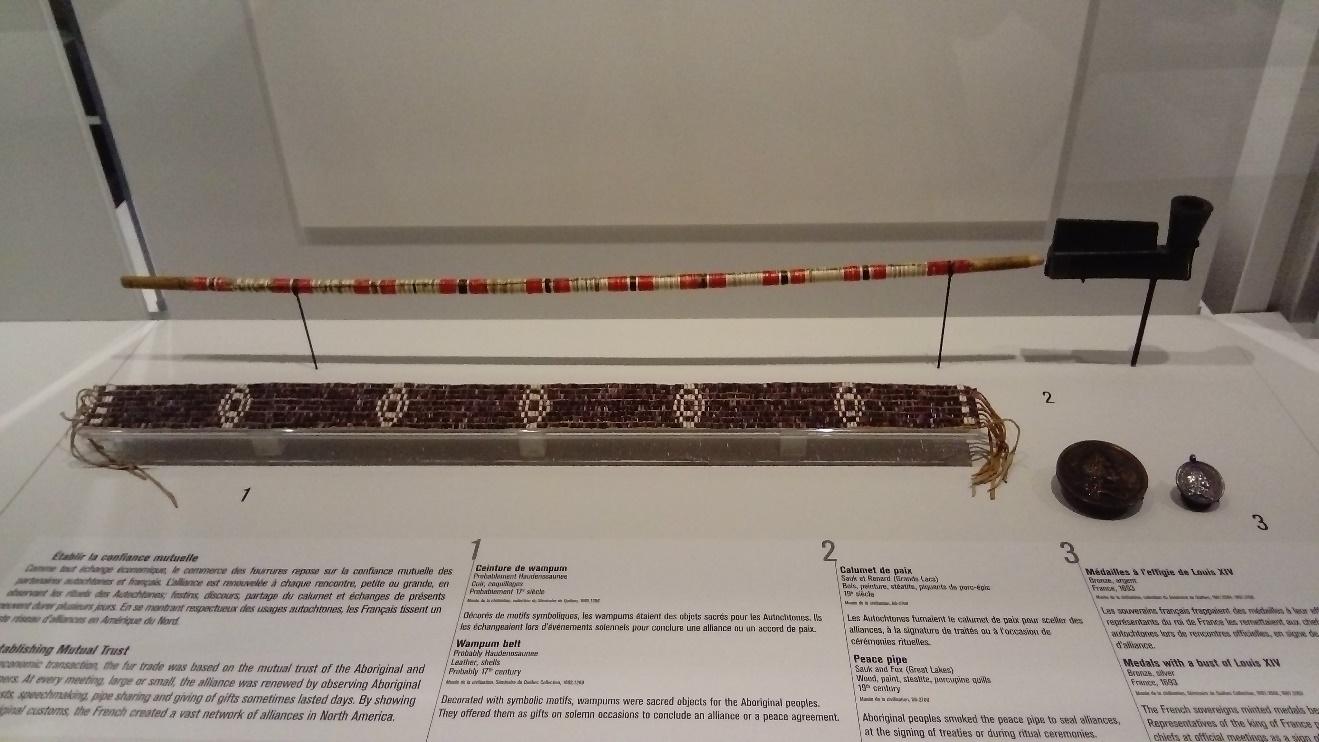
Objets de premières nations et de colons français dans la même vitrine dans l’exposition Le temps des Québécois © O. de Souza
En visitant ces expositions, j’ai réalisé que je ne connaissais pratiquement rien de ces histoires. En France, à l’occasion de la visite de l’exposition Nunavik En terre inuit, j’avais déjà constaté mes lacunes à propos de cette histoire, mais au Musée de la civilisation j’ai pu prendre l’ampleur de ces dernières. Me demandant si je n’avais pas été attentive durant mon secondaire, j’ai décidé de mener l’enquête autour de moi. Commençant par interroger mon colocataire, français aussi, celui-ci m’avoue qu’il ne savait même pas qu’il y avait des Premières Nations à Québec. Je demande alors à ma sœur de chercher dans ces manuels scolaires si elle trouve quelque chose : aucune trace de notre lien avec le Québec. Elle va alors interroger son professeur d’histoire au lycée, celle-ci lui explique que ce n’est pas au programme, mais qu’il arrive que cette histoire soit évoquée à titre d’exemple. Puis elle me rapporte la parole de son amie qui adore le Québec, mais qui pensait que le français y était parlé à cause d’une immense vague d’immigration (certes, on pourrait parler d’une immigration colonisatrice). Je mesure donc que ces lacunes concernent d’autres Français.
Chaque année, des milliers de Français partent au Québec, cette province est vue comme un eldorado, un morceau du rêve américain sans barrière de la langue. Et pourtant on s’attarde rarement sur le fait que ce pays est francophone, car nous l’avons colonisé dès 1534, que des guerres avec les peuples autochtones ont éclaté et que nous avons détruit une grande partie de leur population, de leur civilisation. Cela n'a rien d'étonnant si on nous appelle « maudits Français », on ne connaît pas notre histoire commune, on ne fait pas l’effort de se souvenir de notre lien avec ce pays, ce qu’on y a fait. Et pourtant l’histoire du Québec c’est aussi une partie de l’histoire de France.
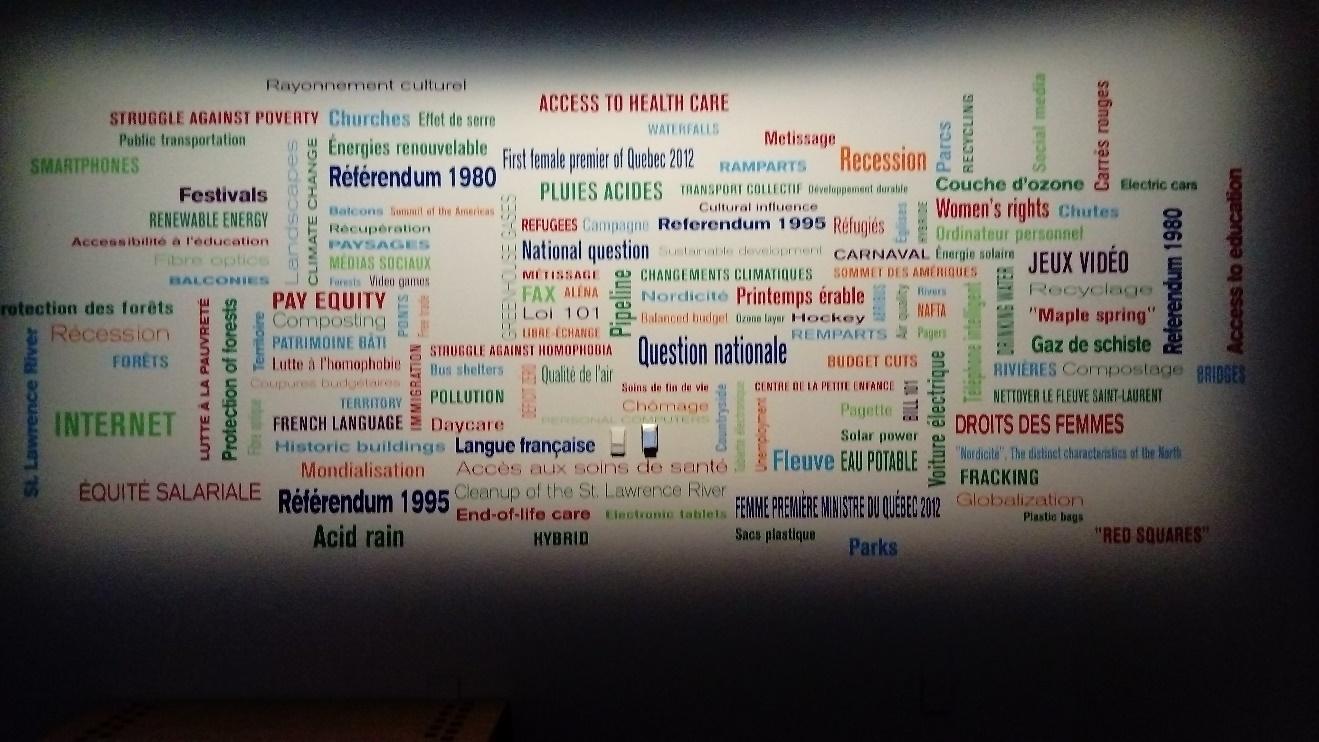
Nuage de mots à la fin de l’exposition Le temps des Québécois répondant à la question : « Le Québec contemporain c’est… » © O. de Souza
Je n’ai pas la prétention de chercher des réponses pour savoir pourquoi cette histoire est « oubliée » ni de débattre sur les enjeux de la réappropriation et la revendication de cette histoire. Je ne parlerai pas de la complexité à comprendre ce récit qui concerne plusieurs nations, plusieurs cultures, il n’est pas bilatéral comme les habituelles histoires de colonialisme. Pour rendre compte de toutes les complexités, c’est à un autre exercice littéraire qu’il faudrait s’atteler : une thèse!
Néanmoins, n’oublions pas : C’est notre histoire.
Océane De Souza
#Québec
#Expositions
#Histoire
- Pour en savoir plus sur cette histoire des premières nations : https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1307460755710/1307460872523
- Pour en savoir plus sur l’histoire du Québec :http://www.histoireduquebec.ca/
- http://www.cieq.ca/
- http://www.biographi.ca/fr/special_top100_fr.html
- Pour visiter le musée de la civilisation et ses expositions : https://www.mcq.org/fr/?gclid=CjwKCAjwu4_JBRBpEiwATmPGp0GMzFNVf6my21wI7909kHDzuoCKzYlQA6RWb2JoyBSJMH8STmO6hRoCX8cQAvD_BwE

C[h]o-régraphie urbaine
Quand on arrive à Brest, on est immédiatement propulséEs dans l'immensité portuaire de cette ville. Le chef-lieu du Finistère est un lieu incontournable de l’expertise maritime. Les activités portuaires se côtoient, dialoguent et façonnent le paysage brestois.
La ville pourtant porte les stigmates de la seconde guerre mondiale. 165. C'est le nombre de bombardements qu'a subi Brest durant cette guerre. En 1944, 200 immeubles, seulement, étaient encore debout, dont quatre dans le centre-ville[1]. L'architecture est donc typique de la reconstruction d'après-guerre. La ville bétonnée de gris ne révèle qu'à de rares carrefours les vestiges d'un temps passé et des murs anciens qu'on imagine avoir luttés pour rester ancrés dans le sol de Brest.
Alors, pour les fadas de vieilles architectures gothiques, quand vous arriverez dans le cœur de la ville de Brest, autant vous le dire, vous n'y trouverez pas votre compte.
Les ravages de la guerre sur Brest sont bien connus, ainsi ce n'est pas pour de l'architecture que j'ai fait un bout de chemin pour atteindre la côte bretonne. Je suis venue faire un tour aux Capucins, plus grande place publique couverte d'Europe. Au fil des murs gris, j'arrive dans la rue Saint Malo. J'aperçois au loin mon point de chute et je commence à arpenter cette rue. Les premiers mètres n'ont rien d'exceptionnel, les murs sombres fredonnent la même rengaine. Et puis soudain.

Vue de la Rue Saint-Malo ⓒ Manon Lévignat
Soudain au bout de la rue Saint Malo, une friche culturelle.
Je suis en contrebas de tout, perdue dans un mélange entre de rares vestiges ayant survécu aux bombardements, des pots de fleurs, des plantes, des couleurs, des tags, des dessins, des fresques, des terrasses de cafés improvisés. 100 mètres de puissance poétique.
Les vestiges abandonnés ont été envahis de vie. Entre les morceaux de bois de la porte d'une petite maison, j'aperçois une légère estrade au bout et des chaises. J'imagine des rires, des échanges, des discussions durant lesquelles on refait le monde, du théâtre, du cirque, des œuvres, on s’engage pour un bien commun.

Vue de la Rue Saint-Malo ⓒ Manon Lévignat
C'est dimanche et la Covid court toujours. Alors la rue Saint-Malo que je traverse est vide, dépeuplée. Le lieu revêt quelque chose de sinistre, un après-effondrement. Mais on imagine cette rue pleine de vie, de mémoire, de verres partagés et de discussions qui ne prennent plus fin. 100 mètres au sein desquelles dialoguent passé, présent et futur.
Après quelques recherches, j'apprends que c'est l'association brestoise Vivre la rue qui est à l'origine de ce petit îlot sauvegardé. Vivre la rue est une association "dont l'ambition est d'être un lieu d'épanouissement pour les projets et les individus en favorisant les rencontres artistiques et les propositions pluridisciplinaires comme des vecteurs permettant de renforcer le lien social, la valorisation d'un quartier sensible et la participation citoyenne[2]". Sur le site Web de l'association, les internautes découvrent la rue saint malo en musique et en poésie.
Des manifestations culturelles, un espace numérique public, des expositions, un salon de thé, tisane et cafés, des spectacles, une épicerie bio, des livres en libre échange : c'est ce qui se vit dans ce coin de rue grâce aux bénévoles de l'association.
Cette rue a connu tant d'histoires que cet article serait trop long si je devais toutes les relater. J'invite les plus curieux.ses à aller les découvrir[3].
Mais une anecdote, pourtant, qui me touche ; la rue Saint Malo, qui ne porte pas encore ce nom en 1685, accueille à partir de cette date un bâtiment appelé La Madeleine. Et à La Madeleine, on y enferme des femmes que l'on appelle "de mauvaises vies". Des femmes que l'on accuse de se prostituer, des veuves ou des femmes considérées comme "folles"[4]. Autant de raisons qui effraient le patriarcat et qui à l'époque légitiment d'envoyer ces femmes en prison ou de les écarter de toute vie sociale. Elles sont un trouble à l'ordre public, un danger pour les mœurs chrétiennes. Stigmate qui pèse aujourd'hui encore très lourd sur la vie des travailleur.se.s du sexe.
En 1782, une femme que l'on connaît sous le nom de "la belle Tamisier" est internée à La Madeleine. Elle est veuve et est envoyée là par son beau-père pour des raisons que l'on ignore. Mais son transfert à la Madeleine est justifié par "sa vie de débauche". On peut aisément dire que cet internement était probablement injustifié. Le 10 février, un incendie criminel ravage le bâtiment. Aucune preuve formelle et certaine ne l'atteste mais l'incendie a débuté dans la chambre de La Belle Tamisier. Il lui est attribué[5].
Elle profite de l'affolement général pour s'enfuir et ne refera plus jamais surface. Sa force et son aura planent encore sur les rues de Brest et construisent l'imaginaire collectif de la ville. Régulièrement des artistes s'emparent de son histoire dans leur création.

Fresque de La Belle Tamisier réalisé par le graffeur brestois Worm ⓒ Damien Goret - Brest Métropole
Après avoir erré dans la rue Saint-Malo, je grimpe quelques marches et je me retrouve face à l'immensité du bâtiment des Capucins. Ancien couvent transformé en ateliers industriels, c'est aujourd'hui un lieu de vie culturel.
Quand j'entre dans cet espace, le soleil est déjà bas et la lumière qui s'infiltre dans l'ancien couvent offre quelque chose de mystique à l'endroit.
J'entends des cris et des rires d'enfant.
Bibliothèque, espace d'exposition, pop-up stores, petit magasin d'artisans brestois, l'éternelle odeur de crêpe chaude qui règne en Bretagne, et espaces de glisse se mélangent dans le bâtiment des Capucins.
Je traverse rapidement l'espace d'exposition à l'étage qui présente le travail photographique de Michel Thersiquel, reportage effectué au centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape, à Ploemeur.
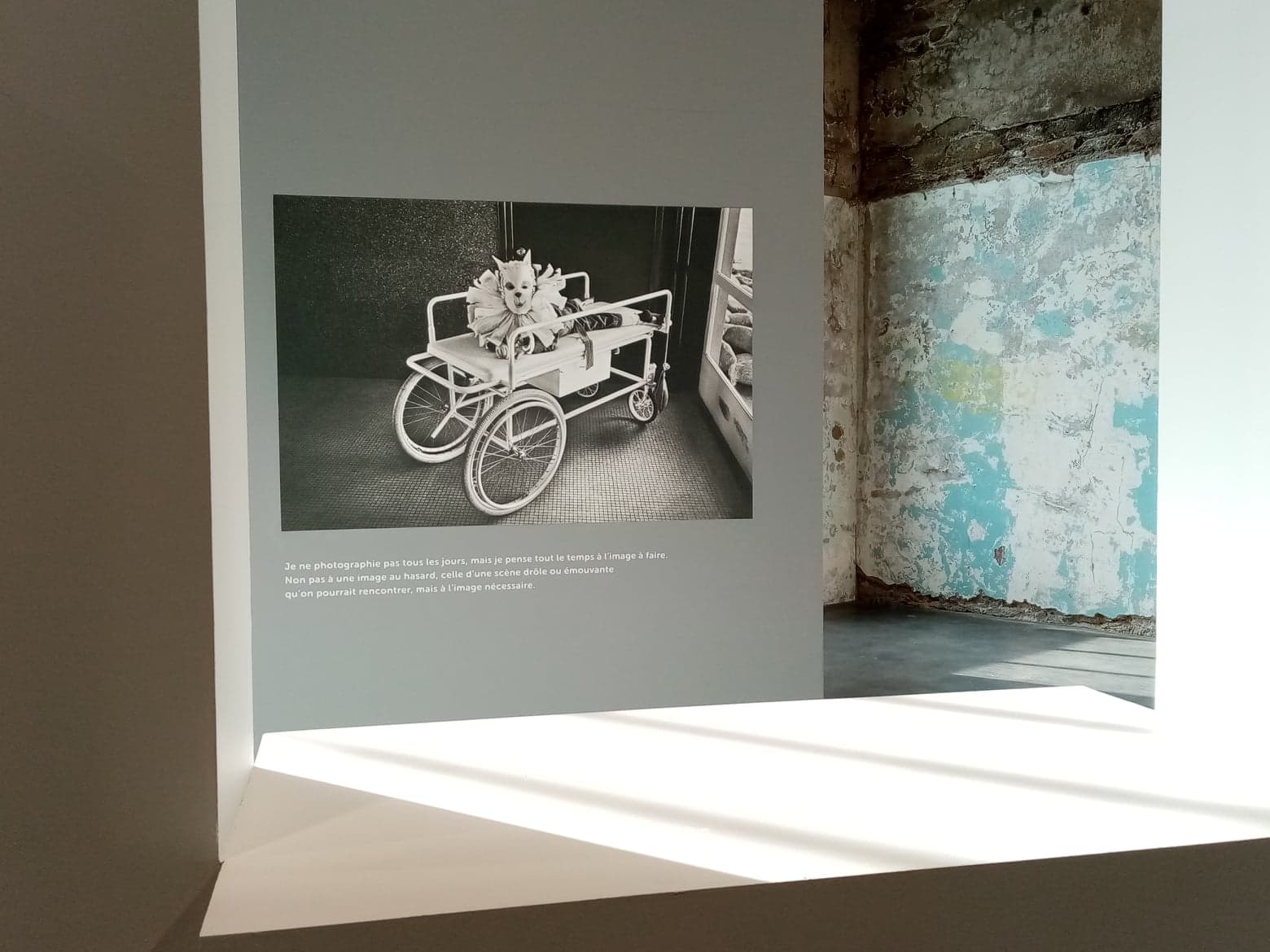
Vue de l’exposition Thersiquel A fleur de corps ⓒ Manon Lévignat
L'artiste s’est attardé pendant 14 ans sur le détail de corps meurtris, immobilisés, en situation de handicap pour en révéler la force et la beauté. Le regard du photographe, je dois bien l'avouer, ne me touche pas et l'accrochage scolaire des photographies me fait rapidement quitter l'espace. Et puis, j'ai bien trop hâte d'aller me mêler aux petits groupes qui envahissent l'espace central.
Je continue ma déambulation et au coin du hangar j'intercepte des bribes de vie. Deux jeunes femmes sont assises à côté d'une balustrade qui donne sur la place centrale des Capucins. Elles ont des fiches et des cahiers posés sur leur genoux et se récitent à tour de rôle des passages de cours, peut-être pour une interrogation à venir.
À côté deux autres jeunes femmes s'embrassent. Et en face d'elles quatre autres dansent, insouciantes aux regards des gens qui les entourent. Des pieds au bout de leurs cheveux, leur corps et leur mouvement improvisent des pas de danse. Elles sont puissantes, imperturbables. Les PassantEs s'arrêtent ou freinent le pas à côté d'elles comme s'iels faisaient partie de leur chorégraphie.
Je redescends et dans l'espace centrale c'est une cour de jeu publique où passé et présent s'entremêlent. Les traces des différentes vies du lieu s'imbriquent. Un pan de mur sur lequel une peinture ancienne s'effrite. Les anciennes machines ayant servi lorsque le lieu était un atelier où l'on fabriquait et réparait les bateaux de la Marine Nationale. La manière dont la lumière vient flatter les corps qui s'activent dans la nef intérieure. Le travail précis de restaurations des ornementations du Canot de l'Empereur, luxueuse embarcation, construite en 1810 à la demande de Napoléon Ier et confiée après la chute de l’Empire à l’Arsenal de Brest[6].
Toutes ces vies sont placées sur le même plan et traitées à égale valeur.

Canot de l'Empereur dans la grande halle des capucins ⓒ Manon Lévignat
Et entre ces pans de vie, le sol a été pensé pour devenir un véritable terrain de glisse et tout le monde se prête au jeu. Mais surtout des enfants qui sont comme maîtres en ces lieux. Les petites filles naviguent d'un bout à l'autre de l'espace munies de trottinette, de patin à roulettes ou de skate. Le regard déterminé, elles slaloment, vives et hilares, entre les gens, les arches et les anciennes machines.
Un petit garçon fait ses premiers essais en roller, ses jambes tremblent un peu, il chute beaucoup mais se relève à chaque fois, sous le regard bienveillant de sa grande sœur qui lui donne des conseils.
Les enfants insouciants montent sur le socle des machines, qui malgré leur aspect effrayant deviennent terrain de jeu. Armés de leurs coudières et genouillères, ils semblent partir à l'aventure et à la découverte des traces du passé industriel du lieu.

Espace centrale des Capucins ⓒ Manon Lévignat
Les cheminements des gens et des enfants dans la nef centrale se font et se défont comme une grande chorégraphie dont tout le monde serait maître. À laquelle chacunE est invitéE à ajouter son pas de danse. Pari réussi pour Brest qui souhaitait avec le projet de ce tiers-lieu culturel redynamiser le quartier tout en conservant le patrimoine industriel des Capucins.
Manon Lévignat
#communsurbains#tiers-lieux#Brest
[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Brest ↩
[2] http://vivrelarue.net/ ↩
[3] http://vivrelarue.net/historique.html ↩
[4] NB : j’utilise ce terme entre guillemet, car c’est celui qui est employé dans les récits historiques et archives sur La Madeleine. Cependant, les termes “folle” et “fou” sont chargés d’une psychophobie importante qui participe à stigmatiser des personnes atteintes de troubles mentaux. Il est préférable de ne pas employer ces termes. ↩
[5] https://actu.fr/bretagne/brest_29019/la-belle-tamisier-pasionaria-du-xviiie_5229002.html ↩
[6] https://www.ateliersdescapucins.fr/fr/propos/notre-histoire]https://www.ateliersdescapucins.fr/fr/propos/notre-histoire ↩

Ça déménage !
Petits ou grands à l’instar du Louvre, seul ou à plusieurs comme à Bourges, en France ou à l’étranger tel le muséum de Neuchâtel : plusieurs musées se sont lancés ces dernières années l’ambitieux défi de déménager tout ou partie de leurs collections. Pourquoi ? À cause d’un manque de place dans les infrastructures d’origine, d’une nécessité de mutualiser des espaces afin de réduire certains coûts ou encore afin de garantir une conservation optimisée des collections. Alors on sort les cartons et le papier bulle et on s’y met ? Pas si vite...Au musée comme à la maison, un déménagement nécessite un endroit approprié où atterrir, des moyens humains et financiers ainsi qu’une bonne dose d’organisation. Car si certain.e.s profitent d’un déménagement pour réagencer la disposition des meubles du salon, les nouvelles réserves, elles, doivent pouvoir accueillir les collections dépoussiérées, étiquetées et classées dans un ordre bien précis. Pour cela de nombreuses étapes et différents outils sont pensés afin de faciliter le déroulé de cette phase importante dans la vie d’un musée.
Camion du muséum permettant le déplacement des équipes. Derrière, le congélateur.
L’exemple du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel en Suisse.

Diorama de la collection permanente
Il comporte une riche collection de dioramas, fortement inspirés des œuvres des peintres naturalistes Léo-Paul Robert (1851-1923) et son fils Paul-André Robert (1901-1977). Cette technique de mise en scène, très appréciée dès les années cinquante, permet de présenter des animaux dans leurs environnements naturels et leurs milieux de vie. Mais seule une infime partie des spécimens abrités par le musée est exposée.
Au total, on recense plus de 20 000 oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens et poissons mais aussi 8 642 coquilles d’œuf, 1 veau à deux têtes, 32 366 mouches et bien d’autres choses. Plus précieux encore d’un point de vue scientifique, trois cents spécimens ayant servi à la description d’espèces sont conservés. On les appelle des « types » et ils restent encore aujourd'hui des références à l’échelle mondiale pour les professionnels de la biologie et de l’histoire naturelle. Par ailleurs, certains animaux appartiennent à des espèces disparues comme le Grand Pingouin ou le Thylacine. On comprend dès lors la volonté du muséum d’apporter un soin particulier à ses collections et de les conserver dignement tout en les gardant accessibles pour la recherche.
1, 2, 3...déménagements !
Installé à son origine dans le collège latin puis dans une ancienne École de Commerce depuis presque 50 ans, le muséum n’en est pas à son coup d’essai en matière de migration des collections. L’année 1982 avait déjà marqué certains esprits puisque le musée, fidèle à sa thématique, avait adopté la méthode « fourmi ». La légende dit que, mobilisant l’école secondaire voisine, chaque élève s’était vu confier le transport d’un spécimen de petite taiIle, acheminé à pied jusqu’au nouveau musée à trois cents mètres de là, créant une joyeuse file indienne. Un procédé écologique et farfelu que l’institution n’a pas souhaité remettre en place cette fois-ci.
Aujourd’hui, les réserves situées au sein du bâtiment ne permettent plus d'assurer de bonnes conditions de conservation. En effet la place se fait rare et les fluctuations de
températures et d’humidité relative, surveillées de près en conservation préventive, ne correspondent pas aux normes climatiques souhaitées. Heureusement, un important
chantier a été mis en place afin d’assurer le transfert de tout ce monde dans un nouveau lieu appelé le pôle muséal. Celui-ci, dont la a construction s’est achevée en 2022, est géré par la ville de Neuchâtel. Le lieu abrite également les réserves du musée d’ethnographie, du jardin botanique, du musée d’art et d’histoire ainsi que les archives de la ville. Le muséum y dispose d’une salle pour les spécimens en alcool, une salle oiseaux, deux salles mammifères, une salle géologie, une salle insectes, un espace pour le travail sur les collections, etc. Les équipes se rendent d’ailleurs chaque début de semaine sur site, épaulés par des déménageurs spécialisés en transport d’œuvres d’art. Jour de fermeture de l’institution au public, le lundi est en effet un moment privilégié pour effectuer des transferts.

Collection d’oiseaux dans les anciennes réserves.
Au matin, les caisses qu’il contient en sont extraites après avoir passé une semaine à -35 degrés. De quoi permettre aux spécimens ayant bénéficier de ce traitement rafraichissant de se débarrasser d’éventuelles larves d’insectes cachées entre deux plumes ou poils. Après cela, ils pourront être déplacés en camion afin de découvrir leur
nouveau lieu de vie. Là-bas, les tablars qui permettront de les accueillir ont été montées sur mesure afin qu’aucune tête ne dépasse ou se cogne. Chaque rangée d’étagères a également reçu un nom correspondant à sa localisation et à la typologie de spécimens qui s’y trouvera. MAM/B, OIS/ W... Mais comment faire le lien entre ces nouveaux
emplacements et les centaines de caisses qui arrivent ? Revenons un peu en arrière... Initiée il y a déjà plusieurs années, une vaste campagne a permis de faire le point sur
ce que contenait précisément le musée. L’occasion d’attribuer à chaque spécimen un QR code facilitant l’accès aux données le concernant mais aussi de vérifier son état et
de le débarrasser des poussières. À présent, lorsqu’un spécimen se prépare à quitter le musée, il est soigneusement installé dans une caisse ayant au préalable reçu un numéro. Celui-ci est reporté dans un tableau à côté des numéros d’inventaire et des anciennes positions de chaque individu se trouvant dans la caisse. Les intitulés des
anciennes rangées sont également reportés sous le numéro de caisse. Du côté du pôle muséal, un document permet d’associer chaque nouvelle rangée à un ou plusieurs anciens emplacements. Ce jonglage numérique permet de garder de l’ordre et de ne pas perdre un spécimen en route. C’est ce que l’on appelle l’adressage.

Collection d’oiseaux en cours de déménagement.
Le carnet de souche, un outil précieux.

Vérification des conditions climatiques au pôle muséal.
Ce nouveau voyage vient désormais s’inscrire dans l’histoire de chaque spécimen déplacé. Au même titre que sa date d’acquisition, sa provenance, son âge, le nom de son espèce ou de sa famille, cette information est documentée. Le but est d’assurer un suivi et d’en garder trace pour les décennies à venir. Chaque étape (mise en caisse, congélation, transport) est donc soigneusement inscrite dans un document papier appelé carnet de souche dont chaque page est ensuite scannée et dont les informations sont retranscrites dans une version numérique au fur et à mesure du déménagement. Ces différentes sauvegardes permettent une très grande traçabilité des collections et sont facilement accessibles pour toute l’équipe. Cela permet également de rendre visible l’avancée du déménagement, même auprès de celleux qui n’y participent pas. Celia Bueno, conservatrice et adjointe de direction mais également coordinatrice du déménagement peut ainsi se faire une joie de partager avec les collaborateurs du Muséum, lors des séances hebdomadaires, l'avancée du chantier et le nombre d’unités déménagées. Mais attention aux chiffres ! Certaines petites caisses, appelées rako, peuvent contenir plusieurs dizaines d’oiseaux lorsqu’ils sont de petites tailles et/ou en peaux (c’est à dire non montés sur socles). À l’inverse, un carton de taille imposante ne renferme parfois qu’un seul mammifère de taille plus imposante. Une chose est sûre, le volume du congélateur lui reste le même et ne désemplit pas depuis de nombreux mois.

Singe prêt à être congelé.
L’ensemble de ce processus est donc un travail titanesque. Pour relever le challenge, le muséum peut compter sur l’aide de nombreuses personnes : étudiant.e.s, stagiaires,
civilistes, conservateur.ice.s mais aussi l'association des amis du musée dont plusieurs membres se proposent comme bénévoles dans le cadre de ce projet. Grâce à toutes ces petites mains, fourmis 2.0, la vie du Muséum peut continuer en parallèle, proposant des expositions temporaires, permanentes, itinérantes, des actions culturelles et bien d’autres surprises !
Je remercie tou.te.s les collaborateur.ice.s du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel pour leur accueil chaleureux et mon intégration, en tant que stagiaire, à ce projet de déménagement.
SP
Crédit photos : Sasha Pascual
Pour plus d’informations sur le muséum : https://museum-neuchatel.ch/
À propos des dioramas (re)lisez l’article de l’Art de Muser : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2271-la-vraie-fausse-nature-des-dioramas
|
#déménagementdescollections #museum #conservationpreventive |

ÇA DÉMÉNAGE ! La Fondation Cartier fête ses 40 ans.
La Fondation Cartier pour l’Art Contemporain dévoile son futur lieu d’exposition à l’occasion de ses quarante ans et accompagne cet anniversaire d’un podcast qui retrace son histoire : “Voir Venir, Venir Voir”.
La Fondation fête ses 40 ans
A ses débuts en 1984, la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, créée par la Maison Cartier et dirigée par l’un de ses fondateurs Alain Dominique Perrin, s’installe au sein du domaine du Montcel, en région parisienne. Elle occupe ce site pendant dix ans avant de déménager dans le sud de Paris, entre le jardin du Luxembourg et Denfert-Rochereau, dans le 14ème arrondissement. A l’image de son premier lieu d’accueil, les locaux actuels se trouvent au sein d’un parc urbain, où l’architecture et les espaces d’expositions dialoguent avec le paysage. En retrait depuis la rue, à la manière d’un squelette de verre et de métal, le bâtiment du boulevard Raspail est rapidement devenu emblématique de l’image de la Fondation : un bâtiment contemporain qui se détache de l’architecture haussmannienne du boulevard, à l’image des œuvres qu’il accueille.
 Le bâtiment de Jean Nouvel pour la Fondation Cartier, boulevard Raspail, Paris.
Le bâtiment de Jean Nouvel pour la Fondation Cartier, boulevard Raspail, Paris.
A gauche : Vue extérieure, Photo ©CT. A droite : Vue intérieure, Photo ©CT.
A l’occasion des 40 ans de sa création, la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain a décidé de marquer le coup, en changeant de décor. Actuellement situé au 261 Boulevard Raspail, le bâtiment de la rive gauche parisienne n’accueillera bientôt plus d’expositions, en raison de sa superficie devenue trop restreinte pour les ambitions futures de la Fondation. Elles vont désormais prendre place dans le cœur de la capitale, à proximité du Louvre, du Musée des Arts Décoratifs, de la Bourse du Commerce Pinault et de la Bibliothèque Nationale de France. Entre la rue de Rivoli et le Palais Royal, un ancien immeuble Haussmannien reconverti par l’architecte Jean Nouvel deviendra le nouveau terrain de jeu de la Fondation, le tout sur plus de 6500m² de surface d’exposition contre 1200 m² auparavant. L’actuel bâtiment du Boulevard Raspail, ayant accueilli l’American Center avant que la Fondation s’y installe, sera consacrée à des espaces de bureaux - dont une partie sera toujours réservée à l’entreprise Cartier.
40 ans d’expositions venues du monde entier, caractères singuliers et universels
Depuis sa création au milieu des années 1980, la Fondation Cartier a posé un regard à la fois singulier et universel sur l’art contemporain et les pratiques artistiques au sens large. Des dix premières années au domaine du Montcel de Jouy-en-Josas aux trente suivantes Boulevard Raspail, la Fondation Cartier offre aux artistes venant de tout horizon de la scène contemporaine la possibilité de rassembler leurs œuvres à travers des expositions sensibles et inédites, tout en leur permettant de se produire in-situ. Peinture, sculpture, tissage, collage, photographie, vidéo, design, paysage, ou même recherches mathématiques, scientifique ou domaine automobile, nombre des secteurs de la culture contemporaine sont représentés à travers les expositions de la Fondation Cartier. Un des objectifs est d’élargir les points de vues sur l’art contemporain et sa définition, sa caractérisation.
Au-delà de varier les médias et les médiums, une autre volonté de la Fondation est d’ouvrir les frontières aux pratiques artistiques internationales. Il est alors question de varier les styles, les types, les genres mais également les origines. Le panorama d’artistes de cette programmation est international, permettant de faire rayonner cette diversité à l’échelle nationale. Le tout premier artiste à avoir collaboré avec la Fondation est le sculpteur César, déjà reconnu à l’époque, aux côtés de deux artistes montant, Julian Opie et Lisa Milroy. Après eux se sont succédé de multiples artistes aux langages variés, parmi lesquels : Jean Tinguely, Agnes Varda, Ron Mueck, Patti Smith, Chuck Close, Junya Ishigami, Enzo Ferrari, Jean-Paul Gaultier, Bill Viola, Andy Warhol, Ron Arad, Issey Miyake, Claudia Andujar, David Lynch, Sarah Sze ou encore Bijoy Jain à travers le travail de Studio Mumbai, et tant d’autres…Elle clotûre ce chapitre avec une rétrospective sur l’artiste colombienne Olga de Amaral.
Cette diversité de fond et de forme fait la richesse de la Fondation depuis sa création. Chaque exposition est l’occasion de plonger le public dans un univers artistique unique. Après quarante années de création d’expositions et de programmation culturelle, les mêmes notions animent la Fondation et questionnent le visiteur : comment se réinventer perpétuellement en élargissant sans cesse le spectre de l’art contemporain, comment établir autrement les relations, aussi bien avec ce qui nous est familier qu’avec ce qui ne l’est pas et comment rester profondément inventif, ouvert d’esprit, curieux et libre ?
 Deux des dernières expositions de la Fondation Cartier : Studio Mumbai et Olga de Amaral.
Deux des dernières expositions de la Fondation Cartier : Studio Mumbai et Olga de Amaral.
Photographies © CT
Une programmation culturelle pour rétrospective
Pour amorcer progressivement son changement de lieu, la Fondation propose une programmation culturelle qui permet au public de se replonger dans les moments phares de son histoire et ce, depuis sa création. Parmi ces propositions, un ouvrage retrace en images ces quarante ans de programmation et d’expositions, une installation photographique sur les futures façades de la rue de Rivoli met en avant les artistes ayant collaboré avec la Fondation, mais aussi un podcast de six épisodes raconte sa genèse, ses événements marquants, ses expositions majeures, le tout à travers des anecdotes inédites narrées par les fondateurs, les équipes, les artistes, archivistes, amis, mécènes, qui ont contribué à construire cette histoire. Une manière insolite et accessible d’offrir aux auditeurs un large panorama de sa production culturelle, de son fonctionnement et de ses engagements durant ces quarante dernières années.
#1 “Créer des expositions comme on crée une œuvre d’art”
Le premier épisode présente la genèse de la Fondation et ses objectifs dès ses débuts. A travers les paroles des personnes qui ont contribué à sa création, ses ambitions premières nous sont dévoilées : élaborer une programmation culturelle sans contrainte, aller au-delà de l’exposition elle-même, prolonger l’impact de l’art par-delà les murs de la Fondation, concevoir un lieu de création vivante, valoriser et promouvoir le travail d’artistes contemporains de tous horizons, connus et moins connus, tisser une relation pérenne entre artistes, commanditaires, critique et public, engager tous les acteurs qui gravitent autour de cette discipline.
#2 “Rendre à César ce qui lui appartient”
Au cours du deuxième épisode, les narrateurs lèvent le voile sur le contexte politique dans lequel la Fondation Cartier a vu le jour dans les années 1980 et le regard qui était posé sur l'art contemporain à cette époque. Les fondateurs expliquent la manière dont s’est construite la Fondation d’un point de vue entrepreneurial et comment cette méthode a pu permettre une plus grande souplesse dans la mise en place des expositions, le choix des artistes, les partis-pris muséographiques. A ce stade, il restait encore beaucoup à faire : trouver le lieu, choisir l’architecte, imaginer les premières expositions, prévoir la programmation, rencontrer les artistes, débloquer des financements…
#3 “C’est pas mal d’être un mécène”
Dans cet épisode, il est question de mettre en évidence le rôle du mécénat et son importance dans la production artistique contemporaine, et principalement dans le cas des fondations privées. L’objectif premier est de valoriser les artistes et faire reconnaître leurs œuvres - comme c’est déjà le cas pour les sportifs à l’époque, tout en dédiabolisant le regard posé sur l’argent et les financements. Cette prise de conscience s’amorce en comparant le fonctionnement à l’étranger et la pratique en France. Grâce à la régularisation et au développement du mécénat, la Fondation peut financer la production des artistes, acquérir leurs œuvres et débuter une collection propre, aménager le lieu pour les accueillir en résidence, organiser des événements pour promouvoir leur travail…
#4 ”Ma non sono morte, pourquoi voulez-vous faire une rétrospective ?
Le quatrième épisode de ce podcast aborde la création et l'expérimentation à travers les expositions. Comment traiter ce qui n’a jamais été traité, comment faire voyager le public vers un ailleurs, comment transcender les frontières en explorant toutes les zones de créations même à l’extérieur du domaine dit “artistique” ? Au fil des années, la Fondation tente de montrer et d’assumer pleinement que les limites de l’art vont au-delà de celles imposées et que les expositions ne sont pas faites pour plaire mais pour oser et marquer les esprits. Cela passe notamment par le fait d’être reconnu comme une institution muséale qui se transforme et se renouvelle sans cesse. La Fondation Cartier possède une collection qui réunit près de 4000 œuvres, réalisées par plus de 500 artistes du monde entier.
#5 “Aller voir ailleurs, et faire le mur toujours”
Cet avant-dernier épisode replonge les auditeurs dans les débuts de la Fondation et aborde le rapport étroit qu'entretient le contenu avec son contenant, c’est-à-dire les œuvres avec l’architecture qui les accueille. A travers les témoignages de l’architecte en charge du projet - aussi bien au domaine du Montcel que sur le boulevard Raspail, les grands enjeux sont explicités : valoriser le rapport au paysage, laisser la nature dominer le lieu, créer un jeu de transparence entre l’intérieur et l'extérieur, offrir un espace de liberté aux artistes, telle une toile vierge pour chaque installation, permettre de réinventer et reconfigurer indéfiniment l’espace, donner une dimension neutre, universelle et intemporelle au lieu…
#6 “Une Fondation, pas une institution”
Dans cet ultime épisode, l’ensemble des sujets traités tout au long de la narration sont de nouveau abordés, de manière à clôturer l’aventure. Après quarante années de fonctionnement, la Fondation souhaite continuer de mettre en avant un panorama éclectique et international de l’art, dans sa définition la plus large, de travailler à l’image d’un écosystème à échelle rapprochée, entretenant toujours un lien étroit avec les artistes et le public, en tentant d’inspirer et d'interroger sur les pratiques et les enjeux contemporains de nos sociétés.
Vers une altérité : des origines et un avenir controversés ?
La Fondation, pour célébrer cet anniversaire, établit un bilan que l’on pourrait considérer comme doré, de ce que furent ces quarante premières années d’activités Cela ne peut empêcher de poser la question de la subjectivité et parfois même, susciter la controverse. Ce vaste empire du monde de l’art dans le secteur privé est un des premiers en son genre en France. A l’époque où ses fondateurs mettent en place cette nouvelle activité, les fondations françaises que l’on connaît aujourd’hui telles que la Fondation Louis Vuitton, créée en 2014 ou la Fondation Carmignac, créée en 2000, n’ont pas encore vu le jour. En revanche, aux Etats-Unis, des Fondations privées telles que la Fondation Solomon R. Guggenheim ou encore la J. Paul Getty Trust existent depuis plusieurs décennies, puisqu’elles sont respectivement fondées en 1937 et 1953.
Malgré tout, se pose encore aujourd'hui de nombreuses questions en termes de consommation de l’art contemporain, la manière dont on le présente, dont on communique ou dont on capitalise sur sa diffusion. Quel rôle doivent jouer les fondations privées dans cet accompagnement et comment une médiation culturelle adaptée trouve-t-elle sa place entre profit et valorisation ? S’agit-il d’une affaire de business ou d’une volonté de mettre à la portée de tous l’infini spectre de la création contemporaine ? Quelles sont les dérives du secteur privé et les leviers qui peuvent être mis en place à l’avenir pour sortir d’un modèle basé sur des principes avant tout économiques ?
En tant que pionnière dans le domaine, la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain doit relever ces nouveaux défis avec attention. Dès sa création, elle a permis de donner les voix aux artistes de leur époque, d’une manière qui n’avait jamais existé auparavant, tout en ouvrant la voie à une nouvelle approche du monde de l’art. Elle écrit aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire, et doit veiller à trouver un équilibre entre tous ces différents enjeux.
 Future façade de la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, Place du Palais Royal.
Future façade de la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, Place du Palais Royal.
Photographie ©CT
Clotilde TROLET
#fondation #architecture #art #contemporain #programmation #podcast
Pour en savoir plus :
- L’Histoire continue Place du Palais Royal : https://www.fondationcartier.com/histoire-mission/fondation-40-ans
- Le podcast “Venir voir, Voir venir” : https://open.spotify.com/show/2ZJ6hggaOteJhpkhhuFjrK?si=893b1a8e10e54fe4
- L’ouvrage “Venir voir, Voir venir” : https://www.fondationcartier.com/editions/voir-venir-venir-voir
- Les archives des expositions de la Fondation Cartier : https://www.fondationcartier.com/expositions/archive
Pour aller plus loin :
- Podcast “Le Bruit de l’Art” : https://open.spotify.com/show/2xWZTl71Pxfu6kArEpilmm?si=eda45e192a8e4c9e
- Podcast “Visites d’expos” : https://www.centrepompidou.fr/fr/podcasts/podcasts-visites-dexpos
- Podcast “L’Amour de l’Art” : https://open.spotify.com/show/5ynCdvIjnQQyZr0Kmi08K2?si=22541a3f492b4695
- Podcast “ça a commencé comme ça” : https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/ca-commence-comme-ca
- Les podcasts du MAM : https://www.mam.paris.fr/fr/les-podcasts-du-mam

Ça rouvre et rferme
Pendant la pandémie, plusieurs lieux culturels ont été occupés par les employés, les syndicats, les intermittents. Si la plupart des occupations ont commencé avec les hauts lieux de l’art vivant, des alternatives ont été éprouvées dans d’autres sites : à Grenoble, après l’occupation de la MC2, une vélorution (manifestation à vélo) a mené les contestataires à la Superette…
Image d'en-tête : Fin de la Vélorution et ouverture des porte du Magasin afin de l’occuper © A. Savarino
Alors que le covid avait empêché l’ouverture de certains lieux considérés comme non essentiels et que d’autres comptaient rouvrir grâce au dé confinement, le Magasin, Centre National d’Art contemporain, ou encore appelé le Magasin des Horizons a du fermé boutique pendant plus d’un an déjà. Ce n’est pas la première crise que connaît ce lieu d’art contemporain. En effet, les directeurs et directrices en ont fait voir des couleurs à ce lieu. La dernière tuile en date concerne le bâtiment lui-même, une friche industrielle, considéré comme délabré, ne permettant pas d’ouvrir ces portes au public.
Le 17 Avril 2021, « un rassemblement d’artistes, d’habitant.e.s du quartier, de militant.e.s, de chercheur.euse.s a rouvert les portes du Centre National d’Art contemporain, le Magasin. À cette occasion, ce lieu culturel a été renommé La Superette. »
Le CNAC reste malheureusement fermé malgré les échanges et négociations avec la mairie. Ils s’installent donc devant, sur la grande esplanade.
Au fil des jours, des lettres sur les portes bleues du Magasin donnent le ton. Deux pancartes sont affichées : « rouvre 7/7 » et « changement de propriétaire ». Le collectif « les amis du Rouvre » s’organise et crée un espace d’expérimentation devant le parvis. Dans un « CDD choisi », ils désirent :
« – faire vivre un lieu abandonné depuis plus d’un an. Essayer de nouvelles choses, être un espace de diffusion, de création, être un.e ami.e pour les milieux associatifs du quartier et surtout pour les gens.
– mettre en avant les problèmes internes liés à la gestion du Magasin, bien connus depuis longtemps et relayés dans la presse1.
– questionner les modes de gouvernance opaques des institutions culturelles. »

Performance de Laurent Faulon © A. Savarino
Malgré quelques jours de pluie, de grandes feuilles permettent l’organisation de la semaine à venir. Qui veut proposer quelque chose peut le partager. L’autogestion reste un point fort de cette manifestation. Les gouvernances complexes du passé du lieu ont motivé les personnes à faire fonctionner la Superette différemment. C’est dans les petits gestes, l’attention envers l’autre et l’écoute que se produisent des ateliers, performances, karaoké, match de foot…
En effet, pendant un mois, le collectif s’organisent, installent parasols et banc. Une diversité d’activités à lieu : « initiation aux cyanotypes, de la broderie féministe, une construction collective de cages de foot, une découpe de patates pour des frites en cornets, un atelier d’écriture et de lectures de textes tristes en coupant des oignons, une performance véhiculée d’un artiste franco-suisse 2. » Des invitations ont aussi lieu pour permettre à des personnes de montrer leurs travaux d’art en cours.

Capture d’écran du compte Instagram de la Superette © Instagram
Mais c’est aussi grâce au BRAC (leur Bureau Rédactionnel des Affaires Conventionnables) que des tables de négociation sont érigées afin de questionner les gouvernances des lieux et leur rapport avec le territoire ainsi que les spécificités du travail artistique et les relations avec le territoire. C’est alors qu’iels créent la C.R.É.A.L.A, soit la Convention de Résidence d’Expérimentation d’Autogestion d’un Lieu Artistique 3 :
« Cette C.R.E.A.L.A est pensée comme une forme en soi, une forme de résistance.
Les Ami·e·s du Rouvre jouent le jeu de l’institution, de l’administratif, des articles numérotés et des pages paraphées pour en souligner l’absurdité. La Supérette est une performance artistique et se saisit de cette convention pour réaffirmer ses exigences, et inverse les rapports de force en affirmant cette expérimentation d’un mois comme un don public. » 4
La présidente du conseil d’administration du Magasin est descendue depuis Paris pour rencontrer les Ami·e·s du Rouvre. Malgré une longue discussion sur une manière alternative de gérer un lieu d’art, la rencontre n’a rien donné. Le langage n’était pas le même de chaque côté. La tentative d’une nouvelle forme de gestion et d’expérimentation a été ignorée et méprisée. Une sourde oreille.
C’est alors que la Superette a fêté son anniversaire d’un mois et le Magasin s’est refermé. Les CCD ont pris fin, et les activités se sont délocalisées. Si de belles envies et propositions ont vu le jour, c’est un petit mur de briques qui s’est dressé devant les portes bleues du Magasin.

Jour de fermeture de la Superette et son mur de briques © Séverine Cattiaux – Place Gre’net
Pour plus d’infos :
Aphélie Savarino
1 Voici quelques liens : https://www.lepostillon.org/Le-Magasin-doit-il-fermer-boutique.html ; https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/03/16/au-magasin-centre-d-art-de-grenoble-les-crises-s-enchainent_6073282_3246.html ; https://www.lejournaldesarts.fr/creation/rien-ne-va-plus-au-magasin-le-centre-dart-de-grenoble-153626
2 https://lundi.am/La-superette
3 https://lasuperette.info/260-2/
4 https://lundi.am/La-superette
#occupation #autogestion #culture
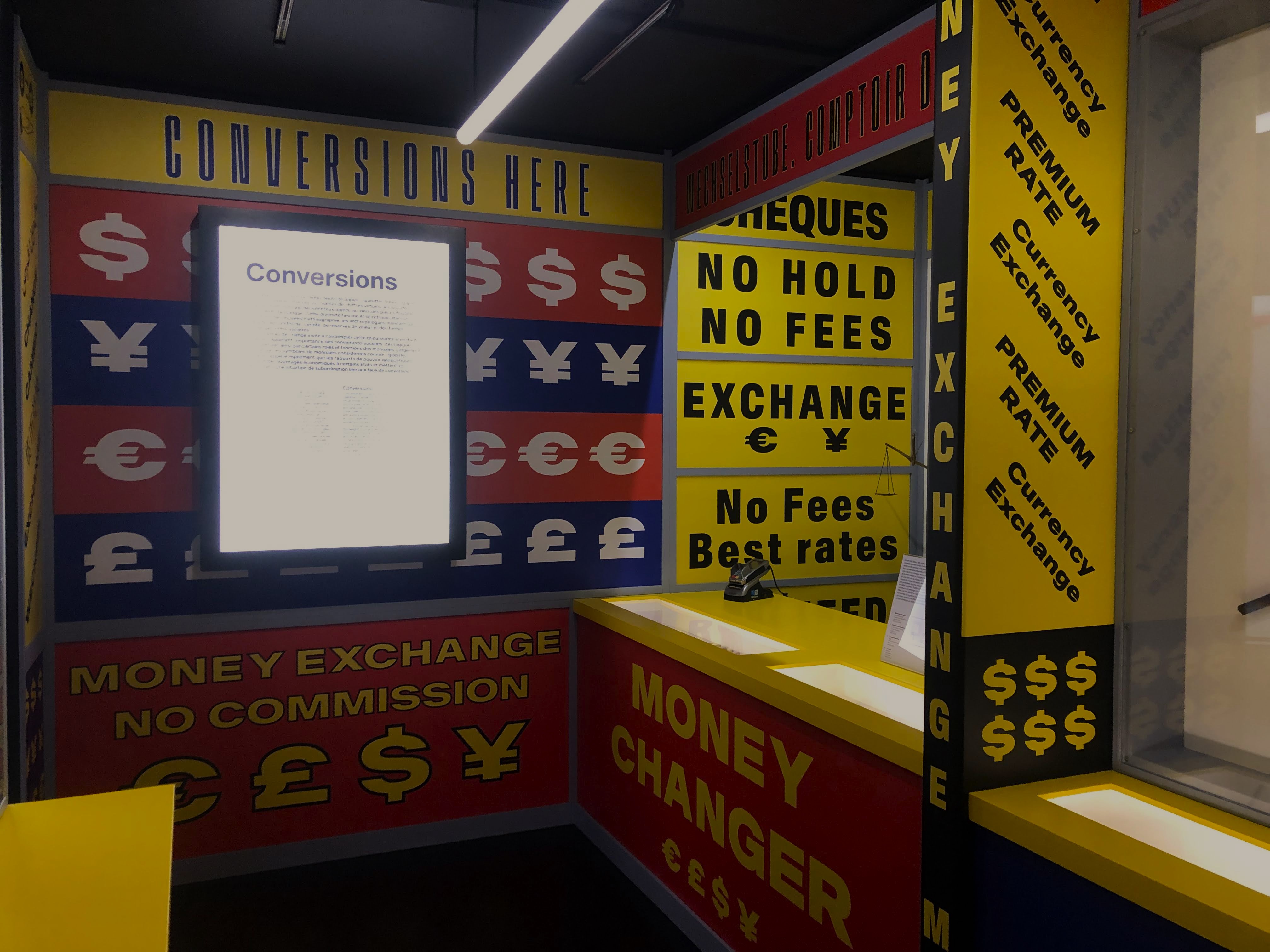
Cargo Cults 2.0 : Quand l'économie devient rituel
L’exposition « Cargo Cults Unlimited » au MEN expose la face cachée de l'économie mondialisée, révélant ses dérives presque religieuses. Fétichisation des marques, foi aveugle en la croissance infinie : Une immersion percutante et dérangeante dans nos croyances économiques.
Salle « Bureau de change » ©Serge Chaumier
Qu’est-ce que le « culte du cargo » ? Popularisée par les anthropologues anglophones au XXème siècle, l’expression décrit un phénomène religieux observé principalement dans les îles du Pacifique, notamment en Mélanésie, à la suite de contacts avec des colonisateurs européens et, plus tard, avec des troupes alliées durant la Seconde Guerre mondiale. Les populations locales, fascinées par l’arrivée massive de « cargo », autrement dit de biens matériels et de marchandises (outils, technologies, aliments, vêtements, etc.) apportés par ces étrangers, en sont venues à développer des croyances et des rituels visant à obtenir à leur tour ces produits auxquels étaient parfois prêtés des origines spirituelles ou magiques.

Les salles-containers vues d'en haut, ©Serge Chaumier
Depuis décembre 2023, le musée d’ethnographie de Neuchâtel invite à redécouvrir, dans un ensemble de quatorze thématiques, les nouvelles significations de ce culte dans son exposition temporaire « Cargo Cults Unlimited ». Dès le rez-de-chaussée, le visiteur est immergé dans un port marchand, le faisant sillonner entre les containers de carton dans lesquels sont abordés les différents domaines de la production et circulation des biens matériels qui amènent à se questionner sur la mystification de cette matérialité. De la transformation de traditions boliviennes en rites marchands, en passant par les zones grises, mais tolérées du marché jusqu’à la production et vente de produits de désir, les containers développent des thématiques variées toutes rattachées aux problématiques de productions, d’offre et de demande. De nombreux objets présentés proviennent de la collection permanente du musée, comme une cinquantaine de tirelires du XXème siècle, ainsi qu’un vaste ensemble de supports audio-visuels.
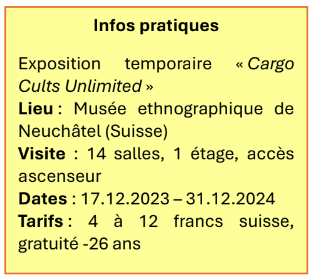
De la pure matérialité du marché, le visiteur monte ensuite à l’étage des bureaux, des postes de contrôle et salles de réunions en plaques de bois. Direction les créateurs et régisseurs de modèles, des normes et discours qui régissent le flux de marchandises en contrebas. Dans un enchaînement de pièces colorées, les « success stories[1] », les krachs boursiers et la routine des employés de bureau s'entremêlent sur les écrans de la salle de contrôle, un message s'affiche en lettres vertes : « Tout croît ». Une croyance profonde en la croissance perpétuelle, nourrissant le rêve de faire croître son entreprise et de devenir un jour l'un de ces grands entrepreneurs « self-made[2] ».

Salle « Poste de contrôle » ©Serge Chaumier
Sur les écrans s’affiche « Tout croît » et « La Grande Fin »
Dans la salle intitulée « Vestiaire », le visiteur est interpellé par les sonneries de téléphones rouges accrochés entre six illustrations de casiers contenant des uniformes de pompiers et des vitrines dans lesquelles se trouvent des photographies et objets originaux provenant de six crises financières célèbres (unes de journaux, boutons de manchette, etc.). En décrochant le téléphone qui sonne, le visiteur peut entendre l’archive d’époque d’une grande personnalité politique qui a été contactée au moment de la crise devant laquelle il se trouve.
Pouvant ainsi « contacter » les autorités, le dispositif souligne le paradoxe entre les critiques l'interventionnisme en temps de prospérité économique et les périodes de crise où l'État devient soudainement indispensable lorsqu'il s'agit de sauver les grandes entreprises, au détriment des fonds publics et sans remettre en question les structures qui génèrent ces crises à répétition. Ainsi, tout en offrant un panorama factuel des grandes crises économiques, comme le krach d’octobre 1987, surnommé « Lundi noir », et en expliquant des concepts tels que le principe de ruissellement des années 80, l'exposition interroge la foi quasi-religieuse en la croissance économique infinie, omniprésente dans le capitalisme moderne.

Salle "Vestiaire" ©Serge Chaumier
Le contraste frappant entre la glorification des entrepreneurs et la réalité des crises boursières montre que ce modèle, loin d'être infaillible, est soumis à des fluctuations imprévisibles et repose sur une précarité sous-jacente. Par ailleurs, la représentation de la routine des employés de bureau souligne la déshumanisation d'un système dans lequel l'individu se trouve pris dans un engrenage de normes et de discours qui le dépassent.
La dernière salle, intitulée « Le dernier marché », métaphorise ce constat en prenant la forme d'une salle de marchés fusionnée à un marché aux poissons, où chaque espèce représente, avec une touche d’humour, un modèle économique différent – économie du don, institutionnalisme, économie marxiste, entre autres. Des images des espèces vendues sont imprimées au-dessous de leur descriptif économique, rangés entre de curieux mannequins en costume de négociants et à la tête de poisson. Par exemple, le requin est associé à l’économie expérimentale, dont l’apparence est initialement effrayante mais dont seulement cinq espèces sont dangereuses pour l’homme. De la même manière, les théories et modèles de l'économie expérimentale, parfois complexes ou déroutants, sont souvent mal compris du grand public. Ils peuvent susciter méfiance et confusion, bien que ces modèles novateurs puissent transformer profondément les systèmes économiques traditionnels. Ces parallèles entre poissons et systèmes invitent donc le visiteur à réfléchir aux systèmes économiques auxquels il choisit d'adhérer. Le dispositif révèle ainsi les limites et les illusions d'un capitalisme qui promet succès et richesse à tous, qui est pourtant source de désillusions et inégalités. Mais c’est à lui de choisir quel poisson acheter et ne pas se laisser effrayer par une espèce qu’il n’a jamais goûtée.

« Le dernier marché », salle de(s) marchés, aux poissons ©Serge Chaumier
Remettant en question l’usage du concept culte du cargo pour désigner des pratiques jugées naïves, l’exposition le transpose donc à l’époque contemporaine : quelle « magie » est attribuée à l’économie mondiale ? Quels cultes se créent autour des marques ? Faut-il avoir « foi » en une croissance continue et éternelle ? Les pratiques économiques actuelles ne seraient-elles pas plus proches de rituels de culte, que celles des Mélanésiens du XXème siècle ? Jusqu'en décembre 2024, le MEN convie à une prise de conscience percutante : interroger les certitudes sur l'économie mondiale et découvrir les croyances cachées derrière ses mécanismes.
Éléa Vanderstock
[1] (trad.) Récits de succès ↩
[2] (trad.) Autodidacte ↩
Pour en savoir plus :
#CroissanceInfinie #MuséeSuisse #ExpositionTemporaire

Carnet d’une journée sous le soleil du care
Restitution de la journée professionnelle organisée par les Neufs de Transilie - Prendre soin : la place du care dans les écomusées et les musées de société.
Cour intérieure du musée d’art et d’histoire Paul Eluard, ancien carmel © É.V.
Mardi 14 octobre 2025, chapelle du musée d’art et d’histoire Paul Eluard (Saint-Denis).
Dans cette salle aux airs de cathédrale, les micros des intervenantes réverbèrent chaque parole sur les murs et montent jusque dans la coupole qui surplombe l’assemblée attentive. Difficile tâche de passer une journée à parler d’accessibilité et confort dans une salle gelée, mais réchauffées par une veste et un foulard, chacune a son carnet et crayon, prête à noter chaque notion clef et exemple pertinent. L’odeur du café brûlant et des croissants emplit l’air alors que commencent les premières interventions : d’abord M. Yannick Caillet, adjoint à la culture et patrimoine de la ville de Saint-Denis puis Mme Inès Mollard, du ministère de la Culture, remercient les présentes à tours de bras et de chiffres. Leurs propos rappellent les fondations juridiques sur lesquelles reposent les politiques culturelles : la loi 2002-5 du 4 janvier 2002, qui institue le label « Musée de France » et inscrit au cœur de la loi la notion d'accessibilité au public le plus large et d'égal accès de tous à la culture. Mais aussi celle de la loi du 11 février 2005 qui impose que les établissements recevant du public (ERP) doivent être accessibles à tous les types de handicap. Depuis les années 2000, ces textes traduisent une ambition politique claire : replacer le public au cœur du musée, non plus seulement les œuvres. Pourtant, comme le souligne Mme Stéphanie Magalhaes, présidente des Neufs de Transilie, les musées de société et les écomusées, par leurs ancrages locaux et leurs valeurs partagées, s’écartent des cadres strictement normatifs, ils s’affirment dès leur création dans une éthique du soin à l’autre.
Après ce temps d’introduction et un premier café, il faut maintenant prendre un temps pour définir les termes, choisir les bons mots et écarter ceux trop chargés de connotations. Un exercice que réussit brillamment M. Guirec Zéo, conférencier indépendant sur les perspectives du care dans le secteur muséal et patrimonial. Son intervention donne le ton pour le reste de la journée mais aussi les œufs sur lesquels il faut oser marcher lorsque le vocabulaire ne suffit pas à exprimer toutes les thématiques qu’on souhaite aborder, aussi complexes qu’elles puissent être. Un exemple frappant est celui de la « bienveillance », qui vient souvent « d’en haut » : on est bienveillant envers quelqu’un, rarement avec quelqu’un. Cette tournure hiérarchique peut sous-entendre un rapport de pouvoir, entre celui qui détient le savoir, la norme ou la ressource, et celui qui en bénéficie. Alors, un musée « bienveillant envers ses publics » risque d’adopter une posture condescendante, comme s’il « faisait une faveur » en ouvrant ses portes ou en adaptant son discours. Au contraire, le care, cherche la réciprocité : il ne s’agit pas de « faire pour » mais de « faire avec ». Il faut également souligner le revers possible de la médaille : dans cette attention à l'autre que prône le care, réside aussi un risque d’altérisation. À force de vouloir protéger, on peut enfermer. À force de vouloir prendre soin, on peut malgré soi figer l’autre dans une identité supposée, celle de la personne à aider, à accompagner, à ménager. C’est une ligne de crête délicate : nommer la différence sans l’assigner, reconnaître un besoin sans réduire quelqu’un à ce besoin. Enfin un rappel indispensable, qui résonne parfaitement dans la salle comme une évidence trop souvent oubliée : le care est, dans son essence, une idéologie féministe. Une éthique née des gestes invisibles, des tâches silencieuses, des attentions quotidiennes que les femmes portent depuis des générations. Elles sont celles qui, souvent, ont ouvert la voie à ces projets d’inclusivité, à ces espaces plus attentifs, plus humains.
Ainsi, dès les premières minutes de la journée, la complexité est posée : le care n’est pas une simple posture généreuse, mais un engagement politique, éthique, sensible, où chaque action révèle la place que l’on donne à l’autre et la manière dont on choisit de faire société.
Des rayons de soleil viennent réchauffer la salle lorsque s’installe la première table ronde avec une question brûlante : « Le musée peut-il être un lieu de soin ? » La réponse simple : non. Non, car les musées ne soignent pas au sens médical. En revanche, les écomusées et musées de société, eux, se tournent moins vers leurs collections que vers les territoires qu’ils habitent et les publics qui les traversent. Leur vocation n’est pas seulement de conserver, mais de relier : relier les vivants à leurs histoires, les habitants à leur mémoire, les gestes à leurs racines. N’est-ce pas déjà une première forme de soin ? Alors, comment faire dialoguer culture et santé ? Plusieurs expériences en témoignent.
La première, nous emmène au cœur du projet « L’Odyssée marine », une co-construction sur le temps long (2022-2025) entre le musée national de la Marine (Paris) et l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP, hôpital Charles-Foix, Ivry-sur-Seine). Dans cette expérience, le musée devient un outil pour sortir du cadre médical, un espace où les patients peuvent redevenir visiteurs, explorateurs. L’hôpital, lui, devient une ressource pour le musée, une source d’inspiration pour repenser l’accueil, le rythme, la parole. Des immersions, des ateliers de co-construction, des tests grandeur nature : soignants, patients et médiateurs se sont accordés peu à peu sur la manière d’habiter la visite. Ainsi, au fil des rencontres, s’est tissé un parcours « temps calme » au cœur des collections impressionnantes du musées. Cet exemple prend encore plus de relief grâce à l’échange de trois membres étroitement impliqués dans le projet : Mme Mathilde Teissier, médiatrice culturelle et référente accessibilité du musée national de la Marine, Mme Juliette Carvunis, cheffe du service culture et mieux-être à l’AP-HP, ainsi que M. Jordan Vigneron, enseignant en activités physiques adaptées et santé, à l’hôpital Charles-Foix. Leurs paroles résonnent d’une même conviction : « soigner » n’est pas seulement un acte médical ou technique. C’est aussi s’occuper du bien-être de quelqu’un, s’occuper de ce qui dépasse la pathologie. Dans cette perspective, le musée est un outil de respiration, un espace de déconnexion, où les patients peuvent s’échapper un instant de la réalité de leur maladie.
L’exemple suivant se déroule au musée d’Art et d’Histoire Paul Éluard (Saint-Denis), lieu hôte de cette journée d’étude. Le projet scientifique et culturel récemment validé réaffirme l’héritage militant du musée, sans oublier la mémoire spirituelle du carmel qui l’abrite, qui fut un espace de vie pour les Carmélites qui arpentaient les couloirs du lieu dès 1625. Ce double héritage invite à repenser le vivre-ensemble et la place du participatif : comment faire d’un musée un espace réellement utile à ses habitants ? C’est de cette réflexion qu’est né le projet « Bien-être des femmes », mené avec des associations locales d’accompagnement. Le but : offrir un lieu d’accueil et de sécurité pour les femmes de la ville en situation de fragilité. Malgré les contraintes d’un bâtiment ancien et difficile d’accès, l’équipe a choisi d’ouvrir ses portes [1] : des séances de yoga et de sophrologie, des ateliers sensoriels pour redécouvrir les collections par le corps, et la création de mélanges à base d’huiles essentielles, inspirée de l’ancien jardin médicinal du carmel. En deux ans, 235 femmes ont été accueillies, le musée devient alors un refuge, un espace de confiance.

Intérieur de la chapelle des Carmélites, tribunal d’instance de 1895 à 1993. Installation de la journée professionnelle. © É.V.
Avant de s’accorder une pause repas, la matinée se prolonge par une expérience du projet mentionné : trois sophrologues invitent les participantes de la journée à arpenter le musée silencieux. En petits groupes, chacune s’installe dans la lumière douce de midi, entourées de pierres et d’histoires. Le silence s’épaissit, habité par la respiration collective. Se tourner vers soi, ici, c’est aussi se tourner vers ce qui nous relie : comment s’ancrer dans le présent au milieu de tant de passés ? Comment respirer, dans un lieu qui garde la mémoire de tant d’autres souffles ?
Après trois longues inspirations et expirations, voilà déjà l’heure de la seconde table ronde et d’un deuxième café pour tenir la digestion et la curiosité éveillée. Venues des quatre coins de la France, les professionnelles racontent : expériences sensibles et touchantes, parfois éprouvantes, souvent enrichissantes, autant de façons d’incarner la logique du « faire avec », si chère aux écomusées et musée de société, où l’on construit ensemble, dans l’écoute et la présence.
Cette fois, c’est Mme Aurélie Prévost, responsable de la médiation culturelle et de la communication du musée de l’AP-HP, qui prend la parole. Créé en 1934, ce musée d’institution et de société retrace l’histoire de la santé et du soin dans la région parisienne. Ses 13.000 objets, témoignent de l’évolution du regard porté sur la maladie, le corps et la solidarité. Depuis 2012, le musée n’a plus de lieu d’exposition permanent. C’est dans ce cadre qu’est né un partenariat avec l’Unité de Rééducation des Troubles du Langage et de l’Apprentissage (URTLA) de l’hôpital Bicêtre. Pendant cinq séances, les classes de sept enfants de 8 à 12 ans ont pu découvrir les réserves du musée, explorer des expositions temporaires hors-les-murs, réaliser des ateliers créatifs, réécrire des cartels et enfin restituer leur réalisation devant leurs proches et les soignants. Il y a dans ce projet une volonté d’adaptabilité à tous les élèves présents, de valoriser leur parole et leur sens de déduction afin de reprendre confiance en leurs capacités.
La parole passe ensuite à Mme Fanny Roilette, attachée de conservation du patrimoine et directrice du musée des Manufactures de Dentelles de Retournac en Haute-Loire. Installé dans une ancienne manufacture active de 1913 à 1997 et ouvert au public depuis 2007, le musée raconte l’histoire d’un savoir-faire local : la dentelle aux fuseaux. En 2022, le musée a porté le projet « Rosea », une initiative mêlant culture, santé et solidarité. Le projet comportait une exposition de photographies de femmes atteintes d’un cancer du sein, la création et vente de rubans en dentelle au profit de la Ligue contre le cancer, des ateliers de couture (coussins-cœur et Lovely Bags[2] ), ainsi qu’une conférence autour des liens entre nutrition et cancer. Dans ce lieu où les fils s’entrelaçaient, la dentelle devient métaphore : la précision d’un geste, la patience d’un tissage, la force tranquille d’une communauté solidaire.
Puis vient Mme Barbara Laigle, du musée de la Céramique - Centre de création, à Ger, au cœur du bocage normand. Installé sur un ancien site de production, le musée célèbre la poterie de grès traditionnelle tout en accueillant des formes contemporaines et participatives. Ici, l’argile devient langage commun, matière de transmission entre générations, milieux et vécus. Le musée accueille des publics éloignés des institutions culturelles, personnes en situation de handicap, aînés en EHPAD, familles accompagnées par le champ social, femmes précaires, adolescents en rupture scolaire. Les ateliers sont co-construits avec des professionnels médico-sociaux, autour d’un principe simple : prendre soin par la matière. Les projets d’œuvres communes, parents-enfants, jeunes-aînés, invitent à recréer des liens, à partager des souvenirs heureux. Les ateliers cosmétiques à base d’argile, écologiques et faciles à refaire chez soi, rappellent que le soin peut aussi être un temps d’échange et de répit. Ici, le savoir-faire devient une éthique de la relation, une façon de redonner place, valeur et beauté à chacun.
Enfin, Mme Claire Laurenzio, médiatrice culturelle du Museon Arlaten, à Arles, partage un dernier exemple. Ce musée d’ethnographie, fondé en 1896, interroge le territoire, les identités et la mémoire provençale. Le projet présenté, mené à l’automne-hiver 2023-2024 en partenariat avec l’association La Collective et l’artiste Hélène Riff, interroge : « Quelles transmissions se réalisent entre femmes, d’une génération à l’autre, d’un récit à l’autre ? » Quinze participantes ont partagé huit séances de rencontres et de création, au musée et hors-les-murs. Elles ont choisi la broderie comme mode d’expression, détournant cette technique traditionnelle en un geste subversif, pour dire leur place, leurs mémoires, leurs luttes. Le musée devient un espace de parole, un atelier d’émancipation où l’on recoud son histoire et celle des autres. À travers le fil, les femmes inscrivent leurs voix dans le tissu du territoire : elles prennent fierté et valeur dans leur récit de vie.
Une question finit par éclore au milieu de l’assemblée : tous ces projets, aussi justes, aussi attentifs soient-ils, ne risquent-ils pas de séparer davantage les publics, de créer des cercles clos plutôt que des lieux partagés ? Qu’en est-il du « faire ensemble », du mélange des expériences et des rencontres ? Nos quatre intervenantes se regardent, leur réponse est nuancée : tout dépend du besoin du public. Certains ont soif de lien, d’autres de retrait. Pour certains, la présence de l’autre effraie ; pour d’autres, elle soigne. L’intimité n’est pas toujours un enfermement : elle peut être un premier pas vers la confiance, un temps de respiration avant de retrouver le monde. Elles rappellent aussi, avec sincérité, que ces projets ne laissent pas indemnes celles qui les portent. Ces médiations sont des traversées d’émotions, des rencontres parfois bouleversantes. Elles demandent un temps pour soi, avant et après, pour laisser retomber les échos et reprendre souffle.
Une table-ronde de la journée professionnelle © É. V.
Mais déjà, le soleil s’incline derrière les vitraux de la salle, avec lui vient le temps des questions plus rugueuses, des doutes et des limites. Car si le care éclaire, il peut aussi hésiter. On évoque alors d’autres horizons, plus lointains : la Suisse, les Yvelines… Des projets y ont connu des obstacles, des lenteurs, des incompréhensions. C’est notamment le cas des « ordonnances muséales », ces initiatives où le soin et la culture cherchent à dialoguer, sans toujours trouver le ton juste ou le cadre adapté. M. Guirec Zéo reprend place pour modérer l’échange, entre M. Pierre-Marie Vautier, des Yvelines, et Mme Marianne de Reynier Nevsky, de Neuchâtel. Deux territoires, deux contextes, mais une même ambition : faire dialoguer culture et santé. Dans les Yvelines, le programme « Solimusées » marque une semaine entière de sensibilisation au handicap. Un spectacle ouvre l’espace des émotions, ainsi que la distribution de carnets de chéquiers de prescriptions muséales, petites invitations à pousser la porte d’un musée comme on prend une bouffée d’air. Mais les limites s’imposent vite, le dispositif veut rester simple, lisible et pourtant : 170 carnets distribués, très peu utilisés. Ce décalage interroge. Peut-être faut-il aussi accompagner les professionnels de santé, donner du sens à l’outil, le légitimer dans leurs pratiques ? Car les collectivités, soumises aux impératifs de résultats, veulent des retours concrets. La culture n’étant pas une « compétence » obligatoire, elle doit sans cesse prouver sa valeur pour survivre dans les budgets.
À Neuchâtel, l’histoire se répète, sous une autre lumière. Après le Covid, des fonds cantonaux permettent le lancement des ordonnances muséales[3], mises en place en février 2025. Mais là encore, le constat tombe comme un souffle court : sur 500 chèques distribués, seuls 5 reviennent au musée. Une hypothèse traverse la salle : la crainte d’être nommé, étiqueté « malade » au moment même où l’on tend le chèque à l’accueil[4]. La peur de voir son intimité devenir visible. Car si le musée peut apaiser, l’entrée en dit parfois trop sur celui qui la franchit. Ces projets inachevés, ces élans freinés, laissent une impression douce-amère. Ils rappellent pourtant une évidence essentielle : la santé n’est jamais l’affaire d’un seul corps, mais d’une communauté entière. Et peut-être est-ce là la leçon de ces expériences hésitantes : que pour faire du musée un espace de soin, même symbolique, il ne suffit pas de prescrire une visite. Il faut tisser de la confiance et réapprendre ensemble à habiter un lieu, non comme malade, non comme public fragile, mais comme individu singulier.
La journée s’achève dans de chaleureux applaudissements alors que le soleil a presque disparu. Le care continue de prendre place même une fois les portes du musée refermées.
Éléa Vanderstock
[1]Des séances d’art thérapie ont été proposées par le Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM, Canada) dès les années 2010 : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2591-prescriptions-museales-vers-le-soin ↩
[2]Le lovely bag est cousu par des femmes pour soutenir d'autres femmes qui font face à une chirurgie à la suite d'un cancer du sein. Il permet de mettre les drains (longs tubes qui relient la zone opérée à des bouteilles pour évacuer les sécrétions, les drains sont présents après une ablation de la poitrine). ↩
[3]Le MBAM fut également précurseur dans cette pratique, dès 2018. ↩
[4]A propos des ordonnances muséales à Neuchâtel (Suisse) : https://www.plateforme-mediation-museale.fr/mediations/les-ordonnances-museales-l-art-au-service-du-bien-etre ↩
#LeMuséequiSoigne #SociétéduCare #CaringMuseum #Muséothérapie
Pour en savoir plus :
Restitution prochaine de la journée professionnelle : http://lesneufsdetransilie.fr/
Guirec Zéo, « Pratiquer le care au musée », La Lettre de l’OCIM [En ligne], 207 | 2023, mis en ligne le 01 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/ocim/6040

Cela aussi passera
La question du temps qui passe et la question de sa trace turlupine d’autant plus lorsque l’on se destine à travailler dans un musée. Oh oui, de biens grands maux, sur lesquels on pose des grands mots souvent bien maladroits pour en extraire une maxime nébuleuse pseudo-hautement philosophique sur le Sens de la Vie.
« Diantre ! Cette scélérate a cru nous avoir avec sa cynique litanie ? La bougresse se terre derrière un style enlevé, digne d’un post aguicheur putaclic, et tergiverse avant de se lancer»
Mettons ces atermoiements sur un probable trop grand gavage de proverbes en papillotes. Loin de moi l’idée d’être une reine de la prose qui va résoudre la Grande Question muséale en quelques XXXX caractères mais tant pis, je me lance.
Les musées, ces temples du savoir, gardiens des reliques de l’Humanité, passeurs d’enseignements du passé, et à l’occasion de valeurs idéalistes.
Un musée, dans l’imaginaire collectif, c’est notamment la Conservation. Une accumulation de pièces de toutes sortes et de toutes valeurs, transformant le lieu en une caverne d’Ali Baba, un cabinet de curiosités emplis de mystères, d’objets rendus fabuleux. Mais au fond,
si Tout finit par se désagréger, puis par disparaître,
à quoi bon vouloir laisser une trace,
retranscrire, transmettre ?

Vue de l'Artothèque de Mons ©Bruynzeel.fr
La vie tient dans des boîtes
Tout est question de contenu dans des contenants.
Pourtant, il est étonnant de voir qu’un contenu
puisse être contenant
de tant de contenu.
Contenu qui, contient tant
de contenus détenu :
Récoltés, accumulés, collectés, collectionnés,
dépossédés de toutes fonctions ou identités,
Ces contenus, plus ou moins involontairement
sont oubliés.
Bien souvent aux dépens
d’une collection bien constituée,
d’une muséographie sélectionnée.
Caché, masqué, dissimulé,
ces contenus sont contenants de secrets sciemment gardés,
autant par leurs premiers possesseurs
que par leurs derniers acquéreurs.
Parfois trop difficiles à céder,
souvent trop difficiles à intégrer
à l’analyse gracile d’un programme bien ficelé.

Espace Bazars - Collection Bozzini ©Alain Germond / Musée d’ethnographie de Neuchâtel
Dans l’Histoire comme au musée
tout n’est qu’interprétation
de faits, d’objets éloignés.
Elle nous est simplement rédigée, présentée
Sans savoir si son orientation
est dirigée ou non.
En bon curieux, il faut toujours remettre en question
la valeur et la véracité d’une information.
Dans l’Histoire, comme au musée,
tout n’est que fragmentation
de ce qui fut un jour notre présent.
Un même sujet peut être traité à foison,
sans jamais l’épuiser,
tant il a de facettes encore non explorées.
Mais la sélection ne permet plus
le débordement du contenu.
Et l’inverse laisse totalement décontenancé
le curieux en quête d’une bribe du passé.

Vue de l’Artothèque de Mons ©L’art de Muser
À l’ère du numérique, où l’homme ne cesse plus
de créer en continu
des quantités de contenus,
traces, souvenirs et données
comme jamais il n’en avait eus ;
De tous ces maigres témoignages,
très bientôt hors d’usages,
d’un temps révolu,
Jamais, il n’en a autant perdu.
À l’ère du numérique, où tout est question
de bits, de place,
qu’en est-il de la conservation
de cette immatérielle trace ?
Que doit-on placer
dans les collections du musée ?
Le fichier originel ?
Une reproduction fidèle ?
Cette manie de la conservation,
de la pérennité, de l’immortalisation,
n’est-elle pas absurde, quand on sait que tout tend
- inévitablement -
vers la disparition ?
À quoi bon ?
Ozymandias
Le musée délivre aux objets une durée de vie plus longue que les personnes qui viennent les observer. La patrimonialisation confère une forme d’éternité ou du moins de pérennité.
Vouloir laisser une trace à travers les années qui passeront après nos morts revient à se battre contre le phénomène même qui est à l’origine du temps. Sans cette dispersion inéluctable de la matière, il n’y aurait aucun message à faire passer au futur, car il n’y aurait pas de nécessité à laisser un témoignage. Aucun objet, événement ou connaissance que l’on essaye de sauvegarder de la destruction n’existerait sans cette destruction. L’impermanence des choses est une propriété fondamentale de l’univers, que les musées auront toujours à apprivoiser.
Parce que tout passe, même le passé.
À quelques heures de la clôture de l’appel à la participation du projet Keo – satellite/time-capsule rassemblant des témoignages à destination du futur– peut-être qu’en transmettant une partie de ces questions, elles y trouveront un jour des réponses. Ou peut-être mieux : au contraire, elles paraîtront nébuleuses, fictionnelles, désuètes. Les musées auront-ils encore lieu d’être ? Seront-ils encore des lieux réels ou virtuels ? Chercherons nous à retourner au matériel, à un espace concret ? Nos écrits seront-ils les rares traces d’improbables reliques ?
JR
#impermanencedeschoses
Pour aller plus loin :
-L’impermanence des choses, la collection permanente du Musée Ethnographique de Neuchâtel : www.men.ch/fr/expositions/la-villa/
- Comment cette capitale s’est évaporée,par Léo Grasset sur DirtyBiology : www.youtube.com/watch?v=nEx2lQyfSlc&t=32s
- Quelle trace voulez-vous laisser ? Le projet Keo : www.keo.org
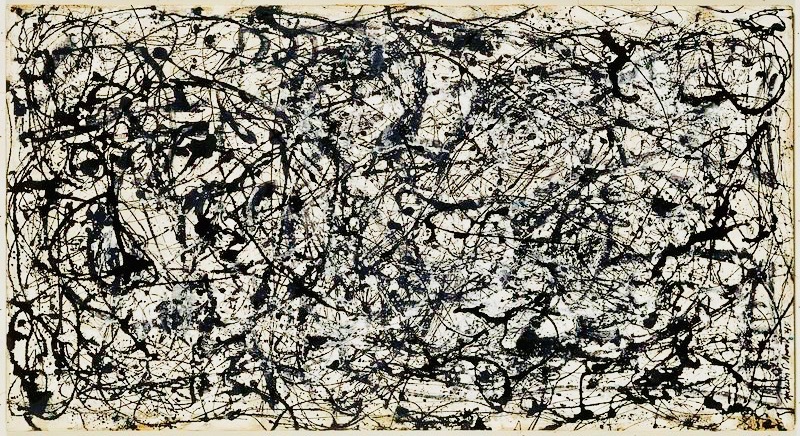
Ceux qui savent, et les autres
La démocratisation culturelle est, depuis les années 1980 en France, un combat que les musées entendent mener en rendant leur établissement inclusif - le mot d’ordre des services des publics - afin de toucher le plus grand nombre. On démocratise, on vulgarise, on donne accès à, on veille à s’éloigner de toutes formes de savoir descendant… Entre “grand public” et “public éloigné”, nos cœurs vacillent. Tout, ou presque, est mis en place pour accueillir le public le plus vaste et le plus diversifié. Pour autant, pouvons-nous affirmer, quarante ans après, remplir ces missions, et ce, sans aucun dévoiement ?
Je sais mieux que toi
Décembre 2017, j’ai l’occasion d'intervenir dans une classe de CM2 de Villiers-le-Bel (Val d’Oise), pour leur parler de la Culture et du musée qu’ils vont bientôt visiter, le château d’Ecouen. Pas encore diplômée, je me demande : que dit-on, à des enfants de cet âge ? Il n’est évidemment pas question de passer deux heures sur Alberti, la perspective... Le château d’Ecouen est surtout connu par son autre nom, le musée national de la Renaissance. Si je ne me sens alors pas à même de vulgariser les arts de la Renaissance, je m’aperçois que des mots “musée” et “national” me viennent une multitude d’idées et de questionnement. Je réalise que je suis davantage intéressée par ce qu’ils ont à m’apprendre plutôt qu’à ce que j’ai à leur délivrer.
“Qui est-ce qui a le droit d’aller au musée ?” Tout le monde ! Bien sûr ! C’est ce qu’ils me disent immédiatement.
“Et qui a le droit de dire son avis sur ce qu’il y a au musée ?”
Pêle-mêle, ils me répondent : “les adultes”, “ceux qui savent”, “qui ont fait des études”, “vous” !
La diapositive suivante est prête à semer la confusion. Je leur montre alors une reproduction de 26a Black and White de Jackson Pollock, et après un petit moment, je leur dis :
“Je déteste”.
Celles et ceux qui avaient osé dire qu’ils appréciaient se regardent, gênés que la détentrice du savoir, selon eux, ait un avis foncièrement contraire au leur.
“Moi j’adore, ça me fait toujours quelque chose de voir ça.”
Malheur, voilà que leur maîtresse n’est pas d’accord avec moi. Comment se peut-il que les deux garantes de la connaissance ne disent pas la même chose ? Est-ce que toutes les réponses sont bonnes ?
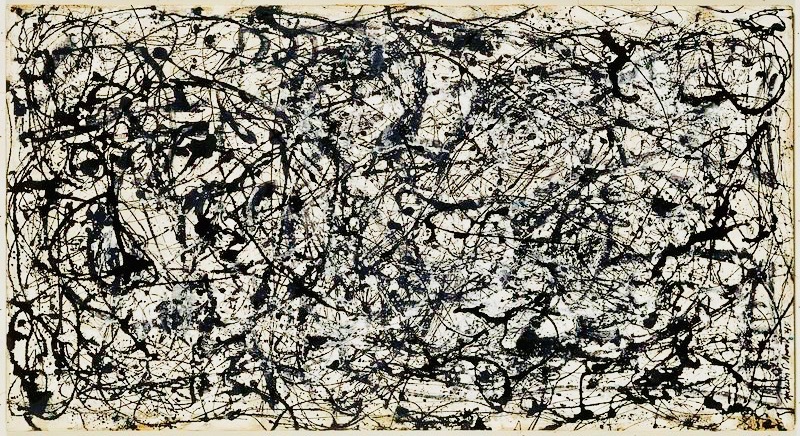
26a Black and White, Jackson Pollock, 1948, 205 x 121,7 cm
La culture est à toutes et tous
Février 2020, plus de deux ans ont passé, mais cette médiation accompagne toujours mes réflexions sur le métier que je souhaite exercer puisque c’est le moment où j’ai véritablement été confrontée à cette réalité : il y a ceux qui savent, et il y a ceux qui ne savent pas.
Pire encore : il y aurait ceux qui ont le droit de dire ce qu’ils ressentent face à une œuvre, et les autres. La culture est parvenue à supplanter la subjectivité au profit d’une “science exacte”. Telle œuvre est digne d’intérêt, telle autre est une vulgaire croûte. Cet opéra est une merveille, ce concert une torture pour les oreilles. Ce film ? Un chef d’œuvre ! Celui-ci ? Qui se contente de ces blockbusters sans émotion ?
L’histoire de la Culture est ponctuée de moment où l’on a décidé de constituer des instances dignes de décider ce qui est, ou non, de l’Art. L’Académie des Beaux-Arts décidait de mettre en lumière certains artistes au détriment d’autres, comme le font encore aujourd’hui des critiques d’art ou commissaires d’expositions. Cette émission encense tel chanteur et dans le même temps des personnalités dites cultivées hiérarchisent les goûts cinématographiques. Un sentiment de honte entoure alors les malheureux qui diront, devant la mauvaise personne, n’avoir jamais lu un seul roman de Balzac.
Cette critique n’est alors pas propre au musée, elle s’ouvre à tous les champs de la culture, et s’étend même au-delà. En laissant planer l’ombre de la pensée légitime, on prend le risque de retirer tout esprit critique par la réduction au silence des pensées et ressentis de chacun. On ne s’interroge plus, nous ne sommes pas en mesure d’émettre un avis qui vaille d’être défendu, sur l’Art ou la société. À l’heure où l’Académie représentant le septième art en France émet, par ses récompenses, un avis discutable sur la Culture, il est temps plus que jamais d’entendre les voix de toutes et tous.
Ainsi, que nous soyons médiatrice, muséographe ou toute autre professionnelle de la culture, nous avons la possibilité de déconstruire cette légitimité, de l’ouvrir à la diversité et au dialogue.
Jade Garcin
#culturalstudies
#démocratisation
#légitimité

Chemins de traverse : L’école muséographique buissonnière
Enfilez vos chaussures de marche ! Munissez-vous de votre crème solaire indice 50, enfournez les barres énergétiques dans votre sac à dos et rechargez votre gourde ! Surtout les amis, n’oubliez pas votre carte IGN… Vous êtes fin prêts ? On part à la rencontre de l’art contemporain !
À l’évidence, vous aimez la randonnée au cœur de grands espaces naturels préservés, la création contemporaine est votre péché mignon et en même temps vous êtes férus de patrimoine rural… Diable, cinq semaines par an ça n’est décidément pas suffisant… que choisir et comment faire pour réunir vos trois violons d’Ingres ? Tendez l’oreille, il existe des endroits fabuleux qui sont faits pour vous. Lacez vos chaussures et en route, nous partons à la rencontre de l’un d’entre eux !

Sentinelle d’Andy Goldsworthy dans Vallée de l’Asse, Tartonne © Brigitte PÉTRÉ
Nature, culture et territoire : le triptyque fertile
Prenez une grande inspiration. Vous sentez l’air des montagnes dignoises qui fait frétiller vos narines et réactive vos sens endormis par les pollutions quotidiennes. Allez, prenez une gorgée d’eau fraîche, le chemin sera long et levez le nez, les paysages sont exceptionnels.
Petits veinards, vous êtes au cœur de la Réserve naturelle géologique de Haute-Provence. Ici, prière de ralentir. À contre-courant de l’effervescence des musées et de la boulimie de l’art, le projet artistique Refuge d’Art est né d’une heureuse association entre le musée Gassendi, la Réserve naturelle géologique de Haute-Provence et l’artiste britannique Andy Goldsworthy. Réalisé entre 1998 et 2010, ce parcours d’art contemporain de 150 kilomètres est ponctué des œuvres de l’artiste, il s’articule autour de trois sentinelles et sept refuges d’art réalisés au sein d’anciens bâtiments à l’abandon (chapelle, bergerie, grange, etc.). Certains d’entre eux sont équipés de dortoirs pour abriter, le temps d’une nuit, les randonneurs de passage.
« À cause des distances entre les refuges d’art, j’ai suggéré de restaurer d’anciens bâtiments afin que les gens puissent y passer la nuit, tout en intégrant une sculpture dans la rénovation. Pour moi, il existe une différence fondamentale entre l’œuvre d’art que l’on regarde quelques minutes dans un musée et l’œuvre avec laquelle on vit pendant un peu de temps, avec laquelle on dort. Dormir dans une sculpture, c’est une idée merveilleuse. »
Andy Goldsworthy

Chapelle Sainte-Madelaine, Toard © Musée Gassendi

Refuge d’Art, Vieil Esclangon © Musée Gassendi
La réhabilitation de ce patrimoine rural témoigne de la dimension sociale et économique du projet d’Andy Goldsworthy. Effectivement, en donnant une seconde vie à ces villages abandonnés, l’attrait touristique de la région s’est largement développé permettant ainsi de favoriser et de consolider des emplois locaux. L’art en chemin est l’association qui vise à valoriser et mutualiser ces activités professionnelles régies par les mêmes valeurs : « solidarité territoriale, lien social, coopération et respect » selon Pascal Bodcher, accompagnateur en montage. L’idée est d’accompagner un tourisme durable pour préserver la vallée tout en y développant des activités culturelles transdisciplinaires.
Cette œuvre d’art est à parcourir en une dizaine de jours de marche mais pour les moins téméraires, pas de panique ! Des randonnées de 1h30 à 6h sont réalisables à la journée avec des niveaux de difficulté accessibles à tous. Vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas partir à la rencontre de la poésie du travail d’Andy Goldsworthy.
Je profite que nous foulions les sentiers des alentours de Digne-les-Bains pour vous informer qu’outre ce projet monographique, le musée Gassendi s’attache depuis 1995 à constituer sur cette même réserve une collection d’œuvres d’art à ciel ouvert. Divers artistes contemporains tels que Richard Nonas, herman de vries, Mark Dion, Joan Fontcuberta, Paul-Armand Gette et d’autres ont travaillé in situ en symbiose avec les montagnes pour offrir leur propre lecture du lieu. Le musée propose aux visiteurs une approche de ces œuvres à travers vingt suggestions de randonnées, éditées en 2012 dans le livre L’art en marche.
Allez, on s’arrête un moment à l’ombre d’un cairn pour reprendre notre respiration et on y retourne pour comprendre pourquoi on marche autant depuis tout à l’heure.
« La marche comme médiation sur le paysage » : une expérience totale
« Dans l’acte de marcher, il y a le déplacement d’un pont à un autre, mais il y a surtout un effort, une intention, qui rendent la découverte de chaque œuvre plus intense et intime. »
Nadine Gomez, Conservatrice du musée Gassendi et directrice du CAIRN.
La proposition artistique d’Andy Goldsworthy organisée autour de stations nécessite, vous l’avez compris, un visiteur mobile qui réalise malgré lui une performance. C’est l’expérience de la marche qui fait art plutôt que la sculpture qui n’est finalement qu’un prétexte pour ressentir et faire corps avec le paysage dans lequel nous évoluons. Ces cairns, ces serpentins dans la terre, ces sculptures de pierres, ne sont que des invitations à ralentir et réfléchir à l’action de l’Homme sur le paysage. La marche est alors le moyen d’opérer cette prise de conscience chez le marcheur-visiteur qui est, à cet instant, intimement lié à l’écologie des montagnes dignoises.
L’artiste a filé la métaphore à la Longside Gallery avec une proposition artistique, Mud ball, présentée en 2007 et 2008 pour les trente ans du Yorkshire Sculpture Park. Cette œuvre d’art, tel un work in progress, est composée jour après jour des débris végétaux (herbe, feuilles, boue) apportés par les chaussures des visiteurs, vestiges de leur traversée du bois et des prairies du parc. Matérialisée, amassée et totémisée dans une grosse boulle de boue, la marche des milliers de visiteurs-marcheurs est l’expression la plus littérale de cette idéologie selon laquelle l’expérience du visiteur crée l’œuvre.
Ainsi, ne me demandez pas « c’est quand qu’on arrive ? », vous savez que l’important n’est pas le but mais le chemin.
Un concept qui fait des petits
Alors bien sûr, vous allez me dire que cette idée de marche dans l’art n’est pas nouvelle et que des artistes comme Richard Long, Francis Alÿs ou bien Marina Abramović l’ont exploitée depuis fort longtemps. Mais à l’heure où la randonnée n’a jamais été autant à la mode et où la population fait ressentir un réel « besoin de nature », ces parcours d’art contemporain en pleine nature fleurissent un peu partout en France et ce sont alors les visiteurs qui se mettent en mouvement.

Grand Lineux#2 de Xavier Rèche, Parcours des Fées, 2016 © Photodicidela
Non loin de Refuge d’Art et du musée Gassendi, la Via Per l’Art Contemporanea (VIAPAC) est un sentier de randonnée transfrontalier de 200 kilomètres servant de jonction touristique entre les villes de Digne-les-Bains en France et Caraglio en Italie. D’envergure européenne, le projet rassemble les travaux d’une douzaine d’artistes contemporains dont Joan Fontcuberta, Paul-Armand Gette, Stéphane Bérard, Mark Dion, Richard Nonas et bien d’autres. On peut encore une fois déplorer le fait que ces artistes de la scène contemporaine se conjuguent seulement au masculin bien que les femmes fassent partie intégrante de ces recherches informelles sur la nature et l’art. Je vous invite à consulter le bel ouvrage de Virginie Luc, Les magiciennes de la terre édité en 2017, qui fait la lumière sur le travail de 17 d’entres elles.
D’autres parcours d’art contemporain accueillent à l’année les randonneurs curieux adeptes de la marche culturelle à l’image de La Forêt d’Art Contemporain dans le Parc Naturel des Landes de Gascogne ou encore Le Vent des Forêts. Implanté dans la Meuse depuis 1998, il constitue l’un des plus anciens « espace rural d’art contemporain » avec 70 bénévoles et 45 kilomètres de sentiers balisés. Chaque année, des artistes plasticiens en résidence étoffent la collection constituée à ce jour de plus de 90 installations.
À l’image du Voyage à Nantes, les territoires ruraux semblent avoir trouvé la parade pour rendre attractif leur territoire et redynamiser leur économie : une installation artistique in situ par-ci par-là le long de sentiers et le tour est joué ! Chaque été, pléthore de festivals d’art contemporain ouvrent leurs portes dans nos vallées et nos campagnes. J’ai choisi de vous présenter l’un d’entre eux qui a une forte dimension sociale et qui s’inscrit réellement dans une démarche de démocratie culturelle.

Installation dans les 5000 hectares du Vent des Forêts © COAL
Située dans la vallée de la Drobie au cœur du Parc Régional des Monts d’Ardèche, cette initiative est née des habitants et des promeneurs qui se désolaient de voir se désertifier leur paysage. De leur union jaillit un projet collectif, Sur le sentier des Lauzes, pour la création d’une « Vallée Culturelle ». Une repartie finement orchestrée contre le douloureux exode rural. Tout en encourageant et en accompagnant les contacts entre habitants, artistes et paysages, l’association a développé des résidences d’artistes qui, chaque année, contribuent à la réalisation d’un Parcours d’Art en Paysage. Une pierre deux coups ! Cet événement fédère les locaux au territoire en leur proposant un renouvellement culturel et attire des touristes avides de découvrir la vallée de manière singulière. Des touristes qui consomment et qui réenclenchent l’économie locale bénéfique aux habitants qui résident sur le territoire. La boucle est bouclée. Ces actions sont menées avec un réel respect de l’environnement et accompagnées d’une réflexion sur l’impact de ces projets par rapport à l’unité des paysages naturels. Une question épineuse qu’il serait imprudent d’ignorer.

Parcours des Fées, octobre 2015 © Serge San
Cette association n’est pas la seule à briller par sa démarche artistique et sociale, à 200 kilomètres à l’est, par exemple, dans la vallée de Crévoux, le Parcours des Fées organisé par l’association Fées d’hiver fait également partie de ces acteurs qui préfèrent « faire ensemble » plutôt que « pour ».
J’espère que vous en êtes maintenant convaincus. La création contemporaine en zone rurale est pleine de ressources quand elle est une manière de nous révéler l’enchantement de nos campagnes et le charme naturel de ses habitants.
Si vous n’en avez toujours pas plein les gambettes, prenez note des prochains rendez-vous de l’été 2019 et venez marcher l’art contemporain. Alors oui, peut-être, vous sentirez un peu plus la transpiration à la fin de votre sortie culturelle mais que diable, nous sommes corps et esprit indissociables, tâchons d’en prendre soin et de les nourrir simultanément le plus souvent possible.
Pour plus d’informations :
- Refuge d’Art : http://www.refugedart.fr
- VIAPAC : http://www.provence-alpes-cuneo.eu/fr/culture/viapac.html
- La forêt d’Art Contemporain : http://www.laforetdartcontemporain.com
- Le Vent des Forêts : http://ventdesforets.com
- Sur le sentiers des Lauzes : http://surlesentierdeslauzes.fr
- Parcours des Fées : http://parcours-des-fees.fr
D’autres parcours d’art contemporain à marcher en France :
- Les bords de la Vire (Manche) : http://www.usine-utopik.com/festival/
- Arras Artitude : http://arras-artitude.fr/fr/accueil/
- Parcours d’art contemporain en vallée du Lot : http://www.magcp.fr/project/measure-the-valleysparcours-dart-contemporain-en-vallee-du-lot01-07-02-09-2018/
- Horizons – Art et Nature en Sancy (Auvergne – Rhône-Alpes) : https://www.horizons-sancy.com
- Les balcons de l’Aigoual (Haute vallée de l’Hérault – Parc national et Cévennes) : https://www.lafilaturedumazel.org/parcours-land-art-les-balcons-de-l-aigoual/
- Aux bords des paysages, Pic Saint-Loup (Occitanie) : https://www.auxbordsdespaysages.com
- Vassivière Utopia (Creuse – Haute Vienne) : https://www.lamontagne.fr/saint-martin-chateau/environnement/creuse/2018/09/26/comment-le-centre-d-art-dessine-le-paysage-avec-son-programme-vassiviere-utopia_12994407.html
Christian Lacroix relooke le musée !
En déambulant dans le quartier du Marais à Paris, on peut trouver de quoi satisfaire sa curiosité muséale ; musée Picasso, musée Carnavalet, maison de Victor Hugo sur la Place des Vosges... Mais aujourd’hui, je vous parle d’un musée plus intimiste et moins célèbre que ses illustres voisins : le musée Cognacq-Jay ou musée des arts du XVIIIe siècle.Ce musée de la Ville de Paris est installé dans un magnifique hôtel particulier, l’hôtel Donon, bâtisse historique du quartier du Marais et héberge les collections du fondateur des magasins La Samaritaine, Ernest Cognacq et de sa femme Louise Jay. Cette collection exceptionnelle rassemble des peintures,des arts graphiques, du mobilier, des arts décoratifs et des sculptures du XVIIIesiècle sur les cinq niveaux de ce musée fraîchement réhabilité.

Le musée Cognacq-Jay - Crédits photographiques : Paris Musées
La visite semble déjà alléchante et elle l’es td’autant plus quand on apprend que Christian Lacroix en personne a investi le musée pour plusieurs missions. Le musée lui a donné carte blanche pour renouveler le fil rouge de l’exposition permanente à travers la thématique du costume, chère à cet artiste, et pour assurer le commissariat d’une exposition temporaire. Cette exposition « Lumières,carte blanche à Christian Lacroix » confronte une sélection d’œuvres du XVIIIe siècle de la collection Cognacq-Jay à des œuvres de quarante artistes contemporains, parmi lesquels Tim Walker, John Currin ou encore Glenn Brown, le tout intégré au circuit permanent. Dix thématiques jalonnent ce parcours qui permet au visiteur de mieux appréhender l’esprit des Lumières et son importance toujours d’actualité au XXIe siècle.
Parmi les séquences proposées, « Paris, capitale des lumières », « Economie artistique de l’Europe » ou encore« Musique, spectacles et danse ». L’accrochage est très libre,surchargé dans certaines salles et aéré dans d’autres, « pas académique » selon Christian Lacroix. Toujours selon l’artiste, « le but étant de suggérer la parenté entre artistes du XVIIIe et du XXIesiècle, la continuité d’un certain esprit, la permanence d’une époque et la pérennité des thématiques du siècles des lumières dans notre propre univers». Cela permet aux amateurs d’art du XVIIIe comme aux amoureux d’art contemporain de se rencontrer et de se confronter, d’apprendre et de faire des découvertes étonnantes sur les liens entre le siècle des Lumières et notre époque.
Paire de chaussures, © Manolo Blahnik, 1942 – Paire de souliers, Anonyme, 1778 - Crédits photographiques : LT
La « salle rose » du musée au troisième étage est l’une des plus réussies tant au niveau de la confrontation des œuvres que du discours tenu. La séquence « Théoriser la pédagogie » présente une confrontation entre des peintures de représentations d’enfants et des photographies contemporaines, et une vitrine où les figurines en porcelaine du XVIIIesiècle côtoient une poupée Barbie et autres jouets du XXesiècle. Le tapis au sol est également une création de Christian Lacroix inspiré de motifs d’un gilet du XVIIIe siècle. Cet étage présente plus largement des séries de portraits de l’enfance à l’âge adulte sur plusieurs séquences en comparant l’art du portrait au siècle des Lumières avec celui du XXIesiècle.
Séquence "Théoriser la pédagogie" Crédits photographiques : LT
Photographie 1 : Les dénicheurs, Bird, 1800-1810 - Sans titre, Bettina Komenda,
Photographie 2 : Tapis Christian Lacroix
Photographie 3 : Portrait de Louis-Antoine de Bourbon, duc d'Angoulême, Bounieu, 1776-1777 - La Petite Souris, série Les grands moments de la vie, Véronique Ellena, 1995-1997
Photographie 4 : Quatre jeunes musiciennes, Kaendler, 1760 - Happily ever after, Barford, 2009 - Barbie spécial anniversaire, 1991
La patte de Christian Lacroix est partout et s’intègre parfaitement aux boiseries de l’hôtel Donon ; le couturier a également créé des moquettes et des voilages et repeint certaines salles du musée,créations vouées à la pérennité. Il est alors facile de se sentir hors du temps entre les murs de cette bâtisse historique entouré d’objets du XVIIIe mariés à des œuvres contemporaines rassemblées dans un cabinet de curiosités.L’artiste-commissaire réussit pleinement sa mission première de recréer une ambiance de visite et d’intégrer ses créations au parcours de la collection permanente. De plus, ses somptueuses moquettes d’inspiration XVIIIeque le visiteur foule au gré des salles valent à elles-seules la visite.

Photographie 1 : Moquette et murs Christian Lacroix - Photographie 2 : Voilages Christian Lacroix– Crédits photographiques : LT
Seul bémol, ce format d’exposition est flou et peut décontenancer le visiteur ; en effet les multiples missions données au couturier ne sont pas clairement expliquées au début de la visite et il est difficile de rentrer dans l’univers du musée et de l’artiste au premier niveau, qui est peu explicite et moins réussi que les autres espaces. Je n’ai pu appréhender le fil de cette exposition qu’à partir du deuxième niveau, notamment avec la très belle salle « Exotismes » où la confrontation des œuvres est évidente.En revanche, la thématique du costume m’a paru s’effacer au fil des salles pour devenir presque secondaire et « décorative » mis à part dans la séquence « Le modèle antique » où les trois robes créées pour La descente d’Orphée aux enferss’intègrent parfaitement.
Heureusement, en l’absence de guide de visite, le musée a créé une application pour cette exposition. Tel un véritable audioguide, cette application apporte beaucoup de contenu à l’exposition et surtout des explications qu’il serait difficile de trouver par soi-même. Bien conçue et facile d’utilisation, elle est un véritable plus pour cette exposition pensée par Christian Lacroix. Le couturier relève le défi haut la main et il est réjouissant de penser que certaines de ses créations au sein du musée, comme ses moquettes et voilages, pourront être admirées sans limite de temps !
LT
Lumières: Carte blanche à Christian Lacroix
Du 19 novembre au 19 avril 2015
Musée Cognacq-Jay
Rue Elzevir
75004 Paris
Pour aller plus loin :site du musée Cognacq-Jay
#Lacroix
#exposition
#XVIIIe
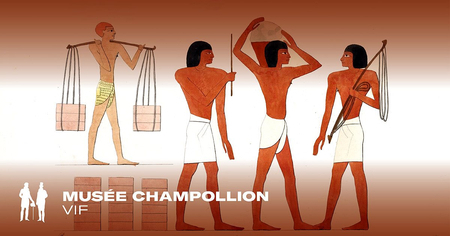
Chroniques d’une ouverture : le Musée Champollion à Vif
Épisode 1 : annonces
Dans le prolongement de la rue commerçante de Vif, petite commune du Sud-Grenoblois, on trouve un bâtiment 19ème avec un mur aveugle où apparaissaient, encore il y a peu, des hiéroglyphes. Non loin de là, sur la petite Place des onze Otages la pizzéria s’est appelée, un temps, le Kheops. Puis les propriétaires ont changé, le nom à consonance égyptienne du restaurant aussi. Parfois, les locaux désignent la bâtisse comme « le Musée Champollion ». Certains se souviennent l’avoir visité en famille, un dimanche après-midi. Les plus jeunes se rappellent seulement les jardins, une grande étendue verte où stylo bille dans une main, réglette pochoir dans l’autre, ils s’étaient appliqués à tracer leurs prénoms en symboles égyptiens.
C’était il y 15 ans, en 2004. La maison du frère de Jean-François Champollion - Jacques-Joseph, également intellectuel de renom et archéologue - ouvrait temporairement au public à l’occasion de la tenue à Grenoble du Congrès international des Égyptologues. Le domaine composé d’une maison bourgeoise, de dépendances et d’un vaste parc de 2,5 hectares ainsi que le fonds familial des frères Champollion avaient étés acquis par le Département de l’Isère trois ans plus tôt, en 2001. La collectivité s’était alors engagée, conformément aux vœux des descendants de Jacques-Joseph, à rendre ce patrimoine accessible à un très large public.
Le parcours de visite installé dans la maison familiale en 2004 rencontra d’ailleurs un franc succès : la bâtisse accueille 45 000 visiteurs malgré des horaires réduits et une jauge limitée. Déjà, une équipe scientifique départementale s’attèle à l’étude des collections et à l’écriture d’un premier projet scientifique et culturel (PSC). Le document vient légitimer le projet de valoriser le fonds Champollion au sein d’un nouvel espace muséal, à créer.
Fin 2016, Jean-Pierre Barbier, président du Département de l’Isère annonce la création d’un musée dans le domaine « Les Champollion ». Il deviendra le onzième musée du réseau départemental. Des articles paraissent alors dans la presse : « Dans trois ans, Vif aura son Musée Champollion », titre le dauphine.com le 4 mars 2017. La visite sur site de Jean-Pierre Barbier, en novembre 2018 donne un nouveau regain journalistique au projet, puis la présentation du chantier en mai 2019 à l’occasion d’un évènement de préfiguration permet au grand public de découvrir l’avancée des travaux.
A l’occasion d’une exposition pédagogique pour présenter le projet, le Musée Champollion communique quelques précisions budgétaires et scientifiques que la presse locale relaye avec intérêt. Le Département de l’Isère investit 4,6 millions d’euros dans le projet de rénovation ; l’État et la Ville de Vif participent au montage financier. Un investissement qui en vaut la peine selon la direction de la Culture et du Patrimoine du Département, qui mise sur une fréquentation de 50 000 visiteurs par an. La présentation des collections – près de 500 pièces de mobilier, textiles, peintures et arts graphique – mettra en valeur les deux frères Champollion et leurs activités de recherche à l’origine d’une nouvelle discipline, l’égyptologie. Le parcours permanent cherchera un équilibre entre des espaces reconstitués et une muséographie contemporaine dédiée. Un programme prometteur pour un pari de taille : innover sur un sujet attendu et apprécié du grand public. Affaire à suivre […].
C.R
Photographie introductive : Le Domaine « Les Champollion » dans lequel sera installé le futur musée © Musée CHAMPOLLION / Denis Vinçon
#MuséeChampollion
#Égypte
#Ouverture

Cités millénaires, comment évoquer ce qui disparaît ?
Il y a quelque temps, j’ai eu la chance de visiter l’exposition « Cités millénaires. Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul », visible du 10 octobre au 17 février 2019 à l’Institut du Monde Arabe à Paris. À grand renfort d’outils numériques performants, l’IMA en partenariat avec l’Unesco a fait revivre Mossoul, Alep, Leptis Magna et enfin Palmyre. Ces villes et sites, tous classés au patrimoine culturel mondial de l’humanité sont le symbole d’une histoire vieille de plusieurs siècles, mais également l’emblème de la lutte contre l’État islamique.
Cette exposition qui proposait une expérience innovante et immersive qui contraignait le visiteur à s’interroger sur la notion de re-constructionet sur ce qui vient Après le déluge.
Grâce à l’acquisition de données multiples, il est possible de restituer, par le biais d’images, les formes architecturales, les différentes phases de transformation ou de destruction. À partir des restitutions, il est possible d’envisager une reconstruction : « Construction d’un édifice ou d'un ensemble d'édifices en totalité ou en partie, dans le respect ou non de la forme initiale, après qu'ils aient été détruits ou fortement endommagés. Une reconstruction peut inclure des opérations de reconstitution »[1]. La reconstitution est quant à elle invérifiable, « elle sort donc du champ strict de la science pour aller vers celui de la création artistique ou de la fiction. »[2].
Une exposition singulière
Une fois les quatre sites localisés grâce à la carte et une brève introduction rappelant que le patrimoine présenté dans l’exposition est « l’emblème d’un passé adoré par les uns, haï par les autres. », le visiteur pénètre dans la salle consacrée à Mossoul, à la scénographie surprenante et spectaculaire.
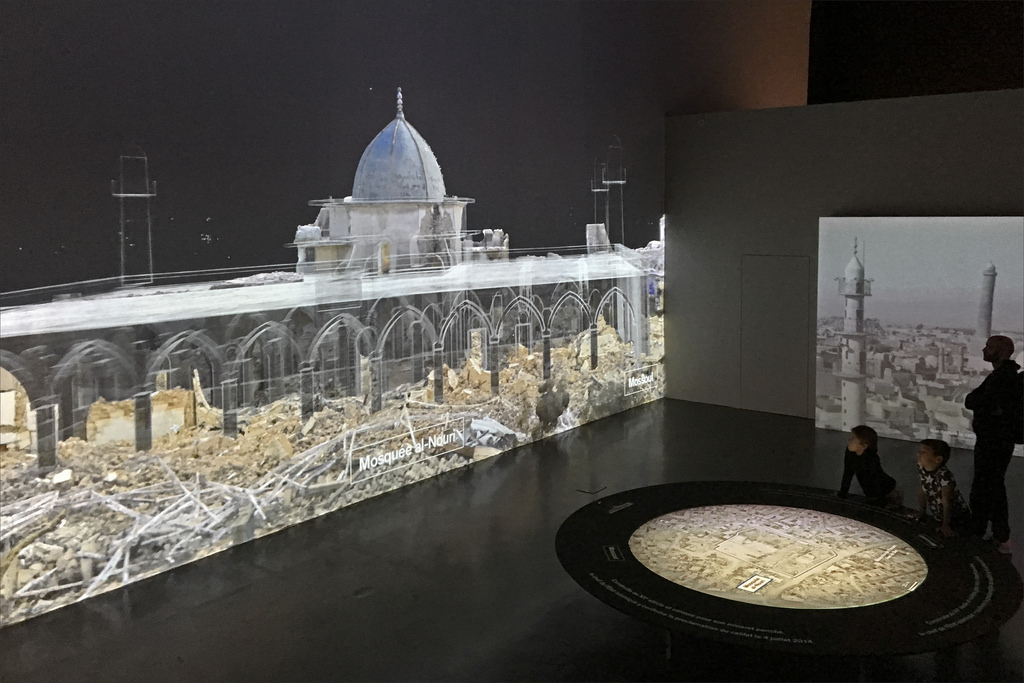
Salle consacrée à la ville de Mossoul en Irak, projection de la restitution 3D de la mosquée al-Nouri © Jean-Pierre Dalbéra
La société Iconem, qui a pour mission de « contribuer à la conservation de ces endroits menacés en les numérisant pour l’exploration et l’étude, aujourd’hui et demain. », a réalisé les images projetées grâce à des prises de vue par drones, qu’elles soient aériennes ou au ras du sol.
L’exposition est extrêmement bien rythmée, chaque section du parcours se fait sur le même modèle :
- Un écran géant dévoilant des images 3D de lieux éventrés, vides d’habitants et dépourvus de couleur. Les images actuelles de destruction et de désolation laissent ensuite place à l’ancienne armature des bâtiments détruits.
- Une table circulaire situe géographiquement les lieux présentés et affiche des citations.
- D’anciennes photographies en noir et blanc des lieux sont projetées, datant principalement du 20ème siècle.
- Des focus vidéos sur d’anciens habitants et des professionnels qui témoignent face caméra donnent corps aux civils qui se battent pour sauver leur civilisation à travers la sauvegarde du patrimoine. Ainsi, des visages remplacent l’habituel sanglant anonymat des guerres.
- En dehors de ces grands espaces, de petites pièces où sont projetés des films sur différents thèmes ponctuent le parcours et complètent l’exploration. Elles peuvent accueillir une dizaine de personnes maximum. Ce système d’alcôves, même s’il favorise isolement et recueillement fonctionne bien lorsqu’il n’y a pas de foule. Autrement, il devient assez difficile d’y accéder, le confort de vision n’est pas assuré, d’autant plus que personne n’est chargé de la régulation des flux.
Au sein de ce parcours, aucun objet patrimonial n’est exposé. Entre chaque section des citations peintes sur des mûrs jaunes, qu’elles soient littéraires, religieuses ou savantes rappellent l’importance des lieux évoqués et de leur histoire. Hormis cela, il y a très peu de texte.
Personnellement, l’émotion était au rendez-vous même si davantage de médiation aurait été bienvenue. Les « tables de médiation dynamiques »[3] présentes au centre de chaque espace et auxquelles il ne faut pas toucher auraient gagné à être interactives. Ce sont elles qui apportent le contenu relatif à ce qui est projeté sur grand écran.
Utilisation réussie du numérique
À la fin du parcours, juste avant la conclusion, le visiteur est invité à mettre un casque de réalité virtuelle et à explorer pendant quelques minutes six lieux présents dans le parcours. Insérer de la réalité virtuelle permet de faire venir du public et surtout de l’élargir d’autant plus que l’IMA a beaucoup joué sur la côte d’Ubisoft, créateur d’Assassin’s creed en proposant notamment des nocturnes de l’exposition où il est possible de tester plusieurs jeux d’Ubisoft (à partir de 12 ans). Ce type de dispositif est assez rarement proposé compte tenu de son coût d’installation et d’entretien, ce qui participe à l’attractivité de l’exposition. Trois personnes s’occupaient d’installer les casques et de réguler la file d’attente d’environ trente minutes mais n’avaient pas forcément le temps de répondre aux questions des curieux ne connaissant pas nécessairement le concept. Enfants comme personnes âgées se prennent au jeu et l’expérience semble remporter un grand succès. C’est un partenariat bienheureux entre Ubisoft, géant du jeu vidéo, l’IMA et Iconem. Au-delà de la performance technologique, c’est intéressant pour le visiteur de pouvoir voir « de l’intérieur » les lieux qu’il a pu observer auparavant dans le parcours. Le fait que cette « activité » soit purement contemplative ne m’a pas dérangée. Cela permet de prendre la mesure de la nécessaire sauvegarde du patrimoine de l’humanité, à la fois fragile et invariable.
« Un acte de résistance contre la barbarie »[4]
La résistance se voit principalement à travers les témoignages des civils qui sont essentiels et jalonnent le parcours de l’exposition. Greetings from Aleppo de Issa Touma est à mon sens la vidéo la plus émouvante de l’exposition. Elle donne à voir pendant 17 minutes le quotidien dans une ville à feu à sang, l’adaptation puis la résilience des habitants.

Captures d’écran de la bande annonce disponible sur © www.film-documentaire.fr
Les personnes interrogées dans le cadre des focus vidéos présents à chaque étape, que ce soit de simples civils ou des professionnels des musées, témoignent de l’importance de la culture et du patrimoine dans la construction d’une civilisation. Certains d’entre eux évoquent le possible développement du tourisme ultérieur.

Capture d’écran des vidéos présentes en salles, visibles sur YouTube © IMA
Faut-il reconstruire le patrimoine détruit ?
Au-delà de l’aspect spectaculaire de l’exposition, deux questions sont posées : faut-il reconstruire le patrimoine détruit ? Comment prendre soin du patrimoine qui reste ?
Traditionnellement, les professionnels des musées sont opposés aux reconstructions au risque de lisser l’histoire en même temps que le patrimoine. Pour beaucoup, les cicatrices sont essentielles à la compréhension de l’histoire d’un lieu. Mais, nous pouvons légitimement nous poser la question de ce qu’il convient de faire lorsque les cicatrices elles-mêmes s’abiment sous l’effet du temps. De plus, l’un des risques encourus est la récupération politique de la reconstruction. Il n’empêche qu’après les nombreuses attaques des extrémistes contre le patrimoine, il semblerait que l’UNESCO et le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) soient davantage favorables à la reconstruction[5]. En 2017, le Comité du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO a pris des décisions concernant le « patrimoine mondial en péril » et les possibles reconstructions des monuments détruits que ce soit à cause de catastrophes naturelles, à cause d’attaques terroristes ou encore à cause de négligences etc. Elle a notamment pris en compte que la reconstruction peut servir à la régénération d’une nation et ainsi lui permettre de regagner une identité dissoute. Pour la reconstruction, la documentation est primordiale, afin de limiter la part d’interprétation. C’est pourquoi le travail entrepris par la société Iconem est très important. La reproduction à l’identique est impossible, puisque les conditions de réalisations sont très différentes. Il ne s’agit pas de faire des répliques, ni des « Disneyland »[6] figés dans le seul but d’attirer des touristes. Le terme Disneyland est employé par Michel Al-Maqdissi, interrogé par l’IMA sur la reconstruction de Palmyre, et dont le témoignage est visible au sein de l’exposition. Il affirme également « Comment voulez-vous qu’un monument qui a été explosé à ses bases et qui est devenu pratiquement de la poussière, comment voulez-vous reconstruire ce bâtiment ? ». Selon lui, « Faire visiter le site avec la destruction actuelle, c’est envisageable, on peut associer cette visite à des écrans (…) où on présente l’état avec la destruction en 3D ça pourrait être une option. ». Chaque cas est unique, il faut prendre en compte la variété des situations. Par exemple à Alep, qui a été détruite à près de 45%, la reconstruction du souk est envisagée car elle est constitutive de l’identité des habitants, commercer a une valeur culturelle mais aussi cultuelle. Lorsque le souk a été détruit, c’est également un patrimoine immatériel qui l’a été, celui qui liait commerçants et clients. Leptis Magna est assez particulière à cet égard car elle n’a pas fait l’objet de destruction pour le moment malgré sept années de guerre. Mais, compte tenu de la situation chaotique, de nombreuses dégradations ont été constatées dû à un manque d’entretien.
Cette très belle exposition pose plus de questions qu’elle n’en résout mais encourage aussi une prise de conscience des enjeux de la conservation et de la valeur mémorielle de la reconstruction.
Armelle Girard
#PatrimoineEnDanger
#InstitutDuMondeArabe
#Ubisoft
Pour aller plus loin :
- Conférence « Le monument et son double : peut-on reconstruire à l’identique ? », Julien Bastoen et Frédéric Didier, Cours public de l’école de Chaillot :https://www.dailymotion.com/video/x6jmkkl.
- Article de Christina Cameron « Faut-il reconstruire le patrimoine ? » : https://fr.unesco.org/courier/2017-juillet-septembre/faut-il-reconstruire-patrimoine
Pour en savoir plus :
https://www.imarabe.org/fr/expositions/cites-millenaires
[1] http://www.culture.gouv.fr/content/download/52715/409376/file/2012-022_Glossaire_termes_MH.pdf.
[2] https://raan.hypotheses.org/files/2018/06/Introduction-A_Badiepublication2.pdf
[3] C’est comme cela qu’elles sont présentées dans l’article de Franceinter consacré à l’exposition : https://www.franceinter.fr/culture/cites-millenaires-voyage-virtuel-de-palmyre-a-mossoul-du-10-oct-18-au-10-fev-19-a-l-institut-du-monde-arabe
[4] Dixit Emmanuel Macron lors de l’inauguration le 16 octobre 2018.
[5] https://fr.unesco.org/courier/2017-juillet-septembre/faut-il-reconstruire-patrimoine

Collection Ecomuséale : Le patrimoine à Fresnes sans réserve
Au cœur de Fresnes, l’écomusée se reconnecte à sa nature. Dans un ancien corps de ferme au plein milieu d’un paysage urbain, l’écomusée se déploie dans la bergerie. Son équipe se concentre notamment sur la formation d’une collection particulière ; la collection écomuséale, un concept hors cadre, une collection hors-les-murs, vivantes et désignée par les plus expert·e·s de ce paysage fresnois : ses habitant·e·s.
Image vignette : Photo d’une carte du Grand-Orly Seine Bièvre © Blanc Alys
Image d'introduction : Photo de l'entrée de l'écomusée de Fresnes, dans un corps de ferme au coeur d'un paysage urbain, 15 nov. 2025, ©Blanc Alys
L’écomusée de Fresnes, autrement appelé du Grand Orly Seine Bièvre, se définit en principe par son ancrage sur le territoire. À Fresnes, cette nature écomuséale s’est traduite par la volonté d’inclure les habitant·e·s fresnois.es à participer aux collections. En 2016, l’écomusée réalise leur première collection écomuséale. Celle-ci a pour principe de désigner des objets appartenant à des Fresnois.es représentant une mémoire collective. Cette démarche est perçue comme un « chamboule-tout » muséale. La collection nommée écomuséale, n’est pas la propriété du musée, mais celle d’habitant·e·s environnant·e·s. C’est la responsabilité d’un collectif et non d’une institution qui est mise en jeu autant pour la désignation des objets, que pour la conservation. De plus, l’écomusée a pour volonté de les considérer au même titre que les collections muséales. La collection écomuséale est répertoriée dans le logiciel Flora auprès des collections muséales.
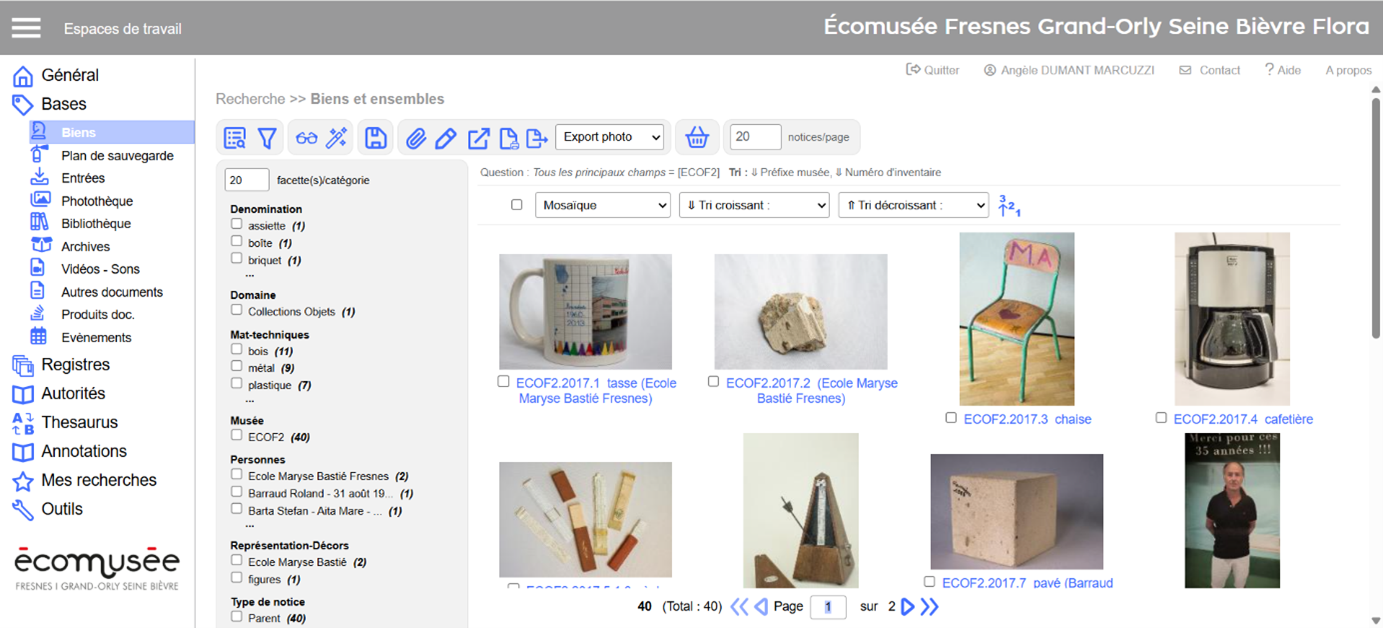
Capture d’écran du Logiciel Flora qui répertorie les collections muséales et dans le cas de l’écomusée de Fresnes, la collection écomuséale. Elle se distingue uniquement par l’appellation ECOF2 au lieu de ECOF1 pour la collection muséale. 15 nov. 2025 ©Ecomusée de Fresnes
Cette initiative s’est malheureusement essoufflée au fil des années, et les objets sont pour la plupart difficiles à retrouver. Dans une optique d’améliorer cette collection écomuséale, la nouvelle équipe a privilégié une démarche innovante. La création d’un statut de désignateur·ice·s pour les habitant·e·s et associations locales permet de redonner le pouvoir de construire leur propre récit. La méthode s’organise en plusieurs temps avec l’accompagnement des Ami·e·s de l’écomusée: des ateliers de désignation collective dans des groupes sociaux (Exemple : Conseil municipal des enfants), suivis d’une phase de recherche de témoignages et d’informations pour étayer le dossier de ce patrimoine désigné. L’entrée d’un élément en collection est validée par un vote majoritaire lors de l’assemblée des désignateur·ice·s du patrimoine, en début 2026. Ce processus transforme l’habitant·e de simple visiteur·euse en participant·e actif·ve, faisant de la collection une propriété morale collective. Il se veut être une fabrique de patrimoine dont l’objectif est d’ouvrir la définition du patrimoine et de la collection à cette nouvelle notion de collection écomuséale. Les ateliers de désignation ont déjà pris part dans le Conseil municipal des enfants, composés de 44 enfants de classes de CM1, par exemple. Les éléments désignés font surtout partie d’un patrimoine immatériel tel que le carnaval des enfants ou encore Berty Albrecht, résistante morte à la prison de Fresnes dont le nom a été choisi pour renommer une école de Suresnes, ville limitrophe, cette année.
L’approche de Fresnes s’inscrit dans une collaboration étroite avec l’Ecomusée du fier monde à Montréal. L’institution québécoise a une collection écomuséale bien installée. Cette collection s’est historiquement concentrée sur le patrimoine bâti et immatériel, travaillant maintenant à combler les lacunes de leurs collections sur des sujets encore peu abordés tel que « Le Village », quartier LGBT de Montréal. L’écomusée du fier monde donne une vision assez claire de comment la collection écomuséale de Fresnes peut prendre de l’ampleur et s’inscrire dans le paysage fresnois.
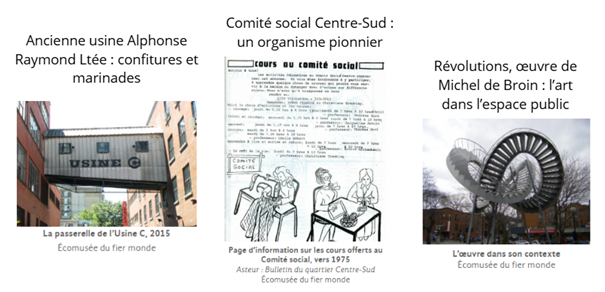
Sélection non-exhaustive d’éléments désignés se trouvant dans la collection de l’écomusée du fier monde à Montréal, disponible sur leurs sites ©Ecomusée du fier monde
Pour la valorisation de ce patrimoine, l’équipe québécoise utilise un kiosque itinérant qui sillonne les rues et parcs de Montréal pour présenter le patrimoine immatériel désigné et recueillir de nouvelles suggestions. À Fresnes, l’équipe s’engage à rapprocher collections muséales et écomuséales en valorisant les éléments désignés dans les futures expositions temporaires, comme ce fut déjà le cas en 2018 avec Objets privés, histoire partagée. L’idée de réaliser des balades urbaines, mobilisant les Ami·e·s de l’écomusée, est aussi un élément possible dans la médiation autour de ce patrimoine vivant.
En définitif, le processus de participation confère aux habitant·e·s un droit moral sur leur patrimoine. Cette responsabilité partagée crée une réelle connexion entre l’écomusée et le territoire, et favorise un sentiment d’appartenance. En donnant la voix aux habitant·e·s, l’écomusée devient une ressource puissante à laquelle les fresnois·es accordent leur confiance. La collection écomuséale s’annonce donc comme LA bonne idée et risque de s’étendre bien au-delà des murs de l’écomusée et de la ville de Fresnes.
Alys BLANC
Un grand merci à Angèle Dumant pour son rôle essentiel dans cette démarche, et à Raphaëlle Venet qui m'a permis de découvrir ce beau musée et d'approfondir ma compréhension de ce sujet passionnant.
#Patrimoineimmatériel #Collection #Communauté
Pour aller plus loin :
https://ecomusee.grandorlyseinebievre.fr/
https://ecomusee.qc.ca/collections/elements-patrimoniaux-designes/

Conversation: Une étrange défaite ? Mai-juin 1940
Le 25 février 2021, la conservatrice du Musée des Troupes de montagne et son équipe se sont rendues au Centre d’Histoire de la Résistance de la Déportation (CHRD) à Lyon afin de découvrir l’exposition Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 https://www.chrd.lyon.fr/chrd/edito-musee/exposition-temporaire-une-etrange-defaite pour laquelle le musée était un des prêteurs. Charlène Paris, chargée d’étude à la conservation des collections, échange avec Céline Boullet, actuellement chargée de régie des collections, qui a travaillé en tant que stagiaire sur l’exposition.

Céline et Charlène. Céline présente le livre de l’exposition Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 © Musée des Troupes de montagne
À quelle référence renvoie le titre Mai-juin 1940. Une étrange défaite ? De quoi traite l’exposition ?
Le titre de l'exposition est une citation de l’essai L’Étrange Défaite, rédigé de juillet à septembre 1940 par Marc Bloch. L’ouvrage, aux éditions Franc-Tireur, est publié pour la première fois en 1946, deux ans après l’assassinat de Marc Bloch par la Gestapo. Ce témoignage direct de la Seconde Guerre mondiale, par un officier et historien, a été une source d’inspiration afin de comprendre les raisons de la défaite française. Le point d’interrogation du titre donne le ton de l’exposition. Il s’agit de questionner la défaite de 1940 au sein des mémoires collectives. Tout au long de l’exposition, le visiteur est plongé dans un contexte de mythes et de contre-mythes. Il s’agit de déconstruire l’idée de la supériorité allemande, notamment en termes d’équipements et d’uniformes.
Comment s’articule le parcours et les thèmes de l’exposition ?
L’entrée en matière de l’exposition dans le hall d’entrée est un appel au temporaire marqué par un side-car motif camouflage et l’affiche du film La Bataille de France - titre en écho à Marc Bloch - de 1964. Puis, deux tenues militaires armées ouvrent le parcours situé au sous-sol. La re-contextualisation donne d’emblée le ton : la défaite s’explique par une mauvaise gestion politique liée au commandement et non par un souci matériel. L’affiche du film La 7ème compagnie, de 1973, incarne l’image d’un soldat gentillet mais peu débrouillard ; or, les soldats n’ont cessé de se battre pour défendre la France. Le parcours propose différents niveaux de lecture, dont un fil conducteur visuel sous forme de Bande Dessinée. L’image de la défaite est interrogée au travers de cinq grands thèmes : les forces en présence et son état des lieux, la drôle de guerre, le temps des combats, les séquences politiques et le sort des populations civiles.

Équipements et uniformes prêtés par le Musée de l’Armée, Paris https://www.musee-armee.fr/accueil.html © Musée des Troupes de montagne
Parlez-nous de la scénographie. Quel est le parti pris? Quelles ont été vos missions ?
La scénographie a été élaborée par l’agence L+M, localisée à Villeurbanne (69), composée de Louise Cunin, scénographe et Mahé Chemelle, graphiste. En tant que chargée d’exposition et de production pour la préparation de l'exposition j’ai pu assister aux réunions de scénographie et graphisme. L’idée principale était de baser la scénographie sur le mot débâcle, mot associé à la période mai-juin 1940, dont le sens renvoie à la “dislocation des glaces”. De grandes tables regroupant différents thèmes ont été créées. Elles évoquent les tables stratégiques militaires, rectilignes et ordonnées. En ce qui concerne mes missions, je me suis occupée de la relation avec les prêteurs : des constats d’états, des fiches d’assurances, du convoiement. J’ai également travaillé sur la relecture des textes scientifiques de l’exposition et du catalogue. Malgré la crise sanitaire, j’ai assisté à toute la mise en place de l’exposition, de la présentation de la première phase muséographique/scénographique en février 2020 à l’inauguration de l’exposition le 23 septembre 2020.
Les tables positionnées de manière dynamique et les couleurs évoquent l’esthétique du mouvement De Stijl, pouvez-vous nous en dire plus ?
Le visiteur choisit son parcours selon les points de vue qu’il souhaite découvrir. Trois couleurs ont été choisies afin de les différencier : le jaune pour le militaire, le bleu pour le politique, le rouge pour les populations civiles. Cette gamme chromatique permet alors d’entrecroiser les points de vue, les événements clefs et de rappeler le foisonnement d'événements qu’il y a eu durant cette courte période. Le visiteur déambule au centre d’un vide structuré par des tables « états-majors ».

Salle de l’exposition Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 © Musée des Troupes de montagne
Pourquoi avoir choisi un béret alpin et des raquettes dans les collections du Musée des Troupes de montagne pour cette exposition ?
Lors de la mise en place du processus de création de l’exposition, nous avons voulu mettre en avant les troupes de montagnes “armée invaincue” dans deux parties de l’exposition. Nous nous sommes alors entretenues avec le commandant Aude Piernas, conservatrice du musée des Troupes de montagne, avec qui nous avons travaillé pour le prêt d’objets issus des collections du musée. Ces deux pièces clefs incarnent deux sous-thématiques : les premiers combats avec Narvik et Namsos de l’Armée des Alpes. Elles sont également des témoignages en termes d’équipements techniques historiques de l’équipement du soldat de montagne. Les raquettes Narvik sont à redécouvrir dans l’exposition Armée des Alpes, Armées Invaincues https://www.museedestroupesdemontagne.fr/armeesdesalpes/ .

Raquettes du Musée des Troupes de montagne © Musée des Troupes de montagne
Trois points de vue, trois couleurs : le jaune pour le militaire, le bleu pour le politique, le rouge pour les populations civiles.
Et vous Charlène, pouvez-vous nous faire vos retours, impression sur l’exposition ?
Une étrange défaite ? Mai-juin 1940 est l’occasion de découvrir ou redécouvrir l'œuvre citoyenne L’étrange défaite de Marc Bloch devenue un texte de référence. Le visiteur devient, tel l’historien capitaine engagé volontaire, témoin face à la débâcle de l’armée française. Mais surtout, il est amené à un examen de conscience, inséparable de son contexte. La faillite est d’ordre intellectuel et moral. Le dogmatisme est aveuglant, ce qui amène le Blitzkrieg (la guerre éclaire) combiné à l’esprit de renoncement, à une situation catastrophique. L’exposition est sous le niveau de la terre, comme le manuscrit qui a pu être sauvé parce qu’il avait été enterré par son ami clermontois : je trouve la métaphore intéressante. L’histoire immédiate et ses niveaux de lecture par couleurs montrent des mondes qui se côtoient mais ne se rencontrent pas forcément pour finalement causer des dommages collatéraux - on le voit bien avec l’extrait du film Jeux interdits de 1952-, en cela la disposition spatiale de la grande salle est efficace. J’aime beaucoup les choix muséographiques, comme celui de l’huile sur papier du musée de la Cavalerie de Saumur https://www.musee-cavalerie.fr La charge à la horgne du peintre de la Marine Albert Brenet. Avec son cartel, on comprend combien il est important de lire et décrypter les images, surtout lorsqu’elles relèvent de commandes et de légendes. Le fait que le parcours se termine par une étagère de livres est une idée originale, incitant le lecteur à poursuivre ses recherches sur cette période.
Charlène Paris
#àlarencontredesprofessionels:laformationMEMenlive
#histoire-mémoire
#brèvesd’apprentissage
#patrimoine-société

Croiser les regards : exposer autrement
L’exposition peut être vécue comme une promenade balisée : le parcours, qu’il soit linéaire ou relativement libre, conduit les visiteurs à observer des œuvres réunies par thématique, artiste ou encore période. Cette présentation est rassurante, déroulant une histoire parfois connue d’avance. Et si l’on renversait l’ordre établi ? C’est ce que
proposent certaines institutions en exposant côte à côte des œuvres de courants opposés, mais reliées par un geste, une couleur, une vibration de la matière. C’est moins l’histoire qui guide l’œil que la sensation immédiate. Mais n’est-ce pas frustrant pour d’autres visiteurs ? Apprécier ces associations ne présuppose-t-il pas d’avoir des connaissances préalables sur les œuvres ?
Dialogues inattendus : comprendre ce type d’accrochage
Ce choix curatorial semble agir comme un antidote contre les classifications académiques. Il refuse que l'œuvre soit réduite à son étiquette historique ; il invite à voir ce qui relie au lieu de ce qui sépare. En forçant l’œil à chercher des points communs inattendus, l’espace d’exposition devient un terrain d'expérience, où formes et couleurs tissent des liens, parfois plus éloquents pour certains publics.

Vue de l’exposition Collected with Vision: Private Collections in Dialogue with the Old Masters, KMSKA, 2024, © KMSKA
Entre émerveillement et désorientation : les limitesAu KMSKA d’Anvers, récemment rénové, le parcours muséal décloisonne les époques en mettant en dialogue les maîtres anciens flamands, comme Rubens ou Van Dyck, avec des œuvres modernes et contemporaines. Non pour illustrer une progression historique, mais pour mettre en évidence des gestes formels partagés : la flamboyance du
rouge, la construction des volumes, l’intensité dramatique. Loin d’exercer le regard à une époque ou une technique particulière, l'institution cherche à provoquer une lecture
transversale. Cette approche a fait l’objet d’une exposition particulière et temporaire Collected with Vision: Private Collections in Dialogue with the Old Masters (2024), questionnant le rôle des musées ainsi que des collectionneurs privés. La muséographie crée ainsi un nouveau dialogue, avec la croyance que les œuvres d'art contemporaines peuvent renouveler les représentations figées des portraits traditionnels ou des figures maternelles, en y insufflant un regard critique et ancré dans l'actualité.

Vue de l’exposition Carambolages, Grand Palais, 2016 © spectacles sélection
Cette approche trouve également un écho dans l’exposition Carambolages (Grand Palais, 2016), conçue par Jean-Hubert Martin. L’éloignement des cartels numériques, invitaient le visiteur à cheminer de manière intuitive, réagissant aux affinités plastiques et symboliques. Jean-Hubert Martin semble ici faire renaître une logique propre à celle du cabinet de curiosité, plus que celle du directeur de musée.

Vue de l’exposition « La couleur parle toutes les langues », Hôtel de la Marine, 2024 ©The AI Thani Collection, photographie par Marc Domage
D'autres exemples confirment cette tendance : l’exposition La couleur parle toutes les langues à l’Hôtel de la Marine (jusqu’au 5 octobre 2025) dont Hélène de Givry, curator
à la Collection Al Thani est la commissaire fait dialoguer 80 œuvres de différentes civilisations issues des cinq continents et couvrant une période chronologique allant du
Néolithique à nos jours. Le parcours est organisé de manière chromatique correspondant aux couleurs fondamentales dans les arts : noir, blanc, rouge, jaune, bleu et vert. Ce mode de classement invite les visiteurs à explorer les matériaux utilisés en lien avec les techniques de production, à percevoir les effets visuels créés par les variations de teintes, d’éclats et de contrastes, et à réfléchir à leur dimension symbolique à travers différentes cultures.
Cette approche rejoint des réflexions théoriques contemporaines sur l’exposition comme « langage », tel que formulé par Jérôme Glicenstein dans « L’exposition comme langage et dispositif », chapitre de son ouvrage L’art : une histoire d’expositions (2009). L’agencement des œuvres devient lui-même un énoncé, engageant le visiteur dans une lecture libre, intuitive et polysémique.
Entre émerveillement et désorientation : les limites
Cependant, cette esthétique de la correspondance comporte ses risques. Si elle invite certains visiteurs à aiguiser leur regard, elle peut également dérouter ceux qui s’attendent à une structure narrative plus claire. Les salles d’exposition permanentes du KMSKA en sont un exemple : selon un article du The Art Newspaper, des préoccupations ont été soulevées concernant les choix esthétiques et curatoriaux du musée, notamment l'absence de fil conducteur historique dans la présentation des œuvres.
De plus, ce type d’accrochage présuppose souvent une certaine culture visuelle. Pour saisir pleinement les échos entre un retable du 15e siècle et une abstraction géométrique du 20e, il faut pouvoir identifier ce qui distingue, et ce qui rapproche. Or, tout le public n’est pas équipé pour une telle lecture. Comme l’analyse Odile Le Guern dans son article Rhétorique d'une mise en espace (2005), une mise en scène audacieuse peut renforcer l’élitisme muséal si elle ne ménage pas des points d’entrée accessibles pour tous. Le risque serait de diluer le sens historique des œuvres en occultant les contextes de création nécessaires à leur compréhension.
Une tension féconde, vers une exposition à double lecture
La juxtaposition libre d'œuvres de styles et d’époques différents constitue une tentative salutaire de revitaliser l'expérience muséale. Elle lutte contre la muséographie figée,
favorisant une lecture intuitive et sensible des formes. Dans ce sens, elle permet de renouveler l'attention du spectateur, de l'arracher à la passivité critique.
Cependant, pour que ce type d'accrochage soit pleinement efficace, il doit s'accompagner d’outils de médiation adaptés : cartels explicatifs, parcours thématiques optionnels,
dispositifs interactifs. Il ne s'agit pas de renoncer à l'histoire au profit d'une pure expérience esthétique, mais de trouver un juste équilibre entre l'émotion immédiate et la contextualisation raisonnée.
Ainsi conçu, l’accrochage par correspondances ne remplace pas la chronologie ; il la questionne, l’enrichit, et ouvre d’autres chemins pour apprendre à voir autrement. Car
exposer autrement, c’est avant tout multiplier les expériences du regard.
- Nina Colpaert
Pour en savoir plus ::
- La couleur parle toutes les langues, 2024, Hôtel de la Marine, du 3 octobre 2024 au 5 octobre 2025 : https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/la-couleur-parle-toutes-les-langues.-aeuvres-choisies-de-la-collection-al-thani
- Collected with vision, 2024, KMSKA : https://kmska.be/en/collected-with-vision-private-collections-in-dialogue-with-the-old-masters
- Carambolages, 2016, Grand Palais : https://www.grandpalais.fr/fr/programme/carambolages
- Zeugma 01, 2025, Abbaye royale et musée d’art moderne de Fontevraud : https://www.fontevraud.fr/evenement/zeugma-romain-bernini/
#ExposerAutrement#DialogueDesOeuvres#MuséographieContemporaine

Dans les éclats du miroir : les musées au regard du pays des merveilles.
La saison dernière, les musées de Strasbourg consacraient une exposition au chef d’œuvre de Lewis Carroll. Retour sur une exposition qui vous fera, sans hésitation, donner votre langue au chat.
Image d’introduction : L’entrée par la gueule du chat, une œuvre de Monster Chetwynd / Photo : P. Dancin
Surréalice, Musées de la ville de Strasbourg, du 19 novembre 2022 au 26 février 2023
Du 19 novembre 2022 au 26 février 2023, l’eurométropole strasbourgeoise se mettait à l’heure anglaise en associant la programmation de deux de ses musées autour de la figure d’Alice et de son univers merveilleux, nés sous la plume de Lewis Carroll avec deux romans successifs Alice au pays des merveilles (1865) et De l’autre côté du miroir (1871). En écho à ces deux romans répondaient deux expositions croisées : Illustr’Alice au Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’illustration et Lewis Carroll et les Surréalistes au Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS). Pour ces deux expositions, une même volonté : montrer l’influence d’Alice par-delà les frontières temporelles et géographiques. Jusqu’à présent, les expositions consacrées à Lewis Carroll en France avaient essentiellement eu lieu dans des bibliothèques avec les Images d’Alice, au pays des merveilles à la Bibliothèque des Champs Libres de Rennes (2011) et les Visages d’Alice à la BPI (1983). Ces deux expositions d’envergure s’intéressaient déjà à la postérité de Lewis Carroll. Fruit d’une organisation concertée et centralisée des musées de la ville de Strasbourg, l’exposition Surréalice fait entrer l’œuvre littéraire de Lewis Carroll dans l’univers muséal.
Poétique du fragment, quand 1 est 1000
Le Musée Tomi Ungerer - Centre international de l’illustration, présente la fascination des illustrateurs pour les aventures d’Alice et la longue postérité du personnage. En couvrant un large spectre temporel et géographique, des premières illustrations britanniques aux interprétations récentes et internationales, l’exposition donne à voir le devenir mythe de l’œuvre de Lewis Carroll.
Illustr’Alice est placée sous le signe de la pluralité, que ce soit par le nombre d’œuvres exposées – près de 150 – et leur origine diverse, ou par la multiplicité des angles d’approche. Au seuil de l’exposition, à la fois préambule et conclusion, un premier espace ouvre sur les esquisses de Icinori, les graphistes de l’affiche ainsi que sur plusieurs projets éditoriaux récents à la croisée du livre d’artiste, de l’album et de l’objet d’art. Cet espace préliminaire donne à voir une création toujours bouillonnante et ancre l’influence d’Alice dans le présent des visiteurs. La première séquence permet de recontextualiser Alice au pays des merveilles. Elle présente une sélection des chapitres-phares, et les plus souvent illustrés, afin de brosser à grands traits l’histoire d’Alice. Pour chacun des chapitres, plusieurs artistes sont convoqués. Cette approche comparative introduit le fil rouge de la diversité des interprétations. Elle met aussi en avant une unité : un consensus autour des épisodes à illustrer émerge de la diversité des styles.
La deuxième séquence prend du recul. Il ne s’agit plus d’observer des différences dans les interprétations individuelles d’un même épisode mais de souligner des tendances propres à des aires géo culturelles. Les artistes et leurs œuvres sont rassemblés par origines géographiques. D’un côté les Britanniques et leur lecture satirique, de l’autre les Français attachés à une Alice enfantine, ou encore les artistes d’Europe centrale et leur lecture fantastique, voire absurde, du personnage. La séquence suivante revient sur les premières illustrations d’Alice avant de laisser cet angle chronologique pour se tourner vers le thème de l’humour et de la satire. La franchise de la jeune fille face à l’absurdité fait d’elle un support satirique pour les dessinateurs de presse. Enfin, la dernière séquence, monographique, présente la série de gravures réalisées par le dessinateur Barry Moser en 1982. Le choix de la technique le place dans la lignée directe des premiers illustrateurs d’Alice au pays des merveilles présentés plus haut dans l’exposition.
La diversité des approches n’est pas signe d’incohérence, quoique le fil directeur disparaisse quelque fois au profit d’un collage légèrement confus sur la fin. Les jeux d’échos avec l’annonce, dans la première séquence, d’artistes qui seront exposés dans les séquences suivantes, affirment une certaine logique, par-delà la fragmentation.
Parti-pris de l’exposition, le texte en lui-même est peu présent, à l’exception de la première séquence – bien que cette dernière s’attache davantage à la structure de l’œuvre plutôt qu’à ses mots –, et des quelques extraits cités dans les cartels. L’exposition vise moins à donner une connaissance précise du texte de Lewis Carroll qu’à faire appel au mythe encore vivace dans l’imaginaire collectif. Ce n’est pas un hasard si la première vitrine ouvre sur l’image d’Alice diffusée par Walt Disney. Ce choix dit aussi la volonté de l’institution d’affirmer le statut d’œuvre originale des illustrations, souvent minorées de par leur subordination à une œuvre première. De fait, la scénographie épurée, façon white cube, reprend les codes de l’art contemporain. Les cimaises semblables à de grandes pages blanches, feraient passer les illustrations, à s’y méprendre, pour des créations ex nihilo déliées de l’œuvre littéraire.
L’exposition donne une vision kaléidoscopique d’une œuvre dont les illustrateurs eux-mêmes ne montrent jamais que des fragments. Les romans de Lewis Carroll apparaissent, ainsi, en filigrane, par les interstices laissés entre la centaine d’œuvres exposées. La discrétion du discours scientifique – les textes de salles comme les cartels restent succincts – laisse toute la place à l’investissement des visiteurs, invités à leur tour, à habiter ce texte ouvert1.
Poétique de diffraction
L’exposition du MAMCS resserre le champ temporel pour présenter la réception de l’œuvre de Lewis Carroll par un mouvement artistique spécifique : le surréalisme. A l’inverse, elle élargit le spectre à l’ensemble de l’œuvre littéraire et poétique de Lewis Carroll, bien qu’Alice reste la référence majeure.
Partant du constat de la fascination des surréalistes pour Lewis Carroll, l’exposition interroge les raisons de cette inscription au panthéon des maîtres. La première séquence ancre la réflexion dans les textes théoriques des surréalistes. Elles donnent à voir des éditions du Dictionnaire abrégé du surréalisme (1938) de Breton et Éluard, des revues telles que Le Minotaureou les traductions de Henri Parisot illustrées par Max Ernst : autant de textes qui, par leur analyse de l’œuvre de Carroll, ont contribué à sa reconnaissance et à sa postérité. Les quatre séquences suivantes sont une plongée dans le raisonnement des surréalistes. Thématiques, elles mettent en regard une notion présente dans l’œuvre de Lewis Carroll et sa mise en œuvre dans les tableaux surréalistes. In fine, peu d’artistes exposés ont revendiqué l’influence directe de Lewis Carroll, si bien que la mise en relation reste parfois un peu théorique et que l’accumulation d’œuvres perd Lewis Carroll de vue au profit des seuls surréalistes. L’exposition construit son propos autour de trois thèmes, trois comme dans les contes : le merveilleux, le corps imprévu et l’absurde.
Le discours de l’exposition est porté par une scénographie audacieuse qui opère un vrai travail de transposition spatiale de l’univers de Lewis Carroll. L’entrée monumentale mène le visiteur tout droit dans la gueule du chat de Cheshire. Avec son pouvoir de disparition et d’apparition partielle, ce personnage emblématique est le maître des seuils. Cette œuvre de l’artiste Monster Chetwynd place l’exposition sous le signe du collage, du fantastique et de la disproportion autant que de l’humour. Les deux salles suivantes poursuivent sur la même veine avec une caverne-tunnel artificiellement prolongée par des miroirs qui reproduit la chute infinie d’Alice. Les parois saillantes ainsi que le motif de grille d’échiquier au sol participent à cette illusion de profondeur. Mythe de la caverne inversé, la salle relativement obscure propose de retrouver un peu de naïveté et l’incrédulité nécessaire au travail de la fiction. Seul bémol, l’éclairage insuffisant sur les textes de salle, parfois denses, en rend la lecture fastidieuse.
Passé de l’autre côté du tunnel, le visiteur revient avec son regard neuf, au point de départ des aventures d’Alice : au pied de l’arbre. Avec sa structure circulaire, il dessine un espace concentrique régi par une logique d’imbrication plutôt que de linéarité. Pour cet espace consacré au merveilleux et notamment au rêve, thème cher aux surréalistes et à Lewis Carroll, le visiteur découvre un espace parcouru d’échos, de résonances, de forces centrifuges et centripètes.

Au pied de l’arbre, dynamiques circulaires / Photo : P. Dancin![]()
Le rêve travaille par condensation et déplacement pour reprendre les termes de Freud. Le feuillage de l’arbre est remplacé par un textile où sont reproduites, entre continuité et discontinuité, plusieurs toiles de Magritte. Plusieurs séries sont exposées comme l’ensemble de 12 héliographies Alice’s adventures in Wonderland (1969) de Dalí ou quelques-uns des 34 frottages rassemblés sous le titre Histoire naturelle (1926) de Ernst, ou encore une sélection de 26 planches entomologiques (1860) d’Henri Buchecker. Pour souligner le goût partagé de Lewis Carroll et des surréalistes pour les sciences naturelles, et l’interdisciplinarité de leurs créations, les collections empruntées au Musée zoologique de Strasbourg se mêlent aux œuvres d’art. Plusieurs spécimens empaillés sont mis en regard de la série de Max Ernst et accompagnés d’extraits d’Alice au pays des merveilles. Les catégories disparaissent au profit d’un rassemblement d’éléments hétérogènes. Cette attention portée à la présence du corps animal dans l’œuvre de Carroll et sa personnification annonce le thème du corps imprévu.

Effets sériels avec les planches entomologiques de Henri Buchecker / Photo : P. Dancin
La séquence suivante s’attache à la plasticité du corps. Si Alice subit les transformations de son corps plus qu'elle ne les choisit, elle apprend petit à petit à les maîtriser. La séquence aborde d’abord la réification du corps féminin, omniprésente dans les œuvres surréalistes, et notamment son assimilation à la poupée avec l’œuvre de Hans Bellmer. Mais elle ne s'y cantonne pas. Murs rouges, miroirs et fauteuils transforment la pièce en antichambre de la Reine Rouge, ce personnage qui manifeste son emprise sur le corps de ses sujets, en faisant planer sur leur tête la menace de décapitation. Plus que montrer l’assujettissement du corps féminin aux désirs masculins, la séquence ouvre sur son émancipation. Une place importante est donnée aux artistes féminines telles que Claude Cahun, Meret Oppenheim, Toyen, Jane Graverol qui ont utilisé l’intimité du corps pour transgresser les codes et les normes établis. Le corps se donne à voir sous toutes ses coutures et tous les médiums, de la peinture à la photographie en passant par les poèmes de Gisèle Prassinos lus par Guendoline Hénot que le visiteur peut écouter.

L’antichambre de la Reine Rouge, le corps entre pouvoir et intimité / Photo : P. Dancin![]()
Entre rupture et continuité, la salle suivante, avec ses murs verts marqués des enseignes des cartes à jouer, contraste fortement avec le rouge de la salle précédente et annonce le thème du jeu. Le visiteur quitte les appartements de la reine pour le terrain de croquet. La salle poursuit le thème du corps avec la métamorphose et le miroir déformant. Moins spectaculaire et plus évasive, la scénographie s’épuise un petit peu. Les références parfois très succinctes à Alice et l’étendue des thèmes abordés diluent la référence à Lewis Carroll sous une profusion d’œuvres.
Un grand miroir fragmenté accompagne la traversée du visiteur vers la dernière séquence dédiée à l'absurde et au nonsense. Elle met en avant le goût des surréalistes pour la langue, manifeste dans les titres comme à l’intérieur des œuvres. Pirouette finale, l’exposition revient aux mots par l’intermédiaire d’œuvres qui les donnent autant à lire qu’à voir, explorant leur nature graphique et signifiante. Ainsi, elle présente la couverture-objet Esquissons les ecchymoses des esquimaux aux mots exquis(1968), ou Le Poichat qui navole (1964) de Victor Brauner. Plus largement, la séquence développe le thème du jeu, de sa mise en scène à l’intérieur des œuvres à son investissement comme médium artistique. Quoique spectaculaire, le grand ciel bleu ponctué de nuages est moins directement signifiant, bien qu’on puisse percevoir la référence à Magritte, figure tutélaire de l’exposition.

Une exposition sous la figure tutélaire de Magritte / Photo : P. Dancin
L’exposition s’est ouverte par une salle obscure au sol-échiquier, elle se clôt sur L’Échiquier surréaliste (1934) de Man Ray, plongé lui aussi dans la pénombre. Il est temps de quitter le rêve pour revenir à la réalité. Le photomontage fragmenté et composite de vingt portraits de surréalistes s’inscrit dans une grille, cette unité close mais potentiellement extensible à l’infini. Ouverture et fermeture, unité et pluralité, l’exposition Lewis Carroll et les surréalistes donne à expérimenter la tension entre une œuvre finie et son influence infinie, plus ou moins explicite et revendiquée. En donnant à comprendre et expérimenter un univers pluriel et merveilleux, elle invite le visiteur à s’approprier l’œuvre de Lewis Carroll et à prolonger la grille de ses héritiers.

Ouverture et fermeture, le retour de l’échiquier avecL’Échiquier des surréalistes de Man Ray / Photo : P. Dancin![]()
Au fil des mots, le littéraire fait lien
Où est le début ? Où est la fin ? Si Alice a le pouvoir de surplomber et déborder les frontières temporelles et géographiques, elle a aussi celui de pousser les murs. Géante, elle enjambe la ville pour réunir les deux musées. Minuscule, elle entraîne l’agitation au cœur même du musée, prolonge l’exposition Lewis Carroll et les Surréalistes au-delà d’elle-même, infiltre les salles alentours et bouleverse l’ordre établi. A la suite de l’exposition, le MAMCS présente un nouvel accrochage des collections nommé D’Absurde à Zibou. Des citations empruntées au Dictionnaire abrégé du surréalisme (1938) sont mises en regard d’une sélection d’œuvres diverses dans leur forme et leur temporalité, de la toile La Fille à l’arrosoir (2010) de Françoise Pétrovitch à l’affiche His Majesty(1897) de Dudley Hardy jusqu’à la sculpture Développer sa propre peau (1970) de Guiseppe Penone. Peu orthodoxe, le Dictionnairese présente comme un collage de citations tant théoriques que littéraires, écrites par les surréalistes et leurs maîtres. Ces dernières sont associées à quelques œuvres des surréalistes. L’exposition propose une transposition du Dictionnaire abrégé : les rencontres hétéroclites d’œuvres adaptent la poétique régissant le Dictionnaire aux collections d’art moderne et contemporain du MAMCS. La reproduction des lettrines, dans la même typographie que celle de l’ouvrage, étend l’espace de la page aux dimensions des cimaises. La scénographie sage et épurée, type white cube, rappelle l’uniformité des pages de dictionnaire. Pourtant, la régularité de la mise en espace avec la lettrine surplombant une à trois citations, le tout aligné dans une même colonne soulignée par l’éclairage vertical, contraste avec l’éclectisme des rencontres et le met en valeur. La lettre fait repère. Plus, elle est un point de ralliement entre des œuvres d’univers mental et géographique différents. Bouleversant l’habituel accrochage chronologique sans pour autant s’assimiler à une organisation thématique, la forme fragmentée du dictionnaire donne à voir une nouvelle lecture de l’histoire de l’art, non plus linéaire mais poreuse.

La lettre comme trait d’union,D’Absurde à Zibou au MAMCS / Photo : P. Dancin![]()
Le bouleversement poursuit sa route à l’étage, avec le dispositif ExpériMAMCS #3 Dans les rêves d’Alice… un espace expérimental et créatif en partie dédié aux familles.
Un espace préliminaire prépare le visiteur à plonger dans l’univers d’Alice avec La Chambre d’Ame, une illusion d’optique reposant sur une perspective truquée. Le dispositif joue avec la perception du visiteur. Voyeur, il observe, par le trou de serrure, ses acolytes subir les mêmes déformations que la jeune fille : grandir et rapetisser. Son regard déséduqué, le visiteur est prêt à commencer son voyage initiatique dans le pays des merveilles. Le premier espace, antichambre de la création, obscure et théâtrale, est dédié au langage poétique et à la liberté lexicale des habitants que croise Alice. Différents jeux de langue sont mis à disposition. La seconde station invite le visiteur à peupler le pays en maniant le crayon de couleur. Le dernier espace se présente comme un terrain de jeux où les maillets côtoient un jeu de l’oie.

Changer son regard, l’illusion de la Chambre d’Ame, ExpériMAMCS#3 / Photo : P. Dancin![]()
Les deux dernières séquences s’ancrent dans deux épisodes du roman : la mare aux larmes et le terrain de croquet de la Reine Rouge. La scénographie immersive donne à voir et à ressentir ces différents lieux par le travail des couleurs, des matières et des surfaces, par la sonorisation discrète de la mare où se fait entendre le bruissement des insectes, et surtout par les illustrations d’Amandine Laprun. Conçu en collaboration avec l’illustratrice, cet espace féerique aux allures d’album jeunesse transforme l’imaginaire d’une artiste contemporaine en porte d’entrée dans la fiction. Œuvre spatiale qui mobilise les corps, œuvre ouverte qui en appelle à créativité des visiteurs, le dispositif favorise la porosité des imaginaires.

Le terrain de croquet de la Reine selon l’illustratrice Amandine Laprun, ExpériMAMCS#3 / Photo : P. Dancin![]()
« Voyons un peu : 4 x 5 font 12 »… et 5 x 1 font 1
Illusion d’optique ou déformation arithmétique, Surréalice rassemble sous un même titre cinq expositions : trois au MAMCS, une au Musée Tomi Ungerer et une à la médiathèque André Malraux. Indépendantes, les expositions se visitent librement, sans ordre préétabli. Mais, l’autonomie ne signifie pas séparation. La réunion des institutions autour d’une programmation commune n’est pas artificielle, elle ne se limite pas au partage d’une même thématique. Entre unité commune et singularités individuelles, les institutions se réunissent autour du même angle, celui de la réception et l’adaptent à la particularité de leurs collections.
Mais le lien se fait aussi par la prise en compte de la réception des visiteurs. Des échos discrets dessinent des ponts entre les expositions, créent des espaces de porosité dans l’expérience de visite. Les illustrations sexualisées d’Alice par Antoine Bernhart leur rappelleront peut-être la séquence dédiée au corps transgressif au MAMCS, tandis que le wall-paperreproduisant l’Alice à la Neige de Roland Topor dans les derniers mètres de l’exposition ne manquera pas d’évoquer les croquis préparatoires de l’artiste présentés au Musée Tomi Ungerer, tout comme l’espace ExpériMAMCS#3 s’inscrit dans la continuation d’Illustr’Alice. Ces liens – non explicités – évitent tout effet d’exclusion et suscitent des effets de reconnaissance voire d’étrange étrangetéchez les visiteurs découvrant un deuxième volet de Surréalice. Une des réussites de cette programmation repose bien dans la finesse de ce jeu d’échos, de coïncidences, de rencontres qui mobilise la mémoire des visiteurs et dessine dans leur inconscient un espace ouvert et fluide. Discrètement, elle donne à vivre ce que Lewis Carroll donne à lire dans ces deux romans.
Ainsi, plus que la somme de ces cinq expositions, Surréalice englobe tout l’espace interstitiel, laissé ouvert aux cheminements des visiteurs. Si l’exposition dans son ensemble présente la diversité des réceptions d’une même œuvre, elle trouve avec ces cinq expositions autonomes mais néanmoins reliées, la forme juste pour porter ses intentions.
Pauline Dancin
1Umberto Eco, Lector in fabula, 1985
Lewis Carroll et les surréalistes, MAMCS
Commissariat : Barbara Forest conservatrice en chef du patrimoine et Fabrice Flahutez spécialiste du surréalisme.
Scénographie : Martin Michel
Identité visuelle : Tandem, Costanza Matteucci et Caroline Pauchant
Illustr’Alice, Musée Tomi Ungerer
Commissariat : Thérèse Willer, conservatrice en chef honoraire
Pour en savoir plus :
- Catalogue : Fabrice Flahutez, Barbara Forest, Thérèse Willer (dir.), Surréalice, Musées de Strasbourg, 2022
- Vidéos de présentation des expositions par leurs commissaires
L'article est aussi disponible sur le site Littératures modes d'emploi : https://www.litteraturesmodesdemploi.org/carnet/surrealice-musees-de-strasbourg/
#Alice au pays des merveilles #Surréalice #Lewis Carroll
De bateau-école à bateau-musée : la Duchesse Anne de Dunkerque
Un son de cloche retentit près du musée portuaire de Dunkerque, venant du navire La Duchesse Anne : à son bord, une enfant pleine de joie se rêve matelote, tenant du bout de ses bras la corde d’un gong des mers.
Le bateau-école La Duchesse Anne, devant le Musée Portuaire de Dunkerque, AD
Dès votre montée sur le trois-mâts, vous découvrez les cordages, les filets et tout ce dont un voilier avait besoin pour être manœuvré par plus d’une centaine de paires de bras, poussé à la simple force du vent afin de sillonner les eaux du globe. À vos yeux, le navire semble intact, comme s’il n’avait jamais navigué. Vous êtes sur La Duchesse Anne. Face à vous se dresse le mât principal, vous levez la tête pour apprécier ses 48 mètres de hauteur, mais à peine avez-vous atteint sa fusée que vous entendez un son de cloche provenant du pont supérieur à l’avant. Annoncerait-il le début d’un événement ? Comme une reconstitution de la vie des matelots sur le navire ? Vous vous approchez et voilà que sonne la cloche de nouveau, cette fois suivie d’un rire d’enfant. Lorsque vous l’apercevez, vous voyez une petite fille trônant fièrement au côté de la cloche, face à ses parents immortalisant le moment.
La cloche de quart n’est pas très grande, a fière allure et paraît ancienne. À ses pieds se trouve une corde qui remonte jusqu’au battant. La famille s’en va et deux visiteurs habitués s’approchent, empoignent la corde puis la tirent. Un son agréable et peu commun, mais une pensée vous submerge : « Comment est-ce possible ? Ce bateau fait partie de la collection du musée, c’est un objet patrimonial qu’il faut conserver. A-t-on vraiment le droit de le manipuler ? » Aucune barrière ni aucun panneau pour nous interdire de la toucher. D’ailleurs, vous ne le remarquez que maintenant, mais à l’exception de quelques panneaux narrant l’histoire du navire, il n’y a que très peu d’éléments muséographiques.

Cloche du bateau-école La Duchesse Anne, AD
Le bateau, entièrement rénové, est aujourd’hui un bateau-musée. La cloche est bien d’origine et on peut la manipuler, on y est même invité ! Tout comme plusieurs autres éléments du navire, que vous pourrez découvrir au gré de votre visite.
Le bateau-école
Ce navire a été construit en 1901 dans le chantier de Bremerhaven. Eh oui, à l’origine, c’était un navire allemand, et plus précisément un bateau-école qui servait à la formation des futurs matelots et officiers de la marine marchande jusqu’en 1932. Il s’appelait le Großherzogin Elisabeth. C’est au terme de la Seconde Guerre mondiale qu’il est passé sous pavillon français lorsqu’il a été offert par la Grande-Bretagne en tant que dédommagement de guerre. Depuis, la Marine nationale n’en avait guère l’utilité, à l’exception de quelques fois où il était utilisé comme dortoir pour des casernes ou des colonies de vacances. Petit à petit, il a été délaissé et régulièrement squatté, jusqu’en 1981 où il a été racheté par la ville de Dunkerque pour un franc symbolique.
Cet achat inaugure un nouveau cap pour la vie du navire devenu épave. L’association Les Amis de La Duchesse Anne est fondée pour le rénover entièrement et l’entretenir. Au terme de vingt années de labeur et en l’honneur de son centenaire, la Duchesse Anne devient un bateau-musée, fleuron de la flotte du Musée Portuaire de Dunkerque.
Conserver et exposer un bateau à flot
Avant de monter sur le navire, si vous demandez à l’agent d’accueil ce qui est visitable, il vous répondra : « tout, mais que les quartiers du capitaine sont actuellement fermés au public en raison d’infiltration d’eau ». Un comble pour un bateau. En effet, celui-ci n’a jamais été conçu pour être un lieu de médiation, ni même pour rester indéfiniment à quai. Non pas qu’il serait mieux conservé en mer, mais que son usage obligerait à entretenir et à remplacer ses pièces. Depuis qu’il fait partie des collections du musée, c’est à présent l’établissement et non plus l’association qui en a la charge. Bien qu’il soit régulièrement entretenu aux frais de la communauté urbaine, force est de constater qu’il subit les affres du temps : que la rouille se développe au même titre que la moisissure sur le bois, au point où même la végétation commence à y pénétrer. À noter que cette dernière était inattendue et plaisante à voir sur le pont, d’autant plus qu’elle dénote avec le caractère industriel du port.
Il ne restait pas grand-chose du navire lorsqu’il a été récupéré par Dunkerque : il n’y avait plus de voiles, une ancre manquait, sans compter le mobilier porté disparu, mais il restait la cloche de quart, qui est d’origine et qui n’avait par chance jamais bougé. La manipulation s’oppose sans doute à la conservation, mais quoi de mieux pour le visiteur, voire une cloche derrière une vitrine où la voir en action, ce pour quoi elle a été destinée ? Conserver, ce n’est pas uniquement faire perdurer un objet dans le temps. Conserver un objet c’est aussi conserver son usage. Comme les matelots, sonnons la cloche.

Ancre du bateau-école La Duchesse Anne & végétation sur le pont, AD
Dans la peau des matelots
De bateau-école à bateau-musée, le trois-mâts est un outil pédagogique. Son objectif muséographique est de faire découvrir aux visiteurs la vie des matelots et officiers à bord, en passant par le nettoyage des ponts, l’entretien des voiles, les cours de langue ou encore la cuisine. En dehors des visites guidées, les visiteurs ont à disposition un document-guide qui les conduit dans les différentes parties du navire : c’est lui qui narre l’histoire du bâtiment et le quotidien de ses occupants.
Je m’attendais à des mises en scène afin d’apprécier au mieux le quotidien des marins, mais le navire en était dénué. Il y a bien des tables d’époque, quelques hamacs et l’aménagement sommaire des quartiers des officiers, mais pas plus. Je n’avais que le document-guide, des panneaux et mon imagination pour entrevoir les activités qui s’y tenaient cent ans avant que j’y pose les pieds. Seules les quelques photographies d’époque de l’intérieur du navire permettent de se rendre compte de sa vie passée.

Quartier d'équipage du bateau-école La Duchesse Anne, aujourd'hui et avant, AD
Toutefois, la visite n’en reste pas moins impressionnante pour quiconque rêve un jour de mettre les pieds sur ces voiliers d’antan. La Duchesse Anne possède une histoire très riche, bien mise en avant. Quant à la volonté de nous faire découvrir la vie de ses matelots, c’est une idée développée lors des médiations, mais qui reste timide en visite libre, la faute à une scénographie légère. Aujourd’hui, le navire est toujours ouvert au public, sauf parties fermées dans l’attente d’une prochaine restauration, qui, avec un peu d’espoir et de financement, s’accompagnera d’une scénographie plus ambitieuse.
Antoine Dabé
Pour en savoir plus :
- Daniel Le Corre, Le Trois-mâts « Duchesse-Anne » : Collection Mémoires de nos voiliers, puis collection « Bretagne », Montreuil-Bellay, éditions CMD, 1999
- Jean-Louis Molle, Le Trois-Mâts carré « Duchesse Anne », ex voilier-école allemand « Grossherzogin Elisabeth », Punch Éditions, 1999.
- La Duchesse Anne sur le site de la ville de Dunkerque (ville-dunkerque.fr).
- Viste des bateaux : Duchesse Anne et Sandettié, Spirit of Dunkerque, tourisme et congrès (dunkerque-tourisme.fr).
- Duchesse Anne (trois-mâts carré), Wikipédia (fr.wikipédia.org)
#DuchesseAnne #Dunkerque #MuséeBateau

De la mémoire au patrimoine : les collections agricoles de la Ville de La Courneuve
La Ville de La Courneuve, située en Seine-Saint-Denis dans la très proche banlieue de l’agglomération parisienne, a engagé depuis 2019 un chantier des collections conséquent. Détentrice d’une collection agricole de plusieurs milliers d’objets issue d’un écomusée fermé depuis les années 1990, elle explore des utilisations patrimoniales non muséales pour ces dernières.
Image d’introduction : Vue de la ville de La Courneuve dans les années 1960 © Ville de La Courneuve
Raconter l’histoire du territoire
A l’aube des années 1980, la Ville de La Courneuve engage un processus de reconnaissance et de sauvegarde du patrimoine local. La constitution de ce dernier est l’occasion, pour la municipalité, de proposer une offre culturelle aux habitants mais également de mettre au point un récit de l’histoire locale dépassant les difficultés frappant le territoire, entre désindustrialisation et dégradation des immeubles de la Cité des 4 000 Logements bâtie au début des années 1960.
Ce processus se développe autour de trois thématiques : l’archéologie, le patrimoine bâti et le patrimoine rural, ce dernier témoignant des activités agricoles qui ont fait la gloire du territoire.Au milieu du XIXe siècle, La Courneuve fait, en effet, partie des trois centres principaux pourvoyant la ville de Paris en cultures maraîchères. Situé en plein cœur de la Plaine des Vertus, l’activité agricole se poursuit jusque dans les années 1960 avant de céder la place à l’urbanisation.
C’est ainsi qu’en 1981 une exposition sur l’histoire rurale du territoire est organisée à l’Hôtel de Ville afin de commémorer cet héritage. A la suite de cet évènement, des agriculteurs apportent à la direction des affaires culturelles de la Ville des objets en rapport avec leurs activités professionnelles, ce qui pousse les équipes à engranger la constitution d’une véritable collection ethnographique. En 1983, un « musée des cultures légumières » voit le jour au 11, rue de l’Abreuvoir, une ancienne maison maraichère. Ce musée se transforme progressivement en écomusée où contempler les espaces intérieurs et extérieurs d’une maison de cultivateurs avec ses mobiliers, ses outils, mais aussi des tombereaux et tarares. Cette installation, complétée par le jardin cultivé, crée un îlot de ruralité au cœur de la Ville.

Cour intérieure du musée des cultures légumières au début des années 1990 © Ville de La Courneuve
C’est l’Association Banlieue Nord, mise en place sous l’égide du Maire en 1983, qui est chargée de la gestion du musée et la valorisation de ce patrimoine courneuvien particulier. Ses membres sont notamment chargés de développer des recherches ethnologiques sur ce sujet, ce qui se traduit par un important travail de collecte de témoignages, d’archives et d’éléments patrimoniaux relatifs à l’histoire agricole courneuvienne et, plus largement, régionale, dans une approche comparative et pluridisciplinaire. Le musée rencontre, en 1992 et 1995, un certain succès, notamment auprès des publics scolaires. La mise en place du « Marché au musée », qui se tient deux fois par an sur le site, permet la découverte du musée par un public plus large.
Une impasse muséale
Le musée ferme en 1995, officiellement pour des raisons de sécurité dues au bâtiment. L’arrêt des activités muséales entraîne paradoxalement un accroissement des collections qui sont mises en réserve dans une friche industrielle, dans des conditions de conservation discutables et qui comprennent au début des années 2000 entre 6 000 et 8 000 objets. Dix ans plus tard, une nouvelle estimation indique 25 à 45 000 items. Ce volume finit par constituer une impasse, tout projet de conservation et de valorisation se trouvant contraint par cet excès d’objets.
En 2002, un audit commandé à l’entreprise Option Culture préconise la (re)création d’un structure muséale, portée par d’autres collectivités et dédiée au patrimoine rural régional. Pourtant, le Département et la Région s’opposent à ce projet, et la Ville se voit contrainte de rassembler seule les moyens humains et financiers pour concevoir un projet patrimonial cohérent, mais l’absence de lieu d’exposition limite le champ des possibles. Dès lors, il est décidé que la monstration des collections se fera hors-les-murs, et que la politique de valorisation des collections se fera par des prêts et dépôts auprès de partenaires issus ou non du champ patrimonial, à l’occasion d’expositions réalisées avec l’exposition Savez-vous planter les choux, réalisée au Parc de Bagatelle avec la Ville de Paris en 2012.

Vue de l’exposition Savez-vous planter les choux ?tenue au Parc de Bagatelles en 2012 © Ville de La Courneuve
La nécessité de libérer l’espace accueillant les collections pousse la municipalité à entériner un déménagement des collections en direction du sous-sol du Centre Culturel de la Ville. Le site présente en effet des conditions de conservation préventive satisfaisantes (température et hygrométrie stables) mais ne permet pas d’accueillir l’intégralité des collections. En 2018, la mise en place d’un chantier de déménagement est actée par la Ville, articulée à un chantier de tri. Une méthodologie est définie avec Fleur Foucher, conservatrice-restauratrice spécialisée en conservation préventive. Les éléments dont la conservation devient impossible en raison de leur état général (infestation par des insectes xylophages, corrosion, présence de champignons, etc.) sont éliminés. Cette approche sanitaire est complétée par une réduction du volume des ensembles récurrents (cagettes, sacs en toile de jute, vannerie etc.). Ce tri interroge la valeur patrimoniale de chaque objet, sa singularité, son lien avec le territoire ou son articulation avec un ensemble d’objets, un donateur-témoin, etc.

Chantier des collections en 2019, au sein de l’ancienne halle industrielle © Ville de La Courneuve
Finalement, le chantier mobilise pendant quatre mois une équipe de six spécialistes en conservation-restauration et six techniciens d’art ainsi que le chargé de projet de la Ville. Il aboutit à un inventaire de 2079 lignes d’inventaire pour un ensemble de 3575 items allant du véhicule hippomobile ou motorisé aux cloches à salades. Une restitution est réalisée en février 2020 lors du colloque annuel de l’APrévU (Association des Préventeurs Universitaires) au Mobilier National.
De nouvelles réserves pour un nouveau projet patrimonial
Mais ce chantier des collections est aussi et surtout le moyen d’envisager, au sein de la Ville, une refonte du projet patrimonial et culturel à partir d’une collection resserrée et dont la conservation est dorénavant soutenable. Le Conseil municipal valide ainsi le principe d’une « banque d’objets patrimoniaux » dans les sous-sols du Centre Culturel Jean Houdremont, prêtables à l’occasion de projets patrimoniaux mais aussi de projets de médiation au sens large. Un partenariat est notamment noué avec la Ferme ouverte de Saint-Denis, voisine du territoire et gérée par les Fermes de Gally dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de Saint-Denis. Cette structure vise à faire découvrir l’agriculture d’hier, aujourd’hui et demain aux publics, et dispose d’un espace muséographique intérieur et extérieur dans lequel les collections courneuviennes sont désormais visibles par les publics de façon permanente.

Vue d’une des salles de la Ferme de Gally, où sont exposées les collections courneuviennes © Lucile Garcia Lopez
La préparation du chantier d’implantation des réserves dans les sous-sols du Centre culturel est en cours. Il s’agit désormais d’installer en 2022 et 2023 du mobilier de rangement permettant de déconditionner les collections, actuellement stockées dans des caisses en plastique et sur palettes. A partir de la fin 2022, ces réserves permettraient un travail de valorisation auprès des acteurs concernés par ces thématiques. L’intérêt de plusieurs institutions patrimoniales nationales (Institut national du patrimoine, Centre national des arts et métiers, MuCEM) et la conduite de certains projets en lien avec les collections, sont autant d’éléments témoignant de l’attachement à ces collections, susceptibles d’être mobilisées dans différents projets.Enfin ce chantier s'inscrit dans une logique plus globale incluant également les maisons maraîchères du 9 et du 11, rue de l’Abreuvoir, dont les espaces cultivables pourraient être mis à la disposition du public dans le cadre de médiations dédiées au patrimoine agricole.
Ainsi, sur ce territoire où les espaces agricoles ont disparu, les collections de La Courneuve pourraient constituer un vecteur de la transmission d’une histoire locale aux nouvelles populations courneuviennes, originaires du monde entier. A l’aune de problématiques écologiques et urbaines toujours plus pressantes, le patrimoine rural se ferait ainsi tisseur de lien social, en capacité de mobiliser les habitants du territoire dans une démarche collective autour des questionnements sur nos modèles alimentaires et économiques contemporains.
Lucile Garcia Lopez
Pour aller plus loin :
- Site de la Ville de La Courneuve
- Mikaël Petitjean, « Quel projet pour quels objets ? », e-Phaïstos, IX-2 | 2021
#Patrimoine #Collections #Ethnologie

Déambuler dans les marges, et oublier Ronsard : le prieuré saint Cosme
Contre la fatigue muséale, pourquoi ne pas prendre le temps de déambuler dans les jardins ?
Overdose muséale… et littéraire
Travaillant dans un musée depuis plusieurs mois, j’ai parfois l’impression de manger musée, dormir musée, lire musée. Chaque weekend, je ressens davantage une fatigue muséale, qui retire une partie du plaisir de la découverte de nouveaux lieux : comment apprécier la visite de centres d’interprétation, musées et autres sites patrimoniaux, quand toute déambulation se mue en observation fine des vitrines, cartels, degré d’accessibilité des textes ? La tête remplie de tous ces critères d’évaluation, comment apprécier « simplement » la visite ?
Lorsque, à l’occasion d’une sortie entre amis, ces derniers proposent de quitter la ville de Tours pour visiter le Prieuré Saint-Cosme à La Riche, petite commune des alentours, j’appréhende. Je n’ai cette fois aucune envie de lire des textes, or nous allons vers une maison d’écrivain, la demeure de Ronsard…
J’imagine alors un vieux bâtiment religieux, remis au goût du jour alternant vieilles pierres et espaces d’interprétation un peu daté, saturé de textes, des guirlandes de poèmes envahissant les murs. J’imagine un personnage grisonnant accompagnant la visite, ponctuant les murs de citations pseudo-inspirantes. J’imagine des roses tapissant les murs, mon seul souvenir de l’écrivain étant ces vers issus des Sonnets pour Hélène(1578) croisés pendant mes études : « […] Vous serez au foyer une vieille accroupie // Regrettant mon amour et votre fier dédain. / Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain : / Cueillez des aujourd’hui les roses de la vie ». Me revient en mémoire alors l’indignation ressentie devant ces vers empreints de sexisme, le poète affirmant que la femme qu’il courtise ferait mieux de s’abandonner à lui dans sa jeunesse, car elle sera bientôt vieille, et donc selon lui fatalement laide et non désirable, regrettant l’attraction dont elle faisait jadis l’objet. Comme si la beauté de cette femme se résumait à sa jeunesse, comme si une femme était un consommable doté d’une date de péremption.
Avec la plus grande méfiance, et persuadée de détester cette visite, j’entre dans le prieuré.
Pour, finalement, me laisser surprendre.
Entrer…
L’hôte d’accueil nous propose dès l’entrée un jeu de piste pour accompagner notre découverte des lieux. Sur une planche, un classeur de quelques fiches successives nous invitent à deviner l’emplacement d’« indices ». Disséminés dans le parc et les bâtiments, ces indices gravés nous révèlent chacun un mot, à reporter sur la planche pour deviner les mots manquants d’un poème. La visite jouée nous est proposée spontanément, et ne semble pas destinée à un public enfant. Tout au long de la visite, nous chercherons donc ces indices, ce qui ravivera régulièrement notre intérêt.
L'aménagement du prieuré est assez récent : d'importantes fouilles archéologiques ont été menées entre 2009 et 2012, permettant de mettre au jour des bâtiments inconnus auparavant, comme l'église construite aux alentours de l'an Mil. Le site a pu rouvrir en 2015 avec un nouveau parcours de visite, qui comprend des salles d'interprétations, dont la réalisation scénographique a été confiée à In Site, mais également une succession de jardins mêlant inspirations médiévales et contemporaines, aménagés par Bruno Marmiroli, architecte et paysagiste.
En quittant l’accueil, une grande salle nous fait ainsi découvrir l’histoire du site, qui était autrefois une île de la Loire, et les découvertes archéologiques dont il a fait l’objet, notamment les tombes des moines ayant fréquentés le prieuré. Les objets sont peu nombreux et présentés très sobrement, en vitrine, et comme posés sur une sorte de sable noir. L’essentiel de la pièce est consacré à un dispositif numérique (réalisé par MG Design et 100 millions de pixels) : une reconstitution 3D du prieuré, qui permet d’en comprendre l’évolution sur plusieurs siècles, ainsi que la fonction des différents espaces que nous nous apprêtons à visiter (ou non, car tout n’a pas été restauré). Si cet effet 3D semble un peu daté malgré sa réalisation récente, les technologies de modélisation 3D évoluant souvent plus rapidement que le temps nécessaire à la réalisation d'un parcours muséal, la présentation est claire et la manipulation intuitive. Elle l’est d’autant plus que, même si une seule personne manipule la tablette, le contenu de l’écran est repartagé sur le mur du fond par une projection. Les autres personnes se trouvant au même moment dans la salle peuvent donc en profiter sans nécessairement attendre leur tour.

Vue du dispositif. (Photo : SN)
Déambuler
En sortant de cette salle, nous arrivons dans le parc. La signalétique, discrète, indique sobrement les différents bâtiments, sans qu’un ordre clair nous enjoigne à partir dans une direction précise.
Le temps est doux, il a plu les derniers jours et l’herbe est grasse autour de nous. Nous avançons, des hamacs se balancent entre les arbres et nous invitent. Nous nous y installons quelques minutes, avant de reprendre notre déambulation.

Vue des jardins. (Photo : SN)
Des bornes présentant des poèmes de Ronsard sont disséminées dans le parc, sans que nous nous sentions obligés de les lire. Nous avons simplement lu en arrivant que Ronsard avait été prieur dans ce lieu. A la direction du Prieuré Saint-Cosme, il s’est occupé de ses jardins et de sa rénovation pendant quelques années, tout en restant aumônier pour le roi Charles IX. Nous ne nous sentons pas obligés d’aller plus loin dans la compréhension de son œuvre, en revanche nous apprécions de pouvoir lire le paysage et comprendre l’esprit qui a guidé ses écrits et accompagné les dernières années de sa vie.
Les jardins odorants et colorés sont à la fois utilitaires (verger, potager, plantes médicinales) et « profanes » (jardin des parfums, espace dédié aux roses…), comme ils l’étaient de son vivant. La végétation ponctue notre visite, nous incitant aux pauses régulières.
L’espace se comprend de façon intuitive : certains espaces sont restaurés ou reconstruits, d’autres simplement suggérés. Une construction en bois symbolise l’ancien plan de l’église, dont il ne reste que les vestiges du chœur, au sein desquels fut inhumé Ronsard. Découverte au XXe siècle lors de fouilles, sa dépouille y a été réinhumée après identification. Nous nous arrêtons quelques instants devant sa tombe gravée d'une épitaphe qu'il avait lui-même choisie. Nous longeons le jardin du cloître jusqu’au miroir d’eau, censé évoquer les ablutions rituelles liés aux rites de purifications.

Vue des jardins, avec les vestiges de l’église et le plan d’eau. (Photos : SN)
Contempler
Après cette pause printanière, nous entrons dans le réfectoire. Cet espace est régulièrement occupé par des expositions temporaires, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui. Le lieu est vide, et en même temps, il semble rempli d’une présence. Des couleurs inhabituelles se projettent sur le sol et les murs. En levant la tête, les vitraux ressemblent davantage à des glaces peintes, mais peintes à l’encre de Chine. En 2010, Zao Wou Ki a ainsi installé 14 vitraux dans cet espace. Les formes esquissées sur les vitraux sont discrètes, et laissent apparaitre en transparence les arbres, des morceaux de ciel et les murs extérieurs du réfectoire.

Vitraux de Zao Wou-Ki pour le réfectoire. (Photos : SN)
En ressortant, nous croisons une forme étrange plantée dans l’herbe. Nous l’avons déjà vu à deux reprises dans le parc, sans l'identifier. Le livret de visite nous indique son utilité : il s’agit d’une installation de Bruno Salay, intitulée Contemplations.Constituée de sept assises réparties dans le parc, cette œuvre propose d’expérimenter le paysage. A la façon des plantes, qui poussent différemment en fonction de l’endroit où elles ont été plantées, Bruno Salay nous propose d’expérimenter ce que produit sur nous et en nous le fait d’être « ici et maintenant ». Face à cette brise, à l’ombre de cet arbre, ou en plein soleil au milieu des pierres, qu’est-ce qui change ? Qu’est-ce que je sens, qu’est-ce que je ressens différemment ? L’emplacement des assises est régulièrement modifié par les jardiniers, qui les sélectionnent avec soin au fil des saisons. Un QR code nous renvoie à une consigne sonore : « S’assoir. Regarder avec soin autour de soi. Mémoriser autant que possible les végétaux, les matières, les éléments architecturaux. Le temps nécessaire. Procéder lentement, avec un esprit paisible. »

Contemplations, Bruno Salay. (Photo : SN)
Créer à quatre mains
Le corps et l’esprit reposés, j’accepte finalement de bonne grâce d’entrer dans l’exposition littéraire située dans la cuisine du prieuré. La muséographie est minimaliste et très rudimentaire : quelques panneaux de textes, des vitrines alignées, des numéros renvoyant à des cartels groupés. Nous regrettons ce jeu de renvois par numérotation, mais apprécions les ouvrages qui y sont présentés : il s’agit de la collection de livres pauvres du prieuré : des feuilles pliées en quatre, sur lesquelles se déploient la collaboration d’un poète et d’un artiste plastique. Ces créations réduisent le plus possible le nombre d’intermédiaires classiques en évitant les imprimeurs, graveurs, ou relieurs. Chaque feuille est différente, métamorphosées par ces créations à quatre mains, qui réduisent parfois le papier à ses plis.
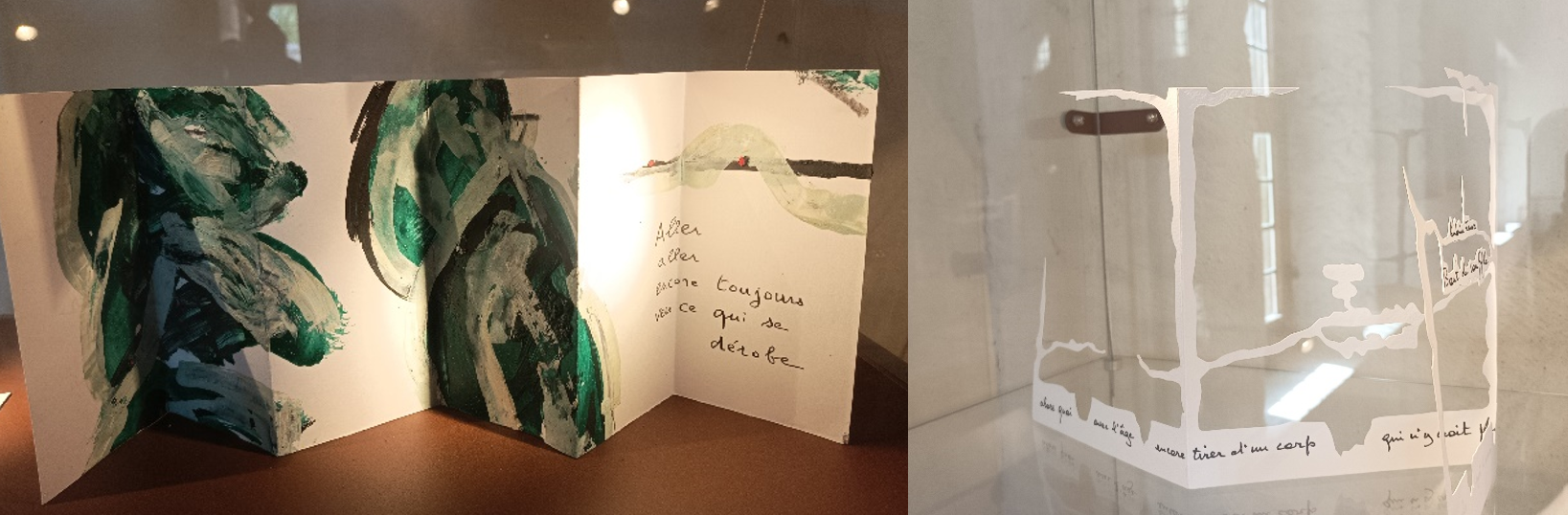
Livres pauvres de la collection du Prieuré. (Photos : SN)
Loin de se consacrer uniquement à Ronsard, le Prieuré donne ainsi à lire et à regarder quelques-uns de ses 2500, livres pauvres en éditions limitées réalisés par des auteurs et plasticiens tels que Daniel Leuwers, Michel Butor, Andrée Chedid, Annie Ernaux, Pierre Alechinsky, Michel Nedjar, Vladimir Velickovic… Et ici la littérature se fait discrète, modeste, qu’elle ponctue les jardins de quelques vers ou s’expose entre deux traits d’encre.
Elle m’envahit moins que ce que je craignais, elle ne me fait pas peur et se laisse aborder plus simplement. L’espace du Prieuré est lui-même poésie : tout comme l’espace laissé blanc est essentiel dans cet art, les espaces liminaires de la demeure sont tout autant travaillés que ceux qui exposent véritablement des contenus scientifiques, historiques ou littéraires. La place est faite au corps comme à l’esprit, par le recueillement, la déambulation, le rien qui n’est pas « rien ». Elle nous incite à regarder ce rien et y voir quelque chose.
Et pour Ronsard, on verra plus tard ?
Nous quittons les lieux un peu précipitamment. A tant errer dans les jardins, il est déjà un peu tard pour visiter le logis, lieu d’exposition des éditions originales de Ronsard, de reconstitutions de son espace de travail. Nous y passons rapidement, en se promettant de revenir les explorer davantage.
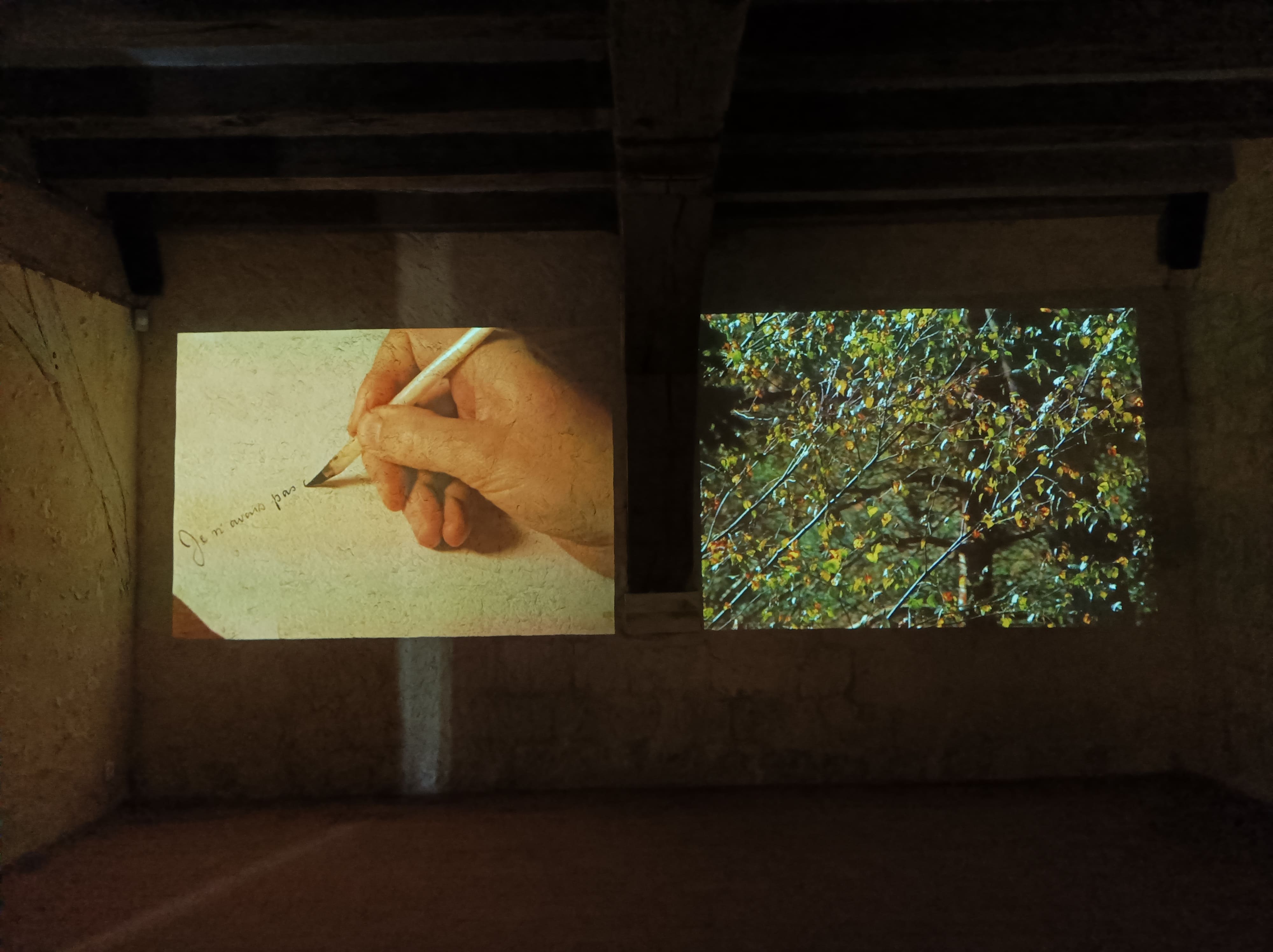
Film de présentation de la vie de Ronsard, réalisation : Compagnie Stasimon. (Photo : SN)
Je suspens pour l’instant mon jugement sur Ronsard. Je n’en connais finalement que des bribes, et si j’ai parcouru des murs qui lui sont consacrés, ce n’est finalement pas tant son œuvre que je retiens de ma visite mais davantage l’esprit du lieu, sa présentation tout en simplicité, et l’accueil fait au visiteur dans son entièreté, prêtant la même attention à son esprit, son corps et ses sens.
Sibylle Neveu
Pour en savoir plus :
- https://www.prieure-ronsard.fr/
- FlorenceCaillet-Baraniak, « Médiation numérique un site archéologique : à la rencontre entre réalité et virtualité », La Lettre de l’OCIM [En ligne], 172 | 2017, mis en ligne le 01 juillet 2018, consulté le 13 juin 2023. URL : http://journals.openedition.org/ocim/1811 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ocim.1811
- Vincent Guidault, « Le renouveau des jardins du Prieuré Saint-Cosme : Demeure de Ronsard », Jardins de France.org[en ligne], consulté le 13 juin 2023. URL : https://www.jardinsdefrance.org/le-renouveau-des-jardins-du-prieure-saint-cosme-demeure-de-ronsard/
#ronsard #prieuré #jardins

Depot Boijmans Van Beuningen, le dépôt aux multiples facettes
Depot Boijmans Van Beuningen. © Aad Hoogendorn
Le Depot Boijmans Van Beuningen, conçu par le cabinet d’architectes néerlandais MVRDV et inauguré en 2021 s’impose dans le Museumpark de Rotterdam comme le premier entrepôt d’œuvres d’art au monde entièrement accessible au public. Son architecture circulaire recouverte de panneaux miroirs reflétant l’environnement urbain qui l’entoure est une attraction en elle-même. Au-delà de son apparence iconique, le Depot interroge la manière dont un musée peut repenser son rapport au public et à la conservation de l’art. Est-il un simple dépôt visitable, une extension muséale ou un concept hybride redéfinissant les règles de la présentation artistique ?
Provenance des collections et leur nature, données et graphiques par © Depot Boijmans Van Beuningen
Un projet pionnier qui bouscule les codes muséaux
Traditionnellement, les réserves des collections des musées sont en grande partie inaccessibles au public, pour des raisons de conservation et de place. Le Conseil international des musées (ICOM) estime que 80 à 90% des collections muséales ne sont pas exposées et restent en réserve. Cette situation soulève des interrogations tant pour le grand public, qui peut percevoir ces œuvres comme inaccessibles, que pour les partenaires, les mécènes et les élus locaux, qui s’interrogent sur la visibilité et la valorisation de ces collections.
Le Depot Boijmans Van Beuningen prend le contre-pied en rendant visible l’intégralité de la collection du musée Boijmans Van Beuningen, soit plus de 154 000 œuvres. Ce désir engendre des choix particuliers à l’organisation des réserves : les œuvres ne sont pas classées par période ou mouvement artistique, mais en les regroupant en fonction de leurs exigences climatiques et matérielles.
Autour d’un espace central, sorte d’atrium déstructuré par des escaliers et passerelles (qui me fait penser à l’école de sorciers Poudlard !), le dépôt fonctionne comme un immense coffre de verre. Cette ligne artistique pensée par la designeuse Marieke van Diemen permet l’observation — des œuvres, des réserves, des ateliers de restauration — sous de nouveaux angles.
Vues de l’atrium central conçu par Marieke van Diemen, Depot Boijmans Van Beuningen. ©NC
Explorer, observer, apprendre : quand la pédagogie s’invite au cœur du dépôt
Le dépôt n’est pas seulement un espace de stockage ouvert au public, il s’agit d’un lieu de travail à ciel ouvert. Depuis les passerelles vitrées, les visiteurs peuvent regarder les restaurateurs et conservateurs à l’œuvre, voir les objets d’art déballés ou préparés pour le transport. C’est l’occasion d’observer en direct une restauration d’une peinture, pour raviver le teint d’une joue, les reflets de soleil sur un ruisseau. Le dépôt donne l’occasion de comprendre le cycle de vie des objets d’art.
Vue sur les réserves, Depot Boijmans Van Beuningen. © Aad Hoogendorn
L’absence de cartels classiques met en tension une expérience qui peut se révéler à la fois plus intimiste, grâce à la possibilité de voir les objets en vision 360 degrés, ou plus froide, en raison du détachement provoqué par l’absence initiale d’informations. Néanmoins, les visiteurs sont invités à scanner des QR codes pour obtenir des renseignements sur les œuvres, les plaçant dans une posture peut-être plus active de découverte.
À gauche : Les « chevalets en verre » de Lina Bo Bardi, 2022, © Boijmans Van Beuningen
À droite : Les QR codes © Boijmans Van Beuningen
Certains espaces du dépôt vont encore plus loin en proposant une hybridation entre exposition et atelier pédagogique en autonomie. Ils ne se contentent pas de montrer des œuvres : ils invitent le public à adopter la posture d’un chercheur en histoire de l’art. Un exemple marquant est l’initiative menée autour des dessins italiens de la Renaissance, où les visiteurs entrent dans la peau d’un expert : sans cartel explicatif immédiat, ils sont amenés à observer, comparer les styles, repérer des détails significatifs pour identifier les dessins.
Aperçu de Secrets of Italian Drawings, Dépôt Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 2024. © Lotte Stekelenburg.
Une identité hybride qui questionne le rôle des musées
Si le Depot Boijmans Van Beuningen se présente comme un projet visionnaire, il soulève néanmoins des interrogations sur son propre positionnement. Ce modèle où le public accède aux coulisses d’un musée est une innovation qui peut troubler ceux qui cherchent une narration claire ou une expérience d’exposition plus classique. L’absence de parcours structurant et l’utilisation du numérique pour accéder aux informations peuvent créer une distance avec les œuvres, rendant la visite déroutante pour certains.
Par ailleurs, en brouillant la frontière entre exposition et recherche, certains espaces du dépôt transforment la visite en une expérience participative, où le regard est plus analytique et interprétatif que contemplatif. Ce modèle, à mi-chemin entre la monstration d’œuvres et l’expérimentation pédagogique, introduit une nouvelle dynamique dans la médiation muséale, en faisant du spectateur un acteur actif de sa propre découverte.
Enfin, en raison des travaux de rénovation du musée Boijmans Van Beuningen, certains espaces du dépôt accueillent temporairement des expositions. Cette proximité permet au public de continuer à accéder aux collections du musée en dehors de ses dispositions habituelles. Ces installations confèrent au lieu une dimension muséale, bien que le Depot ne revendique pas ce statut. Cette ambiguïté interroge : est-on face à une nouvelle typologie d’institution, un entre-deux qui redéfinit la notion même de musée ?
Un modèle d’avenir pour les institutions muséales ?
Le Depot Boijmans Van Beuningen préfigure-t-il une nouvelle typologie d’institution, un entre-deux qui redéfinit la manière de concevoir l’accès aux collections muséales ? Il offre en tout cas une réflexion sur la transparence des institutions culturelles et sur la façon dont elles peuvent partager leurs ressources concrètes et intellectuelles avec le public. Une chose est certaine : en effaçant les barrières entre l’espace muséal et ses réserves, le Depot invite à repenser la relation entre conservation, exposition et interaction avec le public.
Nina Colpaert
#Rotterdam #muséeinsolite #réserves
Pour en savoir plus :
- Le site du dépôt : https://www.boijmans.nl/en/depot/about-depot
- Présentation de la médiation autour de l’exposition Secrets of Italian Drawings, Musée Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 2024 : https://www.plateforme-mediation-museale.fr/mediations/dans-la-peau-d-un-chercheur-sur-les-traces-des-dessins-italiens
- À propos des QR code présents dans le dépôt, un moyen de constituer sa propre réserve : https://www.boijmans.nl/en/depot/app
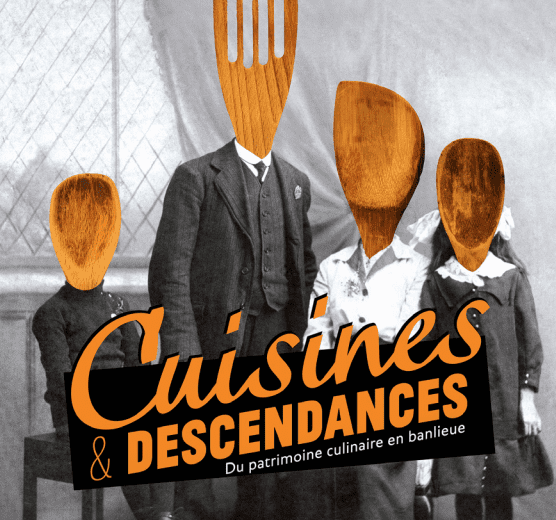
Dispositif participatif : quand le visiteur vient mettre son grain de sel
Rendre une exposition participative grâce à un dispositif suscitant des contributions de la part du public ? Sur le principe, l’idée est riche de potentiel. En pratique, les contributions sont souvent rares et assez peu intéressantes. Au-delà des montagnes de murs de post-it cornés, partons explorer le monde des dispositifs participatifs à la recherche d’une proposition intéressante susceptible de nous inspirer quelques pistes de réflexion.
Des visiteurs apportant leur contribution dans l'exposition Cuisines et Descendances ©RV
L’exposition sera participative ou ne sera pas
Le participatif est au musée ce que la couleur orange est à cette année 2022 : un phénomène de mode. L’idée de participation, de même que dans la vie politique, y est mise à toutes les sauces : on la greffe sur un projet d’exposition, on la tartine sur les documents de communication, on en presse le jus dans des publications et des colloques, on l’invoque jusqu’à en perdre le sens.
Pourtant, l’idée avait de quoi séduire. Si la participation peut susciter un engagement accru de la part du public, pourquoi s’en priver ?
Le concept de participation est apparu dans les années 1970, dans un mouvement de renouvellement du monde muséal qui a trouvé son expression dans l’éco-muséologie. Le principe de cette Nouvelle Muséologie est de donner une place accrue aux publics et aux communautés : le participatif peut y contribuer. C’est même une nécessité selon John Kinard, cité dans le recueil Vagues : Une anthologie de la nouvelle muséologie (1992) : « Si nous voulons que les musées survivent et qu’ils soient le vecteur des nouvelles valeurs culturelles, alors l’impératif majeur est la participation ». Quelques décennies plus tard, la participation a dépassé le monde des écomusées et s’est étendue à tous les champs d’action du musée. Le financement participatif, tel un arbre qui cache la forêt, pourrait nous faire croire qu’ouvrir son porte-monnaie est la seule contribution possible de la part du public. Bien au contraire : on peut contribuer à des inventaires ou des collectes participatives, à des opérations de sciences participatives ou encore à des expériences de commissariat ou de muséographie, elles aussi participatives. D’un parti-pris de rupture propre aux écomusées, l’idée de développer la participation des visiteurs est devenue une tendance installée dans le monde muséal. Le « musée inclusif et collaboratif » fait partie des axes de la Mission Musées du XXIe siècle « Inventer des musées pour demain ». Serions-nous déjà demain ? Le mot « participation » a fait son entrée dans la nouvelle définition du musée adoptée en 2022 par l’ICOM.
Le dispositif participatif, une baguette magique ?
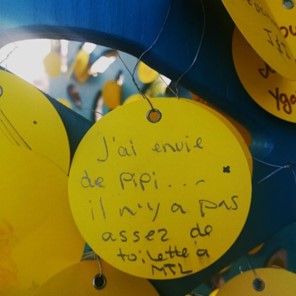
Un dispositif participatif dans l’espace public à Montréal ©RV
Adopter une pratique participative dans les domaines de la gestion des collections ou de la mise en exposition est un défi ardu pour le musée, ne serait-ce que parce qu’il implique de partager une partie de cette autorité muséale dont se drapent certains conservateurs, d’âme et de métier. Pas de panique ! Pour pouvoir cocher la case « participation » à moindre risque, une solution est possible : intégrer à une exposition un dispositif participatif. Un mur d’expression avant la sortie de l’exposition, quelques piles de post-it, trois crayons et dix gommettes, un écriteau « Donnez votre avis » … et le tour est joué ! Les visiteurs vont pouvoir s’exprimer, l’institution aura la conscience tranquille. Pourtant, quelques semaines plus tard, si les post-it tiennent encore au mur – ce qui est loin d’être acquis ! -, le dispositif, lui, tient rarement ses promesses : il faudra se satisfaire de quelques smileys, gribouillages, d’un « Jean-Michel était là » ou de quelques sympathiques « Coucou ! ».
Mais pourquoi donc les visiteurs ne s’emparent-ils pas de cet espace d’expression de manière plus intéressante ? Peut-être parce qu’ils ont senti que le musée ne portait pas grand intérêt à ce qu’ils pourraient y dire. De la même manière qu’un distrait « ça va ? », adressé sans s’arrêter à une lointaine connaissance, n’attend surtout pas d’autre réponse qu’un « oui, ça va » aussi évasif que trompeur, un dispositif participatif sans intérêt appellera des contributions sans intérêt.
Nina Simon, autrice de l’ouvrage de référence The participatoy museum (2010), l’explique lors d’une conférence TEDex : « Je pense que nous avons tous fait l’expérience de commentaires publics qui n’étaient pas très significatifs. […] J'y vois plus une opportunité manquée dans le fait de ne pas les avoir incités à donner du vrai contenu. Je crois que nous tous dans cette salle avons quelque chose de puissant et créatif à donner. Je crois que nous avons tous une histoire à conter, et chacun d'entre vous a probablement quelque chose d'étonnant à partager à ce stade aujourd'hui. Mais je sais aussi que nous pouvons tous être parfois banals. Nous sommes tous un peu stupides parfois. Et pour moi, qui m'efforce d'améliorer la participation, la différence se fait dans la conception de cette invitation à participer. Un bon design peut nous élever à donner le meilleur de nous-mêmes, le contraire est vrai aussi. » (retranscription et traduction française – YouTube)
N'est pas participatif qui le veut
C’est la rançon du succès : le participatif étant à la mode, on veut en mettre partout, au risque d’en perdre le sens et l’intérêt initial. Les écrits théoriques sont nombreux sur la co-conception, ils sont beaucoup plus rares à étudier les dispositifs participatifs. Cela induit une difficulté à cerner les contours de cette notion, d’autant plus que la participation, de manière générale, est difficile à définir. Comme l’écrit Alexandre Delarge dans Le musée participatif, l’ambition des écomusées, « Le mot « participation » englobe de nombreuses acceptions, ce qui peut conduire à des contresens, voire à des conflits ».
On qualifiera ici de participatif un dispositif suscitant l’engagement du visiteur en lui proposant d’apporter une contribution qui enrichira le contenu de l’exposition, sera visible par les autres visiteurs et valorisée par le musée.
Selon cette acception, le participatif ne peut être réduit à une notion avec laquelle il est parfois confondu : l’interaction. Proposer au visiteur d’appuyer sur un bouton pour voter suscite son engagement en le rendant actif. Cependant, selon le sens que l’on donne à ce geste, le dispositif peut être participatif ou seulement interactif. S’il s’agit de répondre à un quizz pour vérifier sa compréhension du sujet à l’issue de la visite, on préfère parler d’interaction, car le visiteur ne donne pas une contribution qui enrichit le contenu de l’exposition. Par contre, si, comme dans l’ancien dispositif Free2Choose à la Maison Anne Franck, il s’agit de se positionner dans un débat éthique grâce à un vote dont les résultats apparaissent dans l’espace d’exposition comme un sondage en temps réel, on peut dire que le dispositif est participatif. La contribution de chaque visiteur apporte réellement sa voix au débat.
Une fois cernée la notion de dispositif participatif, il s’agit de s’intéresser à une proposition considérée comme inspirante et susceptible de faire naître des pistes de réflexion.
Une exposition dans laquelle mettre son grain de sel !

Vue de l’exposition ©RV
L’exposition Cuisines et Descendances a ouvert en octobre 2022 à l’écomusée du Grand-Orly-Seine-Bièvre, une petite structure à la grande ambition, celle d’être « un musée qui change votre regard sur la banlieue ». C’est pour présenter et rendre hommage au patrimoine culinaire de la banlieue que l’écomusée propose cette nouvelle exposition temporaire. Elle présente, au cours d’une déambulation dans les pièces d’une maison, les différents aspects de la transmission culinaire. Pendant sa vie, chacun.e reçoit, s’approprie et transmet de nombreux éléments qui constituent ce patrimoine culinaire : des tours de mains, le goût des produits, des valeurs, des souvenirs, une passion pour la cuisine, parfois la charge qu’elle représente… et bien sûr, des recettes !
A la fin de l’exposition, le visiteur est invité à s’assoir pour partager sa recette fétiche. Il l’écrit sur un papier qu’il peut ensuite accrocher au mur, afin de la faire découvrir à d’autres visiteur.euse.s. Il peut aussi déposer sa contribution dans une « bonbonnière aux recettes », et, en échange, tirer une recette déposée par un autre visiteur pour la ramener chez lui. Il est invité à passer aux fourneaux, prolongeant donc la visite et la relation avec l’écomusée même une fois son portail passé.
La bonbonnière des recettes est présentée lors des évènements organisés par l’écomusée, afin de faire vivre la collecte, comme lors des Journées Européennes du Patrimoine. En faisant circuler les recettes entre les visiteurs, le musée laisse volontairement lui échapper certaines des recettes collectées. Cela pourrait paraître paradoxal dans un milieu habitué à la thésaurisation. C’est en fait un moyen de valoriser le caractère vivant de ce patrimoine, de partager ce qu’est la cuisine. Pour garder une trace de ces échanges de recette, le musée a créé le hashtag #jecuisineaveclecomusee, grâce auquel des photographies des recettes peuvent être partagées sur les réseaux sociaux.
Ce dispositif évite le piège fréquent du participatif gadget, ajouté à l’exposition « parce que ça fait bien ». Au contraire, la proposition est d’une grande cohérence par rapport à l’exposition. Avec son thème, d’abord, puisque l’on propose aux visiteur.euse.s de faire vivre cette transmission culinaire qui est au cœur de l’exposition. Dans la démarche, ensuite, puisque l’exposition a été conçue grâce à une collecte participative auprès des habitants du territoire. Les dix-huit personnes interrogées ont partagé leur expérience de la cuisine et ont désigné un objet et une recette par lesquels ils ont été présentés dans l’exposition. Le dispositif participatif permet donc de poursuivre tout au long de la vie de l’exposition cette collecte initiée lors de sa conception en recueillant les contributions des visiteurs et visiteuses, eux aussi majoritairement habitant.e.s du territoire.
Le graphisme de la feuille sur laquelle le visiteur écrit sa recette reprend d’ailleurs celui des recettes exposées. Nina Simon l’a prouvé, la qualité matérielle du dispositif proposé a un impact fort sur la qualité des contributions. Un visiteur prendra sûrement plus de soin à remplir une feuille cartonnée, de bonne qualité et bien présentée, que si on lui avait proposé un post-it – comme c’est souvent le cas dans les dispositifs participatifs ! -, support associé à des listes de courses, gribouillages ou notes sans importance et colorées. Ici, en plus de la qualité matérielle, la cohérence esthétique est extrêmement valorisante pour le visiteur, qui voit que sa contribution a le même statut que les recettes des personnes interrogées. L’exposition montre que les recettes constituent une partie de ce patrimoine culinaire de banlieue auquel s’intéresse le musée : il y a donc un intérêt sincère de la part du musée dans le fait de collecter les recettes des habitants. Il est d’ailleurs envisagé de publier, en guise de catalogue d’exposition, un carnet de recettes des habitants du territoire, qui regrouperait les recettes des 18 personnes interrogées et celles des visiteurs et visiteuses de l’exposition.
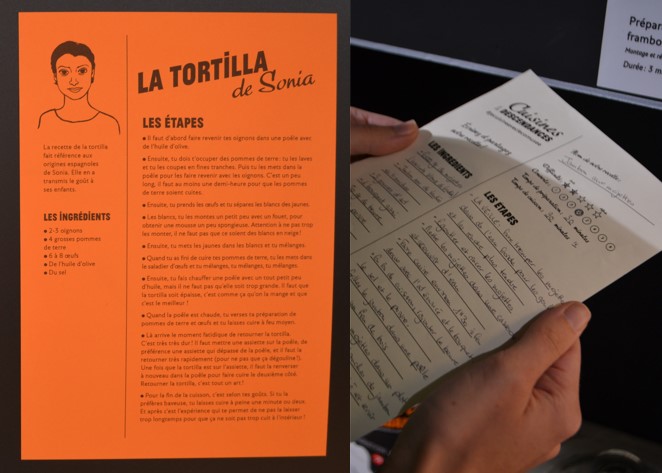
À gauche : La recette transmise par une habitante présentée dans l’exposition / À droite : Une visiteuse lisant la recette déposée par un autre visiteur ©RV
En guise de conclusion : quelques pistes
Alors, à partir de cet exemple, quelles pistes peuvent être mises en avant pour réfléchir des dispositifs plus enrichissants pour les visiteurs et le musée ?
Pour être le plus enrichissant possible, à la fois pour les visiteurs et le musée, un dispositif participatif gagne à :
- être lié à la thématique et au parti-pris de l’exposition, et donc à être pensé dès le début de la conception de l’exposition
- avoir un rendu esthétique qualitatif et cohérent avec le graphisme et la scénographie de l’exposition
- guider le visiteur dans sa contribution
- susciter des contributions intéressantes à la fois pour le visiteur qui participe et les autres visiteurs
- être pensé avec une valorisation des contributions par le musée (dans une exposition ou une publication, sur les réseaux sociaux…)
- prendre vie lors d’évènements ou grâce à la présence de médiateurs et médiatrices

Partage des recettes lors des Journées du Patrimoine 2022 : page Instagram de l’écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre
Raphaëlle Vernet
Si vous avez encore faim de découvertes :
- la page consacrée à l’exposition sur le site de l’écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre : https://ecomusee.grandorlyseinebievre.fr/programmation/expositions/grande-salle
- L’exposition Cuisines et Descendances a été conçue par l’équipe de l’écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre. Nicolas Franchot et Stéphane Rébillon en signent la scénographie et le graphisme. Rendez-vous à Fresnes pour la visiter d’ici mars 2024 !
- deux projets artistiques inspirants autour du partage des recettes de cuisine : le Grandmas Project, dont quelques vidéos sont présentées dans l’exposition (http://grandmasproject.org/fr/) et Kitchen, la cuisine transportable, un projet de Thorsten Baencsh et Christine Dupuis présenté dans une vidéo de Charlotte Grégoire (https://www.monoeil.org/kitchen)
#exposition #écomusée #participatif #cuisine #recettes

Donald Trump, maître d’œuvre d’une censure et réécriture culturelle : le cas Smithsonian
Universités et budgets réduits, menaces de mort ciblant l’historien Mark Bray, spécialisé sur l'antifascisme et réfugié difficilement en Espagne au mois d’octobre 2026, Donald Trump continue de s’en prendre à la culture.
Le 4 juillet 2026, les États-Unis, sous un air étouffant du Président Républicain Donald Trump, fêteront leurs 250 ans. De grandes célébrations sont prévues derrière des convictions jugeant toujours plus le monde culturel actuel trop “woke”. Dans la continuité de la restauration du Bureau ovale (ndlr. Initialement rénové sous la présidence de Barack Obama) comme il l’était sous George W. Bush, de la salle de Bal de la Maison Blanche ou encore de son projet présenté le 15 octobre 2026 d’Arc de Triomphe à Washington, dit l’“Arc de Trump”, s’inscrivant dans une volonté de s’inspirer de la Rome et la Grèce antiques, la présidence américaine entend persévérer la transformation de son paysage historique et culturel.
Une année compliquée pour la Smithsonian Institution
Créée en 1846 et située principalement à Washington DC, Smithsonian Institution possède des fonds historiques de plus de 157 millions d’objets et regroupe 19 musées, 21 bibliothèques et 14 centres de recherche et d’éducation. Gérée par le gouvernement fédéral avec un Conseil des Régents, elle bénéficie d’un financement public important et de fonds particuliers.
Retrouver la vérité et la raison dans l’histoire américaine.
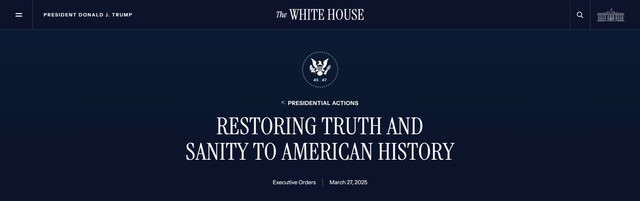
Capture d’écran - The White House
Restoring Truth and Sanity to American History est le titre du décret présidentiel du 27 mars 2025, posté sur le site de la Maison Blanche (The White House - whitehouse.gov) et signé quatre jours plus tard. Y sont accusées les institutions d’avoir un discours d’“endoctrinement idéologique” racial et perturbateur, où depuis quelques décennies, les Américains seraient confrontés à une “réécriture de l’histoire de leur nation”, remplaçant des “faits objectifs par un récit déformé”. L’institution de recherche scientifique américaine Smithsonian Institution en est la première cible. Par exemple son exposition “The shape of Power : Stories of Race and American Sculpture” (8 novembre 2014 - 14 septembre 2025) apprend au public que la sculpture a été un outil puissant de la promotion du racisme, rappelant l’histoire colonisatrice et esclavagiste du pays.

Exposition The shape of Power : Stories of Race and American Sculpture - Smithsonian American Art Museum
Donald Trump ordonne au Département de l’intérieur, notamment à J.D. Vance, le Vice-Président, d’enquêter sur ces musées, ces centres de recherche et d’éducation, ainsi que son zoo pour éliminer “toute idéologie inappropriée”. Une des missions vise à vérifier toute dépense liée à des expositions et programmes qui “dégraderaient les valeurs américaines” et “diviseraient les Américains” sur la base des origines ethniques plutôt que de “valoriser” la nation. Publiée sur le site de la Maison Blanche, le 12 août 2025, une première lettre est adressée à Leonie G. Bunch III, Secrétaire de Smithsonian Institution, l’informant des domaines examinés et lui demandant de fournir tous les documents et listes nécessaires. Une liste d'œuvres jugées problématiques par le gouvernement a suivi le 21 août avec un titre provocateur et profondément partisan “President Trump Is Right About the Smithsonian”, critiquant l’inclusivité, les causes soutenues et le rappel des faits pourtant historiques du pays.
Dans un post du 19 août 2025 sur son propre réseau social, Truth, Donald Trump revient à la charge à coup de majuscules : “The Smithsonian is OUT OF CONTROLE”.
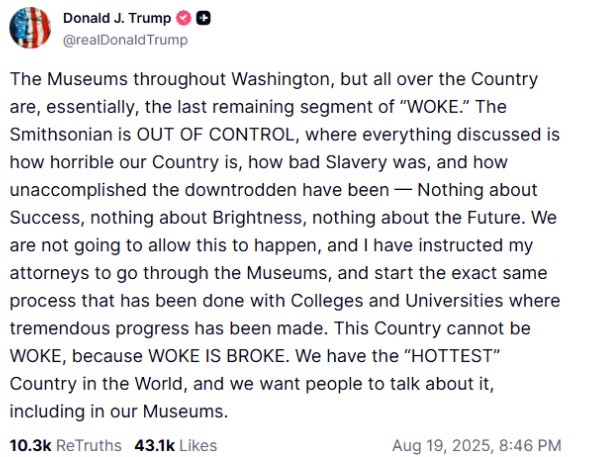
Truth @realDonaldTrump
Le 08 septembre 2026, la Maison Blanche liste dans son “Top 100 des victoires de Donald Trump pour les croyants”, à la section “Promotion des valeurs américaines” la demande au Vice-Président Vance de s’occuper de la Smithsonian Institution.
Un mois plus tard, l’institution annonce sur son site et ses réseaux sociaux la fermeture de ses institutions en raison du shutdown, la paralysie budgétaire du gouvernement. Les programmes, visites et événements sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Le monde culturel s’interroge alors sur l’impact qu’aura cette fermeture concomitante avec les changements entrepris et poussés par le gouvernement. Quelles en seront les conséquences pour les autres musées américains puis internationaux ? Quelques mois plus tôt, l’institution avait fermé ses bureaux dédiés à la diversité et l’inclusion.
Des conséquences et contestations partout dans le pays
Rappelons également que le 30 mai dernier, la directrice de la National Portrait Gallery de Washington, Kim Sajet, en poste depuis 2013, a démissionné après avoir été accusée d’être “trop partisane”. Dans leur exposition “America’s Presidents” (Les Présidents de l'Amérique), un portrait de Donald Trump avait été présenté avec un cartel précisant qu’il a été “visé par deux procédures pour abus de pouvoir et incitation à l’insurrection.”
De son côté, Amy Sherald a annulé d’elle-même en juillet son exposition “American Sublime”, la première exposition personnelle d’un artiste contemporain noir, à la National Portrait Gallery de la Smithsonian Institution pour risque de censure sur son portrait engagé de dix pieds : Trans Forming Liberty de 2024. L’artiste a refusé la proposition de l’établissement de “contextualiser l'œuvre”. Cette toile était la pièce maîtresse de l’exposition. L’exposition sera néanmoins présentée le 2 novembre au Baltimore Museum of Art.
Au cours des mois, les financements fédéraux ont été réduits. Ce qui peut expliquer pourquoi la plupart des musées, parfois pris à la gorge par les conseils d’administration, restent silencieux et appliquent les demandes. L’American Alliance of Museums (AAM) s’inquiète d'une possible étendue sur l’ensemble du territoire. Le Massachusetts Museum of Contemporary Art n’a-t-il pas perdu le financement de sa prochaine exposition portant sur Jeffrey Gibson, artiste Choctaw/Cherokee, parce qu’il ne correspondait pas aux “nouvelles priorités” du président ?
De nombreux autres artistes et historiens prennent part à l’opposition contre les décisions de l’administration Trump, dont l’American Historical Association qui rappelle l’importance de l’institution pour comprendre les “réussites et les moments douloureux” du passé. Le Fall of Freedom réunissant plusieurs artistes dénonce “l’attaque de la démocratie”.
Le monde en sentirait ainsi les relents d’un passé traumatisant. Un air de déjà-vu, où les artistes et les scientifiques seraient à nouveau obligés de combattre la censure et l’idéologie complotiste de Trump. Là où les violences du terme d’“art dégénéré” (et la symbolique qui consiste à l’employer, renvoyant à la période nazie) n’en sont plus très loin contre un “No Kings” scandé les 14 juin et 18 octobre 2025 dans les rues des États-Unis.
Mathilde Leclercq
Pour aller plus loin :
Décret du 27 Mars 2025, Restoring Truth And Sanity to American History : https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/restoring-truth-and-sanity-to-american-history/
Lettre - The White House présentant les missions à l’Institution : https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/08/letter-to-the-smithsonian-internal-review-of-smithsonian-exhibitions-and-materials/
Lettre - The White House “President Trump Is Right About the Smithsonian” : https://www.whitehouse.gov/articles/2025/08/president-trump-is-right-about-the-smithsonian/
Exposition The shape of Power : Stories of Race and American Sculpture : https://americanart.si.edu/exhibition/67675/sculpture-shape-of-power.
Exposition America’s President : https://npg.si.edu/exhibition/americas-presidents-reopened
No Kings : https://www.nokings.org/ Site du mouvement protestant contre les décisions du gouvernement américain.
#Smithsonianinstitution #donaldtrump #censure

Education sexuelle et musées : compatibles ?
La contemplation n’est pas la seule option face à la violence sexiste de certaines représentations innocemment exposées dans les musées. Aujourd’hui, il est temps pour les structures culturelles d’ouvrir la porte à la discipline de l’éducation sexuelle. Objectif : déconstruction des regards.
Education sexuelle et musées : compatibles ?
Villa Borghèse, Rome, il fait une chaleur de plomb, le corps du touriste sue à grosses gouttes mais soudain, son regard se fige. Sous ses yeux, une main toute en tension, veines saillantes, s’est emparée de la chair d’une femme. Le duel, peau contre peau est époustouflant. La main, si ferme, semble être née au creux de sa cuisse. Le touriste recule, encore étourdi devant le détail, pour lire le cartel de l’œuvre : « Gian Lorenzo Bernini, L’Enlèvement de Perséphone, marbre, 1621-22 ». La vérité éclate, la fureur de cette main, la puissance de ce geste est d’une violence certaine. Le récit mythologique prend le pas sur la beauté du marbre : Proserpine est enlevée, elle sera violée par Hadès. Quel esthète, amateur d’histoire de l’art, n’a pourtant pas succombé à la beauté de cette main ?

Figure 1 – (détail) Gian Lorenzo Bernini, L’Enlèvement de Proserpine, marbre, 1621-22 © Antoine Taveneaux, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Rape_of_Proserpina_02.jpg
Dans les musées de beaux-arts, au milieu des chefs d’œuvres, les pieds des visiteurs foulent un torrent de femmes dont le corps a fait l’objet de fantasmes pervers. Exoticisées par les « orientalistes » ou encore les « primitivistes », mises à nues parce que modèles-objet, agressées par Zeus, Hadès ou Apollon, au Louvre ou au Palais des Beaux-Arts de Lille, chaque musée exhibe innocemment des trésors du sexisme. Ces nombreuses pièces banalisent des violences sexistes et sexuelles. Les institutions culturelles se doivent désormais d’agir face à ce que transmet l’image mais que, jamais, ne raconte le cartel ou le guide. Le discours autour de ces représentations participe de l’éducation du regard. Etant donné qu’ils diffusent des images stéréotypées héritières d’une culture sexiste et patriarcale, les musées, lieu d’éducation, sont concernés par l’éducation sexuelle.
Des initiatives dans les musées des beaux-arts
Au British Museum de Londres, le programme « Relationship and Sexual Health Education » (ici abrégé RSHE) destiné aux jeunes de 14 à 16 ans est un bel exemple du lien qui peut s’établir entre la discipline et les pièces exposées. Quatre objectifs y sont mis en avant : apprendre l’histoire des relations et des identités à travers diverses cultures, utiliser des objets issus des collections du musée pour discuter de problématiques contemporaines sur la base de matériaux anciens, améliorer ses compétences dans la matière scolaire RSHE et pour finir, quitter l’activité en se sentant plus confortable pour aborder le sujet de l’éducation sexuelle et en ayant davantage confiance en sa propre sexualité. Menés par un artiste-éducateur, les ateliers abordent plusieurs thématiques : « Qu’est-ce que la pornographie ? », « Explorer le consentement », « L’image du corps à travers le temps », « LGBT » puis « Genre et Identité » et ce, à travers des périodes et aires géographiques différentes : Egypte ancienne, Grèce ancienne, Mésopotamie ancienne, Afrique, Asie du Sud, Japon... Un vaste programme qui reste bien rare aujourd’hui dans l’enceinte des musées de beaux-arts.
Souvent, ce sont des démarches féministes qui apportent l’éducation sexuelle au cœur des musées. Conçue par Musée des Beaux-Arts de Montréal, la plateforme en ligne EducART (https://educart.ca/fr/ ), un outil pédagogique interdisciplinaire, offre pléthore de matières à travailler ayant pour support les œuvres du musée. La thématique « féminisme » est celle qui héberge les questions liées à l’éducation sexuelle. Le consentement est exploré à travers l’œuvre d’Honoré Daumier, Femmes poursuivies par des satyres, 1850. Cette notion est développée au-delà de l’œuvre dans une courte et claire description appuyée par des données statistiques sur le harcèlement sexuel au travail. Une grille d’analyse permet ensuite, par le biais d’une dizaine de questions de décrypter le tableau : matériau, récit, artiste… Enfin, des « questions mobilisatrices » interrogent le jeune sur les jeux de pouvoir présents dans le tableau. C’est la question « Comment peux-tu t’assurer qu’une personne t’accorde son consentement sexuel ? » qui clôt la thématique. Sur la plateforme, d’autres thématiques telles que « genres », « normes esthétiques », « désir » ou encore « contraception » relèvent de l’éducation sexuelle.
Figure 2 : Capture d’écran de la plateforme EDUCART,
URL : https://educart.ca/fr/theme/feminisme/#/femmes-poursuivies-par-des-satyres/cartel
En parallèle des musées, des initiatives voient le jour pour relire les œuvres au prisme des pensées féministes. L’objectif est alors de transformer le regard des visiteurs sur l’histoire entourant les sujets féminins des œuvres. En France, « Feminists in the city » (https://www.feministsinthecity.com/ ) propose des visites de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux. Du Louvre au cœur historique de Bordeaux, il s’agit pour ces guides de présenter l’histoire des femmes dans les collections ou dans la cité. Prix de la déconstruction de votre regard ? Une vingtaine d’euros. Outre ces visites, « Feminists in the city » propose un agenda culturel assez dense avec des conférences. Notons par exemple la masterclass « Histoire de la révolution sexuelle ». Dans ce cas, les visites ne visent pas particulièrement le jeune public.
Ces éléments de discours muséaux mettent en lumière un fait : dans les musées de beaux-arts, l’éducation sexuelle n’est pas exposée sur les murs ou les cartels, elle passe par la médiation, le dispositif numérique ou des actions temporaires. C’est donc par le biais de la contemplation que des scènes qui pourraient faire l’objet d’éducation sexuelle sont abordées. En effet, quelques exemples d’expositions liées à la thématique de la sexualité peuvent être citées : en 1995 au Centre Georges Pompidou « Masculin-Féminin : le sexe dans l’art », en 2017 au Musée des beaux-arts de Calais « Le baiser. De Rodin à nos jours » et, à venir, l’exposition « L’Empire des sens. De François Boucher à Jean-Baptiste Greuze. » au Musée Cognacq-Jay ou encore « L’amour fou. Intimité et création (1910-1940) » au Musée des Beaux-Arts de Quimper. Mais… difficile de s’éduquer sexuellement simplement en regardant des œuvres d’art.
Les musées de sciences, là où le tabou n’est plus ?
Dès 2007, la Cité des Sciences brise le tabou de l’éducation sexuelle avec l’exposition « Zizi Sexuel l’expo » (en collaboration avec Zep et Hélène Bruller). Reprenant les célèbres personnages de la bande-dessinée Titeuf, l’exposition répond à de nombreuses questions qui trottent dans la tête des jeunes entre 9 et 14 ans. Cinq thématiques rythment le parcours : « Être amoureux / amoureuse », « La puberté », « Faire l’amour », « Faire un bébé » et enfin « Ouvre l’œil ». En passant de la chambre de Nadia à celle de Titeuf puis par la salle de bain, des manipe, jeux, dessins animés sont là pour susciter la curiosité des enfants. Les règles, les préservatifs, la pilule, les rapports hétérosexuels ou bien la grossesse n’ont plus de secrets pour le jeune public. Un réel succès. L’humour employé pour traiter toutes ces questions, sur la base des illustrations de Zep, a largement contribué à supprimer les tabous et désinhiber la jeunesse. Les manipes décomplexées telles que « L’essoreuse à langue » grâce à laquelle les jeunes reproduisent avec leurs bras le roulage de pelles dans toute sa splendeur sans oublier le « zizi piquet » en érection qui éjacule gaiement sur le visiteur, la Cité des Sciences n’a pas lésiné sur le grotesque et ça fonctionne. L’institution a ainsi réussi son pari : apprendre la sexualité en s’amusant, c’est possible.
La question reste entière : pourquoi un tel écart existe-t-il entre le traitement de l’éducation sexuelle dans les musées de beaux-arts et celui qui en est fait dans les musées de sciences ? Il faut bien constater que généralement, les musées de sciences n’ont pas de collections à déconstruire (comme c’est le cas des musées de beaux-arts), ce qui donne une plus grande liberté expographique.

Figure 3 : « Zizi sexuel l’expo » à la Cité des Sciences ©
URL : https://www.ladepeche.fr/diaporama/zizi-sexuel-l-expo-qui-fait-polemique-a-paris.html
En 2014, après sept années d’itinérance européenne, l’exposition fait son retour. Mais, surprise, l’accueil ne lui est pas aussi favorable que la première fois… Une pétition de l’association SOS Education demande la fermeture de l’exposition, elle recueille plus de 45 000 signatures. Les pétitionnaires souhaitent que dans le cadre d’une sortie scolaire, les parents soient « informés et consultés » sur la venue de leur enfant dans une telle exposition et puissent s’y opposer s’ils le désirent. Ils ajoutent que « ces sorties scolaires ne doivent en aucun cas être prises sur le temps consacré aux apprentissages fondamentaux ». En outre, l’espace « interdit aux adultes » semble décontenancer les auteurs de la pétition.
Quel avenir pour l’éducation sexuelle au musée ?
L’éducation sexuelle a encore un long chemin devant elle avant de figurer sur les murs des temples des beaux-arts. Les initiatives ne sont pas nombreuses alors aux professionnels des musées d’inventer l’éducation sexuelle par la culture. Le défi est lancé !
Estelle Brousse
#educationsexuelle
#musee
#deconstruireleregard
Pour aller plus loin :
Podcast Vénus s’épilait-t-elle la chatte ? https://podcast.ausha.co/venus-s-epilait-elle-la-chatte
Bibliographie :
Education sexuelle au British Museum
https://www.the-tls.co.uk/articles/sex-education-british-museum/ :
https://www.britishmuseum.org/learn/schools/ages-14-16/school-workshop-relationship-and-sexual-health-education
Féminists in the city : https://www.feministsinthecity.com/
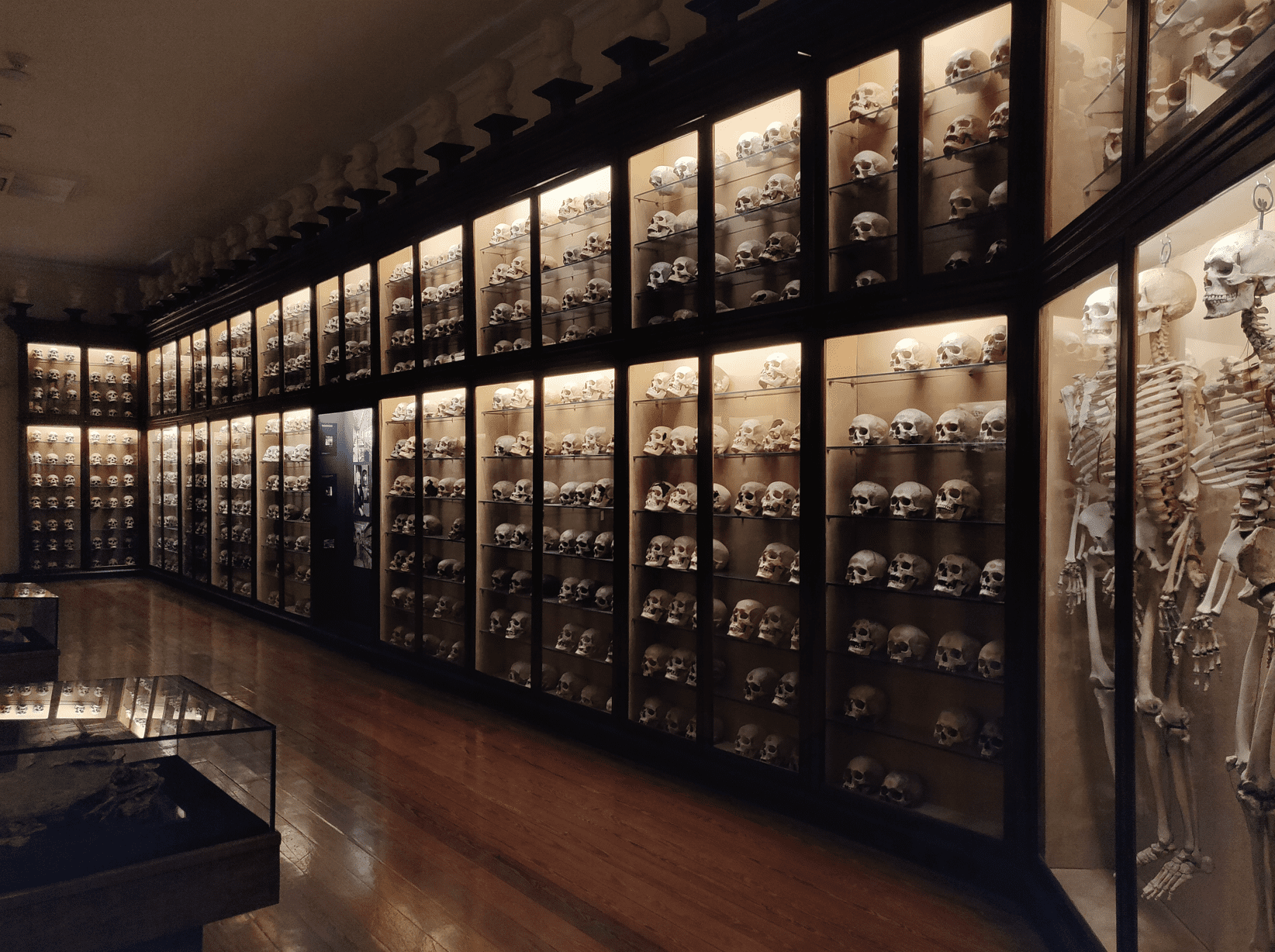
El Museo Canario, une histoire des cultures préhispaniques des îles Canaries
Fondé en 1879 par des scientifiques éminents comme le Dr Gregorio Chil y Naranjo, el Museo Canario est un précieux gardien des vestiges indigènes des îles Canaries, recueillis depuis le XIXe siècle. Pourtant, sa capacité à mettre en lumière cette histoire souvent méconnue pose question.
Situé dans le quartier de Vegueta à Las Palmas, le musée expose principalement les fonds archéologiques des cultures préhispaniques de Gran Canaria entre autres. Offrant une immersion dans le mode de vie des peuples présents sur l'île depuis l'Antiquité jusqu'au XVe siècle, avant la colonisation par les Castillans.
Qui sont les premiers habitants des îles Canaries ?
L’origine des premiers habitants reste encore mal connue à ce jour. Les anthropologues pensent que ce serait un peuple autochtone berbère qui a migré depuis le nord-ouest de l'Afrique, probablement du territoire correspondant à l'actuel Maroc ou à la Mauritanie. Les premiers indigènes sont arrivés dans les îles Canaries vers le premier millénaire avant notre ère, bien que les dates précises varient selon les sources. Les raisons de leur migration vers les îles Canaries ne sont toujours pas élucidées. Pourquoi en sait-on si peu ? Parce que les chercheurs ont commencé à s’intéresser à ces populations lorsqu’elles étaient sur le point de disparaître par le biais du métissage avec les Européens. Il était déjà trop tard.
L'histoire des premiers peuples des Canaries demeure largement méconnue en dehors de l’archipel. Malgré l'afflux de touristes en masse, l'histoire préhispanique reste peu mise en avant, ce qui est regrettable tant elle revêt une importance capitale pour les habitants locaux. Ce patrimoine partagé, unique à l'ensemble de l'archipel, souffre d'un manque de valorisation.
Entre abondance et confusion
Le musée, réparti sur plusieurs étages, offre un espace généreux pour exposer une grande partie de sa collection. Divisé en onze salles, le musée présente divers aspects de la vie quotidienne, tels que l'habitat, les activités économiques et des rituels funéraires pratiqués par les premiers habitants des Canaries. La répartition des onze salles est claire d’un point de vue signalétique dans le musée, elle l’est aussi bien indiquée sur le site du musée. Cependant, malgré cette riche collection d’artefacts, la muséographie des années 1970-80 ne parvient pas à valoriser pleinement le patrimoine présenté et désoriente facilement le public lors de sa visite.
L'absence totale de datation pourrait sembler anecdotique, mais surprend dans un musée d'histoire et d'ethnographie. Aucun objet n'est accompagné d'une indication temporelle. Les vitrines pourtant dotées de longs textes scientifiques ne fournissent aucun repère chronologique. De plus, le fil narratif de l'histoire de ce peuple se perd dans une énumération des faits et des objets exposés, sans cohérence narrative. Cette approche entrave la compréhension d'ensemble de leur histoire.
Le musée dispose d’une grande collection, et peut être par envie de tout montrer nous met face à des vitrines répétitives qui ne cessent d’exposer le même objet en plusieurs exemplaires. Ainsi, beaucoup d’ossements, de poteries, d’outils et de toiles sont en triple ou quadruple exemplaires sans nécessité.
Si on explore attentivement le site internet, il est mentionné que le musée abrite un fonds en sciences naturelles, ainsi qu'une collection beaux-arts. Cependant, ces éléments ne sont pas toujours visibles lors de la visite alors que l'art et la nature locale font partie du patrimoine de l’archipel.

Manufacturas en pieles y fibras vegetales © CP

Tas d’ossements exposés sans indication ni cartel © CP
Une histoire coloniale absente ?
Est-il possible d'évoquer l’histoire d’une société décimée sans traiter de la question coloniale ? Le musée souffre d’un cruel manque de recontextualisation historique lorsqu’on connaît tout le passé colonial de l’archipel occupé par les Portugais, puis par les Espagnols. Bien que cette colonisation espagnole ne soit pas glorieuse, elle est une réalité qu'il est crucial de clarifier : la tragédie d’une population autochtone décimée, similaire à celle des peuples précolombiens anéantis par les Espagnols, un aspect largement omis par le musée. La colonisation castillane est seulement présentée de manière très brève dans le premier QR code audio guide.
Cette approche dépassée de l'histoire laisse un vide significatif dans la compréhension du passé colonial. D’autant que le quartier de Vegueta a été le premier lieu d'établissement des colons européens à Gran Canaria. Ainsi, il y a un manque d'opportunité pour le musée de résonner avec son territoire et de susciter une réflexion critique.
L'absence de mise en contexte est particulièrement frappante dans la salle La antropologíca física (anthropologie physique), où une grande quantité de restes humains est exposée sans explication. Cette exposition est à la fois impressionnante et troublante. On y découvre des centaines de crânes dont l'origine et la période restent inconnues, sans information sur leur découverte. Seules quatre momies sont accompagnées d'informations claires ainsi qu’une modélisation 3D bien réalisée pour chacune d'entre elles. De plus, divers bustes en hauteur sont présentés sans indication sur leur provenance ou leur identité, nous laissant incertain s'ils représentent des personnalités du XIXe siècle ou des moulages d'indigènes de diverses régions.
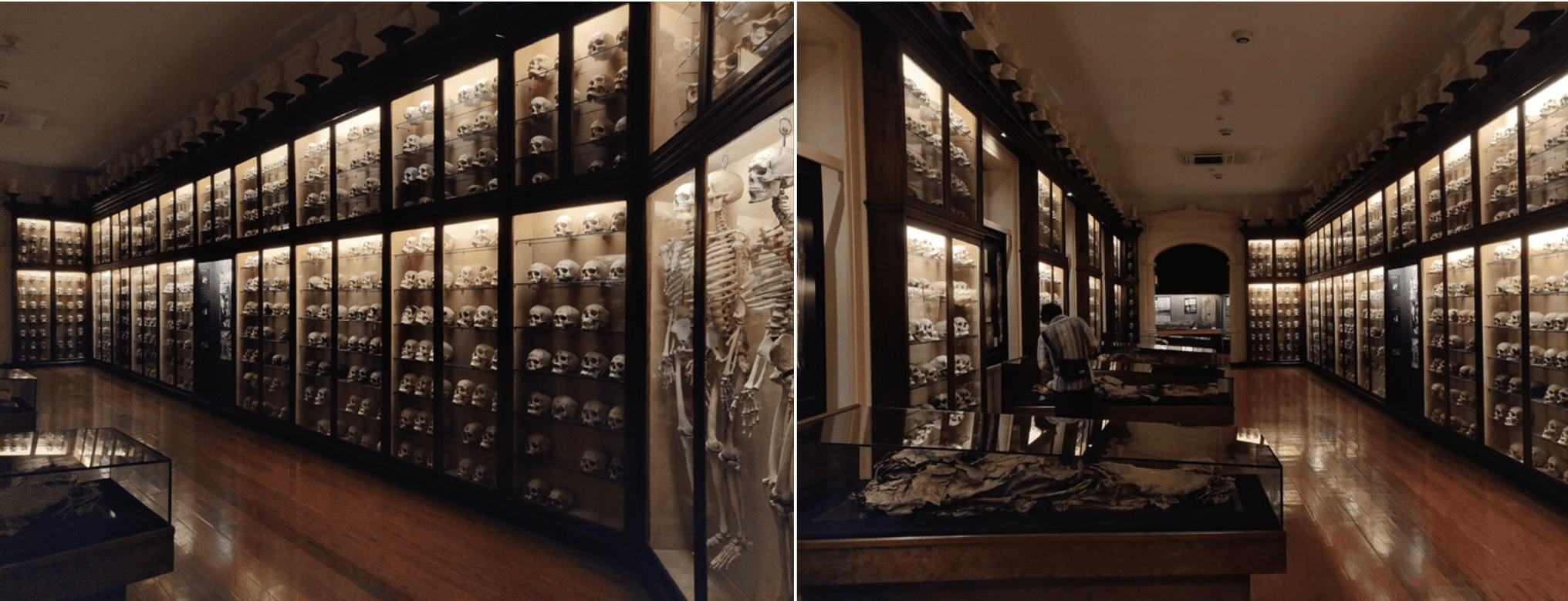
Vues de la salle laantropologíca física © CP
Un musée qui manque sa mission de valorisation ?
Le musée semble trouver un équilibre très intéressant dans la valorisation de son contenu, notamment grâce à la visite virtuelle du musée dans son intégralité disponible sur son site internet. Mais lors de la visite du lieu, l'expérience est bien différente.
Comment peut-on espérer partager et faire connaître son patrimoine à un large public si celui-ci n’est présenté qu’en espagnol (à de rares exceptions en anglais) ? Et le musée ne propose pas d'audioguide matériel à l’accueil, se contentant de QR codes disponibles en anglais et allemand dont l’utilisation est souvent limitée et peu pratique si nous ne disposons pas de casque audio et de connexion internet. Et qui prend réellement le temps de télécharger les QR et d’écouter les bandes sons au musée ?
Cette situation contraste fortement avec celle de la Casa de Colón (Maison de Christophe Colomb), située dans le même quartier de Vegueta, où chaque salle propose des textes traduits en anglais, ainsi qu’en allemand. Cette disparité soulève la question : que veut-on transmettre aux touristes ? À première vue, un musée retraçant l’histoire des circuits de navigation d’un colonisateur plutôt que la découverte de l'histoire des peuples canariens aujourd’hui disparus. Le fait que le contenu ne soit pas traduit risque de priver les touristes non hispanophones d'un accès complet à l'histoire et à la richesse culturelle de l’archipel. En d'autres termes, ils ne connaissent qu'une version de l'histoire de l'île, suggérant que les Espagnols sont arrivés sur une terre vierge.
Cette situation est d'autant plus frappante lorsque l'on constate que la Casa de Colón semble bénéficier d'une meilleure visibilité dans les guides touristiques. Lors de ma visite, le personnel d’accueil et de surveillance m’a demandé d’où je venais pour pouvoir me parler dans ma langue natale. Ils parlaient anglais et allemand avec d’autres visiteurs. Il est donc légitime de se demander pourquoi le musée représentant l’histoire des Canaries, aussi important pour l'archipel, ne parvient pas à offrir un parcours multilingue. Alors même qu'un autre musée plus petit et du même quartier y parvient avec succès. Le musée est-il affecté par un tourisme qui tend à privilégier la familiarité en mettant en avant Christophe Colomb, bien connu des visiteurs ?

Vue intérieure de la Casa de Colón © Casa de Colón
Un musée pour qui ?
A qui sont destinés ces musées ? Aux habitants locaux de l'archipel ou aux touristes ? En ce qui concerne la Casa de Colón, la présence de parcours multilingues suggère une attractivité plus forte auprès des touristes internationaux, avec une mise en avant de la figure de Christophe Colomb par rapport au patrimoine canarien. Quant au Museo Canario, à en juger par l'expérience proposée, on imagine qu'il s'adresse à un public déjà familiarisé avec le patrimoine régional et ayant des connaissances historiques suffisantes pour se passer de repères temporels. Par ailleurs, son centre de documentation avec ses archives en fait incontestablement un lieu d'intérêt pour les chercheurs en anthropologie et en préhistoire. Ce musée semble être davantage un lieu de référence pour les spécialistes que celui d'une diffusion grand public de la connaissance scientifique[1]
Mais pourquoi limiter l'accès et la compréhension du Museo Canario aux spécialistes et aux habitants locaux ? Et à vrai dire pour les locaux, il s'agit aussi d'une perspective biaisée car parmi eux, tous ne possèdent pas les connaissances et repères temporels des spécialistes en anthropologie. Il est donc regrettable de constater que ce patrimoine est préservé et partagé uniquement entre experts.
Et les Canaries aujourd’hui ?
Aujourd’hui, les Canaries connaissent un afflux important de touristes venus principalement d’Europe. Cette forte présence touristique induit une modification de l’économie locale qui défavorise les locaux. Se sont tenues dans la capitale, Las Palmas, des manifestations pour protester contre l’édification de nouveaux complexes hôteliers touristiques incitant davantage les touristes à venir sur l’île. Ces enjeux contemporains de tourisme de masse et ses conséquences sur la vie locale pourraient faire l’objet d’une section au sein du musée. De fait, qui peuple les Canaries aujourd'hui ? En 2023, près de 16 millions de touristes sont venus visiter l’archipel comptant 2,2 millions d’habitants.
Avec le projet d’extension du musée débuté en 2008, il pourrait être fort intéressant que le musée apporte un regard contemporain sur son territoire et montre comment ce tourisme de masse a prospéré. Ce serait une façon de le remettre en cause, de faire comprendre aux quelques touristes qui franchissent le pas de la porte, leur impact lorsqu’ils choisissent de visiter les îles d'une manière qui n’est pas forcément bénéfique pour les locaux, et de mettre en avant les difficultés des habitants aujourd’hui.
Finalement, pour une adepte de musées d’ethnographie, cette visite s'est révélée plutôt frustrante. En ce qui concerne l'histoire des premiers canariens, je suis restée sur ma faim. Pourtant, les Canaries détiennent un patrimoine riche et unique qui mériterait d'être connu par un public plus large que simplement les spécialistes. Une telle démarche pourrait contribuer à modifier l'image de l'archipel aux yeux des touristes.
Camille Paris
[1] D’après le rapport d’activité de 2018, sur 37 325 visites, 86,4 % correspondent à des visiteurs réguliers qu’on imagine être chercheurs et 13,6 % à de nouveaux visiteurs. ↩
Pour en savoir plus :
- Projet d’extension du musée https://www.elmuseocanario.com/en/project-of-enlargement/
- Rapport d’activité de 2018 : https://www.elmuseocanario.com/images/documentospdf/memorias/Memoria%20de%20actividades%20de%202018.pdf
#îlescanaries #ethnographie #histoirecoloniale

En route pour Tatihou ! "Flottes et fracas", une exposition en immersion
Tatihou est une île. Une petite île de moins d'un km² au large de Saint-Vaast-la-Hougue, sur la presqu'île du Cotentin. Sur cette île, un petit musée. Comment y aller ? En roulant ou en flottant, tout dépend de la marée. Et oui, le bateau a des roues !
© Musée maritime de l'île Tatihou, J. Petremann
©Office de tourisme Cherbourg - Cotentin
 Après un périple à travers les parcs à huîtres, nous arrivons sur la cale du petit port de l'île. Nous déposons nos affaires dans notre petite chambre et partons à l'aventure...
Après un périple à travers les parcs à huîtres, nous arrivons sur la cale du petit port de l'île. Nous déposons nos affaires dans notre petite chambre et partons à l'aventure...
Deuxpossibilités : commencer par le tour de l'île, verte et sable, turquoise quand le soleil arrive, ou se diriger vers les bâtiments protégés par l'enceinte de l'ancien lazaret, le musée, caché au fond d'un jardin d'acclimatation luxuriant. Le soleil est de sortie, ce sera le tour de l'île ! Personne malgré le beau temps de septembre, la seule population est constituée des moutons qui entretiennent l'île et de quelques oiseaux de la réserve.
La pluie nous rattrape et nous entrons dans le musée. Flottes et fracas, les épaves de La Hougue, 1692est un circuit permanent exposant les résultats des fouilles menées par le DRASSM de 1990 à 1995 sur les épaves de douze vaisseaux français coulés en 1692 par les Anglais.
Un parcours d'exposition chronologique et immersif
Retraçant les raisons historiques, économiques et politiques qui ont amené à cette bataille, l'exposition démarre par une galerie de portraits rouge vif, peut-être pour montrer que ça commence à chauffer...Les portraits sont en majeure partie des fac-similés, mais leur majesté montre bien les forces en présence, les personnalités engagées, Jacques II, Louis XIV, l'amiral Tourville...
Ensuite, place à la préparation ! Fini le carrelage ; le sol se retrouve tout de bois vêtu, l'ambiance change. Nous voilà dans un autre univers... Le choix du bois, les outils et les différentes étapes de construction des vaisseaux du roi sont expliqués à l'aide de maquettes et d'objets très parlants. Quarante-quatre vaisseaux vont appareiller de Brest le 12 mai 1692. Mais avant de partir, il faut bien les armer et faire le plein de vivres et d'armes. Poulies et caps de mouton, matériel de voilerie, barriques et pièces de gréement sont présentés comme des trésors, choisis parmi les nombreux objets retrouvés sur les épaves de La Hougue.
©Musée maritime de l'île Tatihou
 Plus loin, l'atmosphère change encore : à bord du bateau, les voiles sont à poste, le bois craque au gré de la houle, on sentirait presque le sol bouger. « Hissez les voiles ! », c'est l'occasion de tester nos forces en manipulant un modèle réduit de palan de grand-voile (la poulie centrale mesure tout de même 60cm de haut !) pour comprendre la démultiplication permise par les poulies. À bord, la vie s'organise selon des rythmes précis, des affectations pour chacun, des moments inévitables. Les instruments de navigation côtoient les objets de la vie quotidienne, les uns n'allant pas sans les autres. Matelots, officiers ou surnuméraires, tous sont évoqués par des objets personnels, allant de la pipe rudimentaire en os aux travaux d'art populaire fins et ouvragés.
Plus loin, l'atmosphère change encore : à bord du bateau, les voiles sont à poste, le bois craque au gré de la houle, on sentirait presque le sol bouger. « Hissez les voiles ! », c'est l'occasion de tester nos forces en manipulant un modèle réduit de palan de grand-voile (la poulie centrale mesure tout de même 60cm de haut !) pour comprendre la démultiplication permise par les poulies. À bord, la vie s'organise selon des rythmes précis, des affectations pour chacun, des moments inévitables. Les instruments de navigation côtoient les objets de la vie quotidienne, les uns n'allant pas sans les autres. Matelots, officiers ou surnuméraires, tous sont évoqués par des objets personnels, allant de la pipe rudimentaire en os aux travaux d'art populaire fins et ouvragés.
Exposer les batailles
©Musée maritime de l'île Tatihou

©Musée maritime de l'île Tatihou
 Redécouvertes en 1985, les épaves des vaisseaux français sont alors étudiées par une équipe d'archéologues sous-marins, dirigée par Michel L'Hour et Elisabeth Veyrat. « Retour vers le futur » avec la cloche de plongée, utilisée juste après les naufrages pour récupérer les pièces de bois intéressantes et les canons sur les épaves. Aujourd'hui les fonds sous-marins de la Manche sont plutôt calmes, la houle s'entend encore, mais elle nous porte, elle ondoie,et elle dévoile les épaves et leurs secrets... Sitôt sortis de l'eau il faut s'en occuper, les traiter pour qu'ils ne se désagrègent pas, les étudier pour pouvoir les valoriser et reconstituer l'histoire.
Redécouvertes en 1985, les épaves des vaisseaux français sont alors étudiées par une équipe d'archéologues sous-marins, dirigée par Michel L'Hour et Elisabeth Veyrat. « Retour vers le futur » avec la cloche de plongée, utilisée juste après les naufrages pour récupérer les pièces de bois intéressantes et les canons sur les épaves. Aujourd'hui les fonds sous-marins de la Manche sont plutôt calmes, la houle s'entend encore, mais elle nous porte, elle ondoie,et elle dévoile les épaves et leurs secrets... Sitôt sortis de l'eau il faut s'en occuper, les traiter pour qu'ils ne se désagrègent pas, les étudier pour pouvoir les valoriser et reconstituer l'histoire.
L'exposition est finie, le reste du musée est à explorer, l'île n'a pas encore livré tous ses secrets...
Flottes et fracas, les épaves de La Hougue, 1692 est une exposition remarquable, et surtout très surprenante dans un endroit comme Tatihou. Le parcours chronologique choisi semble tout à fait logique et se déroule de manière très fluide, notamment grâce aux différentes ambiances créées par la scénographie. Sans surenchère, celle-ci nous emmène au cœur du sujet, de la construction des vaisseaux du Roi à la bataille, puis à leur naufrage et leur dernière demeure, sous l'eau. Nombreux pour une exposition de cette taille, les différents outils de médiation sont toujours bienvenus, faciles à comprendre et à utiliser. Les textes ne sont pas rébarbatifs et permettent une très bonne compréhension des facteurs qui ont amené au naufrage des douze vaisseaux du Roi, et des problématiques de l'archéologie sous-marine en Manche.
Le Musée maritime de l'île Tatihou
Le Musée maritime de l'île Tatihou ouvre au public en 1992. Son programme scientifique et culturel a pour vocation de présenter le mobilier archéologique des fouilles sous-marines des épaves de La Hougue, l'occupation de l'île depuis l'âge de Bronze jusqu'à aujourd'hui, l'histoire et l'ethnographie maritimes des côtes de Basse-Normandie, (histoire technique, économique et sociale de la pêche et des aménagements portuaires). Sous la responsabilité du Conservatoire du Littoral, elle présente aussi un volet histoire naturelle du littoral. Avec une gestion au niveau départemental, le musée de Tatihou présente des expositions de qualité malgré son accessibilité difficile, son manque de personnel et de moyens. Îlot culturel, îlot historique, il attire pas moins de 60 000 visiteurs par an, grâce à ses différentes installations touristiques (hébergement, restaurant, ateliers, festivals...).
Muséographie : Com&Graph
Juliette Lagny
#ethnologiemaritime
#tatihou
#muséographie

Entre lac, montagne… et glace ?
Comment ne pas ressentir l’attirance magnétique d’une visite au musée, lors des journées pluvieuses dont Mai a le secret ?
Et c’est bien de magnétisme dont il s’agit à Neuchâtel, puisque le Muséum d’histoire naturelle présente l’exposition « Pôles, feu la glace » jusqu’au mois d’août 2019. Alors hâtez-vous, avant qu’elle ne disparaisse au profit de la chaleur de l’été.
L’exposition « iceberg »
Cette exposition temporaire est construite à juste titre comme un iceberg, puisqu’elle invite le visiteur à acquérir les connaissances de base sur les pôles Nord et Sud, notamment ses saisons, ses paysages et sa faune… (D’ailleurs, savez-vous qui de l’ours polaire ou du manchot vit au pôle Nord ? [Réponse à la fin de l’article]) Mais le plus intéressant est bien sûr de découvrir la partie immergée et parfois effrayante de cet iceberg, ayant trait au climat et à la fonte des glaces.
Le sujet est saisi en croisant la biologie, l’ethnologie, l’astronomie, la climatologie, la photographie… Et bien sûr la glaciologie puisque l’exposition a pour parrain Claude Lorius, explorateur et glaciologue des pôles dont les voyages en Antarctique ont inspiré la conception de Pôles.
Une seconde figure notoire, Luc Jacquet, nous propose une immersion dans cet univers glacial, grâce à ses prises de vues époustouflantes. Ce cinéaste documentariste est connu pour son film La Marche de l’Empereur sorti en 2005. Il invite le visiteur à plonger dans le quotidien des manchots au travers d’une projection qui fait littéralement froid dans le dos. « Comment ces oiseaux parviennent-ils à survivre dans ce froid extrême ? » est la question que tout un chacun se pose. Les températures pouvant chuter jusqu’à -50 degrés, les manchots ont développé une technique dite de la « tortue ». Usant de leur chaleur corporelle, ils forment une carapace dense de corps qui les protègent du froid. La température intérieure de la tortue polaire pouvant atteindre les +40 degrés, les manchots ont donc même souvent… trop chauds ! Pour y remédier, ils échangent régulièrement les rôles, exposant tour à tour leur dos au froid.

Ardemment glacial – Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel © Luc Jacquet
Homo frigoris
Les capacités extraordinaires des manchots, bœufs musqués, phoques et autres espèces de la faune locale qui survivent dans des conditions extrêmes ont grandement inspiré l’animal que nous sommes, Homo sapiens, à faire de même. A bord d’un cargo chargé de ravitailler les villages côtiers, on découvre les conditions de vie des Inuits, très loin des clichés. Ils se fournissent en bibliothèque Billy chez Ikea, alimentent leur story Instagram, et promènent leurs bambins, pas très différemment de nous finalement. Les photographies exposées de l’ethnologue Philippe Geslin apportent un regard frais et contemporain sur ces populations.

Roues et neige © Philippe Geslin
Tout au long de notre pérégrination, l’immersion est de mise. La scénographie épurée suggère les étendues désertes des pôles et les sons et bruits d’ambiance nous rappellent qu’il y a néanmoins de la vie. Au milieu du vent glacé qui fouette l’air, des manchots braient et accompagnent notre avancée. Cette attention portée à l’auditif est une agréable surprise lorsque certaines expositions relèguent trop facilement les bruits au rang d’accessoire, voire de nuisance. Un petit jeu plus visuel contribue aussi à l’expérience du visiteur puisqu’il peut incarner un Inuit vêtu d’une panoplie en peaux, ou un scientifique dans sa tenue molletonnée orange, au moyen d’une caméra à détection de mouvement. Les photos peuvent ensuite être retrouvées sur le site du Muséum, une bonne idée de souvenir à retrouver chez soi !

Deux scientifiques en anorak orange – Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel
Outre l’aspect récréatif, ce jeu nous apprend qu’en plus des populations locales, il ne faut pas oublier que les scientifiques séjournent aussi aux pôles. Cela ne signifie pas qu’ils cohabitent pour autant. Les Inuits vivent au pôle Nord, dans la région arctique et les scientifiques mènent leurs recherches sur les deux pôles, y compris en Antarctique, au pôle Sud, continent le plus froid et venteux de la Terre, où il n’y a pas de populations établies. C’est dans cette région hostile que les scientifiques réalisent l’extraction de carottes de glace. Au fil des siècles, et consécutif aux chutes de neiges successives, des couches de glace se forment au sol. Plus la carotte est longue, plus l’on remonte le temps et il est possible d’obtenir des informations sur les conditions climatiques et les composés chimiques de l’air dans le passé. Claude Lorius est le précurseur de ce champ d’étude puisque c’est en 1965, en observant les bulles d’air emprisonnées dans les glaçons de son whisky, qu’il a émis l’hypothèse qu’elles contenaient des informations sur le taux de méthane et de dioxyde de carbone des siècles passés. A partir des données récoltées, il est possible de comparer les taux de CO² en ppm (partie par millions) du dernier millénaire. La tension monte, le thermomètre aussi. Alors que pendant 1000 ans, le taux était stabilisé autour de 280 ppm, la révolution industrielle a vu une brusque augmentation du taux atteignant les 408 ppm, ce qui représente une hausse de la température de 1°C.
Maintenant ou jamais
L’exposition prend alors un tournant beaucoup plus sérieux et nous emmène dans une salle à l’atmosphère si pesante qu’elle ferait fuir un climato-sceptique. Le tic-tac de l’horloge se fait oppressant et de plus en plus rapide, les lumières clignotent, autant de signes annonciateurs de l’effondrement. L’emphase est mise sur le temps, et l’on comprend qu’il est compté. L’Homme peut se targuer d’exercer des pressions si fortes sur l’environnement qu’il a fait rentrer l’humanité dans une nouvelle ère qui porte son nom : l’Anthropocène. Elle se caractérise par l’impact des activités humaines sur la planète, constituant une véritable force globale à l’origine de catastrophes naturelles, de l’extinction de centaines de milliers d’espèces et de l’épuisement des ressources.
« C’est une triste chose de penser que la nature parle
mais que le genre humain ne l’écoute pas. » Victor Hugo
On trouve dans les interstices des murs quelques regains d’espoir ; baisse de la consommation de viande en Suède, plusieurs millions de tonnes de matériaux recyclés en France, création de smartphones éthiques et écologiques. Mais l’imminence d’une catastrophe écologique sans précédent reste un sujet un peu délicat, et le ton employé est déterminant. Le second degré est un choix audacieux qui fonctionne ici très bien. Le faire-part de décès de la glace permet de lui dire un dernier adieu, ses maigres restes reposant dans une boite en velours. La vidéo du cornet de glace fondu diffusé sur l’écran n’est pas sans provoquer du dégoût chez les visiteurs ou un sourire navré lorsqu’ils comprennent la métaphore.

Feu la glace – Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel
La dernière salle enfin donne la parole aux citoyens grâce à une grande campagne lancée par le musée à son réseau.
« Les glaces de l’Antarctique, qui ont conservé dans leurs strates la mémoire de l’environnement de notre planète au fil des millénaires, nous envoient un message d’alerte : les conditions de vie se détériorent et toucheront de plein fouet nos enfants et leurs descendants. Ainsi, les glaces portent en elles l’histoire de notre climat et donc notre destin. Les Pôles sont un des biens les plus précieux que la nature nous ait légués. Notre devoir est de préserver cet héritage. »
A partir de cette citation de Claude Lorius, une centaine de personnes ont été invitées à réagir et envoyer leurs témoignages sous la forme de leur choix. Ainsi, textes, photographies, dessins et vidéos constituent le manifeste poignant de l’humanité aux Pôles.
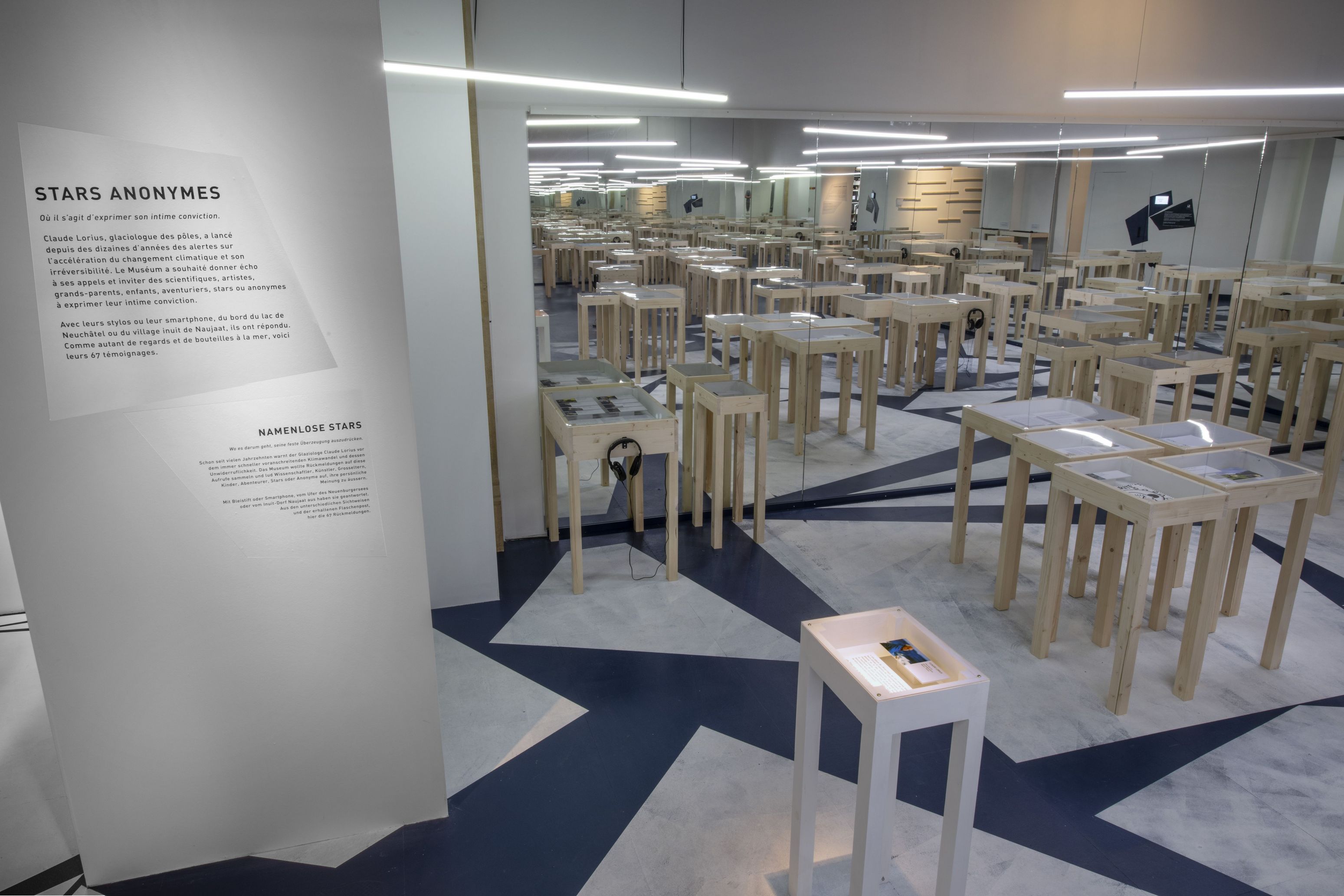
Stars anonymes – Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel
Ne finissez pas la visite sans faire l’expérience de l’installation sonore immersive de Luc Jacquet, dont on ressort troublé, effrayé ou carrément en pleurs. Plongé dans le noir, sans autre sens que l’ouïe, vous allez vivre la rupture fracassante d’un glacier comme si vous y étiez…
C’est ainsi que l’exposition se conclut et le visiteur attentif pourra remarquer avant sa sortie la projection d’un ours polaire sur un tissu blanc. N’est-ce pas là le drapeau brandi appelant à une trêve ?
(Et pssst ! L’ours polaire vit au Nord et les manchots au Sud.)
Laurie Crozet
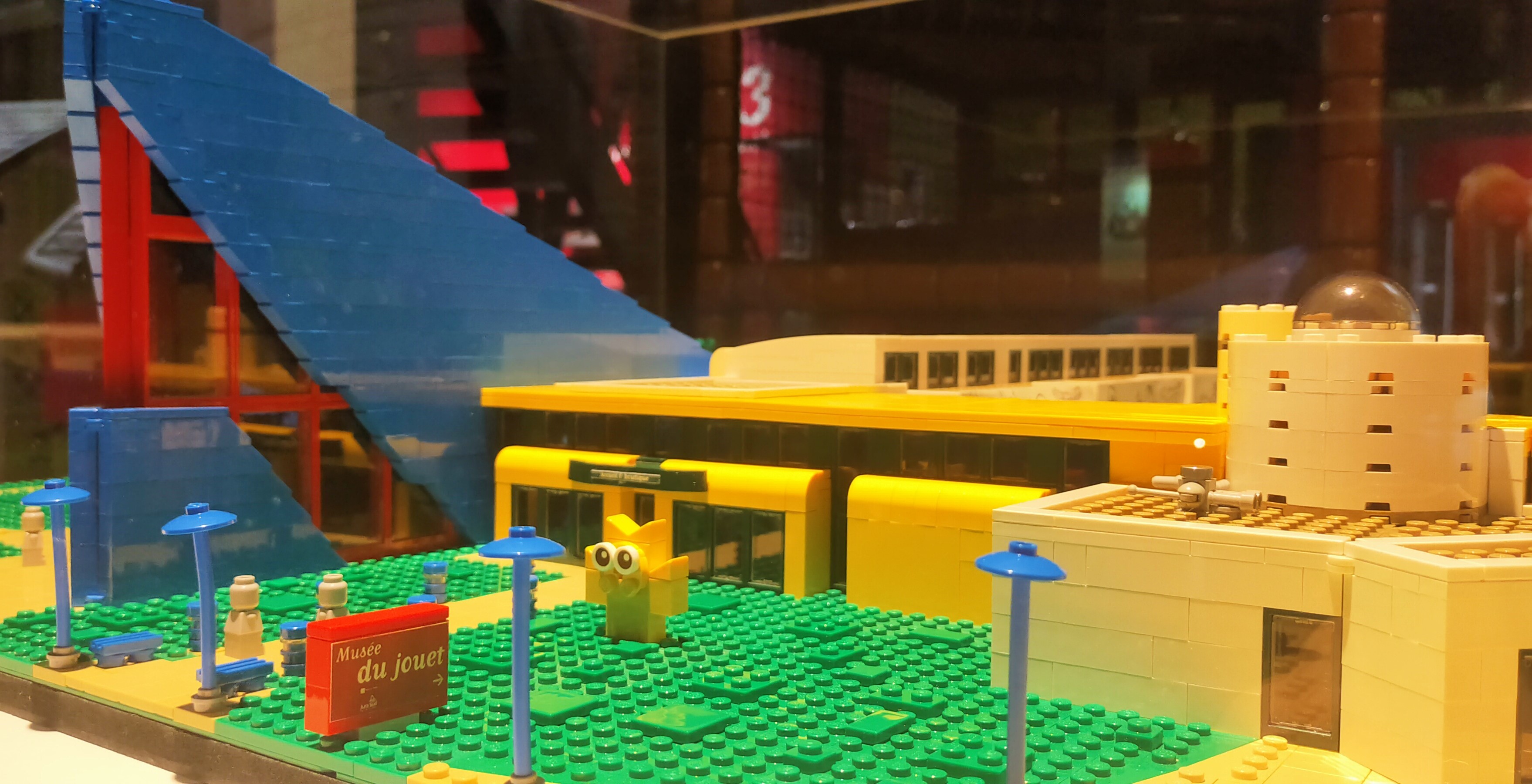
Exploration du Musée du Jouet
Avec ses 2 000 habitants, Moirans en Montagne, petite commune du Jura, n’est pas l’endroit de prédilection pour l’installation d’un musée. Pourtant, les visiteurs étaient plus de 50 000 à y avoir mis les pieds l’année dernière. Comment cela s’explique-t-il ?
Image d’introduction, maquette du musée en lego© JD
Un ancrage local : pourquoi un musée à Moirans en Montagne ?
Le tournage sur bois et la fabrication de jouets ont toujours été au cœur du patrimoine jurassien. Cette région a d’abord un attrait pour le bois, de par ses grandes forêts. Mais, ce sont les moines de l’abbaye de Saint Claude qui apportent le savoir-faire artisanal reconnu aujourd’hui. Très vite, ils initient la population jurassienne à la fabrication d’objets, et notamment de jouets, en bois tournés. Cette tradition s’est développée jusqu’à s’ancrer totalement dans le paysage industriel de la région. Ce fût, pendant plusieurs siècles, le cœur de l’économie régionale. Aujourd’hui encore, le label « Made in Jura » fait vendre des jouets à l’international. La commune de Moirans-en-Montagne n’a pas échappée à ces traditions et quelques industries comme Smoby ou encore Djeco y sont installées.
Un musée d’histoire du jouet jurassien a donc tout légitimité à s’ancrer dans cette commune. Avec une collection de près de 16 000 jeux et jouets du monde entier sur une période de 5 000 ans d’histoire, le musée est fondé en 1989. A partir des années 2 000, les chiffres de fréquentation atteignent en moyenne près de 45 000 visiteurs par an, puis déclinent jusqu’en 2010 pour passer difficilement la barre des 20 000 personnes. Une rénovation est alors lancée pour réaménager et doubler l’espace d’exposition. Depuis sa réouverture en 2012, le nombre de visiteurs ne baissent pas et avoisine les 50 000 par an. Un tel succès et rayonnement est remarquable. Cela viendrait-il du thème du musée qui se veut très attractif pour le grand public ?
Un thème attractif ?
Afin de se rendre compte de la provenance du succès de ce musée, comparons le à deux autres musées du Jouet en France. Le premier se situe à Colmar, en Alsace et le deuxième à Poissy, en région parisienne. Même si la fréquentation n’est pas la seule donnée à prendre un compte, elle permet d’avoir une première idée sur l’appréciation des lieux, surtout lorsque nous la mettons en relation avec le nombre d’habitants ou le développement du tourisme dans la région. Les années après la crise sanitaire ne sont pas forcément très représentatives, mais prenons l’année 2019.
|
Nombre d’habitants |
Fréquentation du musée |
Nombre de nuitées touristiques par an |
|
|
Musée de Colmar |
70 000 |
79 000 |
88.7 millions |
|
Musée de Poissy |
40 000 |
14 000 |
2.7 millions (hors Château de Versailles) |
|
Musée de Moirans en Montagne |
2 000 |
49 000 |
6.9 millions |
Evidemment le musée de Colmar a une plus grosse fréquentation, mais si l’on regarde par rapport à sa population, qui sont les premiers publics cibles, les chiffres sont à peu près équivalents, sans compter la part touristique qui dans cette région, est pharaonique. Le musée de Poissy arrive à toucher un tier de sa population environ. Certes le département, mis à part le Château de Versailles, n’est pas reconnu pour être touristique, mais il reste néanmoins dans la région parisienne qui a une densité de population très élevée. La fréquentation du musée de Moirans, par rapport à son nombre d’habitants est très élevée. Ce qui peut être pris en compte ici, ce sont les quelques millions de touristes par an qui n’ont pas accès à une offre culturelle très variée dans la région.
Certes, les chiffres de fréquentation sont à prendre avec du recul car énormément de facteurs rentrent en compte, mais on voit ici que le musée de Moirans se montre plus attractif. Le thème n’est donc pas l’unique clef du succès.
Un musée qui a su et qui sait évoluer
Un musée basé sur un savoir-faire local peut vite être dépassé par les autres offres culturelles plus contemporaines. Même si la connaissance du passé est primordial pour construire un futur viable, lorsqu’un musée propose une visite ornée d’objets datés et sans interactivité, il semble difficile de continuer d’attirer du public au sein de cet établissement, cela semble d’ailleurs être le problème du musée de Poissy.
Dans l’espace d’exposition de Moirans, le visiteur va se retrouver face à de grandes collections de jouets de quelques milliers d’années. Ici, pas d’innovations particulières. Sauf qu’au fur et à mesure du parcours, le visiteur découvre ces propres jouets derrière la vitrine. Ces objets avec lesquels il a pu jouer sont bien là, exposés, éclairés. A côté d’eux, leurs prédécesseurs mais aussi leurs remplaçants. n’importe quelle génération peut se retrouver dans les collections. Des jouets créer cette dernière décennie sont déjà exposés. La collection s’agrandit d’années en années, ce qui permet au musée de rester contemporain à son époque.

Au sein du parcours, des espaces de jeux sont placés pour que chaque génération fasse découvrir ses jeux aux autres © JD
La muséographie n’est pas chronologique mais bien thématique. Chaque génération est concernée par chaque espace et peut découvrir et comparer, c’est ce qui en fait un lieu d’échanges et de partages. En ajoutant quelques zones d’interactivités où les visiteurs sont amenés à jouer et construire entre eux, la visite est dynamisé, et cela sans tomber dans un musée qui serait seulement un parc d’attractions. Le contenu est développé et plusieurs niveaux de lecture sont proposés. Une partie du musée est évidemment dirigée vers le savoir-faire local et la fabrication des jouets mais elle est placée à la fin de la visite. Le visiteur après avoir découvert ces montagnes de jouets, se rend compte de la façon dont ceux-ci sont fabriqués. Un choix audacieux pour un musée qui traite du savoir-faire local, mais un choix qui fonctionne. Entre l’histoire et la nostalgie, le musée a su trouver le juste milieu.

Espace sur le savoir-faire artisanal situé en fin de parcours © JD
L’exposition temporaire qui explore les nouvelles formes de jeu
Chaque année, le musée du jouet produit une exposition temporaire, qui va rester pour l’année suivante. « Entrez dans le game », une exposition sur les jeux vidéo est ouverte jusqu’en mai 2023.

Espace représentant une ancienne salle d’arcades © JD
Pensée comme une salle d’arcade immersive dans une seule et unique pièce, Mélanie Bessard (muséographe et directrice du musée) et son équipe nous font découvrir le jeu vidéo depuis sa création en 1947. Entre objets de collections, bornes d’arcades pour jouer à plusieurs et graphisme efficace, cette exposition de petite envergure en surface, n’en est pas moins dénuée de sens. A travers différents univers et espaces, le visiteur est plongé dans un univers parallèle.

Aperçu d’un des espaces de l’exposition temporaire « Entrez dans le Game » © JD
Aujourd’hui, de nombreuses expositions et même musées entiers, sont consacrés aux jeux vidéo comme le e-Lab à la cité des Sciences et de l’Industrie ou le Pixel Museum à Bruxelles. Ce qui marque la différence ici, c’est que le musée ne touche pas uniquement les convaincus des multimédias et des jeux vidéo mais une bien plus grande tranche de population, le public du musée étant aussi là pour découvrir l’histoire du jouet. De nombreuses statistiques sont d’ailleurs affichés pour tenter de décrier les stéréotypes que le visiteur pourrait avoir sur les jeux vidéo et leurs habitués. Les barrières tombent et les générations se rejoignent, le musée du jouet permet à tous les visiteurs d’apprendre tout en jouant.
Julie Dumontel
Pour en savoir plus :
- https://www.cdt-jura.fr/wp-content/uploads/2020/10/jura-tourisme-chiffres-cles-2019.pdf
- https://www.sortir-yvelines.fr/Espace-Services/frequentation-tourisme-yvelines-2019
- https://api.art-grandest.fr/files/1c098f49/chiffres_cles_grand_est_septembre_2021.pdf
#exposition #jeux #jeuxvidéo

Exposer ce qui ne se voit pas : « L'Intime, de la chambre aux réseaux sociaux » au Musée des Arts Décoratifs de Paris
L'exposition « L'Intime, de la chambre aux réseaux sociaux » au Musée des Arts Décoratifs de Paris explore l'évolution de l'intimité en Occident, du XVIIIᵉ siècle à nos jours, à travers plus de 470 œuvres et objets. Présentée du 15 octobre 2024 au 30 mars 2025, elle est co-organisée par Christine Macel, conseillère scientifique et artistique du musée ainsi que par Fulvio Irace, historien de l'art et du design.
La scénographie, conçue par l'architecte italien Italo Rota, débutait par un trou de serrure géant, symbolisant l'entrée dans l’exploration de l'intimité. Le parcours est structuré en douze thèmes répartis dans un enchaînement de quatorze salles, abordant des sujets tels que la frontière entre espace public et privé, la fluidité des genres, l'identité, la promiscuité et la surveillance.
L'exposition présente peintures, photographies et pièces de design emblématiques mais encore une diversité d'objets quotidiens moins valorisés dans les musées, tels que des bidets, miroirs, carafes, etc. Elle retrace la transformation des espaces intimes, depuis les chambres à coucher du XVIII ème siècle jusqu'aux lits connectés contemporains, illustrant comment les évolutions sociales et technologiques ont façonné notre rapport à l'intimité. L'exposition souligne également le rôle crucial des femmes dans la redéfinition de l'intimité, en s'affranchissant des rôles domestiques traditionnels qui leur étaient attribués. Enfin, elle aborde la manière dont les nouvelles technologies et les réseaux sociaux ont bouleversé les frontières entre vie privée et vie publique, posant la question de la privatisation de l'intime et des nouvelles vulnérabilités engendrées.
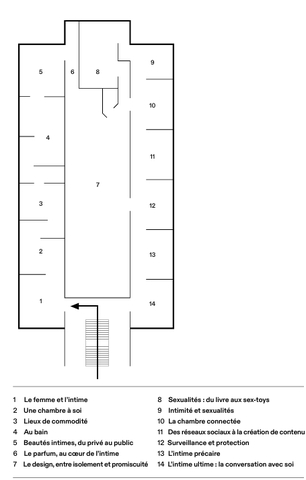
Plan de l'exposition © E.V.
À travers une progression spatiale et thématique, l'exposition interroge la domestication des pulsions, la surveillance, le rôle du design et la précarisation de l'intime : le parcours débute dans le salon, un lieu où se croisent à la fois la vie familiale et la sociabilité. Avec l'avènement de la bourgeoisie au XIXème siècle, le contrôle social et les normes de pudeur redéfinissent les usages domestiques. La progression du parcours conduit vers des espaces plus privés. Cette distinction entre espaces publics et privés s'affirme : la maison devient un espace réglementé, où chaque pièce a une fonction déterminée. La chambre, autrefois privilège aristocratique, devient un espace distinct pour chaque individu dans l'habitat bourgeois du XIXème siècle. La création de la « chambre à soi », concept popularisé par l'écrivaine britannique Virginia Woolf dans son essai publié en 1929, notamment pour les jeunes filles et les adolescent∙e∙s, marque un tournant dans la structuration de l'espace domestique. Aujourd'hui, la chambre est à la fois un refuge et un espace connecté, transformé par la technologie en lieu de travail, de loisirs et d'exposition de soi.

Le tableau « Le Sommeil », d’Edouard Vuillard (1862) mis en parallèle à un lit du XX ème siècle © E.V.
Puis de la chambre, direction la salle de bain, dédiée au soin du corps. Cette pièce, qui se répand progressivement dans les maisons au cours du XXème siècle, pose la question du rapport entre intime et injonctions sociales. Se maquiller, se parfumer, utiliser des soins esthétiques sont-ils des actes individuels ou résultent-ils d'une pression extérieure ? Les objets exposés, du rouge à lèvres d'apparat aux masques LED contemporains, illustrent la normalisation et la popularisation des pratiques cosmétiques. Les parfums, pouvant être sentis grâce à un dispositif olfactif, sont des créations entre proximité et diffusion, une autre manifestation de la dualité entre expression de soi et interaction avec autrui.

Masques LED en vitrine © E.V.
S’en suit un large espace qui présente la manière dont le design intérieur façonne le rapport à l'intime et à la collectivité. À travers une sélection de mobiliers et de concepts architecturaux, elle questionne l'évolution des espaces domestiques entre convivialité et repli sur soi. Dans les intérieurs du passé, les contraintes économiques, les défis liés au chauffage et les dynamiques familiales et sociales favorisaient une intimité partagée et une vie collective. Les lits clos bretons, par exemple, permettaient de conserver la chaleur et d'offrir un espace de sommeil commun, tandis que les tatamis japonais structuraient des pièces polyvalentes où les membres de la famille cohabitaient étroitement. En revanche, durant les années 1970-1980, influencés par le postmodernisme, les designers tendent à privilégier la séparation et l'individualisation des espaces, reflétant une évolution vers une plus grande valorisation de la vie privée et de l'autonomie individuelle, liée à une demande croissante de personnalisation de la part des jeunes générations de consommateurs. Des meubles cocons aux canapés-œufs, les designers explorent aujourd’hui de nouvelles formes d’isolement volontaire. Ces tendances reflètent des mutations sociales profondes, entre désir d’intimité et crainte de l’enfermement, et questionnent notre manière d’habiter l’espace domestique dans un monde de plus en plus connecté, fortement impacté par la crise sanitaire.

Salle 7 : « Le design, entre isolement et promiscuité » © E.V.
L’espace suivant, déconseillé aux plus jeunes, aborde la question des sexualités, longtemps réglementées et censurées. Si le XVIIIème siècle libertin tolère les images érotiques dans un cadre masculin, le XIXème siècle bourgeois opère un retour à la moralisation et à la répression des sexualités « déviantes ». La reconnaissance du plaisir féminin, la révolution sexuelle et l'émergence massive des sex-toys à partir des années 1960-1970 marquent une rupture, bien que les objets du désir restent soumis aux normes du genre. L'exposition montre comment les designers du XXIème siècle réinventent ces objets pour répondre aux besoins d'une diversité de sexualités, en dépassant les conceptions hétéronormées.

Salle 12 : « Surveillance et protection » © E.V.
Cependant, l’arrivée du numérique a bouleversé la notion de sexualité et avec elle, celle de l'intimité. Autrefois espace d'introspection, elle est aujourd'hui mise en scène sur les réseaux sociaux, les téléréalités, où se construisent des identités publiques souvent paradoxales. Les témoignages de plusieurs créateur∙ice∙s de contenu, confronté∙e∙s à une exposition permanente volontaire de leur existence, interroge la distinction entre présence virtuelle et réalité intime. Dans une pièce couverte de caméras de tous types, les dynamiques d'autosurveillance et de construction de soi à travers les technologies numériques sont mises en évidence. Les dispositifs de reconnaissance faciale, de géolocalisation et les bases de données définissent de nouvelles frontières entre sphères publique et privée. En contrepoint, quelques stratégies de résistance sont présentées, du masquage numérique à l'anonymat militant, qui cherchent à rétablir un certain contrôle sur les données personnelles.
L'exposition s'achève sur une réflexion sur la privation d'intimité en situation de précarité. L'absence d'un espace à soi, qu'il s'agisse des sans-abris, des migrants ou des prisonniers, met en évidence le lien fondamental entre intimité et dignité. Les dispositifs architecturaux présentés, comme un banc inspiré de l’architecture hostile au milieu de la pièce, tentent d'y répondre en offrant des solutions adaptées aux populations vulnérables : la création d’une fragile illusion d’intime. Si l'intimité physique et sociale est fluctuante, l'exposition rappelle en dernier lieu qu'il subsiste un « intime ultime », celui de la pensée et de l'imaginaire. L'écriture, de la pratique du journal intime aux blogs contemporains, témoigne de cette irréductibilité de l'espace personnel. Les visiteur∙ice∙s étaient ainsi invité∙e∙s à répondre dans un journal partagé à la question « Qu’est-ce que l’intime ? », pouvant faire le choix de laisser un indice de leur identité ou non. Ces journaux seront conservés dans les archives de l’exposition, gardant la mémoire de ces réponses intimes.
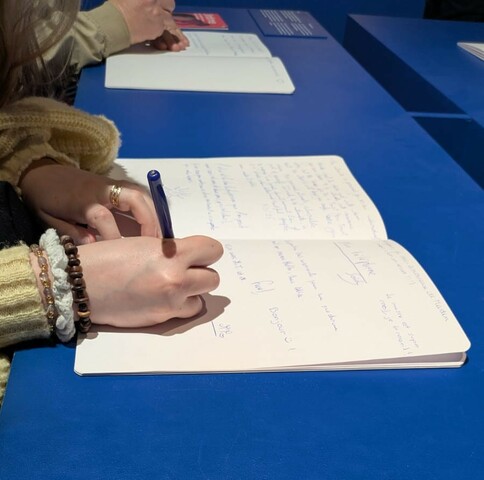
Les visiteur∙ice∙s se prennent au jeu et écrivent dans les journaux pour répondre à la question « Qu'est-ce que lintime ? » © E.V.
En 2025, alors que l'intimité est sans cesse mise à l'épreuve par la surveillance, la marchandisation et l'exposition médiatique, cette part inaliénable de soi constitue un refuge. Ainsi, l'exposition interroge non seulement les mutations de l'intime, mais aussi les moyens de le préserver, en explorant la tension constante entre dévoilement et protection, entre individualité et construction sociale.
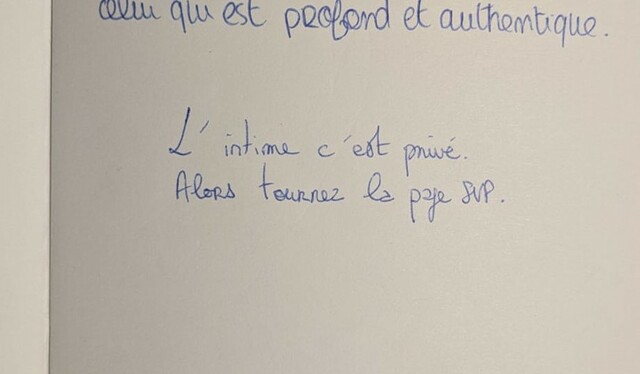
Une amusante réponse © E.V.
Éléa Vanderstock
|
#L'Intime #MuséeArtsDécos #ConstructionSociale |

Exposer l’Homme : conservation, éthique et controverse
Le Muséum d’histoire naturelle de Lille est un muséum tel qu’on aime se l’imaginer : des animaux empaillés, des squelettes suspendus, des momies… Lors de ma visite, confrontée à des êtres, autrefois vivants, exposés, je me suis alors posé une question : comment expose-t-on l’humain ?
Comment les restes humains sont-ils entrés dans les collections des musées en France ? De quelle manière sont-ils conservés et exposés ? Qui est le propriétaire de ces restes et quelles lois régissent ces « biens » ? Sont-ce des personnes ou des objets ?
De l’entrée des restes humains dans les collections
Depuis une vingtaine d’année la place des restes humains au sein des musées pose de plus en plus question. Préparations anatomiques sèches (ossement, fossile, momie) ou en fluides autant de restes présents dans les collections qui sont souvent peu renseignés.
Dès le XVIe siècle les restes humains prennent placent dans les cabinets de curiosités des collectionneurs. Au travers du prisme de l’Égypte, les archéologues se découvrent une fascination pour les momies. Un commerce dans toute l’Europe commence alors ; le corps devient objet d’émerveillement. A partir du XVIIIe siècle, le progrès de la médecine et des techniques de conservation permet l’enrichissement des collections de l’Académie. Le corps plein de mystère fascine, on multiplie les expériences comme celles des machines anatomiques du Prince Raimondo di Sangro. Du côté des musées on voit un développement des collections médicales tel qu’au muséum de Paris fondé en 1793. Du côté des universités de médecine, l’enseignement sur des supports anatomiques est préféré et les corps sont conservés à la suite de la dissection. L’expansion coloniale du XIXe siècle propulse l’étude scientifique sur les différents types de restes humains que le monde conserve et vient nourrir de nouvelles disciplines telles que l’anthropologie. Avec le recul actuel on peut se poser la question de l’acquisition de ces objets, qui souvent est plus que douteuse et relève du pillage. A partir du XXe siècle, l’accroissement des collections est moins important mais on distingue de vraies découvertes majeures faisant avancer l’histoire et la science de notre civilisation (la momie Ötzi). Depuis quelques décennies, l’intérêt pour l’homme et son corps prend un nouveau souffle grâce aux technologies de l’imagerie.
Le musée, en tant que garant de la diffusion des connaissances, se pose alors comme un passeur de savoir auprès des générations futures. Il se doit de pérenniser les collections afin de les transmettre dans le meilleur état possible. Une étude menée par le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF)1 a permis de recenser les restes humains dans les collections muséales. Dans la plupart des cas, les collections disposent de momies complètes ou morcelées. Si la valeur scientifique de ces restes humains semble évidente, la valeur symbolique n’est pas pour autant évacuée une fois les restes entrés dans la collection.
De la conservation à l’exposition
Les conservateurs, responsables de la pérennisation de ces restes, se doivent de proposer une conservation adaptée à la spécificité de ces collections. La diversité des types de sujets peut poser problème. Il sera difficile de proposer une norme de conservation généralisée. Dans un premier temps, il faut prévenir des dégradations physiques et chimiques. De par la fragilité des tissus, la stabilisation de l’environnement est nécessaire. Entre atmosphère trop sèche ou trop humide il faut trouver le juste milieu. Il est conseiller d’avoir une hygrométrie relative de 50% et une température entre 18-20°C. Procurer une atmosphère stable à ces collections, mêmes si elles sont diverses dans leur forme permet d’éviter une fragilisation des tissus, pouvant entrainer une dégradation irrémédiable.
Afin de conserver ces types de collection il semble indispensable de proposer des conditions de conservation idéales. Il serait d’autant plus choquant de voir une mauvaise conservation de ces restes humains. Certes se pose la question de la conservation proposée dans les réserves, mais celle adjointe dans le milieu de l’exposition n’en est pas moins importante.
Exposer les restes humains est finalement un moyen efficace de montrer le passé, le lien avec les morts ou encore saluer les recherches scientifiques. Présenter ce genre de collection n’est pas chose anodine, il ne faut pas oublier que nous n’avons pas tous les mêmes réactions face à la mort et aux corps morts. Ainsi laisser la possibilité de voir ou non, de choisir selon sa sensibilité serait la meilleure façon d’exposer. Si aujourd'hui on trouve des expositions comprenant des restes humains, elles sont toutes (ou presque) inscrites dans un discours scientifique. L’exposition Les momies ne mentent jamais… proposée par Cap Science (Bordeaux) en 2016 s’inscrivait également dans cette démarche scientifique. Le visiteur pouvait en apprendre plus sur les différentes techniques de momifications, les gênes permettant d’identifier l’origine géographique d’une personne, comment embaumer une personne ou tout simplement connaitre l’histoire des momies présentées.
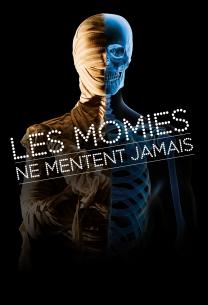
Les momies ne mentent jamais ©cap-sciences.fr
La muséographie ainsi que la scénographie vont jouer un rôle prégnant dans la réception positive ou non du public de l’exposition. Tout est une question de limite de ce que l’on peut montrer et de comment on le montre. Afin d’exposer des restes humains plusieurs critères seraient pris alors en compte. Si l’état de conservation semble évident, la question du mode de présentation reste chose complexe. A ce moment une valeur entre en jeu : le respect. Le respect envers les restes humains, envers sa communauté si on peut l’identifier, ainsi qu’envers les vivants qui les regardent. Plusieurs possibilités d’exposition peuvent être envisagées, comme avec la remise en contexte de découverte (Musée de l’Homme de Neandertal, Corrèze), ou encore de manière isolée.
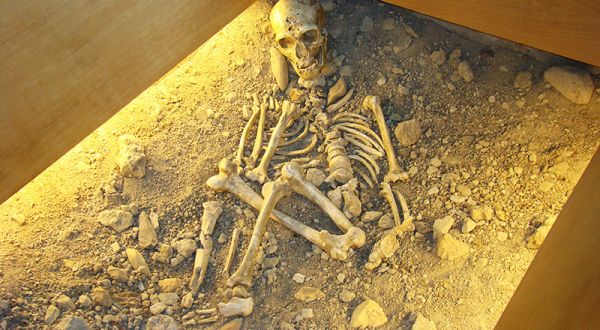
Squelette ©Musée de l'Homme de Neandertal
Au muséum de Lille, certaines vitrines sont restées dans leur « jus ». Dans une volonté de montrer l’exposition des restes humains au XIXe siècle, les momies et crânes humains sont présentées dans des vitrines de cette époque. Une cage de verre (simple vitrage) et de bois, aucun éclairage, deux cartels, un du XIXe et du XXIe qui vient recontextualiser le premier cartel. Le cartel du XIXe vient nous expliquer, par le biais de la présentation de ces crânes, les différentes « races humaines », en produisant tout un discours sur l’indice Céphalique I.C. (le rapport entre la plus grande largeur et la plus grande longueur du crâne). Ainsi le cartel du XXIe vient mettre en garde le visiteur contre ces discours racistes.


Momies du muséum de Lille, ©MS
Des restes patrimonialisés ?
De quelle propriété relèvent ces restes ? A qui appartiennent-ils ? Depuis quelques années ces questions viennent hanter les musées du monde entier. Ce sont nos voisins anglais et américains qui en ont été les premiers témoins. Cette question de la propriété, voire de la question de l’obtention de ces collections, a conduit à des restitutions 2. En France la législation est plus que floue concernant le statut des collections de restes humains conservés dans les musées.
Selon l’article 16-1 de loi bioéthique de 1994 relative au respect du corps humain : « Chacun a droit au respect de son corps. (…) Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial 3. ». En outre, l’Etat ne peut être propriétaire d’un corps. Situation paradoxale : les restes humains ne peuvent appartenir à l’Etat, pourtant ce dernier est propriétaire des collections muséales, qui sont par ailleurs inaliénables et dont font partie les restes humains. L’Etat en est donc propriétaire en un sens. Du fait de cette inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité des collections, renforcée par la loi musées 4 de 2002, les restes humains sont donc « coincés » dans les collections, ce qui peut poser problème lors de cas de restitutions, comme cela a pu se produire à Rouen 5. Les restes humains sont alors entre deux juridictions : en tant que dépouille et en tant que sujet culturel par leur place au sein des musées.
Dans le cas de litige, le plus souvent ce sont les juristes qui décident d’appliquer telle ou telle lois, sans qu’aucune ne soit réellement adaptée à la situation. On peut citer notamment le cas de la restitution de la Vénus Hottentote à l’Afrique du Sud en 2002, où était mise en avant dans un premier temps l’inaliénabilité des restes (puisqu’inscrit dans l’inventaire) pour faire finalement prévaloir la loi bioéthique de 1994. Chaque cas est différent et mérite toute attention.
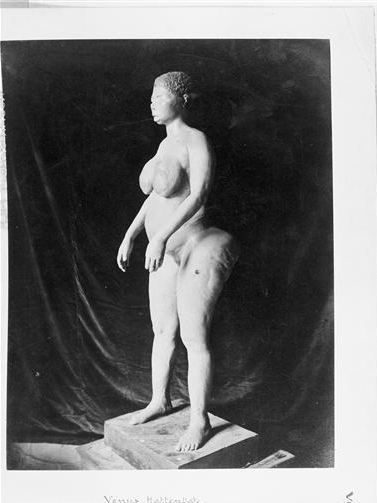
Vénus Hottentote, ©photo.rmn.fr
Une première tentative vers une législation de ces collections « sensibles » est donnée par l’ICOM dans son Code de déontologie pour les musées. En effet, les articles 2.7 ; 3.7 et 4.3 viennent proposer un « cadre » plus clair pour les restes humains, que ce soit en terme d’acquisition, de conservation, et d’exposition. En 2008, le Quai Branly s’est également engager dans une conversation internationale autour de ces questions avec le symposium « Objets anatomiques aux objets de culte : conservation et exposition des restes dans les musées ».
On pourrait finalement se dire que les restes humains sont patrimonialisés selon deux manières : par leur entrée dans les inventaires de collection des musées mais aussi par leur réification. Les musées par leur discours proposent des concepts scientifiques, des concepts abstraits qu’ils viennent illustrer par les restes humains. L’être vivant devient un objet, une chose ; il est réifié. C’est à ce moment que le corps humain, devenu chose sur laquelle on peut exercer un droit de propriété et d’action, est susceptible de devenir patrimoine 6 .
Our Body. A corps ouvert : une exposition controversée
Ouverte en 1995 par le Dr. Gunther von Hagens, anatomiste, a mis au point une technique de conservation des corps. Pour cela il injecte dans un premier temps une solution dans le corps pour le stabiliser et détruire les bactéries, puis il entame une dissection, où les corps gras vont être retirés. Après déshydrations du corps, le corps est plastiné par « imprégnation polymérique ». Une fois ce travail effectué, le corps est placé dans la position désirée. Cette démarche de travail prendrait 1500 heures de travail et 1 an pour achever la préparation.
Dans cette démarche de partage des connaissances sur le corps humain, Gunther von Hagens a donc créé une exposition « conçue pour montrer le fonctionnement interne du corps humain ainsi que les effets d’une bonne ou d’une mauvaise hygiène de vie au public ». Tout en voulant faire « prendre conscience de la fragilité de notre corps et de reconnaitre la beauté anatomique de chacun 7 ». La volonté de cette exposition serait donc de montrer le sens du mot « santé », de signifier le potentiel physique du corps humain et de faire réfléchir le public sur la vie. Actuellement, on nous indique sur le site internet de l’exposition que 44 millions de personnes à travers le monde aurait vu Body Worlds.
Que ce soit sur le site internet ou dans leur communication l’Institut de la plastination ne parle pas de « cadavres » mais de « corps, de spécimens » ou encore de « modèles anatomiques ».
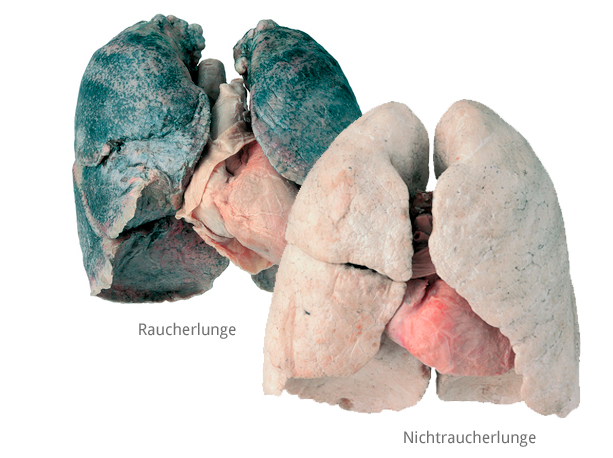

Our body. Body worlds, ©bodyworlds.com
C’est en 2007 que l’exposition fait son entrée en France. La même année l’exposition était présentée dans des centres de sciences aux Etats-Unis (Orlando, Détroit, Oklahoma). Après avoir été à Marseille et Lyon l’exposition devait être accueillie par la Cité des Sciences et de l’Industrie, mais le Comité consultatif national d’éthique a mis son véto. Plusieurs arguments sont mis en avant à ce moment : un aspect commercial en contradiction avec l’interdiction de commercialisation du corps humain ; la question du consentement des sujets ; une représentation de la mort qui porte atteinte à la dignité et à l’identité des sujets et une exposition qui propose un regard techniciste qui rappelle le traitement des cadavres dans les camps d’extermination. La question de la procuration des restes humains n’ayant pas pu être formellement identifiés vient également poser problème. Les corps seraient ceux d’opposants politiques de la République Démocratique de Chine. Le « docteur la mort », comme il est appelé en Allemagne, aurait également affirmé que certains corps avaient une balle dans la tête. Lors de cette réunion du Comité est également présenté que ces restes humains, déréalisés, deviennent des représentations d’eux-mêmes et gagnent ainsi en virtualité. Ainsi l’approche scientifique et pédagogique est pointée du doigt, et le côté « artistique » de l’exposition n’est pas reconnu. Pourtant si on compare cette exposition aux autres musées de France présentant des restes humains, comme le musée médical Dupuytren on se rend compte que Body Worlds inscrit davantage sa démarche dans l’explication de l’anatomie au public. En outre, sur le site internet, on peut retrouver des dossiers pédagogiques pour les enseignants, les familles, les étudiants qui souhaitent mieux comprendre le corps humain et la technique de la plastination. Si la pédagogie se compte en nombre de panneaux, le musée Dupuytren, classifié comme scientifique, serait moins accessible que l’exposition Body Worlds.
Suite à une pétition, les signataires avaient la possibilité de laisser des commentaires concernant l’exposition. 23% disent l’exposition « ignoble, immonde, monstrueuse, (…), choquante » et dénoncent une « marchandisation des corps » (37%), mais pratiquement aucun ne parle de la question de l’éthique (1,5%). D’autres en revanche expriment leur émerveillement et admirations alors qu’ils étaient partagés à la base. Une étude menée par le professeur Ernst-D. Lantermann de l’Université de Kassel et publiée sur le site de l’exposition vient souligner les « bienfaits » qu’aurait procurer Body Worlds dans toutes les villes où elle a été présentée. Il avance par exemple, que 87% des visiteurs déclarent mieux connaitre le corps humain après avoir vu l’exposition, 79% ont été émerveillés par la beauté du corps et que 69% ont quitté l’exposition en décidant d’adopter une meilleure hygiène de vie 8 . D’autres chiffres sur la prise de conscience du corps des visiteurs sont avancés. Des chiffres montrant donc le « possible » impact fait sur la vie des visiteurs.
En 2008, des associations ont saisi le Tribunal de Grande Instance en s’appuyant sur l’article 16-1-1, « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à la crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». Le Tribunal statue en faveur des association en récusant la possibilité que des corps humains puissent être considérés comme des œuvres d’art ou des supports scientifique. Après avoir fait appel à la décision de justice, les organisateurs de l’exposition ont perdu, puisqu’ils étaient dans l’incapacité de produire des preuves de l’origine licite des corps et du consentement des personnes.
La question du consentement revient à plusieurs reprises dans les réflexions sur les expositions comprenant des restes humains. Doit-on considérer ces derniers comme des personnes ou des sujets voire des objets de collection ? Il n’existe pas de réponse préconçues à cette question. Comme nous l’avons vu la loi ne nous apporte pas plus de clarification à ce sujet. On pourrait donc se dire que cela relève de la sensibilité de chacun, du conservateur, ou encore de la communauté fréquentant son musée. Aujourd'hui plusieurs personnes, 15 000 personnes dans le monde auraient décidé de faire don leur corps à l’Institut de la plastination, afin qu’ils soient plastinés, puis exposés.
L’exposition des restes humains dans les musées et dans les expositions est donc un sujet complexe en France. Même si le Code de déontologie de l’ICOM propose des normes, les lois françaises manquent de cadre spécifique aux cas des restes humains entrés dans des collections muséales. D’autres pays commencent à mieux légiférer le cas des restes humains dans les musées, notamment autour de la question de la restitution.
Maëlle Sinou
#exposerlhomme
#éthique
#resteshumains
#momie
1http://c2rmf.fr/collection/les-restes-humains-patrimonialises
2 Laure Cadot, « Les restes humains : une gageure pour les musées ? », La Lettre de l’OCIM [En ligne], 109 | 2007, mis en ligne le 17 mars 2011, consulté le 09 avril 2018. URL : http://journals.openedition.org/ocim/800 ; DOI : 10.4000/ocim.800
3 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000549619&categorieLien=id
4 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000769536&categorieLien=id
5 CCNE, Avis sur les problèmes éthiques posés par l’utilisation des cadavres à des fins de conservation ou d’exposition muséale, n°111, http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_111.pdf
6 Loïc Robert, « Réification et marchandisation du corps humain dans la jurisprudence de la Cour EDH. Retour critique sur quelques idées reçues », La Revue des droits de l’homme [Online], 8 | 2015, Online since 18 November 2015, connection on 08 December 2017. URL : http://journals.openedition.org/revdh/1602 ; DOI : 10.4000/revdh.1602
7 https://bodyworlds.com/about/philosophy/
8 https://bodyworlds.com/about/philosophy/

Exposer l’underground - La fête s’invite dans les institutions culturelles
Les raves n’ont pas toujours suscité l’enthousiasme au sein des institutions culturelles et politiques. Rattachées à l’underground, à l’alternatif, à l’illégal et aux excès, elles s’opposent dans leurs pratiques et par définition aux formes culturelles académiques et aux cadres législatifs et sociaux établis.
Plus qu’un simple thème d’exposition, que peut-on retenir de l’entrée de la techno, emblème de la contreculture, au sein des musées ?
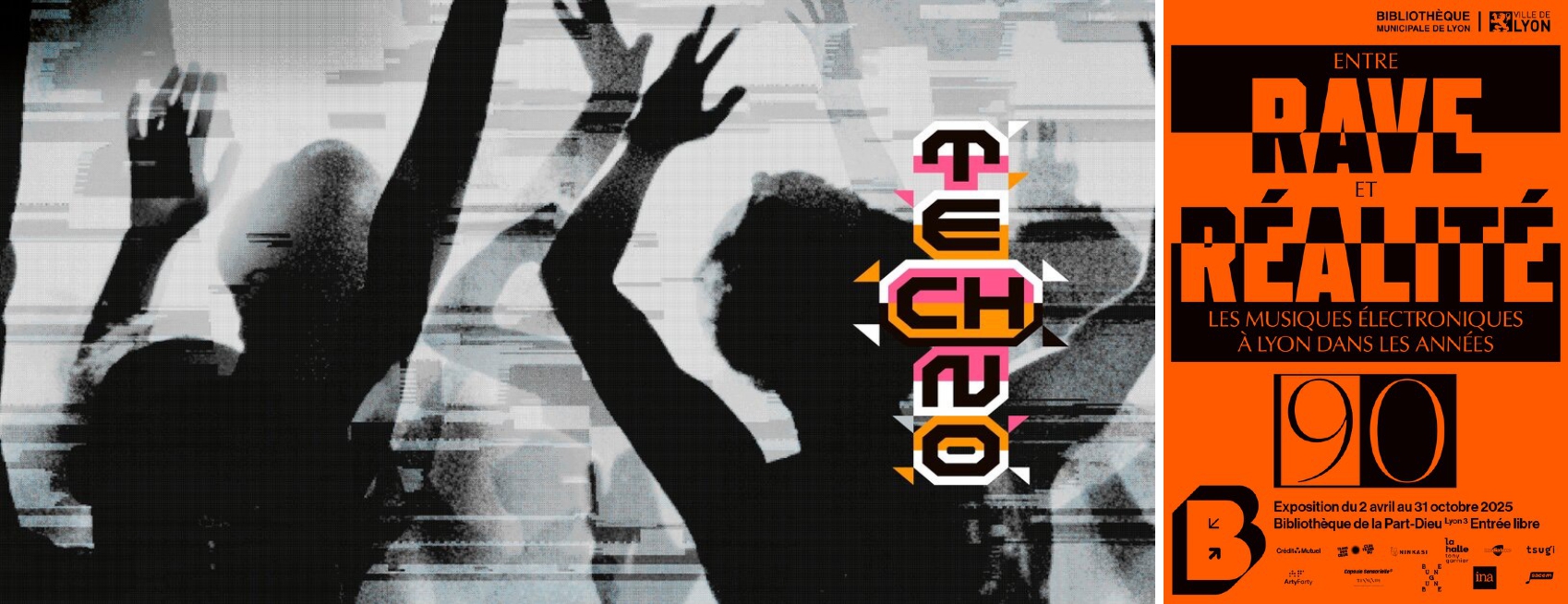
Affiches des expositions TECHNO et Entre rave et réalité.
La Bibliothèque Part-Dieu, à Lyon, présente « Entre rave et réalité » jusqu’au 31 octobre 2025. L’exposition explore la dimension politique des fêtes techno et de ce mouvement musical plus largement. Elle crée ainsi des liens entre le contexte qui a favorisé l’émergence de ce style aux États-Unis dans les années 80 et les choix législatifs autorisant la répression des raves, particulièrement virulente dans la ville de Lyon. Les visiteureuses sont amené.e.s à se questionner sur ce qu’il reste de la dimension contestataire et antisystème au sein des soirées techno, à l’heure où leur popularité explose grâce à des images stéréotypées véhiculées via les réseaux sociaux.
Parallèlement, du 21 mars au 17 août 2025, le Landesmuseum situé à Zurich expose « TECHNO ». Le Musée national suisse entend explorer les multiples champs influencés par le mouvement musical éponyme, de la danse au graphisme en passant par la mode. Rappelant par la même occasion que la ville accueille chaque année le plus important événement techno du monde : la Street Parade, l’institution revendique l’inscription de la techno dans la culture helvétique.
Pourtant, les raves n’ont pas toujours suscité l’enthousiasme au sein des institutions culturelles et politiques. Rattachées à l’underground, à l’alternatif, à l’illégal et aux excès, elles s’opposent dans leurs pratiques et, par définition, aux formes culturelles académiques et aux cadres législatifs et sociaux établis. Aussi, que retenir de l’entrée de la techno, emblème de la contreculture, au sein des musées ?
Exposer la culture underground dans des lieux patrimoniaux.
L’inscription de la culture techno berlinoise au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Unesco en 2024 en fait un courant établi. Désormais classée dans la catégorie « arts du spectacle, coutumes sociales, fêtes et rituels », la techno est à la mode. C’est pourtant avec une dimension « rétro » et avec un biais un brin nostalgique que s’ouvre « Entre rave et réalité ». Sous-titrée « Les musiques électroniques à Lyon dans les années 90 », l’exposition s’appuie sur de nombreuses archives telles des vidéos, des journaux ou des flyers afin d’immerger le visiteur dans cette période charnière pour l’implantation de cette contreculture à Lyon. L’exposition aborde en profondeur l’acharnement des autorités et des médias à enrayer ce mouvement porté par la jeunesse, mais aussi l’émulation créative née de cette contrainte répressive. Les mots crient, les couleurs saturées explosent. Comme un écho à cette tension entre répression et création, la typographie impactante et le fluo rythment le parcours et répliquent les affiches et les logos des collectifs de l’époque.
Cheminant entre les postes d’écoute au casque, les vitrines et les néons de lumière noire, les visiteureuses découvrent cinq modules.
Les raves replace la naissance des raves dans le contexte politique de l’époque avec une présentation de quelques raves locales comme The Summer of France (1993).
Les clubs présente les lieux fondateurs qui ont permis l’ancrage de l’esprit rave à Lyon : l’Hypnotik, le Factory, le Space…
L’évènement Polaris revient sur une soirée décisive, bien que n’ayant jamais vu le jour suite à une décision défavorable des autorités. Son annulation donna en effet lieu à des manifestations et déboucha sur la première assemblée générale de l’association Technopol « pour la reconnaissance de la culture, des arts et musiques électroniques ».
Le DJ et le mix propose une station d’écoute afin d’aborder le travail essentiel du mixage et les différentes machines associées. Ce module offre aussi une visibilité à des talents locaux des années 90, en insistant sur une équité de genre dans les profils mis en avant.
Labels, disquaires, radios, fanzines invite à découvrir l’effervescence créatrice lyonnaise. Faisant un pied de nez aux structures traditionnelles, ces différent.e.s acteurices cité.e.s se sont organisé.e.s collectivement afin de produire et diffuser leurs musiques de façon indépendante. Ainsi, c’est dans cette dernière salle qu’est évoqué le magazine Trax, centré sur les musiques électroniques, qui paraîtra de 1997 à 2023. Un pont subtil pour accompagner les visiteureuses vers une période plus contemporaine et lui donner envie de prolonger sa visite à la bibliothèque par le feuilletage d’un des nombreux ouvrages.
Mais de quelle légitimité dispose la bibliothèque Part-Dieu, institution culturelle et publique, pour s’emparer de cette thématique de la rave ?
Plus grande bibliothèque municipale de France, la bibliothèque Part-Dieu abrite un riche département de la Documentation régionale et du Dépôt légal. Des collections très complètes sur les aspects historiques, patrimoniaux, environnementaux mais aussi sur l’actualité de la ville et de l’ancienne région Rhône-Alpes sont consultables sur place. S’appuyant sur ces ressources, le lieu n’hésite pas à proposer des expositions engagées, en lien avec le territoire : « Dans les marges - 30 ans du fonds Michel Chomarat[1]» en 2023, « À corps et à cris - Conditions de vie des femmes et mobilisations féministes » en 2021. Autant de sujets qui ont marqué et façonné la ville, expliquant leur entrée dans les salles d’exposition de l’établissement.
En parallèle, le Département Musique de la Bibliothèque de la Part-Dieu développe depuis 2009 le Fonds Mémoire des musiques lyonnaises. Celui-ci regroupe l’ensemble des productions musicales ayant un lien avec la métropole lyonnaise. Ce travail de collecte et de conservation s’accompagne d’une mission de soutien et de valorisation de la création musicale grâce au webzine de la bibliothèque qui publie régulièrement des coups de cœur et des dossiers thématiques. Côté exposition, une autre scène musicale locale avait également été mise en lumière avec « Lyon, capitale du rock 1978-1983 » en 2019.
L’institution se prête donc particulièrement bien à accueillir une manifestation sur les raves, prolongée par de multiples rencontres, ateliers musicaux, projections et autres concerts qui participent à développer le dynamisme culturel de la ville.
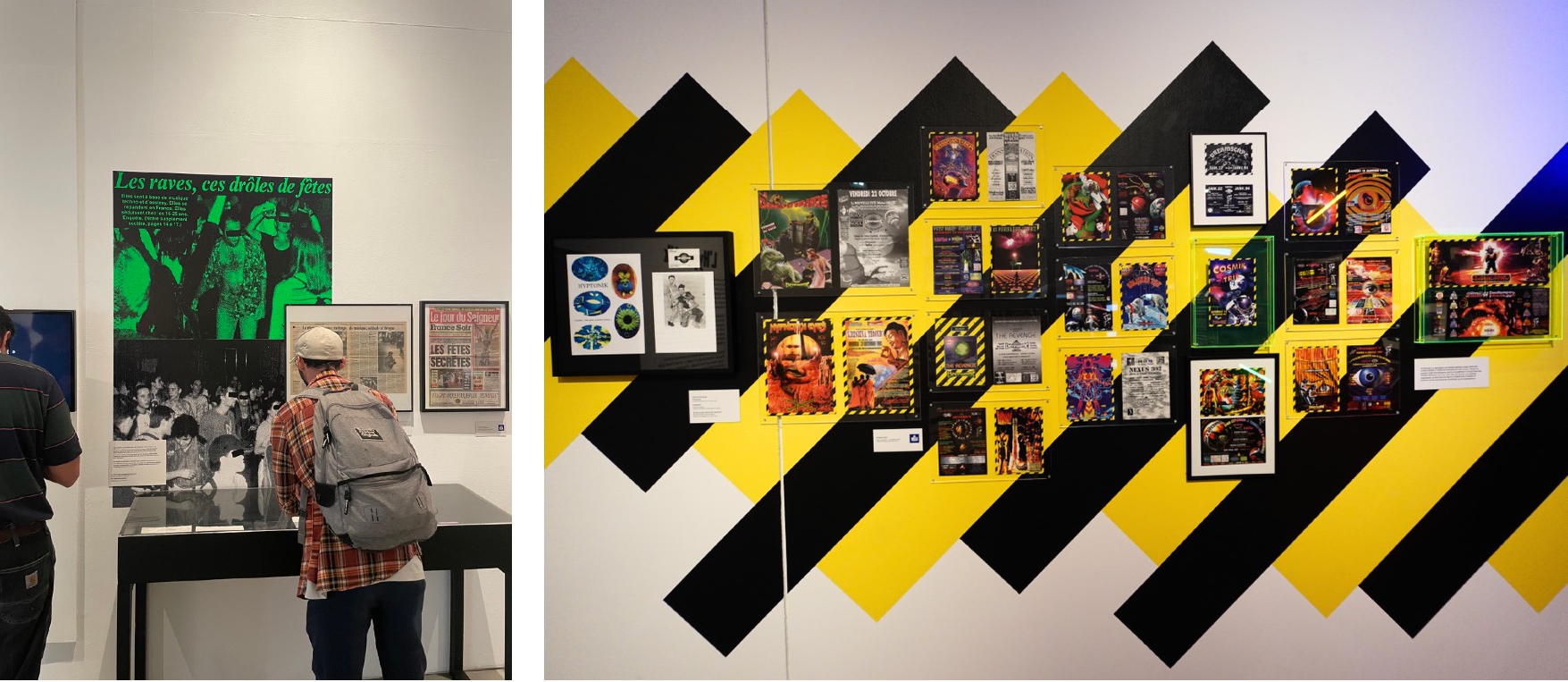
Vues de l’exposition « Entre rave et réalité »
Le pari semble réussi puisque l’exposition « Entre rave et réalité », sans en dénaturer l’atmosphère ou les récits, rappelle avec justesse que la techno est au départ une affaire de passionné.e.s de musique. Ils et elles ont su exploiter les interstices d’un système dominant pour développer un mode d’expression qui s’étend bien au-delà d’un style musical. In fine, focaliser l’exposition sur la période temporelle restreinte que sont les années 90 permet également de confronter avec force le tournant pris récemment par les scènes musicales électroniques.
Patrimonialiser l’underground
« Mais ce qui surprend peut-être le plus l'observateur extérieur, c'est la reconnaissance d'une musique avec une sous-culture totalement moderne et enracinée dans le jeunisme : généralement, les patrimoines de l'UNESCO, matériels ou immatériels, sont des présences du passé déplacées dans le présent - l'inclusion de la techno berlinoise est plutôt une reconnaissance radicale du présent ainsi qu'un témoignage d'une scène artistique extraordinairement vivante et actuelle. »[2]
Si les musiques électroniques gagnent en popularité et en visibilité auprès d’un certain public, rendant le sujet propice aux expositions à succès (on pense aussi à Clubbing visible jusqu’au 12 octobre au Grand Palais Immersif à Paris), l’univers de la fête techno demeure un milieu précaire. En proie à des difficultés économiques certaines, il reste associé à des nuisances dans l’imaginaire collectif et auprès des pouvoirs publics - la documentation abondante présentée dans « Entre rave et réalité » le montre bien. L’allier à des objectifs culturels et artistiques peut s’avérer être une stratégie payante pour assurer sa survie et légitimer son existence. À cet égard, la création récente (2025) du label Club culture - lieu d’expression artistique et de fête est considérée comme une victoire par les acteurices du milieu. Selon le média Tsugi, ce label est une première étape dans le changement de perception adopté par les institutions, les municipalités mais aussi le grand public vis à vis des activités des clubs. Selon la volonté des professionnels ayant participé à la co-construction du label, il ne sera pas question d’argent ni de subvention mais d’accompagnement et de certification. Le site gouvernemental annonce, quant à lui, vouloir valoriser « des lieux hybrides, à la croisée des mondes artistiques, culturels et festifs, qui participent pleinement à la vitalité des musiques actuelles »[3].
Exposer la techno au musée est un autre moyen de revaloriser son image et de l’instituer comme moteur de création musicale mais aussi vestimentaire, graphique, photographique. C’est l’angle d’approche qu’a choisi d’adopter le Landesmuseum de Zurich. L’exposition, conçue en collaboration avec des travailleureuses de la scène techno suisse, met un point d’honneur à présenter ce mouvement comme une tradition helvétique bien vivante, nourrie de collaborations et d’échanges.
Pour pénétrer dans l’exposition, les visiteureuses sont invité.e.s à monter un escalier en haut duquel un char les attend. Les pancartes colorées placardées affichent le slogan Happy people Zurich. Dès le départ, la filiation existante entre la Love Parade berlinoise et la Street Parade zurichoise est rappelée. Le prologue de l’exposition permet également une remise en contexte en prenant comme point de départ les villes de Detroit, Berlin et Zurich pour présenter les fondements du mouvement techno au moyen de tableaux synoptiques et de contenus numériques. Bouleversements sociaux et conditions économiques des années 90 sont directement mis en regard avec l’œuvre Dance of Urgency (2019) dans laquelle l’artiste Bogomir Doringer interroge la signification actuelle de la techno et la danse comme stratégie possible d’adaptation en situation de crise. Des personnes appartenant à la scène techno ukrainienne et géorgienne apparaissent à l’écran et livrent des récits intimes où la fête, qui peut sembler paradoxale en temps de guerre ou de répression étatique, devient un espace de résistance et de liberté.
Cinq modules suivent cette introduction : DJ, MUSIC, SPACE, CLUB, STYLE, chacun affirmant la dimension artistique et patrimoniale de la fête. Dans cette même perspective, une partie des aménagements du Club Zukunft (fermé au mois de mars 2025), présentés pour l’occasion, intégreront par la suite la collection du Musée national suisse. Plus globalement, TECHNO fait la part belle aux objets, aux photographies ou encore aux vidéos, illustrant la profusion de contenus directement inspirés par le mouvement mais aussi dans un souci d’économie de textes. Leur rédaction en quatre langues : français, allemand, italien et anglais, semble avoir contraint le musée à adopter des écrits courts et synthétiques qui permettent de se focaliser sur les œuvres et sur les dispositifs muséographiques. Cela permet aussi d’avoir une ambiance générale très stimulante (lumières, sons, couleurs) et une visite fluide et agréable.
Vue de l’exposition TECHNO
En définitive, l’exposition vise en partie un public de non initié.e.s à l’univers de la techno en mettant en place des dispositifs comme une reconstitution de magasin de disques, des témoignages vidéos et des objets inédits pour un musée. La visite permet de revivre les évolutions et l’impact social de la culture techno, en rappelant que la vitalité de cette dernière découle des interactions riches entre les différents champs de la création artistique…et à présent les institutions culturelles ?
Selon Arnaud Idelon, auteur, critique d’art et chercheur associé à l’Université Paris 1, « le mouvement d’institutionnalisation est inéluctable, toutes les contre-cultures, le hip-hop, le graffiti, ont été institutionnalisées (…) La bonne manière de poser la question c’est : Quelles seraient les conditions d’une bonne institutionnalisation? »[4]
Un passage par les institutions culturelles pour (r)ouvrir le champ des possibles
À la fin du parcours de l’exposition Clubbing au Grand Palais Immersif, on peut lire cette phrase de l’auteur Tim Lawrence : « Si la fête ne résoudra pas les problèmes de ce monde, elle pourrait néanmoins être le lieu où nous pourrions commencer à en imaginer un autre. »
En mettant en lumière la fête comme lieu politique et acte de résistance, les institutions culturelles offrent un espace de réflexion également propice à réinventer des mondes, des modes de luttes et des dynamiques sociales. Les musées présentés ici, mais qui ne sont pas les seuls à le faire, s’emparent ainsi d’un sujet d’actualité et touchent des publics variés, habitués à fréquenter ces milieux festifs et musicaux ou non.
Vue de l’exposition Clubbing
Et Tim Lawrence de conclure : « Danser, se mélanger, se lier, communiquer, travailler, construire et prier, la nuit scintille encore d’un espoir utopique que la lumière du jour serait bien en peine de faire naître. »
Sasha Pascual
Pour aller plus loin
Expositions/Art/Animation
Retrouvez les informations liées à l’exposition Entre rave et réalité :
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/les-evenements-de-la-bml/
Retrouvez les informations liées à l’exposition TECHNO :
https://www.landesmuseum.ch/fr/expositions/temporaire/2025/techno/techno#autres-expositions
Retrouvez les informations liées à l’exposition Clubbing :
https://grandpalais-immersif.fr/agenda/evenement/clubbing
Pour en savoir plus sur le projet Dance of Urgency (2019) de l’artiste Bogomir Doringer :
https://www.minimalcollective.digital/editorial/a-rave-review-bogomir-doringer-explores-the-political-bearing-of-the-dance-floor
https://bogomirdoringer.com/index_curation
L’atelier d’exploration Club, à la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs de Saint-Blaise (Paris 20ème), ça vous tente ? :
https://www.paris.fr/evenements/club-atelier-d-exploration-91254
Article/Littérature/Conférence/Débats
Pour une introduction à propos de la dimension politique de la fête :
https://video.blast-info.fr/w/dcBqMUE64esMsMsEx1KWGG
Un peu de lecture…l’ouvrage BOUM BOUM - Politiques du dancefloor (2025) d’Arnaud Idelon :
https://www.editionsdivergences.com/livre/boum-boum
Et le livre Love Saves the Day: A History of American Dance Music de Tim Lawrence 1970 – 1979 (2003) dont est issu la citation lu à Clubbing :
https://www.timlawrence.info/
À propos du label Club Culture : 30.11.24, FRAISSE Corentin, Le ministère de la Culture lance le label ‘Club Culture’, Tsugi.
https://www.tsugi.fr/le-ministere-de-la-culture-lance-label-club-culture/
[1]Michel Chomarat, né à Lyon en 1948, est une personnalité active dans la communication, la défense de la culture et du patrimoine imprimé, la politique et l'édition, ainsi qu'un militant pour les droits LGBT en France. ↩
[2]205.04.24, SALAMONE Lorenzo, Pourquoi la techno berlinoise est devenue un site du patrimoine de l’UNESCO, NSS France. https://www.nssmag.com/fr/lifestyle/36127/techno-berlino-unesco ↩
[3]329.10.24, Circulaire relative à la mise en œuvre du programme « Club Culture-lieu d'expression artistique et de fête », ministère de la Culture. https://www.culture.gouv.fr/catalogue-des-demarches-et-subventions/appels-a-projets-candidatures/club-culture-lieu-d-expression-artistique-et-de-fete ↩
[4]419.06.25, CHAVEROU Éric, Label, expositions : les clubs et le clubbing acteurs culturels enfin officiellement reconnus, France Culture. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-info-culturelle-reportages-enquetes-analyses/label-officiel-expositions-les-clubs-et-le-clubbing-acteurs-culturels-enfin-officiellement-reconnus-5331217 ↩
Crédits photos : Landesmuseum / Musée national suisse, Bibliothèque municipale de Lyon / Sasha Pascual et Bibliothèque municipale de Lyon, Grand Palais Immersif / Sasha Pascual
#culturetechno #patrimoineimmaterieldelunesco #landesmuseum #bibliothèquemunicipaledelyon
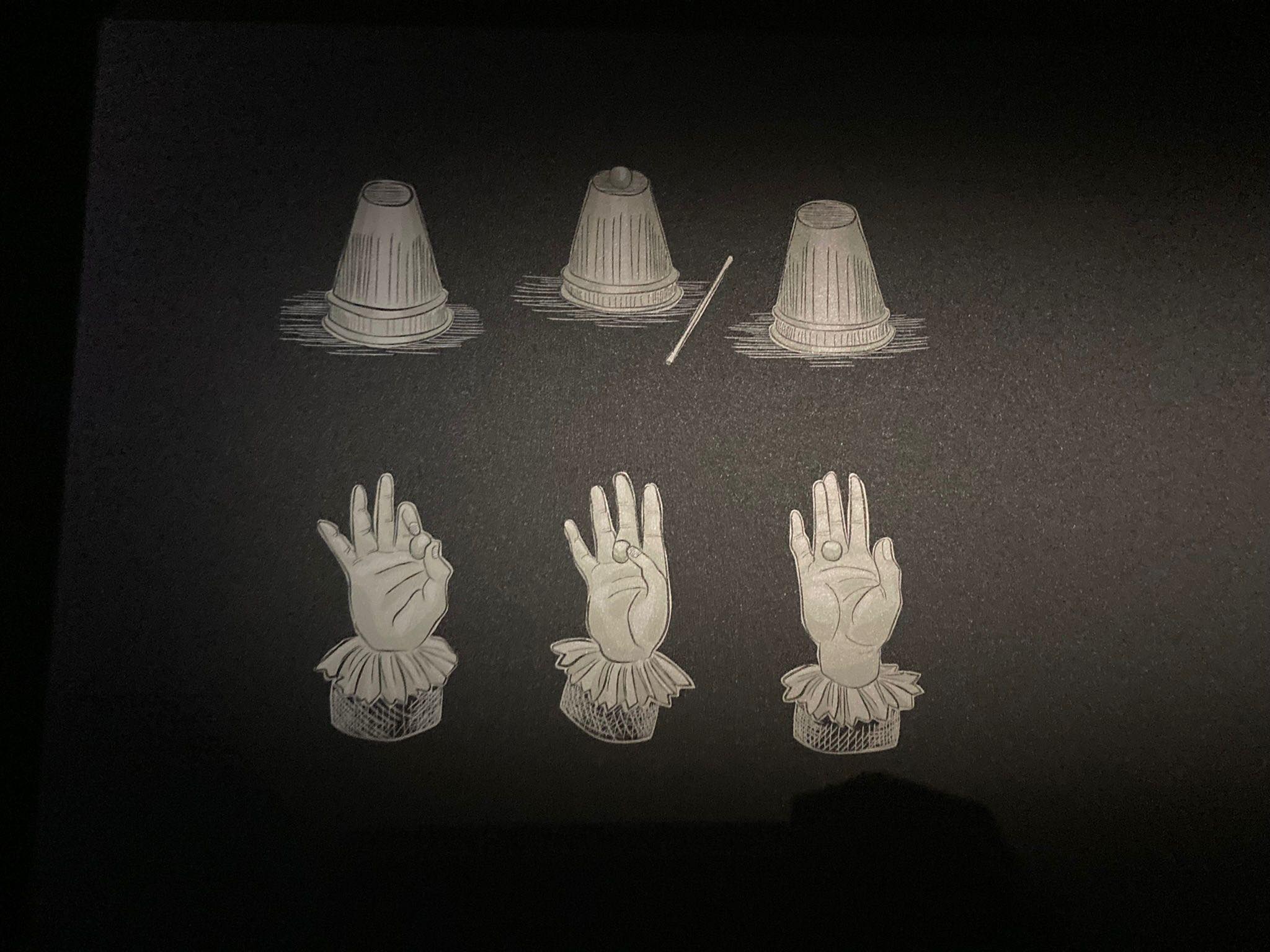
EXPOSER LA MAGIE : MAGIQUE, MUSEE DES CONFLUENCES
« Pour que la magie existe, il faut que la société soit présente. » Marcel Mauss et Henri Hubert, Esquisse d’une théorie générale de la magie, 1904.
Quels rapports nos sociétés entretiennent-elles avec l’occulte ?
Le Musée d’Histoire Naturelle de Toulouse et le Musée des Confluences se sont saisis du sujet pour co-produire main dans la main un projet collaboratif ambitieux.
Image d'intro : @CL
L’acte 1 de l’exposition Magies-Sorcelleries à Toulouse se tenait du 19 mai 2021 au 2 janvier 2022. Il abordait la magie à partir du prisme des savoirs scientifiques et occultes. A Lyon l’acte 2 Magique, du 15 avril 2022, explore le rapport de nos sociétés à la magie comme un fait social universel et intemporel. L’équipe des deux musées s’est alors entourée d’un comité scientifique pour construire son propos : anthropologue africaniste, ethnologue spécialisée dans les religions européennes, archiviste, conservateur en chef du patrimoine, magicien.

@TB
Dès le début du parcours le visiteur est plongé dans une forêt obscure cernée de signes occultes et de bruits nocturnes, conçus par Marion Lyonnais de l’entreprise Fakestorybird. La forêt fait appel aux origines, à la nature, à l’imaginaire. La scénographie alterne entre évocations culturelles (rideau rouge de prestidigitation, formules magiques) et évocations naturelles (éclipse, bruits nocturnes, arbres en bois flotté). Ces derniers ont été choisis par rapport à des exigences de conservation et en fonction de leurs étrangetés. L’exposition aurait pu choisir d’aborder la magie par la peur et la fascination de l’illusion comme le font de nombreux films de notre époque. Pourtant un nombre conséquent d’objets ont été choisis pour leurs propriétés de guérisons plutôt que de malédiction pour ne pas heurter le public et pour se montrer les effets bénéfiques de la magie sur l’homme. Magique regroupe au total plus de 400 objets issus des sciences naturelles, de l’archéologie ou encore de l’ethnographie. Son parcours retrace intelligemment l’histoire de la magie en lien avec notre passé occidental hérité de l’antiquité et parallèlement aborde le processus magique, universel et intemporel. Des origines à l’époque contemporaine il relate une histoire plurielle et ambivalente de la magie, empreinte de tourments et de questionnements, de la matérialisation de l’invisible (représentation des divinités, alchimie, sorcellerie) à sa réappropriation (prestidigitation, spiritisme, néo-chamanisme, néo-sorcières).

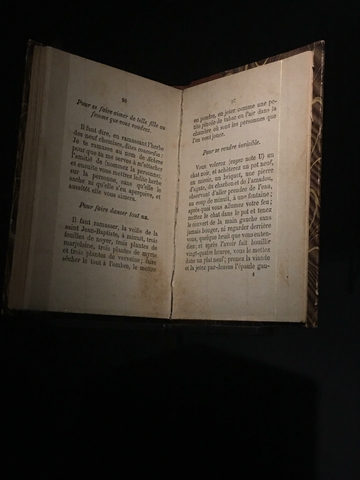

@TB et CL
L’action magique intervient sur le réel et nécessite dans toute culture l’entrée en contact par un intermédiaire (qui dispose d’attributs, de pouvoirs innés ou acquis) sur un sujet (animal ou humain), à qui il destine des intentions ambivalentes par la mise en place de gestes magiques.
Dans l’espace qui traite de l’époque moderne en occident, les nouvelles technologies sont employées à des fins de divertissement et de spectacle. Certains illusionnistes du XIXème siècle affirment tirer leurs pouvoirs du diable et du monde des morts. Les affiches de leurs spectacles déploient un imaginaire dans cette continuité. L’ambiguïté de leurs pouvoirs magiques est à questionner, mais le principe d’action magique sur le réel est bien présent, au même titre que le chamane ou le sorcier dans d’autres cultures et à d’autres époques.
Retracer le passé par ce prisme nous permet ainsi de faire des parallèles entre nos différentes sociétés mais également de mieux appréhender notre société contemporaine.

@CM
Le parcours se termine là où il a commencé : dans la forêt. Il ne s’agit plus d’une forêt naturelle mais d’un arbre à vœux, rituel pratiqué de tout temps et dans chaque culture pouvant s’apparenter à la dendrôlatrie (adoration des arbres). Ce dernier dispositif est le plus retenu du visiteur (plus de 700 mètres de rubans épuisés dans la seule journée du 11 novembre 2022). Il permet au visiteur de s’inspirer d’un des gestes magiques précédemment évoqué plus tôt dans le parcours (action de souffler, d’écrire, d’attacher, de nouer, de faire une offrande) afin d’user d’ingéniosité en se l’appropriant et en laissant son empreinte pour exprimer à son tour son souhait.
En prenant le parti d’aborder le phénomène magique à l’échelle occidentale puis mondiale l’exposition se révèle polymorphe et multiculturelle. Retracer l’histoire de la magie occidentale c’est aborder notre passé empreint de rationalisme et de spectaculaire. Le processus magique lui est intemporel et universel. La mise en parallèle de ces deux histoires permet de nous questionner sur la place de la magie dans notre quotidien, sur un simple geste humain rempli d’espoir dans le but d’influer sur le cours des choses.
Un chaleureux remerciement à Carole Millon, cheffe de projet de l’exposition Magique,qui a répondu à mes questions.
Theo Balcells
Pour aller plus loin :
#Museedesconfluences, #exposition, #magique

Exposer le privé : une manière de mettre en scène l’actualité ?
« Aller au bout de ses rêves, ça fait peur. Mais c’est aussi s’assurer de ne pas avoir de regrets », Walter Vanhaerents.
Mark Handforth, Stardust, 2005 ©Séléna Bouvard
La Vanhaerents Art Collection est une collection familiale d’art contemporain rassemblée par Walter Vanhaerents et ses enfants Els et Joost, qui fournit un aperçu des courants artistiques de la fin des années 70 à aujourd’hui.
A travers 57 œuvres monumentales colorées et engagées, l’exposition organisée au Tripostal de Lille (du 6 octobre 2023 au 14 janvier 2024) reflète la diversité et la vitalité des pratiques artistiques actuelles avec des artistes confirmés et émergents comme Bruce Nauman, Matthew Day Jackson, ou encore Ali Banisadr, occasion de mêler peintures, sculptures, installations, et vidéos.
Passionné par l’art provocateur, Walter Vanhaerents, commissaire de l’exposition, propose aux visiteurs de découvrir des œuvres revendicatives et dénonciatrices du quotidien. Walter Vanhaerents propose une exposition qui adopte un regard tourné vers le présent comme vers le futur.
Exposer une collection privée n’aurait alors pas toujours comme but de faire un état des lieux d’œuvres à prix démesuré en vogue sur la scène du marché de l’art.
Une muséographie sobre au regard de la scénographie
Le Tripostal offre trois plateaux de 2000m2 chacun. Pouvant profiter de cette souplesse spatiale, les œuvres de la collection Vanhaerents s’inscrivent à merveille dans cet espace culturel. La muséographie fait écho à celle mise en place dans le lieu d’exposition de Bruxelles (un ancien entrepôt transformé par le duo d’architectes Robbrecht & Daem) où Walter Vanhaerents décide de modifier la manière de présenter ses collections au public en adoptant le format d’un dépôt de visualisation où s’entremêlent esthétique et fonctionnalité.

Intérieur du musée (29 rue Anneessens, 1000, Bruxelles) ©VanhaerentsArtCollection
Le Tripostal utilise cette même manière d’exposer en adoptant une muséographie peu développée, à l’exception des cartels éclairés de manière tamisée par des plafonniers. Les œuvres sont posées au sol ici et là telles que celles composées de néons d’Ivan Navarro, KickBackKickBackKickBack (2016) ou Twin Towers (2011). D’autres sont accrochées sur des murs blancs n’accueillant qu’un seul tableau comme The Arrival of Spring in Woldgate (2011) de David Hockney et One Minute You’re here (2020-2021) de Friedrich Kunath. Ou encore, des sculptures sont placées au milieu du parcours telles que celles de Laure Prouvost (This Means, 2019) ou d’Ugo Rondinone (If There Were Anywhere but Desert, Sunday, 2000), afin de rompre la monotonie des couloirs droits.
Au rez-de-chaussée, la scénographie se compose de multiples fils noirs où les œuvres Tomas Saraceno (Cloud Cities : mise-en-Aéroscène (2016-2023)) habitent tout l’espace d’exposition. Le visiteur est invité à déambuler librement à travers ces fils afin d’observer de près les œuvres de cet artiste. Le parti-pris de Tomas Saraceno avec ce type de scénographie est à la fois innovant autant que surprenant car le visiteur doit alors porter toute son attention à ne pas heurter les fils et les œuvres de cette installation.
Les expôts sur fond neutre, en l’occurrence au Tripostal dans des salles blanches, dégagent une impression de sobriété. Les cimaises sous forme de « white cube » soulignent l’importance de chaque objet et fournissent une présentation homogène. Les objets et l’espace forment alors un tout car une même importance leur est accordée. Néanmoins, au premier et deuxième étage, les mises en scène, objets comme cimaises, varient. Les œuvres sur le troisième plateau impressionnent par leur dimension (Vaughn Spann avec sa toile sur châssis en aluminium et peinture polymère Blue Joy (2020) de plus de 2m de hauteur et de largeur), et leurs matériaux. La salle 12, consacrée à David Altmejd, présente des sculptures grandioses de figures anthropomorphes en plexiglas, mousse expansée, fils de nylon, cristaux et miroirs.
L’éclairage est adapté à la pièce et au thème de l’exposition. L’œuvre de Yinka Shonibare (Leisure Lady, 2001), disposée sur un piédestal, est mise en valeur par son socle et sa visibilité est renforcée par la lumière, tandis que des espaces sont plongés dans la pénombre pour que la projection des vidéos comme celle de Bill Viola (Martyrs, 2014) ou des films comme The Feast of Trimalchio (2019) de AES+F immergent les visiteurs comme dans une salle de cinéma. Ces luminosités différentes établissent alors une hiérarchie des perceptions entre les pièces d’exposition, les expôts, et l’espace, tout en renforçant l’expérience émotionnelle.

Ugo Rondinone, If There Were Anywhere but Desert, Sunday, 2000, Fibre de verre, peinture, vêtements, paillettes. © Séléna Bouvard
Tomas Saraceno, Cloud Cities : mise-en-Aéroscène, 2016-2023, miroirs, plexiglas, fils. © Séléna Bouvard
Lumière et engagement
Les œuvres, telles qu’exposées, semblent à première vue purement esthétiques. Mais lorsque le visiteur s’informe, auprès des médiateurs présents dans la salle ou des cartels, du concept exprimé par l’artiste, le discours devient tout autre.
Au premier étage, Yinka Shonibare propose Leisure Lady (2001), une sculpture colorée d’une femme sans tête portant une robe en wax d’époque victorienne et tenant en laisse trois ocelots. Ce tissu de coton imprimé selon un procédé à la cire et ces félins d’Amérique en voie de disparition dénoncent une époque marquée par la colonisation et des thèmes à la mode tels que l’apprivoisement de la faune. Le XVIIIè et le XIXè siècle rappellent, en France comme en Europe, le temps des « expositions d’ethnographie coloniale » dans des « zoos humains » où étaient présentées des populations d’origines africaines afin de montrer l’exotisme des contrées que la France, la Hollande ou encore le Portugal, pays colonisateurs, n’hésitaient pas à piller et à exploiter à travers l’esclavage. En supprimant la tête du personnage, Yinka Shonibare évoque la décapitation de la bourgeoisie et de l’aristocratie colonisatrice qui avaient le monopole sur le commerce et le transport d’esclaves.
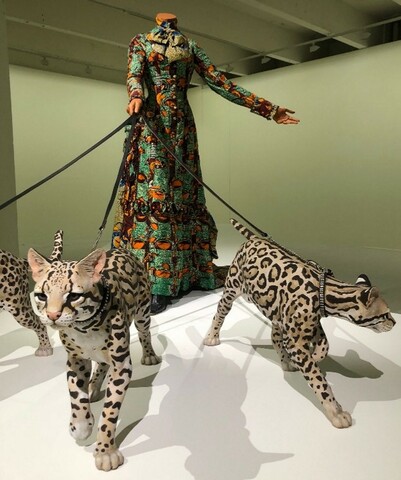
Yinka Shonibare, Leisure Lady, 2001, mannequin grandeur nature, trois ocelots en fibre de verre, wax hollandais imprimé sur coton, cuir, verre © Séléna Bouvard
Oubliés ou supprimés dans l’histoire de la peinture occidentale, Titus Kaphar tend à dénoncer dans Beneath an Unforgiving Sun (2020) la sous-représentation des minorités. Sur ses huiles sur toile, il découpe les portraits d’enfants afro-américains se tenant à côté de leur mère ; se lit un sentiment d’épuisement et de désespoir. Revendiquant le racisme et l’oppression qui pèsent sur la communauté noire, Titus Kaphar accentue cette violence en laissant des trous dans les tableaux, en miroir du regard des Blancs. Ces “victimes fantômes” soulignent la fragilité de leur vie et de leur avenir incertain.
Avenir incertain, tel fut le cas pour Trayvor Martin qu’évoque Vaugn Spann dans Blue Joy (2020) au deuxième étage. L’artiste rend hommage à cet adolescent de 17 ans non armé tué par un agent de sécurité en Floride. A première vue, cet arc-en-ciel éclatant semble transmettre un état d’esprit positif et joyeux, mais la réalité est autre. Aux couleurs du slogan publicitaire « Taste the Rainbow » pour la promotion des Skittles, cet arc-en-ciel aux mêmes couleurs a une originalité, celle de posséder un rayon noir qui fait écho à la violence et aux injustices subies par les communautés noires africaines. En effet, cela peut faire écho au meurtre de Georges Floyd aux Etats-Unis en 2020, tué sans raison valable par des policiers.
Dans Eye Candy (2022) de Derrick Adams, le regard du visiteur se concentre sur une imagerie dynamique de six panneaux colorés représentant chacun la même figure masculine noire qui tient une sucette. Cette œuvre aux couleurs « pop » dissimule et renferme, en parallèle du visage à moitié caché, le concept de « friandise pour les yeux », en référence au titre de l’œuvre. Cette approche s’inspire d’une image promotionnelle de sous-vêtements tirée d’Ebony, un magazine à destination du public afro-américain des années 80. Entre publicité, culture populaire et consumérisme, l’artiste emploie l’iconographie du corps afin de contester la perception stéréotypée de la masculinité noire.
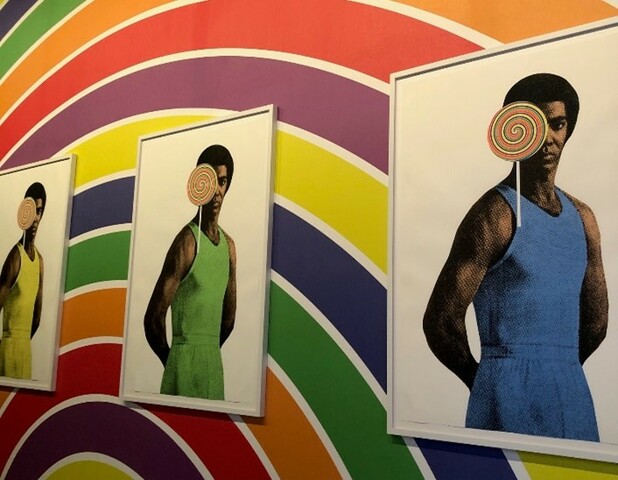
Derrick Adams, Eye Candy, 2022, six sérigraphies avec collages en relief encadrées, papier peint © Séléna Bouvard
Entre thématiques identitaires, historiques et sociales, les artistes sélectionnés par Lille3000 en collaboration avec la collection Vanhaerents exposent des œuvres lumineuses et engagées qui, par leurs couleurs et leurs dimensions, marquent les visiteurs.
Une beauté mystérieuse
« Je cherche constamment la possibilité de présenter les mêmes choses de différentes manières - et d’y introduire un élément de vulnérabilité humaine », Sudarshan Shetty
Poétiques tout autant qu’esthétiques, les artistes proposent des œuvres en lien avec la vanité, le temps qui passe, approchant parfois le Memento Mori. Cette beauté fantasmagorique est portée par les matériaux employés et par le concept dicté par l’artiste.
Sculptures surréalistes et monumentales, tel est le cas de David Altmejd dans la salle 12 du troisième plateau du Tripostal qui réalise Le Ventre (2012) où il expérimente la nature de l’être humain, entre transformation et dualité. David Altmejd joue sur les ombres et les lumières à travers des matériaux translucides qui filtrent la lumière, tout en montrant l’intérieur d’un ventre humain en désagrégation. L’artiste oscille alors entre le beau et le macabre, l’intérieur et l’extérieur, afin d’illustrer la fragilité et la vulnérabilité du corps humain, ouvert à la vue de tous.
Explorer les possibilités des matériaux non conventionnels comme le gonflable est le parti-pris de Fredrik Tjaerandsen qui réalise Blue Crescent (2023), un body en latex formé de deux croissants reliés par un cordon reposant sur les épaules du mannequin. Cette œuvre est issue d’une performance, diffusée par une télévision. En miroir à ce contenu multimédia, se tient un mannequin fictif qui porte ce body. Alliant mode, art et performance, l’artiste souhaite faire prendre conscience au visiteur qu’il se limite trop souvent à sa propre bulle. Cette idée d’isolement se ressent par la dimension de l’œuvre : l’épaisseur du body met une distance entre le mannequin et le visiteur, donc en prolongement, entre chaque être humain.
À première vue, Dark Blue Clock (2022) d’Ugo Rondinone semble être un vitrail mais qui se révèle être, d’après le titre de l’œuvre renseignée sur le cartel, une horloge. Dépourvue des aspects essentiels à la compréhension de sa fonction dont le visiteur a besoin pour lire l’heure, cerclée de plomb, elle brouille les perceptions connues de l’horloge avec aiguilles et chiffres. Ugo Rondinone rappelle que le temps que le visiteur habite dicte sa vie de manière arbitraire. Aiguilles, chiffres, ou non, le temps est impalpable et aléatoire.
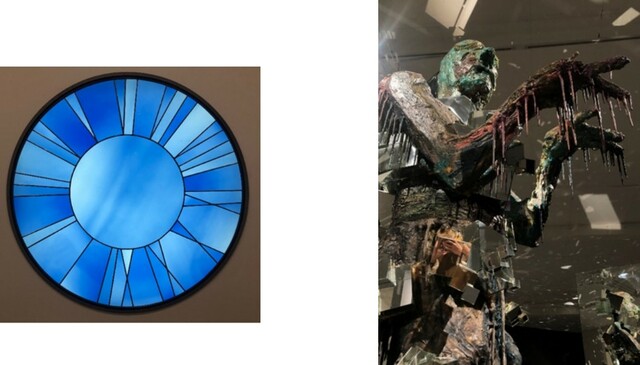
Ugo Rondinone, Dark Blue Clock, 2022, vitrail © Séléna Bouvard
David Altmejd, Le Ventre, 2012, techniques mixtes © Séléna Bouvard
Au deuxième étage, ces univers à la fois étranges tout autant que familiers (l’espace intime et personnel, le corps humain, le temps) illustrent des visions plus nuancées, moins polémiques ou politiques mais tout aussi fortes en matière de création.
C’est en se penchant vers les cartels des œuvres que ces dernières prennent sens. Si certaines peuvent sembler purement esthétiques, un message fort s’y cache. La Vanhaerents Art Collection propose des œuvres au grand éclectisme ouvrant une porte aux artistes non-occidentaux et offrant aux artistes émergeants l’opportunité de trouver une place sur le devant de la scène artistique contemporaine. L’accrochage et l’installation exploitées au sein du Tripostal de Lille, dépouillées, permettent au visiteur une immersion au sein de la collection privée de la famille Vanhaerents. Cette dernière s’inscrit, au travers de ses œuvres, dans une actualité contemporaine tant d’un point de vue social (la considération entre chaque individu qui s'évanouit ainsi que le vivre ensemble qui s’efface) que politique (les violences policières et l’invisibilité des personnes noires).
Séléna BOUVARD
#collection privée #art contemporain #lieu culturel
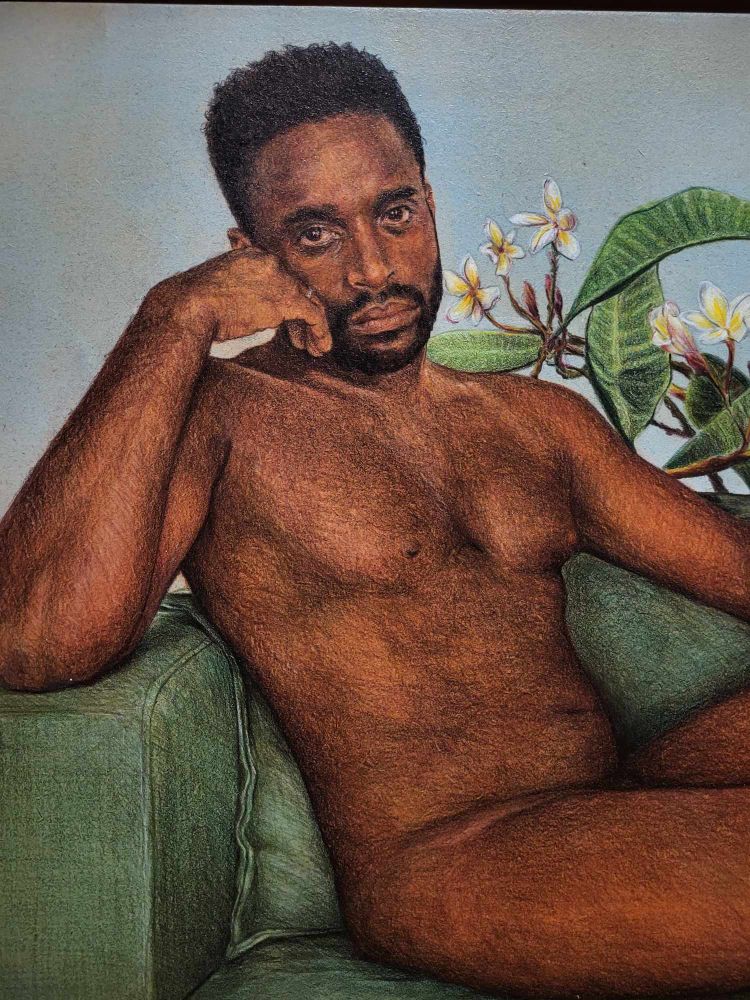
Exposer le queer : intimité ou voyeurisme?
Donner de la visibilité à la culture queer devient un réel engagement politique. Deux institutions muséales parisiennes ont relevé le défi d’aborder cette thématique dans le cadre d’expositions temporaires. Il est intéressant de les présenter en diptyque afin de prendre conscience d’une pluralité de récits et de partis pris.
“Ce qui se passe au lit dépend de ce qui se passe en politique”, Youssef Chahine
Depuis le 28 juin 2023 et jusqu’au 13 novembre 2023, le Centre Pompidou Paris présente l’exposition Over the Rainbow qui met en scène le récit LGBTQIA+ occidental. Mettre en écho cette exposition à Habibi : Les révolutions de l’amour, qui a eu lieu du 27 septembre 2022 au 19 mars 2023 au sein de l’Institut du Monde Arabe à Paris est inévitable. Les mettre en écho permet de se questionner sur les différents discours développés sur cette thématique tendance qu’est la culture queer.
L’intime politique
Over the Rainbow présente des œuvres occidentales (Europe et Amérique) sur différents supports (tableaux, livres, photographies, documents graphiques, vidéos, musiques…), rendant la visite variée et dynamique. Avant d’immerger le visiteur dans l’expérience muséale, une chronologie répertoriant les luttes militantes de la fin du XIXè siècle à nos jours est inscrite sur une cimaise extérieure à l’exposition. Plaçant le visiteur dans un cadre déterminé, ce dernier se dirige vers l’exposition où il y trouve un livret renfermant un lexique abordant des termes contemporains parlant de sexualité et de genre. Une entrée en la matière permettant d’appréhender facilement cette dimension sociale et politique. Les artistes s’attachent donc à dépeindre des visions différentes des sexualités en sortant du cadre hétéronormatif.
Prenant le parti-pris de réaliser une exposition chronologique et historicisante, des salons lesbiens du XIXè siècle aux luttes militantes activistes du XXIè siècle, cette dernière donne l’illusion d’une culture visuelle fixe et arrêtée, sans réelle mise en récit. Le Centre Pompidou ancre cette exposition temporaire dans une dimension particulièrement sociale, mais empêche, de manière regrettable, le jeune public d’y avoir accès dû aux représentations sexuelles de la première partie d’exposition. Cette dernière aurait pu être un lieu de sensibilisation et de prévention des jeunes afin de lutter contre l’homophobie ou la transphobie, la culture permettant d’ouvrir les mentalités sur la société actuelle comme les faits politiques et sociétaux. Cette mise en lumière de l’apport artistique des luttes menées par les communautés LGBTQIA+ devrait être accessible à tout public afin que chaque personne puisse apprendre, s’imprégner, ou se retrouver dans ces combats, et lutter face aux discriminations liées à l’orientation sexuelle et au genre.
Les questions de sexualité et de genre relèvent en premier lieu de l’intime. Mais ici, le visiteur ne le perçoit pas car il observe majoritairement des expôts illustrant des mouvements communautaires et non des moments d’entre-soi, des portraits intimistes, tel qu’à l’Institut du Monde Arabe. Effectivement, c’est en passant par le collectif que l’on arrive à mieux se faire entendre. Toutefois, Over the Rainbow semble vouloir être une exposition vendeuse de défendre des causes ou encore de légitimer par l’histoire la culture queer, mais qui n’est en réalité qu’une façade marketing et voyeuriste d’une suite d’œuvres, majoritairement masculinistes, se voulant pour certaines assez trash.
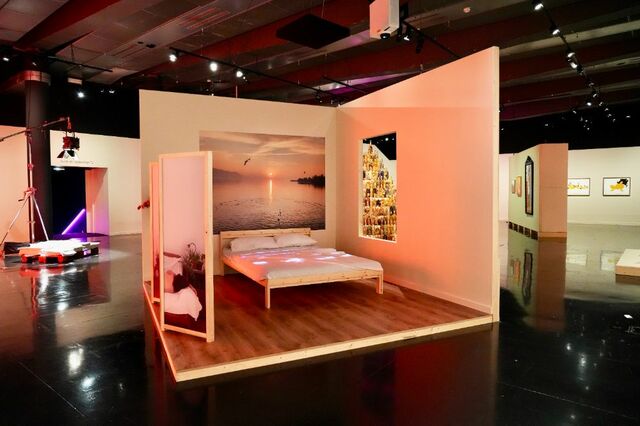
Scénographie de l’Institut du Monde Arabe pour l’exposition “Habibi : les révolutions de l’amour” © Benoît Gaboriaud

Scénographie du Centre Pompidou pour l’exposition “Over the Rainbow” © Janeth Rodriguez-Garcia
Des contenus explicites : sanction du discours ?
« En raison de leur caractère sexuellement explicite, les œuvres présentées dans cette exposition peuvent heurter la sensibilité du public. L’accès des mineur-e-s à l’exposition est déconseillé ». Voici comment débute l’exposition Over the Rainbow. Adaptation du parcours à ses désirs, le Centre Pompidou limite l’accès au moins de 18 ans concernant une exposition souhaitant aborder la représentation des personnes queer dans l’art ainsi que les luttes menées par les communautés LGBTQIA+ pour la reconnaissance de leurs droits. L’exposition de l’Institut du Monde Arabe développe également en début d’exposition un court disclaimer informant que certaines œuvres peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Au contraire d’Over the Rainbow, Habibi présente la nudité qu’au travers de peintures figuratives. Une question se pose alors : quel est l'intérêt de présenter ces luttes sous le prisme d’une sexualité omniprésente? Le sexe doit-il obligatoirement être un axe de lecture centrale ? Cette vision peut desservir le propos tenu et l’inscrire une nouvelle fois dans des stéréotypes forts et inconfortables. Pourquoi déconseiller l’accès aux mineur-e-s, qui restent alors enfermé-e-s dans des représentations biaisées des genres et des sexualités ?
Dans le cadre de cette exposition et en lien avec l’accessibilité, le Centre Pompidou prend comme parti d’utiliser le langage inclusif pour l’ensemble de ses textes de médiation. Belle initiative, mais pourquoi ne pas souhaiter offrir cette ouverture d’esprit à tout type de public, enfants et adolescents compris ?

Germaine Kroll, Nu féminin, Epreuve gélatino-argentique, 1928 ©Séléna Bouvard

Raymond Voinquel, Jean Marais, Négatif monochrome, 1938 ©Séléna Bouvard
Certaines œuvres peuvent sembler déconcertantes pour un jeune public telles que les photographies érotiques de Raymond Voinquel figurant le désir érotique homosexuel ou encore les photographies surréalistes, à la limite du pornographique, de Pierre Molinier. Il est également important de souligner que les représentations de femmes, minoritaires dans l’exposition, sont toujours très sexualisées. Toutefois, de nombreuses œuvres illustrant l’action des personnes LGBTQIA+ telles que les luttes militantes et les collectifs anti-sida sont présentes, mais arrivent tardivement dans l’exposition, lorsque le visiteur a déjà lu et vu beaucoup de contenu. Il se rend donc dans cette partie d’exposition fatigué, avec peut-être l’intention d’y passer moins de temps. Pour un voyage dans la culture visuelle LGBTQIA+, il aurait été plus judicieux d’intégrer dans le parcours muséographique, dans un premier temps, l’affirmation d’une action militante pleinement exercée dans l’espace public à la fin des années 60 comme les productions vidéo du Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire, ou encore les collectifs d’artistes antisida comme Boy / Girl with Arms Akimbo, et plus tardivement, dans les années 90, l’affirmation de la théorie queer.
“L’exposition qui rend visible l’invisible”
L’Institut du Monde Arabe a offert, fin 2022, une impressionnante exposition nommée Habibi, Les révolutions de l’amour qui nous plonge au coeur des multiples cultures queer du monde arabo-musulman. Les œuvres des 23 artistes exposés se croisent, se rencontrent, se mêlent et créent ainsi un discours extrêmement visuel et envoûtant. La muséographie de l’exposition met un point d’honneur à dévoiler des identités cachées, mises sous silence et réprimées dans le but de mettre en lumière une scène arabe LGBTQIA+ contemporaine plus qu’effervescente. C’est un premier point de différence avec l’exposition Over the rainbow qui retrace l’histoire des expressions et esthétiques queer occidentales mais qui ne réalise pas d’ouverture vers notre monde actuel.
Contrairement à ce que l’on peut ressentir au Centre Pompidou, les œuvres de l’exposition Habibi misent sur l’expression de l’intime, empreinte d’une poésie bien plus personnelle et incarnée. La série photographique de l’artiste soudanais Salih Basheer The home seekers présente le parcours d’Essam, homosexuel expulsé par sa famille soudainaise et contraint à s’exiler en Egypte. Se dévoile en noir et blanc ce destin déchiré, marqué par un manque d’appartenance, aussi bien du coeur que du sol. Un sentiment de double aliénation dicte alors la vie de ces réfugiés : comment vivre librement en étant queer ET étranger?

The Home Seekers (2018-2021) de Salih Basheer, présenté dans l’exposition “Habibi, les révolutions de l’amour” à l’Institut du Monde arabe, Paris, 2023 ©Giulia Guarino
“Habibi, les révolutions de l’amour” est l’occasion de mettre à nu les difficultés existentielles liées au genre. Le choix de montrer une diversité de médiums artistiques témoigne de ce besoin viscéral de s’exprimer autrement que par les mots. Au sein du monde arabo-musulman, où l’honneur social et l’attachement à la famille est primordial, la sphère privée se confond à la sphère publique et politique. Cette dynamique est toujours très actuelle, bien qu’elle se teinte d’un progressisme insufflé par de nombreux militant-e-s. Les individus souffrant de ce carcan lourd et désincarnant sont en proie à une sorte de dédoublement identitaire : choisir entre ce que l’on doit être et ce que l’on est réellement, choisir entre son identité sexuelle et sa culture. L’artiste arabo-américain Riddikuluz explore, par le biais du portrait, ce phénomène d’intersection identitaire. The Girl dresse le portrait de Sultana, une célèbre Drag Queen libanaise. Vautrée sur un divan, elle réalise sa routine de soin en appliquant de la crème Nivea. Le regard balaie le tableau et aperçoit un Keffieh, foulard traditionnel du Moyen Orient, caché sous un des coussins du canapé.

Riddikuluz, The Girl, 2021, Peinture à l’huile, 122 cm x 147 cm © Benoît Gaboriaud

Scénographie aux couleurs néons, présentation des catalogues à la fin du parcours ©Giulia Guarino
L’intimité, l’intériorité, le quotidien qui peut s’avérer douloureux, le questionnement vis à vis des différences, la liberté des corps : ce sont autant de territoires explorés par les artistes. Le parcours muséographique est réalisé de sorte à ce que le visiteur soit réellement immergé dans une atmosphère délirante, pop et colorée faite de néon, lumière bleu et autres dispositifs scénographiques intéressants.
L’engagement politique de ces artistes exposés, sublimé par cette esthétique tout à fait envoûtante et poétique, fait d’Habibi, les révolutions de l’amour une exposition d’utilité publique, donnant une visibilité nécessaire à ces militants de l’Amour. Jonglant entre liberté des corps et omniprésence politique tentaculaire et liberticide, ces artistes n’entendent pas devenir les fervents défenseurs de la cause LGBTQIA+. L’exposition Habibi s’apparente à une sorte de patchwork de vécus, de destins, de sensibilités, d’histoires personnelles, qui s'enchevêtrent et se nourrissent. Elle ne peut se résumer à un simple agglomérat d'œuvres engagées, contrairement à la vision type catalogue du Centre Pompidou. C’est en ce sens qu’Habibi contourne l’écueil d’un voyeurisme qui peut s’avérer stérile.
Mettre en écho ces deux expositions met en évidence les différents partis pris effectués sur une thématique complexe. Ce qui dessert le propos d’Over the Rainbow est de réaliser un parcours désincarné du présent qui soutient une pensée communautaire, un effet de masse, sans réellement mettre l’individu au centre du propos.
Séléna Bouvard & Giulia Guarino
Pour en savoir plus :
- Podcast (58 minutes) sur France Culture : Beyrouth, épicentre de la culture queer dans le monde arabe https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/affinites-culturelles/beyrouth-epicentre-de-la-culture-queer-dans-le-monde-arabe-3971478
- Podcast “Kiffe ta race” (48 minutes) Sexualité(s) et islam, à l'intersection des luttes
- Disponible sur Youtube https://youtu.be/ZrrrWvr2cm0?si=y1gKM_SXBWP68uIb
- Art et queer, l'émission "Un podcast, une oeuvre" du Centre Pompidou explore les liens entre art et queer à travers quatres oeuvres d’artistes de la collection du Musée national d'art moderne https://www.centrepompidou.fr/fr/podcasts/un-podcast-une-oeuvre/art-et-queer
#LGBTQIA+ #politique #queer

Exposer le train : spectacle et jeu d’échelle

Vue extérieure de la Cité du Train de Mulhouse © C.R.

Vue extérieure de Train World - Bruxelles © C.R.
Le train fait son cinéma
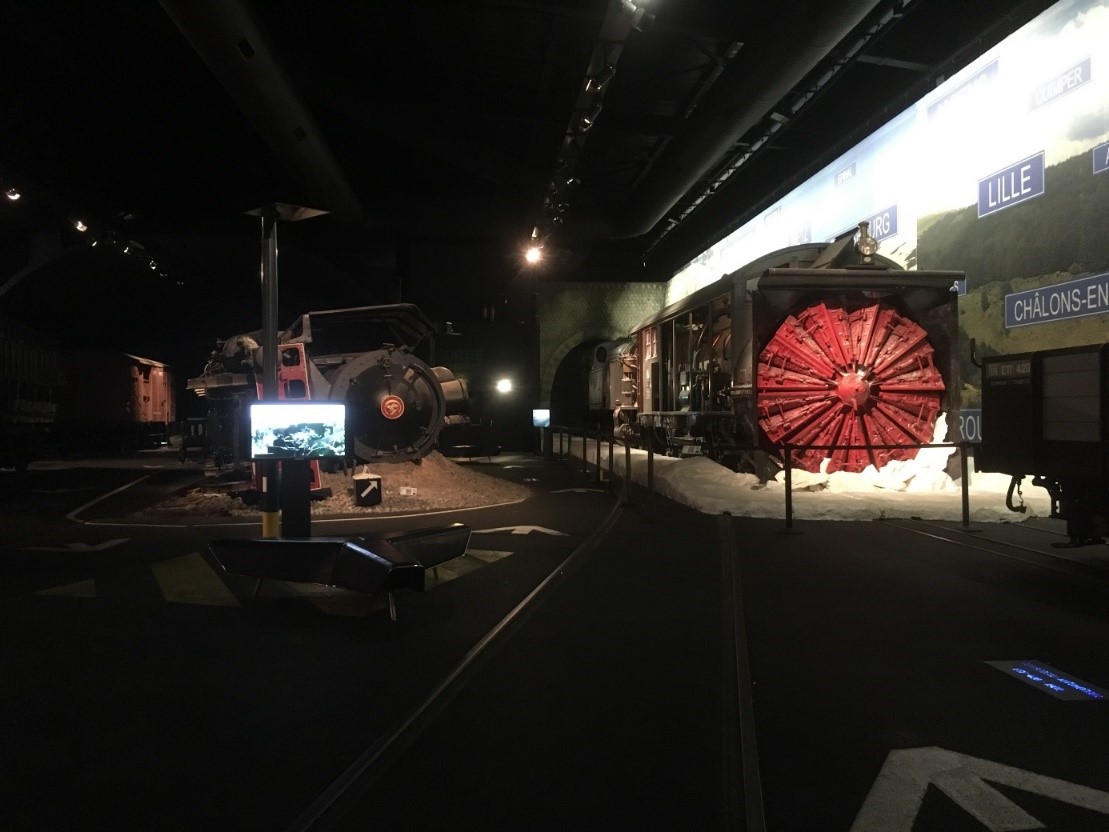
Cité du Train. Comme au cinéma, les locomotives sont mises en scène dans des décors © C.R.

Cité du Train. A gauche : vidéo d’archive insérée dans le wagon évoquant les départs en vacances de l’été 1936. A droite : téléviseur monté dans une motrice de métro Sprague © C.R.

Train World. Scénographie blockbuster pour raconter la grande épopée du Train. © C.R.

Train World. Le couloir d’horloge menant au « grenier ferroviaire » © C.R.
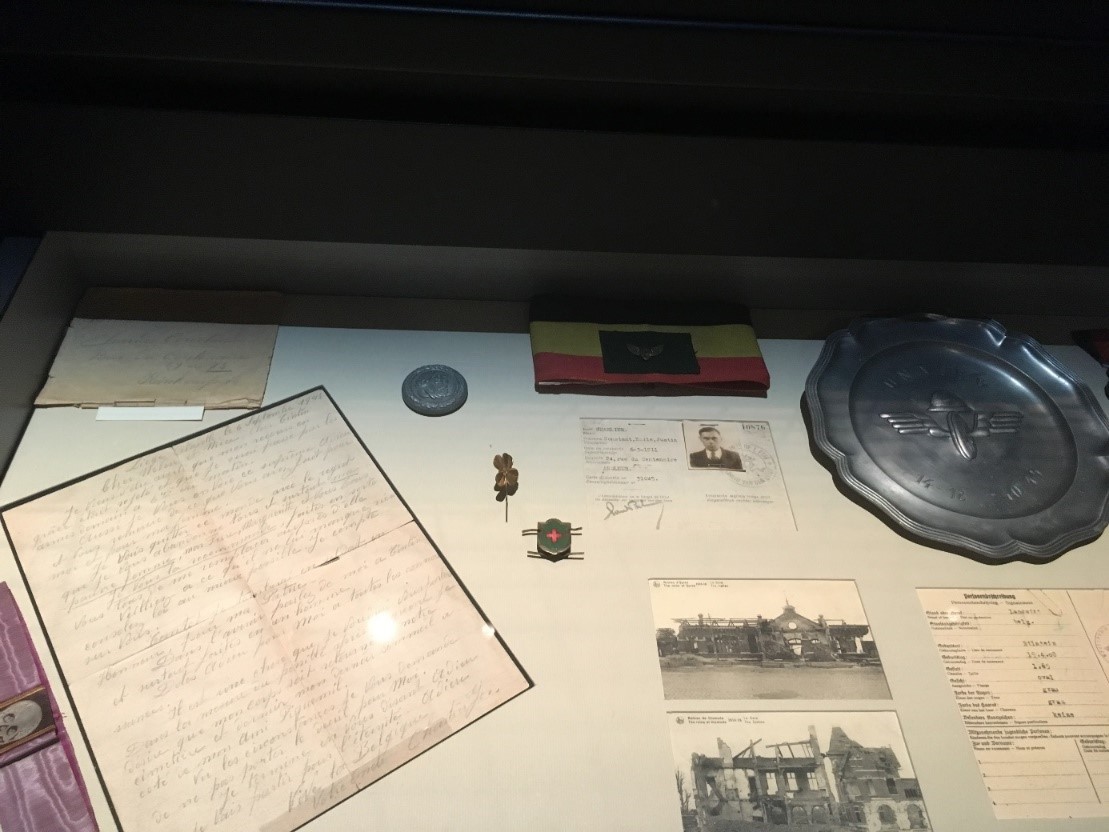
Train World. Dans les tiroirs du grenier, des souvenirs de la résistance cheminote © C.R.
Le train en miniature, plus vrai que nature ?
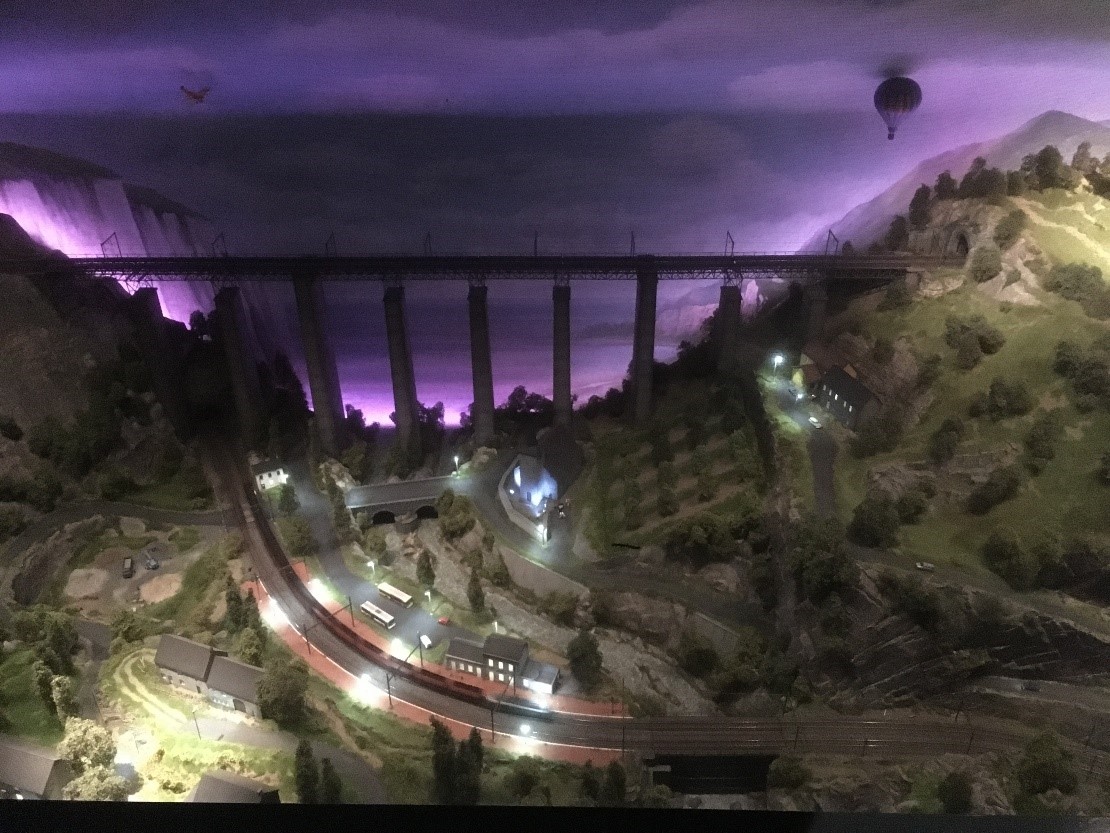
Train World. Maquette dont l’éclairage varie. Aube ou crépuscule ? © C.R.

Train World. Au premier plan : maquette de l’Eurostar en LEGO. Arrière-plan, modèles-réduits de wagons et de locomotives. © C.R.

Exposition Amazonie : l’immersif au service de l’engagement
Amazonie, le chamane et la pensée de la forêt
L’exposition présentée au Château des Ducs de Bretagne de Nantes offre au public une partie de collections inédites. Le Musée d’ethnographie de Genève conserve l’une des plus importantes collections amazoniennes d’Europe. Il s’associe au Château des Ducs, parmi d’autres musées, pour cette exposition itinérante en constante évolution.
Structurée en deux parties, l’exposition propose une première approche factuelle des travaux européens, et tout particulièrement suisses, menés sur le sujet de l’Amazonie et des peuples amazoniens.
Des parures, des armes, des instruments de musique et des objets usuels illustrent les présentations avec une quinzaine de populations, parmi lesquelles les Wayana, les Yanomami, les Kayapó ou encore les Shuar. Expressions de la symbiose avec le monde de la forêt et des esprits, ces témoins de la culture matérielle permettent d’aborder la pratique du chamanisme, commune à toutes les populations du bassin amazonien.
Le parcours de l’exposition
Certainement par une contrainte d’espace, l’exposition se situe sur deux étages. Cette contrainte est cependant tournée à l’avantage du musée qui sait parfaitement utiliser son espace afin de servir son propos.
L’introduction et la première partie de l’exposition se font ainsi sur tout le rez-de-chaussée. La visite débute avec l’histoire précolombienne de l’Amazonie, des origines à la conquête, ainsi qu’à celle des collections qui lui font écho, jusqu’à l’époque actuelle. Les témoignages des populations amazoniennes permettent d’aborder les questions de leur sauvegarde et de la disparition de la forêt. Cette section permet de contextualiser les découvertes, mais également d’aborder, de manière factuelle, certaines des nombreuses civilisations présentes sur ces territoires.

Xabono © Château des Ducs de Bretagne
Dès cette première salle, la lumière est tamisée. Le public est prévenu : cette faible luminosité est dans un but de conservation préventive, dû à la sensibilité des costumes traditionnels souvent confectionnés de plumages. Le public est ensuite invité à entrer dans un Xabono, construction en bois (photographie ci-dessus) érigée à la lisière de la forêt. Seules quelques parures sont présentées : ce qui interpelle dès l’entrée, ce sont ces nombreuses photos de scènes de vie quotidienne de la fin du XXe siècle aux années 2010, témoins de mode de vie en constante évolution dû à l’occidentalisation des villes environnantes. Une tablette et deux écouteurs sont mis à disposition pour regarder et écouter des témoignages d’acteurs autochtones, qu’ils et elles soient leaders de communauté ou étudiant.e.s.

Intérieur du Xabono © David Gallard_LVAN
Un bémol : les textes des salles sont inondés de vocabulaire complexe. Du mot « paupérisation » à « inéluctablement », le vocabulaire emprunté est loin d’être accessible à un public large, alors que les médias locaux annoncent une exposition familiale aux nombreuses activités pour enfants.
Avant d’emprunter les escaliers pour passer à la suite, un fond (à l’image de la communication de l’exposition et des panneaux portant des slogans écologistes) nous invite à prendre une photo afin de la poster sur les réseaux avec un hashtag précisé. Ce dispositif, très certainement pensé pour la fin de la visite, comme espace de conclusion au parcours forçant les visiteur.e.s à revenir sur leurs pas (obligation dûe à l’architecture du bâtiment), il peut être également envisagé comme une pause à la fois ludique et responsabilisante, avant d’entrer dans le vif du sujet.
Une fois les escaliers montés, le public est tout de suite plongé dans une atmosphère immersive. Guidé.e.s par une lumière encore plus tamisée, les visiteur.e.s déambulent aux rythmes des instruments des chamanes. Un jeu multimédia permet de faire directement connaissance avec ces instruments méconnus voire inconnus en occident, pour ensuite procéder au reste de la visite en reconnaissant les sons et les voix.
Les peuples amazoniens sont présentés, localisés, rappelés à l’aide d’une carte sous chaque cartel. La déambulation continue son cours, sous les couleurs vives et attirantes des costumes et des objets, quand soudain…

Exposition Amazonie. Le Chamane et la Pensée de la forêt © David Gallard_LVAN
La douce musique berçante jusqu’ici est interrompue par un bruit. Bruit terrible, haut volume : on reconnaît très nettement le bruit d’une tronçonneuse. Désagréable, il dure une dizaine de secondes, jusqu’à ce qu’on entende la chute d’un arbre… Puis, silence… Les bruits de la forêts reprennent, ainsi que les chants et musiques des chamanes.
L’immersif au service de l’engagement
Cette intervention sonore est bien plus prenante qu’on ne pourrait l’imaginer. Le son stoppe la visite, les conversations, ou au contraire la voix monte car on ne s’entend plus.
Le son de l’arbre qui tombe et le silence qui le suit deviennent subitement très lourds de sens. Personne n’est aujourd’hui sans savoir ou avoir du moins une idée vague de la situation catastrophique de l’Amazonie. Qu’il s’agisse des incendies récents produits cet été, de sa surexploitation par les nord-américains et les occidentaux depuis ces trente dernières années, mais également de l’écosystème complet remis en question au nom du « progrès », ce simple bruit de tronçonneuse presque assourdissant en vaut mille mots d’explications. Une volonté de sensibiliser, indispensable aujourd’hui.
À la fin du parcours, le Château des Ducs va plus loin : il propose à ces visiteur.e.s de devenir acteurs et actrices du changement.
Pour le peuple Ashaninka, vivant au Pérou et au Brésil, les puits sont à sec pendant la saison sèche. Et boire l’eau de la rivière, polluée par l’exploitation minière, est dangereux. L’association genevoise Aquaverde a été associée à cette exposition pour lancer un appel aux dons afin de financer des « safe water cube », fontaines qui permettent de filtrer 1 000 litres d’eau par heure. Pendant les six mois de l’exposition Amazonie, l’équipe du musée et Aquaverde espèrent récolter les 5 500 € nécessaires à l’achat, l’installation et la formation à l’utilisation d’une de ces fontaines.
« Nous voulons que cette exposition soit utile : on veut donc offrir la possibilité aux visiteurs de devenir acteurs en faisant un don pour financer ces fontaines », explique Krystel Gualdé, directrice scientifique du musée.
Julia Parisel
#Immersionsonore
#scénographie
#urgenceécologie

Fabuleux Maintenon
Dans le froid, un poème
Quand vient l’hiver
Et que tente le château
De revêtir son pull-over
Par des foyers bien chauds,
Un évènement se prépare,
Dame Maintenon à l’honneur
L’attention elle accapare,
Pour Noël à ses heures.
Quelques mois durant,
Petites fées des coulisses
N’ont pas assez de leur temps
Pour rendre les lieux complices.
Au rythme de la cadence
Lundi, mardi, mercredi,
S’organise la danse
Des mouvements d’objets pardi !
Identification
Plan d’organisation,
Répartition
Opération.
Même jour autre musique
Pour les acteurs fabuleux,
Jouer pour rendre féérique
L’histoire des lieux.
Successeurs de logis
Du 13e à nos jours,
Ainsi conte le récit
Tour après tour.
Repérer les salles,
Définir les actes,
Quelles œuvres idéales
Ou quels artefacts ?
Identification
Puis scénarisation,
Organisation
Enfin démonstration.
Marquises costumées
Se pavanent sous les chants
Devant un public fasciné
Par les salons chatoyants.
L’amour se dévoile
A travers les portes secrètes,
Entre tissus et voiles
S’amusent les interprètes.
Et pour ainsi
Saisir les intéressé.es,
Il faut toutefois aussi
Déplacer les objets.
Pots, lampes et fauteuils,
Ne doivent pas perdre la tête
Et pour cet accueil
Tous aux cachettes !
Objets chamboulés
Pour spectacle annuel,
Tout est presque prêt
Pour le Fabuleux Noël.
Brumes dans les jardins,
Lueurs sur le chemin,
Le château embellit
Rend toute sa magie.

Cour avant du Château de Maintenon pendant le Fabuleux Noël ©CL
La frénésie de Noel
Chaque année au Château de Maintenon, un remue-ménage effréné fait vivre les lieux. Sur plusieurs week-ends de novembre et décembre, le spectacle du Fabuleux Noël conte l’histoire du château et celle de ses hôtes. Il est produit par la société de production événementielle Polaris. Pour accueillir acteurs et techniciens bénévoles ainsi que tous les visiteurs attendus, les espaces du château sont vidés puis décorés par du mobilier scénographique. Meubles, tableaux et objets décoratifs sont déplacés, que ce soit pour la sécurité des personnes et des œuvres, ou pour correspondre au scénario du spectacle. Gérées par le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, les collections sont minutieusement stockées en attendant Noël.
Une belle occasion de découvrir le château par son histoire sous un ciel duveteux puis le redécouvrir pour ses salles et leurs mobiliers au petit printemps…

Grande galerie du Château de Maintenon pendant le Fabuleux Noël ©CL
Pour en savoir plus :
www.chateaudemaintenon.fr
L.L
#Déménagementcollections
#ChâteaudeMaintenon
#FabuleuxNoël

Fortuny, un Espagnol à Venise ?
Du 4 octobre 2017 au 7 janvier 2018, se tient l'exposition Fortuny, un espagnol à Venise au Musée de la mode de la ville de Paris dans le palais Galliera.
© Brenda Seck
Du 4 octobre 2017 au 7 janvier 2018, se tient l'exposition Fortuny, un espagnol à Venise au Musée de la mode de la ville de Paris dans le palais Galliera. Elle clôt un cycle sur l'Espagne dont font aussi partie les expositions Balenciaga, l'oeuvre au noir et Costumes espagnols, entre ombre et lumière.
Mariano Fortuny (1871-1949) est qualifié de « magicien », et pour cause, il est à la fois photographe, peintre, graveur, collectionneur, scénographe pour le théâtre et inventeur de techniques utiles à son travail de couturier. Sur ce dernier point, une part de mystère flotte car on ne sait toujours pas reproduire les plissés de la robe Delphos, par exemple, à qui Fortuny SRL rend hommage dans la robe rose (voir photo).
Le titre de l'exposition, Fortuny, un espagnol à Venise et le cycle sur l'Espagne lancé par le musée laissent-ils à penser que je vais apprendre comment vivait Fortuny en Espagne ? Est-ce qu'on va me donner à voir son voyage, son déplacement jusqu'à Venise, en passant par Paris et son contact avec la ville et ses habitants ? Je me doute que cette exposition est plus ambitieuse : le site internet du Musée la présente plutôt comme une rétrospective.
Fortuny à Venise
Dans la première pièce, une présentation générale de Mariano Fortuny nous montre son lien de sang avec la peinture, ses travaux en scénographie et en gravure qui expliquent son attrait pour la lumière. Sont également exposés ici, sa collection de peintures et de tissus anciens, venus de Byzance notamment, ainsi que son lieu de vie par le biais de photographies. L'une d'elle en particulier représente l'intérieur du Palais Orfei-Pesaro, à Venise où l'artiste s'établit. Des tissus lourds à gros motifs sont aux murs, sur lesquelles sont disposés des tableaux, des objets de collections et des meubles viennent parfaire ce décor pompeux, d'influence orientale.
Je perçois comment la scénographie reprend cette atmosphère : des photographies et même des tenues, disposées à la verticale à la manière de tableaux, sont accrochés sur des murs bleus imitant ça et là des tissus orientaux. La scénographie permet ici de contextualiser, de donner l'esprit d'un lieu et de la personne qui a vécu à l'intérieur. Dans la partie suivante, dédiée à l'influence de la Grèce, les robes semblent d'ailleurs être dans des armoires vitrées. Enfin, un somptueux canapé au bout de la pièce attend le visiteur qui peut vivre une immersion chez Fortuny, en écoutant un peu de musique classique diffusée dans les casques. Cette contextualisation bienvenue n’était guère annoncée par la sobriété de l'affiche qui, mettait en valeur le côté atemporel des robes de Fortuny.

© Brenda Seck
Des tenues sacralisées
La tendance, ces dernières années, est d'exposer les tenues sans vitre. Cette technique, risquée pour la conservation de la plupart des pièces, a cependant l'avantage d'être plus proche du public. Ici, ce n'est pas le parti-pris choisi bien que les principes d'exposition des vêtements soit très divers (mannequiné, plié, sur cintre, à plat à l'horizontale ou à la verticale comme on l'a vu plus haut) et on a cherché, au contraire, pour les pièces majeures de Fortuny, à les sacraliser. Elles sont alors sur un haut piédestal. Cela présente l'avantage que n'ont pas toutes les expositions présentant des costumes, d'avoir des cartels à hauteur des yeux ce qui évite de se baisser.
Ce point de vue en contre-plongée permet également de mieux comprendre l'importance de la lumière dans le travail de Fortuny. Les différentes matières, influences byzantines, plis et impressions à base de poudres métalliques sur velours sont ainsi mis en valeur mais que de reflets dans les vitres ! Le site de Galliera parle « d'atmosphère miroitante » et, après avoir essayé de prendre des photos dans tous les angles de vue, je comprends tout à fait l'idée.

© Brenda Seck
Une rétrospective ?
Le génie technique de Fortuny est donc bien mis en valeur, le côté atemporel des robes aussi avec des photos et des vidéos montrant la célèbre robe Delphos crée en 1909 et portée jusque dans les années 1960, sans compter les hommages faits par les grands couturiers de nos jours. Le voyage est évoqué par les influences de Fortuny (Grèce classique, Renaissance, Orient) et sa renommée, notamment auprès de grandes clientes parisiennes comme la comtesse Greffülhe.
« (…) on dit qu'un artiste de Venise, Fortuny, a retrouvé le secret de (la fabrication des étoffes merveilleuses de Venise) et qu'avant quelques années les femmes pourront se promener, et surtout rester chez elles dans des brocarts aussi magnifiques que ceux que Venise ornait, pour ses patriciennes, avec des dessins d'Orient. »
Propos de Elstir, dans À l'ombre des jeunes filles en fleur, Marcel Proust
L'Espagne n'est pas du tout mise à l'honneur, à part dans le titre de l'exposition. Les origines de Fortuny sont un prétexte pour le faire entrer dans la programmation du palais. Soit, mais pourquoi l'avoir mis dans le titre ? L'exposition montre les occupations et les travaux de Fortuny, ainsi que là où il vivait, mais sa personnalité n'est, finalement, pas vraiment mise en avant et l’exposition n’évite pas quelques digressions sur la tendance générale à l'antique du début du XXème siècle et tout une pièce consacrée à Babani, un couturier avec qui l'atelier de Fortuny a collaboré, comme il l'a fait pour Paul Poiret.
Malgré ces quelques points, j'ai passé un bon moment dans l'exposition. Les costumes sublimés et l'atmosphère très esthétique m'ont permis d'être immergée dans le monde de Fortuny. Les principaux enjeux de son atelier ont été assimilés avec plaisir.
Louison Roussel
#ExpoFortuny
#palaisgalliera
Pour en savoir plus :
http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/expositions/fortuny-un-espagnol-venise
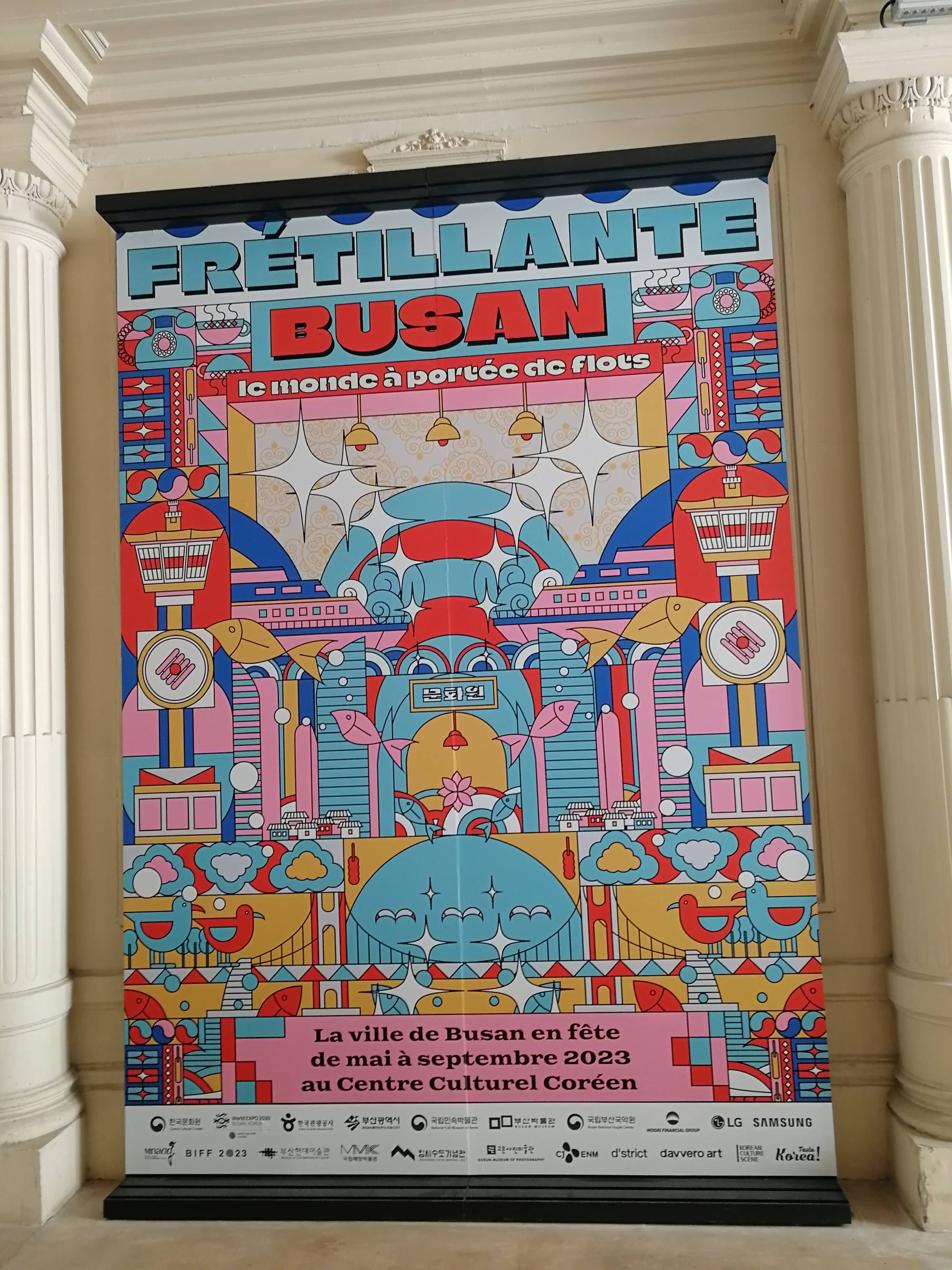
Frétillante Busan, le monde à portée de flots au Centre Culturel Coréen de Paris
Comment mettre en lumière Busan, candidate à l’Exposition Universelle de 2030 ?
En 2021, la Corée du Sud a inscrit la ville de Busan comme candidate à l’Exposition Universelle de 2030 auprès du Bureau International des Expositions. Depuis, dans cette optique, de nombreuses actions sont menées par le gouvernement sud-coréen pour promouvoir la ville de Busan par-delà les frontières.
Busan est une ville au sud-est de la péninsule ; elle abrite un port international d’importance. Le choix de cette ville est essentiel et souligne l’ouverture du pays vers l’extérieur : un choix politique, économique et culturel. Sa situation géographique est essentielle face à la mer, élément que le visiteur peut observer dès son arrivée.
De mai à septembre 2023, le Centre Culturel Coréen de Paris a relevé un challenge : mettre en lumière et présenter Busan dans le cadre d’une exposition temporaire.
La technologie au cœur du parcours de visite
La construction du parcours de visite prouve au visiteur que la Corée est une puissance moderne et innovante. Busan nous est présentée comme une ville entre tradition et modernité grâce à de nombreux dispositifs numériques disposés dans les espaces d’exposition et particulièrement au rez-de-chaussée.

Vue de l’exposition ©CM
Un paravent dans sa symbolique est un écran ou un passage entre les différentes temporalités et les espaces.
Un « paravent digital » est l’un des premiers éléments qui accueille le visiteur. Le paravent permet à la fois de dissimuler la suite de la visite et en même temps de donner envie d’aller plus avant et de le contourner, pour partir à la découverte de l’exposition, de Busan et de la Corée. La scénographie s’inspire de l’habitat traditionnel coréen en reprenant un élément de mobilier incontournable de la vie quotidienne, comme j’ai pu en admirer au Musée Guimet dans la collection coréenne.
Cet élément du mobilier coréen est constitué de cinq écrans ou cinq tableaux virtuels animés, fruit du travail de l’artiste Kim Jaewook. Ce dernier a brossé un portrait moderne de Busan et de ses principaux monuments de manière atemporelle. Le visiteur est invité à s’asseoir pour prendre le temps d’admirer ces paysages digitaux. Il peut y découvrir l’identité bien spécifique de la ville, une géante composée de plus de 3 millions d’habitants. Constituée de 15 arrondissements, elle était, pendant un moment, considérée comme la capitale de la Corée.
L’art au centre de l’exposition
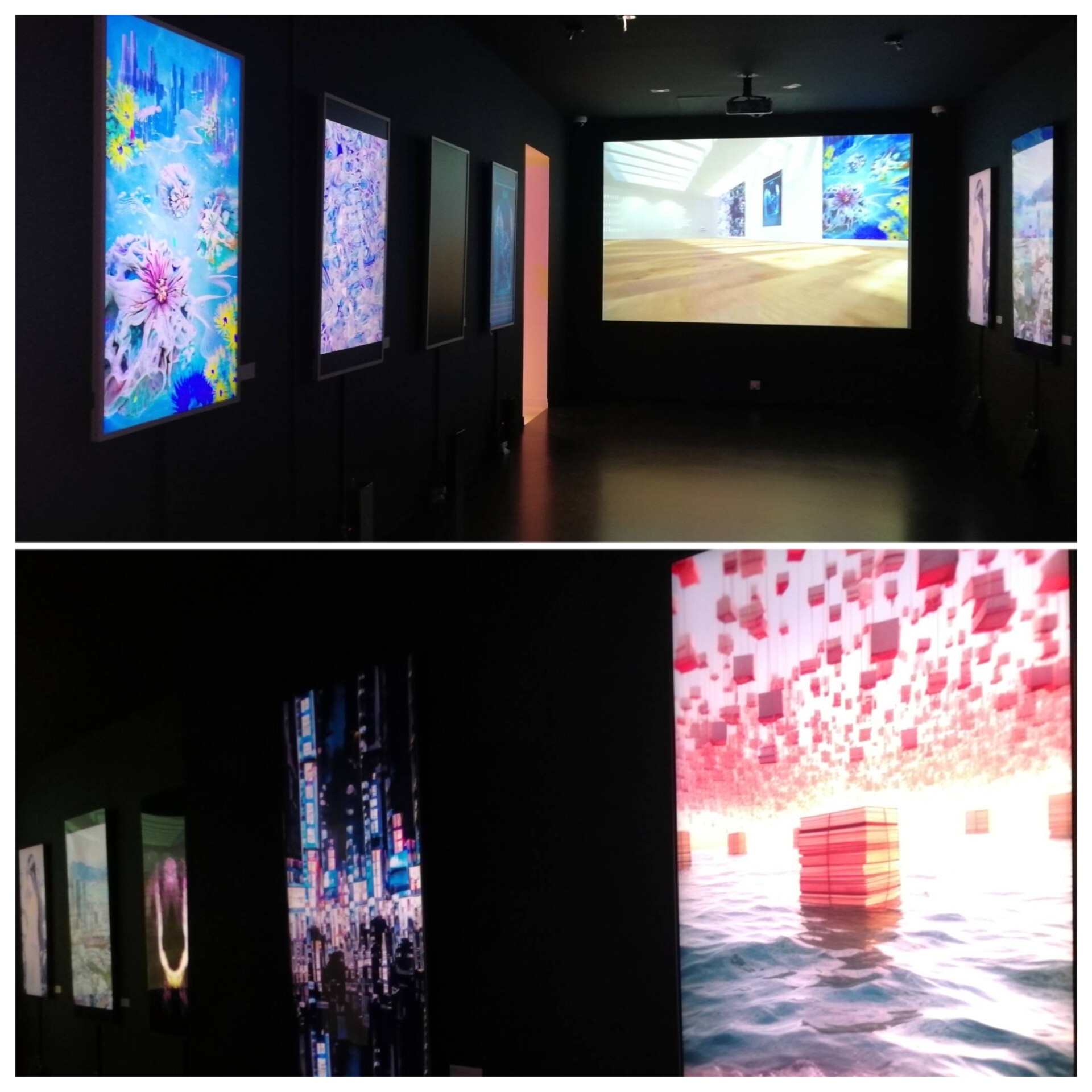
Vues de la salle « Busan à l’heure de l’intelligence artificielle » ©CM
Le paravent, une fois contourné, ouvre alors une perspective sur un second espace dédié au monde virtuel dans la salle d’exposition suivante. Ce sont cette fois des NFT « Non Fungible Tokens » qui investissent la salle. Les œuvres digitales de huit artistes sont accrochées sur les murs, toutes inspirées par des ambiances de la ville de Busan. L’écran du fond est différent car il représente une véritable mise en abime de la salle.
Les artistes coréens, américains et français, sollicités par le Centre Culturel Coréen Agoria, Booyasan, Bosul Kim, CSLIM, Ivona Tau, JuneK, HyeGyung Kim et Sasha Stiles proposent des compositions artistiques numériques.
Pour poursuivre le parcours, le visiteur traverse une « AR Photozone » une zone conçue pour être filmée grâce à la réalité augmentée. Ce dispositif permet au visiteur de voyager en Corée virtuellement et d’immortaliser ce moment en publiant les images capturées sur les différents réseaux sociaux avec les hashtags appropriés.
Ces espaces du rez-de-chaussée, restent placés sous le signe du numérique et démontrent que la Corée est un pays à la pointe de la technologie. La revendication est très nettement marquée et cela transparaît dans la muséographie choisie. Le visiteur découvre une exposition « culturelle et mémorielle ».
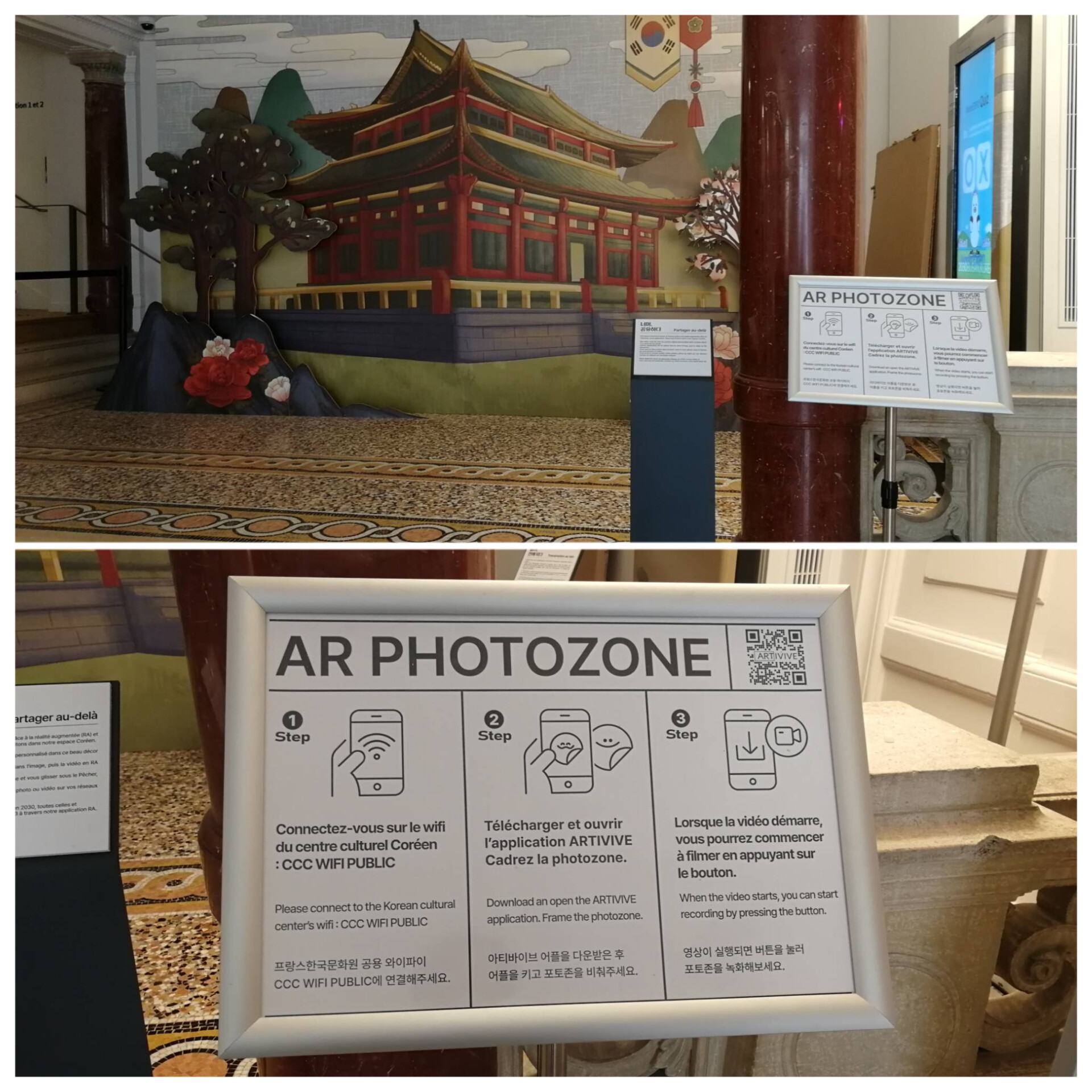
Vues de l’AR Zone (zone en réalité augmentée) ©CM
Une immersion dans la Corée des années 50 grâce à la reconstitution
Le Centre Culturel Coréen a également opté pour le parti pris de la reconstitution afin d’immerger le visiteur dans la Corée d’autrefois. De nombreux objets ont été collectés par l’équipe pour recréer des espaces aux ambiances uniques bien loin de la Corée d’aujourd’hui incarnée par la K-pop. Au rez-de-chaussée, c’est un café/salon de thé qui a été reconstitué à l’identique. Vinyles, vieux livres et magazines d’époque ont été rassemblés dans cet espace pour recréer l’ambiance du lieu. Certains professionnels de l’équipe ont contribué à cette collecte d’objets anciens en y ajoutant leurs effets personnels : le collectif est au service du pays, de la nation. Ce café a même été ouvert une dizaine de jours pour faire découvrir les saveurs de Busan.

Vue de l’exposition ©CM
A l’étage, le visiteur peut entrer dans le célèbre café « Mildawon ». Ce café est caractéristique de l’époque de la Guerre de Corée, période tragique de l’histoire marquée par un exode important de réfugiés vers la ville portuaire de Busan. Dans cette deuxième plus grande ville de Corée s’est alors développée toute une vie artistique et culturelle et notamment grâce à ces cafés/salons de thé. Au cours de cette période sombre de l’histoire, ces lieux ont permis à la population de se réunir et de s’adonner à des activités artistiques et créatives, d’où l’importance de reconstituer ces endroits symboliques où le visiteur va pouvoir déambuler comme s’il se trouvait un peu chez lui grâce aux objets présentés dans un lieu familier, un salon.

Vues de l’exposition © CM
Une mise en exergue des traditions et de la vie quotidienne : une exposition sociale

Vues de l’exposition © CM
Au sein de l’exposition, les vitrines et les cartels sont mis en parallèle avec des photographies d’archives, des écrans, des images projetées qui représentent la réalité des conditions de vie des Coréens : dans les usines, la réparation des bateaux au port par les femmes. Les objets visibles dans les vitrines sont mis en lien avec leur fonction et surtout leur lieu de fabrication.

Vues de l’exposition © CM
Frétillante Busan est une exposition à la présentation dynamique. Les panneaux qui abordent l’art culinaire coréen sont introduits aux visiteurs de manière originale : les bols, les récipients, les coupelles sont accrochées en relief, les plateaux de table sont quant à eux fixés à la verticale. Cela donne aux visiteurs une perspective déroutante.
La thématique de l’alimentation et des ressources halieutiques est mise en valeur avec des dispositifs avec des témoignages de travailleurs projetés sur écrans. La scénographie permet de rendre vivants les objets disposés et les coquillages dans les récipients, à travers les reportages proposés sur les écrans.
Une exposition caractéristique du Soft-Power coréen
La Corée du Sud connaît aujourd’hui une popularité accrue notamment grâce au phénomène hallyu ou vague coréenne et grâce à l’industrie de la K-pop. La péninsule est connue internationalement à travers le monde dans d’autres domaines tels que le cinéma ou encore la gastronomie. « Portée par les succès industriels de Samsung, LG ou Hyundai à partir des années 1990, la Corée du Sud a rejoint les « dragons asiatiques » et gravi les échelons du capitalisme mondial. En cinquante ans, ce territoire considéré comme l’un des pays les plus pauvres du globe est passé au rang de onzième puissance économique mondiale, balayant la planète de son irrésistible soft power. »(Le Nouvel Observateur, 2019)
Les actions menées pour promouvoir Busan dans le cadre de sa candidature à l’Exposition Universelle de 2030 offrent l’opportunité à la Corée de rayonner encore davantage et de diffuser un certain Soft-Power par le biais d’expositions comme Frétillante Busan, le monde à portée de flot. Le pays du matin clair veut montrer au monde qu’il est devenu une puissance mondiale à la suite du miracle économique. « En 1910, quand l’Empire colonial japonais annexe la Corée, c’est à Busan qu’il amarre et débute sa conquête. Captive pendant trente-cinq ans, la ville se modernise malgré elle. Jusqu’à l’indépendance, en 1945, ses habitants sont privés du droit de parler leur langue et sont forcés d’abandonner leurs noms au profit de patronymes nippons. Les industriels d’Osaka ont même essayé de leur interdire de porter du blanc – la couleur traditionnelle des vêtements – pour écouler un stock embarrassant d’étoffes colorées. »(Le Nouvel Observateur, 2019)
La Corée souhaite également partager des nouvelles valeurs modernes écologiques, se placer en avant-garde, en prônant une exposition qui se veut moins polluante, tout en alliant adroitement les nouvelles technologies.

Vues de l’exposition © CM
Loin d’être une exposition figée sur le passé ou centrée sur la modernité, l’objectif muséal ici est de mettre en exergue la force, la volonté et le dynamisme d’un petit pays incarné par la ville de Busan, qui a su tirer les enseignements du passé pour se tourner vers l’avenir même si, à travers l’agencement de certaines salles l’exposition reste encore traditionnelle. Le visiteur reste également encore un peu passif et n’interagit pas toujours par le biais de dispositifs multimédias.
Pour autant, cette Corée au puissant Soft-Power ne renie pas son passé et fait écho dès le début du parcours à sa présence à l’Exposition Universelle de Paris en 1900 avec son pavillon coréen qui permit pour la première fois de faire connaître la péninsule coréenne au public français. L’ouvrage Li Chinécrit par l’auteure Shin Kyung-Sook développe plus avant le début des relations franco-coréennes et revient sur la vie du premier diplomate français en Corée : Victor Collin de Plancy.
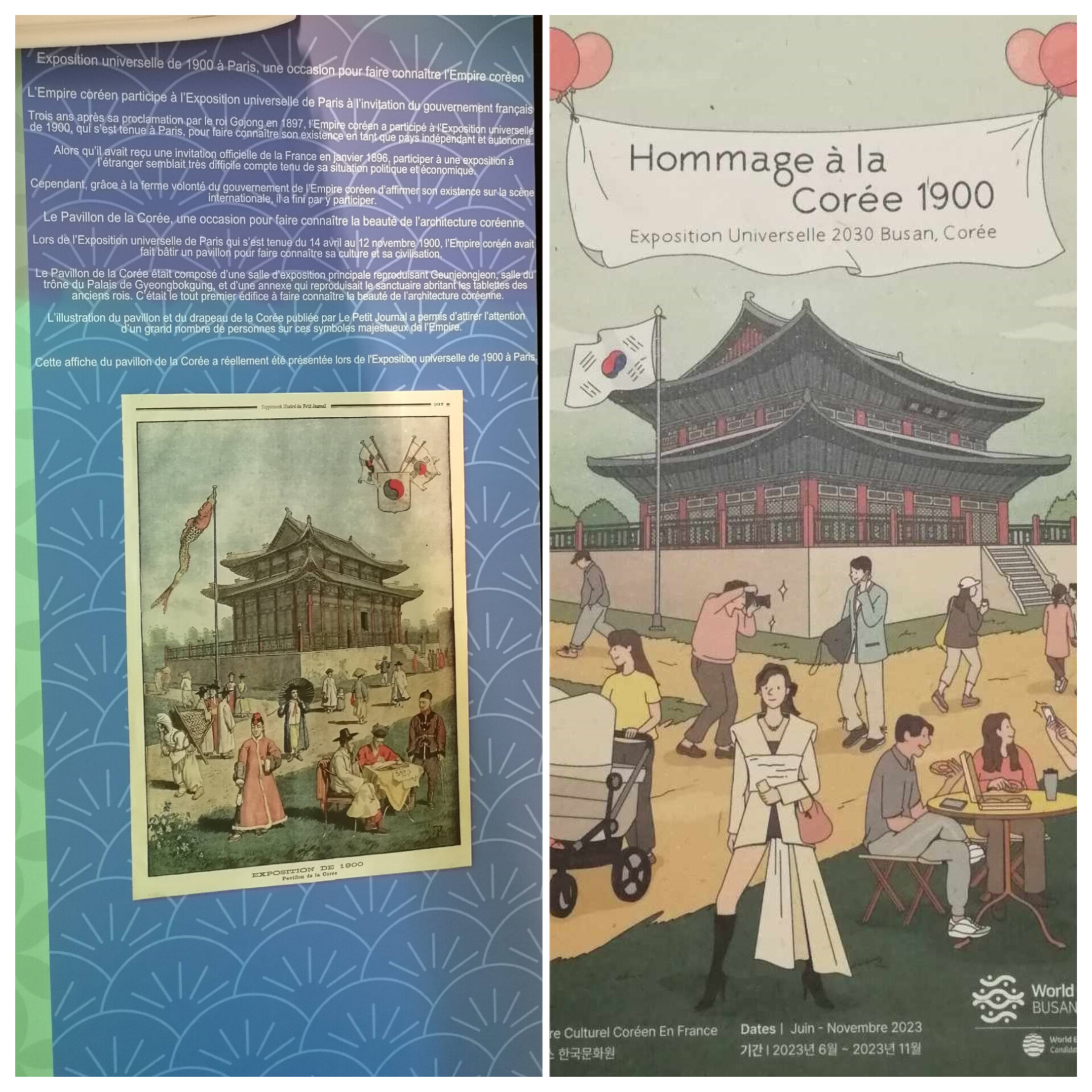
Affiche originale du pavillon de la Corée en 1900 et nouvelle affiche « Hommage à la Corée 1900 » ©CM
Millie CHIRON
Pour en savoir plus :
-
https://www.coree-culture.org/modification-de-date-fretillante,5591
-
https://french.korea.net/NewsFocus/Culture/view?articleId=233223
-
https://www.nouvelobs.com/voyage/20191029.OBS20416/a-la-decouverte-de-busan-l-enigme-sud-coreenne.html
-
https://flickr.com/photos/dalbera/48576138417/in/album-72157625713760989/
-
Shin, Kyong-Suk (2010). Li Chin. Editions Philippe Picquier, 576pp (Picquier Poche).
-
Min Jin Lee (2022). Pachinko. Editions Harpercollins, 640pp (Poche).
#worldexpo2030 #Busan #Corée
Harriet Baker (1845 - 1932) : une artiste qui peint les femmes
Pour sa dernière exposition temporaire, le Musée d’Orsay nous dévoile, pour la première fois en France, une rétrospective de l’artiste peintre suédoise Harriet Backer. Cette exposition, qui retrace le parcours de l’artiste, met en lumière sa sensibilité et ses engagements de femme, dès la fin du XIXème siècle. Ce voyage singulier, musical et sensible, était visible du 24 septembre 2024 au 12 janvier 2025.
Fig 1 : Entrée de l’exposition « Harriet Backer (1845-1932) : La musique des couleurs », Etablissement Public du Musée d’Orsay, Paris, 2024 - ©CT
Cette exposition initiée par le National Museum, Oslo et le Kode Bergen Art Museum, est organisée en collaboration avec le Nationalmuseum, Stockholm et le Musée d’Orsay, Paris. Elle permet au visiteur de découvrir l’œuvre de l’artiste grâce à cinq salles thématiques, animées au rythme de morceaux de musique joués par la sœur de l’artiste, de formes arrondies et de couleurs douces.
Une femme en avance sur son temps
Harriet Backer, née à Holmestrand en Norvège en 1845, est une artiste peintre déjà reconnue de son vivant dans son pays. Elle étudie la peinture dans de nombreuses villes européennes telles que Oslo, Munich, Berlin ou encore Paris et devient une figure majeure de la scène artistique norvégienne de son temps, aux traits singuliers et reconnaissables. Elle délaisse peu à peu les techniques dites « classiques » pour se rapprocher des influences impressionnistes. Cette évolution est d’ailleurs visible dans le parcours d’exposition puisqu’il regroupe aussi bien ses premiers tableaux que ses créations plus tardives.
Au cours de sa vie, Harriet Backer s’entoure de nombreuses femmes ; enseignantes, écrivaines, artistes - dont Kitty Kielland, Raga Nielsenn ou encore sa sœur, Agathe Backer Grøndahl, musicienne, dont elle est proche et souvent présente dans son œuvre. Ces femmes deviennent ses amies, des modèles qu’elle peint et dont elle s’inspire également. Une des salles de l’exposition met en lumière ces liens qu’elle entretient avec ses contemporaines et qui, avec certaines, durera jusqu’à sa mort.
À son retour en Norvège, Harriet Backer fonde une école de peinture où sont formés de nombreux artistes dont des femmes. Connaissant le succès de son vivant, elle présente ses œuvres aux expositions universelles, dont celle de Paris, où elle reçoit de la médaille d’argent en 1889 pour son tableau Chez moi datant de 1887 et représentant l'écrivaine Asta Lie jouant du piano.
En plus d’enseigner la peinture, Harriet Backer, en avance sur son temps, s’implique dans des causes politiques et féministes. Elle rejoint l’association norvégienne pour les droits de la femme aux côtés de ses amies proches, Kitty Kielland et Raga Nielsenn en 1889. Elle participe à une marche pour les droits des femmes en l’honneur Camilla Collet en 1893, deux ans avant la mort de l’autrice norvégienne féministe. Elle est nommée au conseil d’administration et au comité d’acquisition de la galerie nationale de Norvège par le gouvernement norvégien, place qu’elle occupe pendant plus de vingt ans. Harriet Backer est également nommée chevalier de l’Ordre de Saint-Olav, une des plus haute distinction norvégienne encore décernée aujourd’hui.
Toutes ces étapes clés de la vie de l’artiste sont expliquées dès la première salle de l’exposition. Une frise chronologique panoramique y résume ses événements marquants. Des repères sont donnés sur ses origines, sa famille, son éducation, ses voyages et son implication dans de nombreuses causes pour son pays, et notamment les luttes féministes.
Une femme qui peint les femmes
Harriet Backer peint la figure féminine comme peu d’autres artistes de son temps. Une femme qui peint les femmes, qui plus est celles de la vie quotidienne, n’est pas commun à la fin du XIXème siècle. En effet, à cette époque, les femmes ne sont pas considérées comme des citoyennes à part entière en Norvège (elles obtiennent le droit de vote au suffrage universel pour les scrutins nationaux en 1913). Cela met notamment en exergue la personnalité et les idées politiques que défend de l’artiste. Les portraits de femmes sont nombreux, voire au cœur de cette exposition. Et lorsqu’il ne s’agit pas de portraits, Harriet Backer peint la femme dans diverses scènes de la vie quotidienne.
La femme est toujours l’élément principal du tableau. Parfois jouant de la musique, parfois s’occupant du linge, parfois priant à l’église ou bien encore lors de scènes de baptêmes, mais également pour un adieu à la famille, scène d’émancipation d’une jeune fille qui part vivre à l’étranger, comme ce fut son cas. Les femmes sont parfois accompagnées d'hommes, mais dans la composition de la peinture, l’artiste n’en fait pas les éléments centraux du tableau.
Le visiteur plonge dès les premiers instants dans l’univers de l’artiste et surtout celui de son époque. Les couleurs y sont douces, du rose pâle, au rose poudré pour sublimer les intérieurs en passant par des bruns doux et chauds pour accompagner les scènes d’extérieur. La lumière est tamisée, elle met subtilement en valeur chaque tableau et nous pousse à nous concentrer sur les détails, les textures, les mouvements de son pinceau.
Dans la continuité de la salle introductive, autour de la frise chronologique, plusieurs portraits de femmes sont exposés, comme Intérieur Bleu, peint en 1883, qui représente son amie Asta Norregaard assise sur une chaise, un tissu à la main, mais aussi Autoportrait, (inachevé), que l’artiste peint en 1910.


Fig 2 et 3 : Première(s) salle de l’exposition « Harriet Backer (1845-1932) : La musique des couleurs », Etablissement Public du Musée d’Orsay, Paris, 2024 - ©CT
La deuxième salle, permet de faire écho au travail d’artistes contemporains à Harriet Backer, avec des œuvres d’artistes qui ont appartenu à son cercle d’amies proches et qui partageaient ses ambitions féministes. C’est un premier pas vers les sources d’inspirations de Harriet Backer et d'œuvres qui ont pu avoir un impact sur son travail. Cette mise en scène plante le décor et le point de vue de l’artiste dès le début de l’exposition.
Une femme qui peint l’intime
Plus tard, elle délaissera les portraits au détails réalistes pour les intérieurs, notamment les scènes dans les salons de musique, les pièces de vie de la maison dont plusieurs intérieurs norvégiens typiques, caractéristiques d’une des périodes phares de son œuvre. À travers ces scènes d’intérieurs, Harriet Backer peint l’intime.
Elle fait entrer celui qui regarde dans une atmosphère chaleureuse, douce et lumineuse, dont elle maîtrise la technique de manière unique. C’est d’ailleurs ce que l’on ressent dans les salles suivantes de l’exposition, où prennent place ces scènes d’intérieur et ces femmes, mises les unes à la suite des autres, parmi lesquelles : Védastine Aubert (1910), Au piano (1894), Femme cousant (1890), ou encore Lavande (1914). Cet accrochage leur donne d’autant plus de d’importance, au vu de leur nombre.
La salle centrale, salle maîtresse de l’exposition, est l’évocation du cocon du foyer, par ses formes douces, ses cimaises courbes et ses assises circulaires au centre. Le visiteur est transporté dans le temps grâce à une musique d’époque qui accompagne le parcours, faisant écho à l’amour que Harriet Backer et sa sœur avaient pour la musique. Cet amour est très souvent représenté à travers le mouvement de son geste dans ses tableaux.

Fig 4 : L’espace central : le foyer, « Harriet Backer (1845-1932) : La musique des couleurs », Etablissement Public du Musée d’Orsay, Paris, 2024 - ©CT
Dans la suite du parcours, les œuvres nous transportent de l’autre côté des intérieurs que peint l’artiste. Le visiteur découvre une série de toiles représentant des espaces extérieurs, des lieux publics, du paysage Norvégiens : campagne, champs, bords de cours d’eau, église… Tout autant d’endroits dans lesquels Harriet Backer place de nouveau la femme comme sujet central, hors de la maison. C’est par exemple le cas de son huile sur toile intitulée ”Blanchiment du linge”, qu’elle réalise en 1886-1887 et qui met en avant trois femmes dans une scène de vie rurale norvégienne.
“Peindre les femmes” VS “Peindre les hommes”
En parallèle de cette rétrospective, le Musée d’Orsay présente dans son deuxième espace dédié aux expositions temporaires une exposition monographique sur l’artiste Gustave Caillebotte, intitulée « Caillebotte : Peindre les Hommes ». Cette juxtaposition des genres peut sembler être le pendant du travail de l’artiste norvégienne exposé juste en face. Caillebotte dépeint son environnement quotidien, offre une vision directe de son époque, questionnant l’intime, la place de l’homme dans la société et les différentes fonctions qu’il peut occuper. Il s'interroge sur la condition masculine, à l’image d’Harriet Backer qui le fait pour la figure féminine.
En effet, Gustave Caillebotte consacre une grande partie de sa carrière d’artiste à la peinture de sujets masculins, qu’ils s’agissent de portraits, de la figure de l’homme dans la ville ou encore l’homme sportif à travers ses séries de sportsmen. Ces tableaux datant de la même période que l'œuvre de Harriet Backer, mettent en avant deux approches radicalement différentes, un homme qui peint les hommes / une femme qui peint les femmes. Ces deux visions juxtaposées mettent en exergue une même question : la place de l’homme et de la femme dans la société dans laquelle évoluent respectivement chacun de ces deux artistes.
Les deux muséographies dialoguent, avec deux scénographies opposées : une aux couleurs chaudes, aux angles arrondis, l’autre aux tonalités plus froides, plus franches, accompagné d’un parcours d’apparence plus rectiligne. Ces deux sujets en vis à vis permettent aux visiteurs de se placer à hauteur d'œil des enjeux sociaux de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle en Europe, en réinterrogeant les normes et les conditions de genre à travers l’histoire de la peinture. Mais, l’une de ces visions n’efface-t-elle pas l’autre ?


Fig 5 : Deux femmes, Nenna Janson Nagel, née Backer Lunde, huile sur toile, 1896-1897, et Vedastine Aubert, huile sur toile, vers 1910, « Harriet Backer (1845-1932) : La musique des couleurs », Etablissement Public du Musée d’Orsay, Paris, 2024 - ©CT
Fig 6 : Deux hommes, Portrait de Paul Hugo, 1878, et Portrait de Jean Daurelle en pied, huile sur toile, 1887, exposition « Caillebotte : peindre les hommes », Etablissement Public du Musée d’Orsay, 2024 - ©CT
Une programmation culturelle en résonance
Pour aller plus loin, le Musée d’Orsay propose une programmation culturelle en lien avec l’exposition monographique sur Harriet Backer. Aussi, il est possible de retrouver au mois de novembre le Festival Norvégiennes en Scène, qui propose une immersion au cœur de la création norvégienne. Cette initiative fait notamment écho à l’attache très forte entre Harriet Backer, peintre, et sa sœur, Agathe Backer Grøndahl, musicienne, deux femmes animées par leur passion commune pour les arts.
“Durant une semaine entière, ce festival pluridisciplinaire sera l’occasion d’une exploration musicale, chorégraphique, littéraire et esthétique du dynamisme de la création norvégienne, et plus particulièrement le travail des femmes artistes d’hier et d’aujourd’hui.” Musée d’Orsay.
Clotilde Trolet
#exposition #peinture #impressionnisme #féminisme
Pour en savoir plus :
Histoire et Mémoire (1) : Le déboulonnage des statues
Depuis mon expérience professionnelle au Mémorial Alsace-Moselle (Schirmeck), je me questionne sur le lien étroit entre histoire et mémoire. Que ce soit pour des évènements sociaux ou politiques de notre siècle ou des faits plus anciens, la mémoire collective ou individuelle s’est souvent heurtée aux faits relatés par les historien·ne·s.
Monument à la gloire de l'expansion coloniale français, allégorie des Antilles par Jean-Baptiste Belloc, 1913.
Cachées dans le jardin tropical de Paris, se trouve à même le sol plusieurs sculptures de l’artiste ariégeois, Jean-Baptiste Belloc. Ce groupe statuaire appelé Monument à la gloire de l'expansion coloniale française, a été inauguré en 1922 puis déplacé à la Porte Doré lors de l’exposition coloniale de 1931. Aujourd’hui démontées en cinq pièces, les statues ont retrouvé leur place d’origine en 1962 dans ce qui était autrefois le jardin colonial. Même si le caractère affligeant et déshumanisant des zoos humains présents lors de l’exposition coloniale de 1931 n’est plus discuté, pourquoi les statues de Belloc rendant gloire à l’Empire français coloniale sont-elles toujours présentes dans l’espace public ? Pour comprendre ce qui a motivé le choix de laisser ces statues en dépit du caractère amer du passé colonial, il est nécessaire de définir les termes. Histoire et mémoire et de situer le cadre spatiotemporel dont seront extraits les exemples à suivre.
La notion d’histoire fait référence aux « connaissances du passé de l'humanité et des sociétés humaines, il s’agit d’une discipline qui étudie ce passé et cherche à le reconstituer »[1]. Ce qui revient à étudier des traces écrites du passé, créer des liens entre les faits et les contextualiser. Ce travail consent à donner un enchaînement avéré aux faits, suggérant l’idée d’une évolution. Il se peut également que l’historien·ne se base sur des témoignages oraux. Ces derniers tout comme les écrits peuvent être sujets à des interprétations, qui éloignent d’une prétendue objectivité. Les témoignages oraux s’inscrivent dans un contexte socioculturel qui n’est pas le même que l’historien·ne. Leurs auteur·e·s peuvent être soumis inconsciemment ou non à leur vision subjective des faits.
Ainsi les témoignages relèvent de la mémoire, ce qui renvoie à un « ensemble des faits passés qui reste dans le souvenir des individus, d'un groupe »[2]. Il n’existe pas seulement une mémoire mais un ensemble de mémoires qui font référence à un ou plusieurs faits historiques vécus individuellement ou collectivement. Autrement dit, à partir d’un même fait historique, deux individus peuvent avoir vécu l’expérience historique de manière diamétralement opposée. Pour résumer, selon l’historien franco-bulgare Tzvetan Todorov dans Les abus de la mémoire publié en 1995 aux éditions Arléa, « l'histoire privilégie l'abstraction et la généralisation ; la mémoire, le détail et l'exemple ».
Au vu de certaines manifestations, la frontière entre histoire et mémoire devient floue, allant même quelques fois à disparaître. Cet article a pour intention de comprendre en quoi des événements récents font ressortir dans l’espace public des tensions cristallisées où l’histoire et la mémoire se retrouvent au cœur des débats ? Les exemples choisis témoignent d’une histoire française complexe et les blessures ne sont pas encore totalement guéries. Nos exemples portent sur le déboulonnage des statues exposées dans l’espace public, celles qui reflètent le passé colonial français.
Depuis l’apparition du mouvement politique Black Lives Matter en juillet 2013, amplifié par la mort de l’afro-américain George Floyd, des citoyen·ne·s de plusieurs nations aux quatre coins du globe sont sorti·e·s dans les rues pour déboulonner des statues incarnant le passé colonial de leur pays. Ce fut le cas outre-manche où les Anglais·e·s ont fait tomber la statue en bronze d’Edward Colston érigée depuis 1895 dans la ville de Bristol, connue pour être un port important dans le commerce d’esclaves. Coté France, le débat s’est porté autour de l’investigateur du Code Noir, Jean-Baptiste Colbert dont la statue de plain-pied trône devant l’Assemblée Nationale. La statue a été aspergée de peinture rouge vif et son piédestal tagué de la mention « Négrophobie d’Etat ».
Des gestes qui ne sont pas récents
Ces gestes ne sont pas symptomatiques du XXIème siècle. Selon l’historien Bertrand Tillier, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les déboulonnages sont des actes anciens remontant à la période révolutionnaire qu’a connue la nation française. Détruire des représentations s’inscrit également dans les mouvements contestataires comme celui des huguenots au XVIe, quand ces derniers ont détruit des représentations du christ et autres iconographies catholiques. En Irak en 2003, les opposants au régime irakiens ont fait tomber les statues incarnant le pouvoir en place. Ne pouvant s’en prendre directement aux responsables politiques, le déboulonnage des statues est symbolique. Le déboulonnage renvoie à un protocole d’actions : les statues sont arrachées de leur socle et s’écroulent au sol, ou les têtes des statues sont décapitées ou elles sont recouvertes de peinture. Enfin quelques statues connaissent le supplice de la noyade comme celle du marchand d’esclaves, Edward Colston.
Des arguments qui questionnent
Nos exemples concernent essentiellement une statuaire coloniale figurée par des hommes blancs. Ici, la question est de savoir si l’on « supprime » les traces du passé colonial française dans l’espace public. Les arguments qui vont suivre n’ont pas pour but d’aborder le problème sous un angle manichéen, mais plutôt de comprendre efficacement deux argumentaires distincts.
Pour les historien·ne·s, déboulonner les statues revient à effectuer une relecture de l’histoire. C’est faire table rase d’une partie de l’histoire d’une personnalité ou d’une personne. Dans le cas du déboulonnage de la statue de Jules Ferry, l’action ne permet pas seulement de faire abstraction des antécédents colonialistes. C’est également tout l’héritage du travail de Ferry en tant que réformateur de l’éducation qui est effacé. Or l’histoire étant plurielle, elle doit représenter toutes les facettes de la vie d’un personnage, même si ses actions reflètent les heures les plus sombres du passé français. Si la statue prend place dans l’espace public, elle résulte d’un consensus des commanditaires établi en connaissance de causes. Si le consensus est rompu et que les statues contestées sont ôtées, cela signifie que les blessures du passé n’ont pas été pensées.
Pour les défendeur·e·s de l’histoire, faire enlever les statues symbolisant le passé colonial français revient à censurer une vérité dérangeante de l’histoire. Selon l’historien Dimitri Casali, « déboulonner les statues de nos Grands Hommes c’est ouvrir la boîte de Pandore du révisionnisme historique »[3].
Retirer des statues représentant des personnalités aux pensées colonialistes ne signifie pas pour autant que le passé colonial français sera oublié, il s’agit encore moins de réécrire l’histoire. Selon Françoise Vergès, le déboulonnage des statues n’a rien à voir avec l’effacement de l’histoire, mais davantage d’une question de justice mémorielle : un acte symbolique contribuant à la reconnaissance du passé colonial français plutôt qu’une volonté de réécrire l’histoire. Les statues sont le reflet de l’histoire française et une interprétation esthétique de l’histoire résultant de choix politiques, à titre de gloire. Ces choix politiques sont idéologiques reflétant la moralité et l’état d’esprit de la société qui a vu ériger ces statues. Cette morale et les valeurs qu’elles reflètent ne sont plus celles de notre société actuelle.
Les laisser ou non ?
Plusieurs options sont envisagées par l’ensemble des protagonistes. Pour Karfa Diallo président de l’association Mémoire et Partages, les statues ne doivent pas être déboulonnées mais contextualisées avec le recours de panneaux explicatifs qui permet de définir davantage les actions d’une personne. Il peut en être de même avec les noms de rues ou bien des places publiques. Cette solution contribuerait à la sauvegarde physique de la mémoire en laissant la statue ou le nom de rue sur son emplacement initial, tout en comprenant historiquement les faits, qui relèvent ici de crimes contre l’humanité.
Selon Ghyslain Vedeux, président du CRAN (Conseil représentatif des associations noires), le déboulonnage des statues n’est peut-être pas la solution à envisager. Cet acte n’étant pas officialisé par les autorités compétentes, le retrait des statues réalisé légalement aurait un impact symbolique plus fort. Une reconnaissance de l’Etat enverrait un message non négligeable de soutien dans la lutte contre les discriminations.
D’autres penchent plutôt pour la mise en place dans l’espace public de contres-monuments rétablissant la mémoire. C’est notamment le cas pour Bordeaux, ancienne place forte du commerce d’esclaves au XVIIIème siècle. Les services de la ville ont ainsi érigé une statue représentant Modeste Testas, esclave Africaine achetée par des négociants bordelais. Dans le même sens, Edouard Philippe suggère de faire renaître des cendres la statue du général Dumas alors fondue par les nazis.
Un nouveau rôle pour les musées ?
Que faire alors des statues déboulonnées ou qui vont peut-être retirées pour laisser la place à d’autres statues ? Certains pensent aux musées, comme le musée de la Citadelle situé dans un quartier berlinois à Spandau. La directrice de l’institution révèle qu’une partie du musée renferme des statues déboulonnées ou des têtes décapitées. Certaines de ces statues ne sont plus admissibles dans l’espace public. Derrière les murs du musée se trouve la tête décapitée de la statue de Lénine, résultat de la chute du mur de Berlin. Ici, les statues sont contextualisées et servent de supports pédagogiques. Tout comme le souligne Urte Evert, « le musée est considéré comme un espace sûr où l’on peut voir ces monuments toxiques et où l’on peut en parler ensemble »[4].
L’anthropologiste Octave Debary, pense quant à lui qu’il existe plusieurs façons de gérer ce qu’il appelle « les restes de l’histoire ». Employant la métaphore d’un festin terminé, Debary met en exergue trois moyens de faire « le tri ». Première option, certains individus éprouvant un fort attachement au présent ne se concentrant que sur celui-ci, font table rase du passé et ne gardent aucune trace de ce repas. Deuxième option, d’autres plus attachés au passé expriment le besoin de faire un tri : se pose alors la question de ce qui va être gardé ou bien jeté. Dernière option, une conservation totale, toutes les traces devant être gardées sans mesure, dans une volonté de protéger le passé. Les deux dernières options renvoient aux conceptions mutuelles des historiens et des pro-déboulonnages dans la question des statues à caractères coloniales. L’anthropologue définit aussi le musée comme un espace-temps de l’oubli où les choses que l’on ne veut plus voir sont reléguées dans un espace clos, neutre. Autrement dit, le musée prend le relais de ce que l’espace public ne veut plus en son sein.
A-t-on besoin de voir pour se remémorer les choses du passé ? Voir est-il synonyme de savoir ? Si nous passons devant un mémorial de guerre, est-ce que cela convoque en nous systématiquement des connaissances ? Ce n’est pas parce que nous posons le regard sur la statue de Gallieni que nous sommes au fait de l’histoire du personnage et de ses actions. Que l’on déboulonne les statues ou que l’on les laisse en place, l’essentiel est de contextualiser ces œuvres, dans l’espace public ou dans un musée et cela doit passer par un travail de sensibilisation et d’éducation.
Edith Grillas
#Histoire #Mémoire #Décolonialisme
[1]Définition Larousse : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/histoire/40070 ↩
[2]Définition Larousse : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9moire/50401 ↩
[3]https://www.huffingtonpost.fr/dimitri-casali/faut-il-deboulonner-les-statues-de-colbert_a_23219160/ ↩
[4]https://fr.euronews.com/2020/06/20/que-faut-il-faire-des-statues-de-personnages-historiques-qui-sont-contestees-et-vandalisee ↩
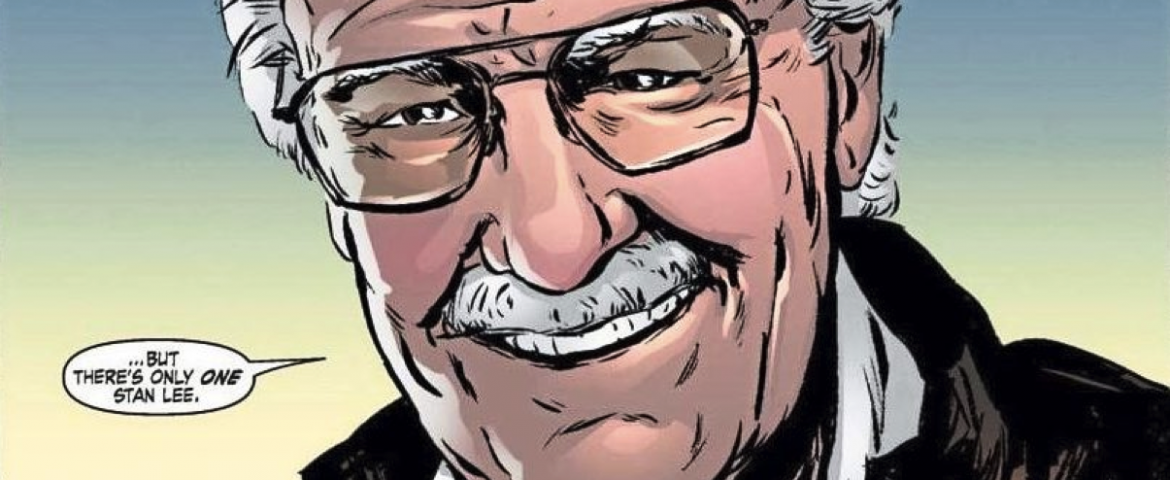
Homère est mort ?
Ces dernières décennies, la pop culture est devenue de plus en plus légitime aux yeux des experts de la culture classique ainsi qu’à ceux des grandes institutions. Retour sur l’invasion des costumes moulants et autres héros dans nos musées.

© David Cubero - suppaduppa666
Le fond du slip
Mettons les poings sur les (L)« i » : les super-héros, ce ne sont pas (seulement) de joyeux fripons en mégaslip-sur-collants bardés de super-pouvoirs, partant exécuter moults cabrioles entre deux gratte-ciels pour aller castagner du margoulin. Non. Ce qui a fait le succès de la « recette Stan Lee », c’est de créer des personnes derrière ces personnages, leur donner de véritables personnalités auxquelles le lecteur peut s’identifier. Par ce biais, il aborde de nombreuses thématiques fortes comme l’intolérance, la discrimination (Professeur X & Magnéto), le racisme (Black Panther), les troubles mentaux (Hulk) ou encore le handicap (Daredevil).
À travers leurs aventures, Stan Lee invite le lecteur à se méfier de ceux qui leur disent comment penser, à oser s’affirmer malgré son passé. Jason, Achille et Hector sont de nos jours réincarnés dans les (super-)héros de Stan Lee. Véritables inspirations morales et (oserais-je le dire?) philosophiques, ils sont des figures incontournables de la (pop) culture.
Cependant, une question reste en suspens : à l’heure où Homère meurt, quel héritage reste-t-il de ces épopées dans notre culture ?
Le ludique, passeur de culture
Le saviez-vous ? Le comics fait partie de ce que l’on appelle l’art ludique, un mouvement artistique conceptualisé par Jean-Jacques Launier, directeur du (feu) musée Art Ludique, dans son livre éponyme écrit avec Jean-Samuel Kriegk (2011). L’art ludique, c’est tout l’art des industries créatives qui modèle(nt) notre imaginaire : bande-dessinée, manga, jeu vidéo, cinéma d’animation et bien sûr, le comics. Les personnages comme les histoires issues de ces œuvres sont le reflet et l’incarnation de nos références culturelles, de nos imaginaires collectifs, bref : nos mythologies contemporaines. Avec l'ouverture d'Art Ludique – Le Musée le 16 novembre 2013, les héros de l'entertainment deviennent des créations, de l'art. Le musée revendique avec ferveur la dimension artistique qu'est le figuratif-narratif, souvent dénigré dans le milieu de l'art contemporain.
En 2012 naît également un autre projet qui défendra haut et fort les couleurs de la pop culture : BiTS, chronique hebdomadaire sur Arte. Rafik Djoumi, son rédacteur en chef, y offre une lecture originale du monde contemporain en explorant les liens, créant des ponts entre les sciences humaines (histoire, sociologie, etc.) et les cultures. Sa mission ? « Désenclaver la culture pop : montrer en quoi elle nourrit et se nourrit de ce que l’on appelle la culture classique, mais en insistant sur ses mutations, ses réinventions perpétuelles, sa capacité paradoxale d’échapper à la norme alors qu’elle s’adresse à tous ». Aussi, Djoumi insiste sur le fait qu’« il est important de séparer la notion marchande de culture de masse de la notion historique de culture populaire ». Au fond, l’objet de pop culture parle de nous, ses pièces de collections sont des trésors culturels, au même titre qu’une œuvre d’art ou n’importe quel objet ethnographique ayant sa place dans un musée.
Geek is was the new chic
Loin de vouloir surfer sur la vague de coolitude dont le Geek a pu bénéficier dans les années 2000, il est important d’incorporer les objets de la pop culture à ceux de la Culture dans nos musées. Certains diront que cela fût une grâce accordée de force à cette culture longtemps considérée comme marginale. Cependant, il faut bien reconnaître que cette vague a permis d’en soulever une autre dans sa houle. Jamais la pop culture n’a été aussi représentée dans la recherche universitaire que ces quinze dernières années. Mémoires, thèses, journées d’études, théorisation et autres analyses en tout genres et dans toutes disciplines confondues ont menés la pop culture à une institutionnalisation incontestée et incontestable.
Viens là tout le paradoxe de cette démarche : comment parler de l’intelligence de cette culture, intrinsèquement accessible à tous, sans tomber dans l’élitisme, sans trahir ce qui fait sa force ? Bien des musées échouent à être accessibles à tous, et utilisent la pop culture afin de se détacher de l’image de lieu poussiéreux et effrayant. Est-ce par égoïsme (exposition « putassière », blockbuster) ou y a-t-il une intention sincère, bien que souvent maladroite ?
Faut-il faire entrer au musée cette culture de la rue, au risque de la subtiliser au peuple pour la transformer à son tour en une culture qui lui soit inaccessible ? Cette question fut déjà posée par le pop art. Cependant, ce dernier est un mouvement qui analyse, théorise et élitise. L'intérêt de l'art ludique est de connecter l'art contemporain et le grand public, lui dire que ce qui fait la culture populaire issue de ces industries créatives est bien de l'art.
La street cred, un chemin long et tortueux ?
Cannibalisme culturel ?
Bon, il faut être honnête : cette soi-disant guéguerre n’est quasiment plus. Cet engouement pour l’art ludique est totalement accepté voire normalisé. La BD, couronnée du titre de « 9e art » et bien aidée par l’appui du Festival d’Angoulême, n’a plus vraiment à se battre pour avoir sa place sur une cimaise, surtout quand il s’agit de monstres sacrés franco-belges (Moebius à la Monnaie de Paris, Hergé au Grand Palais, Hugo Pratt à Confluences, etc). Le cinéma d’animation, hybride du 7e et 9e art, n’est plus très difficile à défendre non plus (Tim Burton au MoMA). Il faut bien avouer qu’en dehors des événements ou lieux spécialisés, la France reste globalement encore un peu frileuse quand il s’agit d’exposer le comics, le manga ou le jeu vidéo.

Vue de l’exposition « L’Art des Super-Héros Marvel », du 22 mars au 31 août 2014 © Art Ludique
Le Musée Art Ludique fit exception dans ce domaine. Je ne vais pas vous mentir : j’ai un amour sincère pour le travail de ce musée. Déjà par l’audace du couple Launier, qui a initié ce projet ambitieux (et unique sur la scène parisienne), mais aussi par l’admiration que j’éprouve face à tant de travail abattu en si peu de temps d’existence (à peine plus de quatre ans). En proposant pas moins de huit expositions sur les plus grands studios d’animation (Pixar, Ghibli, Aardman, Blue Sky, Walt Disney), les comics (Marvel et DC Comics) et le jeu vidéo, Art Ludique instaura une reconnaissance définitive de ces héros dessinés au sein des beaux-arts. Ses expositions se concentraient essentiellement sur les dimensions artistiques de ces œuvres et techniques de ces productions. Normal étant donné la volonté de se revendiquer comme musée d’art contemporain. Durant mes visites, les ouvertures occasionnelles sur d’autres disciplines qui furent proposées me laissaient autant exaltée que frustrée de ne pas en avoir plus.

Vue de l’exposition « L’Art de Blue Sky Studios », du 25 mars au 25 septembre 2016, où une analyse philosophique du personnage de Scrat par Thibault de Saint Maurice était présentée © Art Ludique
Chaque salle montre les différentes (ré)interprétations d’un même sujet au travers des siècles et des différents médiums et médias.
Vue de la salle Jiangshi de l’exposition « Enfers et Fantômes d’Asie » © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Gautier Deblonde
La salle des Vampire-sauteurs est l’une des plus étonnante sur ce point. La figure du jiangshi de son vrai nom, fut rendue populaire dans les années 80 grâce aux films Spooky Encounters et Mr Vampire, qui lanceront une grande vague d’émules. Au centre, sur l’estrade, une reconstitution présente des costumes traditionnels de mandarins (issus des collections du musée) sur des jiangshi grimaçants plus vrais que natures, produit par le studio hongkongais QFX Workshop spécialement pour l’exposition. Un diorama façon kung-fu zombie des années 80. De quoi donner des frissons au visiteur qui entre dans la salle, même si la menace est en silicone.
Plus loin, la salle des yokais donne à voir cette réinvention de la représentation de ces créatures fantasmagoriques traditionnelles. Planches d’illustrations, jeux vidéos, figurines issues de mangas ou de longs-métrages d’animation : tous se mélangent et se côtoient dans une même vitrine, élevant les objets en série de la pop culture au rang d’objets ethnographiques légitimement exposables.
Vue de la salle Yokai de l’exposition « Enfers et Fantômes d’Asie » © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Gautier Deblonde
Seul et unique point noir : l’exposition aurait pu être parfaite si ce n’est la présence regrettable de cette minuscule salle annexe dédiée au jeux vidéo. Pourquoi ne pas les intégrer séparément au reste des salles, comme tous les autres expôts, plutôt que de les cantonner à leur statut de média vidéoludique ?
C’est en cela que réside la force d’impact de ces apparitions dans nos institutions muséales : quand les objets de la pop culture font leur entrée dans les vitrines, cela donne lieu à une toute autre analyse de cette culture longtemps marginalisée. C’est une porte vers d’autres regards que celui de l’art. Sociologie, anthropologique, ethnologique, scientifique et pourquoi pas philosophique ! C’est une reconsidération d’une culture longtemps dédaignée, désignée comme « sous-culture ».
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités
Auparavant, les termes de ces passions étaient des objets jetables, produits en masse. Omniprésents et donc invisibles : la contre-culture parfaite. Même le milieu de l'art contemporain – toujours en quête de nouveauté, de provocation et de discours sur le monde – n'a osé venir s'y frotter timidement qu'à la fin des années 1990. C'est là qu'intervient l'audace de Diane et Jean-Jacques Launier, qui ouvre en 2003 la galerie Arludik à Paris. Seuls sur le marché de l'art contemporain à vendre des œuvres issues des créatifs de l'entertainment, il est ironique de se dire que 10 ans plus tard, ils fonderont le musée Art Ludique – premier musée de l'entertainment au monde – qui attirera près de 180 000 visiteurs lors de sa première exposition sur « Pixar, 25 ans d'animation ».
En attendant que la valeur artistique de l'art ludique se révèle aux yeux de tous, il restait un mot magique pour forcer les esprits revêches à écouter : le patrimoine. Tout a été trié, étiqueté, entreposé et rangé dans les bibliothèques des maisons d’éditions et autres bases de données des studios de productions – et par les passionnés consciencieux – pour le jour où le présent des institutions culturelles rejoindrait le passé de l'art ludique. Mais est-ce vraiment le monde académique qui a aidé à faire accepter cette culture de masse ? Même si elle est parfois tentée par la mentalité de ghetto, la contre-culture ne se définit pas toujours contre. Cette dernière, pétrie de sciences, n'a jamais été loin du monde académique. N'est-ce pas au California Institute of Arts qu'ont été formés les créateurs actuels de l'entertainment (Tim Burton, Glen Keane, John Lasseter, Michel Ocelot, Brad Bird) ? Il serait donc normal que tous ces artistes, qui ont influencés la planète entière de l'Amérique au Japon, assurent la continuité entre tradition et modernité.
Après tout, le pop art n'a pas absorbé le comic book, il l'a même nourri à son tour. L'entertainment, pas un art ? La bourgeoisie peut toujours essayer de courir après l'art ludique, elle n’empêchera jamais cette culture populaire de se régénérer sans fin et de courtcircuiter tout ce que l'on croit savoir d'elle.
Un peu comme The Amazing Cameoman finalement.
Jeanne Régnier
#stanlee
#artludique
#bdaumusée
#theamazingcameoman
Pour aller plus loin : www.youtube.com/user/bitsartemagazine

Immersion au musée municipal d'Helsinki
Il fait chaud pour un mois d’août à Helsinki, la ville est pleine de touristes ce qui contraste avec les autres villes de Finlande. En flânant entre la cathédrale et la place du marché, un bâtiment siglé « MUSEE », m'attire.
Je pénètre sans le savoir dans le musée municipal d'Helsinki, ouvert en 2016 et qui se revendique être avant tout un lieu de vie, ouvert à tous les visiteurs. Le grand hall, point central de ce lieu constitué d'un groupement de 5 bâtiments et 3 cours intérieures, est plein de groupes, d'enfants, de touristes, attirés par une entrée libre et une ouverture tous les jours. Je m'approche du guichet, on me distribue le plan et je commence l'exploration de ce lieu peu banal, pour découvrir l'histoire de la capitale finlandaise et la vie de ses habitants.
Au rez-de-chaussée, la découverte de la ville commence grâce à une machine à remonter le temps qui fait revivre l’Helsinki d’il y a cent ans à travers des scènes de la vie urbaine capturées par la photographe Signe Brander et qui s’animent grâce à des lunettes de réalité virtuelle : ainsi défile l’évolution des paysages de la capitale au fil des années.

Projection de la ville interactive, à droite, les casques de réalité virtuelle © Cloé Alriquet
Au premier étage, le retour dans le passé n’est plus virtuel.
La visite commence par l'obtention du journal "Helsinki Echo" qui en plus d'avoir l'allure d'un quotidien, est un plan du musée et donne des informations supplémentaires sur les différentes zones d'exposition. On explore ainsi plusieurs "morceaux choisis" du quotidien des habitants - d'où le titre, Helsinki Bites-, d’une rue passante restituée, en passant par un appartement des années 1950 où l'on peut s'installer et écouter la radio, un bar des années 70 où l'on peut découvrir sur un juke box les musiques finlandaises populaires de cette époque mais aussi un téléphone public qui sonne où l'on entend en décrochant le témoignage sonore d'habitants de la ville. La scénographie très immersive, l’ambiance sonore constante et l’utilisation du numérique par exemple par des projections de personnes dans des environnements comme le bar, apportent beaucoup de stimuli à la visite de cette exposition qui comporte peu de texte mais beaucoup d’images et qui relève plus de l'exploration et de l’expérience. La dernière salle consacrée au skateboard à Helsinki depuis l’ouverture du musée, a vocation à changer régulièrement car elle est imaginée avec des associations et des habitants sur des thématiques en lien avec la ville.


Une rue finlandaise vs une salle sur la pratique du skateboard à Helsinki © Cloé Alriquet
Reparti entre le premier et le deuxième étage, Children's Town, invite les jeunes visiteurs (et les plus grands !) à une expérience immersive. Ils peuvent jouer dans un bateau, dessiner, passer des déguisements, suivre une leçon sur les bancs d’une école du siècle dernier recréée à l’identique et même entrer dans un appartement des années 1970 où chaque week-end, une médiatrice du musée y joue la grand-mère. Les salles, en plus de présenter des jouets à manipuler, expose des objets en lien, ainsi à côté d'une maison de poupée gigantesque, se trouve en vitrine des maisons de poupées d'époque. On retourne en enfance avec l'envie de tout toucher, de tout explorer !


Jouer aux poupées ou découvrir un appartement ancien, des livres au transistor à Children’s town © Cloé Alriquet
Le troisième et dernier étage du musée est un espace réservé aux expositions temporaires. Les expositions réalisées depuis l'ouverture du musée ont toutes un point commun : raconter la vie des habitants d'Helsinki sous le prisme de l’émotion, du sensible.
Ainsi, la première expo qui s’y est tenue s’intitulait « musée des relations brisées » (Museum of Broken Relationships) pour laquelle de nombreux Finlandais ont fait don anonymement d’un objet ou d’une histoire évoquant l’une de leurs relations qui se sera soldée par une rupture. Se sont ainsi retrouvés exposés entre autres des bagues, des vêtements divers, des cartes routières... Les donateurs de ces objets ont écrit eux-mêmes les quelques mots destinés à présenter leur objet au public. Pour une autre exposition intitulée Smell, le musée a demandé aux habitants d’Helsinki quelles odeurs incarnaient le mieux la ville. La dernière en date, intitulée Helsinki Hobo, s'intéresse aux sans-abris, aux prostituées et à toutes personnes habituellement invisibles dans la rue à travers le récit d’un écrivain finlandais.
Quel meilleur moyen pour attirer des visiteurs que de mettre en avant leurs émotions ou de parler de leur ville sous un angle inattendu ?
De retour au rez-de-chaussée, de multiples activités s’offrent à moi : boire un café ou manger un bout, visiter la boutique pour y acheter des objets design, me prélasser dans des canapés ou visiter les archives du musée accessibles librement et qui comptent plus d’un million de photographies d’Helsinki, que l'on peut admirer sur place et même imprimer contre quelques euros !

La photothèque du musée, en libre accès ! © Cloé Alriquet
En conclusion, la posture assumée du musée municipal d’Helsinki est de mettre en avant la vie quotidienne des Finlandais hier et aujourd’hui, sans trop de texte avec des visuels, de l'interactif et en attirant les enfants. Ce lieu est une vrai bouffée d'air frais dans la ville : grand, aéré, ouvert et surtout en phase avec son époque.
Cloé Alriquet
Le site du musée : https://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/en/
#musee
#helsinki
#finlande

Immersion dans les archives ménagères
Les Archives Nationales (AN) ont présenté du 5 février au 30 juillet 2022 une exposition temporaire, intitulée Au Salon des arts ménagers (1923-1983)sur le site de Pierre-sur-Seine (93). L’exposition présente un évènement emblématique du XXe dédié aux innovations techniques et technologiques destinés à la sphère domestique. Ce rassemblement, désormais disparu, avec l’apparition des boutiques, marque durablement les souvenirs. Aujourd’hui chaque marque gère son image et sa présentation au public sans passer par l’organisation d’un salon institutionnel. L’affiche présente un environnement très masculin malgré le thème de la vie domestique traditionnellement dévolu au monde féminin. L’exposition interroge une histoire de la consommation et permet de réunir ménagères et militantes pour l’égalité au détour des stands scénographiés.
Image d'intro : © Photographies - Farida Bréchamier
Dialogue entre archivistique et muséographie
Le premier salon organisé à Paris s’est tenu en 1923 aux Champs de Mars puis a été déplacé au Grand Palais en 1928. Il a été organisé par Jules-Louis Breton, personnage politique et homme de sciences qui souhaitait mettre en avant les progrès techniques, l’utilisation de l’électricité au foyer et faciliter l’usage de l’espace domestique. L’évènement accueille en son temps des milliers de visiteurs et s’étend sur plus de 5 000 mètres d’exposition, de stands et de réclames publicitaires.
Le commissariat scientifique de l’exposition à Pierrefitte-sur-Seine est assuré par le personnel des Archives Nationales : Sandrine Bula, conservatrice en chef du patrimoine aux AN, Marie-Eve bouillon, historienne, chargée d’étude aux AN et Luce Lebart, historienne de la photographie, commissaire d’exposition. Elles ont pu compter sur un fonds conséquent transmis en 1985. Martine Segalen, sociologue spécialiste de la famille, décédée en juin 2022, a également participé au catalogue de l’exposition.
Le salon a été porté par Jules Louis Breton, créateur et premier directeur de l’Office national de recherches scientifiques et industrielles, l’ancêtre du CNRS. L’exposition a donc largement puisé dans le fonds versé par le CNRS. L’organisation du Salon a pris fin en 1983 et ce fonds a été versé aux Archives Nationales en 1985 à la suite de la dissolution du commissariat général du Salon. Le fonds comporte aujourd’hui environ 40 000 tirages photographiques soit 350 mètres linéaires, mais aussi des vidéos, affiches, brochures et a beaucoup influencé les choix scénographiques proposés par l’atelier Deltaèdre : « La scénographie rend un clin d’œil ludique à l’univers visuel saturé et chatoyant du salon en mettant en scène une série de stands correspondant chacun à l’une des thématiques avec de nombreuses évocations d’enseignes, de logos, de publicités servant à la fois de décors et de supports de médiation. »1
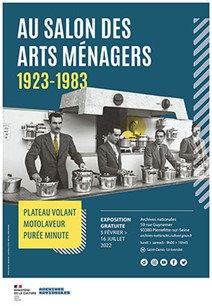
© affiche de l’exposition / Archives Nationales
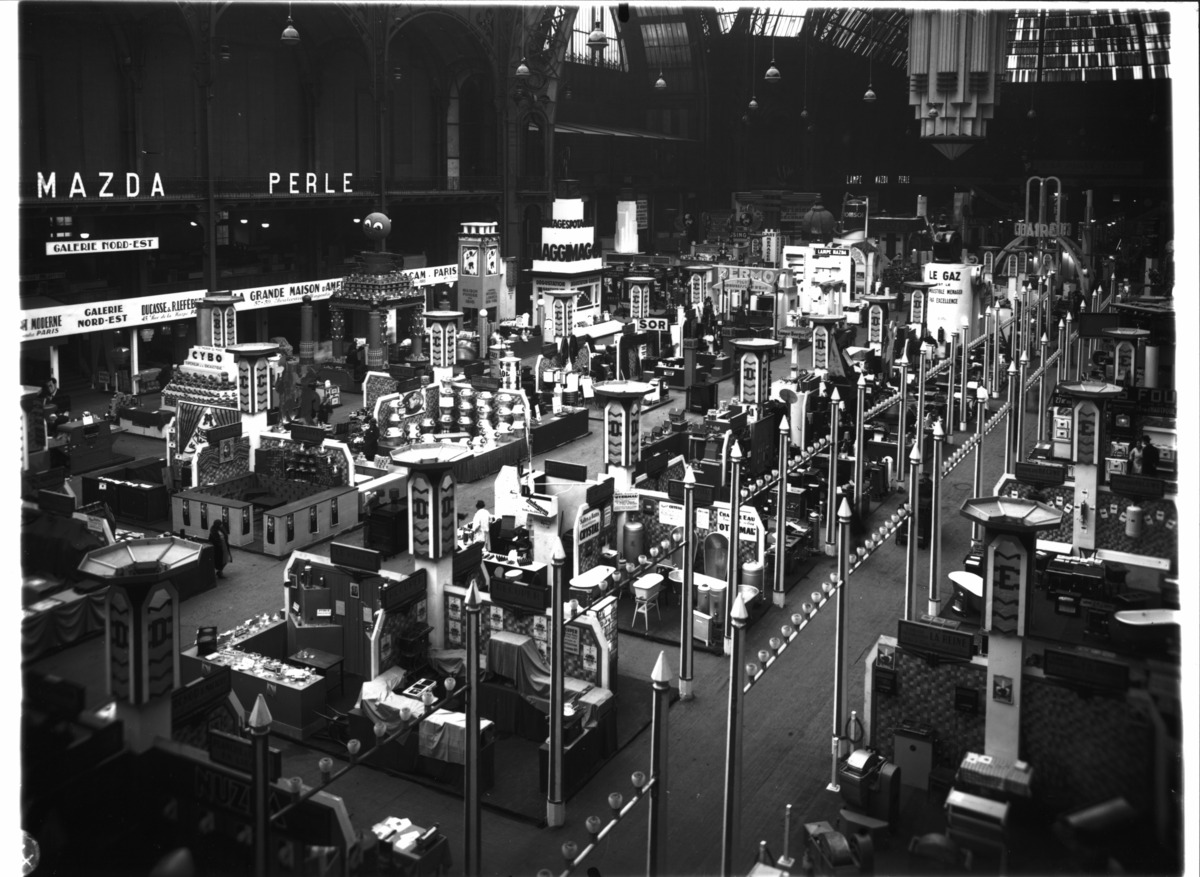
© Fonds historique / CNRS Photothèque
Une exposition immersive et ludique aux archives
La circulation n’est pas linéaire, l’espace présente un rondpoint central et donne sur des allées transversales. Les supports de médiations audiovisuels fourmillent sans faire l’économie d’encarts présentant des éléments de contextualisation apportent un éclairage bienvenu sur l’ensemble des visuels mis à disposition. Comme le parcours n’est pas linéaire, chaque ilot peut être abordé indépendamment, ce qui accentue la sensation de déambulation, le visiteur ne s’arrête alors à un titre qui nous alpague ou une couleur qui accroche notre regard.
Chaque îlot encartonné présente un thème tel que la fabrique du salon (architecture), les concours des appareils ménagers (pratiques commerciales), les employés de salons (travail), la mythification du salon (communication et publicité). Il est possible d’entrer dans chaque îlot ou d’en faire le tour puisque l’extérieur présente également des expôts. Chaque thème est divisé en 5 à 10 sous-thématiques accompagnés d’archives.
Des espaces indiquent également des focus qui précisent une thématique en dehors des ilots comme le taylorisme appliqué aux ménages. Ils reprennent pour cela la charte graphique de la réclame publicitaire. Le rendu est saisissant, la sensation de foule, le bruit, la perte de repère au milieu des stands. Pourtant ce n’est pas un frein à la compréhension de l’ensemble et rend parfaitement l’effervescence de ces évènements. Une grande frise chronologique permet de voir l’évolution du Salon mais aussi son insertion dans un contexte plus large. De nombreuses statistiques apportent des chiffres sur la fréquentation de l’événement.
De l’archive à la muséographie
Les expositions temporaires aux archives ont pour objectif de valoriser les fonds à disposition dans le centre. Cette typologie d’exposition implique l’archiviste en tant que vulgarisateur d’un fonds et commissaire. Tous les archivistes n’ont pas la possibilité d’exercer au sein d’une institution telle que les AN. Un archiviste en poste en entreprise ou dans une institution publique malgré une formation similaire n’aborde pas forcément la question de la médiation et de la valorisation des archives dans ses missions. C’est donc une possibilité gratifiante de voir prendre une forme muséographique à des fonds détenus et étudiés.
Cependant, l’aspect immersif aurait gagné à présenter des objets d’époque du Salon et à s’affranchir des archives. Plus de traces matérielles des salons auraient pu être prêtés par les entreprises qui conservent souvent des objets dans leur propre démarche d’archivage, par des musées plus axés sur la technique et la science, ou par des particuliers sur un appel des Archives nationales. Cela a été fait par le musée de l’Immigration qui présente dans sa galerie des objets obtenus par collecte.
En outre nous disposons finalement de peu d’informations socio-économiques sur les visiteurs du Salon et les utilisateurs de ce type d’objets. Le regard des entreprises manque également, notamment concernant leurs stratégies et leur choix de passer du Salon aux supermarchés à partir des années 1980.
La conception d’une exposition gagne en qualité grâce aux caractère transdisciplinaire du commissariat scientifique, entre professionnelles des archives et un commissaire d’exposition spécialiste de photographie. De façon générale, l’exposition est donc une réussite sur le plan de sa simplicité, et gagnerait à être présentée dans divers endroits. L’exposition s’étend sur 380 m2 aux Archives Nationales, a été réalisée avec un budget de 50 000 euros HT. C’est un excellent exemple d’une bonne exposition demandant peu de moyens, ce qui est une préoccupation récurrente pour les personnels des archives.
Hélène Raboteur
1 Source : Atelier Deltaedre, consulté le 27, octobre 2022, [en ligne], URL : https://atelier-deltaedre.com/references/au-salon-des-arts-menagers-1923-1983. ↩
Pour en savoir plus :
- https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/au-salon-des-arts-menagers
- https://www.grandpalais.fr/fr/article/dossier-pedagogique-un-grand-palais-pour-les-arts-menagers
- Pour plus d’images sur le salon des arts ménagers, consultez le dossier sur CNRS Images : https://images.cnrs.fr/archives/le-salon-des-arts-menagers.
#Exposition #Histoiresociale #Arts ménagers
Jules à Amiens, Verne à Nantes
Née à Amiens et résidant à Nantes, on peut dire que je foule les pas de Jules Verne !
Dans chacune de ces villes qui lui ont été chères, se trouve aujourd’hui un musée qui valorise à sa façon l’écrivain,l’inventeur, comme l’homme politique.
Jules Verne est issu d’une famille nantaise de navigateurs et d'armateurs. Il nait sur une des îles de Nantes en 1828 et grandira dans l’effervescence des allers et venues des navires de marchandises. Il ne passera que ces 20 premières années à Nantes, pour partir ensuite à Paris faire ses études de droit. La vie de couple l’emmène ensuite à Amiens, d’où est originaire sa femme. Il y vivra 34 ans jusqu’à sa mort en 1905.
Ces deux villes qui ont fortement marqué l’écrivain, s’imposent donc dans la réception de son héritage et la création de lieux patrimoniaux.
Naissance du musée nantais
A Nantes les premières célébrations de Jules Verne commencent dès 1955 pour le 50e anniversaire de sa mort. Une association nantaise (La Société Académique de Nantes) lui consacre une exposition. C’est au cours de cet événement que l’idée commence à germer d’un « musée Jules Verne ».
La bibliothèque municipale prend la suite. Ayant déjà plusieurs ouvrages de l’écrivain, dont certains offerts et dédicacés par l’auteur lui-même, l’institution se penche sur la « star » locale. En 1963, elle lui consacre également une exposition pour célébrer le centenaire des « Voyages Extraordinaires ». La famille de l’écrivain touché par cet intérêt offre à la ville une cinquantaine de lettres autographes de l’écrivain. C’est alors le point de départ de la spécialisation de la bibliothèque nantaise qui va orienter ses recherches et sa politique d’acquisition sur l’auteur.
La création du centre d’étude vernien est officialisée au sein de la bibliothèque en 1969. Le musée deviendra ensuite une sorte d’annexe de la bibliothèque, un lieu de présentation et de médiation autour du fond vernien.
Le musée Jules Verne naît le 8 avril 1978, annéedu 150ème anniversaire de la naissance de Jules Verne à Nantes. L’évènement est largement fêté dans la ville, l’année 1978 est même déclarée année Jules Verne. Pour les 100 ans de sa mort en 2005, le musée est rénové. Aujourd’hui la bibliothèque est à nouveau en train de réfléchir à l’évolution du projet d’établissement du musée Jules Verne.
Un voyage thématique plus que temporel
Le musée nantais propose d’explorer Jules Verne à travers plusieurs thématiques : la terre, le ciel, l’espace. Les premières salles, plongent tout d’abord le public dans le contexte historique de la jeunesse de Jules Verne : la ville de Nantes en pleine effervescence maritime et industrielle. Persuadé que cela a profondément inspiré le jeune auteur, le lien avec le port de Nantes et la passion de Jules Verne pour les bateaux et les voyages sont très marqués. En témoignent plusieurs citations présentes dans le musée.
Les salles thématiques exposent au public tour à tour les inventions sous-marines et spatiales de l’inventeur avec de nombreuses maquettes. Puis une place importante est donnée à l’écrivain, notamment à sa collaboration avec son éditeur Hetzel, mais aussi ses nombreuses pièces de théâtre.
Enfin certaines pièces présentent l’interprétation de l’œuvre de l’auteur par des artistes contemporains. Les salles semi-permanentes, s’adaptent aux expositions temporaires. On y trouve notamment beaucoup d’illustrateurs, ou encore d’extraits cinématographiques.
La scénographie est assez épurée et propose plutôt de plonger dans les univers verniens, et dans sa réinterprétation actuelle. L’exposition est assez didactique et décrypte bien les passions de l’écrivain. L’idée ici n’est pas de réécrire l’histoire de Jules Verne, mais d’en présenter les grandes étapes, les grandes idées, et d’en perpétuer le souvenir.
Vue du musée Jules Verne avec la citation suivante : « Il y a cette circonstance que je suis né à Nantes, où mon enfance s’est tout entière écoulée (…) dans le mouvement maritime d’une grande ville de commerce » © CdA.
Une des salles de musée Jules Verne avec la citation suivante « Je n’ai jamais pu voir partir un vaisseau, navire de guerre ou simple bateau de pêche sans que mon être tout entier s’embarque à son bord. » © CdA.
La naissance du musée amiénois
Sur ses 34 ans de vie à Amiens Jules Verne habita plusieurs maisons, mais c’est dans celle du 2 rue Charles-Dubois qu’il y restera le plus longtemps. Dans cette très belle demeure du milieu du 19esiècle, typique du nord de la France en brique rouge, il mènera la grande vie avec de nombreuses réceptions.
Dès 1971, se rassemblent plusieurs passionnés et collectionneurs de Jules Verne pour se constituer en association au sein de la maison de l’auteur. Ils commencent alors à constituer une collection d’objets, ayant appartenu ou en lien avec l’homme. En 1980, la ville d’Amiens achète la maison. Pour éviter qu’elle ne tombe en ruine, des travaux sont réalisés l’année suivante pour que le Centre International de Jules Verne s’y installe. Plusieurs projets de réhabilitation du site se mettent en place comme une maison des sciences avec une partie consacrée à l’écrivain.
En 1990, 10 ans plus tard, la maison commence à s’ouvrir au public. Des travaux sont à nouveau réalisés au rez-de-chaussée pour restituer le salon de musique et la salle à manger de l’écrivain. A nouveau presque 10 ans plus tard, la ville laisse le CIJV (Centre International de Jules Verne) gérer la maison officiellement. C’est alors que le bâtiment est classé au sein de la Fédération des Maisons d’Écrivain et des Patrimoines Littéraires. Le fond vernien s’agrandit considérablement quand en 2000, le collectionneur Piero Gondolo della Riva, cède 30 000 objets à la ville.
La Maison de Jules Verne fait peau neuve en 2006, grâce entre autres au scénographe François Schuiten (qui a réalisé la scénographie du Train world à Bruxelles). Il ajoute à la tour de la maison un globe en métal tout à fait dans l’esprit de l’écrivain.
Une immersion dans la vie quotidienne de l’auteur
La maison a pris le parti de retranscrire une ambiance d’époque, créer une maison intime. On plonge dans une habitation bourgeoise du 19e avec quelques inspirations néogothiques comme la Maison de Victor Hugo à Paris. Le visiteur foule les pas de l’écrivain dans sa salle à manger, son fumoir, sa bibliothèque, etc. On découvre que l’homme, d’une manière très prosaïque, écrivait dans un tout petit cabinet avec juste de quoi écrire, dormir et observer les allers et venues des trains à travers une petite fenêtre.
Est évoqué également l’homme politique, ce qui n’est pas le cas à Nantes, à juste titre car c’est à Amiens qu’il s’engagera dans le conseil municipal de la ville. Y figure donc des distinctions qui lui ont été remises et des reproductions d’un de ses grands projets qui lui a tenu à cœur : la création d’un cirque à Amiens (aujourd’hui renommé cirque Jules Verne) pour promouvoir la création artistique.
 Puis, plus on monte dans les étage plus on s’évade dans des univers oniriques. Au 3e étage sont évoqués les bateaux et les voyages avec la reconstitution d’une cabine de bateau qui nous immerge dans une bulle spatio-temporelle. Le dernier étage joue sur l’effet « grenier » dans un bric-à-brac d’objets évoquant la postérité de l’œuvre de Jules Verne avec des objets de cinéma, théâtre, des marionnettes, etc.
Puis, plus on monte dans les étage plus on s’évade dans des univers oniriques. Au 3e étage sont évoqués les bateaux et les voyages avec la reconstitution d’une cabine de bateau qui nous immerge dans une bulle spatio-temporelle. Le dernier étage joue sur l’effet « grenier » dans un bric-à-brac d’objets évoquant la postérité de l’œuvre de Jules Verne avec des objets de cinéma, théâtre, des marionnettes, etc.
Globalement dans cette maison, l’ambiance est assez chargée, il y a beaucoup de collections, parfois un peu trop. Cependant l’objectif n’est pas le même qu’à Nantes, le public vient ici d’abord pour visiter un bâtiment « historique », et s’imprégner de la vie et de l’esprit de Jules Verne et ensuite butiner vers certains objets qui auront piqué sa curiosité.
Vue extérieure de la Maison Jules Verne, Amiens. © CdA.
Vue intérieure d’une salle de la Maison Jules Verne, Amiens. © CdA.
Jules à Amiens, Verne à Nantes
Malgré des dates assez communes, les deux sites verniens n’ont pas eu la même évolution. A Nantes, les choses se sontfaites assez rapidement, le premier musée nait à la fin des années 1980, alors qu’à Amiens la ville rachète tout juste la maison. La force des deux associations à l’origine du musée diffère également. A Amiens, le CIJV s’est constitué comme une association très puissante, puis le musée a été géré par les bibliothèques de la ville. Il y a eu un transfert de compétences et de gestion. A Nantes, le lien avec la bibliothèque municipale est marqué dès l’origine et installe une belle continuité dans le temps, même si aujourd’hui le musée mériterait de prendre son envol.
Chaque musée a choisi en bonne intelligence de valoriser une facette de Jules Verne. A Nantes nous est présenté les rêves de l’homme, ses inventions, ses passions, son univers si inspirant. Tandis qu’à Amiens, est recherché l’intimité avec l’écrivain, son lieu de vie, ses ouvrages, et le contexte politique dans lequel il vécut.
Bien sûr ces deux villes n’ont pas le monopole de la valorisation de Jules Verne . Tout comme les musées, les passionnés du monde entier se font un plaisir de réinterpréter l’œuvre qui touche aussi bien le domaine de la littérature, de l’histoire, des sciences, de la politique, du cinéma, etc.
Charlotte Daban
#JulesVerne
#Amiens
#Nantes
#Littérature
#Voyage
Pour en savoir plus :
Musée de Jules Verne Nantes : http://www.julesverne.nantesmetropole.fr/home.html
Maison de Jules Verne Amiens : http://www.somme-tourisme.com/amiens-et-autres-histoires/jules-verne-dans-la-somme
Centre International de Jules Verne : http://www.jules-verne.net/index.php/le-centre

Jusqu'au bout du monde, regards missionnaires : voyage au cœur des Missions
Jusqu'au 8 mai 2022 se tiendra, au musée des Confluences, l'exposition Jusqu'au bout du monde, regards missionnaires qui choisit d'évoquer l'un des épisodes de la constitution de ses collections. L'exposition présente des objets ramenés du monde entier en les associant aux parcours de vie des missionnaires qui les ont collectés.
À l'origine, un dépôt des Œuvres Pontificales Missionnaires. Dépôt participant à la constitution et à l'enrichissement des collections du musée des Confluences. En son sein, une multitude d'objets divers rapportés par des missionnaires catholiques français partis évangéliser le monde à la fin du 19ème siècle. Avec l'exposition Jusqu'au bout du monde, regards missionnaires, le musée des Confluences choisit d'aborder la question des Missions à travers plusieurs prismes. Tout d'abord c'est là l'occasion d'interroger le rôle du musée, démarche déjà à l'origine de l'exposition Les trésors d’Émile Guimet sur la création d'un musée des religions à Lyon en 1879 par le voyageur et collectionneur du même nom, et de Dans la chambre des merveilles réinterprétant les cabinets de curiosités lyonnais.
L'introduction du parcours d'exposition revient sur la création, à Lyon, de l’Œuvre de la Propagation de la Foi en 1822, qui soutient le départ de milliers de jeunes hommes et femmes religieux vers l'Océanie, l'Asie, l'Afrique, ou les Amériques, afin d'évangéliser les populations. Celle-ci fut créée sous l'impulsion de Pauline Jaricot, qui dès l'âge de 20 ans, en 1819, imagine une collecte afin de recueillir des fonds matériels et financiers pour les Missions. Cette idée mènera trois ans plus tard à la création de l’Œuvre.

Pauline Jaricot, initiatrice de la fondation de l’Œuvre de la Propagation de la Foi
© Jean-Loup Charmet / O.P.M.
Dans le but de contribuer à attirer des soutiens mais aussi de susciter de nouvelles vocations, sont diffusés périodiquement les récits de vie des missionnaires dans un journal, les Annales de la Propagation de la Foi, rédigées et imprimées à Lyon dès 1822. Une entreprise réussie au vu du nombre de tirages important, qui témoigne d'une curiosité et d'une soif d'aventure bien réelle chez un public pour qui les Annales sont bien souvent la seule source de connaissances des cultures étrangères. Cette publication continuera en 1868 sous le nom de Les Missions Catholiques et se tournera davantage vers les aspects les plus pittoresques des pays de mission.
L'envoi à l'Œuvre de la Propagation de la Foi des objets collectés sur le terrain par les missionnaires, constitue la preuve de leur présence sur place. Ces objets étaient maladroitement exposés (en ce sens qu'ils ne bénéficiaient d'aucune mise en lumière pour être appréciés) dans le musée de l'Œuvre, dont l'une des photos de la salle est visible dans l'introduction de l'exposition, imprimée en grand format sur une cimaise. Cette photographie a d'ailleurs permis aux conservatrices de reconstituer un objet dispersé à plusieurs endroits.
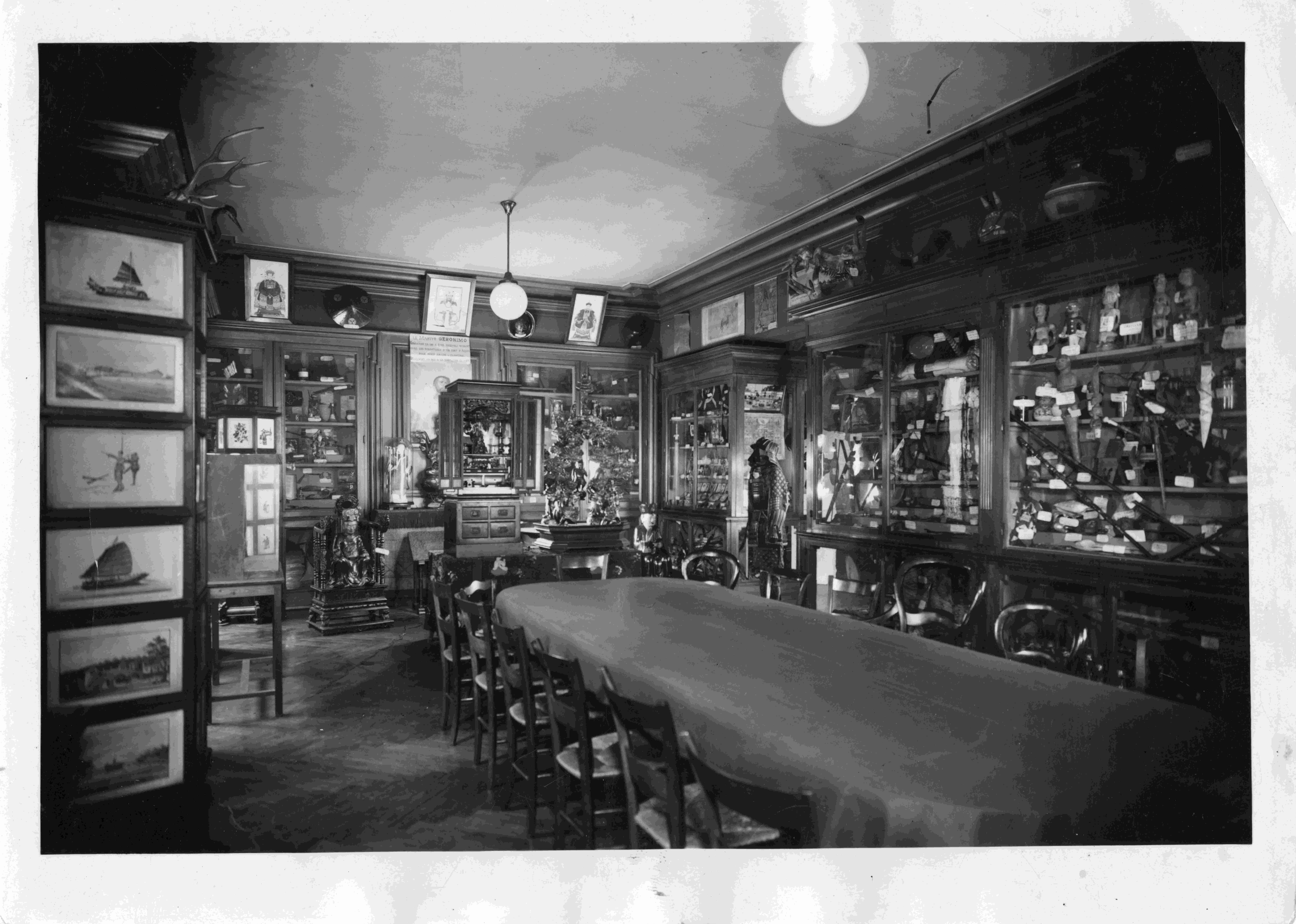
Salle du Conseil et du musée de l’Œuvre de la Propagation de la Foi, 1943
© O.P.M.

Autel funéraire familial reconstitué, butsudan
© musée des Confluences – Olivier Garcin
Une exposition riche
Une fois l'introduction passée, notre voyage expographique peut commencer. Sur le plan visuel le visiteur n'est pas déçu : le contenu est riche sans trop l'être et les objets sont attractifs. Leur variété, justifiée par la diversité des lieux de collecte et par les préoccupations des missionnaires lorsqu'ils en ont : démontrer l'état de misère religieuse dans lesquelles se trouvent les peuples autochtones, valoriser un savoir-faire, illustrer un trait culturel, ou simplement explorer un centre d’intérêt, empêchent une lassitude de s'installer.

Exposition "Jusqu'au bout du monde, regards missionnaires" au musée des Confluences
© musée des Confluences – Bertrand Stofleth
Les objets exposés sont regroupés en cinq grandes parties : quatre d'entre elles restituent simplement l'origine géographique continentale de ces derniers (dans l'ordre de visite : Océanie, Asie, Afrique et Amériques). La dernière partie réunit quant à elle des objets dont le lien entre eux est directement lisible par le visiteur : instruments de musique d'une part et maquettes de bateaux d'autre part.
La scénographie est semblable à ce à quoi le musée des Confluences nous a habitués : le tout est épuré, l'espace est sombre mais les lumières bien dirigées et assez fortes (une intensité faisant parfois défaut dans d'autres expositions du musée). L'espace entre les différents plateaux est bien calculé et les couleurs, sobres et complémentaires, mettent en valeur les expôts. Notons ici le fait que plusieurs des objets ethnographiques exposés ne sont pas sous vitrine, chose rare mais appréciable lorsqu'on peut se le permettre.

Exposition "Jusqu'au bout du monde, regards missionnaires" au musée des Confluences
© musée des Confluences – Bertrand Stofleth
Enfin, le mobilier central contenant différents audiovisuels qui restituent la parole de missionnaires, se fond dans l'espace et permet une accessibilité confortable pour une personne en fauteuil.
Plongée sonore au cœur de récits missionnaires
Si la collecte d'objets fait partie des Missions, celle-ci n'occupe cependant qu'une place secondaire dans ses objectifs. L'enjeu de l'exposition apparaît alors clairement indiqué : derrière les objets présentés, faire état du parcours de vie de certains missionnaires les ayant collectés. Ces récits sont peu connus du grand public, encore moins des plus jeunes, et participent à la restitution d'une histoire riche, même si le manque de sources pour restituer la vision des différents peuples autochtones rend le regard unilatéral (exception faite de Jean-Baptiste Pompallier, missionnaire mariste parti en Nouvelle-Zélande auquel une vidéo est consacrée). En plus des présentations de chaque missionnaire et de citations à proximité des objets présentés, l'exposition fait le choix d'incarner certains récits en les faisant interpréter par des comédiens. La sélection s'avère révélatrice d'un ensemble de faits : partir en Mission est une entreprise périlleuse, les voyages sont longs et difficiles, le missionnaire est bien souvent livré à lui-même sur un territoire qu'il ne connaît pas, aux conditions climatiques parfois très rudes (évoquons notamment Joseph Bernard parti en Alaska), parlant une langue qu'il ne pratique pas, et ayant en tête l'idée d'y finir sa vie. Si les Missions peuvent être souvent vues, dans l'imaginaire commun, comme liées à une entreprise coloniale, l'exposition permet de restituer la réalité de l'engagement missionnaire. Nous sont rapportés plusieurs témoignages de missionnaires mobilisés dans différentes parties du monde. Ainsi, Joseph Gabet et Évariste Huc, partis ensemble en 1844, nous content leur périple de 18 mois, à dos de cheval, de mulet ou de chameau, de la Mongolie jusqu'à Lhassa, capitale du Tibet. Alexandre Le Roy, premier français à gravir le Kilimandjaro, fut un défenseur du rôle scientifique du missionnaire : ses dessins, qui témoignent de cultures rencontrées et de la faune et flore observées en Tanzanie et au Gabon, sont remarquables.
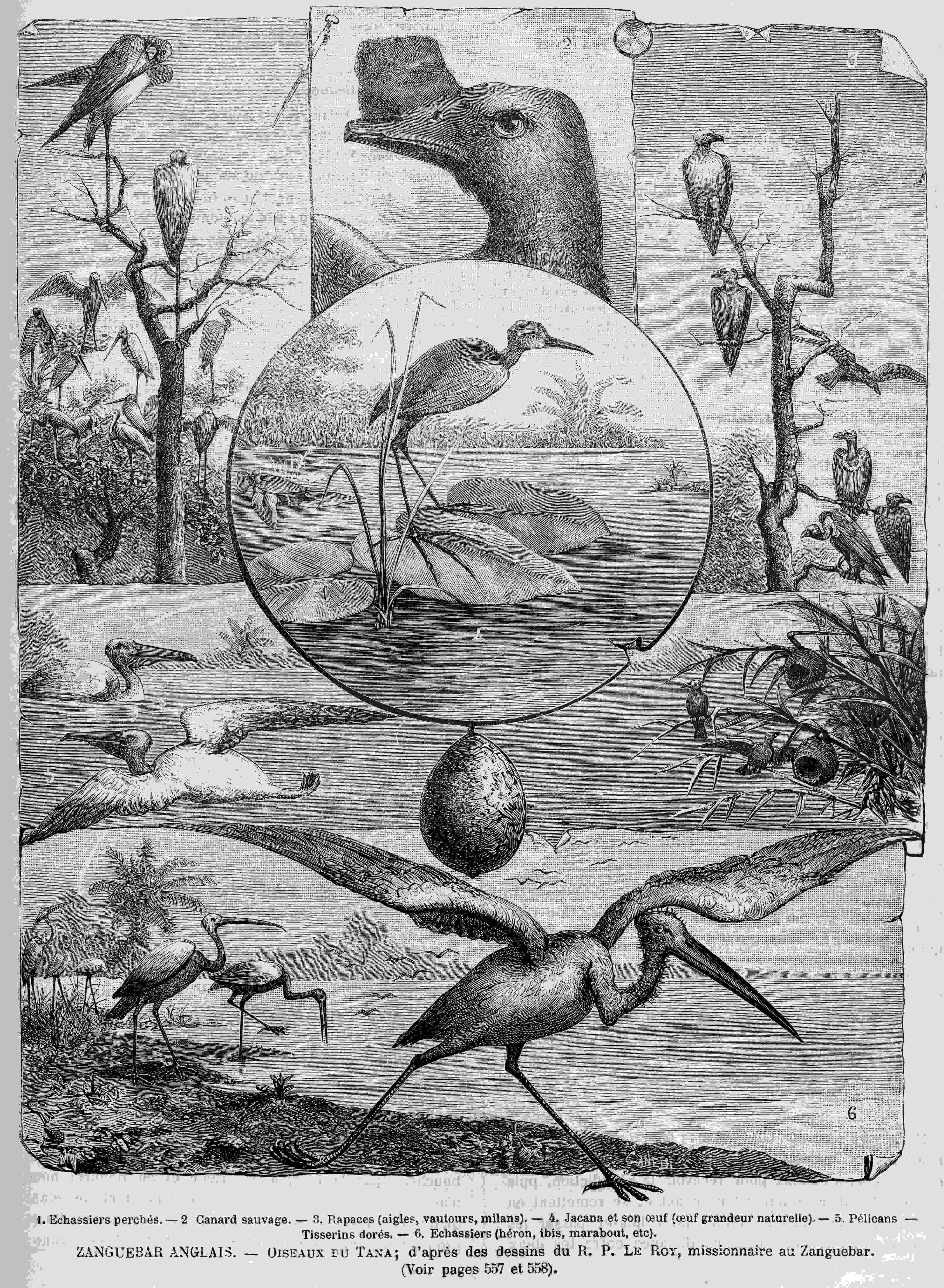
Oiseaux du Tana d’après les dessins d’Alexandre Le Roy
© Archives générales du Saint-Esprit
Enfin, Joseph Bernard, surnommé « le curé le plus proche du pôle Nord », nous parle de sa mission en Alaska, où il vécut la plupart du temps seul avec son attelage de chiens, au rythme des autochtones. L'ensemble des récits audio est illustré par des photographies d'époque ou des dessins.

Joseph Bernard avec ses chiens, St Mary's Igloo, 1910
© O.P.M.
La diversité des témoignages nous permet surtout de comprendre ce qui nous apparaît finalement si logique : le regard posé sur l'autre dépend, une fois sur le terrain, en majeure partie de la personnalité du missionnaire, bien que celui-ci soit forcément convaincu d'apporter la civilisation salvatrice à ces peuples. Missionnaires qui ont pu contribuer à la connaissance de cultures méconnues, non seulement grâce aux objets envoyés ou rapportés, mais aussi au travers de lexiques ou dictionnaires cherchant, par nécessité de compréhension et d'intégration dans une culture, à retranscrire phonétiquement des langues jusque là seulement héritées d'une tradition orale. Notons par ailleurs l'effort fait par l'exposition pour rendre compte de l'implication des femmes parties en Missions. Plus nombreuses encore que les hommes et pourtant restées peu visibles, elles partent souvent dans le but d'échapper à leur condition et leur perspective d'évolution dans leur société d'origine. Ces dernières ayant la possibilité d'accéder plus facilement à la sphère intime du noyau familial, leur mission est centrée sur le soin, l'éducation des femmes et des enfants, et la diffusion des valeurs chrétiennes.

Timbre représentant Françoise Perroton, première femme missionnaire à Wallis et Futuna
© Samuel Hense / Hans Lucas
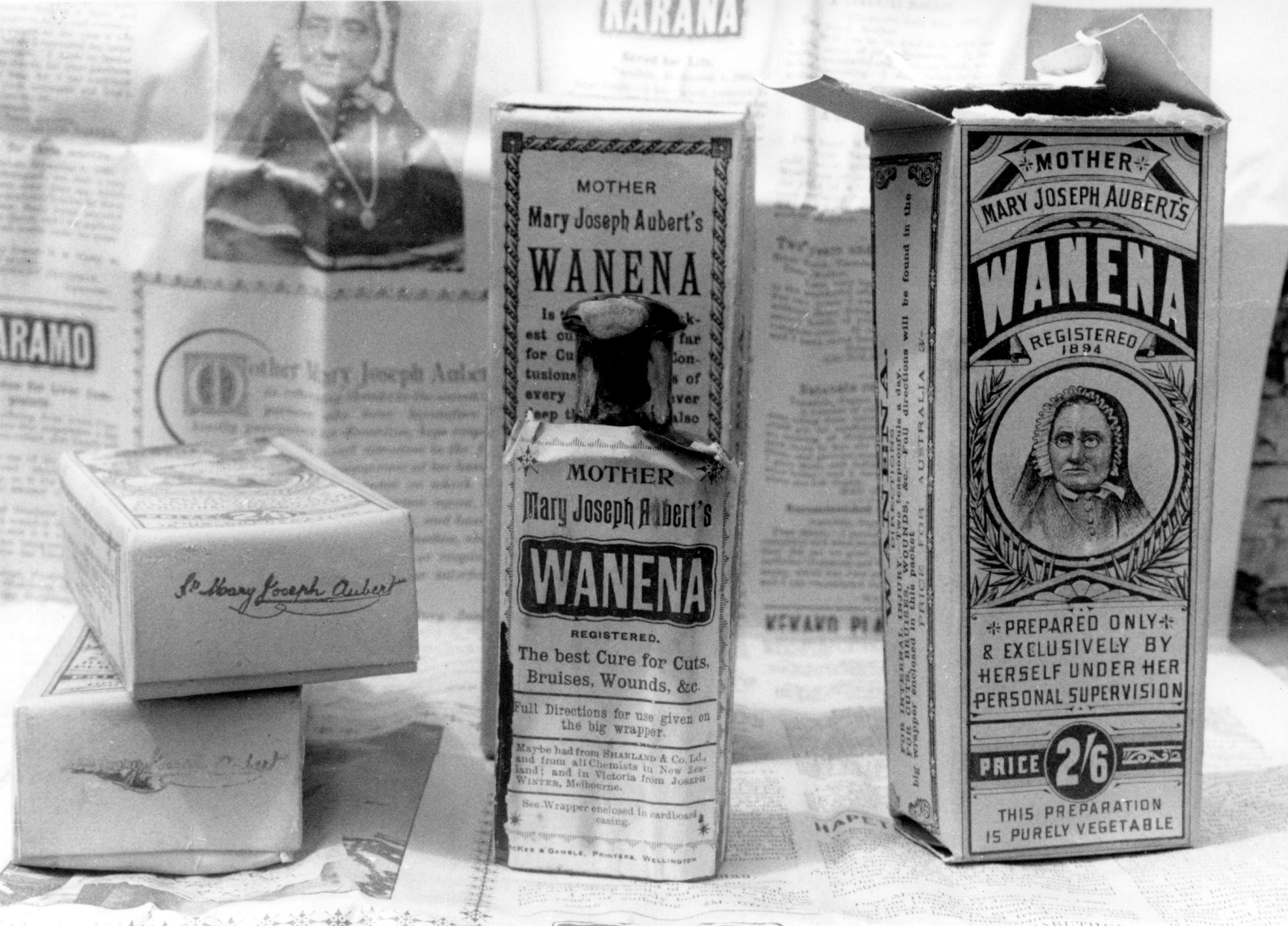
Médicaments préparés par Suzanne Aubert
© Sisters of Compassion
Une contextualisation bienvenue
Un entretien avec Claude Prudhomme, ancien professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Lumière Lyon 2, constitue le véritable cœur de la compréhension globale. Son intervention contextualise les Missions, leurs objectifs, leur fonctionnement, les difficultés rencontrées, leur lien avec la colonisation, l'évolution de leur perception dans le temps, ainsi que le changement d'axe d'observation opéré par les musées missionnaires pour s'adapter au regard de l'époque. Il nous permet ainsi d'apprendre que la mission d'évangélisation était conçue comme dépendante d'une mission civilisatrice, que l'école était au centre de ce dispositif, et que l'objectif était avant tout de former un clergé local. La question de la prise en considération de la culture locale est par ailleurs approfondie, nous permettant de comprendre qu'elle était une directive essentielle formulée par le pouvoir catholique. Le missionnaire devait être à même de pouvoir distinguer les pratiques païennes contraires à la foi chrétienne, de celles qui ne la gênaient pas, et de celles qui pouvaient y être rattachées. Un jugement qui variait bien entendu selon le missionnaire en question. Enfin, nous apprenons que la christianisation s'est diffusée et développée avec la décolonisation et non la colonisation, et parfois même dans des pays non-colonisés (la Chine par exemple). Si l'on aurait aimé voir ces informations mises plus en avant, d'autant plus lorsqu'on apprend à travers cet entretien que la collecte d'objets reste finalement très secondaire dans l'objectif missionnaire, elles restent une bonne conclusion à l'exposition.
Une exposition intéressante pour ce qu'elle est, mais aussi pour ce qu'elle pourrait ouvrir comme horizon. Un premier pas dans une histoire mal connue du grand public, et qui pourtant aurait sûrement des avantages à l'être, permettant une prise de recul bienvenue dans notre époque. En effet, si les musées sont des lieux de conservation, de recherche, et d'expositions, ils n'en restent pas moins des lieux d'ouverture vers le débat, tant ils peuvent laisser à penser. Ils ne devraient donc pas faire l'impasse, par crainte de réactions, sur des sujets dont l'influence, les répercussions, sont encore d'actualité, et qu'ils sont les rares à pouvoir aborder au détour d'un divertissement culturel pensé et non d'une flambée médiatique.
Lucas Perrus
|
Exposition : Jusqu'au bout du monde, regard missionnaires – du 18 juin 2021 au 8 mai 2022 Superficie : 250 m² Cheffe de projet : Marianne Rigaud-Roy Référentes des collections : Deirdre Emmons, Marie-Paule Imberti & Marie Perrier Scénographie : Emmanuelle Garcia & Étienne Lefrançois Graphisme : Emmanuelle Garcia |
Pour aller plus loin :
-
Claude Prudhomme, Missions chrétiennes et colonisation : XVIe-XXe siècle, Éditions du Cerf, 2004.
-
Claude Prudhomme (dir.), Une appropriation du monde : mission et missions, XIXe-XXe siècles, Éditions Publisud, 200.
-
Lien vers l'événement et podcast sur le sujet

L'ADN du street art
Des ducs de Lorraine à la culture urbaine
Quand on pense street art, et plus généralement cultures urbaines, on pense plus volontiers à New York ou Philadelphie qu’aux villes de province françaises. Et pourtant, depuis quelques années maintenant, des œuvres colorées fleurissent sur les murs des villes de toutes envergures, et des sculptures et des installations contemporaines viennent habiller l’espace public plus ou moins régulièrement. Si l’art de rue est clairement inscrit dans l’ADN de certaines villes, d’autres n’ont choisi d’explorer ce terrain que récemment : Toulouse par exemple a vu cette forme d’expression artistique se développer sur ses murs dès les années 1980, et si les premiers graffeurs ont d’abord joué au chat et à la souris avec la municipalité, la ville rose revendique aujourd’hui d’avoir été l’un des berceaux du street art français. D’autres villes ne disposent pas de cette culture de l’art dans l’espace public : ainsi, si la Cité des Ducs a accueilli quelques œuvres depuis 1988, elle n’a pour autant pas développé une grande culture de l’installation dans l’espace public1.
Les dernières élections municipales ont marqué un tournant pour le street art nancéien (notons qu’il est question ici du street art « institutionnel », et non pas de l’art de rue dans sa globalité) : le projet « Aimons Nancy - Cap sur 2020 », porté par Laurent Hénart, affirme le développement de l’art urbain comme l’une de ses priorités. La ville arbore ainsi fièrement un nombre croissant d’œuvres de street art depuis l’été 2015 : des artistes de renommée locale, nationale et internationale ont ainsi été sollicités pour habiller l’espace urbain. L’idée étant d’encourager une production artistique riche et variée, complémentaire aux propositions des musées et des galeries de la ville, qui puisse être accessible à un public plus large. En pratique, cette entreprise se traduit par la mise en place de nombreuses commandes artistiques publiques, émanant d’acteurs en lien avec la ville : certaines œuvres sont commandées par la Ville de Nancy, d’autres par la Métropole du Grand Nancy. Une installation peut également être un dépôt du FRAC Lorraine à l’initiative de la Ville, ou être le fruit d’une coproduction entre la ville et une galerie d’art. La gigantesque fresque « Giulia » réalisée en 2015 par l’artiste David Walker illustre bien le second cas de figure : c’est suite à l’invitation de la Galerie Mathgoth, spécialisée en art urbain et installée dans le XIIIème arrondissement de Paris, que le célèbre portraitiste mural s’est déplacé à Nancy. La Ville étant propriétaire du mur sur lequel a été réalisée la fresque, l’œuvre résulte d’une coproduction entre elle et la galerie.

David Walker, Giulia © Ville de Nancy
ADN : L'art à portée de rue
L’opération « ADN » (pour « Art Dans Nancy ») a pour objectif principal la création d’un musée à ciel ouvert via un parcours de street art, qui vienne compléter l’offre artistique proposée par les musées de la ville, l’idée étant d’offrir à la vue des œuvres variées qui viennent aussi bien rythmer le quotidien des Nancéiens, qu’attiser la curiosité des touristes ou des visiteurs de passage. Voici un aperçu (non-exhaustif) des types d’œuvres que les passants peuvent rencontrer en arpentant la ville.
Ces œuvres dans la ville sont de natures variées, et ne sont pas placées au hasard dans l’espace public. Une œuvre peut être le fruit de la demande d’un mécène, ou accompagner les transformations de la ville : ainsi, lorsque la rue des Ponts est devenue semi-piétonne en 2015, les artistes suisses Sabina Lang et Daniel Baumann ont réalisé « Street painting #8 », une œuvre colorée à même le sol, dans l’idée d’interroger l’architecture des lieux et de marquer la fermeture de la rue aux automobiles. Cette œuvre à l’esthétique pop permet également de créer un autre rapport à la création contemporaine, puisque les passants peuvent marcher directement sur l’œuvre et ainsi mieux se l’approprier.

Lang/Baumann, Street Painting #8 © Ville de Nancy
Ces changements dans l’espace urbain peuvent faire l’objet de plusieurs installations successives, d’ampleur grandissante : la rénovation de la place Thiers, située devant la gare, s’est accompagnée de la mise en place de modules d’exposition sur lesquels les passants peuvent observer les projets photographiques d’artistes locaux, comme le collectif Salle de Shoot ou l’artiste Arno Paul. Le changement de nom de la place, qui passera de « place Thiers » à « place Simone Veil », fait actuellement l’objet d’un appel à projet publié par la Ville, dans le but d’installer sur la place une œuvre faisant écho à l’action de Simone Veil pour les droits de l’Homme, et pour les droits des femmes.

Modules d'exposition, place Thiers © lasemaine.fr
Une œuvre peut également faire écho au patrimoine local : il en va ainsi pour le portrait monumental « Stan » réalisé par Jef Aérosol à quelques pas de la place Stanislas, créant ainsi un effet de perspective et de dialogue avec celle qui fut désignée comme étant l’une des plus belles places d’Europe. Notons que cette œuvre est, comme « Giulia », le fruit d’une commande artistique de la Ville de Nancy en collaboration avec la Galerie Mathgoth.

Jef Aérosol, Stan © Galerie Mathgoth
Enfin, les œuvres dans l’espace urbain peuvent entrer en résonance avec l’activité des musées de la ville : à l’occasion de la fermeture pour rénovation du Palais des ducs de Lorraine (le musée lorrain), la Ville de Nancy a passé commande à Julien de Casabianca. Dans un premier temps, l’artiste a été invité à découvrir les collections du musée lorrain ; il a ensuite choisi certaines œuvres, dont il a reproduit, agrandi puis collé les personnages en format géant sur les murs des bâtiments de la ville. Ce ne sont donc pas moins de vingt personnages des collections du musée lorrain qui ont été « libérés » dans la ville ; l’idée de faire de la ville un musée à ciel ouvert prend alors tout son sens.
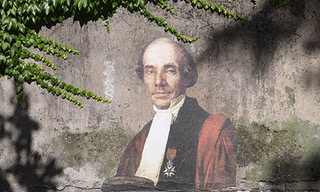
Julien de Casabianca, Outings © Nancy Tourisme Info
Quelles médiations autour de ces oeuvres?
Cette opération s’axe sur trois points principaux :
- Le développement d’un parc d’installations urbaines pérennes, grâce à l’acquisition d’œuvres par la Ville (ou la Métropole),
- La programmation évènementielle sur l’espace public, en lien avec le parcours street art mis en place dans le cadre de l’opération,
- La médiation et la communication autour des œuvres, le travail en direction des publics et la valorisation et l’entretien de l’existant.
La question de la médiation autour des œuvres placées dans l’espace public est toujours délicate. C’est pourquoi le département des publics de la Direction Nancy-Musées propose une initiation à l’art urbain via la conception d’un parcours street art, à réaliser en visite libre ou en visite guidée, permettant de découvrir les œuvres installées dans les principaux quartiers du centre-ville. Le service des publics met également à disposition un dossier pédagogique, facilement consultable sur internet, détaillant la carrière des artistes, l’historique et la signification des œuvres et les techniques employées pour les réaliser. Des distributeurs de dépliants « ADN » sont placés à des endroits stratégiques de la ville (des lieux de passage), afin que chacun puisse avoir aisément accès aux informations nécessaires pour comprendre et apprécier le projet mis en place par la collectivité.
Au final, les projets de cet acabit présentent de nombreux avantages pour les villes, parmi lesquels ceux de rajeunir leur image, et de permettre une approche différente de l’art pour les habitants, et d’insuffler une nouvelle dynamique au tourisme : les parcours que composent les œuvres permettent aux visiteurs de passage dans la cité des ducs d’arpenter les différents quartiers de la ville à la recherche des œuvres, découvrant ainsi les lieux et monuments phares de la ville le temps d’une escale. A Nancy, les graffiti outdoor font écho à des œuvres placées dans les musées : ainsi l’anamorphose de Felice Varini s’invite dans le parcours permanent du Musée des Beaux-Arts, créant un pendant aux personnages de Julien de Casabianca tout droit sortis des réserves pour s’en aller arpenter les ruelles de la ville.

Felice Varini, Anamorphose © Jason Whittaker sur Flickr
Solène Poch
#streetart
#nancy
#insitu
1. Propos de Pierre Mac Mahon, Pôle Culture et attractivité, direction des affaires culturelles, Services « Arts visuels » et « Art dans la ville » (ville de Nancy)
Sur l’opération ADN et les œuvres

L'effet de groupe dans les expositions
Trois histoires de visite
L'esprit du lieu, un ingrédient décisif

Edouard Manet, Un bar aux folies bergères , 1881-1882, Courtauld Galler
Soudain, une personne en bouscule une autre, et il devient plus difficile de s’approcher de Suzon, derrière son bar aux folies bergères. La relation tissée auparavant est semblerait-il parasitée, les salles de la Fondation Louis Vuitton attirant une foule plus conséquente. Plus de grincement du bois au sol, les salles historiques sont devenues plus lisses. Les œuvres sont pourtant bien là, à l’occasion de l’exposition Le parti de l'impressionnisme (2019), mais la magie qui pouvait s’opérer dans leur résidence britannique semble s’être évaporée dans l’atmosphère parisienne.
La contrainte, ennemie de l'exposition
Intérieur du château de Versailles, avec le parcours contraint © Jade Garcin
Emporté.e.s par la foule
Largement attendue de par son ouverture repoussée au 1er juillet 2020 et sa présence en ligne dès la fin du printemps promettant une expérience monumentale, l’exposition Pompéi au Grand Palais se devait être une immersion dans la ville romaine, avant et pendant l’éruption du Vésuve. L’on rêve alors de déambuler dans les rues animées de Pompéi, découvrir ce qu’il se cache dans chacune des habitations et chacun des commerces ouverts de chaque côté de l’allée centrale, où s’y trouvent des objets de collections. La réalité est néanmoins bien éloignée de ces promesses. Après avoir patienté un long moment à l’extérieur du musée, il faut encore se montrer patient.e dans la salle d’exposition. Les espaces latéraux sont eux aussi soumis à une file d’attente, telles des attractions dans un parc, si bien que même avec la meilleure volonté, l’on ne les visite pas. Ici, et contrairement à l’exemple cité précédemment, c’est bel et bien l’affluence qui brise l’illusion qui était pourtant souhaitée par les concepteurs de l’exposition, nous laissant alors sur notre faim, tant du côté de l’expérience que des connaissances que nous n’avons pas pu ne serait-ce qu’approcher.
Une file d’attente pour accéder à un espace de l’exposition, bloquant la circulation © Jade Garcin
Trois visites en valent mieux qu'une ?
L’expérience que l’on vit lorsque l’on pénètre dans une exposition est alors pleinement liée à celles et ceux avec qui on la partage, qu’ils soient des inconnus, en majorité, mais aussi des proches, dont nous ne parlerons pas dans cet article. Nos vies et les expositions sont faites de telle sorte que nous voulons profiter de chaque information, découvrir chaque œuvre présentée. Une exposition est pensée comme un ensemble, ou le discours est développé de la première salle à la dernière et où chaque objet de collection présenté est censé répondre aux autres, créant ainsi du sens. Mais n’est-ce pas également une conséquence de ce besoin “d’en avoir pour son argent” ? Le foisonnement des expositions communément appelées blockbuster participe par ailleurs à une appréhension différente de ces dernières, relevant davantage de l’événement auquel il faut avoir assisté, ayant pour conséquence une affluence démesurée, que de l’expérience sensible et personnelle.
Se plonger dans deux ou trois œuvres, puis revenir plusieurs fois dans une exposition, permettrait une toute autre expérience, mais n’est malheureusement pas possible pour nombre des visiteurs. En effet, la question du temps, mais aussi financière, entre en jeu. Une entrée dans un musée tel que le Louvre peut monter jusqu’à 17€, représentant alors le budget que l’on peut envisager pour deux séances de cinéma, mais certainement pas pour - seulement - deux peintures ou sculptures. La priorité pour les musées, à l’heure actuelle, ne serait-elle alors pas de repenser le rapport aux œuvres, les liens sociaux créés au sein même des expositions ainsi que l’influence de l’effet de groupe, bien avant de chercher le spectaculaire ou l’inédit ?
Jade Garcin
*été 2016, soit bien avant la crise sanitaire
#fréquentation
#blockbuster
#expérience
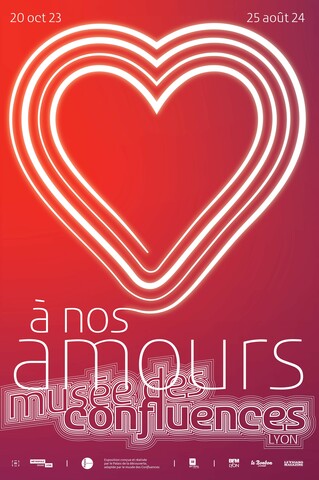
L'exposition « À nos amours » du Musée des Confluences : aurez-vous le coup de cœur ?
Ouverte depuis le 20 octobre 2023 jusqu'au 25 août 2024, le Musée des Confluences de Lyon propose de découvrir « À nos amours », une exposition qui fera chavirer les cœurs.
Affiche de l’exposition © Musée des Confluences
Une multitude de manières d'aimer au sein d'une scénographie immersive
Aborder les différentes formes d'amour, de manière physique, sociologique et culturelle ; c'est le but de cette exposition. Adaptant l'exposition "De l'amour" qui s'est tenue au Palais de la découverte à Paris en 2019-2020, le Musée des Confluences permet aux visiteurs de découvrir l'ambivalence et l'universalité du sentiment amoureux, seul ou à plusieurs.
La scénographie plonge le visiteur dans une expérience émotionnelle, dès l'entrée. Avec une succession de passages en forme de cœurs et un fond sonore reprenant des mots d'amour dans diverses langues rythmé par des battements de cœur, le visiteur est immédiatement immergé dans l'essence même du sujet. À la suite de cette entrée, le visiteur accède à une place centrale. Celle-ci relie les différentes thématiques abordées au sein de l'exposition. La déambulation est voulue libre : les rencontres et les échanges sont possibles. Les différentes alcôves se répondent les unes aux autres, tout en étant indépendantes.
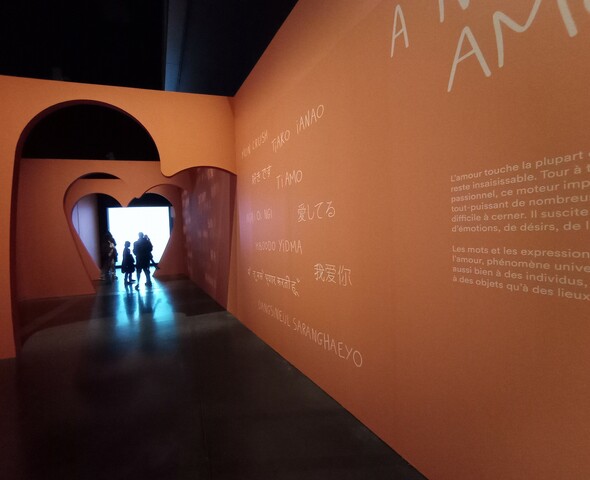
Entrée de l’exposition © Gaëlle Magdelenne
De l'amour mère-enfant à l'amour virtuel, la possibilité pour le visiteur de s'interroger sur l'amour qu'il reçoit et celui qu'il transmet
Avant d'accéder à la place centrale, le visiteur peut passer par un espace qui définit ce qu'est l'amour de manière plurielle grâce à un film d'une vingtaine de minutes. Suite à cette introduction qui peut paraître longue, le visiteur choisit le sens de sa visite à partir de la place centrale. Il a le choix entre différentes thématiques : comment définir l’amour ; se replonger dans ces premiers amours avec les liens unissant un enfant à ses parents ; s'interroger sur l'amour que l'on peut éprouver pour les autres et envers soi-même ; comprendre les manifestations corporelles de l'amour et parler de la sexualité humaine ; voir la multiplicité des rencontres amoureuses au cours de nos vies et l'importance de garder le lien. Une alcôve permet de découvrir la vision de l'amour au travers de contes d'autres cultures, élargissant ainsi la vision occidentale à d'autres manières d'exprimer et ressentir l'amour.
L'exposition permet même de déplacer notre perception : ce sentiment est-il présent chez d'autres espèces animales et les nouvelles technologies engendrent-elles une nouvelle définition de l'amour ?
Une exposition qui se découvre seul ou à plusieurs
La majorité des espaces contient des médiations participatives et interactives. Ces dispositifs permettent de s'imprégner des connaissances : passant du dispositif vidéo à la manipulation tactile et aux jeux ludiques, seul ou à plusieurs. L'alcôve développant « L'amour pour tous » permet, grâce à des miroirs et des citations, une interaction avec soi. Dans ce même espace, une tablette pose des questions auxquelles répondre seul ou à deux. L’objectif est de pouvoir mesurer son empathie.
Au sein de l'alcôve “Hymne à l’amour”, les couples ont la possibilité de jouer à un dispositif (1) qui consiste à deviner la réponse de leur partenaire en fonction de celle qu'il ou elle aura donnée. Cela met en avant les preuves d’amour. Un autre dispositif, numérique (2), projette des échanges écrits entre deux personnes. Ce dispositif s’appuie sur le travail de Morgane Ortin, autrice et créatrice du compte @amours_solitaires sur Instagram. Le visiteur peut décider du type d'échange entre les deux personnes et ainsi montrer les nouveaux codes sociaux.
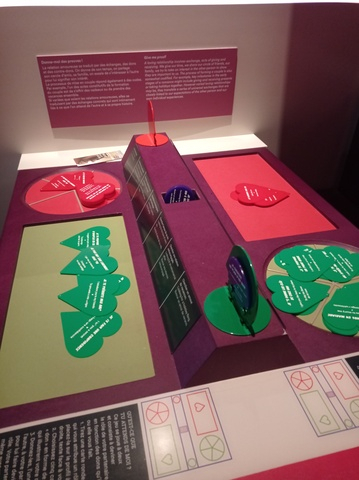
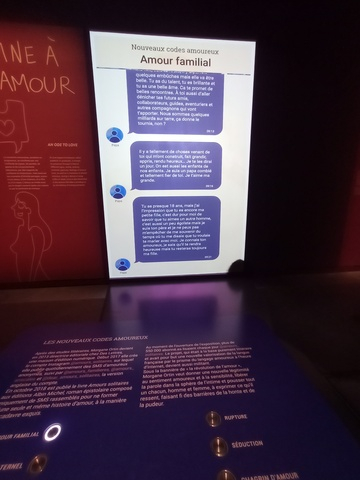
Exemples de dispositifs de médiation (1 et 2) © Gaëlle Magdelenne
Dans cette même alcôve, un espace de bal avec un juke-box vintage et un écran diffusant des clips de musique invitent les visiteurs à effectuer quelques pas de danse, afin de reproduire certains codes de séduction de différents pays.

Espace de bal © Gaëlle Magdelenne
Cette exposition riche en informations et en dispositifs, vécue en solitaire ou en groupe, propose une scénographie immersive. Le parcours libre donne l'occasion aux visiteurs de circuler, tester et manipuler les différents outils de médiation. Comme l’amour est familier aux visiteurs, que ce sentiment reste subjectif et multiple, c’est l’opportunité de découvrir d’autres manières d’aimer.
Gaëlle Magdelenne
Pour en savoir plus :
- Site de l’exposition : https://www.museedesconfluences.fr/fr/expositions/expositions-temporaires/nos-amours
#exposition #MuséedesConfluences #amour

L’Odyssée muséale
A l’occasion de la 25e Conférence générale de l’ICOM, qui se tiendra à Kyoto en septembre 2019, un appel à contribution a été lancé en mars dernier pour repenser la définition du musée. Le parfait prétexte pour s’interroger sur la nature du musée, tel qu’il était à ses débuts antiques et tel qu’il se veut 2500 ans plus tard… Avaient-ils tout compris jadis ?
Si la définition actuelle du musée place l’acquisition et la conservation des objets en tête de ses missions, il n’en a pas toujours été ainsi. Dans l’Antiquité classique, des biens précieux sont effectivement rassemblés auprès des temples, et bien qu’ils soient destinés aux dieux, ces trésors composés de donations et d’ex-voto, étaient exposés à la délectation des pèlerins et touristes. Ces temples-musées témoignent de l’affection des sociétés pour les beaux objets, et plus encore s’ils sont chargés d’une symbolique religieuse ou spirituelle. Or, si l’on vient aux temples, c’est avant tout pour rencontrer les entités divines qu’ils abritent et qui inspirent des générations d’artistes et de curieux.
La naissance des Mouseîon
Les mères du musée sont en effet les Muses, déesses grecques des arts, que l’on célèbre dans les Mouseîon, temples qui leur sont consacrés. Il existe neuf déesses personnifiées pour neuf arts antiques.
Calliope, muse de l’éloquence distinguée par son goût pour la poésie épique, tandis que sa sœur Erato préfère la poésie lyrique,
Melpomène et Thalie, respectives muses du théâtre tragique et comique,
Euterpe et Terpsichore inspirent elles la musique et la danse,
Polymnie est la muse de la rhétorique et du chant, grâce auquel sa sœur Clio raconte l’histoire,
Et enfin Uranie, muse de l’astronomie, dont l’homonyme n’est autre qu’une planète.

Parnassus, Anton Raphaël Mengs
Ces muses sont des sources d’inspiration pour les poètes, artistes, dramaturges et scientifiques. Elles sont les descendantes de Zeus et Mnémosyne, la déesse de la Mémoire. Nous comprenons mieux le lien solide qui unit les musées, les arts et la mémoire. Le « musée » est la colline où elles chantent, dansent et jouent, sur l’Hélicon, non loin de leur Olympe natal. Le Mouseîon est le lieu terrestre où l’on convie les vivants à célébrer tous les arts.
Cette conception du musée s’exporte en Egypte, avec le Mouseîon d’Alexandrie, fondé par le roi Ptolémée Ier en 280 avant J.-C. Il se situe dans l’enceinte de son palais et c’est un lieu consacré aux arts et à la recherche, vitrine des richesses intellectuelles de l’Egypte. C’est tout à la fois un laboratoire, observatoire astronomique, jardin botanique, parc zoologique, institut de recherche, bibliothèque, réfectoire et salle de colloques… Le musée accueille les savants qui travaillent ensemble à la production de savoirs et à sa diffusion au travers de conférences. Il se pense comme un lieu vivant d’invention plutôt que de conservation, l’exception étant la fameuse bibliothèque d’Alexandrie. Sa politique d’acquisition n’a rien à envier aux pratiques actuelles. Chaque navire qui mouillait à Alexandrie était tenu de laisser ses manuscrits le temps d’une copie, pour être stockée à la bibliothèque. Cette démarche impressionnante a fait de ce lieu un temple du savoir universel où s’accumulait quelques 700.000 rouleaux de parchemins.
La culture pour tous… mais si affinités !
La description des musées antiques ne sonne-t-elle pas étrangement familière à nos oreilles contemporaines ? Depuis plusieurs dizaines d’années, le musée est en réinvention permanente, cherchant le rôle qu’il doit jouer dans un monde capitaliste où les richesses matérielles supplantent les œuvres de l’esprit.
Un des éléments les plus marquants dans l’histoire des politiques muséales actuelles est d’abord l’accent mis sur la démocratisation culturelle. Le premier pas en ce sens a été franchi dans les années soixante, sous l’impulsion du tout premier Ministre des Affaires culturelles, André Malraux. La politique mise en place à cette période avait pour but de permettre un plus grand accès des citoyens à la culture, au travers notamment de la création de Maisons de la Culture. Ces lieux ont pour vocation de faire se rencontrer les individus et l’art dans toutes ses formes, sans autre support de médiation.
« La confrontation qu’elle suscite est directe, évite l’écueil et l’appauvrissement de la vulgarisation simplificatrice […] La première forme de ce qu’on appelle d’ordinaire, par un mot d’ailleurs magique, « l’initiation » aux arts est une rencontre intime. » nous dit Pierre Moinot, conseiller d’André Malraux.
Cette tentative maladroite d’éveiller l’individu à l’art par une rencontre directe et crue n’a pas eu le succès escompté. La démarche engagée nous permet néanmoins de réfléchir à deux choses. La première est que la culture doit être accessible à tous sans distinction de classe sociale, c’est un bien commun qui appartient à la société dans son ensemble. La seconde est que l’appréhension de la culture ne va pas de soi, et nécessite un recours à des médiations de diverses natures, ainsi qu’à une prise de distance par rapport aux objets.
Des musées-temples aux musées-spectacles
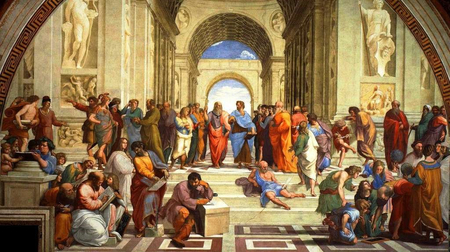
L'École d'Athènes, Raphaël
Certains musées ont fait de la distanciation vis-à-vis des objets le principe même de leur établissement, comme les centres d’interprétations, même s’ils se cantonnent encore à des champs réduits de la muséographie. Une démarche décentrée des objets encourage forcément à rechercher d’autres modes de médiations, davantage tournés vers l’humain et conçus spécifiquement pour illustrer le discours, en contrepied d’une logique inverse où le discours est au service de l’objet. Et quels objets ? Les musées brillent au travers des chefs-d’œuvre qu’ils recèlent et conservent parfois jalousement. Mais en termes de culture matérielle, une canette de soda n’est-elle pas plus représentative de notre société que le plus beau joyau qu’elle pourrait produire ?
Le musée du 21e siècle ne peut plus se contenter d’être le dépôt des œuvres de l’humanité. Sa fonction éducative et divertissante est à réaffirmer, à la manière des musées américains qui associent aisément l’entertainment à l’activité pédagogique et proposent une diversité de pratiques culturelles. Plutôt que des « musées-temples », le nouveau paradigme est aux « musées-spectacles », lieux de recherche et de loisirs transdisciplinaires, dans lequel la course aux trésors n’a plus lieu d’être. Dans mon musée imaginaire, il n’y a pas d’objets, seulement des individus, acquittés des considérations de temps et d’argent, qui échangent ensemble dans un lieu de vie conçu avec eux et pour eux.
Bref, tout un art… de Muser !
Laurie Crozet
#ICOM2019
#Antiquité
#Muséeimaginaire
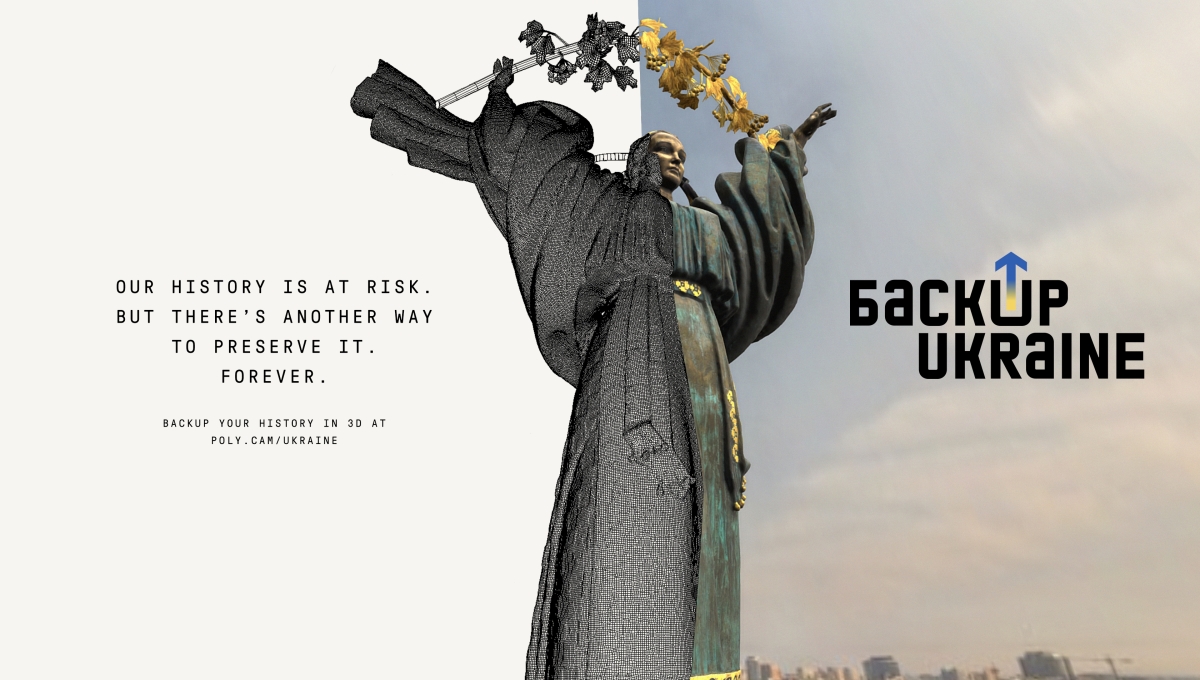
La 3D, à la rescousse du patrimoine ukrainien
Patrimoine. Culture. Victime, elle aussi des conflits. "Le moyen le plus rapide d'effacer l'identité nationale d'un peuple est de détruire son patrimoine culturel » disait Tao Thomsen, directeur créatif de Virtue Worldwide et co-créateur de Backup Ukraine.
Image de la campagne Backup Ukraine © Polycam and the BackUp Ukraine project
Éviter que son patrimoine ne parte en fumée, disparaisse sous les bombardements russes et pouvoir le transmettre aux générations futures, voilà ce qui a motivé le projet Backup Ukraine, traduit par la sauvegarde de l’Ukraine. Le projet a dû se mettre en route rapidement pour garder la mémoire des lieux car au 27 mai 2022, c’était déjà selon le ministère Ukrainien : « 367 crimes de guerre contre le patrimoine culturel du pays […], dont la destruction de 29 musées, 133 églises, 66 théâtres et bibliothèques et un cimetière juif centenaire ».
Une initiative participative
Backup Ukraine initié par l’agence VICE, Virtue Worldwide en avril 2022 s’est associée à Blue Shield Danemark, un organisme visant à protéger les sites culturels, et à la Commission nationale danoise pour l’UNESCO. Ce projet est mené en étroite collaboration avec l'initiative de sauvetage d'urgence du patrimoine ukrainien et le Musée national de l'histoire de l'Ukraine. Il s’agit d’une archive numérique qui a pour but de recenser le patrimoine matériel ukrainien grâce à des modélisations 3D.
Le temps pressant, l’outil a été développé de manière à ce que tous les Ukrainiens volontaires ayant un smartphone puisse apporter leur pierre à l’édifice via une application nommée Polycam.Celle-ci est mise à disposition pour le projet par ses développeurs qui sont également partenaires. Pour prendre part à cet appel à participation, les volontaires remplissent un formulaire pour recevoir une autorisation des autorités ukrainiennes. L’usage de la technologie ne s’est pas encore répandu, la plateforme compte entre 30 à 50 participants actifs en août 2022, soit 6000 contributions, ce qui est compréhensible au vu de la situation : en avril 2022, un ukrainien sur six a dû fuir son foyer et cinq millions ont quitté leur pays selon les Nations Unies.
Cet outil repose sur la photogrammétrie, ou technologie LiDAR consistant à créer des modèles 3D détaillés à partir de plusieurs photographies, prises sous différents angles. Cette technologie prend en compte un calcul de distance et de taille de l’objet pour assembler les images et former un modèle. 100 à 250 images, voilà le prérequis pour concevoir une représentation 3D réaliste. Le surplus contribue à améliorer la qualité et la précision des conceptions. Pour aider les volontaires à réaliser ces captures, l’application propose un tutoriel, tout en invitant les usagers à ne pas se mettre en danger.
Les numérisations sont liées à un emplacement qui est automatiquement retranscrit dans la base de données de l’archive, à l’abri des bombardements. Les numérisations sont sous licence Creative Commons 4.0 et seront partagées avec l’UNESCO et les musées partenaires du Blue Shield. Le site Polycam recense les scans, ainsi qu’une carte permettant de situer les lieux numérisés, contribuant ainsi à l’efficacité du projet et limitant les doublons.
Le projet a pris de l’ampleur grâce à l’accessibilité de l’application, ce qui a favorisé, en parallèle de la numérisation des objets de musées et du patrimoine matériel ukrainien, la préservation d’objets moins monumentaux, des objets du quotidien, ordinaires mais importants dans la vie des habitants et leur histoire. Le choix des objets numérisés pose donc la question de ce qui est important culturellement pour la population.
Au-delà de documenter les objets culturels, Polycam est également utilisé pour rendre compte de la destruction des monuments, et des objets culturels pendant la guerre.
Une sauvegarde difficile de sites
Les bâtiments d’envergure sont plus difficiles à reconstituer, et leur numérisation est donc moins réalisable par la population civile puisqu’il faut se munir d’un drone, ceux-ci n’étant pas toujours autorisés, surtout en temps de guerre.

Scan 3D de l’Église de Pyrohochtcha, à Kiev, construite à l’origine en 1132 © Polycam, the BackUp Ukraine project, Courtesy Maxim Kamynin / Licence : Creative Commons 4.0
Il s’avère que la modélisation des surfaces brillantes et transparentes est également compliquée, puisque ces textures sont difficilement interprétables par l’algorithme de l’application.
Au-delà du côté technique, la photogrammétrie en lieu de confit est dangereuse et donc peu praticable dans les points centraux comme Kiev qui regroupe un certain nombre de lieux culturels majeurs du pays comme la cathédrale Sainte-Sophie classée à l’UNESCO.
A terme, en fonction de la qualité des modélisations, celles-ci pourront être utilisées à des fins de reconstruction, notamment celles des sept sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO pour leur importance culturelle et donc en théorie protégés par la loi. Les modèles peuvent également donner matière à des projections dans un espace physique ou fictif notamment via la réalité virtuelle et la réalité augmentée permettant d’explorer le lieu, à défaut de pouvoir le reconstruire.
Des initiatives qui se multiplient
L’Ukraine n’est pas la seule à avoir lancé des initiatives dans ce sens, celles-ci se développent dans les territoires en conflit comme la Syrie où une quinzaine de chercheurs syriens accompagnés de la start-up française Iconemont été formés à la photogrammétrie. En février 2015, en Irak, l’artiste iranienne Morehshin Allahyari s’est engagée dans la reproduction en impression 3D des sculptures détruites à Mossoul par les djihadistes de Daech. La 3D permet ainsi d’envisager une autre voie contre la destruction et l’oubli engendrés par la guerre.
Loona
Pour en savoir plus :
- https://poly.cam/ukraine
- https://www.instagram.com/backup_ukraine/?hl=fr
- https://edition.cnn.com/style/article/ukraine-uses-3d-technology-to-preserve-cultural-heritage/index.html
#GUERRE UKRAINE
#SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
#NUMÉRISATION 3D
La bière exposée
La bière. Ce liquide aux teintes chaleureuses, au parfum enivrant, à la douce âpreté, aux reflets flous et aux calories infinies. A dire vrai, outre d’irréductibles frileux, elle semble mettre tout le monde d’accord.
La bière. Ce liquide aux teintes chaleureuses, au parfum enivrant, à la douce âpreté, aux reflets flous et aux calories infinies. A dire vrai, outre d’irréductibles frileux, elle semble mettre tout le monde d’accord. Cette boisson ancestrale qu’on dit créée par Dieu comme témoignage de son amour pour l’Homme a fait ses preuves depuis bien longtemps. Comment, à son évocation, ne pas se rappeler une soirée trop arrosée, une rencontre fortuite dans un bar, un artefact ponctuant les retrouvailles amicales voire, pour les plus chanceux, un rafraichissement apprécié à la cantine … ? Ne laissant personne indifférent, son omniprésence traduit son appréciation commune. Dès lors, comment pourrait-elle échapper aux musées ? Si certains l’exposent, l’exercice n’en est pas plus évident du simple fait qu’elle semble familière et proche.
© E. L.
Des angles d’approches fréquents
En effet, le thème même sollicite les souvenirs d’expériences propres, ramène à des moments inédits, partagés ou solitaires, rappelle des réflexions animées ou divagantes. Cela, notamment, en fait naturellement un support privilégié pour l’ethnographie, l’anthropologie ou le traitement du patrimoine immatériel à travers sa consommation. Si dans l’événementiel autour de la bière se succèdent, aussi banalement qu’efficacement, maintes brasseries et dégustations, le musée a lui aussi du mal à s’extirper d’angles d’approches déjà exploités. Mais la bière et son utilisation, englobant mille et une problématiques et autant de secteurs –ivresse, religion, genre, écologie, économie, cosmétique, …-, se voient généralement réduites au prisme de son histoire et fabrication.
A travers lui, une distance s’installe entre le public et ce breuvage qui semble finalement plein de mystère. Ce n’est pas pour refroidir les amateurs qui se montrent alors avides de connaissances et souhaitent les compléter ou parfaire leurs expériences prochaines. Aussi, ce regard sur son évolution et sa mise en œuvre peut être adjoint de découvertes savoureuses en début ou fin de visite, le public étant amené à apprécier l’infime partie d’un panel de bières que l’on sait bien plus nombreuses.
Visitons donc trois musées de la bière.
© E. L.
Un musée européen de la Bière, le Musée de Stenay
Il est intéressant de constater que le Musée européen de la Bière qu’est le musée de Stenay, créé en 1986, propose lui aussi une approche historique, qu’il s’agisse de présenter la fabrication de la bière ou sa communication publicitaire, permettant cependant d’aborder les thématiques de la convivialité, de la femme, des approches sociologiques …, et ce au prix de 5€ par personne. Si cet angle d’attaque est aujourd’hui très répandu, il s’agit peut-être du musée le plus légitime à l’aborder. Cela découle en partie du fait que l’initiative de sa création vient d’un regroupement d’archéologues stenaysien au nom explicite : le « Groupement Archéologique ». Sont alors présentés, au rez-de-chaussée, le bâtiment et son investigation en tant que musée de la bière.
A l’étage, l’exposition débute par un rapide et sensoriel parcours sur ses ingrédients et leur place dans le processus de fabrication. Pour le reste sont présentés ses différentes techniques et matériaux ainsi que leur évolution au cours du temps. Le tout aboutit, en fin de visite, à une exposition temporaire voire une dégustation à la Taverne associée au musée. D’importants et pertinents dispositifs de médiation sont mis en place, témoignage d’une véritable démarche non-négligeable. Le musée s’adresse de manière privilégiée aux scolaires de tous âges en leur proposant des ateliers ludiques sur les constituants tels que les épices, ou encore des ateliers autour de la prévention. Il est à noter que la visite guidée, optionnelle, est un véritable avantage et permet de mieux appréhender les discours du circuit muséal tout en les agrémentant d’informations supplémentaires.
© E. L.
Bière qui mousse amasse foule
Evidemment, de son côté la Belgique peut se targuer d’avoir à son compte de multiples Biermuseums. Peut-être avez-vous déjà eu l’occasion d’entendre un belge s’exclamer fièrement « Ah ça, en matière de bière et de chocolat, on a un bel assortiment ! ». Bière et chocolat, un duo à la mode dans les dégustations. Il devient nécessaire de mettre en exergue cette spécificité aux multiples expressions. Malgré tout, l’engouement naturel pour ce breuvage peut-il amener à survoler avec une certaine facilité ? Le Belgian Beer Musuem de Bruxelles peut laisser perplexe. Idéalement situé au bord de la Grande Place, dans un quartier éminemment touristique, il propose un espace très réduit au-delà d’une belle devanture. Celui-ci se divise principalement en deux parties.
La première sert d’espace de dégustation dans lequel règne en maître l’association de brasseurs. La seconde est un espace d’exposition où sont succinctement abordées les questions de fabrication (par le biais de suspensions murales explicatives) et d’histoire et distinctions de bières (par le biais d’une projection filmographique au support écrit en trois langues, dans des tailles de caractère et couleurs différentes pour chaque mot, rendant la lecture périlleuse). L’entrée comprend la dégustation finale de la bière du musée à table, dont les propriétaires ont d’ailleurs du mal à parler, si ce n’est préciser qu’elle est blonde.
L’exposition devient-elle prétexte, sachant que « bière qui mousse amasse foule » ? Qu’en est-il du but non-lucratif des musées ? Si certains se contentent de cette présentation au coût de 5€ (même prix d’entrée que celui du musée de la bière de Stenay …) en profitant pleinement de leur séjour bruxellois, la majorité du public se sent lésée et en garde un goût amer venant accentuer celui du rafraîchissement.
© E. L.
Une vision plus polymorphe
Certains musées, comme le Biermuseum de Bruges, s’écartent cependant de ces chemins tous tracés. Profitant lui aussi d’une position géographique avantageuse en plus d’un thème évocateur, il ne néglige cependant pas son contenu. Il est tout-de-même à noter que le lieu, exploitant plusieurs étages, dispose également d’un bar au-dessous des étages d’exposition. Aussi, s’il est possible de visiter le musée avec (15€ l’entrée comprenant 3 « tastings » de 15cl) ou sans forfait dégustation (9€), il n’est cependant pas nécessaire de faire la visite pour accéder à l’espace comptoir.
Toujours est-il qu’ici, les séquences de l’exposition permanente sont variées et permettent une vision plus riche. Evidemment, la fabrication et les matériaux sont abordés, mais également la place de la femme, le rapport à la nourriture, les distinctions de productions, ainsi que bien d’autres approches. Le parcours est moins limité au niveau des catégories (bien que l’exhaustivité soit inconcevable) en plus d’être particulièrement ludique. Une tablette à réalité augmentée et son casque sont mis à disposition du visiteur pour l’accompagner dans sa visite. Celui-ci doit fixer des expôts pour que des éléments explicatifs s’affichent sur son écran.
Globalement, il peut choisir d’approcher un sujet par le biais de l’image, du son, ou du texte, pouvant même combiner ces trois médias. Vingt petits quizz sont également présents dans le parcours, parfois évidents, parfois plus dissimulés, invitant le public à un véritable jeu basé sur des questions de connaissances incongrues sur le thème de la bière. La densité d’informations, pour une exposition aux intentions d’envergure, a néanmoins tendance à épuiser le visiteur qui peut finir par délaisser son support multimédia et perdre le reste des contenus.
© E. L.
Les expositions permanentes ne sont pas les seules à s’attarder sur ce sujet. Si elles ont tendances à l’approcher bien souvent de la même manière, les expositions temporaires, elles, peuvent prendre de la distance vis-à-vis de ces carcans. Les lectures nouvelles et innovantes y trouvent peut-être plus facilement leurs places. L’exposition temporaire « Bistrot ! De Baudelaire à Picasso », de la Cité du Vin à Bordeaux, présente des œuvres artistiques plutôt que des expôts ethnographiques pour traiter les boissons à travers leurs dimensions sociales, sociétales, anthropologiques, …
A quand une exposition sur la bière qui assume ces croisements ? Le renouvellement initié de regard n’en est encore qu’à ses débuts, et il est à espérer d’autres investigations à l’avenir. Comme celles que va proposer une programmation autour de de la bière réalisée en partenariat entre le Master MEM et le musée de la Chartreuse de Douai par exemple …
Emeline Larroudé
#Bière
#Patrimoineimmatériel
#Belgique
#MuséedelaChartreuse

La biodiversité exposée
Qu'est-ce qu'un parc régional ?
Carte des 54 Parcs © Fédération de Parcs naturels régionaux de France
D’après l’article R333-1 du Code de l’Environnement, les Parcs naturels régionaux ont pour missions :
- De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ;
- De contribuer à l'aménagement du territoire ;
- De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
- De contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
- De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
Les missions des Parcs et leurs objectifs
- Un enjeu d’image et de représentation : une porte ouverte sur le territoire
- Un enjeu de transmission de messages auprès des publics
- Un enjeu d’intégration et de reconnaissance
Les expositions des parcs et leurs enjeux
Plusieurs enjeux sont au cœur de leurs projets d’expositions :
Des expositions pour tous les publics
Le public familial est assez présent, notamment l’été. L’exposition « En quête de patrimoine » présentée l’été 2019 reprenait la forme ludique d’une enquête pour résoudre le meurtre d’une historienne. En farfouillant dans sa bibliothèque, les visiteurs découvraient les trésors patrimoniaux du parc : demeures seigneuriales, moulins à vent, fours à chanvre, maisons troglodytes…

Exposition « En quête de patrimoine », Maison du PNR Loire-Anjou-Touraine, 2019 © LL
A la découverte des richesse du parc

Exposition « Des arbres et des cartes », Maison du PNR Marais du Cotentin et du Bessin, 2016 © Maison du PNR Marais du Cotentin et du Bessin
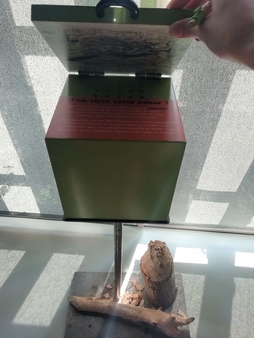
Dispositif olfactif des sécrétions du castor, Exposition permanente Maison du PNR Loire-Anjou-Touraine © LL
La préservation de l'environnement, première mission des PNR

Exposition « La cistude à l’étude », Maison du PNR de la Brenne, 2019, Illustration de Benoît Perrotin © CL
Les problématiques envronnementales au coeur de la conception d'exposition

Affiche « Vivre dans le Parc en 2050 » © PNR Marais du Cotentin et du Bessin
(1) Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France, <https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/article/quest-ce-quun-parc-naturel-regional-definition>
(2) Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France, [En ligne] <https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/carte_54_pnr_26022020.pdf>
(3) Maison du Parc Loire-Anjou-Touraine, centre de ressources, [En ligne], mis à jour le 10.02.12, <https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/centre-de-ressources/experience/maison-du-parc>
(4)
La maison du Parc de la Brenne <https://www.parc-naturel-brenne.fr/visitez/la-maison-du-parc>
L.L
Pour en savoir plus : https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
Maison du PNR Loire-Anjou-Touraine : https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/decouvertes/la-maison-du-parc
Maison du PNR des Marais du Cotentin et du Bessin : https://parc-cotentin-bessin.fr/maison-du-parc
Maison du PNR du Perche : http://www.parc-naturel-perche.fr/le-parc-en-action/bienvenue-la-maison-du-parc
Maison du PNR de la Brenne : https://www.parc-naturel-brenne.fr/visitez/la-maison-du-parc
Maison du PNR Normandie-Maine : https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/la-maison-du-parc-geoparc.html

La Bioinspiration dans les musées : quand l'art et la nature s'unissent
"Va prendre tes leçons dans la nature, c’est là qu’est notre futur."
Cette citation de Léonard de Vinci résonne avec force dans le contexte actuel, où l’interaction entre la nature, l’architecture et les modes de fonctionnement deviennent une source d’inspiration pour l’art, la science, et même la préservation de nos écosystèmes.
De plus en plus, les musées adoptent cette approche, non seulement pour enrichir leur esthétique, mais aussi pour intégrer une dimension écologique essentielle dans la conservation des œuvres et la gestion de leurs infrastructures. La bioinspiration est une approche novatrice qui consiste à puiser dans les stratégies de la nature pour repenser nos façons de créer et de protéger l'environnement.
Une nouvelle vision artistique et architecturale
La bioinspiration fait référence à un processus créatif fondé sur l’observation des systèmes vivants – des micro-organismes aux écosystèmes entiers. Elle consiste à s’inspirer des solutions que la nature a développées au fil du temps pour résoudre des problèmes, dans le but d’innover dans divers domaines, y compris la muséographie.
Si la nature a toujours été une source d’inspiration pour les artistes et les scientifiques, elle a été largement délaissée pendant la révolution industrielle, lorsque les progrès
technologiques ont conduit à l’idée que la nature était imparfaite et ne pouvait plus être un modèle fiable. Pourtant, au XXIe siècle, nous redécouvrons l’importance de l’observation de la nature pour stimuler la créativité.
Les musées contemporains incarnent parfaitement cette alliance. Certains choisissent des emplacements insolites et éloignés des centres urbains, où la nature est non seulement un cadre de vie mais aussi une source d'inspiration.
Des musées biomimétiques dont l'architecture s’inspire de la nature
De nombreux musées contemporains intègrent des éléments biomimétiques dans leur conception, allant du simple esthétisme à une démarche éco-responsable. Ces espaces créent une atmosphère propice à l’immersion, à la contemplation et à l’introspection.
Le Musée Fabre à Tokyo, au Japon, a une architecture qui rappelle la tête d’un insecte, symbolisant ainsi l’interconnexion de la nature et de l’art. De même, le Musée des Confluences à Lyon adopte une forme évoquant un nuage, et est un autre exemple de l’utilisation du biomimétisme dans l’architecture muséale. Ces musées invitent les visiteurs à réfléchir aux possibles échanges entre différents éléments architecturaux et naturels, sans pour autant s’inspirer de leur écosystème.
La préservation d’un écosystème : la bioinspiration comme démarche écoresponsable
Les musées adoptent de plus en plus la bioinspiration pour intégrer des solutions écologiques dans leur architecture et la gestion de leurs ressources. Inspirés par la nature, ils imitent des processus naturels pour réduire leur empreinte environnementale et promouvoir la durabilité. Ces pratiques incluent l’utilisation de matériaux locaux, la gestion efficace de l’eau et de l’énergie, ainsi que l’intégration de végétation pour réguler les températures et l'humidité. Voici quelques exemples :
Le Musée du Quai Branly à Paris présente par exemple 800 m² de murs végétaux conçus par Patrick Blanc. Composés de 15 000 plantes, ils régulent naturellement la température et l'humidité tout en favorisant la biodiversité urbaine. C’est également le cas du Centre de Conservation du Louvre à Liévin, qui préserve ses collections en ayant recours à un toit végétalisé qui stabilise le taux d’hygrométrie.

© Musée du Quai Branly, Photigule
De même, l'ArtScience Museum de Singapour, avec sa forme inspirée de la fleur de lotus, récupère l'eau de pluie qui est ensuite recyclée et réutilisée par le musée grâce à un système de cascade, et optimise la diffusion de la lumière.
Alliant mimétisme et renforcement, le Musée Ordos, situé dans la ville du même nom en Mongolie-Intérieure en Chine, utilise des panneaux métalliques pour se protéger des fréquentes tempêtes de sable et des vents froids d’hiver. Il s'adapte ainsi à son environnement désertique en tentant de s’y fondre grâce à son architecture aux allures de dunes ou de galet. Cette démarche se remarque autant qu’elle se questionne : le bâtiment relève-il vraiment du mimétisme, ou ne vise-t-il qu’un effet spectaculaire malgré son intégration au paysage ?

© Musée Ordos, Chine, Popolon Architects : Ma Yansong, Yosuke Hayano, Dang Qun from MAD Architects
Impulsé par le Muséum National d’Histoire naturelle, le projet Bioinspire-museum soutient et valorise cette pratique dans l’ensemble des activités du musée, tout en permettant l’émergence des matériaux de demain inspirés du vivant. L’accent est mis sur la bonne compréhension de la biologie, nécessaire au succès du projet.
Ces projets montrent que la bioinspiration peut permettre aux musées de renforcer leur engagement en faveur de l’écologie, mais aussi de créer des espaces plus durables et résilients face aux défis environnementaux actuels.
Et si la bioinspiration influençait la conservation préventive ?
La bio-inspiration offre également des pistes intéressantes pour une conservation préventive plus respectueuse de l’environnement. Il n’est pas rare que des œuvres soient face à des risques de moisissures ou de craquèlement dus à une mauvaise gestion du taux d’humidité de leur lieu de conservation. Le Musée des Beaux-arts de Brest voit ses portes fermées pour plusieurs années à la suite de moisissures sur 18 de ses 190 tableaux exposés. Il est obligé de réaliser de lourds travaux de réhabilitation voire même de reconstruction totale du bâtiment.
Le toit végétalisé du Centre de Conservation du Louvre à Liévin permet par exemple d’anticiper ce genre d’incidents en aidant naturellement et efficacement à la régulation du taux d’humidité et de la température intérieure.
Parfois même lorsque ce n’est pas prévu, la nature vient en aide à certains instituts : au Portugal, des chauves-souris ont été mises à contribution pour protéger les collections de bibliothèques, en régulant les populations d’insectes nuisibles de manière naturelle et sans produits chimiques. Bien entendu, leur présence implique une protection toute particulière des objets.
Ainsi, l’innovation et la nature peuvent tenter de se conjuguer pour préserver nos patrimoines tout en prenant en compte l’environnement. Mais ces bâtiments sont-ils capables de se fondre dans leur environnement de par leur taille ? Leur aspect reste industriel et leur impact écologique important.
Un modèle durable
Bien entendu, la bioinspiration ne se limite pas aux musées. Elle est un levier pour repenser les villes de demain. À l’horizon 2050, près de 80 % de la population mondiale vivra dans des zones urbaines. Il devient donc essentiel de repenser les villes comme des écosystèmes durables, capables de s’adapter aux changements climatiques et aux défis environnementaux. En tirant parti des principes du biomimétisme, il est possible de concevoir des bâtiments qui consomment moins d’énergie, qui recyclent les ressources et qui offrent des espaces de vie harmonieux avec la nature.
Ainsi, lorsque nous parcourons les expositions de ces lieux inspirés du vivant, nous ne faisons pas que contempler des œuvres. Nous vivons une expérience qui se veut immersive où l’art et la nature ne font plus qu’un, nous invitant à repenser notre rapport à l’environnement et à la préservation de notre planète. Mais l’est-elle réellement ?
Pauline Mabrut
Pour aller plus loin :
- La bioinspiration expliquée par le Muséum National d’Histoire Naturelle : Biomimétisme : Quand la Nature nous inspire | MNHN
- Le projet Bioinspire-Muséum : https://www.mnhn.fr/fr/bioinspire-museum
- Biomimétisme : quand la nature inspire l’architecture : Biomimétisme : quand la nature inspire l’architecture - Design-Mat
Expositions en lien avec cette thématique :
- “Bio-inspirée” au Musée des Sciences et de l’Industrie (exposition permanente depuis septembre 2020) : https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/les-expositions/bio-inspiree/lexposition
- “Mimèsis. Un design vivant au Centre Pompidou-Metz (exposition temporaire :06/2022 - 06/2023) : Mimesis. Un design vivant
#Bioinspiration #Conservation #Ecoresponsabilité #Architecture

La Cité internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon
« La Table, c'est l'endroit de détente et de convivialité par excellence... C'est pourquoi, il faut également utiliser son imagination pour venir compléter les efforts de la cuisine. » Bernard Loiseau (1951-2003), chef-cuisinier créateur du restaurant étoilé à son nom en Côte-d'Or.
Vue du bâtiment © Ville de Dijon
Un projet de grande ambition
La Cité internationale de la Gastronomie et du Vin a ouvert le 6 mai 2022 à Dijon (Côte-d'Or). Plusieurs villes avaient candidaté pour accueillir ce nouveau projet dont le réseau s'étend déjà avec des « Cité de la Gastronomie » à Lyon, Paris-Rungis et Tours. La capitale de la Bourgogne a travaillé, depuis 2013, sur les travaux de l'ancien hôpital Saint-Esprit, réhabilité pour devenir cette gigantesque structure culturelle.
Sous cette enseigne, le site propose plusieurs prestations notamment des expositions, un village gastronomique avec des commerces de bouche, des ateliers de dégustation et une école de cuisine Ferrandi et une école de Vins de Bourgogne. Il y a également neuf salles de cinéma Pathé qui accueilleront le premier Festival du cinéma gastronomique. Un projet à plus de 250 millions d'euros, mais une diversité qui devrait lui garantir un fonctionnement toute l'année.
La ville de Dijon, labellisée « Ville d'Art et d'Histoire », ne cesse de démontrer ses intérêts pour le patrimoine et la culture : l'ancien Hôtel-Dieu, bâtiments du XVème siècle, reprend aussi vie grâce à l'implantation d'un Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP), appelé 1204en référence à la date de construction de l'hôpital historique Saint-Esprit.
Inscrits « Patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO », les repas gastronomiques français et les climats du vignoble bourguignon sont tous deux réunis pour un voyage à travers 1 700m² d'expositions. Dans le bâtiment principal de la Cité, il y a, au rez-de-chaussée, l'exposition permanente « A table, le petit théâtre du bien manger et du bien boire » scénographiée par Gilles Courat et une exposition temporaire « C'est pas du gâteau, les secrets de la pâtisserie française » scénographiée par Anne Levacher, Sylvie Coutant. A l'étage, l'exposition permanente « En cuisine » mise en scène par l'équipe de deux scénographes. Dans la Chapelle située sur le site, l'exposition permanente « La chapelle des climats et des terroirs » valorise les climats de Bourgogne.
D'un point de vue muséographique, l'objectif était de concevoir « des parcours culturels à la scénographie poussée », en créant « des expériences culinaires remarquables ». Le commissaire de l'exposition, François Aulas (agence Abaque), s'est chargé de sélectionner les contenus.
Des contenus divers et variés

Espaces d’exposition © Ville de Dijon
Dès les premiers mètres dans les expositions, le visiteur est plongé dans un univers culinaire aux dimensions parfois disproportionnées. La mise en scène se base sur une médiation sensorielle incluant une multitude de dispositifs qui interrogent nos repas, nos habitudes culinaires et notre façon de cuisiner. Le visiteur déambule dans différents espaces emblématiques comme la cuisine, la salle à manger, le garde-manger, la cave et dans des décors de boulangerie, de restaurant des années 30... Il est invité à ouvrir, activer, manipuler les ingrédients ou leur représentation via un écran... L'exposition joue avec des contenus qui interpellent comme le cupcake ou macaron géant dans l'espace des pâtisseries.

Espace d’exposition © m13rie_photo
L'exposition semble traiter tous les ingrédients allant des condiments au fromage, en évoquant les régions de France. Elle cherche à situer géographiquement les produits des repas français, à mettre en scène l'art du repas à travers les siècles, retraçant les habitudes culinaires françaises de l'apparition de la formule entrée/plat/fromage/dessert à la composition des différents services de table. Le visiteur se saisit pleinement du contenu en retournant les assiettes d'un service de table, s’asseyant à une table en écoutant un audio via un haut-parleur, pressant une senteur pour comprendre les arômes.
Une « cuisine expérimentielle »propose aux visiteurs de réaliser numériquement des recettes incontournables comme le bœuf bourguignon, les œufs en meurette... Plusieurs îlots permettent de s'amuser ensemble à réaliser les plats, le plus rapidement possible. De façon générale, les contenus vont puiser des références emblématiques avec un mur de portraits des grands chefs-cuisiner, des repas français en peinture mais également des contenus issus de la culture populaire avec des affiches de films.
A l'étage, l'exposition « En Cuisine » joue avec nos 5 sens. Une mise en scène plus tournée sur les climats de Bourgogne avec des dispositifs qui questionnent les arômes, les couleurs. Le discours, plus scientifique, prend forme avec des îlots colorés qui, d'une part, propose un module sensoriel et, d'autre part, apporte une réponse physionomique à l'expérience vécue grâce à la manipulation. La scénographie se veut accessible et interactive. Espaces destinés à comprendre les repas gastronomiques français et les climats du vignoble bourguignon, comme le présuppose le nom du lieu, ou succession de jeux pour divertir et découvrir le monde de la cuisine ?
Une belle Cité, mais pour qui ?

© Ville de Dijon
Les dispositifs sont très hétéroclites. Le discours muséographique s’échelonne sur différents niveaux de langages : graphique, numérique, plastique. Les expositions présentent une multitude de dispositifs interactifs. L'ensemble cherche à faire vivre des expériences aux visiteurs avec, toutefois, un prix d'entrée assez fort. La visite des expositions de la Cité et du 1204 (CIAP) se fixe à 9€ pour un adulte et 5€ pour un enfant. Le site propose une formule qui a du succès : en plus des visites, il est possible de déguster deux verres de vin ou jus de fruits de la Cité, avec la remise d'un verre à pied au logo de la Cité. Cette prestation est à un prix de 13€ par personne. De nombreuses combinaisons sont proposées sur leur site internet : dégustations et visites patrimoniales sont à expérimenter avec la visite d'expositions pour des prix croissants. Cela interroge sur le type de public visé. Contrasté par la médiation sensorielle qui se veut attractive et accessible pour un large public et par les prestations du site à un prix pour public aisé. Le parallèle avec la Cité du vin de Bordeaux semble inévitable. Bien que cette dernière s'attarde davantage sur l'histoire des vins, les médiations s'alignent pour un discours très accessible.
A travers les expositions, le visiteur traverse différents décors, mais également différentes régions voire différentes cultures notamment avec l’exposition « C'est pas du gâteau, les secrets de la pâtisserie française » qui expose des desserts du Japon, d'Autriche, des États-Unis, de Tunisie. Cet espace sur la pâtisserie française ne semble pas uniquement faire l'apologie de la cuisine nationale. Dans les commerces de bouche situés dans la Cité, en périphérie des expositions, les produits de Bourgogne-Franche-Comté sont mis en avant, notamment la célèbre moutarde de Dijon, les vins de Bourgogne, la grande diversité de fromages... Le réseau des Cités internationales de la Gastronomie ne cesse de s’étendre ; le but ne serait-il pas touristique, commercial et visant à asseoir une certaine image de marque du produit made in France ?

© Ville de Dijon
Olympe HOELTZEL
Pour les plus gourmands, les liens pour aller plus loin...
- https://www.citedelagastronomie-dijon.fr/visiter
- https://www.lyon-france.com/je-decouvre-lyon/culture-et-musees/musees/la-cite-de-la-gastronomie-a-lyon
- https://citegastronomie-parisrungis.com/
- https://www.tours.fr/decouvrir-tours/447-gastronomie.htm
- https://www.laciteduvin.com/fr/parcours-permanent
#expositions #gastronomie #vin
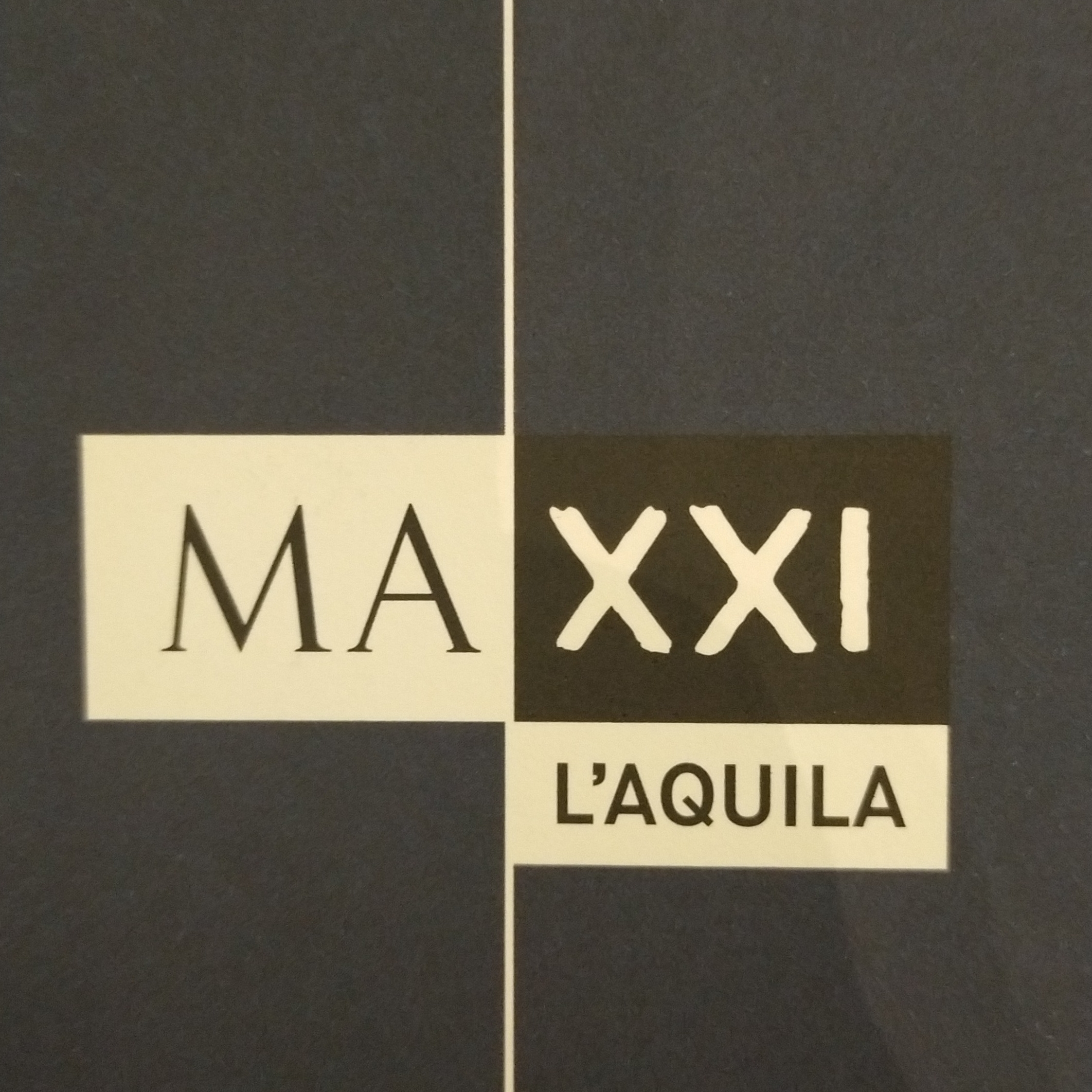
La culture peut-elle nous sauver la vi(ll)e ?
Lorsque l’on pose la question de l’impact d’un musée sur un territoire, un tortueux débat s’ouvre, avec son cortège de théories complexes, de chiffres et d’arguments contradictoires. Il ne sera pas question de cela aujourd’hui, mais plutôt d’une discussion imaginaire. Celle qui se tiendrait si l’on réunissait autour d’une table quatre villes qui, par-delà leurs différences, partagent un point commun : avoir misé sur la culture pour remédier aux difficultés de leur territoire.
A cet échange fictif sont invitées
- Bilbao, Pays-Basque espagnol. Cette ville portuaire dont le dynamisme était basé sur la métallurgie et la sidérurgie a subi la crise industrielle des années 1980. Un vaste projet de rénovation urbaine a été initié pour faire renaître la ville et changer son image, avec comme symbole la grandiose architecture de Frank Gehry qui accueille l’antenne du musée Guggenheim. Avec un million de visiteurs par an, l’impact de ce musée sur son territoire est tel que les spécialistes parlent d’un “effet Bilbao”.
- Détroit, Michigan, États-Unis. Capitale mondiale de l’automobile au début du XXe siècle, la ville a connu un déclin tel qu’elle s’est déclarée officiellement en faillite en 2013. Pour éponger ses 18 milliards de dollars de dettes, la mairie a envisagé un temps de vendre une partie des collections du Detroit Institute of Arts, parmi les plus importantes des Etats-Unis.
- Lens, Pas-de-Calais, France. Le musée du Louvre, souhaitant ouvrir une antenne en France, a choisi le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, frappé par la désindustrialisation. Le Louvre Lens a été inauguré en 2012 dans un bâtiment dessiné par l’agence d’architecture japonaise SANAA. Il entend participer à la reconversion de ce territoire, une dynamique forte déjà illustrée par l’ouverture en 2002 de La Piscine, musée d’art et d’industrie de Roubaix.
- L’Aquila, Abruzzes, Italie. De l’autre côté des Alpes, c’est le MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo - de Rome qui décide d’ouvrir une antenne dans une ville sinistrée. Il s’agit de L’Aquila, capitale des Abruzzes, frappée par un dramatique tremblement de terre en 2009. Alors qu’une grande partie de la ville reste à rebâtir, le Palazzo Ardinghelli, datant du XVIIIe siècle, a été restauré pour accueillir le musée d’art contemporain, qui a ouvert ses portes en 2021.
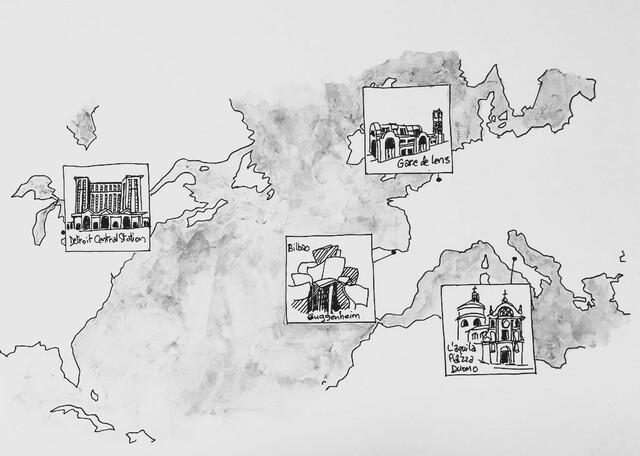
Les villes qui dialoguent ici © Vincent Audin
Bilbao
C’est l’effet « Bilbao »
Lit-on dans les journaux :
Quand l’industrie finie
Me laissant appauvrie,
Voilà qu’un grand musée
On décide d’installer.
Oui ! Prenons Guggenheim
Et misons sur Gehry !
L’architecte et la marque
Feront qu’on le remarque,
Pensaient les spécialistes
Reluquant les touristes.
Cela n’a pas manqué :
De lointains visiteurs
Sont venus par milliers,
Pour me combler d’honneur
Adieu la torpeur !
Détroit
Quelle chance vous avez !
De mon côté de l’océan
Les choses se passèrent autrement.
Une fois la faillite arrivée
Avec ses dettes à solder
Ce sont les œuvres du musée
Qu’on a voulu céder.
Nous aurions pu perdre Van Gogh, Rembrandt et puis Matisse
Si nous n’avions compris que la valeur de l’art
Dépasse celle des dollars.
Lens
Bilbao, Detroit, Lens : c’est une même histoire industrielle
Entre métallurgie, automobile et mines
Avec toujours cette même question :
Aux affres de la désindustrialisation,
Le musée est-il une solution ?
A Lens, c’est donc le Louvre qui s’installe
Dans un genre moins royal
Avec un bâtiment,
Bien moins exubérant. [en se tournant vers Bilbao]
Les œuvres de la galerie du temps
L’ancien puits de mine croisé en se baladant
Toutes traces, plus ou moins lointaines, d’un passé
Que l’on veut repenser.
En s’en tenant aux chiffres, certains – peut-être – diront
Qu’on peut être déçus par la fréquentation.
Mais ici, l’objectif est tout autre
L’ambition non moins haute :
Sur son territoire rester ancré,
Et à tous la culture partager.
L’Aquila
Ciao, io sono L’Aquila.
Je ne suis pas surprise :
Vous ne me connaissez pas
Je ne suis ni Florence, ni Rome ni Venise
Mais la capitale d’une région méconnue
Que l’on nomme Abruzzo.
Au centre de la botte,
Du haut des Apennins jusqu’à l’Adriatique
Je suis la terre des ours et du safran doré
Je suis une terre sauvage aux sommets enneigés
Je suis une terre qui tremble froissée par les séismes
6 avril 2009, 3h32, 308 morts
Une décennie plus tard,
On vante la résilience
D’un peuple qui en silence
Rêve un nouveau départ.
Il reste tant à faire
Et il faut de l’argent
Pour réparer les pierres
Sans oublier les gens.
A l’Aquila c’est l’art contemporain
Qui se fait pèlerin
Quand de Rome le MAXXI
Vient prendre ses quartiers
Au Palazzo Ardinghelli
Tout juste restauré.
De l’art contemporain ? me direz-vous
C’est élitiste, c’est pas pour nous
Mais pour qui d’autre, alors ?
L’antenne d’un grand musée venu de la capitale ?
Comme chez toi [en se tournant vers Lens]
S’ouvre un débat
Quand certains parlent de colonialisme culturel.
Mais quand j’ai vu le palais restauré
Les habitants s’y rencontrer
Quand j’ai vu les œuvres exposées
Mon territoire représenté
Je me suis reconnu.
Je me suis reconnu dans les photos de Paolo Pellegrin
Celles qui montrent les fissures et les ruines
Mais aussi dans celles de Stefano Cerio
Qui peuple de structures gonflables
Les plaines inhabitées
Du Campo Imperatore
Je me suis reconnu dans la douleur
Me suis retrouvé dans la couleur
Est-ce que l’art peut nous soigner ?
Vous vous ferez votre idée.
Peut-être pourra-t-il m’aider
Pour ne pas oublier
Mais sans se limiter
Aux souvenirs sombres
Emprisonnés sous les décombres.
Pour penser à demain
Est-ce si lointain ?
Car comme dit la chanson
Demain est déjà là
Domani è già qui

Photographie prise dans les Abruzzes en 2021 © Raphaëlle Vernet
Raphaëlle Vernet
Pour en savoir plus :
- Brochure de l’exposition d’inauguration (Punto di equilibrio) du MAXXI L’Aquila, avec visuels des oeuvres
- Article relatant l’ouverture du MAXXI à L’Aquila en 2021 et présentant son projet en lien avec le territoire
- La chanson (en italien) Domani, écrite en soutien aux Abruzzes et à ses habitants suite au séisme de 2009
- L’Aquila Fenice, un podcast (en italien) co-produit par le MAXXI pour raconter la renaissance de L’Aquila
#culture #développementlocal #antennes #L’Aquila

La Fondation GoodPlanet, de la « bulle verte » à la vitrine écologique
Le 14 octobre dernier, les amis de Yann Arthus-Bertrand se « vend[ai]ent aux enchères »1, au profit de la Fondation GoodPlanet installée depuis mai 2017 au Domaine de Longchamp. Comme en témoigne cette manifestation hors-du-commun, le lieu destiné à « placer l’écologie et la solidarité au cœur des consciences »2 ne lésine pas sur le spectaculaire. Au risque de verser dans une écologie hors-sol et dans une solidarité verbeuse.

Château de Longchamp, bâtiment de la fondation GoodPlanet (bois de Boulogne, Paris, 16e), le 26 juin 2018 © Celette
Le domaine de Longchamp, un lieu grand public ?

Des enfants participant à un atelier créatif proposé par créative l’association Créative handicap, sous l’œil attentif de Yann Arthus-Bertrand, le dimanche 14 octobre 2018 © C.R.
Les scolaires sont particulièrement ciblés par l’offre de médiation de la Fondation : 5 000 enfants auraient été accueillis entre mars et août 20186. Le catalogue 2018/2019 propose 19 ateliers abordant sous des formes variées (jardinage, ateliers photos, jeux de rôle, etc.) des thématiques liées au développement durable et à la solidarité. Or, dans la documentation disponible en ligne, les données chiffrées prennent largement le pas sur ces indicateurs qualitatifs - pourtant essentiels pour une fondation qui se donne pour objectif d’éveiller les consciences.
Une écologie plus contemplative qu’active
La Fondation GoodPlanet se veut également un lieu « d’expérimentation » de l’écologie. Dans le parc, la sensibilisation aux enjeux environnementaux se fait au travers d’un potager en permaculture, d’un rucher pédagogique, d’une roseraie et d’un hôtel à insectes. Le 14 octobre, aucune médiation n’était organisée autour de ces espaces.

Le compost et son panneau explicatif © C.R.
Si des panneaux expliquent de manière concise et efficace le fonctionnement et l’intérêt de ces dispositifs, des bénévoles auraient été bienvenu.es pour initier le public au désherbage manuel du potager ou à l’entretien du compost. Des ateliers payants intitulés « comprendre et s’initier à l’agroécologie » permettent tout de même aux plus motivé.es – ou aux plus fortuné.es - de participer aux travaux du potager. Pour le reste, l’entretien des espaces verts est confié à un jardinier indépendant7. On imaginerait pourtant bien, dans ce lieu solidaire, des salarié.es en chantier d’insertion.

La roseraie en friche © C.R.
Autre argument phare du parc, l’exposition Genesis de l’artiste Sebastião Salgado. Les photographies de Sebastião Salgado, comme celles de Yann Arthus-Bertrand, appellent à « s’abreuver à la splendeur des régions polaires, des savanes, des déserts torrides, des montagnes dominées par les glaciers et des îles solitaires »8. Cette nature vierge et spectaculaire figée dans les photos de Salgado n’est ni d’aucun lieu, ni d’aucun temps et sa préservation incombe à tous – donc à personne en particulier. Creusant la distance entre des lieux photographiés, devenus paysages à sanctuariser, et nos lieux de vie quotidiens, ce genre d’exposition motive difficilement l’action. Pourtant, les espaces à préserver sont d’abord ceux dans lesquels nous évoluons au quotidien et dans lesquels nos capacités d’action sont les plus grandes.
Rencontrer des humains mais pas ses voisin.es
Cette difficile articulation du global et du local se fait encore sentir dans les espaces d’exposition intérieurs. Sans surprise, les deux tiers des espaces sont occupés par l’exposition du travail de Yann Arthus-Bertrand9, le dernier tiers étant réservé à la Fondation Rocher.
Dans les deux cas, le/la visiteur.euse est assomé.e de chiffres dénonçant des inégalités de tous ordres. L’exposition Celles qui changent le monde de la fondation Rocher place en contrepoint de ces indicateurs pessimistes la présentation de projets écologiques et solidaires menés par des femmes aux quatre coins du monde. Ces présentations sont sommaires mais ont le mérite d’être contextualisées.
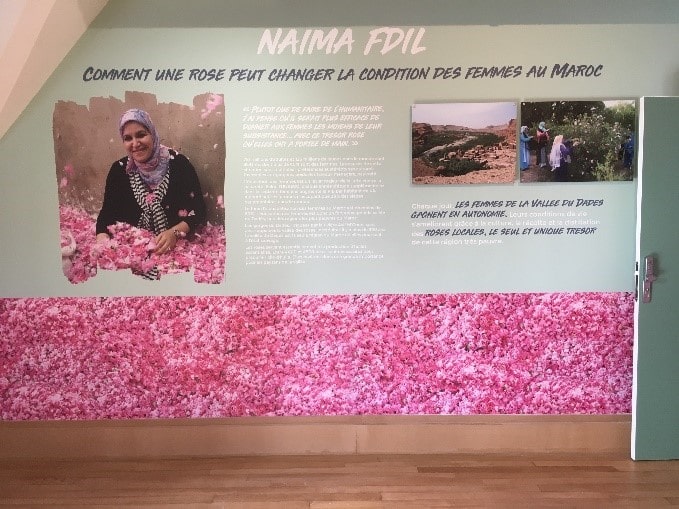
Celles qui changent le monde © C.R.

Exposition HUMAN, espace « dialogues » © C.R.
Aux étages supérieurs, le projet vidéo HUMAN, présenté dans plusieurs salles thématiques, propose de découvrir 2 000 portraits, défilant en très gros plans. Le dispositif fonctionne à la perfection : les brefs récits de vie des personnes filmées, projetés sur grand-écran, sont poignant.es. Pour autant, le témoignage suffit-il pour vivre une réelle expérience de l’altérité ? A-t-on vraiment « rencontré » une personne lorsqu’on l’a regardée sur un écran pendant quelques minutes ? Plus largement, que retire-t-on de cette « expérience émotionnelle » ? Une fondation reconnue d’utilité publique10 n’a-t-elle pas vocation à créer un lien social plus complet et durable ? Il faudrait, pour cela, laisser un peu de place à l’exposition d’initiatives de proximité. On pourrait par exemple imaginer de mettre en dialogue l’exposition HUMAN avec de petits films réalisés sur le même modèle par des visiteur.euses11. Des projets de ce type pourraient en outre être portés par des associations de proximité qui faciliteraient ce passage de l’échelle monde à celle du territoire.
Faut-il vendre ses amis pour sauver la (good)planète ?
Vous l’aurez compris : dans tous les domaines, GoodPlanet voit grand. Il faut dire que la fondation a des partenaires prestigieux. Elle est notamment soutenue par la « volonté philanthropique de la Fondation Bettencourt-Shueller » et par pléthore de grands mécènes12, au premier rang desquels BNP Paribas et Suez. En 2017 les mécènes (entreprises et particuliers confondus) assuraient 65% des ressources de la Fondation ; d’où, sans doute, le message assez consensuel tenu au Domaine de Longchamp.
Malgré ces généreux donateurs, le bilan 2017 de la Fondation est déficitaire. Heureusement, Yann Arthus-Bertrand peut compter sur ces ami.es célèbres qui acceptent de vendre aux enchère un moment passé avec eux. Dimanche 14 octobre le commissaire-priseur d’un jour Nikos Aliagas a ainsi pu mettre à prix une journée privilégiée aux côtés de Zazie – partie à 6 500€ - ou encore un déjeuner avec Blaise Matuidi, adjugé-vendu à 7 200€13. Au total, la vente aura rapporté 176 140€. Les acheteurs ? Des particuliers et… encore des amis14 !. Les copains pouvaient bien rendre un service, c’était le week-end de la Fraternité à la Fondation GoodPlanet.
C.R.
#GoodPlanet
#écologie
#solidarité
1Selon le flyer de l’évènement.
2 Plaquette de présentation de la Fondation GoodPlanet.
3 Rapport d’activité 2017 de la Fondation GoodPlanet, p. 7. Le rapport est consultable en ligne : https://www.goodplanet.org/fr/la-fondation-goodplanet/.
4 https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/Yann-Arthus-Bertrand-s-installe-a-Longchamp-pour-l-ecologie-727522
5 Rapport d’activité 2017 de la Fondation GoodPlanet. L’ensemble des citations de ce paragraphe sont issues du même document.
6 Catalogue des ateliers jeunesse, septembre 2018-juin 2019, p.3. Le catalogue est consultable en ligne : https://www.goodplanet.org/wp-content/uploads/2018/10/Ateliers-Jeunesse-Fondation-GoodPlanet.pdf
7 https://www.goodplanet.org/fr/la-fondation-goodplanet/equipe/
8 Texte de présentation de l’exposition, signé de Lélia Wanick Salgado, commissaire de l’exposition.
9 Ce que Télérama qualifiait malicieusement de débordement « égologique ». https://www.telerama.fr/sortir/goodplanet-yann-arthus-bertrand-replace-l-ecologie-au-coeur-de-la-capitale,158050.php
10 La Fondation GoodPlanet a été reconnue d’utilité publique en 2009, quatre ans après sa création.
11 Un atelier de ce type a pris place au Musée de l’Homme en 2017. http://www.benoitlabourdette.com/actions-culturelles/ateliers-creatifs-ouverts/musee-de-l-homme-atelier-cinema-anime?lang=fr
12 Rapport d’activité 2017 de la Fondation GoodPlanet, p.62 à 68.
13 Chiffres relevés par Kombini, footballstories.konbini.com/news/bonne-cause-dejeuner-blaise-matuidi-a-ete-vendu-7-200e-aux-encheres/
14 « Des amis de la fondation », Selon Le Parisien, http://www.leparisien.fr/paris-75/176-740eur-recoltes-pour-la-vente-de-yann-arthus-bertrand-14-10-2018-7918914.php#xtor=AD-1481423553%23xtor=AD-1481423554

La littérature jeunesse s’infiltre au muséum...
Tranquillement blotti dans votre fauteuil préféré, vous ouvrez votre livre et soudain, vous voilà transporté dans les salles d’un muséum pour y mener l’enquête. Fiction ou réalité ? Plongez dans la collection d’ouvrages jeunesse , Enquêtes au muséum !
Sélection de 10 titres de la CollectionEnquêtes au muséum de Laurence Talairach illustrée par Titwane et publiée aux éditions Plume de carotte © Pauline Dancin
Subrepticement, la fiction et notamment la fiction policière a investi l’univers du musée. Escape games, jeux d'enquête, audioguides et podcasts construits autour d’une énigme à résoudre par des visiteurs transformés en enquêteurs-amateurs font aujourd’hui florès dans les programmes de médiation. Mais si cette rencontre du musée et de la fiction policière se noue désormais sur les sites mêmes, elle s’est longtemps tissée sur le terrain de la fiction seule, qu’elle soit littéraire ou cinématographique. De la série télévisée L’Art du crime (2017), au best-seller de Dan Brown Da Vinci Code (2003) en passant par L’Exposition (2008) de Nathalie Léger, le musée se pose comme le lieu d’une recherche qu’elle soit résolution d’un crime, quête existentielle ou scientifique. La littérature jeunesse ne fait pas exception à cette intrication de l’enquête et de l’univers muséal. La collection Enquêtes au muséum de Laurence Talairach installe ses intrigues dans les muséums de France et d’Europe. Commencée en 2017 et aujourd’hui composée de 26 titres, cette collection dédiée aux jeunes lecteurs de 8 à 12 ans met en scène les aventures de Zoé, accompagnée de sa meilleure amie Alice et de son petit frère Clarence – sans oublier Archibald, le fidèle chinchilla du garçonnet –, dans la recherche de ses parents, deux ornithologues disparus lors d’une mission en Nouvelle Zélande. Chaque nouvelle aventure entraîne le trio dans la découverte et l’exploration d’un nouveau muséum d’histoire naturelle.
Un projet singulier pour une pluralité de muséums
La quête de Zoé commence au Muséum de Toulouse. Laurence Talairach, professeur à l’Université y mène entre 2008 et 2014, en collaboration avec l’équipe du muséum, un projet de recherche, Explora, consacré aux représentations des sciences du vivant dans les arts et la littérature. Zoé et ses amis font leur entrée en scène dans deux titres, En piste, Punch ! et Le Collectionneur de Sirènes, tous deux situés dans l’établissement toulousain. D’abord soumis à Francis Duranthon, directeur du muséum, le projet de collection est ensuite proposé à la CPMF, la Conférence Permanente des Muséums de France, un réseau formé en 2011, rassemblant aujourd’hui 44 muséums franco-européens dont le Luxembourg et la Suisse.
Le projet est à la fois solidaire et participatif afin que tout muséum, quels que soient sa taille et son budget, puisse y trouver sa place. Il repose sur un financement participatif : les muséums qui le souhaitent, contribuent à hauteur de leurs moyens, entre 500 et 5000 € par an. En échange, ils bénéficient d’une remise sur le stock d’ouvrages à vendre dans leur boutique. Quelle que soit leur mise de fonds, chaque membre de la CPMF a la possibilité de lancer une invitation à Laurence Talairach. C’est ainsi que la quête de Zoé se poursuit depuis 2017 dans quinze muséums de France, de Lille à Marseille, en passant par trois musées européens, Oxford, Luxembourg et Neuchâtel.
Si le titre de la collection met en avant un singulier générique, une des raisons d’être du projet est pourtant bien de mettre en avant la diversité des muséums et de leur patrimoine. Chaque titre installe l’intrigue dans un nouveau site. Si certains se déroulent dans des lieux imaginaires, huit sur les vingt-six titres actuels, ils n’en restent pas moins très inspirés de lieux réels.
Chaque titre repose sur un schéma narratif identique. Une énigme se présente d’abord à Zoé que ce soit un étrange message codé glissé sous le paillasson dans Les Animaux du roi, la mort étrange et simultanée de plusieurs animaux du jardin d’acclimatation dans La Malédiction du gecko ou le soupçon d’un trafic animalier dans Le Monstre marin. Pour résoudre le mystère, Zoé entraîne ses amis dans les couloirs et les salles d’un muséum. Chaque exploration est donc prétexte à une description fine et détaillée de l’architecture et de la géographie des sites. Ainsi, dissimulés dans le MOBE dans Alerte en pleine forêt, les trois amis constatent que « sur chaque mur, des panneaux expliquaient comment participer à des projets de recherche scientifique, comment observer et agir pour défendre et protéger l’environnement, donnant l’exemple d’associations qui militaient pour la sauvegarde de certaines espèces et collectaient des informations. Ici, l’observatoire des vers de terre invitait tout un chacun à recenser les vers ; là, les murs exhibaient l’impact des activités humaines sur l’élévation du taux d’extinction de certaines populations. » Le détail de la description permet aux lecteurs informés, visiteurs ou futurs visiteurs des lieux, un effet de reconnaissance et de familiarité.

Le « 4 Tiers », 4ème étage du MOBE visité par Zoé et ses amis dansAlerte en pleine forêt © Pauline Dancin
La précision de l’ancrage s’explique par le travail préparatoire mené en collaboration avec les établissements. L’invitation reçue, Laurence Talairch engage un premier travail de recherche sur l’histoire du musée et de son patrimoine. Cette étape préliminaire est suivie d’une visite des lieux, notamment des collections permanentes et des réserves, au cours de laquelle l’autrice rencontre l’équipe du muséum et échange avec elle. Cette immersion, d’une journée à une semaine, permet de dessiner et valider le parcours du trio à travers les salles et les couloirs, y compris les espaces réservés au personnel du musée et donc inaccessibles aux publics, afin de dévoiler les coulisses tout en préservant la sécurité des lieux.

Pénétrer les réserves… Vue de l’exposition « Bien conservés ! » au Musée d’Histoire Naturelle de Lille – du 21 octobre 2022 au 03 juillet 2023 © Pauline Dancin
Pourtant, malgré le désir d’ancrage, les muséums sont anonymisés et les indications géographiques gommées. L’identité du lieu n’est révélée que dans le paratexte, le court dossier qui suit la fiction permettant de revenir sur des notions, de les expliciter et de les approfondir. Cette mise à distance de la réalité maintient les muséums dans l’imaginaire, évitant tout effet de vitrine promotionnelle. Il résulte pourtant de cette association entre le détail des descriptions et l’ambiguïté géographique, un sentiment paradoxal d’unité et d’unicité : d’un côté, l’affirmation d’une appartenance à une seule et même identité et d’un autre côté, la revendication de leurs particularités. Cette tension est représentative du statut des muséums dont l’appellation générique regroupe des collections très diverses : zoologie, géologie, botanique, paléontologie, préhistoire, archéologie, ethnographie, anthropologie, médecine, astronomie, pharmacie, physique-chimie, etc. Plus qu’un ancrage dans des lieux, chaque titre ancre l’intrigue dans une collection à partir des objets ou thématiques emblématiques et représentatifs du muséum. Le Palais des Glaces souligne la spécificité ethnographique des collections du Musée de l’Homme et met en avant la statuette de la Vénus de Lespurge ainsi que les cires anatomiques que les trois enfants rencontrent au cours de leur enquête.
A l’entre-deux entre le muséum générique et les muséums pluriels, entre le muséum réel et le muséum fictif, la collection des Enquêtes au muséum entraîne ses lecteurs sur les pas de Zoé, à la découverte de ces lieux de patrimoine. Elle les invite à franchir les seuils, pousser les portes, bref, à pénétrer les musées.
Entrée par les portes dérobées de la fiction
Issues de secours, portes dérobées, entrées de service, tous les chemins sont bons pour pénétrer les muséums et explorer leurs coulisses. Quand les portes principales lui résistent, le trio emprunte des voies détournées, des passages privés et réservés et défie les interdits. C’est là tout l’avantage de la fiction, de permettre cette entrée privilégiée et privée, ce pas de côté pour contourner l’obstacle que représente, peut-être, la porte du musée. Car la fiction joue bien ici un rôle de médiation, de passerelle comme nous le raconte le personnage de Clarence. Le benjamin de la bande, est parfois réticent voire effrayé à l’idée de pénétrer le muséum. Pourtant, sa propre interprétation imaginaire de l’énigme et son désir de résoudre le mystère le poussent à affronter ses peurs et à se confronter à l’inconnu. Ainsi, le petit garçon, persuadé d’une invasion de Luniens, extraterrestres venus de la lune, pénètre seul dans le muséum de Montauban, à la suite de Zoé et Alice parties à la recherche de la météorite écrasée.
Si les enfants pénètrent comme des voleurs, des intrus, obligés de se cacher à la vue des gardiens et des adultes en tout genre, ils ne transforment pas moins le muséum en un lieu familier. Leur statut d’« étrangers » ne résiste pas longtemps à leur capacité à s’approprier les lieux. Ils s’orientent avec facilité dans le dédale des salles. Aucun interdit ne vient les freiner dans leur exploration frénétique : de la cave au grenier, des combles aux réserves, des laboratoires aux bureaux, tous les espaces sont pénétrés, fouillés, inspectés. Au fur et à mesure de leur enquête, les trois enfants font du musée leur maison, leur repère. Seuls dans le muséum, ils ont tous les passe-droits. De manière générale, peu d’obstacles se présentent à eux. Les gardiens sont rares voire inexistants – ils demeurent une menace latente mais rarement réelle –, les portes sont rarement fermées à clef, ni caméras ni alarmes ne dénoncent leur présence : le muséum, tel que le découvrent les enfants, n’est pas une forteresse mais plutôt un lieu ouvert à l’exploration, de jour... comme de nuit.
Bien souvent en effet, Zoé, Alice et Clarence infiltrent le muséum à la nuit tombée, en catimini, lorsque les portes se ferment au tout public. Laurence Talairach joue avec notre imaginaire collectif, celui de l’animation nocturne des collections inanimées. La série de quatre films à grand succès La Nuit au musée, sortis entre 2006 et 2020, a en effet contribué à inscrire dans nos représentations, l’image du muséum comme un être biface et fantastique, présentant aux visiteurs diurnes un visage sage et immobile et laissant tomber le masque dès les portes refermées. Le muséum de Laurence Talairach révèle bien un monde « fantastique », mais ce n’est plus le fantastique chimérique et imaginaire de La Nuit au musée. Certes, le merveilleux demeure par l’intermédiaire de Clarence et de son imagination impétueuse, mais ses fantasmes d’invasion extraterrestre, de savant fou et de fantômes sont vites balayés par le rationalisme de Zoé pour qui le muséum est avant tout un lieu de science et de savoirs. Ainsi, pénétrant dans le muséum, les trois enfants découvrent la fantastique réalité de la nature et du vivant. Ni les animaux empaillés, ni les squelettes qu’ils rencontrent ne s’animent, mais le trio leur découvre un passé, une histoire, un discours qui leur donnent vie et qui font d’eux bien plus que des statues. Chaque enquête mène le trio à se frotter à des problématiques muséales tels que les enjeux de conservation ou la constitution des collections. Ainsi dans L’Énigme de la patte de chat, les enfants sont confrontés aux problèmes de conservation des collections naturalistes liés aux insectes et aux parasites. Dans Les Animaux du roi, ce sont les différentes techniques de naturalisation à travers l’histoire qui sont mises en valeur. La dimension coloniale est développée dans Le Monstre marin et La Malédiction du gecko.

Vitrine pédagogique sur la technique de taxidermie au Musée d’Histoire Naturelle de Lille © Pauline Dancin
Les collections ont une histoire et une vie, certes, mais les lieux aussi sont habités. Au cours de leurs enquêtes, les trois enfants découvrent l’activité cachée des muséums en dehors des expositions permanentes. Dans les coulisses, nombre de personnes œuvrent : techniciens et régisseurs montent et démontent les expositions dans Le Palais des glaces, les conservateurs tiennent l’historique et documentent les collections dans Le Fragment d’étoile, scientifiques et laborantins poursuivent leurs expériences dans Le Roi des rats… Le muséum se donne à lire comme un lieu de vie inconnu, dépaysant et déroutant mais délicieusement attirant puisque sa découverte nécessite d’enfreindre un interdit : pénétrer la nuit, sortir des sentiers balisés…
La fiction invite les lecteurs à pénétrer le muséum par ses petites portes, à la suite de Zoé, sans même quitter son lit. Ce premier seuil franchit, comment ne pas avoir envie de pousser les grandes portes ? C’est le pari que lancent plusieurs muséums dont celui de Toulouse. Ce dernier s’est emparé des Enquêtes pour proposer un programme de médiation à destination des scolaires de cycle 3. Le projet se structure en plusieurs sessions au cours desquelles il s’agit d’abord de découvrir l’œuvre littéraire, de se familiariser avec le muséum de papier avant d’aller rencontrer le muséum de pierre. La collection permet d’engager un dialogue autour de notions-clés liées à l’activité muséale et aux sciences du vivant. Mais plus encore, l’écrit devient un lien fort reliant les élèves au muséum, grâce à l’entretien d’une correspondance avec le médiateur. La fiction ouvre la porte à la découverte du muséum, permettant de tisser des liens qui ne sont pas seulement érudits, scientifiques mais aussi oniriques, poétiques, émotionnels, affectifs.
Parents et patrimoines naturels : une histoire de filiation
Un fil rouge relie les différents titres de la collection : la disparition des parents de Zoé lors d’une mission scientifique en Nouvelle Zélande. Leur métier d’ornithologue permet d’articuler au fil rouge de la parentalité celui de la biodiversité et de l’environnement. Si chaque titre apporte une preuve supplémentaire de la vie des parents de Zoé, il le fait au travers d’une nouvelle intrigue mettant en jeu des problématiques environnementales liées aux collections des muséums.
La spécificité de cette collection est aussi de mettre en valeur les missions contemporaines des muséums. Leur rôle de conservation des patrimoines naturels et culturels ne se limite pas à la protection d’une collection mais aussi à celle de la biodiversité. La protection des espèces menacées (Le Monstre marin), les programmes de recherche (Le Roi des rats), le développement des sciences participatives (Alerte en pleine forêt) sont autant de missions aujourd’hui assumées par les muséums que découvrent Zoé et ses amis. Plus largement, la collection joue un rôle de vulgarisation des savoirs liés aux théories de l’évolution et à la formation du vivant. Le Fragment d’étoile aborde au travers des météorites le mystère de l’extinction de masse des dinosaures quand Le Secret de Mélusine introduit la théorie de l’évolution au travers du plésiosaure.
Le choix du genre policier permet de souligner la valeur et la préciosité de ce patrimoine qu’est la biodiversité, à la fois dans sa dimension économique avec les spécimens protégés par la CITES saisis par les douanes dans Le Monstre marin mais aussi dans sa dimension existentielle. Les différents titres soulignent la fragilité de ces espèces éteintes ou menacées d’extinction et leur participation à l’équilibre de la chaîne du vivant. L’importance de ce patrimoine est aussi illustrée par son articulation à la parentalité : retrouver la trace de ses parents et préserver les traces du vivant sont finalement une seule et même quête.
Le muséum devient un espace névralgique où se rassemblent ces différents fils. Il se donne à voir à la fois comme un lieu de savoirs et de mémoire des évolutions passées, mais aussi comme le gardien d’un patrimoine vivant toujours en mouvement. Le muséum nous relie au monde, que ce soit au microcosme familial ou au macrocosme de notre environnement.
Le muséum de Laurence Talairach est un lieu de réponses et de résolutions plurielles, à la différence de nombreux ouvrages jeunesse, romans et escape books, qui font du musée le lieu d’une énigme dont la solution se trouve à l’extérieur, dans la ville et la rue. Ainsi, dans Mission dinosaure : Vol au musée d'Histoire naturelle de Lille (2016) de Nancy Guilbert, les trois amis Ylan, Nell, Théo, accompagnés de leur chien Mozart, partent à la recherche du squelette d’iguanodon, dérobé dans la nuit. Point de départ de l’intrigue, le muséum restera un lieu mystérieux et inexploré : empêchés par les policiers d’entrer dans le muséum, les trois enfants suivent les indices à travers la ville, jusqu’à la découverte du pot aux roses, dans un appartement lillois. Le muséum disparaît petit à petit au profit de l’enquête et de sa résolution. Une fois le mystère levé, rien ne ramène les enfants dans l’enceinte du musée. Le musée pose des questions, mais ne les résout pas. La réponse se trouve au dehors.
D’une façon similaire, Timothée et Liv, les jeunes détectives du Mystère de l'Alcyon (2020) écrit par Philippe Declerck, se heurtent, lors d’une visite scolaire au musée des Beaux-Arts de Dunkerque, au problème d’une toile : qui est son vrai propriétaire ? Aurait-elle été volée ? Leur enquête les mène à l’extérieur du musée, dans la maison de monsieur Rubinstein, jusqu’aux archives départementales. Une fois de plus, le musée se pose comme un lieu de questionnements et non comme un lieu de réponses. Mais à la différence de Mission dinosaure, la résolution du mystère permet aux enfants de réinvestir le musée avec un regard informé.
Ces deux exemples esquissent les traits d’un paradigme de la représentation du musée dans la littérature jeunesse : le musée fait énigme – et peut-être n’est-ce pas un hasard s’il apparaît majoritairement dans la littérature policière –, il pose question, titille, intrigue, stimule, il fait naître une envie de connaissance. Mais le mouvement qu’il impulse est toujours dirigé vers le monde extérieur.

Le musée fait question mais la réponse est au dehors… Couverture de deux romans jeunesse
En posant le muséum comme un lieu de réponses à des quêtes plurielles, Laurence Talairach façonne dans l’imaginaire des jeunes lecteurs une nouvelle représentation du muséum. Il n’est plus uniquement le lieu du problème et de l’incompréhension, le lieu à quitter pour pouvoir avancer, mais il est un lieu qu’on pénètre, un lieu qu’on explore, un lieu qu’on investit. En devenant lieu de réponses, le muséum devient un espace habitable tant pour la fiction qui peut y dérouler son intrigue que pour les lecteurs d’aujourd’hui et futurs visiteurs. C’est aussi parce qu’il est un lieu de réponses que le muséum cesse d’être indifférent et détaché du monde. En peignant un muséum conscient et à l’écoute des enjeux contemporains, la fiction peut aborder des sujets engagés, tels que la biodiversité, et représentatifs des défis qui se présentent aujourd’hui aux muséums. Alors, plus besoin de preuves, partez à la recherche des Enquêtes au muséum… !
Pauline Dancin
Merci à Laurence Talairach d’avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Sources
- Charon Patrice, « Les collections des muséums d’Histoire naturelle en chiffres », La Lettre de l’OCIM, 25 juin 2014, no153.
- Cpmf, « Une définition inadaptée », La Lettre de l’OCIM, 1 novembre 2019, no186, p. 18-20.
- Duranthon Francis, « Point de vue : Enquêtes au muséum, un projet d’édition collectif original », La Lettre de l’OCIM, février 2019, no 181, p. 59-61.
- Declerck Philippe, Le Mystère de l’Alcyon : Drôle d’affaire au musée de Dunkerque, Aubane éditions, coll. « Polars du nord junior », 2020.
- Guilbert Nancy, Aventure au musée de l’Institut Pasteur de Lille, Villeneuve d’Ascq, Ravet-Anceau, coll. « Polars du nord junior », 2018.
- Guilbert Nancy, Mission dinosaure : Vol au musée d’Histoire naturelle de Lille, Villeneuve-d’Ascq, Ravet-Anceau, coll. « Polars du nord junior », 2016.
Pour aller plus loin
- AG, « À quoi ressemblent les musées dans les livres pour enfants ? », L’Art de Muser, décembre 2020.
# Enquêtes au muséum # Laurence Talairach # littérature jeunesse

La Machine à contes du Musée Dauphinois
Sur ce blog Muséomix nous est bien connu. Si plusieurs de nos articles l’ont déjà évoqué, cette fois nous vous parlons d’un dispositif né à la suite de l’édition de 2013. Pour cela, allons au Musée dauphinois ; ce musée de société situé à Grenoble est sensible depuis longtemps au patrimoine oral dont la mise en exposition n'est pas sans difficultés. C’est pourquoi le musée avait souhaité en faire une des thématiques de l’édition Muséomix accueillie dans ses murs. Une équipe, les « blablateurs », a produit un prototype de « machine à contes » pour faire écouter des contes, faire comprendre leurs mécanismes et surtout en récolter.
Aujourd’hui la machine à contes, c'est un dispositif numérique dans une sorte d'alcôve dans lequel les visiteurs entrent et peuvent écouter un conte, en créer grâce à un jeu qui permet de comprendre et d’explorer les ressorts narratifs qui sous-tendent les contes et enfin enregistrer un conte. Le jeu consiste à inventer un conte à plusieurs en suivant des étapes indiquées par le dispositif.
La façade de l’alcôve dans lequel se trouve le dispositif (crédits : C. R.)
Le cartel interpellant les visiteurs et expliquant le dispositif (crédits : C. R.)
Vidéo du Musée dauphinois expliquant le fonctionnement de la machine à contes : https://www.youtube.com/watch?v=x6gETf8Mpkc
Le Musée dauphinois a décidé d’en faire un dispositif pérenne au sein de son exposition longue durée Gens de l’Alpe, consacrée à la vie en montagne. Ce projet a pu être mis en œuvre en remportant l’appel à projet « services culturels numériques innovants » lancé en 2015 par le Ministère de la culture.
Le prototype a été conçu en trois jours (conformément aux conditions d’un Muséomix) mais la conception et réalisation du dispositif pérenne a duré plus de deux ans et a mobilisé de nombreux partenaires. La notion d’équipe et de travail partagé par plusieurs corps de métiers s’est retrouvé tout au long du projet, du prototype Muséomix à la réalisation finale. En effet, de nombreux partenaires ont participé, le musée bien-sûr, le pôle innovation de la direction de la culture et du patrimoine, le service de la lecture publique, le Centre des Arts du Récit (scène conventionnée d’intérêt nationale dédiée aux contes et conteurs) ainsi que France Bleu. A ceux-ci s’ajoute l’agence SètLego de Marseille a fait le développement numérique du projet et sa scénographie, puisque le dispositif prend place dans une alcôve conçue sur mesure.
Cette liste témoigne de l’intérêt suscité par ce projet et par la thématique du patrimoine oral et des contes, qui a rassemblé des institutions qui ne se croisent pas forcément.
Vue du dispositif dans son alcôve (crédits : C. R.)
La Machine à contes s’appuie sur le travail de Charles Joisten, ancien conservateur du Musée dauphinois qui a collecté et retranscrit de très nombreux contes alpins. La conception du dispositif a donc naturellement commencé par un choix de contes, effectué par Alice Joisten et Jean Guibal, directeur du musée au moment de la conception. Ils ont ensuite été interprétés par deux conteuses qui se les sont appropriées tout en restant fidèles aux retranscriptions de Charles Joisten. Enregistrés dans les studios de France Bleu, les contes ont nécessité un important travail technique sur le son.
Le reste du contenu a ensuite été créé à partir des contes : il a fallu d’abord faire le nuage de mots, développer le jeu et enfin les outils d’enregistrement et de gestion des contes enregistrés.
Pourquoi pérenniser ce dispositif ? Quel intérêt pour le musée ?
Celui-ci souhaitait mettre en valeur le patrimoine oral des contes, et le numérique constituait le bon un outil pour construire un module de mise en exposition des contes. Cela permet aussi de les faire entendre dans un contexte proche de leur « environnement naturel », c’est-à-dire par la voix d’un conteur et non par la lecture d’un livre comme c’est souvent le cas.
Mais la machine à contes n’a pas seulement pour but la simple écoute d’aller au-delà en faisant comprendre le fonctionnement des contes et en donnant la possibilité d’enregistrer un conte existant, ou inventé. En effet poursuivre la collecte de ce patrimoine oral est un objectif que le musée s’est fixé en créant cet outil. Les visiteurs ne peuvent enregistrer de contes qu’une fois qu’ils ont écouté, afin de s’assurer qu’ils aient bien compris la démarche. Si l’équipe du musée juge que le conte enregistré a sa place dans la machine à contes, il intègre le corpus des « contes d'ici et d’ailleurs » et les visiteurs pourront l’écouter.
J’ai rencontré Patricia Kyriakides, chargée de la médiation au Musée dauphinois à l’été 2018, nous avons échangé autour de la Machine à contes et de retour sur expérience deux ans après la mise en place du dispositif.
Selon elle, si le jeu consistant à inventer un conte marche bien auprès du public, elle n’est pas complètement satisfaite de l’utilisation actuelle du dispositif car il y a peu d’écoutes et d’enregistrements. Dans la situation actuelle elle a l’impression que le dispositif ne remplit pas ses objectifs, à savoir faire comprendre ce qu’est un conte et surtout en collecter. Je pense cependant, que les visiteurs sont sensibilisés à la thématique et que s’il ne faut pas s’en contenter, on ne peut considérer que c’est un échec.
En conclusion Patricia constate que le dispositif est compliqué s’il n’est pas accompagné. C’est pourquoi elle souhaite améliorer la médiation autour de la machine à contes, en faisant des ateliers, des formations avec les enseignants, en accueillant des scolaires. L’avenir du dispositif passera donc par davantage d’accompagnement et de médiation.
Cet échange nous rappelle que si les dispositifs numériques donnent parfois l’impression qu’ils peuvent fonctionner tout seuls, qu’ils seront automatiquement attractifs pour les visiteurs car numériques, ils ne peuvent bien souvent se passer de médiation.
En revanche ne laissons pas cette conclusion en demi-teinte faire oublier que les dispositifs numériques sont des outils précieux pour mettre en exposition et peuvent permettre de renouveler notre approche d’une thématique, comme ici la culture orale.
Merci encore à Patricia Kyriakides, responsable de la médiation au Musée dauphinois d’avoir accepté de répondre à mes questions et pris le temps d’échanger autour de la machine à contes.
Bethsabée Goudal

La Tour Abbatiale : un musée de territoire témoin d'une historie locale
Situé à une quinzaine de kilomètres de Valenciennes, le musée municipal de Saint-Amand-les-Eaux est abrité dans la tour de l’ancienne église abbatiale. Cet édifice du XVIIème siècle, classé Monument Historique depuis 1846, a subi d’importantes rénovations de 2004 à 2012. Le musée bénéficie d’un cadre remarquable, et tient à conserver cette vocation intellectuelle et créative qui a fait la renommée de cet ancien édifice religieux influent.
Musée de la Tour Abbatiale © Idhem Mehdi
Des expositions temporaires qui traitent de l’histoire de la commune :
La visite débute dans la salle Lannoy, attenante à la boutique, et abritée sous une voûte sculptée en pierre. C’est ici que sont présentées les expositions temporaires tout au long de l’année, en rapport avec les collections permanentes, ou dans la continuité de la programmation culturelle municipale. Ces expositions abordent des thèmes particulièrement variés : art moderne et contemporain, faïences, histoire de l’édifice entre autres.
Celle qui s’y déroule actuellement depuis le 8 octobre 2016, et qui s’achèvera le 31 décembre 2016 s’intitule : « Par les Villes et les Champs, Regards d’artistes sur la vie quotidienne dans le Nord (1890-1950). » Le second volet de cette exposition est présenté au Musée d’Archéologie et d’Histoire Locale de Denain depuis le 19 octobre 2016, et jusqu’au 8 janvier 2017. Cette exposition temporaire traite des évolutions économiques et sociales ayant marqué la région au cours des XIXème, et XXème siècle.
« Par les Villes et les Champs » © Ville de Saint-Amand-les-Eaux
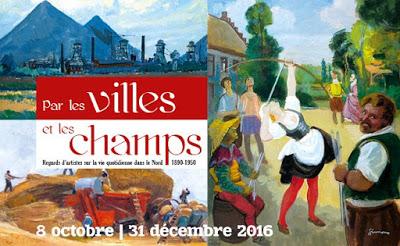 En particulier la révolution humaine et paysagère propres à l’industrialisation, et son impact auprès de l’artisanat et de l’agriculture. Le parcours, qui ne propose pas de sens de visite spécifique, expose essentiellement des peintures à travers des parties thématiques. Quelques sculptures et objets sont aussi à découvrir, notamment un jeu de logique ancien. Les peintures présentent des scènes de genre de l’époque, et relatent des instants essentiels de la vie quotidienne.
En particulier la révolution humaine et paysagère propres à l’industrialisation, et son impact auprès de l’artisanat et de l’agriculture. Le parcours, qui ne propose pas de sens de visite spécifique, expose essentiellement des peintures à travers des parties thématiques. Quelques sculptures et objets sont aussi à découvrir, notamment un jeu de logique ancien. Les peintures présentent des scènes de genre de l’époque, et relatent des instants essentiels de la vie quotidienne.
L’exposition tient à refléter cette sensation de « bon vieux temps » auprès du visiteur contemporain, à travers une reconstitution qui placent ces œuvres dans leur contexte historique. La scénographie est sobre, et tient à mettre naturellement en valeur le style architectural de l’édifice. La couleur rouge des cimaises valorise les œuvres exposées, et renforce le message chaleureux véhiculé au travers des tableaux. Les choix en matière de lumière privilégient un éclairage doux, ce qui rehausse l’architecture du bâtiment.
Salle d’exposition temporaire © Lucie Taverne
 Parmi les peintures exposées, la plupart proviennent de collections de musées de la région, parmi lesquelles : le Musée diocésain d’art sacré de Cambrai, le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, le Palais des Beaux-Arts de Lille, ou encore la Piscine de Roubaix. Ces prêts participent au succès de cette exposition, qui est sans doute l’une des plus importantes parmi celles présentées à la Tour Abbatiale.
Parmi les peintures exposées, la plupart proviennent de collections de musées de la région, parmi lesquelles : le Musée diocésain d’art sacré de Cambrai, le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, le Palais des Beaux-Arts de Lille, ou encore la Piscine de Roubaix. Ces prêts participent au succès de cette exposition, qui est sans doute l’une des plus importantes parmi celles présentées à la Tour Abbatiale.
Une collection permanente qui révèle un savoir-faire traditionnel :
La suite de la visite se poursuit à l’étage de la tour, où sont présentées les collections permanentes du musée municipal. Elles se sont constituées au début des années 1950 autour de la céramique amandinoise, avec plus de trois cent pièces de faïences du XVIIIème siècle. Une première salle expose des faïences anciennes et contemporaines, de même que leur technique de fabrication. Ces pièces témoignent de la renommée de la tradition céramique à Saint-Amand-les-Eaux, marquée par l’implantation de manufactures de porcelaine au sein de la ville à partir de 1705.
En effet, la commune disposait d’un environnement adéquat à l’installation d’une usine de faïence : un réseau routier qui facilitait le transport de la porcelaine, et la présence d’une forêt à proximité, permettait de disposer facilement de bois pour les fours. Une seconde salle, située sous une voûte à arcs brisés, présente des œuvres consacrées à l’histoire de l’abbaye. Sont aussi exposées des peintures et sculptures religieuses du XVIème au XVIIIème siècle des anciens Pays-Bas du Sud ; ainsi que des objets en lien avec l’art campanaire (claviers, cloches).
Salle d’exposition permanente © Tripadvisor
 Les restaurations récentes sont relativement visibles, puisqu’aucune trace de dégradations biologiques, humaines ou de sinistres sont à constater. Ce qui prouve à quel point l’édifice est bien entretenu en termes de conservation préventive. De même que pour la salle d’exposition temporaire au rez-de-chaussée, les choix scénographiques misent sur la sobriété, de sorte à ne pas dénaturer les décors sculptés de la tour abbatiale. Les céramiques sont exposées dans des salles aux murs blancs, à l’intérieur de vitrines quasi neuves, et sont mises en valeur grâce à la lumière naturelle qui pénètre l’intérieur des pièces, à travers de grandes fenêtres.
Les restaurations récentes sont relativement visibles, puisqu’aucune trace de dégradations biologiques, humaines ou de sinistres sont à constater. Ce qui prouve à quel point l’édifice est bien entretenu en termes de conservation préventive. De même que pour la salle d’exposition temporaire au rez-de-chaussée, les choix scénographiques misent sur la sobriété, de sorte à ne pas dénaturer les décors sculptés de la tour abbatiale. Les céramiques sont exposées dans des salles aux murs blancs, à l’intérieur de vitrines quasi neuves, et sont mises en valeur grâce à la lumière naturelle qui pénètre l’intérieur des pièces, à travers de grandes fenêtres.
Un édifice municipal classé qui s’efforce de rester accessible :
La question de l’accessibilité se pose dès l’arrivée au musée puisque l’entrée s’effectue par une porte située sur la façade est de la tour ; porte qui est trop étroite pour permettre à des personnes en fauteuil roulant de pouvoir y accéder. Tout comme l’accès au premier étage, qui s’effectue par un escalier à vis situé près de l’entrée. Sachant que l’édifice n’est pas équipé d’un ascenseur, le musée demeure donc difficilement accessible pour certains types de publics. La mise en accès de l’édifice pour les personnes à mobilité réduite semble difficilement envisageable du fait que le monument soit classé, et compte-tenu aussi du manque de moyens en termes financiers et humains dont dispose le musée.
En matière de signalétique, seul un panneau dans la salle d’accueil indique la direction à suivre pour accéder à l’exposition temporaire et les collections permanentes. Panneau qui n’est pas forcément visible de prime abord. D’autant que certaines œuvres de la collection permanente qui sont présentées en vitrines ne possèdent pas de cartels. Malgré tout, certains éléments portent à croire que le Musée de la Tour Abbatiale s’applique à élargir son accès au plus grand nombre. Tout d’abord, le fait que le musée soit ouvert toute l’année, et tous les jours de la semaine (excepté le mardi).
La visite est gratuite, il suffit simplement d’indiquer son code postal à son arrivée. Bien qu’il n’existe pas d’outils d’aide de compréhension à la visite, l’accueil du musée qui fait également office de boutique, propose en libre-service divers documents : catalogues d’exposition, documents informatifs sur l’édifice, programmes d’activités, etc. Des cartels et panneaux explicatifs clair et illustrés aident à la compréhension du visiteur, aussi bien dans la salle d’exposition temporaire que permanente. Les informations mentionnées sont aisément compréhensibles, et s’adressent de ce fait à un large public.
Des activités de médiation de qualité adaptées à tous sont organisées tout le long de l’année. D’autres sont proposées de manière ponctuelle dans le cadre des expositions temporaires. La plupart sont gratuites, et s’adressent à un public familial, ou demeurent à un prix relativement accessible. La Tour Abbatiale assume ainsi pleinement son identité de musée municipal ancré dans son territoire. Un musée municipal prometteur, qui s’évertue à se réinventer, et à demeurer ouvert au public le plus large.
Joanna Labussière
#Architecture
#Céramique
#Monument Historique
Pour plus d’informations : http://www.saint-amand-les-eaux.fr/fr/culture/musee-expositions/musee.htm

LE PARLAMENTARIUM de Bruxelles – une visite ultra-connectée
Nous voici à Bruxelles, dans le quartier des institutions européennes, composé de ses grands bâtiments tout en verre dont l’ambiance dénote du reste de la capitale.
Agora Simone Weil © Justine Faure
Au cœur de ce quartier, l’immense esplanade Solidarnosc et l’agora Simone Weil, permettent de joindre les différents bâtiments, en dehors des grandes artères de circulation routière. Au milieu se trouve l’accès à deux espaces d’expositions entièrement gratuits pour tous : la Maison de l’Histoire Européenne et le Parlamentarium. Intrigué par le contenu et la présentation de ces espaces j’ai visité celui dont le nom ma paraissait le plus farfelu.
Le Parlamentarium, qu’est-ce donc ? Un mélange entre le parlement et un planétarium ?
Audio-guide (boitier numérique) © Justine Faure
Qualifié de « centre parlementaire pour visiteurs d’Europe », il prend place à l’intérieur de l’un des bâtiments du parlement européen de Bruxelles. Contrairement à la Maison Européenne qui, elle, raconte l’histoire du continent, le Parlamentarium retrace la création du parlement européen et de la politique européenne depuis les deux Guerres Mondiales et jusqu'à aujourd’hui.
Dés son entrée, le visiteur passe un premier sas où « bienvenue » est énoncé presque simultanément dans les différentes langues de l’union européenne.
L’accueil se poursuit par la prise en main d’un audio-guide qui s’avère être un véritable compagnon de visite. Disponible dans les vingt-quatre langues officielles de l’union européenne, avec une adaptation possible pour les personnes malentendante et malvoyante, il permet une large accessibilité à l’exposition.
Composé d’une oreillette et d’un petit écran, il est un outil de médiation à part entière. Un système de trois symboles permet de guider le visiteur pour utiliser l’appareil. Equipé d’un capteur, il suffit de positionner le petit écran sur l’un des symboles pour l’actionner.
Un « I » qui permet de donner des informations, une clef qui permet de déverrouiller les écrans tactiles et un smile qui correspond au parcours enfant.
Positionnement de l’audio-guide sur un symbole pour activer la médiation numérique © Justine Faure
En fonction des salles, les informations données peuvent être orales ou bien visuelles sous forme d’images et de textes. Il n’y a que très peu, voir pas du tout de texte au sein du parcours. En effet, chaque espace comporte les symboles permettant à chaque visiteur d’actionner les informations pour comprendre la signification des images, objets et cartes exposés.
Sur trois étages d’expositions, le Parlamentarium nous propose une immersion dans l’histoire de la politique européenne.
Ecoute de l’audio-guide devant les maquettes des institutions européennes © Justine Faure
A partir de trois maquettes, le premier espace permet de comprendre les trois villes où se situent les institutions européennes : Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles. Intrigué par le contenu du parcours enfant, j’actionne le symbole pour écouter le propos. Succin et clair, il est très agréable et constructif, même plus intéressant et moins « barbant » que le propos du parcours adulte !
Fenêtres présentant l’histoire des guerres mondiales © Justine Faure
Le second espace retrace l’histoire des deux premières guerres mondiales et nous plonge dans une scénographie sombre parsemé de fenêtres, comportant des images phares de cette première moitié du XXème siècle. A chacune, il suffit d’actionner l’audio-guide pour écouter les explications. Mais, petite frustration pour les grands enfants que nous sommes : seulement 2 photos sur une vingtaine comportent le symbole du parcours enfant. Dommage car le parcours enfant s’en trouve dès lors décousu et n’apporte pas beaucoup d’explications utiles.
Table sur l’histoire de la création de l’Union européenne © Justine Faure
Le troisième espace se décline en enfilade du deuxième, avec une scénographie légèrement plus lumineuse. Au centre, par le biais de panneaux vitrés et de tables tactiles, se trouvent des informations sur la création de l’union européenne et le rassemblement des pays, et également sur les différents décrets et événements politiques.
Ligne du temps photographique © Justine Faure
Sur la droite, une ligne du temps composée de photographies, retrace l’histoire des années 1950 à aujourd’hui, évoquant les événements clefs, qu’ils soient culturels, politiques, écologiques, sociaux…
Lorsque l’on actionne l’audio-guide, nous pouvons rechercher les légendes des différentes photos par décennie. En famille, cet espace favorise les dialogues intergénérationnels et devient un support pour raconter des moments vécus par les uns et les autres.
L’espace suivant se veut un lieu de compréhension du fonctionnement du parlement et de l’élection de ces différents membres. Une maquette représente les différents partis ainsi que les différentes nationalités au sein de ceux-ci. Des bornes tactiles permettent d’aller à la recherche des députés des différents pays et d’autres permettent également de se mettre dans la peau d’un député et de donner son avis sur des questions européennes.
Enfin le dernier espace est divisé en trois activités interactives, reconnectant l’attention du visiteur.
Modules amovibles © Justine Faure
Au centre, se trouve une immense carte de l’union européenne, au sol, avec des noms de villes. Des modules amovibles sont disposés de part et d’autre de la salle. Le visiteur s’empare alors de l’un d’eux et se déplace en le poussant. Lorsqu’il passe au-dessus d’une ville, une vidéo se déclenche sur le module. Le visiteur se balade dans l’espace accompagné de son module, aux grés de ses envies. Un dispositif intéressant en fin de visite car il ravive l’intérêt du visiteur qui devient actif. Par contre l’audio-guide ne sert plus à rien si ce n’est déverrouiller l’écran. Le son des vidéos sort directement des modules et créé un environnement sonore peu agréable pour les visiteurs utilisant le dispositif en même temps.
Deux autres espaces entourent cette salle.
D’un côté une séance de cinéma panoramique nous plonge dans le fonctionnement du parlement, de l’élaboration des lois et de la conséquence de la politique européenne dans notre quotidien. L’effet visuel fonctionne bien d’autant que les visiteurs sont assis en cercle dans des fauteuils dignes de ministre, cependant le ton utilisé donne des airs de « publicité » au film mettant en évidence les valeurs de l’union européenne.
Cinéma panoramique © Justine Faure
Espace d’écoute © Justine Faure
De l’autre côté, c’est un espace davantage dévolu à la détente où fauteuils et canapés dépareillés créent une atmosphère de salon. Chacune des assises est composée d’un écran amovible qui permet d’écouter et de regarder des témoignages d’Européens donnant leur vision de l’union européenne. Cet espace plutôt chaleureux isole néanmoins chaque individu devant des écrans.
Pour une fin d’exposition sur l’union européenne, j’aurais imaginé un dispositif qui rapproche les publics et les invitent au dialogue, car les précédentes salles interactives qui ont rendu acteur le visiteur ne favorisent pas la rencontre des publics dans une dimension participative !
En définitive, le Parlamentarium offre un mode de visite singulier où toutes les informations passent par le numérique. Ce système est tout à la fois un facteur d’isolement des publics pendant la visite, mais permet également une grande accessibilité et variété de publics.
Justine Faure
#numériqueaumusée
#visiteinteractive
#parcoursconnecté
#parlementeuropéendebruxelles
Pour aller plus loin :
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/bruxelles/parlamentarium

Le choix de la raison pour le projet de rénovation du Musée lorrain
Situé à Nancy, le palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain regroupe trois sites classés monuments historiques : le Palais Ducal et son jardin, l’église et le couvent des Cordeliers, ainsi que le Palais du Gouvernement.
Le Palais Ducal est construit à partir de la fin du XIVème siècle, à la suite de la victoire du duc René II de Lorraine à la bataille de Nancy1. À partir de 1739, les bâtiments deviennent propriété de la Ville, et une partie est détruite afin d’édifier le palais de la Nouvelle Intendance, l’actuel Palais du Gouvernement inaugurée en 1755.
Au nord du Palais Ducal, l’église et le couvent des Cordeliers, bâtis à la fin du XVe siècle, se distinguent par une particularité rare : l’église, toujours affectée au culte, reste consacrée au sein même d’un ensemble muséal.
Fermé au public depuis 2018, le palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain connaît un tournant décisif. Face aux critiques récurrentes d’associations patrimoniales, le projet d’extension a été abandonné en juin 2025 au profit d’une restructuration plus sobre et recentrée sur le bâti existant.
La rénovation du Musée lorrain soulève des questions fondamentales sur notre rapport au patrimoine. Entre respect de l’histoire et exigences contemporaines, comment intervenir sans figer ni trahir ?
Du palais au musée : l’épopée du Musée Lorrain
Dès 1829, la Société d’Archéologie lorraine s’efforce de créer un musée au sein du Palais Ducal pour rassembler les antiquités de la région et les œuvres de ses figures illustres. Malgré plusieurs échecs, le projet aboutit en 1851 avec l’ouverture du Musée historique lorrain dans une partie du vestibule du palais, inscrit dès 1840 sur la première liste des monuments historiques.
Adolphe Maugendre, Les débuts du Musée historique lorrain, dessin au graphite coloré à l'aquarelle, 1860, conservé au Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain, Nancy. © Palais des ducs de Lorraine, Musée Lorrain, Nancy
Grâce à de nombreux dons (peintures, tentures, sculptures, objets d’art), le musée s’enrichit et est inauguré en 1862 dans la galerie des Cerfs. En 1869, un catalogue recense déjà 1 415 œuvres.
Mais dans la nuit du 16 juillet 1871, un incendie éclate dans le bâtiment de la gendarmerie, une partie voisine de l'église des Cordeliers. Le feu ravage une aile restaurée, la galerie des Cerfs, le plafond et la toiture du palais. Si quelques œuvres sont sauvées, la majorité, dont des portraits ducaux et toute la bibliothèque de la Société d’archéologie lorraine disparaît. Seul le rez-de-chaussée abritant les collections d’archéologie et de sculpture est épargné ; au moins la moitié des œuvres sont détruites.
Quelques mois après le sinistre, la Ville de Nancy décide de construire une caserne de gendarmerie à la place du jardin des Cordeliers. En échange, elle obtient l’usage complet des ruines du palais ducal, dont la restauration est prise en charge par l’État. Mais la municipalité choisit ensuite d’y bâtir une école supérieure de garçons, obligeant la Société d’Archéologie lorraine à renoncer au fait d’installer le musée dans l’ensemble du palais. Après d’importants travaux, le musée rouvre en 1875.
En 1895, les collections du musée atteignent près de 3 000 objets, soit presque le double qu’en 1869. En 1908, il est réorganisé en quatre sections (archéologie ; objets d’art et mobilier ; estampes, livres et sceaux ; numismatique), chacune confiée à un conservateur bénévole de la Société. Deux ans plus tard, une section dédiée à l’art populaire est créée, accompagnée de nouveaux espaces d’exposition, tandis que l’École supérieure de garçons est transférée dans les bâtiments du jardin.
Un nouveau plan de restructuration lancé en 1934 aboutit à l’inauguration du nouveau Musée lorrain le 6 décembre 1937, avec une muséographie repensée comprenant 31 salles contre 7 auparavant. Le musée s’enrichit ensuite d’une salle sur le judaïsme, puis d’un laboratoire d’archéologie des métaux, à l’origine en 1966 du musée de l’histoire du fer à Jarville-la-Malgrange (l’actuel Féru des Sciences).
Toujours en expansion, le musée manque de place et réorganise sans cesse ses espaces. Il est préconisé en 1995 de faire de l’établissement « un musée de synthèse au niveau régional dans les domaines qui sont les siens : archéologie, art, histoire, ethnographie », et de le rendre davantage accessible aux publics.
Musée Lorrain de Nancy © Agence DUBOIS & Associés / Agence MIL-LIEUX / Patrice CALVEL / Atelier du Paysage
Un projet de rénovation et d'extension contesté
Le projet de rénovation et d’extension du musée est lancé dans les années 2000, après l’approbation de son projet scientifique et culturel. Il réunit la Ville de Nancy (maître d’ouvrage), la Société d’histoire de la Lorraine et du Musée lorrain, l’État et la Région.
Des fouilles révèlent des objets liés à la vie de cour entre les XVème et XVIIIème siècles, tandis qu’un chantier des collections recense près de 155 000 pièces. En 2013, le musée adopte son nom actuel : le palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain.
En avril 2018, cinq ans après le concours international d’architecture remporté par l’agence Dubois & Associés, le musée ferme ses portes au public.
La Commission nationale des monuments historiques émet un avis favorable sur le projet architectural en septembre 2014. Cependant, des fouilles menées par l’INRAP révèlent l’importance du « mur de Baligand », construit vers 1745. Face à cette découverte, le Ministère de la Culture demande une révision du projet pour préserver ce vestige, initialement destiné à être détruit. La Ville de Nancy adapte donc le projet, qui est approuvé par la Commission en octobre 2016.
Après trois tentatives infructueuses d'appel d'offres entre 2018 et 2019, le projet remanié trouve enfin preneur après cinq années d’attente.
Le projet prévoyait la construction d’un pavillon en verre sérigraphié de 35 mètres de long à la place des bâtiments dits de « fond de cour », jugés sans intérêt patrimonial par la Ville.
Ces bâtiments comprenaient : le mur de Baligand et l’écurie du XVIIIème siècle qui auraient été déconstruits puis remontés, avec des ajouts contemporains, ainsi que l’ancienne gendarmerie du XIXème siècle ayant aussi servi d’établissement scolaire. Face à la mobilisation des opposants, cette partie du projet a été annulée en 2021.
Toutefois, malgré un projet allégé, les critiques persistent. En réaction au lancement des opérations préliminaires, les associations Sites & Monuments (association nationale) et Défense et avenir du patrimoine nancéien ont déposé un référé-suspension, invoquant l’interdiction de démolir un bâtiment classé sans déclassement préalable par le Conseil d’État.
Le tribunal administratif a donné raison aux opposants le 12 février 2025, ordonnant la suspension des travaux sur cette partie du chantier.
Selon les opposants, le projet viole le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui sert à protéger, restaurer et encadrer l'évolution des secteurs historiques dans le but de préserver le patrimoine. Les opposants ne remettent pas en cause le principe d’une extension, mais critiquent son architecture, jugée incompatible avec l’environnement historique, notamment le bâtiment en verre sérigraphié, perçu comme trop intrusif.
Juin 2025 : un nouveau tournant majeur
Lors d'une conférence de presse, le maire de Nancy a annoncé l’abandon du projet d’extension. Face à une explosion des coûts passés de 43 à 54,5 millions d’euros en huit ans, la municipalité opte pour une révision complète du projet. Désormais recentré sur la seule restructuration du palais ducal, le nouveau plan prévoit de réaménager les espaces existants sans creuser de nouveaux volumes en sous-sol.
Si cela implique une possible réduction des surfaces dédiées aux expositions temporaires, les espaces d’exposition permanente seront conservés.
Le nouveau calendrier fixe la désignation du maître d’œuvre à 2028, avec un début des travaux en 2029 et une réouverture envisagée à l’horizon 2033.
Ce temps de redéfinition est aussi, selon le directeur Richard Dagorne, l’occasion de repenser en profondeur les contenus du musée à l’aune des enjeux contemporains (genre, pouvoir, mémoire) et d’opérer un retour aux fondations, à la fois architecturales et intellectuelles, du projet muséal.
Ainsi, une question essentielle se pose : comment intervenir sur un bâtiment historique sans trahir son essence, tout en lui permettant de répondre aux exigences contemporaines ? Rénover un bâtiment historique, c’est marcher sur une ligne de crête entre deux écueils : la destruction excessive au nom de la modernité, et la conservation figée qui empêche toute évolution.
Dans ce débat, la nuance requiert justement de considérer chaque bâtiment, chaque usage, chaque époque.
Il est temps de faire preuve de bon sens : intervenir, non pas pour effacer l’histoire, mais pour lui permettre de continuer. Restaurer et adapter sans figer, tel est le défi. La réponse n’est ni dans la pure conservation, ni dans la rupture, mais dans un dialogue intelligent entre passé et présent.
Solène Bérus
Pour en savoir plus :
Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain - Le projet de rénovation : https://musee-lorrain.nancy.fr/le-musee/le-projet-de-renovation-1
Beaudouin architectes - Musée lorrain Nancy : http://www.beaudouin-architectes.fr/2013/11/projet-musee-lorrain-nancy/
Le Journal des arts, https://www.lejournaldesarts.fr/patrimoine/nouveau-rebondissement-dans-le-projet-du-musee-lorrain-178436, Nouveau rebondissement dans le projet du Musée lorrain, Marion Krauze, publié le 19/06/25, [consulté le 29/06/25].
Bibliographie:
Jean-Marie Collin, « Le palais ducal de Nancy, de Charles IV à Stanislas », Pays Lorrain « 150 ans pour faire l’histoire (hors-série) », 1998.
Lonny Bourada et Hélène Duval, « Les apports de l’archéologie à la connaissance de l’histoire du palais ducal au XVIIIe siècle », Pays Lorrain, vol. 99, 2018.
Laurent Jalabert et Pierre-Hippolyte Pénet, La Lorraine pour horizon. La France et les duchés, de René II à Stanislas, Cinisello Balsamo, SilvanaEditoriale, 2016.
Étienne Martin et Pierre-Hippolyte Pénet, L’église des Cordeliers : Le sanctuaire des ducs de Lorrain à Nancy, Nancy, Société d’Histoire de la Lorraine et du Musée Lorrain, 2022.
Bénédicte Pasques, « Brève histoire illustrée du Musée lorrain », Pays Lorrain, vol. 99, mars 2018.
Martine Mathias, « Anciennes muséographies et perspectives nouvelles pour le Musée Lorrain », Pays Lorrain « 150 ans pour faire l’histoire (hors-série) », 1998.
Thierry Dechezleprêtre et Marie Gloc, « La restauration du palais ducal de Nancy au XIXe siècle », Pays Lorrain « 150 ans pour faire l’histoire (hors-série) », 1998.
Pierre Marot, « Le Musée historique lorrain : œuvre de patriotisme, instrument de culture », Pays Lorrain, vol. 1, 1976.
Paul Sadoul, « Le Musée Lorrain, mémoire de la Lorraine », Pays Lorrain « 150 ans pour faire l’histoire (hors-série) », 1998.
Fabrice Mazaud, « Un regard sur le projet architectural », Pays Lorrain, vol. 99, mars 2018.
Sophie Mouton, « Le musée en partage », Pays Lorrain, vol. 99, mars 2018.
Le Journal des arts, https://www.lejournaldesarts.fr/patrimoine/musee-lorrain-quest-ce-qui-gene-les-associations-patrimoniales-170916, Musée lorrain, qu’est-ce qui gêne les associations patrimoniales ?, Marion Krauze, publié le 14 février 2024, [consulté le 05/05/25].
#PalaisdesducsdeLorraine–Musée lorrain #Défenseursdupatrimoine #Extension #Rénovation

Le Cnap : une institution au cœur de la création contemporaine
L’année dernière, j’ai eu l’occasion de réaliser un stage de six mois auprès de la chargée des collections de design et d’art décoratifs du Centre national des arts plastiques (Cnap), à Paris. Je fus étonnée de constater qu’au sein de mon entourage, un grand nombre ignorait tout de cette institution, de son existence à l’ensemble de ses missions. Le Cnap tient pourtant une place importante dans le milieu de l’art contemporain en France. Cet article a donc pour objectif de présenter le Cnap ainsi que l’ensemble de ses actions dans le secteur culturel public.
Le Cnap est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Établi à La Défense, en périphérie de Paris, le Cnap a pour principale mission de soutenir et de promouvoir la création artistique contemporaine. Depuis sa création en 1982, l’institution soutient un grand nombre d’acteurs s'agissant principalement d'artistes (peintres, plasticiens, photographes, designers...), mais aussi de critiques d’art, d'éditeurs, de galeristes, d'historiens de l’art, ou encore de restaurateurs. Son champ d’action s’étend sur l’ensemble du secteur des arts plastiques et visuels. Afin d’encourager ces différents corps de métiers, le Cnap met régulièrement en place des commandes et des coproductions.
Le soutien à la création : un dispositif d’aides à destination des professionnels de l’art contemporain
Les professions liées à l’art contemporain touchent à des champs d'action très divers allant de l’édition à l’exposition en passant par la production ou la recherche. Tous ces professionnels constituent un vaste réseau que le Cnap a pour mission d’aider. Dans le but d'apporter à chacun une aide personnalisée, le Cnap a mis en place treize dispositifs de soutien différents auxquels il est possible de candidater par le dépôt d’un dossier, ensuite étudié par une commission. Les critères de sélection portent sur la qualité, la cohérence, la faisabilité et le budget du projet.
Ces dispositifs permettent avant tout aux artistes d'obtenir une aide financière et matérielle dans le but de réaliser un projet artistique. Certains chercheurs peuvent également prétendre à ces aides pour entreprendre des recherches. Le Cnap est aussi un véritable soutien pour les artistes en situation de précarité qui peuvent ainsi prétendre à une aide de secours exceptionnelle en cas de difficultés financières. De plus, l’institution met en place des aides ponctuelles en réponse à des situations de crise comme actuellement l'épidémie de Covid-19 qui handicape grandement les projets artistiques. Ces aides exceptionnelles, destinées aux professionnels subissant des pertes de rémunération, permettent de conserver une dynamique de création artistique même dans des périodes les plus difficiles.
Au-delà des artistes et des chercheurs, d’autres acteurs du milieu culturel peuvent bénéficier d’aides de l’État par l'intermédiaire du Cnap. Les galeries d’art peuvent prétendre à une aide leur permettant d'organiser des expositions, de participer à des salons d'art, de mettre en place des partenariats à l'international ou encore de commander une œuvre originale à un artiste. De même, les éditeurs de livres d'art peuvent bénéficier d'une aide leur permettant de participer à des salons en France ou à l'étranger. Enfin, les maisons de production souhaitant expérimenter de nouvelles techniques de création audiovisuelles peuvent également prétendre à une aide pour le développement, la production et la post-production de leurs projets. C’est grâce à ce soutien notamment que le film C’est Paris aussi de Lech Kowalski a pu voir le jour. Dans cette sorte de « remake d’Un américain à Paris »1, le réalisateur donne à voir Ken, un native american, déambulant dans le Paris de la « zone » en bordure de périphérique. Les deux hommes vont à la rencontre de ces habitants de bidonvilles et réfugiés, dont l’histoire est mise en parallèle avec celle de Ken et de ses origines.
Au-delà des aides financières et matérielles, le Cnap fournit un nombre de ressources considérables pour les professionnels du secteur culturel : offres d'emploi, accompagnement dans les démarches administratives et financières, réseau d'adresses... Ces ressources s'avèrent extrêmement utiles, notamment pour les jeunes professionnels qui débutent leur carrière.
En parallèle, le Cnap mène également une politique d’acquisition très active destinée à régulièrement alimenter sa collection d'œuvres d’art, et qui a pour ambition principale d'être le reflet de la création contemporaine. Ainsi, par le biais de nombreuses commandes et acquisitions, le Cnap s’ancre dans le marché de l’art.
Le fonds national d’art contemporain : une collection éclectique et en mouvement
Le Cnap gère le Fonds national d’art contemporain (FNAC), une collection publique parmi les plus grandes d'Europe qui rassemble plus de 100 000 œuvres d'art. La collection est cependant bien plus ancienne que le Cnap lui-même : ce fonds est en réalité hérité de la grande collection d'œuvres d'art constituée des biens du clergé, des collections royales et des Emigrés créée en 1789 à la suite de la Révolution française. Ce n’est qu'en 1982 que le FNAC est affecté au Cnap, sous la tutelle du Ministère de la Culture. Le Cnap a donc depuis sa création l'ambition d’enrichir sa collection d'œuvres d'art et de la diffuser aussi bien en France qu'à l'international, et ce conformément à la politique de décentralisation de la culture menée au début des années 1980.
Le FNAC se décline en plusieurs collections comportant des œuvres d’artistes français et étrangers :
- La collection historique : 23 300 œuvres de 5 300 artistes datant de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à 1910;
- La collection moderne : 25 600 œuvres de 7 900 artistes datant de 1905 à 1960;
- La collection arts plastiques : 19 600 œuvres de 5 900 artistes des années 1960 à aujourd'hui;
- La collection design et arts décoratifs : département créé en 1981, comportant 9 500 œuvres de 2 200 auteurs;
- La collection de photographies : 12 100 œuvres de près de 1 100 artistes;
- La collection vidéo : ensemble de près de 800 œuvres;
- La collection Art public : 1 300 œuvres de 700 artistes couvrant une période de 1945 à nos jours. Cette collection est destinée à être présentées en dehors des lieux d’exposition traditionnels et dans l’espace public;
- Le fonds études et maquettes : 4 300 éléments d’études de 720 artistes. Cette collection comporte des études et autres travaux préparatoires réalisés dans le cadre de commandes d'œuvres depuis 1983.
Cette collection éclectique dite « sans murs » car ne disposant pas de lieu d’exposition propre, s’enrichit constamment au gré de la création contemporaine. La diffusion de ces œuvres par l'intermédiaire du prêt constitue la principale raison d'être du FNAC. Le Cnap est à ce titre régulièrement sollicité par les institutions culturelles (principalement les musées et centres d’art) qui souhaitent emprunter certaines œuvres en vue de divers projets d'exposition. Les professionnels du « Pôle collection » du Cnap ont pour mission de valoriser, de conserver et de documenter cette collection par le biais de coproductions d’exposition ou de publications d’ouvrages. Pour acquérir des œuvres du FNAC, un travail prospectif est mené afin de faire les choix les plus pertinents pour rendre ce fonds d’art contemporain le plus inclusif possible. Ces acquisitions peuvent accompagner des carrières d’artistes déjà bien initiées, ou bien mettre en valeur la nouvelle génération d'artistes. Par le biais de ces acquisitions, le Cnap enrichit exclusivement sa collection avec des œuvres d’artistes vivants, français ou étrangers, peu présents dans les collections françaises. Trois commissions d’acquisition ont lieu tous les ans dans les domaines suivants : Arts plastiques, Photographie et images, Arts décoratifs, design et métiers d’art. Le choix des œuvres se fait de manière collégiale. Les commissions sont composées de six membres du Cnap, deux artistes, et six personnalités choisies pour leurs compétences dans le domaine artistique en question (critiques, collectionneurs, chargés de collections d’art contemporain, etc.). Ces commissions sont chargées de réaliser des acquisitions pour le compte de l’Etat et sont renouvelées tous les trois ans.
En parallèle de sa politique d'acquisition, le Cnap passe régulièrement un certain nombre de commandes publiques, ce qui lui permet d'enrichir sa collection tout en soutenant activement les artistes. Un nouveau projet de commande a récemment été lancé pour la création de quinze œuvres à protocole temporaires et réactivables, destinées à être exposées dans l’espace public.
Une institution au service de la diffusion et de la valorisation de la création
Cette collection est destinée à être prêtée ou déposée un maximum puisque comme nous l’avons dit précédemment elle ne dispose pas de lieu d’exposition qui lui soit propre. De ce fait, des commissions de prêts et dépôts se réunissent tous les mois, en présence des chargés des collections, de la direction du Cnap mais aussi des personnes en charge de la régie des œuvres, afin de se concerter et se prononcer sur les demandes formulées par les différentes institutions. Ainsi, la collection est diffusée et permet à des musées ou centres d’arts de disposer d’une grande diversité d’œuvres pour leurs expositions temporaires ou permanentes. L’institution participe alors, grâce à sa politique de diffusion, à valoriser la création contemporaine, mais également les musées de régions. Ceci se fait notamment grâce aux nombreux dépôts qu’il effectue dans des institutions culturelles afin qu’ils bénéficient de ces œuvres sur le long terme.
Cette collection est peu connue du grand public mais pourtant très présente dans les institutions et l’espace public français, ce qui est un paradoxe. De nombreuses œuvres des collections permanentes de musées de régions sont ainsi des dépôts du Cnap. À titre d’information, il est indiqué sur le site internet du Cnap que : « Le nombre d’œuvres déposées peut varier de 500 à 1 200 œuvres en fonction des années. Parallèlement, le Cnap prête près de 2 000 œuvres chaque année pour des expositions temporaires auprès d’institutions de toute nature, en France et à l’étranger »2.
Cette diffusion des oeuvres du FNAC n’est pas la seule manière pour le Cnap d’assurer sa mission pédagogique. En effet, un service de médiation met en place différents projets à destination de publics variés :
- Création d’outils pédagogiques dont le projet « Mon musée du design », application destinée à faire découvrir la collection design du Cnap en proposant à l’utilisateur la création de sa propre exposition virtuelle. Cette plateforme peut être utilisée dans le cadre scolaire, un guide à destination des enseignants est également disponible.
- Médiation numérique avec les applications « Partcours », guides dédiés aux œuvres déposées par le Cnap dans l’espace public. Pour le moment il en existe deux versions : une dans le jardin des Tuileries en partenariat avec le musée du Louvre, et une seconde au domaine de Kerguéhennec, proposant la visite du parc de sculptures.

Vue des nouveaux locaux du Cnap à Pantin © Carole Fékété - Cnap
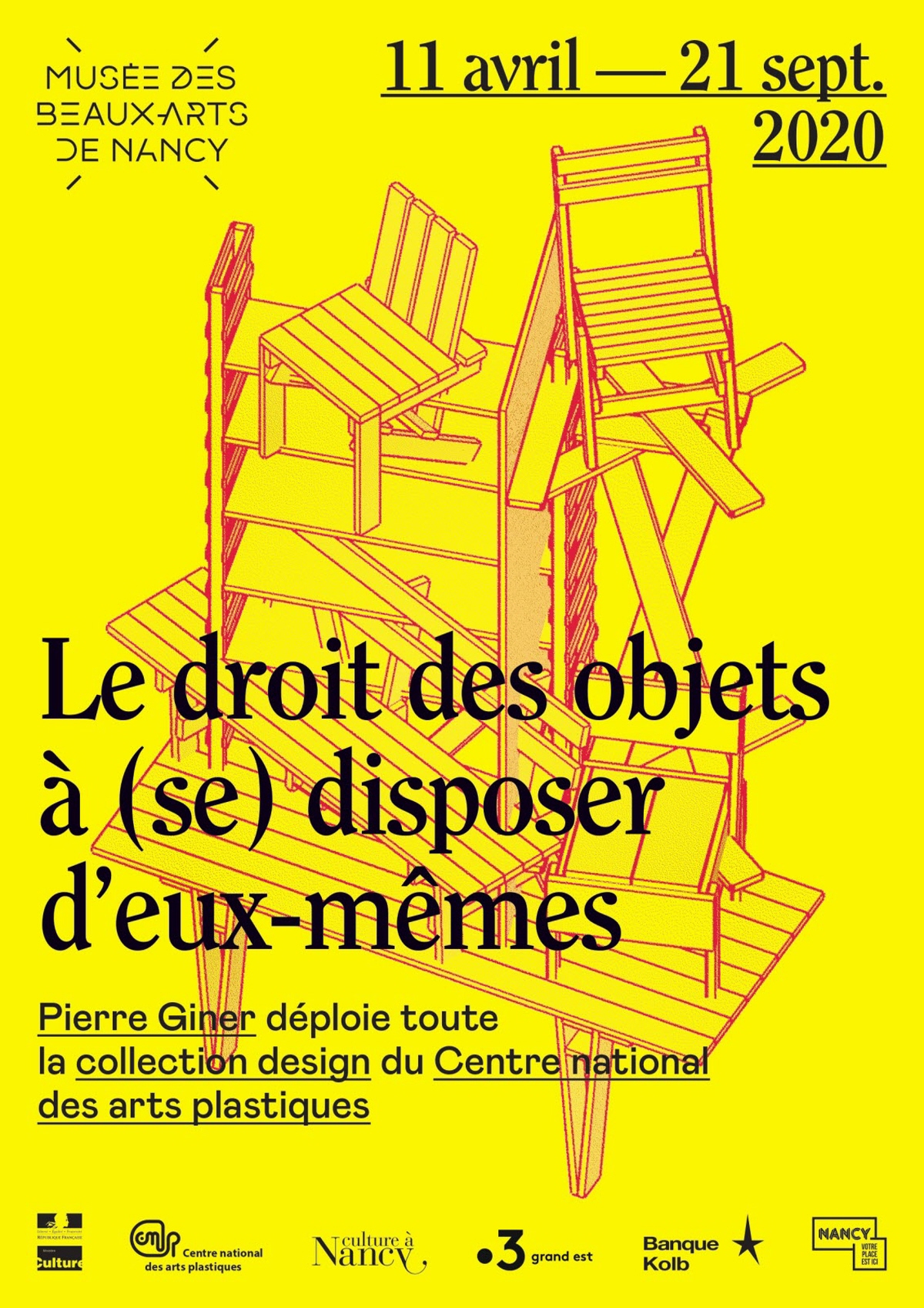
Affiche de l’exposition « Le droit des objets à (se) disposer d’eux-mêmes » - Musée des Beaux-Arts de Nancy - Cnap
- Médiation « Hors les murs » avec le projet « MuMo ». Sous la forme d’un camion-musée itinérant transportant des oeuvres du Cnap et du Frac, ce musée mobile propose des visites, rencontres et ateliers pédagogiques. L’objectif est de sensibiliser un public dit « éloigné » de la culture en amenant la culture à lui.
Le Cnap est donc un établissement polyvalent, il est l’opérateur de la politique culturelle du ministère de la Culture en terme d’art contemporain et mène donc des projets variés, participant et encourageant le dynamisme de la scène artistique contemporaine. En ce moment même, plusieurs expositions présentant des œuvres du FNAC sont en cours sur le territoire français. Citons « Le droit des objets à (se) disposer d’eux-mêmes » au Musée des Beaux-Arts de Nancy en collaboration avec l’artiste Pierre Giner, ou l’exposition de la commande « Flux, une société en mouvement » dans le cadre du festival Photaumnales à Beauvais et Douchy-les-Mines. Ces deux expositions sont malheureusement actuellement suspendues en raison du contexte sanitaire actuel.
Parallèlement aux projets d’expositions, d’éditions ou de commandes, le Cnap a débuté cette année un chantier des collections de grande envergure en vue du déménagement de ses locaux et réserves dans un nouveau bâtiment à Pantin, prévu en 2023. Ce chantier est d’une grande utilité pour le fonds car il permet de vérifier l’état des œuvres dans leur ensemble, de les photographier et de les documenter. Ces nouvelles infrastructures installées en banlieue parisienne seront plus adaptées à l’accueil des différents professionnels de l’art contemporain avec lesquels travaille le Cnap. Réunissant toute l’équipe sur un même lieu, il est certain que ces nouveaux espaces seront l’occasion de mener à bien de nouveaux projets tout aussi riches et variés, dirigés depuis l’année dernière par Béatrice Salmon.
V.E.
1https://fidmarseille.org/film/cest-paris-aussi/
2Cnap.fr - Deux siècles de diffusion des œuvres en France et à l'étranger
Image de couverture : locaux du Cnap à la Défense ©V.E.
Pour en savoir plus sur le Cnap et ses actualités : www.cnap.fr
Pour parcourir la collection en ligne : www.cnap.fr/collection-en-ligne#/artworks
#artcontemporain
#soutienàlacréation
#politiqueculturelle
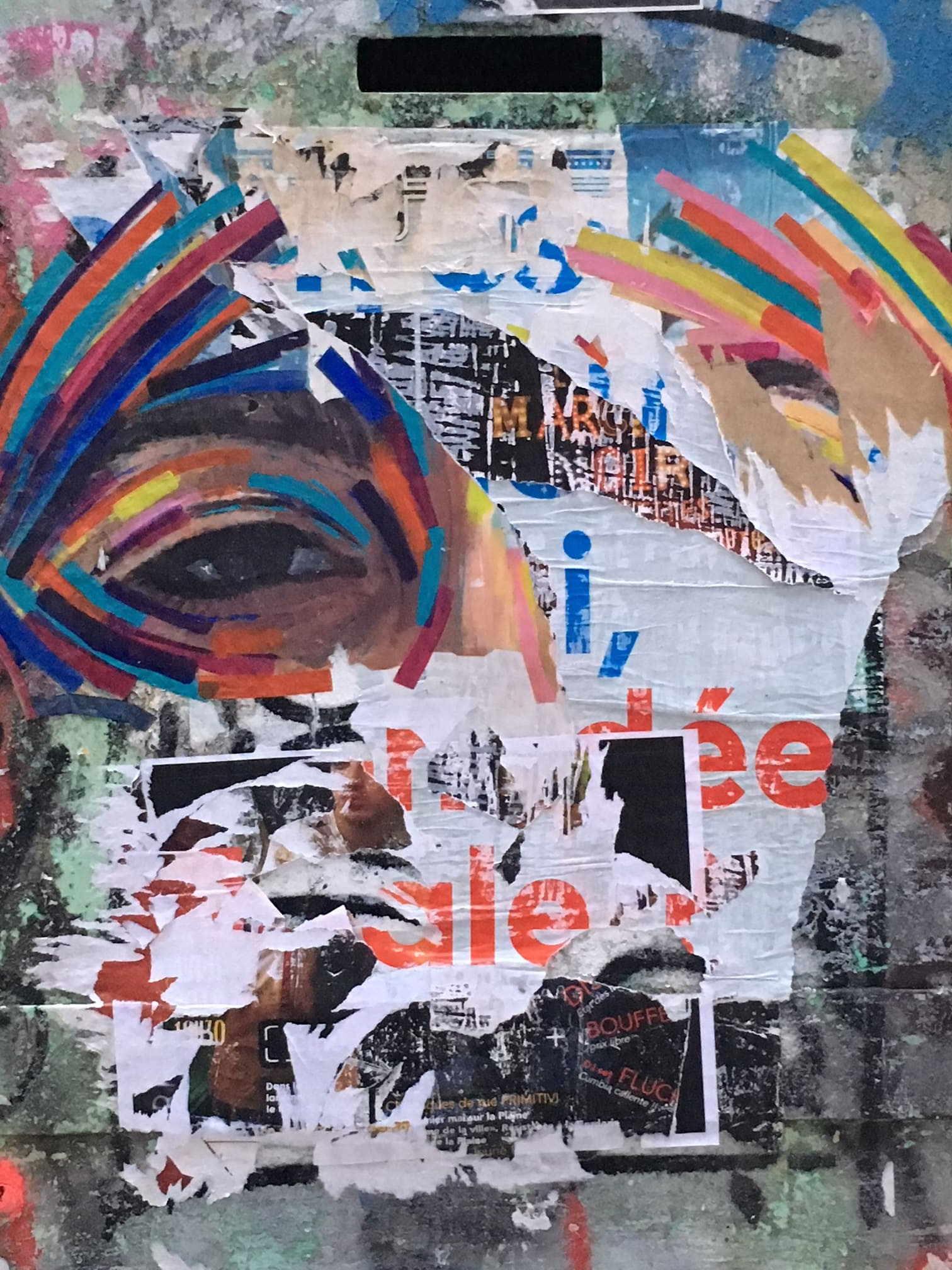
Le crew Dantès
Je ne sais pas vous, mais les musées, moi, je n’en peux plus. Trève de black box et de white cube, fini la scénographie immersive, je ne veux plus entendre parler de musées : je vais dehors me balader et prendre l’air.
Je vais dehors, en ville, m’imprégner de la culture urbaine. En passant rue Curiol, je suis en bas du conservatoire, j’y entends du violon pendant qu’en contrebas des gamins passent des basses sur leurs portables, je continue mon chemin et j’arrive rue Boris Vian : ça y est je suis dans la rue de la bibliothèque et je m’engouffre dans les boyaux marseillais qui serpentent derrière le cours Julien.
Je parle de boyaux car on y voit des tripes sur les murs: des personnes qui y ont projeté la rencontre sérigraphiée du troisième type entre une tortue géante et un plongeur, des squelettes bien vivants qui dansent sur les murs d’un bar. Je me sens bien ici, au milieu de ces ruelles que les graffeurs ont parées de leurs peintures nitro alkyde ou d’acryliques. Plus loin je croise le regard d’un fakir et celui d’une femme qui allaite son enfant multicolore. Ici, ce sont des fresques spontanées, là ce sont des prises de parole intempestives qui surgissent dans les rues insoumises de Marseille. J’ignore pourquoi j’ai cet attrait pour le mur peint : les blagues qu’il me propose, les illustrations qu’il m’inspire… j’ai l’impression que la ville est une pote plus qu’une amie, qui me fait rire, me fait penser, me fait divaguer.

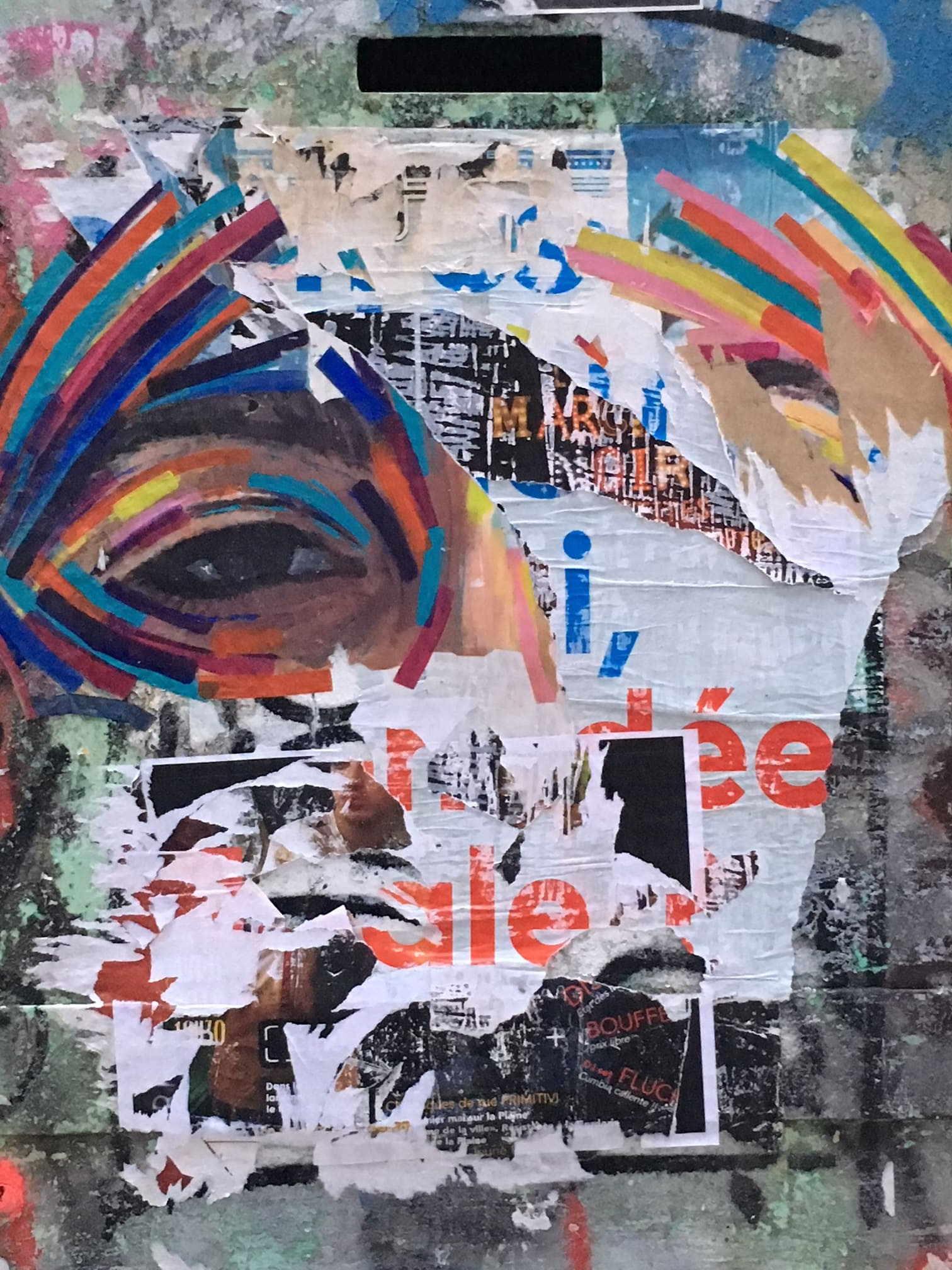
Changements d’échelles entre fresque et reste de sketch © CC
Mais pensez vous que la route s’arrête ici? Certes non, à l’aventure! Direction le Château d’If, fier bout de caillou dans lequel je ne pense pas que j’aurais aimé croupir. Depuis 1529 il est construit afin d’être une prison : contrôle du passage maritime et des penchants révolutionnaires marseillais..: pour quelqu’un qui ne voulait pas s’enfermer! Aujourd’hui il est un bâtiment dirigé par le Centre des Monuments Nationaux, c’est un lieu de patrimoine où on aime se perdre pour mieux en explorer les recoins. Quoi de mieux alors que de se risquer dans les pas d’Edmond Dantès? Je m’évade peu à peu, en guettant les graffitis : vous me voyez venir, il y en a plein.
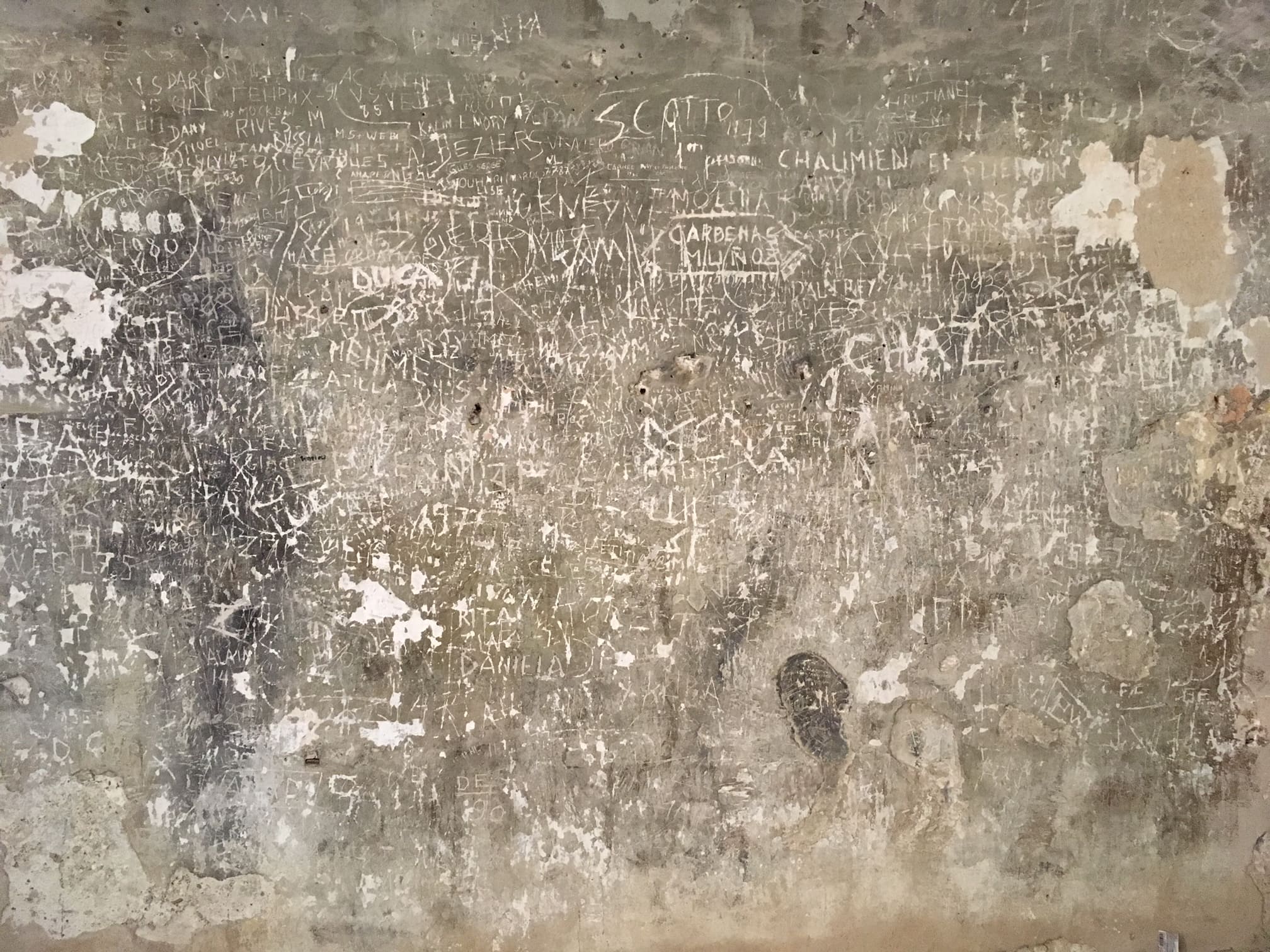
Graffitis sur le mur d’une geôle du Chateau d’If © CC
Bien entendu, il y a ceux des prisonniers, puis ceux des soldats, mais il y a aussi et surtout ceux des curieux qui viennent découvrir le Château d’If depuis son ouverture à la visite en 1880. Et en cherchant leurs marques, je finis par en trouver d’autres à l’air curieux.

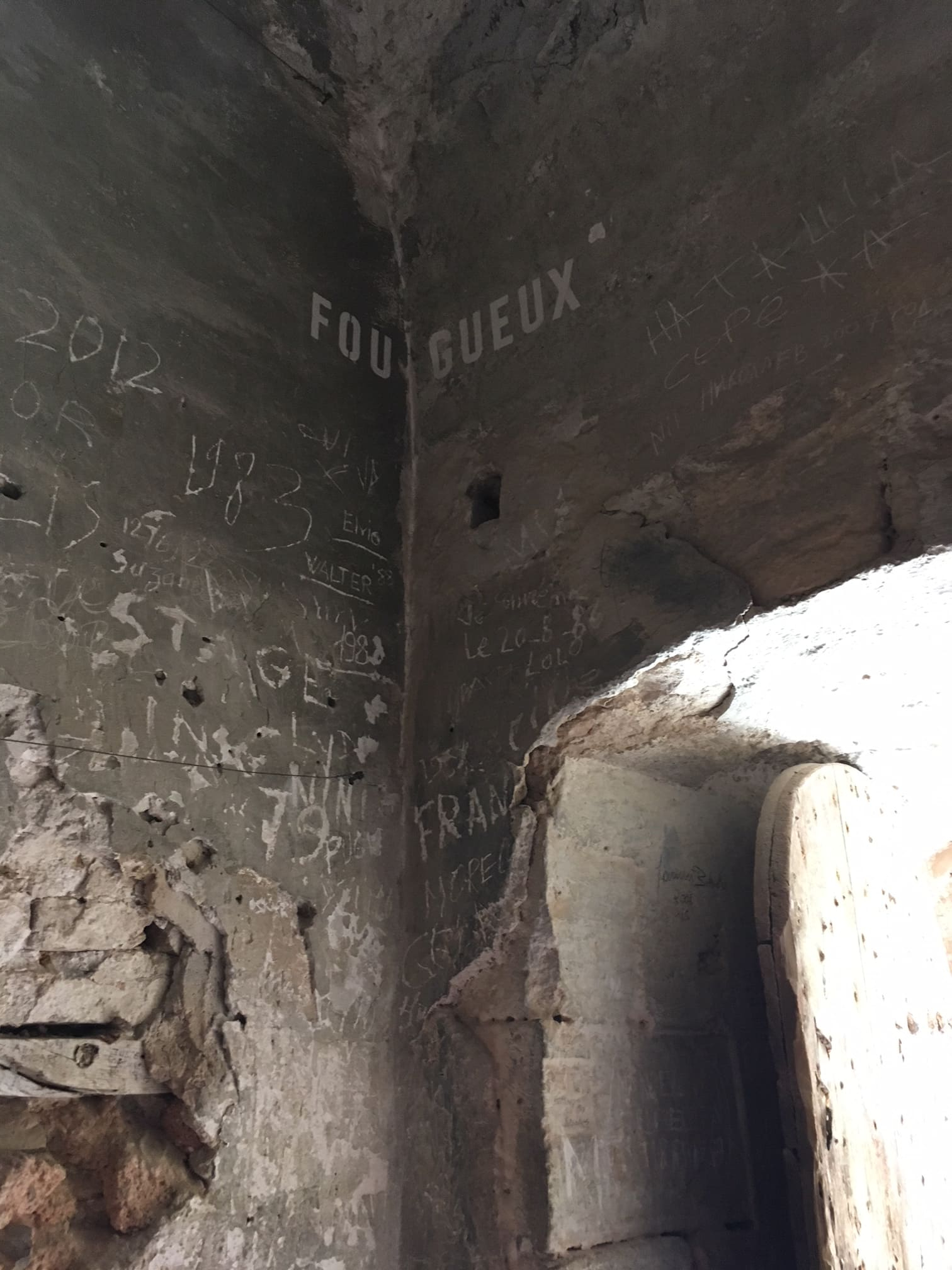

En levant les yeux, des mots-d’angles de David Poullard et Marie Chené © CC
Effectivement, de mai à novembre 2018, l’exposition “Un amour de graffiti”, prend place dans les geôles et sur les murs de l’ancienne prison. A la croisée des initiatives de MP2018 Quel Amour et de la saison nationale du Centre des monuments nationaux « Sur les murs, histoire(s) de graffitis », l’exposition propose à des acteurs originaux du graff de prendre leurs marques sur place. Cinq ans après MP2013, le bassin marseillais se gorge d’une programmation culturelle amoureuse qui dynamise le territoire et qui rencontre parfois des démarches nationales comme celle du CMN qui cherche à comprendre ce qui pousse à prendre la parole sur les murs. Au programme au Château d’If: des recherches sur les mots, une installation de Madame, mais aussi des zooms sur les graffitis que vous n’auriez pas relevés au milieu de ce brouhaha scriptural.
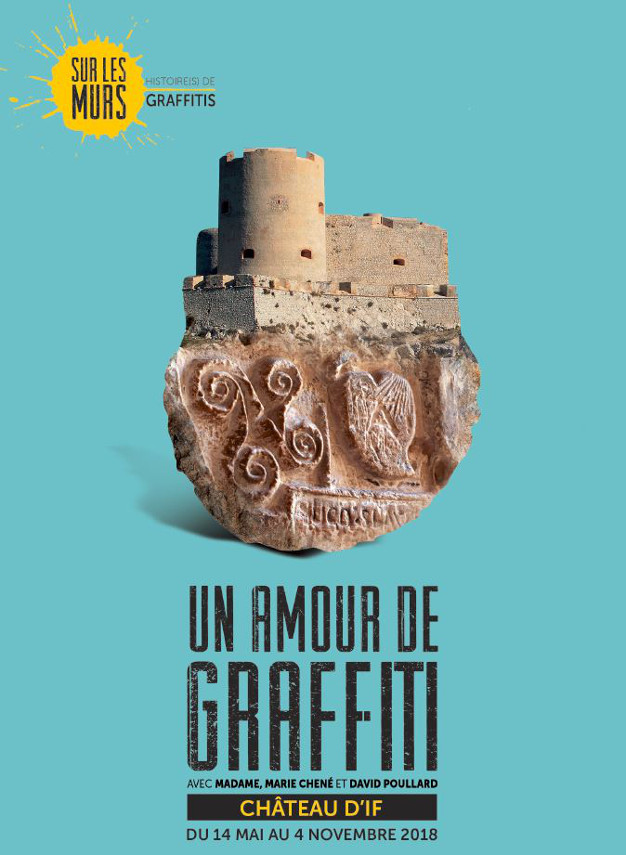
Affiche de l'exposition
En sortant de là, qu’est ce que je me dis? Je me dis que je suis touchée, de ces gens qui ont spontanément pris la parole. En fait peu importe le discours que l’histoire de l’art a et aura sur le graffiti, j’aime l’expression lire / libre que tout un chacun aura fait jaillir sur les murs. Peu importe le propriétaire du mur : collectivité, mairie, copropriété…l’important est la pensée ou le bon mot qu’il véhicule. Je vous en prie, vous même, prenez vos stylos,vos sprays,vos pochoirs, vos burins, vos stylets, dites que vous êtes passés par là, que vous vous êtes aimés ici, que vous comptez les jours qui nous séparents, criez vos questions, avec ou sans fautes d’orthographes, avec ou sans signature, l’important est d’y mettre ses tripes.
Coline Cabouret
#Graff
#Sur les murs
#Château d’If
#Tripes
Pour en savoir plus sur la programmation de MP2018:
http://www.mp2018.com/presentation/
Pour vous faire prendre l’air:
http://graffitivre.tumblr.com/
Le drag et la scène ballroom : entre divertissement, politisation et art
La performance drag s’introduit et tente de se faire une place parmi les pratiques artistiques reconnues. Récemment, les drags queens gagnent les galeries et les musées. Elles affirment ainsi leur place non seulement en tant qu’artistes, mais aussi en tant qu’icônes fondamentales de la diversité et de la créativité au XXIe siècle. Toutefois, si leur présence s’accroît, rares sont les institutions qui leur consacrent une exposition entière.
© Din, Pexels
Le 6 avril dernier, la Piscine de Roubaix organisait un concours de drag queens en partenariat avec l’école Esmod de Roubaix. Dans le cadre d’une exposition rétrospective de Jeremy Deller, le musée des Beaux-Arts de Rennes a accueilli une performance de drag queens. Le Palais des Beaux-Arts de Lille avait également présenté une soirée spéciale “Drag Palace” en juin 2024. Les performances et artistes drag sont surtout citées de manière succincte ou prennent part à la programmation autour d'une exposition dans le cadre de médiation, d’atelier ou de hors les murs, comme si elles ne pouvaient franchir ce plafond de verre de la reconnaissance institutionnelle muséale.
Naissance d’un divertissement artistique
Le drag, tel que nous le connaissons aujourd’hui, s'épanouit dans les années 1960 aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi en France, à Paris, en particulier dans le quartier de Pigalle. Il se développe autour de la performance scénique dans les bars et cabarets, lors de compétitions pendant lesquelles plusieurs concurrentes s’affrontent dans des épreuves de roast and shade, de lip sync, de danse ou encore de catégories. Ces compétitions prennent un nouveau tournant avec la création de la scène ballroom. En effet, à la fin des années 60, les compétitions qui ont lieu principalement à Harlem à New York, sont constamment gagnées par des drag queens blanches. Les compétitrices noires et latinas décident alors de quitter cette scène et de créer la leur. En raison de leurs conditions de vie précaires, elles ne peuvent louer que des salles municipales de bal. Par métonymie, ces nouveaux lieux de rencontre et de développement d’une culture propre, prennent le nom de ballroom. Initialement, la ballroom est composée principalement de femmes trans africaines-américaines ou latinas, mais s’élargit rapidement.
Se développe également la communauté drag king. De la même façon qu’une drag queen s’approche d’une esthétique dite « féminine » en performant les stéréotypes du genre féminin, un drag king se tourne vers une esthétique dite « masculine », en performant les stéréotypes du genre masculin. Toutefois, le drag king n’est pas le pendant masculin absolu de la drag queen. Plusieurs chercheureuses situent la naissance des pratiques king au début des années 1990, dans les bars underground de New York, de San Francisco et de Londres. Si les drag kings s’inspirent des mouvements queer nés aux États-Unis à la fin des années 80, ils s’inscrivent également au sein d’une culture de la performance et du travestissement bien plus ancienne, qui remonte aux années 1860.
Vers la reconnaissance d’un art vital
Dans un premier temps, la scène ballroom est un espace-temps non-mixte, sorte de parenthèse safe loin d’un monde discriminant et dangereux comme scène clandestine, car illégale. Il s’agissait de lieux de rencontre, de création, de divertissement, de fête, de libération et de spectacle où étaient célébrés des corps et identités discriminées. Le drag est aussi un exercice de libération identitaire, un affranchissement des codes. Pour beaucoup, le fait de pouvoir s’exprimer et d’être soi sans peur est libérateur. Le fait de s’habiller de tenues extravagantes, colorées et pailletées a un effet performatif de la joie. Il s’agit pour les drag queens et kings de faire une performance pour répandre cette joie et cette fête. Ainsi, ielles sont de véritables performeureuses multidisciplinaires. En plus de se maquiller, confectionner leur tenue et perruque, ielles mettent au point de véritables spectacles, alliant différents arts de la scène. Progressivement ielles sont reconnues comme telles, même si cela reste lent et minime. Cette reconnaissance intervient surtout dans les années 2000, notamment grâce à l’émission américaine RuPaul Drag Race, lancée par la célèbre drag queen RuPaul. Cela participe largement à l'intégration de la culture drag à la culture populaire américaine. Ces dernières années, la communauté ballroom connaît également un regain de visibilité notamment grâce au succès de la série Pose. Ce n’est pas la première fois que le drag et la culture de la scène ballroom connaissent une résurgence dans la culture populaire. Dans les années 90, les films Paris is Burning et Priscilla, folle du désert, avaient provoqué l’intérêt et le dépassement des frontières américaines, notamment en France grâce à Mother Niki Gucci et Mother Lassandra Ninja. En 1990, Madonna « strikes a pose », dans sa chanson Vogue, reprenant les mouvements du voguing, danse née au cœur de la scène ballroom dans les années 70. Toutefois, il faut mettre en avant la longévité inédite de ce récent engouement. RuPaul est une figure de la pop culture depuis plus de 10 ans. Avec la génération YouTube et les réseaux sociaux, de plus en plus de drag queens émergent. Certaines vont même au-delà du drag comme performance, comme la drag queen américaine Violette Chachki, ou la française La Grande Dame défilant comme mannequin pour des marques de luxe comme Prada, Moschino ou encore Jean-Paul Gaultier. Si l’émission et les différentes franchises donnent accès au grand public à l’envers du décor, cela se fait dans le cadre du divertissement. De plus, le caractère léger voire frivole des performances, rend pénible sa reconnaissance comme art à part entière. Esthétique révolutionnaire et nouvelle manière de faire performance, le drag s’inscrit pourtant dans la lignée des arts du spectacle.

© Kamaji Ogino
Le dérangement des codes et identités genrés.
En tant qu'élément important de la culture queer, le drag dérange non seulement parce qu'il introduit de nouvelles valeurs esthétiques, mais aussi et surtout parce qu'il prône les différences et s'attaque aux idées préconçues sur le genre et les identités différentes qui existent dans la société. Le drag dérange les codes et met en avant une pluralité des genres, mais surtout la fluidité d’expression de genre puisqu’il s’agit de créer son personnage. De même pour la scène ballroom de manière générale, qui promeut l’inclusivité en opposition à la société discriminante. Les compétitions célèbrent toutes les identités, alliant mode, esthétisme, performance. Le drag et la scène ballroom cherchent à effacer toutes les distinctions d’origine, de genre et de sexualité.
A la fin des années 80, la pensée queer se théorise et accompagne la diffusion de la culture de la scène ballroom. Cette pensée pose ce principe fondamental : le genre est une construction sociale et non une définition biologique. La binarité homme/femme est remise en question. L’avènement de cette pensée prend place en 1990 lorsque Judith Butler publie l’essai fondamental Trouble dans le genre. Instaurant la théorie queer comme discipline universitaire, cet ouvrage est la rampe de lancement des études du genre. De même, lorsque Monique Wittig publie The Straight Mind (1992), exposant le contrat hétérosexuel comme régime politique au fondement de la société binaire et patriarcale.
Ce sont des questions encore très actuelles et le drag, comme pratique du divertissement, est idéal pour une génération critique du genre. Une réelle corrélation existe entre la théorie des études du genre et la pratique du drag. Non seulement transgression du féminin et du masculin, le drag invente des créatures queer surréalistes avec le mouvement des clubskids qui interprètent non pas un personnage genré, mais une sculpture vivante.
De manière générale, cette nouvelle scène artistique tente de faire comprendre et accepter l’abandon d’une société binaire. De multiples ateliers tels que les ateliers de Louise De Ville, qui a importé le drag king en France à partir des années 2000, sont créés et ouverts à toustes pour apprendre les bases de cette pensée minorisée. Thomas Occhio, drag king français, explique l’aspect politique fulgurant de la scène drag à la lumière de sa déconstruction du patriarcat et de toutes les injonctions féminines sur l’appropriation de l’espace et des corps. Le fait d’être dans une société patriarcale donne une dimension politique au drag king. Là où la drag queen présente une ode à la féminité, le drag king prend exemple sur une masculinité dominante, néfaste.
L’art du drag et la culture de la scène ballroom questionnent des grands concepts comme la féminité, la masculinité, mais également l’hétérosexualité, la blanchéité et les classes sociales. Il met l'accent sur l'intersectionnalité et la multidisciplinarité.

© Rosemary Ketchum
Le corps : un étendard politique
L’art du drag et plus généralement la culture de la scène ballroom sont par essence politiques. Toutefois, il faut exercer une distinction entre la conscientisation et la politisation. L’art du drag est politique en soi, car il vient questionner de grands concepts, et apparaît même comme symbole de résistance et de résilience. Mais cela est-il fait en conscience d’être politique ?
La scène ballroom apparaît comme cas d’école de l’incarnation de l’intersectionnalité, de la pratique artistique comme pratique politique parce que c’est une culture, un mouvement. Elle est une scène intrinsèquement politique mais pas nécessairement politisée : politique parce qu’elle a été créée pour des raisons politiques dans un système raciste, patriarcal et classiste, mais elle n’est pas constamment dans le pro-activisme, dans un militantisme de terrain.
Souvent, un but politique est projeté sur la scène ballroom, voire militant, ce qui implique une conscientisation. La scène ballroom est une scène queer racisée noire-latina donc elle est politique en soi parce qu’elle est l’avènement de la revendication, la volonté d’existence, de représentation de cette communauté par elle-même et pour elle-même. De plus, elle est le lieu de la mise en mouvement de corps minorisés. La mise en mouvement d’un corps est politique ; mais concernant les corps minorisés, exister dans la rue est un acte politique, même involontaire, car ces corps sont discriminés et à l’encontre des codes imposés par les groupes dominants. Toutefois, cette politisation n’est pas forcément conscientisée, ou revendicative.
Il convient de distinguer les artistes dépolitisé.e.s et celleux apolitiques pour des raisons stratégiques. Une branche tend vers le mainstream, au profit d’une plus grande visibilité quand une autre plus radicale crée des espaces militants pour porter les messages. Prenons l’exemple de la drag queen Symone, gagnante de la saison 13 de RuPaul Drag Race. Après avoir défilé avec un durag, elle affirme : « Durag is a part of black culture and I wanted to celebrate that on the stage ». Pour l’épisode 9, elle défile également les mains en l’air, vêtue d’une longue robe blanche sur laquelle on peut voir à l'arrière deux trous de balles, ainsi qu’une coiffe blanche sur laquelle est écrit « Say their names », tout en énumérant les noms de Breonna Taylor, George Floyd, Brayla Stone, Trayvon Martin, Tony McDade, Nina Pop, Monika Diamond en voix off. D’autres comme Courtney Act ou Nina West de la saison 11 s’affirment également activistes et leurs performances sont militantes.
La mainstreamisation : entre visibilisation, reconnaissance et appropriation
En raison du succès rencontré, l’art du drag et la culture de la scène ballroom sont sortis de leur sphère initiale pour le mainstream et la pop culture, pris dans des logiques de capitalisation et de mainstreamisation. Les codes d’émancipation de la scène ballroom sont davantage célébrés, mais principalement lorsqu’ils sont dépolitisés.
Deux visions apparaissent alors : l’une positive, car cette mainstreamisation apporte de la visibilité sur des groupes minorisés et permet à davantage de personnes de s’identifier et de ne pas se sentir isolées. La mainstreamisation est intéressante en ce sens qu’elle permet d’exister hors de la ballroom. Elle permet la représentation culturelle. Une autre vision, plus négative apparaît lorsqu’un public non concerné intègre la scène ballroom et les performances drag et capitalise. D’autant plus que dans cette capitalisation, les personnes employées pour représenter la scène ballroom ne sont pas nécessairement les principales concernées.
La marchandisation du drag, l'introduction d'une recherche pécuniaire, semble nier son aspect politique. Mais cette critique essentialise les identités. La rémunération et la professionnalisation sont une manière pour les drag queens et drag kings de se faire reconnaître et d’être pris.es au sérieux. Il faut nuancer la condamnation du profit puisqu’il concerne des personnes évoluant dans les marges, voulant parfois en sortir. La fidélité aux marges est une posture théorique, car toute personne a besoin de revenus dans un système capitaliste. Cela reflète l’injonction à la pureté militante contre la monétisation d’une identité ainsi que le refus de la sociologie d’allier expérience et expertise perpétuant le mythe du faux activiste intéressé.
Le problème de cette mainstreamisation est donc l’appropriation non-respectueuse de cette culture par la classe dominante.
Dans sa conférence « Décolonisons ledancefloor » (2017), l’activiste queer et féministe Habibitch dénonce l’appropriation culturelle qui découle de cette mainstreamisation. Iel explique que « toutes pratiques artistiques créées et fédérées par les communautés marginalisées sont au centre du processus d’appropriation culturelle ». Il y a appropriation culturelle quand il y a capitalisation donc profit, qu’il soit matériel ou immatériel, d’éléments de cultures d’un groupe dominé, par le groupe dominant. Habibitch inscrit cela dans un continuum colonial : parce qu’aujourd’hui la colonisation géographique et territoriale est moindre, c’est la culture qui est colonisée. Iel reprend ainsi les mots d’Aimé Césaire dans son Discours sur le colonialisme (1950) dans lequel il explique l’effet retour du colonialisme par l’appropriation culturelle. Ce continuum colonial passe d’une colonisation matérielle à une colonisation immatérielle, qui s’exprime dans le domaine de la culture et du symbolique.
Régulièrement, les groupes dominants se saisissent de pans culturels de l’Autre, font du profit, ne prennent pas en considération la charge mentale et la charge raciale des personnes ayant créé ces cultures dans un souci de survie. L’écrivain afro-américain Greg Tate résume cette friction en quelques mots : « Everything but the Burden », titre de son livre publié en 2003. En ces termes, il dénonce l’appropriation d’une culture de communautés minorisées pour en tirer profit et sans penser à la raison d’être de l’élément de culture en question, de son origine et de son aspect politique. Par exemple, le succès est davantage tourné vers le voguing – pratique de danse et performance - et moins vers la ballroom comme réunion d’individus. Il y a de la part de la classe dominante, une instrumentalisation des communautés minorisées par l’adoption de leurs codes.
La mainstreamisation est donc indissociable des notions de domination et d’asymétrie. Le risque ne réside pas dans l’impératif économique des communautés concernées faisant perdre la visée politique ; mais dans l’appropriation des dominants, invisibilisant les histoires passées comme présentes. De plus, la mainstreamisation entraîne l’arrivée d’un nouveau public au sein des clubs. Ces personnes, qui ne sont pas forcément de la communauté, peuvent par leur curiosité, fétichiser et exotiser les participant.e.s de la culture en question. Les menaces de rendre la scène moins safe et d’outer des personnes augmentent puisque de plus en plus de personnes filment et postent sur les réseaux sociaux. Il y a donc une responsabilité individuelle à respecter l’histoire de cette scène artistique quelle que soit notre identification.
L’art du drag rejoint la scène ballroom dans des impératifs intrinsèquement politiques. Les deux ont offert une incarnation possible de toutes ces personnes marginalisées et minorisées, dans un espace flamboyant et au croisement de toutes les identités. Cette nouvelle manière de s’exprimer par la performance, la danse, le maquillage et l’esthétique s’éprend du dancefloor qui devient le lieu parfait d’expression et de résilience en troublant les codes et identités genrées. Entre défauts de reconnaissance et appropriation culturelle poussée par la capitalisation et la mainstreamisation, l’art du drag et la ballroom ont des défis à surmonter.
Adèle-Rose Daniel
#Drag #Ballroomscene #Arts

Le droit d'inventaire des « Premières choses » - MARKK
Si les musées d'ethnographie ont longtemps eu le monopole de la représentation de l'altérité humaine, la crise traversée par l'anthropologie a conduit les musées de société à remettre en question le regard porté sur leur collection et le discours qui en découle. L'exposition « Erste Dinge » (Premières choses) se propose de revenir sur la constitution de la première collection du musée d'anthropologie de Hambourg.
« Musée de colonisateur », « musée du monde », entrer dans un musée d'anthropologie n'est plus un choix aussi anodin qu'auparavant. Comment pourrait-il en être autrement pour nombre de ces institutions créées au XIXe siècle à une époque où ethnographie rimait avec peuples exotiques ou primitifs ? Il faudra d'ailleurs attendre le début du XXe siècle pour que les anthropologues européens se rendent compte du rapport d'altérité dans leur propre continent, et de la disparition des cultures populaires sur l'autel du progrès. En 2006, Jean-Pierre Willesme, conservateur en chef du Musée Carnavalet, concédait que ce musée de la ville voulu par le baron Haussmann correspondait à « une mémoire de bonne conscience »1;pour une élite se satisfaisant des nouvelles larges avenues parisiennes ouvertes à l’air frais et aux canons, et pour une classe populaire pour qui le musée devait être un argument d'acceptabilité de la violence politique. Ce schéma est le même pour les musées ethnographiques, voire même à un degré supérieur : imaginez qu'une instance étrangère vous force à renier votre culture « archaïque » et vous impose une « modernisation », en échange de quoi quelques aventuriers viendront dans votre ville ou village acheter (dans le meilleur des cas) quelques objets qu'ils exposeront chez eux pour le plaisir de leurs semblables. Ces derniers pourront admirer de belles mises en scène de rituels traditionnels, ceux-là même qui ont perdu tout leur sens chez vous, car les Blancs y ont tué vos génies. Un changement radical du mode de pensée des musées ethnographiques est donc nécessaire, et c'est dans cet élan que s'inscrit le nouveau programme muséographique du musée de Rothenbaum, à Hambourg.
L'exposition « Erste Dinge. Rückblick für Ausblick » (Premières choses. Rétrospective pour une perspective) répond à deux impératifs actuels du musée : la prise en compte dans son discours des dynamiques humaines entre Hambourg et le monde, et un examen approfondi des collections selon les principes d'une anthropologie respectueuse des peuples. Créé comme un « musée de l'autre » qui cherche à « donner à voir le monde » des autres cultures que la sienne2, ce musée d’ethnographie a enclenché depuis une trentaine d’années plusieurs cycles de restructuration répondant à l’affirmation des anciens pays colonisés et à la nécessité de dialoguer avec lui autrement qu'à travers un rapport ascendant hérité du colonialisme. En juin 2018, sous l'impulsion de sa nouvelle directrice Barbara Plankensteiner, le musée est rebaptisé MARKK (Museum am Rothenbaum / Kulturen und Künste der Welt – Musée de Rothenbaum / Cultures et Arts du monde) et se définit comme « un forum de réflexion examinant de manière critique les traces de l'héritage colonial, les modes de pensée traditionnels et les enjeux de la société urbaine mondialisée postmigrante ». Signe d'un nouveau départ, l’exposition « Erste Dinge », première exposition semi-permanente proposée depuis, porte un regard réflexif sur les premières acquisitions du musée, alors simple bibliothèque devenue musée, comptabilisées dans l’inventaire de 1867.
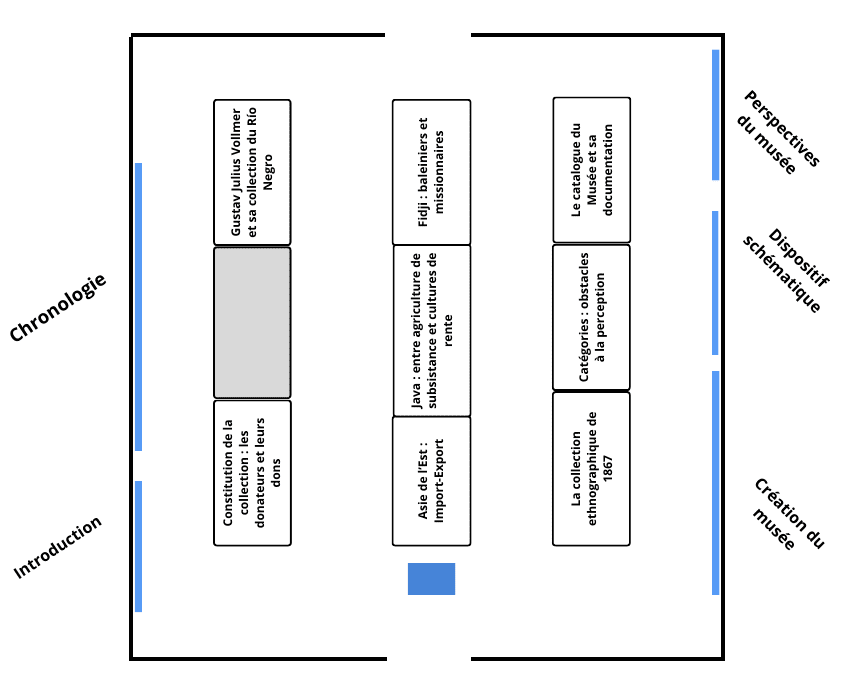
Figure 1 : Schéma de l'exposition ⓒ JT
Mondialisation et colonisation, mères de la collection de 1867
Le discours muséographique s'attache à montrer les liens étroits que tisse le musée avec la classe bourgeoise et moyenne commerçante de Hambourg. L'inventaire de 1867 recense tous les objets ethnographiques détenus par le Musée d'histoire naturelle de Hambourg, avant que ne soit mise en place une quelconque politique précise d'acquisition. Les donateurs des 650 objets recensés sont des acteurs importants de la ville, en lien avec les réseaux de marchands hambourgeois, à l'image de Gustav Julius Vollmer qui jouait un rôle de relais entre la société vénézuélienne et les expatriés allemands en Amérique du Sud. Des fonds ont ainsi été constitués à partir de réseaux relativement informels : selon le propos muséographique, il est par exemple probable qu'une partie des objets amenés des îles Pacifiques à Hambourg aient été rassemblés par des missionnaires méthodistes wesleyens dans le but de les vendre en Europe.
D'autres fonds d'objets, particulièrement ceux originaires de Chine et du Japon, sont au contraire le produit d'une industrie d'exportation orientée pour répondre au goût d'exotisme européen, tout en s'adaptant aux modes de vie occidentaux. Le visiteur assidu peut mettre en relation ces différentes origines d'objets avec la grande frise chronologique où se retrouvent pêle-mêle histoire mondiale de la mondialisation et de la colonisation, histoire nationale allemande, histoire commerciale des villes hanséatiques et le développement du commerce maritime à Hambourg. Cette représentation du commerce hambourgeois et du lien aux objets de l'inventaire est renforcée par une carte du commerce mondial où est indiqué le nombre d'objets inventoriés par région d'origine. On peut y lire, par exemple, que 221 objets proviennent d'Amérique latine (apparemment à la fois l'Amérique latine et l'Amérique du Sud) où les marchands vendaient des produits manufacturés en échange de matières premières tropicales telles que le sucre, le café, le tabac ou encore le cacao. Plusieurs encarts faisant référence à des routes commerciales de la carte permettent de découvrir l'intégration spécifique de Hambourg dans le commerce mondialisé ; la collection n'est plus seulement un ensemble d'objets sélectionnés scientifiquement, mais un rapport au monde historiquement situé et enchâssé dans des dynamiques qui peuvent être restituées : commerce des esclaves, commerce hambourgeois entre l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est, l'importance des baleiniers, etc…
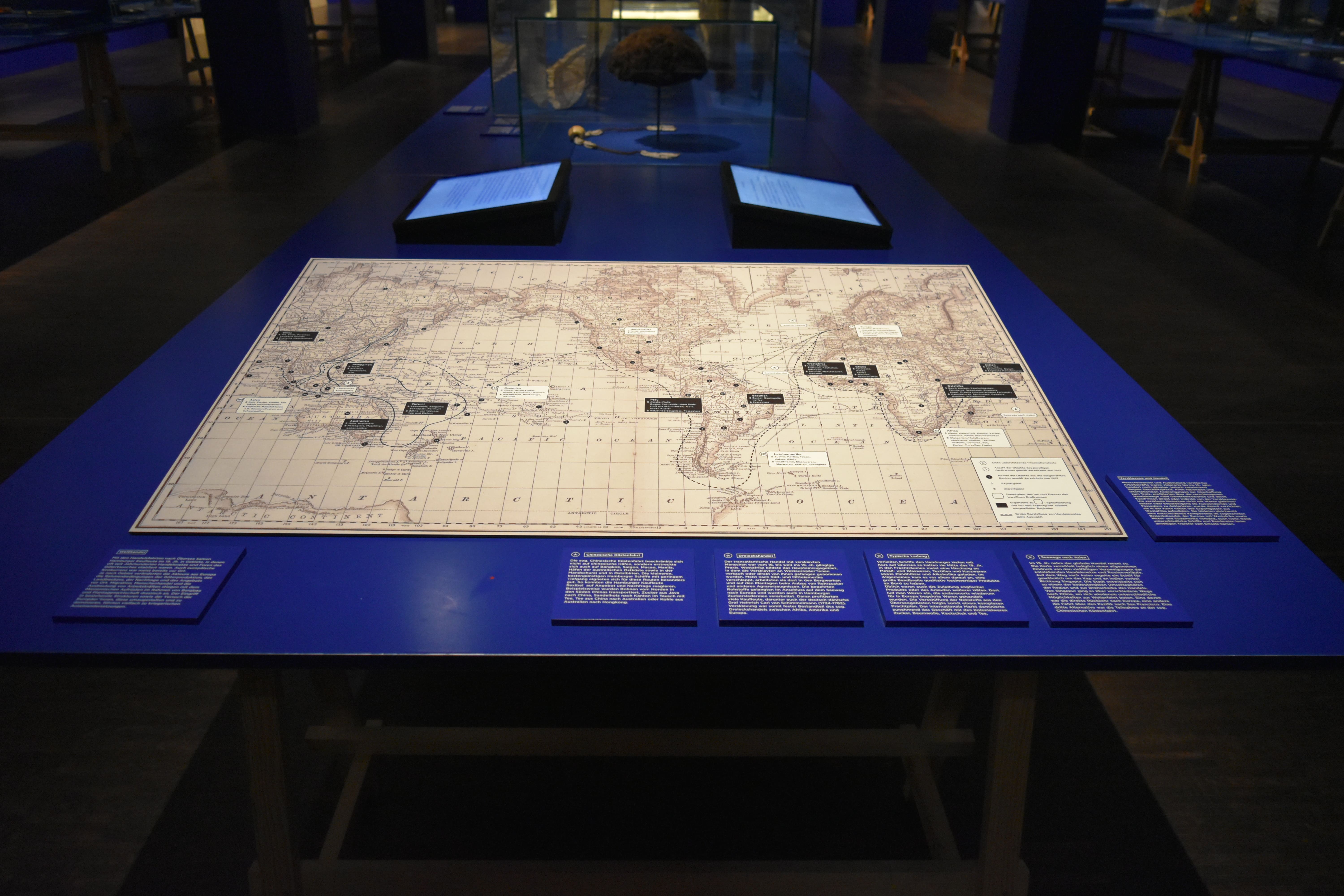
Figure 2 : Carte du commerce mondial, tablettes tactiles en arrière-plan ⓒ JT
Une anthropologie muséale hors-catégorie
Le second intérêt de l'exposition est l’interrogation portée sur les catégorisations des objets et la manière dont elles orientent la compréhension que nous avons de ces derniers, ainsi que de leurs sociétés d'appartenance. En 1867, la Commission du musée de la Société d'Histoire Naturelle prend la décision de classer les objets par région ou ethnie, faisant passer au second plan les logiques comparatives par type d'objet. Mais que faire alors des objets résultant de la rencontre de différents groupes ? C'est toute la problématique d'une ethnologie coloniale qui a longtemps voulu classifier le vivant (humains compris) sans voir les dynamiques d'échange culturel et de migration inhérentes à toute société en contact avec le monde extérieur. Le visiteur peut d'ailleurs se rendre compte par lui-même de la méthode de classement par ethnie en consultant les fiches historiques de l'inventaire sur une tablette numérique.

Figure 3 : Dispositif schématique ⓒ JT
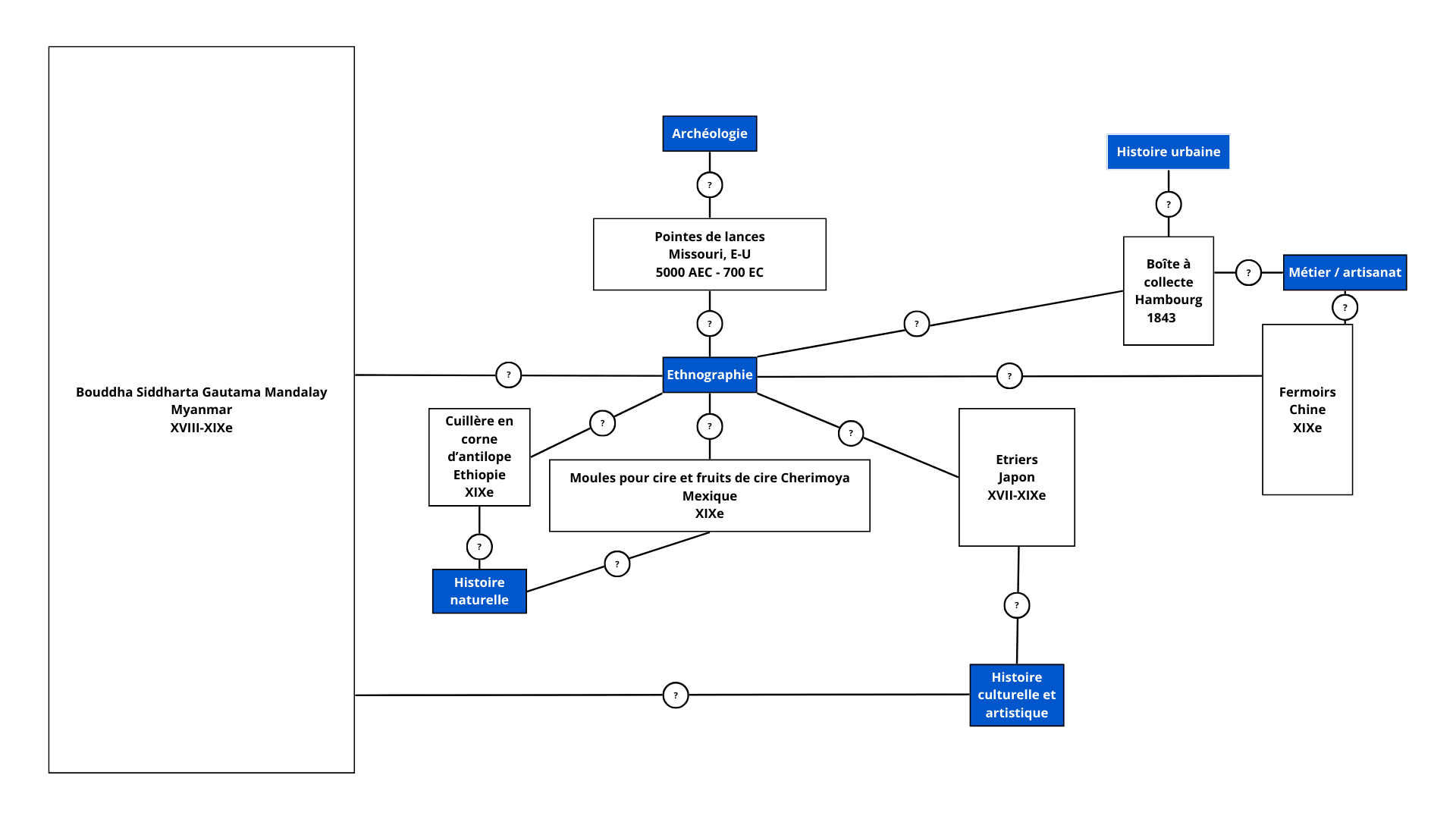
Figure 4 : Schéma du dispositif ⓒ JT
Enfin, l'un des dispositifs les plus originaux de l'exposition consiste en une disposition d'objets de façon à construire un schéma des types d'interprétations possibles selon le point de vue adopté, notamment disciplinaire. Si les objets sont rassemblés au musée pour leur intérêt ethnographique, tous peuvent être le support d'un autre savoir, comme les fruits de cire Cherimoya qui auraient autant leur place dans un Muséum d'histoire naturelle que dans un musée d'ethnographie (en termes de ressemblance à l'original, ils n'auraient pas à rougir des animaux empaillés). Cette proposition scénographique rappelle les réflexions de Thierry Bonnot dans L'attachement aux chosesoù il questionne les rapports sociaux aux objets : les classifications muséographiques sont à l'image de leurs contemporains, et c'est dans la relation que ces derniers tissent avec l'objet collecté qu’ils lui donnent du sens. Le dispositif reflète cette volonté de créer une nouvelle relation aux objets en les sortant de leur catégorie ethnique, en les mettant en relation à travers des disciplines qui ne sont plus aujourd'hui si étanches les unes par rapport aux autres.
Une métamorphose réussie ?
Seuls un an et demi séparent l'arrivée de la nouvelle directrice du musée et le vernissage de l'exposition Première chose, laissant penser que cette dernière a dû être montée rapidement pour répondre à l’agenda politique du musée et de la ville. La scénographie elle-même donne une impression de chantier à l'ensemble avec sa couleur bleue sans nuance et ses longues tables sur tréteaux, cet aspect work in progresscorrespond sans doute à la fois au propos de l’exposition et à son caractère transitoire. Malgré son air d’« exposition-manifeste », l'expographie n'a pas accouché de dispositifs interactifs ou participatifs qui traduirait une nouvelle approche dans les rapports de médiation. L’omniprésence du texte et la focalisation sur le seul sens de la vue sont des freins à la compréhension du message pour le plus grand nombre, tout comme l’absence de mesure d’accessibilité disponible au moment de ma visite.
Il n'en reste pas moins que le programme esquissé en discours s’est depuis traduit en acte : dès 2019, le musée a restitué au Musée national folklorique de Corée deux statues en pierre gardiennes de tombe achetées en 1987 à un collectionneur privé ayant outrepassé l'interdiction d'exportation des biens culturels en Corée. Ce nouveau départ a ainsi été l’occasion pour le musée de créer un partenariat de long-terme concrétisé par la mise en place de l'exposition semi-permanente « Uri Korea. Ruhe in Beschleunigung » (Uri Corée. Calme en accélération, depuis le 15 décembre 2017) sur le quotidien contemporain des Coréen.nes. Les expositions actuelles reflètent cette nouvelle politique de rupture de la représentation Soi/Autre, de rééquilibrage des rapports entre anciens pays colonisateurs et colonisés, et de participation concrète des acteurs culturels à la conception des expositions.
Julien TEA
Ouverture : 12 septembre 2018 - exposition semi-permanente, visitée en décembre 2022.
[1] Jean-Pierre Willesme, « Le musée Carnavalet : mémoire et patrimoine de la Ville de Paris » dans Andreas Sohn (ed.), Memoria : Kultur - Stadt - Museum. Mémoire : Culture- Ville - Musée, Bochum, D. Winkler, 2006, p. 284. ↩
[2] Benoît de L’Estoile, Le goût des autres: de l’Exposition coloniale aux arts premiers, Paris, Flammarion, 2007, p. 17. Un « musée de l'autre » se compose d’une représentation finie d'un univers culturel (mise en ordre) tout en offrant une expérience d'altérité au visiteur (mise en scène) à travers la vue, sens le plus sollicité (mise en forme). ↩
Annexe :
Les expositions actuelles et leur lien au programme muséographique :
- « Benin. Geraubte Geschichte » (Bénin, Histoire volée, 17 décembre 2021 à mars 2025) présente dans son entièreté la collection de Bronzes du Bénin du musée avant que cette dernière ne soit restituée au Nigéria.
- « Jurte jetzt! Nomadisches Design neu gelebt » (Yourte maintenant ! Le design nomade réinventé, du 15 décembre 2023 au 3 novembre 2024) met en relation des yourtes de la collection et contemporaines pour présenter des problématiques liées à la mobilité, la durabilité et les compétences traditionnelles dans notre monde actuel.
- « Hey Hamburg, kennst Du Duala Manga Bell? » (Hey Hambourg, connais-tu Duala Manga Bell ?, du 14 avril 2021 au 7 avril 2024), conçue avec l'héritière de Duala Manga Bell, interroge l'héritage colonial et raciste de l'Allemagne et de Hambourg à travers cette figure de la lutte contre l'esclavage et pour l'égalité humaine.
- « Das Land spricht. Sámi Horizonte » (Le pays parle. Horizons sámi, du 8 septembre 2023 au 31 mars 2024) met en résonance les collections du musée avec des œuvres contemporaines d'artistes sámi, peuple victime d'ethnocide.
Pour aller plus loin :
- Sur le passage d'une anthropologie structurale vers une anthropologie de l'action : Bensa Alban, La fin de l’exotisme: essais d’anthropologie critique, Toulouse, France, Anacharsis, 2006, 366 p.
- Sur le rapport entre l'anthropologie et le contexte historique : Naepels Michel, « Anthropologie et histoire : de l’autre côté du miroir disciplinaire », Histoire, Sciences Sociales, 2010, 65e année, no 4, p. 873‑884.
- Sur le rapport entre l'individu et l'objet : Bonnot Thierry, L’attachement aux choses, Paris, France, CNRS éditions, 2014, 239 p.
#Allemagne ; #anthropologie ; #postcolonialisme

Le fonds de dotation, radeau de fortune(s)
« Dix ans de Fonds de dotation du Louvre, c'est très peu comparé aux huit siècles d'histoire du musée et pourtant, pour nous, c'est déjà beaucoup. Ces dix années ont permis d'installer le Fonds dans le paysage philanthropique français comme un exemple à suivre»1, Philippe Gaboriau, directeur du Fonds de dotation du Louvre depuis 2014.
À l'heure où les affres de la pandémie sévissent encore en France et menacent la stabilité économique du pays, les mesures sont encore floues quant au soutien financier et à la réouverture des lieux culturels après ces mois de confinement. Les premiers émois du ministre de la culture, soubresauts discrets et timides, murmurent que seuls les « petits musées » seraient autorisés à accueillir de nouveau du public ou que les monuments historiques bénéficieront d'un prêt garanti par l'état. Voilà qui confirme le désengagement progressif de l'état dans le financement des institutions culturelles alors même que le marché de la culture devient de plus en plus concurrentiel : les musées rivalisent en effet avec des fondations irriguées par des moyens colossaux. Dans ce contexte le fonds de dotation fait bien émerger une nouvelle forme muséale, hybride, bénéficiant de ses propres ressources, inspirée des musées américains et de leur système d'endowment funds. Radeau de fortune(s), promesse d'indépendance financière... Le cataclysme économique déclenché par le coronavirus lance un coup de projecteur sur la nécessité de ce dispositif pour la survie économique des musées.

Cercle de mécènes du musée du Louvre © https://www.louvre.fr
Qu'est-ce qu'un fonds de dotation ?
Dans la lignée de la loi Aillagon qui permet un avantage fiscal pour toute disposition de mécénat, le fonds de dotation est un nouvel outil encourageant lui aussi les financements privés vers des organismes ou des missions d'intérêt général. Cette structure juridique permet d'accueillir dons et legs de particuliers ou d'entreprises qui sont transposés dans le budget du musée. Le musée du Louvre est un pionnier en France et pour cause : c'est à la suite de l'implantation du nom « Louvre » à Abu Dhabi que la célèbre institution presse le gouvernement français de créer une nouvelle forme juridique pour disposer des quelques 120 millions cédés par les Émirats Arabes. La loi est promulguée le 4 août 2008, le Louvre ouvre son fonds de dotation en 2009. Et la formule a du succès : pas moins de 3 000 fonds ont éclos en France depuis 20082 ! Outil d'émancipation des financements publics, pensé pour faire fructifier les dons en investissant l'argent en bourse, le fonds de dotation permet d'accueillir des dons de particuliers comme d'entreprises pour mieux compenser la baisse croissante de subventions allouées aux établissements culturels depuis 2012 (pour exemple le musée du Louvre a perdu près de 30 millions d'euros de subventions publiques en dix ans)3. Ce phénomène s'explique à la lumière du modèle muséal états-unien. Les États-Unis ne disposant pas de ministère de la Culture, les musées américains fonctionnent majoritairement grâce à des financements privés permis par les endowments funds (entité interne au musée qui permet la gestion de capitaux). La France a ainsi adapté ce système en préservant une spécificité culturelle : celui de la séparation du fonds du musée en lui-même afin de garantir l'inaliénabilité des collections.
Un musée-entreprise au service de l'intérêt général ?
Plusieurs avantages à ce point. Le musée soutenu par des financements privés se détache entièrement des recettes de billetterie, ce qui pourrait encourager une plus grande liberté quant aux contenus scientifiques des expositions4. La pression de la rentabilité économique de l'exposition vis-à-vis du public étant réduite, nous pouvons espérer que l'institution devienne plus innovante. À noter également que le financement privé a déjà permis au musée du Louvre de mettre en place des projets importants développés sur du long terme comme la création de nouvelles infrastructures tels que le centre de conservation près de Lens et celui de Liévin pour lequel 1,4 millions d'euros proviennent du mécénat5. D'autres expériences de mécénat collaboratif ont également décuplé les capacités du musée : au Palais des Beaux-Arts de Lille, ce dispositif mis en place depuis 2017 a permis l'acquisition et la restauration d’œuvres d'art, de rénover les plans-reliefs de la collection, ou penser un programme de démocratisation culturelle6.

Logo du fonds de dotation du Centre Pompidou © Centre Pompidou
Si le fonds de dotation est un appareil protéiforme, adapté à la diversité des besoins des structures, il exige aussi de développer de nouvelles stratégies de management, notamment en suscitant le besoin de recruter plus de professionnels chargés de gestion des fonds. En plus de ces questions relatives aux ressources humaines, nous pouvons également interroger la manière dont est employé cette forme juridique. Prenons pour exemple le fonds Accélérations créé par le Centre Pompidou en 2018 : celui-ci semble être une belle vitrine pour le musée plus qu'un support d'innovation. Sept entreprises à ce jour sont partenaires du Centre pour réaliser ensemble une résidence d'artistes autour d'un thème pour le moins consensuel (pour cette saison 2018-2020, le sujet est « l'émotion »). De plus, les œuvres produites par les artistes dans ce cadre rentrent d'office dans les collections du musée. La volonté d'amplifier la visibilité des donateurs valorise davantage la place de l'entreprise dans la société plus qu'elle n'enrichit l'identité du musée. Difficile de définir ici dans quelle mesure ce type de mécénat, fédérateur d'entrepreneurs, soutient une mission d'intérêt général tant cette initiative constitue un bel outil de communication.
D'autre part, la création du fonds et sa rentabilité nécessitent évidemment d'y injecter des moyens importants. Pour le musée des Beaux-Arts de Lyon par exemple, le fonds est abreuvé chaque année de 50 000 euros provenant de son président, Raphaël Appert, directeur général du Crédit Agricole Centre-Est. L'impératif d'une manne de départ pour créer le fonds limite également les initiatives : l'administrateur du château de Versailles Thierry Gausseron déclare en effet qu'il faudrait au minimum 40 millions d'euros pour que la création du fonds puisse être rentable. Le fonds serait-il ainsi un outil qui bénéficierait en majorité aux grosses structures ? Cet argent une fois placé en bourse crée également des ressources qui peuvent être certes décuplées, mais qui demeurent instables. Cette privatisation progressive des musées ouvre la porte à une financiarisation croissante des institutions et des œuvres d'art : or, un musée est-il un produit financier comme un autre ?
Le fonds de dotation apparaît ainsi comme un levier d'expérimentation vers un statut entrepreneurial du musée. Seule échappatoire à un monde de la culture en crise.
E. B.
#dons
#mécénat
#muséesprivés
1 Philippe Gaboriau cité par : Martine Robert, « Le musée du Louvre profite à plein bénéfices de son fonds de dotation », in. Les Echos, 6 décembre 2019, [En ligne] disponible sur : https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/le-musee-du-louvre-profite-a-plein-des-benefices-de-son-fonds-de-dotation-1154327 (consulté le 15/04/2020).
2 Sarah Hugouneng, « Les fonds de dotation, une révolution pour financer les musées ? », Le Quotidien de l'Art, 23 avril 2020, [En ligne], disponible sur : https://www.lequotidiendelart.com/articles/17599-les-fonds-de-dotation-une-révolution-pour-financer-les-musées.html (consulté le 15/04/2020).
3 Ibidem
4 Fabrice Hervé, Rémi Mencarelli, Mathilde Pulh, « L'évolution de la structure de financement des organisations muséales : éclairage sur le rôle des endowment funds », Erudit, 28 juillet 2011, [En ligne], disponible sur : https://www.erudit.org/fr/revues/mi/2011-v15-n3-mi1813695/1005432ar/ (consulté le 15/04/2020)
5 Ministère de la Culture. Le futur Centre de Conservation du Louvre à Liévin. [En ligne], disponible sur : https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Le-futur-Centre-de-conservation-du-Louvre-a-Lievin
6 PBA Lille. Musée privé. Mécénat. [En ligne] disponible sur : https://pba.lille.fr/Musee-prive/Mecenat

Le Louvre n'est plus un musée
Un tableau vous manque, et tout est chamboulé...
Définition adoptée par l’ICOM à l’assemblée générale de Vienne, 2007

Salle Médicis © Musée du Louvre

Salle Médicis © Didier Rykner

La Joconde dans la salle des Etats rénovée © Musée du Louvre / Antoine Mongodin
Le Louvre n’est pas le seul à rayonner au travers de quelques toiles ou sculptures et les critiques formulées plus haut - si elles entraînent de vives réactions comme celle de Jason Farago dans son article "It’s Time to Take Down the Mona Lisa" - ne lui sont alors pas propres. Si différentes institutions se permettent de déroger aux missions établies par l’ICOM dans sa définition du musée, peut-être alors la nouvelle définition proposée lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’ICOM à Kyoto en septembre 2019 peut aussi être un rappel à l’ordre en direction des directeurs de musée, afin de les faire réfléchir à l’orientation qu’ils devaient conserver.
Jade Garcin
#Joconde
#Louvre
#Icône
Article cité : https://www.nytimes.com/2019/11/06/arts/design/mona-lisa-louvre-overcrowding.html?smid=tw-nytimesarts&smtyp=cur

Le mal du voyage
Une touriste chez les Helvètes
Camarades de voyage, adieu !
Vous l’avez peut-être deviné, c’est en Suisse que je vous emmène, pour un roadtrip* au Musée d’ethnographie de Neuchâtel ! Sa formule « Black Box » à durée limitée m’a immédiatement séduite et j’ai fait mes bagages. Si vous n’avez pas le mal du voyage, n’attendez surtout pas pour en profiter, l’offre s’arrête le 28 mars 2021 !
Mais avant le départ, voici les incontournables à avoir dans son sac à dos :
- Le livre « L’idiot du voyage » de Jean-Didier Urbain
- De bonnes chaussures pour arpenter les 8 étapes du voyage
Jour 1 : Ce goût du voyage

 Le temple de la morale – Exposition Le mal du voyage, Musée d’ethnographie de Neuchâtel © L.C.
Le temple de la morale – Exposition Le mal du voyage, Musée d’ethnographie de Neuchâtel © L.C.
« Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas. »
Me voilà enfin embarquée dans l’avion, l’occasion rêvée pour une petite réflexion sur le voyage. Avez-vous déjà écouté les conversations des gens dans les transports ? Ne dites pas le contraire. En baladant mes oreilles, j’ai remarqué que mes compagnons de vol semblent tous connaître la « bonne » manière de voyager. Entre le youtuber écoresponsable (paradoxal n’est-ce pas ?), la bénévole qui se donne bonne conscience en tweetant #helpafrica, et le couple de begpackers* qui part en tour du monde, tout y est. La perle reste cet étudiant Erasmus en anthropologie qui jure que non non, il ne va pas du tout au Brésil pour faire la fête ou visiter le pays, mais pour étudier la culture des autochtones et qui, vraiment, aurait préféré rester chez lui pour lire du Lévi-Strauss. Finalement est-ce qu’une bonne manière de voyager existe vraiment ? Pour ma part, j’assume mon statut de touriste. Après tout, je le fais aussi pour vous, mes fidèles followers !
Jour 2 : Plage aux mille visages

 Welcome to everywhere – Exposition Le mal du voyage, Musée d’ethnographie de Neuchâtel © L.C
Welcome to everywhere – Exposition Le mal du voyage, Musée d’ethnographie de Neuchâtel © L.C
Des vacances sans journée plage sont comme un touriste sans appareil photo : un sacrilège. Munie de ma crème solaire (respectueuse des océans attention !), je repère un transat libre : la parfaite invitation à se poser. Objectif : bronzage au top ! J’ai passé la soirée d’hier à me préparer pour venir à la plage, je compte bien la rentabiliser. Heureusement mon summer body* était prêt à temps ! Mais ne croyez-pas que je viens ici juste pour me dorer la pilule, j’ai aussi tout prévu pour une séance de snorkeling* afin de découvrir la faune et la flore marine. Du moins c’est ce que je croyais… ! Je n’ai vu pratiquement aucun poisson, et seulement quelques coraux blancs, c’était vraiment décevant. Alors que je barbotais au milieu d’autres groupes de touristes, j’ai entendu quelqu’un dire qu’il y avait eu une attaque de requin le mois dernier. C’est vrai qu’avec tout ce monde, on oublie parfois que l’on est sur le territoire d’autres animaux. Finalement, je crois que je vais regagner mon transat, me laisser bercer par la musique et méditer sur le slowtravel*. Mais à la deuxième chanson, la radio grésille. Une voix explique qu’un bateau de migrants s’est échoué sur une plage d’un pays voisin… Il me semble que des nuages jettent une ombre menaçante sur la plage. Il est temps de rentrer.
Jour 3 : Boulimie culturelle

 L’appétit du monde – Exposition Le mal du voyage, Musée d’ethnographie de Neuchâtel © L.C
L’appétit du monde – Exposition Le mal du voyage, Musée d’ethnographie de Neuchâtel © L.C
À peine réveillée, la chanson « Voyage Voyage » me trotte encore dans la tête. Mais pas de temps à perdre, aujourd’hui est une journée placée sous le signe du patrimoine ! Armée de mon pass « 1 journée 4 monuments », je fends les foules de touristes massées devant les bâtiments patrimoniaux. L’attente est longue, mais le prix n’est vraiment pas cher, ça vaut la peine. Avant que je ne réalise, le soleil est déjà en train de se coucher. Je retourne donc dans mon Airbnb* situé en plein cœur de la vieille ville, super authentique... C’est si enrichissant, lorsqu’on part en voyage, de s’immerger dans la vie et le rythme des locaux. Franchement si c’est pour aller à l’hôtel, autant rester chez soi. Un apéro s’est improvisé avec mes voisins de palier, des Portugais, Américains et Polonais ; toutes ces rencontres sont une telle richesse multiculturelle ! Et quelle soirée… Nous avons fait la fête dans la rue jusqu’à 4h du matin, avant de nous faire réprimander par un monsieur qui a crié par sa fenêtre des mots incompréhensibles dans un patois local. C’est vrai que le bruit devait être gênant… Mais bon, c’est les vacances !
Jour 4 : Rallye photo

 La jungle des images – Exposition Le mal du voyage, Musée d’ethnographie de Neuchâtel © L.C
La jungle des images – Exposition Le mal du voyage, Musée d’ethnographie de Neuchâtel © L.C
Quel est le comble pour une baroudeuse qui s’apprête à faire une excursion en pleine jungle ? Oublier son appareil photo... Je suis dégoûtée en voyant tous les autres prendre des photos. Heureusement le téléphone portable me sauve et je capture tout ce que je peux, faisant fi de la mauvaise qualité. Le guide nous fait visiter un endroit connu seulement des autochtones : une oasis de verdure avec une cascade ! Mais avant que nous nous élancions, le guide nous dit de faire attention à ne pas tomber, il parait qu’un touriste s’est déjà gravement blessé en voulant prendre un selfie. C’est affligeant de penser que certains sont prêts à prendre autant de risques juste pour un selfie… Plus de 250 personnes sont déjà décédées comme ça ! Plus modeste, je me contente d’un post Instagram avec geotagging*, pour rendre mes amis jaloux.
Jour 5 : Permis de débauche

 La grotte des interdits – Exposition Le mal du voyage, Musée d’ethnographie de Neuchâtel © L.C
La grotte des interdits – Exposition Le mal du voyage, Musée d’ethnographie de Neuchâtel © L.C
Je suis bien trop fatiguée par l’excursion d’hier pour faire quoique ce soit aujourd’hui... Par chance, j’ai trouvé une émission sur le tourisme à la TV, l’excuse parfaite pour rester au lit ! Des touristes assis en cercle racontent leurs aventures de vacances plutôt douteuses. Ils avouent profiter de leurs escapades en pays lointain pour faire tout ce qu’ils ne peuvent pas faire chez eux au prétexte que « transgression, risque et déglingue forment la part initiatique du voyage ». Depuis les sports extrêmes jusqu’aux fêtes sauvages, ils profitent des lois beaucoup moins restrictives que dans leur pays d’origine. Le tourisme sexuel est un des services les plus demandés par les occidentaux aux fantasmes exotiques. Les locaux qui vivent du tourisme sont donc forcés d’offrir ces services. Et bien sûr, les hommes fortunés qui en profitent n’ont aucune contrainte ou responsabilité à assumer ensuite. D’ailleurs ils ne savent même pas qu’ils sont parfois pères…
Jour 6 : En terre lointaine
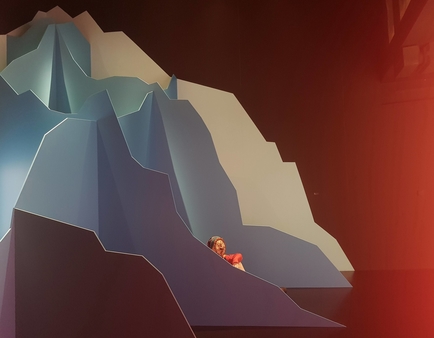
 L’appel des confins – Exposition Le mal du voyage, Musée d’ethnographie de Neuchâtel © L.C
L’appel des confins – Exposition Le mal du voyage, Musée d’ethnographie de Neuchâtel © L.C
« Tentez l’ascension du plus haut pic de la région et allez là où nul n’est jamais allé ! » disait la brochure. Il est illusoire de penser que je serais la première à atteindre le pic, mais peu importe, je m’engage dans ce périple en toute conscience. En bas de la montagne, j’ai le choix entre prendre un funiculaire, monter avec les chiens de traineaux… ou à pied. Je ne me démonte pas, ce sera à pied, un point c’est tout ! J’aurai au moins le mérite d’avoir réussi seule. Néanmoins, je suis bien heureuse d’être avec d’autres randonneurs pour grimper. À la queue leu leu, un rythme s’installe et nous saluons ceux qui descendent, motivés par leurs mots d’encouragement. C’est presque comme être sur l’autoroute, on accélère, on double, on sort les casse-croûtes, on demande si c’est encore loin et on discute durant des heures avec nos compagnons de route. Je fais ma BA du jour en ramassant les déchets qui bordent les chemins. L’arrivée en haut est triomphante, mais je suis frigorifiée. Alors quel bonheur de trouver un restaurant dans lequel me réchauffer après ce périple ! Exténuée, je redescends en funiculaire et je regarde mélancoliquement les skieurs par la fenêtre. La montagne cache encore bien des secrets, mais je vous laisse le soin de les découvrir…
Jour 7 : C’est le souk

 Le fabuleux laboratoire – Exposition Le mal du voyage, Musée d’ethnographie de Neuchâtel © L.C
Le fabuleux laboratoire – Exposition Le mal du voyage, Musée d’ethnographie de Neuchâtel © L.C
Maman, papa, mamie, tonton et tata, les neveux et nièces, la catsitter, le petit copain… Ok je crois que je n’oublie personne. Mon séjour touche bientôt à sa fin, ainsi le marché de souvenirs est un passage obligé ! Chaque étal attire mon œil et je sens déjà que le choix va être difficile devant la quantité d’objets proposés. On y trouve autant des attrape-nigauds stéréotypés, limite estampillés Made in China, que des objets d’artisanat tels que je n’en ai jamais vu ailleurs et qui illustrent parfaitement la dynamique de mondialisation. Par le tourisme, une nouvelle créativité émerge, inspirée par les attentes des voyageurs et qui se trouve au carrefour d’une multitude de cultures. Ces objets transculturels ne nous parlent pas des traditions du pays, mais de la manière dont les locaux pensent que l’on perçoit leurs traditions. C’est un dialogue, incarné dans un objet destiné aux touristes. Pour moi, ce dialogue prendra la forme d’une statuette « traditionnelle » faite main par un artisan. Celle-là rejoindra directement ma vitrine !
Jour 8 : Vous reprendrez bien un peu de mon voyage ?
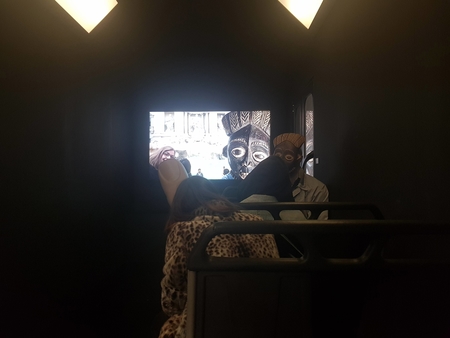
 Le blues du retour – Exposition Le mal du voyage, Musée d’ethnographie de Neuchâtel © L.C
Le blues du retour – Exposition Le mal du voyage, Musée d’ethnographie de Neuchâtel © L.C
Bagages pliés et prêts au retour, le mental un peu moins… Je profite du voyage en bus, direction l’aéroport, pour visionner mes 849 photos de voyage. Je vais préparer un diaporama, au cas où quelqu’un demande ! Je sais ce que vous allez dire : avalanche d’images superflues, déjà capturées par les milliers de touristes me précédant. Aujourd’hui presque tout le monde voyage et chaque voyageur suit les pas de ceux qui le précèdent. Mais pour ce voyageur, c’est une expérience unique et la tentation de la revivre avec ses proches, à travers des photos et récits est irrépressible. Or, l’expérience du voyage se vit et ne se raconte que difficilement. Alors vous qui me lisez encore, j’espère vous avoir transmis un peu de la magie de ce voyage et assez intrigués pour que vous ayez vous-mêmes envie de l’entreprendre !
Si ce voyage m’a appris quelque chose, ce sont les multiples facettes du statut de touriste et leur nature paradoxale. La découverte d’autres cultures et la confrontation avec d’autres modes de pensées sont essentielles pour sortir des préjugés et apprendre la tolérance et le respect. Le tourisme pose néanmoins des problématiques environnementales, économiques et sociales. Il n’existe sans doute pas de solution parfaite, mais il est important de repenser nos manières de voyager. D’abord en prenant conscience du caractère exceptionnel d’un voyage, mais aussi en étendant sa conception à plus qu’un hôtel demi-pension au bord d’une eau turquoise. Et si un voyage était aussi une nuit sous la tente dans le jardin, une découverte des villages de notre région ou… une visite au musée ?
Lexique des dessous du voyage :
Roadtrip : expérience indispensable sur un CV.
Begpackers : touristes occidentaux sans gêne, mendiant le luxe de voyager.
Summer body : référence corporelle irréaliste valorisée par les magazines féminins.
Slowtravel : dans la lignée de la tendance « slow ». Voyager lentement pour mieux s’imprégner du pays.
Airbnb : illusion d’authenticité sur fond de colonisation des villes et de disparition de la vie de quartier.
Geotagging : l’équivalent humain d’une lumière pour un papillon de nuit. Fléau pour les espaces naturels soudainement envahis de touristes.
Laurie Crozet
#suisse
#aventure
#tourisme

Le Mur de Berlin, un monde divisé : un discours plein de paradoxes, un visiteur troublé
Le Mur de Berlin. Un Monde Divisé. Un titre évocateur. Aujourd’hui, quand on pense au Mur de Berlin, on aime penser à sa chute. Symbole de révolte, de liberté et d’unification européenne. C’est la victoire d’un peuple contre l’oppression et le totalitarisme. Mais quand le Monde fait face aujourd’hui à une montée de l’extrême droite et que des conflits se pressent aux portes de l’Europe, l’ombre si menaçante du Mur de Berlin se disperse et ne semble plus qu’un vague souvenir. Aussi, un peu plus de 30 ans après la réunification berlinoise, Musealia, en collaboration avec la Fondation du Mur de Berlin, propose une exposition itinérante qui revient sur les événements ayant déchiré un peuple. Le Mur de Berlin. Un Monde Divisé ouvre pour la première fois à Madrid avant de partir pour une tournée mondiale qui s’étendra sur une décennie. Paris accueille, de mai à septembre 2025, l’exposition à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
Un parcours à la temporalité troublante
Au gré d’un long parcours très encadré, le visiteur traverse le temps et se confronte aux différents évènements qui ont mené à la construction du Mur. Dans une scénographie
sombre, à l’ambiance grave, le parcours linéaire propose au visiteur une histoire scénarisée en quatre grands axes chronologiques. Après avoir traversé plusieurs espaces relatant la fin de la Seconde Guerre Mondiale et son lendemain, la montée des superpuissances, la naissance de la guerre froide et la course à l’armement nucléaire, le visiteur fait face à un Berlin au cœur des tensions politiques mondiales. Dans cette deuxième partie de l’exposition “Avant le Mur”, l’Allemagne et Berlin, les grands vaincus de la guerre, sont fragmentés et petit à petit instrumentalisés par les vainqueurs. Puis le visiteur voit peu à peu naître le Mur et l’Allemagne se déchirer encore dans une troisième partie intitulée “Diviser et vivre avec le Mur”.
La longueur du parcours et la lenteur de la chronologie de ces trois premières parties participent à illustrer les étapes insidieuses qui ont progressivement mené à la construction du Mur. Le visiteur se remémore le parcours, essaie de comprendre quand cela a vraiment basculé. Au moment de la construction du mur physique ? Quand les premiers barbelés ont été posés ? À la mise en place des contrôles des allers et venues à la frontière ? À travers la chronologie du parcours qui s’étire, le visiteur peine à déterminer quand la situation devient critique et prend conscience du piège qui s’est peu à peu refermé sur la population berlinoise : une restriction, une interdiction, une surveillance et un jour, sans s’en rendre compte, la liberté n’est plus qu’un rêve inaccessible.
Quand le visiteur sort de la première galerie, la Bernauer Strasse est déchirée en deux, les Berlinois risquent leur vie pour fuir à l’ouest, d’autres risquent leur vie pour les
aider. Puis, le visiteur descend un escalier et pénètre dans la deuxième galerie où il est confronté à un dézoom rapide. Cette quatrième et dernière partie “La transformation
mondiale et la fin de la guerre froide” évoque la décolonisation, l’avancée technologique, les révolutions sociales et populaires en Europe et dans le monde. Et enfin, dans la dernière salle, c’est le 10 novembre 1989, le mur est tombé pendant la nuit, comme le montre une vidéo émouvante.
Face à tant d’informations, le visiteur peine à tirer le fil logique. Après un début d’exposition qui instaure un rythme lent et précis dans le déroulement des événements, la
résolution du conflit apparaît au visiteur comme floue et précipitée. Il arrive à faire le lien entre tous les événements, mais celui-ci est ténu. Et l'événement tant attendu, symbole de liberté et d’union, tournant décisif pour l’avenir de l’Allemagne et de l’Europe, est sommairement traité.
La dualité de la temporalité chronologique du parcours illustre un parti pris dans la narration de l’exposition. Cette dualité étonne et une question s’impose : quel était
exactement le sujet de l’exposition ?
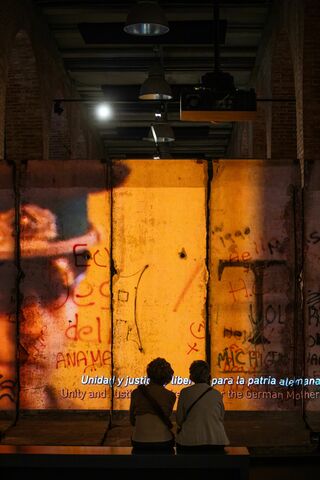
Visiteurs devant une projection de l'exposition Le Mur de Berlin. Un monde divisé ©Musealia.
Quelle place pour la mémoire dans une exposition historique ?
Le visiteur happé par l’exposition regarde sa montre. Ses pieds trahissent les 3h de visite qui viennent de s’écouler. Les quelques 200 objets exposés ainsi que la variété de la médiation ont su capter son intérêt.
L’audio-guide vient en renfort aux panneaux écrits et assure des respirations dans le parcours. Des schémas, des diagrammes ou encore des cartes allègent et complètent les textes, rendent les informations visuelles et claires. Quelques dispositifs interactifs numériques permettent au visiteur de s'arrêter dans sa déambulation et de devenir acteur de l’exposition. Un contenu numérique interactif particulièrement saisissant amène le visiteur à expérimenter divers types de bombes nucléaires sur différentes villes. Le visiteur voit le nombre de victimes augmenter et atteindre des chiffres inimaginables.
De la peluche, aux lits de camp, en passant par des photos, des vidéos, des journaux télévisés, des affiches de propagande mais également des bobines de barbelés, des
fragments de Mur, les expôts sont extrêmement divers pour incarner un fragment de l’Histoire. Finalement, bien que très académiques, la muséographie et la scénographie
mobilisent d’innombrables outils pour un parcours historique qui capte l’attention du visiteur.

Jochen l'ours (1909) Jörgen Hildebrandt, exposé © Musealia.

Fils barbelés (1961) Stiftung Berliner Mauer, exposés © Musealia.
Néanmoins, le visiteur ressent une certaine désincarnation de l’histoire qui se déroule sous ses yeux. Si les dates lui rappellent que moins de 40 ans le séparent des faits, ne
semble-t-il pas que ces gens sur ces photographies appartiennent à un autre temps? Il faudra presque attendre le dernier quart de l’exposition pour entendre de saisissants
témoignages. Témoignages d’autant plus saisissants que le récit jusqu’alors semblait relater une époque lointaine. Et là, à l’écart du parcours, dans de petites salles noires, sur des écrans, nombre de profils semblent s’adresser directement au visiteur. Cette femme d’une cinquantaine d’années, par exemple, qui a grandi à Berlin-Ouest et qui a pour paysage d’enfance cette immense déchirure qui sépare deux mondes au sein même de sa ville. Le visiteur réalise alors que l’Europe n’existait tout simplement pas une trentaine d'années auparavant. Et là, dans cette pièce noire, devant l’écran, la frontière entre le sujet et lui se fendille : il lui semble alors que cela s’est passé hier, mais pourrait aussi bien se passer demain.
Le visiteur aimerait voir l’ensemble des témoignages, mais il y en a tellement qu’il est impossible de tous les voir, d’autant qu’ils sont condensés en un lieu à l’écart du parcours principal. Et il faut pourtant se relever, sortir de la salle et se déconnecter à nouveau de la Mémoire pour se replonger dans l’Histoire.
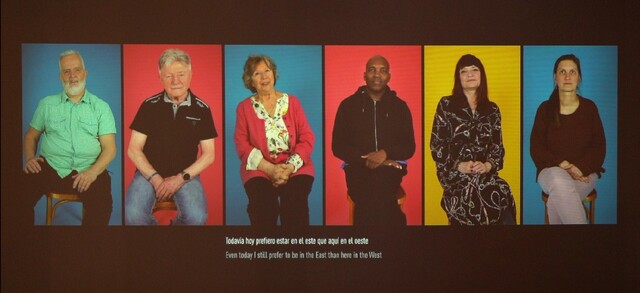
Témoignages sous formes de capsules vidéos © Musealia.
Un regard engagé et contemporain ?
À l’issue de ce parcours narratif entre Histoire et Mémoire, le sujet de l’exposition est-il le Mur de Berlin ? Pas seulement. Plutôt les conséquences de la Seconde Guerre
mondiale ? La Guerre Froide ? L’exposition porte surtout sur les conséquences des conflits humains et la dangerosité de la montée en puissance d’un régime totalitaire. Elle montre comment une population se retrouve sans s’en apercevoir, privée de ses libertés fondamentales.
Néanmoins, le parti pris manichéen du conflit opposant l’Allemagne de l’Est et l’Allemagne de l’Ouest est étonnant. L’un tortionnaire, l’autre salvateur. Un Berlin Ouest,
américain, prospère, rêve et asile de tous face à un Berlin Est, communiste, qui exerce une répression violente et meurtrière.
Finalement, si elle dénonce les dérives du pouvoir politique et les lents rouages de la mainmise sur une population, le Mur de Berlin. Un Monde Divisé ne questionne pas la
suprématie des vainqueurs sur les populations vaincues. Les Allemands, opprimés par le gouvernement communiste totalitaire, étaient occupés également par les Français, les Anglais, les Américains. Dans un monde actuel où le droit fondamental qu’ont les peuples à disposer d’eux-mêmes est souvent bafoué, le Mur de Berlin. Un Monde Divisé, qui aurait eu toute la latitude de prendre ce thème à bras-le-corps, a étonnamment choisi d’en faire un non-sujet.
Lise Mattei
Pour en savoir plus :
- https://www.citedelarchitecture.fr/fr/presse/article/le-mur-de-berlin-un-monde-divise
- https://francefineart.com/2025/05/22/3624_le-mur-de-berlin_cite-de-l-architecture-et-du-patrimoine/
#guerrefroide #lutte #liberté
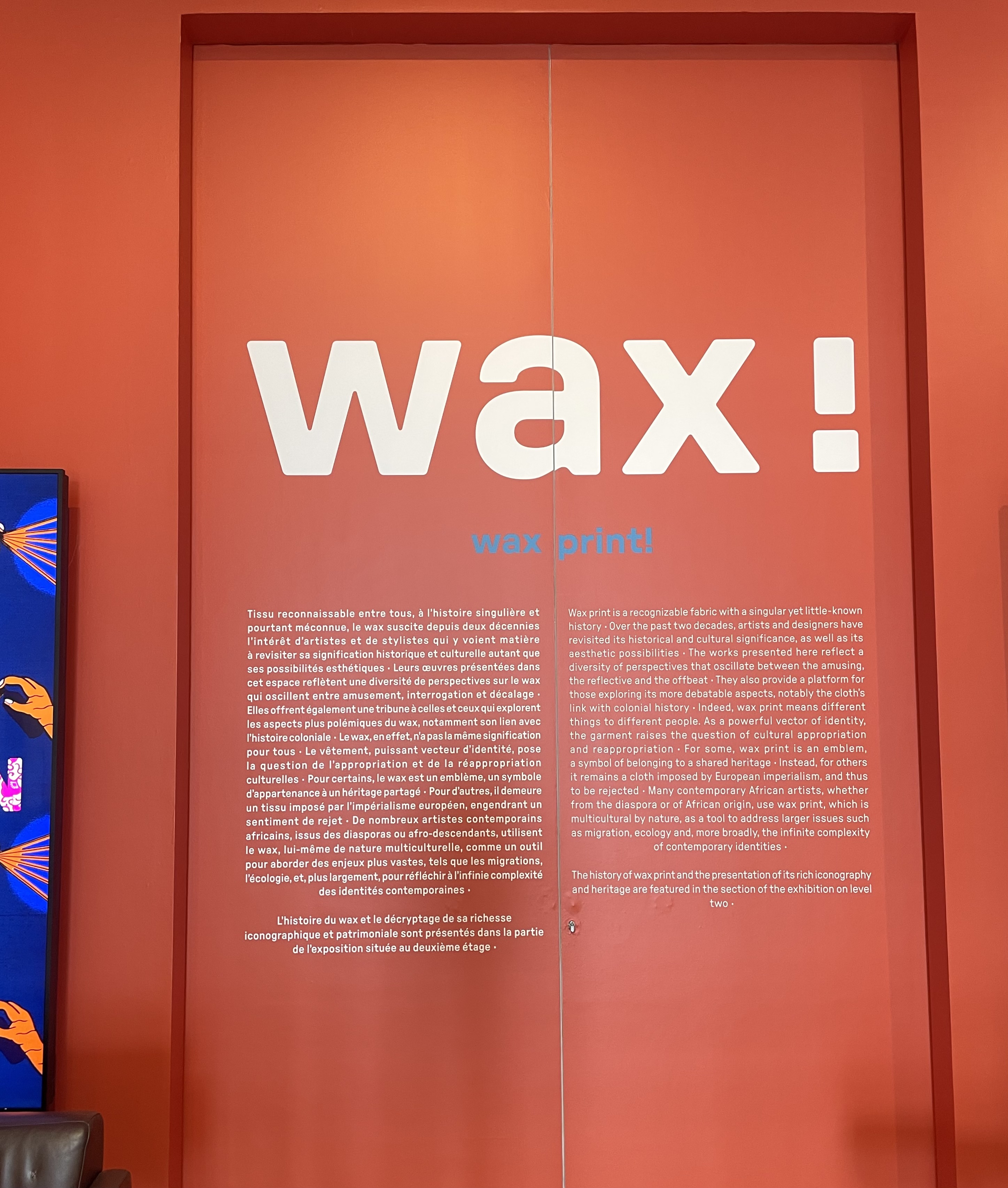
Le Musée de l’Homme dévoile le Wax sous toutes ses coutures
Derrière cette étoffe se cache un bien de consommation qui s’est, depuis son apparition, toujours situé au carrefour des relations mondialisées entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique.
L’exposition WAX décrypte ainsi les dynamiques d’échanges culturels, économiques, politiques qu’a permis la démocratisation de ce tissu. WAX se fait l’écho du parcours du musée Migrations, une odyssée humaine, et reflète l’ambition de l’institution de s’ouvrir sur l’actualité tout en luttant contre les idées reçues.
WAX est visible au Musée de l’Homme à Paris jusqu’au 7 septembre 2025.
Migrations, une odyssée humaine est visible au Musée de l’Homme jusqu’au 8 juin 2025.
Une histoire à plusieurs voies
Après avoir dépassé les escaliers dans lesquels la bienvenue est souhaitée en de multiples langues aux visiteur.euse.s, c’est à ils et elles de choisir par quelle entrée débutera leur parcours de WAX. Se laisser tenter par une approche artistique contemporaine au premier étage, ou plutôt préférer un regard historique au deuxième ?
Si l’on préfère un parcours chronologique, alors le récit débute au 19ème siècle. Car si le Wax est facilement identifiable grâce à ses motifs et ses couleurs vives, les contours de son histoire et ses filiations restent encore largement méconnus du grand public. On s’interroge : « Wax is it? » peut-on lire sur l’un des premiers cartels colorés. Ceux-ci sont imprimés sur une étoffe identique au wax, avec un dispositif de suspension qui laisse apparaître le verso à motifs géométriques des cartels. Le textile a la part belle et aucun flyer ne lui fait ici concurrence. Le choix de ne pas avoir d’editing papier, en plus d’être écologique, permet de garder le regard constamment à hauteur des tissus, qui flottent le long des murs tels des étendards. Une jolie façon de présenter des étoffes comme de véritables tableaux ou drapeaux vecteurs de messages. Le ton est donné et les détails esthétiques de l’exposition n’enlèvent rien au sérieux et à la richesse des informations transmises.
La technique de réalisation du Wax s’inspire du batik, tissu indonésien utilisant de la cire chaude pour créer des motifs par réserve. Son nom provient de l’anglais « wax » qui signifie « cire ». Sa production est d’abord hollandaise avec des marques emblématiques comme VLISCO. Dans un premier temps, le déversement sur l’île de Java de ces imitations industrielles de batik est un échec. Mais bientôt, l’étoffe se voit récupérée par des soldats ghanéens, alors en place sur l’île sous autorité hollandaise, qui participeront à la diffusion première du wax en Afrique de l’ouest.
Son exportation et son utilisation se sont ensuite largement étendues à de nombreux autres pays du continent. Enfin, le wax fait son entrée dans la mode européenne et américaine plus tardivement. Illustrant ces apports multiples, l’exposition met en valeur des collections d’autres institutions parisiennes : les marionnettes indonésienne et malienne du musée du Quai Branly ou encore un oiseau naturalisé du Muséum National d’Histoire Naturelle.
 Entrée de l’exposition au premier étage du musée
Entrée de l’exposition au premier étage du musée
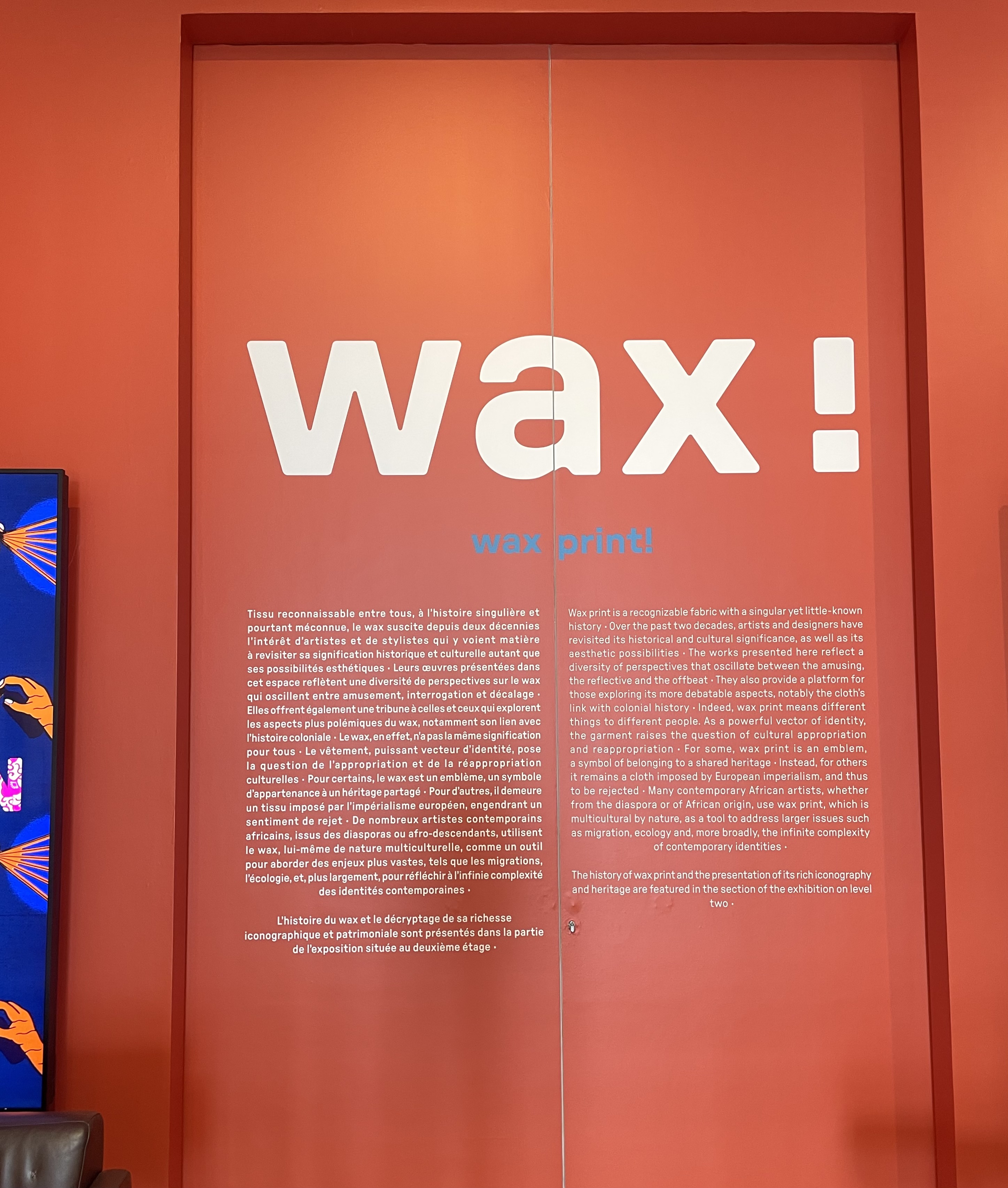 Entrée au deuxième étage
Entrée au deuxième étage
En regard de ces objets patrimoniaux, des œuvres d’artistes contemporains tel La Naissance du wax de Gombo, amènent un éclairage nouveau sur le passé pluriel de ce tissu.
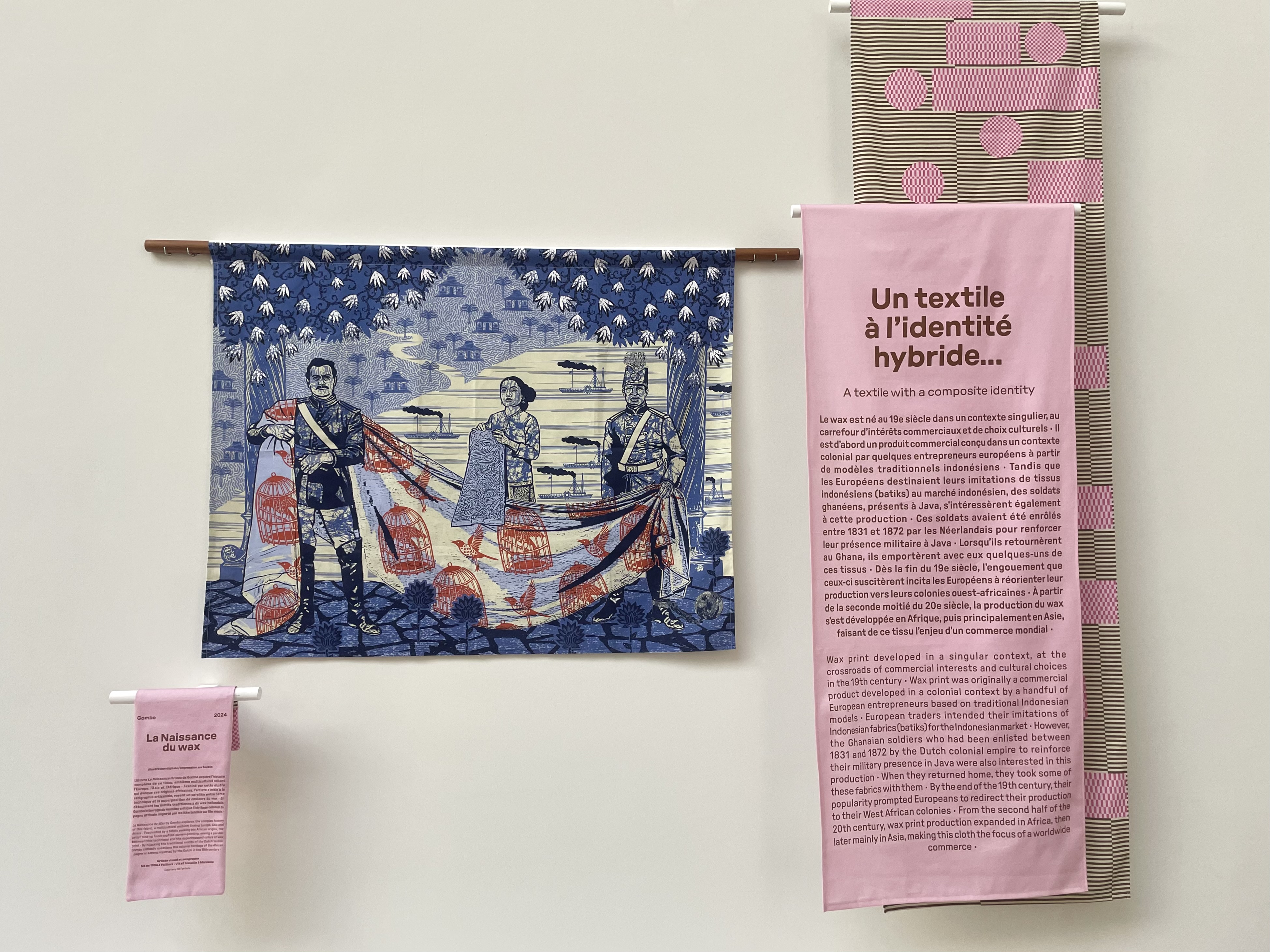
La Naissance du wax de Gombo / Cartel
L’artiste visuel afro-européen s’attache en effet à retranscrire l’esthétique du Wax, de façon détournée, dans des œuvres sur toile ou papier. Son travail conjugue transmission de savoir-faires traditionnels comme la sérigraphie, et l’utilisation du dessin numérique et de l'intelligence artificielle, créant des motifs complexes et hybrides à l’image de l’histoire de l’emblématique textile. Il questionne ainsi la mémoire collective tout en célébrant les héritages africains.
L’arbre tombé, Famille, L’oeil de ma rivale
Bien que produit dérivé du colonialisme, le wax a rapidement été enrichi de valeurs sociales et symboliques, puis enchevêtré au patrimoine de nombreux pays d’Afrique. C’est ce que propose d’explorer la suite de la visite. Des échantillons textiles sont présentés à côté de leur appellation populaire, généralement donnée par la clientèle, et du détail de leurs symboles. Cette partie permet également de mettre en avant les gammes et les déclinaisons colorimétriques typiques du wax. Une étoffe arborant poule, poussin et tête de coq sur fond vert est ainsi renommé « famille » dès 1952. Ce nom rend hommage au rôle majeur tenu par les femmes au sein du foyer.
 Détail de la symbolique des motifs
Détail de la symbolique des motifs
« Nana Benz » et les acteurices de l’industrie du wax
L’exposition met d’ailleurs en lumière le rôle que joue les femmes dans les échanges gravitant autour du wax : celles qui font commerce du tissu et en tirent des richesses et du pouvoir; celles qui le transmettent, généralement de mère en fille mais aussi entre différents membres féminins de la famille. Ces circulations du textile, de mains en mains, de générations en générations, se placent en miroir des nombreux voyages constitutifs de son histoire cités plus avant dans l’exposition. Les deux modules se retrouvent même face à face, bien que l’on ne puisse pas passer de l’un à l’autre au vu des spécificités du lieu.
L’histoire du Wax ne cesse de s’écrire !
Le wax représente un héritage ambivalent, symbole de la colonisation autant que d’empouvoirement, que questionnent de nombreux photographes, stylistes ou encore peintres. C’est ce que donne à voir l’autre pan de l’exposition, pour celleux ayant commencé ou poursuivit par la visite de l’étage inférieur.
Mais les réflexions contemporaines autour du wax dépassent les iconographies et sont aussi faites de mots. Ainsi, plusieurs néologismes comme Afrodystopie sont décryptés grâce à des cartels détaillés juxtaposés aux œuvres. Ce concept est tiré de l’essai Afrodystopie de Josef Tonda, publié en 2021 avec le soutien du CNRS. Le professeur de sociologie et d’anthropologie de l’université Omar Bongo de Libreville y décrit notamment le « rêve afrodystopique (comme) une composante de la violence des imaginaires colonialistes et impérialistes qui structure l’inconscient des rapports des mondes euro-américains avec les mondes euro-africains, mais aussi les rapports des États aux citoyens, des dominants aux dominés. »[1] Une œuvre de l’artiste kinois Hilary Balu est présentée en miroir de la définition puisque directement inspirée par l’ouvrage de J. Tonda. Issue de la série picturale In the Floods of Illusions, la toile dépeint une société africaine transformée par la globalisation et le consumérisme, marquée par la vision utopique occidentale relayée par les écrans. Préfigurant la fin de la visite, l’œuvre ne cesse de questionner les échanges entre les continents et dénonce les rapports d’influence établis entre eux.
En reconstituant ainsi l’histoire du wax, l’exposition démontre à quel point les textiles sont, toujours, autant des biens économiques que culturels et géopolitiques. À ce titre, ils demeurent constamment modelés par les dialogues, les échanges, les apports de nombreux acteurs.
Une jolie invitation à porter un autre regard sur les objets qui nous entourent, en se posant la question de leurs origines ainsi que de leur devenir.
 Hilary Balu, In the Floods of Illusions VI, 2022 / Cartel d’Afrodystopie
Hilary Balu, In the Floods of Illusions VI, 2022 / Cartel d’Afrodystopie
Sasha Pascual
[1]Joseph Tonda, Afrodystopie. La vie dans le rêve d’autrui, Paris, Karthala, 2021, 268 pages ↩
Pour en savoir plus : https://www.museedelhomme.fr/fr/exposition/wax
#histoiredutextile #exposition #Museedelhomme
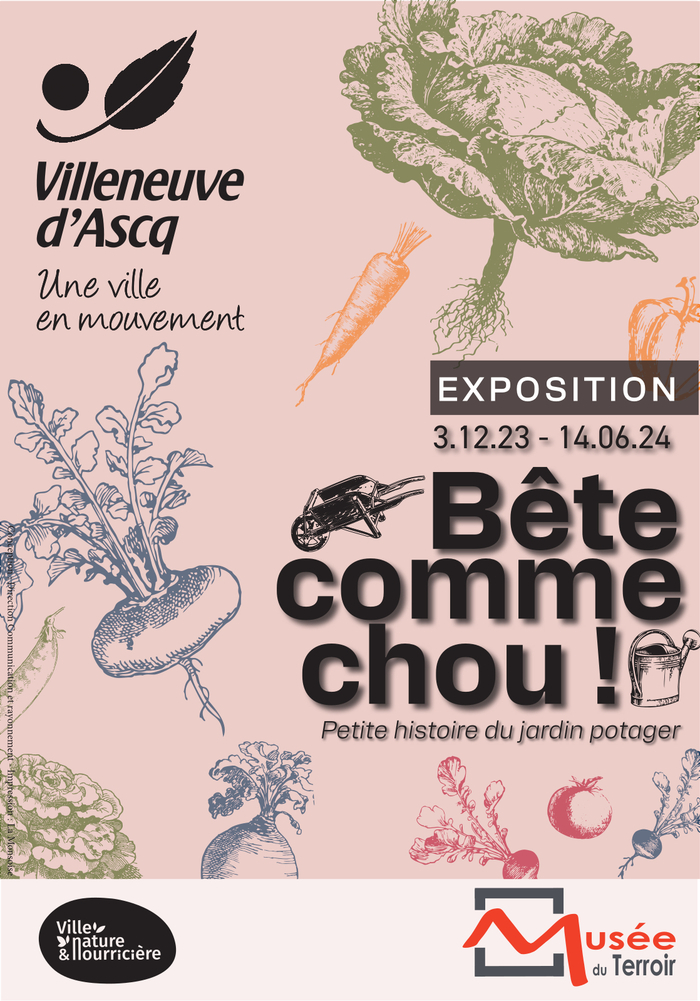
Le Musée du Terroir : savoir-faire autonomes d’antan ou de demain ?
A l’ère de la surconsommation, des lieux comme le Musée du Terroir de Villeneuve d’Ascq deviennent des lieux de transmission de savoir-faire oubliés permettant aux habitants de se reconnecter à leur territoire.
© Musée du Terroir
Créé en 1973, le Musée du Terroir est situé à Villeneuve d’Ascq, dans le quartier d’Annapes. Le Musée se distingue par son bâtiment : un ancien corps de ferme « la ferme Delporte », le nom des anciens exploitants agricoles, avant d’appartenir aux familles de Brigode et de Montalembert. Le Musée est fondé à l’initiative d’une association, « La société historique de Villeneuve d’Ascq et du Mélantois », qui initie une collecte d’objets. La collection compte aujourd’hui environ 20 000 objets. Afin de les conserver, des réserves ont été créées dans les années 2010 quand le Musée a été réhabilité. Depuis 2016, la ville de Villeneuve d’Ascq est gestionnaire du Musée.
Sauvegarder le patrimoine rural à l’ère de la surconsommation
Des expositions temporaires engagées
Le Musée du Terroir propose chaque année des expositions temporaires qui interrogent nos modèles de vie et de consommation. Leur prix est inclus dans le billet d’entrée du Musée. Cette année, l’exposition s’intitule « Bête comme chou ! Petite histoire du jardin potager », accessible depuis décembre 2023, elle peut encore être visitée jusqu’au 14 juin 2024. L’exposition invite le visiteur à découvrir l’histoire des jardins potagers et la manière dont nos ancêtres les cultivaient.

Affiche de l’exposition temporaire © Musée du Terroir, Ville de Villeneuve d’Ascq
Dans cette petite exposition, des objets sont présentés dans plusieurs vitrines, outils anciens pour cultiver le jardin potager ou encore des ouvrages ou manuels scolaires à destination de ceux et celles qui souhaitaient prendre soin de leur parcelle de terre.


Vues de l’exposition temporaire © Millie CHIRON
Au Musée du Terroir, les thématiques d’expositions sont choisies en fonction des objets conservés dans les réserves, que l’équipe souhaite valoriser. Pour cette exposition, le propos se focalise sur le jardin cultivé par les habitants et nous partage leur regard. Le thème est actuel. Le propos rend hommage à nos ancêtres attentifs à leur environnement et visaient une autonomie alimentaire. Il y a 100 ans, le terme d’« écologie » n’existait pas. Par moindre progrès et agriculture intensive, ils vivaient de façon plus responsable vis-à-vis de l’environnement. Les biens matériels avaient plus de valeur car les gens mettaient plus de temps à les acquérir. Une tendance qui revient aujourd’hui, certains préfèrent acheter peu et privilégier la qualité ou le circuit-court. L’équipe du Musée veille toujours à faire référence aux enjeux écologiques actuels pour souligner cet écho entre les collections anciennes du musée et la société moderne. Le musée est ainsi reconnecté à sa vocation, à son rôle, à notre époque et à son territoire.


Vues de l’exposition temporaire © Millie CHIRON
Autour de cette exposition des visites sont organisées avec des « classes patrimoine ». Les professionnels de l’équipe proposent aux enfants des ateliers en rapport avec le jardinage.

Vue de l’exposition temporaire © Millie CHIRON
Sensibiliser les visiteurs pour faire face aux enjeux écologiques actuels
Millie CHIRON
Pour en savoir plus :
- Site du Musée du Terroir : https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/
#écologie #savoir-faire #transition
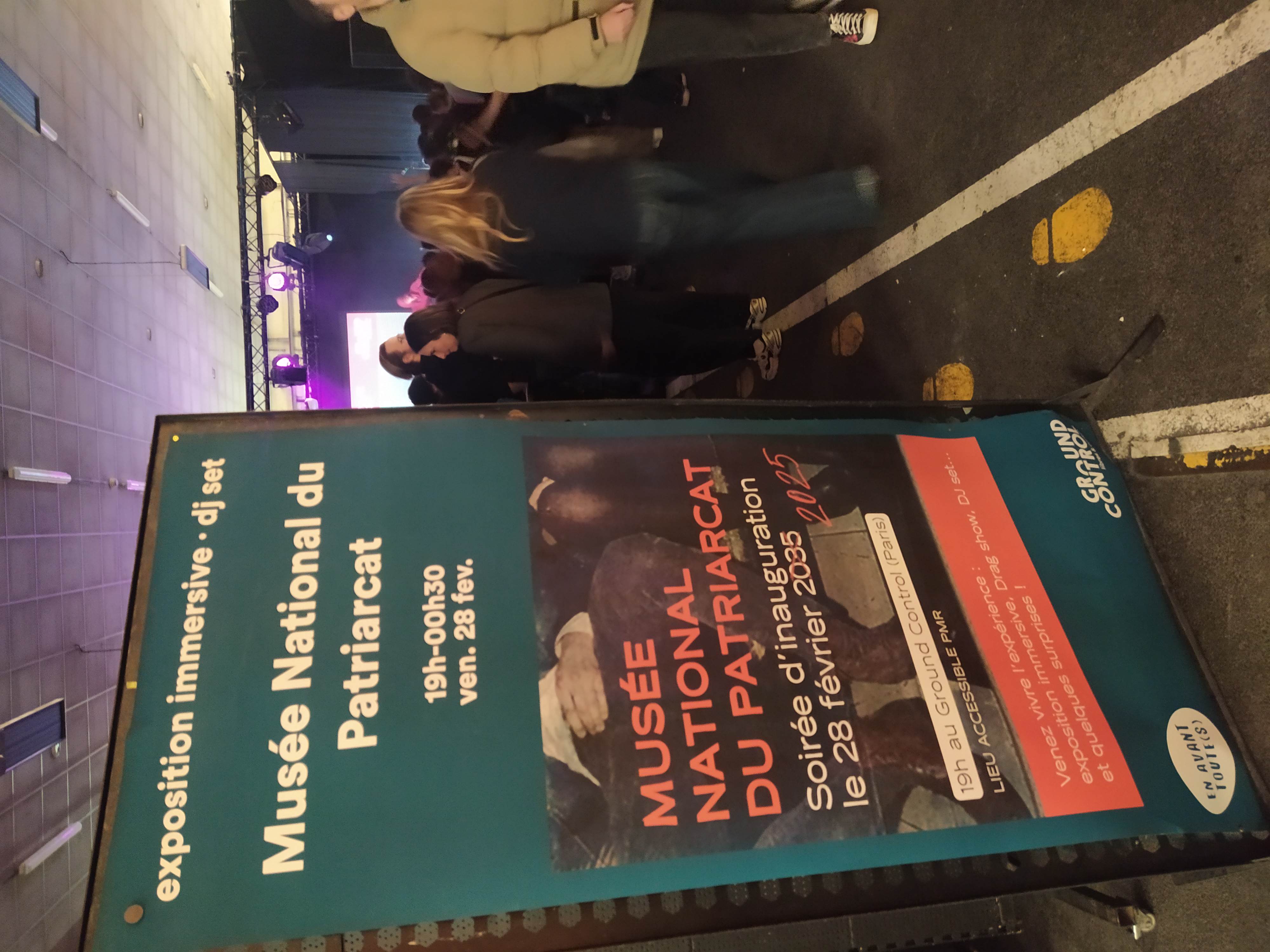
Le musée national du patriarcat
Et si le patriarcat appartenait à une époque si lointaine qu’il serait exposé dans un musée ?
© T. Schriver
“*Imaginez, nous sommes en 2035 et le patriarcat est mort. Fermez les yeux 5 minutes et imaginez un monde où les violences sexistes et sexuelles n’existent plus, où l’injustice et les inégalités liées au patriarcat sont enfin reléguées au passé*.” Ce monde si lointain devrait avoir un musée. C’est ainsi que le Musée National du Patriarcat a ouvert, le temps d’une soirée au Ground Control à Paris, le 28 février 2025.
L’association “En avant toute(s)” a consacré investi un espace de 176m2, pouvant accueillir 270 personnes debout. Sur les murs, les visiteurs et visiteuses découvrent de nombreuses affiches qui ont permis de faire la promotion de l’ouverture du musée “Venez découvrir un monde où la contraception était exclusivement féminine”, “Il y a un temps où la place des femmes dans la société se comptait en centimètre”.
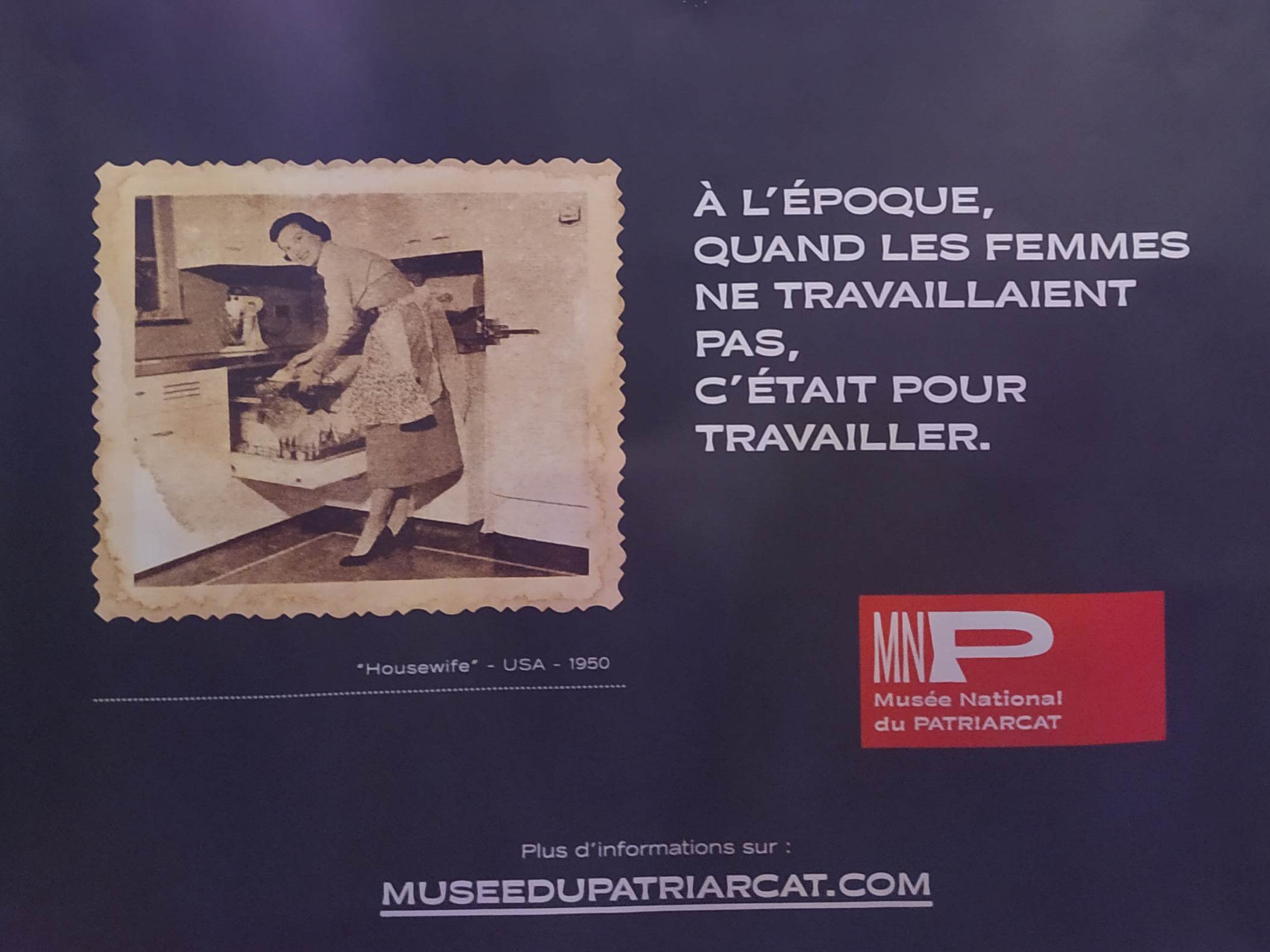
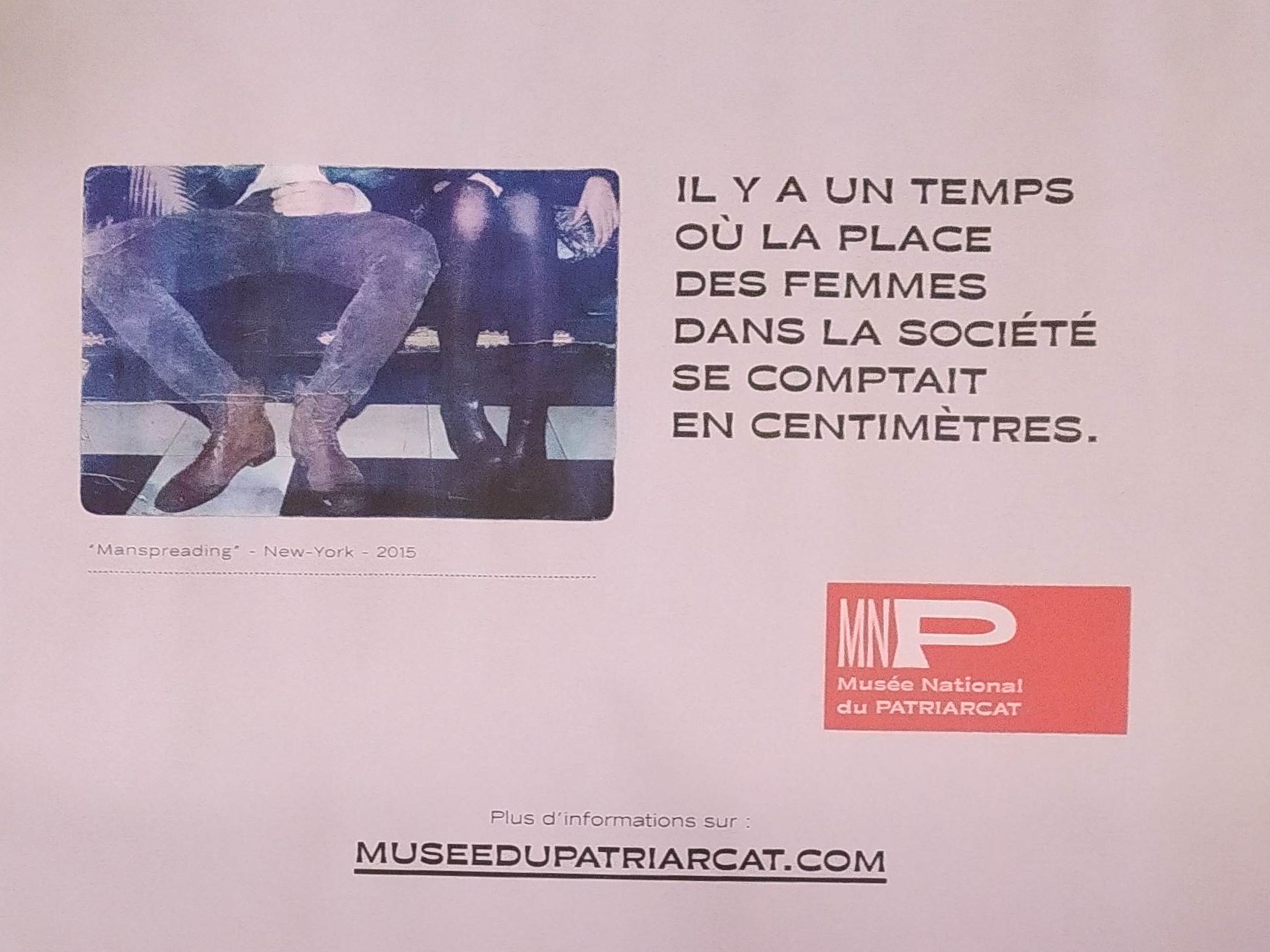
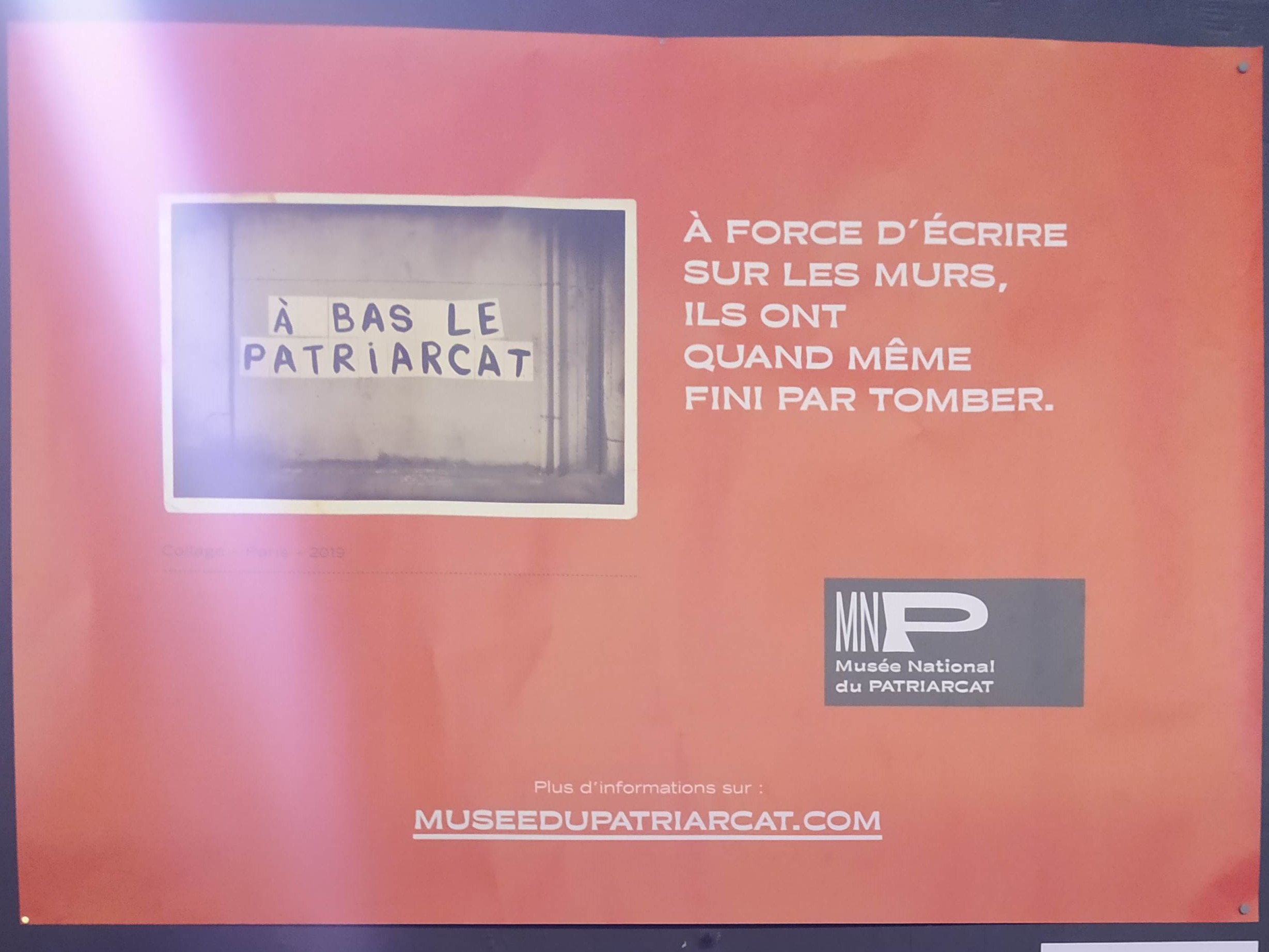
© T. Schriver
Parmi les “archives” exposées :
● des pancartes de manifestations,
● le violentomètre, outil de détection développé fin 2018 notamment par En avant toute(s) suite à une commande de l’état français,
● des jouets genrés (bébé rose, ordinateur bleu)
● des captures d’écrans où seul “Madame” ou “Monsieur” peuvent être cochés
● des rasoirs bleus et roses pour aborder la taxe rose etc.
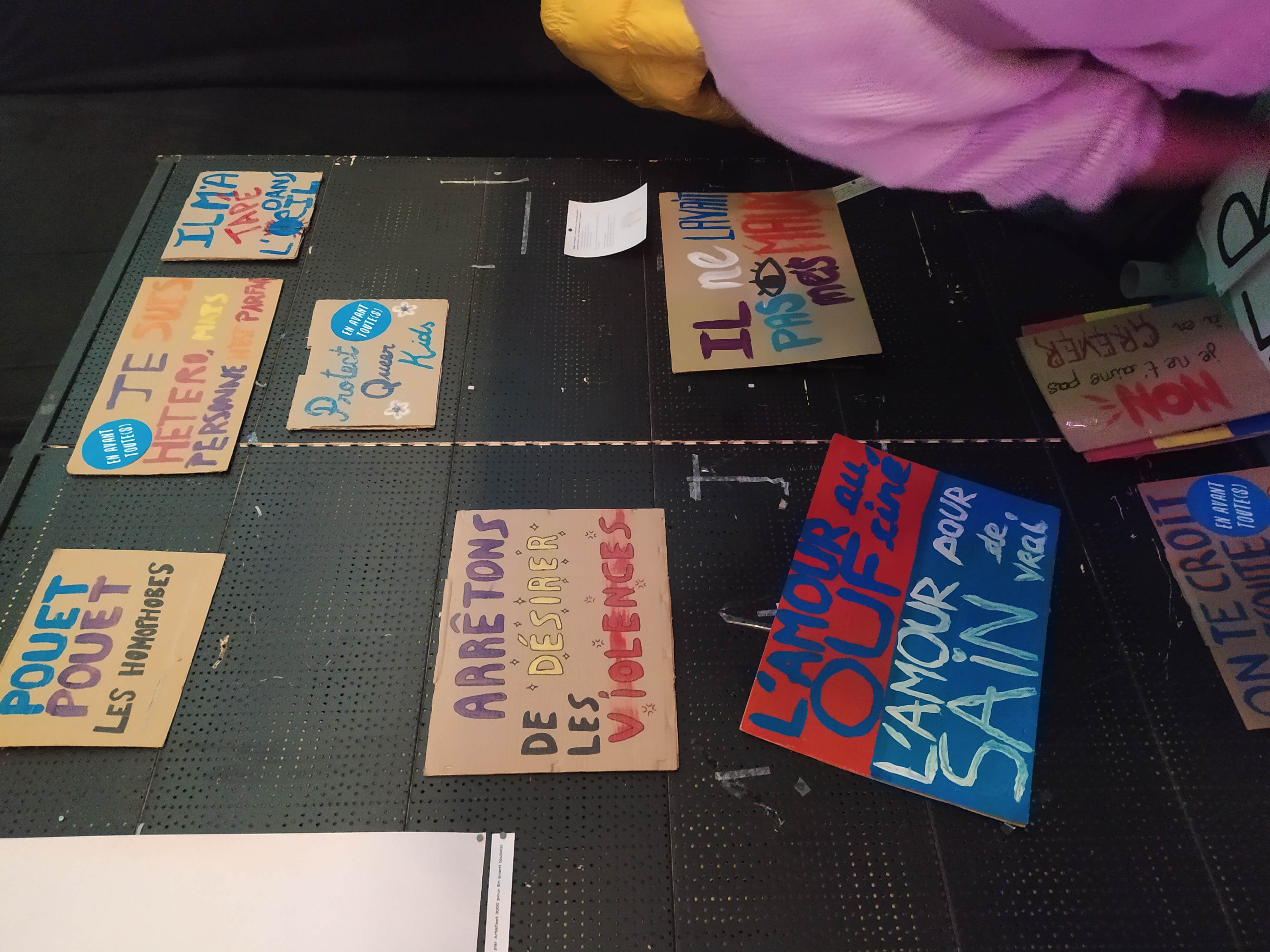
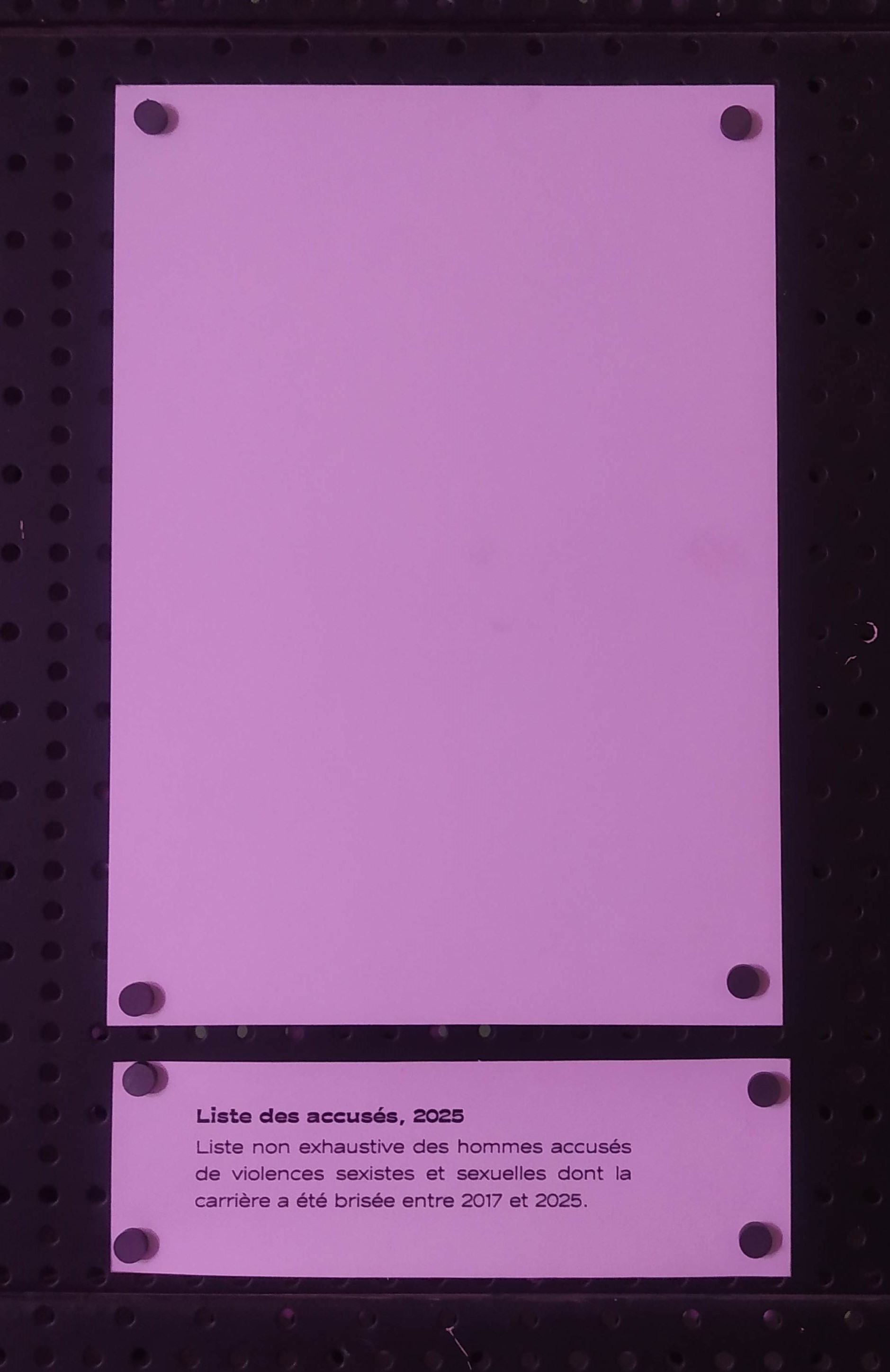
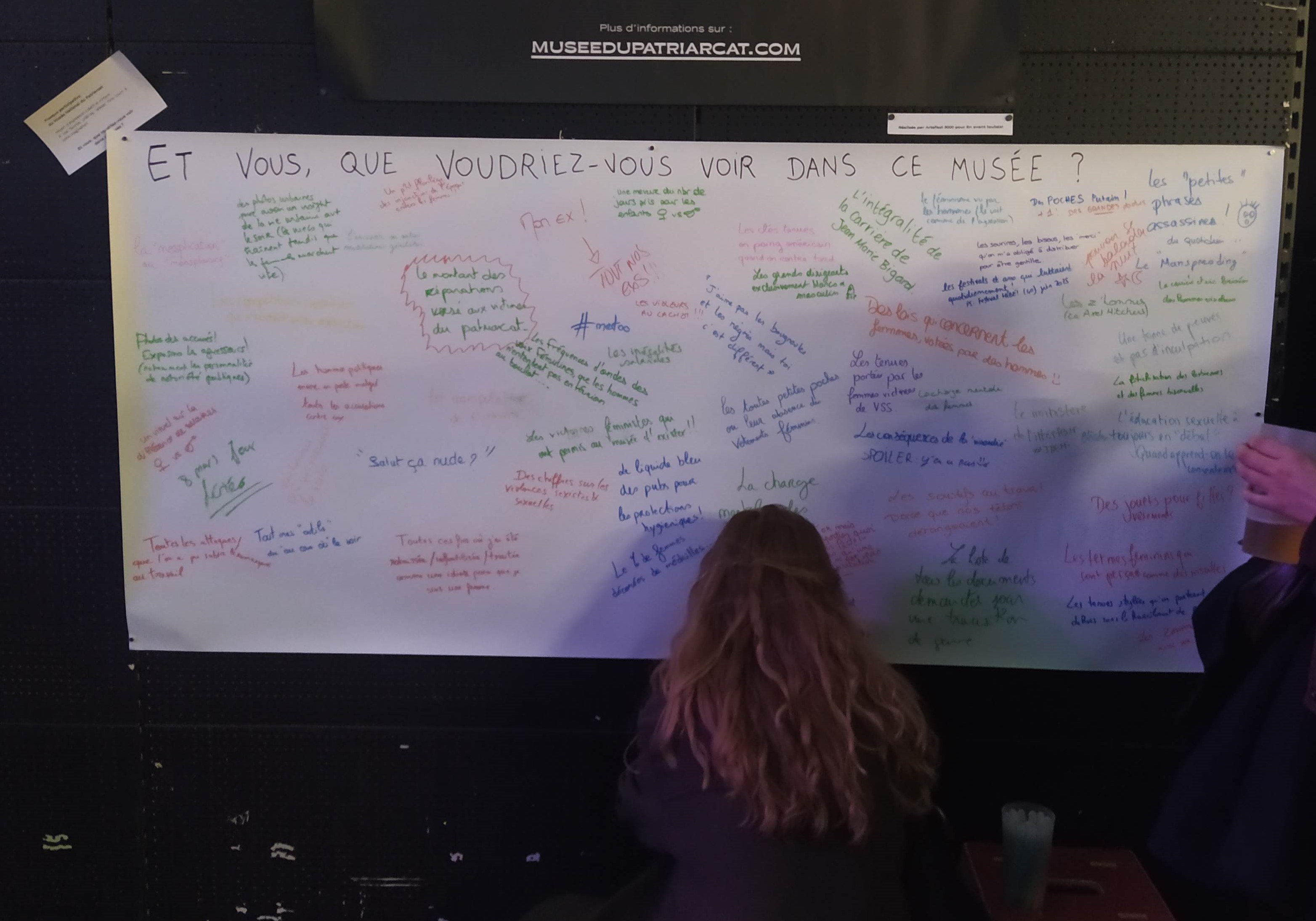
© T. Schriver
Ne manquant pas d’ironie pour pimenter le parcours, un vase rempli d’eau représente les “larmes ouin ouin des hommes” et une feuille blanche liste les “hommes accusés de violences sexistes et sexuelles dont la carrière a été brisée entre 2017 et 2025”.
L’association n’a pas travaillé avec des professionnels du monde muséal, néanmoins, elle a eu le réflexe de varier les moyens de médiations : une vidéo interactive sur le harcèlement de rue, et, à la fin du parcours, un mur sur lequel les participant.es répondent à “Et vous, que voulez-vous voir dans ce musée ?”.
Cette exposition éphémère, accessible après avoir fait un don à l’association, a aussi été le lieu de divers événements au cours de la soirée : discours des fondatrices de l’association, DJ sets, stand up et drag show.
Succès
L’événement relayé sur différentes plateformes (site web, instagram, journaux, magazines), a fait l’objet d’affichages publics avec MediaTransports. Et la collaboration entre l’association et l’agence de pub Artefact 3000 a été lauréate du Concours Futurs Désirables, organisée par le Club des Directeurs Artistiques.
De nombreux badauds, attirés par le mystère de cette salle feutrée de rideaux et de ses événements, ont bien tenté de se faufiler. C’était sans compter l’équipe de bénévoles qui leur demandait leurs bracelets ou bien expliquait le projet et le don de 10€ afin de rentrer. Une majeure partie était intriguée, intéressée par le projet et a fait ce don. Entre questions et réponses, la plupart d’entre eux terminaient par “Vous avez de l’espoir !”. Néanmoins, le succès fut tel que les rideaux qui marquaient la taille de la pièce, s’ouvraient de plus en plus, et que leurs ourlets ne touchaient plus le sol. Il était temps d’ouvrir l’exposition à toute.s.
Suite à ce succès temporaire, il est important de noter :
● que le sujet du patriarcat et de sa place dans un passé révolu intéresse l’opinion publique, les médias, les publicitaires
● que l’imaginaire du musée peut être saisi par tous et l’est saisi notamment par les associations à des fins de sensibilisation et d’opérations coup de poing (cf. les militants écologistes et leurs jets de soupe ou peinture)
● que le musée à l’image de lieu poussiéreux, bon à exposer des archives, lorsqu’il est repris par des sphères amatrices, est un lieu vivant, d’échanges, d’humour !
Tiphaine Schriver
#patriarcat #association #éphémère #féminisme
Pour en savoir plus sur “En avant toute(s)” :
“En avant toute(s) a été créée en 2013 par Ynaée Benaben et Thomas Humbert, très vite rejoint par Louise Delavier et Céleste Danos. Une vaste étude de terrain a permis de montrer que les structures destinées aux femmes victimes de violences étaient trop peu nombreuses ou surchargées et de constater la prévalence des violences chez les plus jeunes femmes.
Nous avons alors décidé d’œuvrer dans notre environnement proche en nous adressant aux personnes de notre âge en cherchant des modes de communication plus adaptés aux usages actuels et à l’imaginaire de notre génération.
Depuis 10 ans, nous développons notre expertise et menons toutes nos actions dans l’optique de : promouvoir l’égalité des genres, prévenir les violences de genre, s’adresser aux jeunes.”

Le NFT expliqué à ma mère
Depuis février 2021 les NFT, une sorte de cryptomonnaie, agite les rédactions de nouvelles technologies comme artistiques. Entre les jargons, les raccourcis et les acronymes, entre les enthousiastes et les inquiets, difficile de s’y retrouver. Alors maman, je vais essayer de t’expliquer, même si je suis néophyte en la matière.
Le NFT veut dire en anglais ‘Non Fungible Token” c’est-à-dire Jeton Non Fongible, ou plus simplement jeton non échangeable. Ces jetons virtuels peuvent te rappeler les jetons de pokers : ce sont des supports de valeurs, d’un montant d’argent. Ils circulent donc comme des actions financières qui peuvent prendre ou perdre de la valeur. Ces jetons ne s’échangent pas sur les cours boursiers habituels où des institutions financières jouent des rôles d’intermédiaires, ils s’échangent sur des blockchains et particulièrement pour les NFT sur la blockchain « Etherum ».
Image d'en-tête : Exemples de NFT - Capture d’écran de la Marketplace Nifty Gateway
Apparté : qu’est-ce que la blockchain ?
Imagine une chaîne de blocs, cette chaîne est décrite comme un « système informatique participatif et décentralisé », c’est-à-dire que la chaîne relie plusieurs serveurs placés partout dans le monde. Les « blocs » sont donc les stockages de l’information, mais ils contiennent aussi une sorte de serrure : chaque information est dotée d’un code – une cryptographie – qui permet à la fois de certifier, protéger, et tracer son passage par les « nodes » qui décodent l’information et la transmettent.
C’est par ce système qu’existent les cryptomonnaies, l’écriture cryptée permet de certifier que tel élément numérique a été acheté par tel agent à un moment donné, qui va générer un code – une trace ou une empreinte – dans le système et transmettre les informations simultanément à tous les utilisateurs.
Les Jetons Non Fongibles (NFT) sont très particuliers, d’une part ils sont différents des autres cryptomonnaies (comme la plus connue : le bitcoin ou l’etherum) car au-delà d’être une somme dans ton portefeuille, ils sont liés à une image numérique : une photo, une vidéo, voire de la musique donc des fichiers numériques de formats variés (jpeg, MP3, GIF etc.) qui constituent une « information complémentaire » sur le code du jeton.
D’autre part la différence repose sur la notion de « non fongible ». Imagine un billet de 5 euros unique : tu ne peux pas échanger ton billet de 5 euros contre 5 pièces de 1 euro.
Ajoute à cela l’image numérique qui est liée au jeton. En principe une œuvre du même artiste n’est pas égale à une autre, et à l’opposé un fichier numérique est duplicable à l’infini, tu peux copier/coller autant de fois que tu veux, un fichier en vaut un autre. La subtilité du NFT se joue ici : en étant « non fongible », l’image numérique qui lui est liée prend de la valeur, ce fichier qui d’ordinaire se « copie/colle » n’est plus égal aux autres. L’image adopte le principe de l’œuvre d’art car elle est accolée à un jeton unique avec un code traçable : ce fichier numérique est devenu rare et unique. C’est ainsi que, comme pour le marché de l’art, c’est le jeu de l’offre et de la demande qui fait augmenter la valeur du jeton à mesure qu’il est échangé.
Alors comment ça marche ?
Pour entrer sur le marché il faut s’inscrire sur l’une des nombreuses plateformes en ligne, les plus connues sont OpenSea, Mintable, Nifty Gateway et Rarible, ce sont des places de marché – exactement sur le même principe qu’un emplacement sur le marché du samedi matin. Elles ont pour rôle d’identifier les utilisateurs et de les intégrer à la blockchain Etherum. Cependant, ce marché qui est défendu comme libre d’accès ne l’est pas exactement : il y a des coûts d’entrées sur ces places et les coûts de transactions pour transformer tes dollars en cryptomonnaie. Ainsi, si tu veux placer une photo de vacances en NFT il faut s’attendre à payer entre 30 et 300 dollars simplement pour entrer sur le marché.
Une fois sur le marché, la photo de vacances que tu auras générée et évaluée pour un montant de X Etherum sera une écriture cryptée sur la blockchain, si elle est échangée, tu recevras des dividendes à chaque échange. Tous les utilisateurs pourront voir la photo qui servira à l’identification de l’actif, c’est pour cela que les NFT permettent d’échanger de l’art numérique comme de la musique, des extraits d’exploits sportifs : tout ce qui peut faire l’objet d’une image.
Est-ce que c’est nouveau ?
Historiquement dans les nouvelles technologies et les cryptomonnaies (qui sont pour le dire vite des devises virtuelles, qui ne sont pas frappées ou imprimées) le NFT existe depuis les années 2010 et a déjà connu des « booms » d’intérêts.
Tu as pu en entendre parler en 2017 avec les CryptoPunks qui ont eu un tel succès que certaines galeries d’art ont demandé des impressions pour les exposer. Ces petits personnages sont uniques et les utilisateurs sont invités à les collectionner, il en existe 10 000 qui s’échangent toujours actuellement.

Capture d’écran des dernières grosses ventes de CryptoPunks, depuis le site des créateurs.
Un autre boom, plus confidentiel fut celui provoqué avec les CryptoKitties, un jeu collectif en ligne qui consiste à élever des chats, un peu comme un tamagochi, sauf que ceux-ci se situent sur la blockchain et sont uniques, certains ont été échangés pour des milliers de dollars. Oui, ce sont bien des images de chats et non plus de punks.
Alors pourquoi les NFT font un nouveau boom ?
Beaucoup doutaient de la longévité des cryptomonnaies, pourtant celles-ci ont continué à intéresser de plus en plus de personnes et à prendre (ou perdre) de la valeur de façon impressionnante, si bien que quelques chanceux ont pu voir leur portefeuille de cryptomonnaie devenir très lucratif.

C’est ainsi que des NFT qui pouvaient sembler très anecdotiques, comme ceux représentés par le premier tweet publié au monde ou une image de NBA (basketball) ont été échangés pour quelques millions d’euros. Des œuvres d’artistes, habituellement boudés du marché de l’art pour leurs productions numériques, ont aussi été échangées et valorisées à des très grosses sommes par le biais des NFT. C’est le cas de Beeple, artiste visuel qui utilise principalement des supports numériques, qui a effectué une vente record de 69 millions de dollars.
Ce mouvement fait parler de lui car il questionne les principes de propriété : n’importe quelle image peut être utilisée puisque c’est le code qui lui est associée qui porte la valeur et non le fichier « image » en lui-même. On a pu voir des reproductions d’œuvres prestigieuses (de musées ou de collectionneurs) être échangées en NFT, ce qui a pu interroger au sujet du droit à l’image et de l’utilisation commerciale de celle-ci. L’engouement autour des cryptomonnaies inquiète aussi dans sa potentielle capacité à concurrencer le rôle des devises contrôlées par des institutions financières.
On voit également apparaître de véritables plateformes d’échanges, des galeries d’art voire même des villes virtuelles qui mettent en avant ces jetons pour les acheteurs. Les acteurs habituels du marché de l’art sont donc pris de course par ces propositions toujours plus créatives.


Captures d’écran d’une ville virtuelle proposant de nombreuses galeries d’art d’œuvres numériques disponibles sous forme de NFT.
Cependant c’est l’impact environnemental de ce système qui inquiète le plus, qui a amené plusieurs acteurs à abandonner les NFT. En effet, l’énergie consommée pour générer et échanger des NFT est extrêmement importante notamment du fait de la complexité des codes et qu’ils « portent » des fichiers visuels avec eux.
Au-delà des NFT, c’est tout le système des blockchains qui est pointé du doigt pour sa consommation énergétique : il faut des serveurs qui tournent à plein régime pour crypter et décrypter ses informations toujours plus nombreuses.
Certains acteurs s’engagent à trouver des solutions plus neutres quant à la consommation d’énergie. Ce sont ces propositions créatives qui ont d’abord attiré mon attention.
Ainsi, Larvalabs, le groupe à l’origine des CryptoPunks, a développé les Autoglyphs.
Sans se perdre dans les détails techniques, lorsque tu achètes un Autoglyph tu n’achètes pas une image, mais un code qui permet de générer un visuel aléatoire, ainsi les autoglyphs sont moins gourmands en énergie que des NFT classiques. Tu génères le visuel en dehors de la blockchain. En plus, tous les dividendes liés à l’échange de ces Autoglyphs sont reversés à une association luttant contre le changement climatique. Tu peux donc posséder une œuvre numérique unique, mais attention, le « générateur » s’arrêtera après 512 exemplaires et les Glyphs s’échangeront alors sur des marchés secondaires. L’intention est évidemment de créer de la rareté alors que des millions de combinaisons sont possibles.

Exemples de Glyphs générés par le système Autoglyphs proposés par LarvaLabs.
J’espère que ces NFT sont désormais plus clairs pour toi. Sans connaître leur longévité il est indéniable que ces curieuses œuvres numériques vont avoir – et ont déjà pour certaines –un impact sur le marché de l’art physique et permettront de faire connaître de nouveaux artistes.

Everyday : the First 5.000 days, de Beeple, adjugée 69,3 millions de dollars en mars 2021 chez Christie's. crédit (AFP)
Les grandes maisons d’enchères comme Christies - à l’origine de la vente record de Beeple - et Sothebys ont déjà pris le pli des NFT, nous verrons de ce que l’avenir leur réserve.
✨The final day of the Fungible Open Edition sale by @muratpak is about to start on @niftygateway✨
Cubes are available to purchase from 1-1:15PM ET. Don't miss out👉https://t.co/dxiO0vIA20#DigitalArt #NFTs pic.twitter.com/miw7tYMSzu— Sotheby's (@Sothebys) April 14, 2021
Allez explorer Cryptovoxel, le monde virtuel de l’Etherum; https://www.cryptovoxels.com/
#cryptomonnaie #artnumérique #NFT
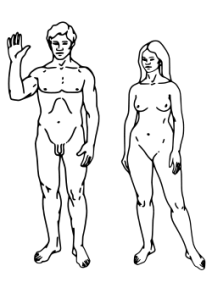
Le plus vieux moyen de médiation du monde
Le moyen de médiation muséal que nous vous présentons aujourd'hui est certainement le plus moderne de tous, sa modernité est intemporelle et indépassable.
HomoSapiens© N.A.S.A.
Le moyen de médiation muséal que nous vous présentons aujourd'hui est certainement le plus moderne de tous, sa modernité est intemporelle et indépassable. Pourtant son ancienneté dépasse largement l'existence des musées : 7 millions d'années environ pour le tout premier modèle, environ deux cent mille ans pour le modèle actuel après de nombreuses évolutions. Il fut aussi de l'aventure des tous premiers musées, il les créa et fut l'instigateur de toutes ses transformations.Nous vous le donnons en mille : l'humain.
Mais pas n'importe lequel : celui auquel nous nous intéressons aujourd'hui est original de par son statut mais aussi sa raréfaction. Il ne se trouve que dans un seul type de musée : les musées associatifs, il s'agit des intervenants bénévoles.
Ceux-ci ne sont pas de nature des « moyens » de médiation, ils ne sont là que pour l'accueil et le bon fonctionnement du musée. Et pourtant ! Là où tant de musées dépensent des sommes faramineuses en équipements de médiation ultra-modernes,ou dans les salaires des professionnels de cet discipline indispensable, lesbénévoles accomplissent cet office gratuitement, avec une animation, une chaleur et un ton unique. Pour illustrer cela, nous nous sommes rendus dans un musée associatif : le Musée du Vermandois, situé dans l'Aisne, à Vermand ; petite commune de 2000 habitants proche de Saint-Quentin. Nous avons vu là-bas une intervenante qui à elle seule illumina notre visite et rendit ce musée plus vivant et parlant qu'aucun autre musée de ce type. Cette personne n'a aucune formation dans le domaine des musées, mais c'est une passionnée avec une culture très riche, variée. Elle a surtout toujours l'envie de partager ses connaissances avec les visiteurs, qu'elle accueille toujours avec un sourire puis avec une présentation du musée et de sa ville ; présentation très complète sans être scolaire.
Mais avant tout, mettons-nous d'accord sur la définition de « moyen de médiation », et précisons pourquoi une personne peut-en être un. D'abord parce que ces bénévoles font tout ce qu'un moyen de médiation doit faire, sans être ni des guides, ni des médiateurs agréé.
Ils présentent le musée, racontent l'histoire de ses collections, le parcours. Pour le musée du Vermandois, il s'agit notamment de mettre en avant la riche histoire de la cité depuis les celtes, pour mettre en valeur la collection archéologique issue des fouilles. Il faut aussi présenter les autres étages, leurs buts, intérêts et liens avec la ville de Vermand et sa région.
Puis ils deviennent vraiment des outils de médiation indispensables lorsque la médiation fait défaut dans le musée. Les musées comme celui-ci n'ont ni les moyens, ni la place, ni la possibilité de mettre en place une médiation et un affichage informatif exhaustif partout. Heureusement, pour toutes les questions possibles et imaginables les bénévoles sont là. Ils n'ont pas toujours les réponses, mais ont toujours une remarque qui indique la valeur de l'objet en question, le remet dans un contexte ou du moins donne au visiteur l’impression d'être avec quelqu'un comme eux.
Souvent cela ouvre sur une discussion, un échange qui permet au visiteur de faire naturellement le lien entre son expérience personnelle et la collection présentée, en même temps que d'apprendre quelque chose. Cet échange gratuit et chaleureux entre deux amateurs rend les bénévoles si spéciaux ; par rapport aux professionnels pour lesquels tout échange est une formalité avec un rapport donnant / recevant, et par rapports aux moyens de médiation artificielles.
Un diorama © Musée du Vermandois
 Dans ce musée comme dans tous ceux du même type, ils deviennent donc indispensables. Une visite avec ou sans leur intervention est radicalement différente. Le meilleur exemple se trouve dans la partie du musée consacrée aux « métiers d'antan ». C'est la partie ethnologique du musée, dans laquelle sont présentés de nombreux objets de métiers ou de la vie quotidienne du XXe siècle. Il y a d'abord eu un effort de mise en scène avec des dioramas, tel le musée de Frédérique Mistral. Mais grâce, ou à cause de dons nombreux, il y a eu un assemblage d'objets de plus en plus divers, sans qu'il soit possible de tout référencer, par manque de place il y a très peu de cartels et d'affichage. C'est devenue une véritable caverne d'Ali Baba très riche, peut-être même trop. Sans médiation, il est possible de reconnaître certains objets et de percevoir des évolutions (comme les machines à laver ou les télévisions), malheureusement on peut aussi être frustré et saturé de se retrouver face à une telle masse d'objets, cela peut être illisible.
Dans ce musée comme dans tous ceux du même type, ils deviennent donc indispensables. Une visite avec ou sans leur intervention est radicalement différente. Le meilleur exemple se trouve dans la partie du musée consacrée aux « métiers d'antan ». C'est la partie ethnologique du musée, dans laquelle sont présentés de nombreux objets de métiers ou de la vie quotidienne du XXe siècle. Il y a d'abord eu un effort de mise en scène avec des dioramas, tel le musée de Frédérique Mistral. Mais grâce, ou à cause de dons nombreux, il y a eu un assemblage d'objets de plus en plus divers, sans qu'il soit possible de tout référencer, par manque de place il y a très peu de cartels et d'affichage. C'est devenue une véritable caverne d'Ali Baba très riche, peut-être même trop. Sans médiation, il est possible de reconnaître certains objets et de percevoir des évolutions (comme les machines à laver ou les télévisions), malheureusement on peut aussi être frustré et saturé de se retrouver face à une telle masse d'objets, cela peut être illisible.
Mais avec l'intervention d'un bénévole, cela devient une expérience muséale unique. Surtout avec celle que nous avons vu, qui en plus de son charme naturel, sa classe, son sourire, a fait l'effort de se renseigner sur presque tout ce qui se trouve dans cette caverne, qui devient alors un lieu d'échange didactique incomparable.
On y apprend d'abord des choses, notre étonnement devant certains objets étranges se transforme en découverte de pratiques, aujourd'hui disparues. Certains objets qui semblaient insignifiants ou perdus dans la masse retrouvent leurs sens. Là où des cartels et panneaux seraient indigestes, surtout pour de si nombreux objets, la mémoire de l'intervenante et son talent de conteuse nous les rendent intéressants et vivants.
La section « métiers d'antan »© CDT02
 Puis, souvent, la leçon se transforme en discussion, en échange de connaissances, et mieux encore de souvenirs. Voilà qui est au cœur de la volonté de beaucoup de musées ethnologiques : faire le lien avec le présent. Chacun projet montre naturellement ce qu'il a connu ou ce qu'il pensait connaître dans cette caverne qui s'anime alors par la magie de l'imaginaire. L'échange est fructueux pour les deux parties, puisque l'intervenant n'est pas censé tout savoir et peux tomber sur un visiteur qui a connu tel ou tel objet. Une visite sans médiation, qui aurait pu durer quelques minutes et ne déboucher sur aucune connaissance, se transforme en rencontre chaleureuse entre gens curieux dans laquelle le musée retrouve son sens premier : la diffusion de connaissances, mais avec ce plus humain, et la possibilité de développer tout en gardant le visiteur concerné.
Puis, souvent, la leçon se transforme en discussion, en échange de connaissances, et mieux encore de souvenirs. Voilà qui est au cœur de la volonté de beaucoup de musées ethnologiques : faire le lien avec le présent. Chacun projet montre naturellement ce qu'il a connu ou ce qu'il pensait connaître dans cette caverne qui s'anime alors par la magie de l'imaginaire. L'échange est fructueux pour les deux parties, puisque l'intervenant n'est pas censé tout savoir et peux tomber sur un visiteur qui a connu tel ou tel objet. Une visite sans médiation, qui aurait pu durer quelques minutes et ne déboucher sur aucune connaissance, se transforme en rencontre chaleureuse entre gens curieux dans laquelle le musée retrouve son sens premier : la diffusion de connaissances, mais avec ce plus humain, et la possibilité de développer tout en gardant le visiteur concerné.
Alors que les musées modernes sont généralement dans une recherche de clarté, d'épuration, on voit que cette forme d'exposition qui tend à disparaître peut avoir un intérêt grâce à ces outils de médiation humains, amateurs et passionnés que sont les bénévoles. Cela pourrait même être un concept à reprendre dans certains grands musées.
Bien sûr, ces « appareils » ont de nombreux défauts, dus à leur nature humaine et leur statut non professionnel : le manque d'exhaustivité des connaissances, l'inconstance des sentiments et des humeurs de chacun, la disponibilité aléatoire selon la fréquentation du musée.
Mais songez que ce sont les seuls qui s'adaptent vraiment à chaque visiteur, à chaque type ou catégorie. Souvent, les outils de médiation mis en œuvre par les professionnels s’adressent à un type de public spécifique, ciblé, la plupart du temps scolaire. Ici, chacun à le droit à un accueil personnalisé, qu'il soit enfant, groupe de scolaire, personne âgée, professeur d'Histoire, passionné de tel ou tel sujet, simple passant, curieux ou même non curieux, sans qu'il n'y ait aucune stratégie basée sur des a priori dont les professionnels aiment à user lors de colloques.
Sans prétention aucune, ils permettent une approche des collections qui leur est propre et ne pourrait être imitée. Ils humanisent des choses sans vies, et impliquent le visiteur qui se transforme alors en invité privilégié dans une promenade à travers le temps, qui s'achève le plus souvent, grâce à une fréquentation moindre, en une sympathique discussion autour d'une boisson. Le personnel du musée apprend parfois autant de certains visiteurs que l'inverse, ce qui peut amener celui-ci à s'améliorer, ce qui rend en plus cette médiation participative.
Nous avons donc là un moyende médiation humaine inimitable et propre aux associations, original par son statut de bénévole et d'amateur, toujours et à jamais moderne car l'esprit humain est une machine indépassable en matière de technologie, avec la capacité d'adaptation la plus grande possible et cette possibilité d'impliquer le visiteur. Mais surtout original car chacun d'entre eux est spécial et rend chaque visite unique.
Daniel Bonifacio

Le respect du spirituel dans l'espace muséal
La reconnaissance de la dimension spirituelle des objets dans les musées est une préoccupation partagée par diverses cultures. Cette considération influence la manière dont les objets sont exposés, conservés et interprétés, en respectant les croyances et les pratiques des communautés d'origine. Comment les musées intègrent-ils ces considérations spirituelles dans leurs pratiques muséales ?
Une approche collaborative avec les communautés autochtones
Dans de nombreuses cultures autochtones, les objets conservés dans les musées ne sont pas seulement des artefacts matériels, mais des entités investies d’une signification spirituelle. Leur gestion dans les institutions muséales prend donc en compte ces particularités immatérielles pour éviter toute décontextualisation ou appropriation irrespectueuse.
Le soin des objets sacrés ou culturellement sensibles repose sur un partenariat entre les musées et les communautés autochtones. Selon les recommandations du Gouvernement du Canada, ces consultations permettent de comprendre des aspects comme le pouvoir intrinsèque des objets et leurs implications pour ceux qui les manipulent ou les exposent.Le concept maori de Mana Taonga, qui considère les objets comme des ancêtres vivants, exige un traitement adapté. Cette philosophie, adoptée par des institutions comme le Musée Te Papa Tongarewa en Nouvelle-Zélande, place les communautés au cœur du processus décisionnel. Elles participent progressivement depuis les années 80 à la définition des soins nécessaires pour les objets, qu’il s’agisse de rituels spécifiques ou de la mise en place de protocoles restrictifs. Cela inclut la gestion de masques ou d’autres objets cérémoniels, qui peuvent avoir été séparés de leur communauté d’origine pendant longtemps sans perdre leur pouvoir ni leur importance.

Espace sacré maori Rongomaraeroa, Musée Te Papa Tongarewa, Nouvelle-Zélande, 2019. © Johnny Hendrikus. Te Papa.
Ainsi, de nombreux musées mettent en place des restrictions d’accès et d’exposition. Certains objets ne peuvent être vus ou manipulés que par des personnes initiées, des chamans, ou des personnes d’un sexe spécifique. Par exemple, des restrictions interdisent l’accès à des femmes enceintes ou en période de menstruation. Les objets particulièrement sensibles sont placés dans des vitrines opaques ou dans des espaces restreints pour limiter leur exposition au grand public.
Respect et sacralité de certains objets asiatiques
L’exposition de certains objets provenant des traditions shintô et bouddhistes en Asie nécessite une attention particulière pour respecter leur caractère sacré et préserver
les sensibilités des pratiquants.
Les statues de Bouddha, incarnant les enseignements spirituels, sont souvent exposées dans des espaces dédiés aux distractions minimisées. Ces environnements recréent
parfois l’ambiance d’un temple, avec bougies, encens et coussins de méditation. Ces salles peuvent être réservées aux pratiquants ou nécessiter la présence de guides
spirituels. De plus, par souci de respect, il est tenu d’exposer et d’entreposer les statues de Bouddha de sorte que la tête dépasse les objets qui l’entourent.
Les thangkas, peintures bouddhistes tibétaines, servent de supports visuels pour la méditation et sont utilisées dans des rituels spécifiques. Elles sont également présentes
lors de rituels d’initiation ou de purification. Leur manipulation est restreinte aux pratiquants qualifiés ou aux moines, pour préserver leur intégrité spirituelle.
Les masques rituels d’Asie de l’Est, quant à eux, sont perçus comme des incarnations d’esprits ou de divinités. Leur exposition peut être temporaire, limitée à des cérémonies
spéciales, pour éviter toute profanation ou perte de pouvoir spirituel. De même, les statues de Kannon, déesse de la miséricorde dans le bouddhisme Mahāyāna, sont souvent présentées dans des espaces propices au recueillement, accompagnées éventuellement de chants ou prières.
Comme pour les cultures autochtones, les musées asiatiques consultent régulièrement des moines, prêtres ou praticiens pour s’assurer du respect des traditions spirituelles. Le musée royal de Mariemont, à l’occasion de l’exposition Bouddha, l’expérience du Sensible (2024-2025), a notamment fait appel avant l’ouverture au public à des bouddhistes pour garantir une présentation respectueuse.

Vue de l’exposition Bouddha, l’expérience du Sensible. Musée royal de Mariemont, Belgique,2024. © Paulette Nandrin.
Défis communs, solutions spécifiques
Les objets spirituels liés aux traditions africaines, comme ceux du vodoun, posent également des défis particuliers aux musées. Ces objets, tels que les masques et les fétiches, sont investis de pouvoirs sacrés, d’un rôle actif lors de cérémonies. D’où des solutions spécifiques : l’exposition dans des espaces dédiés, la tenue de rituels de
purification ou encore la restriction de l’accès à certains publics.

Un fétiche bizango en tissu rembourré. Le scanner révèle la présence d’une croix de cimetière, un crâne, des bouteilles renfermant des âmes. Exposition Zombis, musée du Quai Branly, France, 2024. © Léo Delafontaine.
Les objets des religions monothéistes requièrent aussi des protocoles de traitement pour les reliquaires catholiques ou pour les rouleaux de parchemin de la Torah des Juifs,
que les restaurateurs ne doivent pas réparer, à moins d’avoir suivi une formation spéciale et obtenu la sanction de la communauté. De même, l’exposition des rouleaux de la Torah est soumise à des conditions particulières. Ne sont exposés que les rouleaux ne pouvant plus être utilisés pour la lecture publique en raison de dommages ou d’altérations. Il est essentiel de présenter les objets religieux en évitant toute banalisation ou profanation de leur usage en les accompagnant de supports éducatifs appropriés.
La problématique de la spiritualité des objets dans les musées reflète une prise de conscience croissante de la complexité et de la diversité des cultures représentées. Qu’il
s’agisse d’objets autochtones, asiatiques ou africains, ces artefacts incarnent des dimensions immatérielles qui nécessitent des approches adaptées. En collaborant avec les communautés d’origine, en limitant l’accès aux objets sensibles, et en créant des environnements qui respectent leur sacralité, les musées parviennent à concilier leur mission éducative avec le respect des croyances spirituelles. Ces pratiques encouragent une compréhension plus profonde et plus respectueuse des cultures, contribuant ainsi à la valorisation des diversités culturelles et à la préservation des héritages spirituels.
Nina Colpaert
Pour en savoir plus :
Note d'information générale sur les politiques relatives à l'autonomie gouvernementale et aux revendications territoriales globales du Canada et sur l'état actuel des négociations PARIS, Camille, « Visions chamaniques. Arts de l’Ayahuasca en Amazonie péruvienne », Le magazine du Master Expographie Muséographie, 2024. : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2519-visions-chamaniques-arts-de-l-ayahuasca-en-amazonie-peruvienne
PARIS Camille, « Musées et communautés autochtones, vers un partage des pouvoirs au musée ? », Le magazine du Master Expographie Muséographie, 2024.https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2514-musees-et-communautes-autochtones-vers-un-partage-des-pouvoirs-au-musee
Tchénando Patrick Noukpo, Les masques africains : des patrimoines identitaires dans la diversité culturelle entre espaces profane et sacré au Bénin, thèse de doctorat en
Sociologie. Université de Lorraine, 2020.https://theses.hal.science/tel-03208608/
#muséographie #PatrimoineSpirituel #collaboration

Le syndrome de l'expositionnite
Devant l’ampleur que prenait ce phénomène, deux professeurs d’Histoire de l’art du bel paese ont pris la plume pour dénoncer les complications auxquelles pourrait mener la situation. Tomaso Montanari et Vincenzo Trione sont deux historiens de l’art, professeurs à l’université de Naples (respectivement d’art baroque et d’art contemporain), éditorialistes et critiques d’art pour la presse italienne (ils écrivent notamment pour le Corriere della sera et pour Reppublica). Ils ont publié en octobre 2017 aux éditions Giorgio Einaudi un ouvrage intitulé « Contro le mostre », littéralement « Contre les expositions ». Et le sous-titre de confirmer la thèse suggérée par le titre : « Un système de sociétés commerciales, de « commissaires en série », d’élus déboussolés et de directeurs de musées asservis au politique aboutit à la production continue d’expositions bankable, creuses et dangereuses pour les œuvres d’art. Il est temps de développer des anticorps intellectuels, recommencer à faire des expositions sérieuses, et redécouvrir le territoire italien ». Le ton est donné.
© ibs.it
Montanari et Trione dénoncent donc cette « expositionnite » dont l’Italie est, selon eux, devenue la patrie, et critiquent en particulier le torrent d’expositions « blockbusters » toujours composées des mêmes éléments : le Caravage, Léonard de Vinci, les impressionnistes, Van Gogh, Dalì et Warhol. Pour les deux historiens de l’art, ces expositions relèvent presque toujours du pur divertissement, cher et de piètre qualité. Ils regrettent qu’il n’y ait quasiment jamais de recherche originale derrière le projet, voire même rien à apprendre, rien à découvrir. Et surtout, ils insistent sur le fait que ces expositions soient impulsées par des privés « sans scrupules » et des institutions publiques « sans projet » mettent en péril des œuvres uniques, dont la valeur artistique et financière est souvent extrêmement élevée.
Mais qui sont donc ces « privés sans scrupules » dont il a été fait mention à plusieurs reprises ? Parmi les responsables de cette situation, il y a, selon Montanari et Trione, des hommes comme Marco Goldin : mi-historien de l’art, mi-entrepreneur, mi-producteur, mi-manager, Goldin a inventé dans les années 90 un format d’exposition qui a connu un succès particulier. Depuis près de trente ans, il est à l’origine d’une ribambelle d’expositions qu’il décrit comme non-élitistes, faciles d’accès, dédiées à un public familial.
- Des artistes phares soigneusement choisis parmi les stars de l’art moderne, ou d’un mouvement ultra-populaire (les impressionnistes, de préférence)
- Des chefs d’œuvres à volonté, qu’importe la distance qu’ils devront parcourir
- Une thématique simple, si possible en rapport avec la nature (l’eau, l’or, la nuit, la neige…)
- Un prix d’entrée épicé (compter 15€ à 17€ pour une entrée adulte)
… Quitte à ce que le résultat laisse à première vue perplexe. On pense notamment ici à l’exposition « Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento » (« Toutânkhamon Caravage Van Gogh. Le soir et les nocturnes des Égyptiens au XXème siècle »), qu’a accueilli la Basilique palladienne de Vicence entre décembre 2014 et juin 2015. Les quelques photographies de l’exposition que l’on trouve sur le web témoignent d’une scénographie simple (les murs sont unis, la médiation écrite consiste à première vue en des blocs de texte justifiés), ce qui laisse à penser que le budget colossal engagé dans la conception de ces expositions serait absorbé par le prêt d’œuvres prestigieuses de grands maîtres (voir la photo ci-dessous).

Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento © domanipress.it
La critique de Montanari et Trione est acerbe, et extrême à de nombreux égards. D’un autre côté, placer un business-man comme Marco Goldin en position d’évangélisateur, prêt à tout pour porter l’Art à un large public serait peu à propos. Qu’il s’agisse de Montanari, de Trione, ou de Goldin, tous semblent réduire l’exposition à une simple monstration d’œuvres d’art. Et non des moindres, puisqu’il s’agit ici des « grandes œuvres de l’humanité » : des chefs d’œuvres ou rien !
Mais alors, quelle place y a-t-il pour les publics dans cette conception de la muséographie ?
Celle du porte-monnaie, en premier lieu. Même si, en regrettant le manque de fond de certaines expositions « blockbuster », les deux professeurs de l’université de Naples soulèvent un point important ; car ce n’est a priori pas le concept d’exposition « blockbuster » que Montanari et Trione rejettent, mais bien la vacuité du propos de certaines de ces expositions, qui ne poussent pas le visiteur à se questionner, qui ne l’accompagnent pas dans la découverte d’un sujet, d’un artiste, mais qui le placent simplement face à une œuvre considérée comme étant exceptionnelle, selon des critères qu’il peut d’ailleurs ne pas connaître. Il semble en effet que la médiation ne soit pas la priorité des commissaires de ces expositions, le travail sur les publics encore moins. D’ailleurs, la popularité de ces dernières repose parfois sur le prestige et la renommée de l’institution qui les accueille, comme c’est le cas pour le Vittoriano à Rome, qui bénéficie de sa position stratégique (juste derrière les forums impériaux) et qui ne propose, sauf erreur de ma part, pour seule programmation culturelle autour des expositions qu’il reçoit, que des visites guidées adaptées au public qui les suivra (et un atelier pour enfants d’une durée de deux heures, pour seulement l’une des deux grandes expositions qu’il accueille sur le moment).
En soi, l’exposition « blockbuster » peut être un outil ingénieux pour intéresser un public large. Concrètement, il n’y a aucun mal à organiser une exposition autour d’un grand nom de l’Histoire de l’art, ou d’une période appréciée du grand public ; bien au contraire, les « super-expositions » peuvent donner envie à des publics réticents de faire un premier pas fans le monde des musées. Utilisé à bon escient, ce type d’expositions peut constituer un moyen ludique et efficace de toucher un public diversifié, bien que l’on puisse regretter le fait qu’il s’inscrive dans une logique de démocratisation culturelle, et propose (impose ?) une perception verticale et très hiérarchisée de l’art. Là où le bât blesse, c’est que cette entreprise de démocratisation peut éclipser un autre phénomène : celui de la marchandisation artistique, qui pousse à évaluer le succès d’une exposition, ou de manière générale une manifestation culturelle, à sa fréquentation. Ainsi l’impératif de fréquentation pousse-t-il les institutions à penser l’exposition en termes de rentabilité, parfois au détriment de la construction d’un discours original sur un sujet. De même, ce phénomène pourrait laisser penser que seules les expositions présentant des pièces de maîtres sont dignes d’intérêt ; expositions présentées, les trois quarts du temps, par des institutions bénéficiant déjà d’une bonne visibilité au niveau national et international. Ainsi, ces « super-expositions », qui bénéficient de campagnes de communication soignées et dont la fréquentation n’en sera que meilleure, occultent des expositions plus petites, pourtant parfois plus pertinentes mais moins médiatisées, donc moins visitées, qui pourraient finir par être délaissées par le public. Finalement, ce sont moins la qualité de l’exposition et la pertinence de son discours qui attestent de la qualité de l’exposition que sa fréquentation et sa rentabilité.
Peut-être Marco Goldin devrait-il prendre exemple sur les « super-expositions » de sciences, qui utilisent la pop-culture pour faire passer un message scientifique à tous types de publics : on pense notamment ici à l’exposition Jurassic World à la Cité du Cinéma à Paris, où derrière les dinosaures géants se cachait un propos scientifique parfaitement vulgarisé, clair et accessible. Une exposition de chefs d’œuvre n’est pas toujours une « exposition chef d’œuvre »…
Solène Poch
#Blockbuster
#Beaux-arts
#Italie
Sources :
- Article « Tutankhamon Caravaggio Van Gogh a Vicenza. Mummie o mignotte purché sia notte » sur ArtsLife, consulté le 11 novembre 2018
- Article « Se il mostrismo fa male al museo » sur Il giornale dell’architettura consulté le 11 novembre 2018
http://ilgiornaledellarchitettura.com/web/2015/04/11/se-il-mostrismo-fa-male-al-museo/
- Article « Il pamphlet di Montanari e Trione. Le mostre sono i mostri dell’arte » sur Corriere della sera, consulté le 11 novembre 2018
- Article « Art : problématique des expositions blockbuster » sur Fastncurious, consulté le 13 novembre 2018
http://fastncurious.fr/asymetrie/exposition.html/
- Article « Un approccio idiota all'arte: a proposito delle mostre blockbuster » sur Finestre sull’arte, consulté le 14 novembre 2018
https://www.finestresullarte.info/309n_mostre-blockbuster-approccio-idiota-all-arte.php

Les « Tableaux Fantômes » du musée Benoît-de-Puydt
Il est coutumier pour les musées d’exposer un évènement passé, une tradition oubliée, des techniques ou savoirs faires anciens, une période révolue ou méconnue… En revanche, matérialiser des œuvres d’art disparues est bien moins fréquent. Le musée Benoît-De-Puydt a pourtant choisi de consacrer une partie de son parcours permanent aux « Tableaux Fantômes », détruits lors de la Première Guerre mondiale…
Image d'introduction : Des tableaux fantômes ? © Doriane Blin
Un bref historique du musée
Benoît-De-Puydt naît en 1782 et décède à Bailleul en 1859. Riche collectionneur, il détient une importante collection d’art, de cabinets de curiosités et de céramiques. N’ayant aucun héritier, il lègue l’entièreté de sa collection ainsi que sa maison à la ville de Bailleul. Et ce, sous deux conditions, la première : créer une académie de dessin, de peinture et d’architecture, la seconde : que l’on donne une messe en son honneur tous les ans. Ses prescriptions seront respectées : l’académie et le musée ouvrent en 1861. Grâce au legs de Louis- Henri Hans, de nouvelles œuvres intègrent les collections du musée. Edward Swynghedauw, conservateur du musée de 1881 à 1912, effectue un travail d’inventaire particulièrement précis. Il décrit avec minutie les 133 œuvres de ce legs et référence leurs dimensions exactes.
Mais en 1914, la Première Guerre mondiale éclate. La ville de Bailleul, non loin du front, est géographiquement inquiétée par les offensives allemandes. Cependant, durant les trois premières années de conflit, le musée continue d’accueillir des visiteurs. Ce n’est qu’en 1918 que la population fuit Bailleul et laisse la ville uniquement peuplée de soldats. Le musée est alors contraint de fermer ses portes. En février 1918, le lieutenant Fernand Sabbaté est dépêché par le Service de protection des œuvres d’arts du front Nord pour faire état de la situation. Il décide d’évacuer la collection. Fernand Sabbaté revient avec seulement deux camions pour évacuer les œuvres. A l’époque, le bois manque pour réaliser les caisses de transport. Il est impossible de sauver l’entièreté de la collection. Priorité est donnée notamment aux cabinets flamands, tandis que d’autres œuvres restent sur place et connaitront leur perte le 22 mars 1918 lors du bombardement de la ville. Le musée est intégralement détruit. Outre les œuvres pillées, celles restées sur place ne sont plus que décombres parmi les ruines du bâti. Après une évaluation des dommages de guerre, il est question de trouver un nouveau lieu pour accueillir les œuvres sauvées, évaluées entre 10 et 20% du total de la collection initiale.
Le musée Benoît-De-Puydt est aujourd’hui installé dans un bâtiment reconstruit par Maurice Dupire, au même emplacement que l’ancien musée.

La façade du musée aujourd’hui © Justine Thorez, musée Benoît-De-Puydt
Exposer des « Tableaux Fantômes » ou redonner vie à des œuvres disparues
L’histoire du musée Benoît-De-Puydt ne s’arrête pas là. A partir de l’inventaire d’Edward Swynghedauw retrouvé en 1990, Laurent Guillaut propose d’exposer les œuvres disparues : il fait écrire sur des panneaux de mêmes dimensions que les œuvres originelles, leur description, telle une incarnation de leur disparition. Ces « Tableaux Fantômes » prennent alors place aux côtés d’autres ayant pu être conservés.

Salle des « Tableaux Fantômes » © Justine Thorez, musée Benoît-De-Puydt
Comment expliquer ce choix d’exposer le disparu ? Nous avons interviewé Chloé Jacqmart, chargée de développement et des publics au musée Benoît-De-Puydt.
Pouvez-vous commenter l’initiative d’exposer les « Tableaux Fantômes » dans le musée ? Quel message y-a-t-il derrière cet accrochage ? Quel parti-pris muséographique ?
Chloé Jacqmart : L'initiative est celle de Laurent Guillaut, conservateur des musées Benoît-De-Puydt et de Cassel entre 1991 et 2000.
Cette démarche avait notamment pour volonté de marquer l'histoire de la Grande-Guerre dans un musée reconstitué à l'image d'une maison de collectionneur. Au sein d'un musée dont les espaces de présentation des collections rappellent celui d'un intérieur bourgeois du XIXe, les « Tableaux Fantômes » rappellent l'histoire plus contemporaine et l'impact non seulement sur les collections, mais sur la ville et le territoire. Le parti-pris muséographique est celui d'un intérieur de maison de collectionneur reconstitué, mais également réinventé. Les descriptions des œuvres disparues ne sont pas seulement visibles du public, elles sont présentées comme pourraient l'être les œuvres si elles faisaient encore partie du fonds. Elles n'accompagnent pas les collections, elles incarnent les collections.
C'est également, de manière peut-être plus indirecte, une manière de mettre en lumière le travail exceptionnel de description réalisé par Edward Swynghedauw, second conservateur du musée et directeur de l'Académie de peinture, dessin et architecture Benoît-De-Puydt, qui maîtrisait aussi bien la plume que le crayon. Il décrit les objets du musée tel un naturaliste, et c'est une approche scientifique et méthodique des collections à un instant T dont les « Tableaux Fantômes » sont aujourd'hui le témoin.
« Sur une pelouse, devant un épais massif de verdure, près d’un piédestal surmonté d’un grand vase de fleurs et qui occupe le premier plan de droite parmi des fleurs variées, tout un groupe de petits garçons, au nombre de neuf, s’amusent à faire monter un ballon que l’un d’entre eux tient par la ficelle. Devant celui-ci un petit chien blanc taché de brun aboie après le joujou qui est de diverses couleurs et qui a le don d’amuser singulièrement ces enfants. »
Description de l’une des œuvres aujourd’hui disparue par Edward Swynghedauw
Comment se nomme la salle dans laquelle se trouvent les « Tableaux Fantômes » ?
C. J. : Cette salle n'a pas de nom en particulier, si ce n'est salle B, mais il s'agit d'un repère pour le parcours de visite. En revanche la situation du mur qui présente les « Tableaux Fantômes » au rez-de-chaussée fait partie intégrante du parti pris muséographique de l'ensemble de ce niveau, à savoir une immersion au cœur d’un musée de la fin du XIXe siècle-début du XXe siècle. La naissance du concept des « Tableaux Fantômes » est certes postérieure à ce type de muséographie mais la collection concernée fait partie du fonds antérieur au conflit de 14-18, et de fait l'incarnation de la disparition fait sens dans cet espace musée-maison de collectionneur réinventé.
Le nombre de tableaux disparus est considérable. Savez-vous pourquoi ceux exposés ont été choisis ?
C. J. : Pour ce qui est des œuvres exposées sur le mur présentant les « Tableaux Fantômes », le choix s'explique dès l'origine du projet. Le choix de Laurent Guillaut se porte sur le Legs Louis-Henri Hans (1879), constitué d'une centaine d'objets et dont il reste après la guerre seulement 5 tableaux et 1 bénitier en ivoire. Les notices incarnant les « Tableaux Fantômes » sont une partie des œuvres de ce legs.
Je ne pourrais malheureusement pas me prononcer sur le choix de M. Guillaut, mais à mon sens cet ensemble renforce le propos et le message en ce qu'il représente l'importance de la disparition en s'appuyant sur une partie de la collection : les 6 objets sauvés face à la centaine initialement léguée et présentée au sein du musée avant 1918 illustrent particulièrement bien l'ampleur des pertes subies.
Que vous évoque, personnellement, ce choix d’exposer « matériellement » le disparu, la perte ?
C. J. : Au même titre que de nombreux ensembles, monuments, commémorations, etc. qui découlent de la Grande-Guerre, les « Tableaux Fantômes » contribuent au travail de mémoire, leur existence directement due à cet événement. Ce choix d'exposer est également à mon sens une forme de représentation de ce qu'est un musée, de son rôle : au-delà de la fonction de conservation, il interroge la place et la trace des objets. Lieu de délectation le musée est aussi un lieu de réflexion qui se doit d'interroger l'évolution des sociétés dont il conserve les vestiges.
Les « Tableaux Fantômes » font prendre une toute autre dimension aux œuvres disparues et en modifient le statut, et de fait le rapport qu'elles ont avec le spectateur. Mais bien qu'elles ne soient plus visibles, ces œuvres disparues conservent un rapport avec l'esthétisme, créé par l'ensemble des impressions graphiques présentées comme des œuvres, et à travers l'imagination suscitée par les descriptions. Le rapport à l'image est différent mais toujours présent.
Les « Tableaux Fantômes » sont aujourd'hui une étape incontournable de la visite et font partie intégrante du parcours permanent du musée. Outre les témoins et marqueurs de l'histoire du musée, ces « Tableaux Fantômes » font aujourd'hui partie de son identité, et de l'expérience qu'il fait vivre à ses publics.
Ce choix muséographique provoque-t-il des réactions de la part des visiteurs ? Si oui, quelles sont-elles ?
C. J. : Les visiteurs sont très souvent intrigués par cette présentation et, curieux d'en savoir plus, ils apprécient d'échanger avec la personne assurant l'accueil ou les médiateurs présents. Éclairés sur l'histoire du musée, ils appréhendent différemment les lieux et les collections.
Une réinterprétation par des artistes contemporains
Non seulement les « Tableaux Fantômes » deviennent eux-mêmes des objets de collection en ce qu’ils sont exposés ainsi au sein du musée, mais ils deviennent support à l’écriture d’une nouvelle page de l’histoire. Sur l’initiative de Luc Hossepied, en 2018 – centenaire de la Grande Guerre - des artistes contemporains réinterprètent les tableaux et donnent naissance à de nouvelles œuvres d’art. Valorisées à l’occasion de l’exposition itinérante intitulée « Les Tableaux Fantômes » à travers les Hauts-de- France, les œuvres ont été accueillies dans 8 institutions, parmi elles : la médiathèque de Bailleul, le Muba, la Bibliothèque du Fort-de-Mons ou encore la Piscine de Roubaix… Les visiteurs ont pu admirer 91 créations contemporaines toutes inspirées des précieuses descriptions d’Edward Swynghedauw et respectant le format des œuvres initiales. Le commissariat de cette exposition a été assuré par Luc Hossepied, Eric Rigollaud, Nicolas Tourte et Sylvette Botella-Gaudichon.
Comment est né le projet de réinterprétation de ces œuvres par des artistes contemporains ? Que cela signifie-t-il pour le musée et pour la ville de Bailleul ?
C. J. : Le projet a été imaginé et initié par des acteurs extérieurs au musée, preuve non seulement que le concept et l'histoire des « Tableaux Fantômes » laissent difficilement indifférent mais qu'il inspire et invite à réfléchir, réagir, et créer.
C'est aussi une forme de manifestation de l'appropriation de notre Histoire contemporaine sous forme de création artistique, via les différentes empreintes qu'elle laisse et qu'elle invite à explorer. La création, l'interprétation et la réinterprétation se mêlent et contribuent à écrire l'histoire du musée et de la création artistique.
Se rencontrent ici des écoles artistiques, des pratiques artistiques, des contextes de créations, des inspirations, etc. L'art est constamment en mouvement et rarement (voire jamais) en rupture totale avec le passé, et une histoire comme celle des « Tableaux Fantômes » écrit une histoire de l'art à travers le temps.
Il ne s'agissait pas de combler un manque mais bien d'écrire une nouvelle histoire en s'inspirant de ce qui a été. Pour le musée, ces œuvres contemporaines symbolisent le lien entre création artistique et patrimoine. Elles sont également une nouvelle page de l'histoire des œuvres disparues et de l'histoire du musée.
Nous remercions Chloé Jacqmart pour son éclairage sur l’histoire des collections du Musée Benoît-De-Puydt qui continue de s’écrire.
Pour aller plus loin :
- Le site internet du musée : https://www.musee-bailleul.fr/
- Cloé Alriquet, plateforme des médiations muséales : http://www.plateforme-mediation-museale.fr/mediations/salle-des-tableaux-fantomes
- Reportage de France 3 : les tableaux fantômes, exposés à la Piscine de Roubaix : https://www.youtube.com/watch?v=JicI_9qypnI&ab_channel=France3Hauts-de-France
#TableauxFantômes #Benoît-De-Puydt #Bailleul

Les lieux de Mémoire de la Shoah
Le Dictionnaire de la Shoah publié chez Larousse en 2015 soulève que «les mémoriaux et les musées de la Shoah sont d'excellents révélateurs de la difficulté de constituer l'histoire de l'extermination et de sa mémoire» (p. 350). Bien des espaces sont dédiés à la mémoire de l’Holocauste : d’une part, les plaques commémoratives apposées sur la façade d’établissements scolaires et les Monuments aux Morts (monument aux Martyrs de la Résistance d’Épernay, monument aux Héros du Ghetto de Varsovie), d’autre part, les mémoriaux accompagnés d’un centre d’informations (Berlin), les mémoriaux de la Shoah qui organisent des expositions permanentes ou temporaires (Paris, Jérusalem…), les lieux de l’horreur devenus musées (Auschwitz-Birkenau, Maison Anne Franck), et les nouveaux musées du Judaïsme (Paris, Berlin, Amsterdam…) qui abordent logiquement le sujet. Par rapport à tous ces lieux, comment un Mémorial de la Shoah se positionne-t-il entre hommage et devoir de mémoire, avec quelles fonctions et surtout avec quels procédés muséographiques, scénographiques et architecturaux pour rendre compte à la fois de l’Histoire passée et du futur à éviter, tout en s’adressant au Présent ?
Image d'introduction : Monument en l'honneur des soldats et partisans juifs qui combattirent contre l'Allemagne nazie à Yad Vashem, Jérusalem (Avishai Teicher, Creative Commons)
Les fonctions d’un Mémorial de la Shoah : le cas d’Auschwitz
Après 1945, certains lieux de l’horreur sont devenus des musées plus ou moins rapidement. Le Musée national Auschwitz-Birkenau a ainsi ouvert dès juillet 1947 suite à l’investissement des lieux par un groupe d’anciens détenus polonais souhaitant « sauvegarder la mémoire des victimes d’Auschwitz [et] protéger les vestiges des installations. Ce groupe parvint à organiser ce qui s’appelait à l’époque la Préservation Permanente du Camp d’Auschwitz et à accueillir les milliers de pèlerins qui affluaient massivement, à la recherche de traces de leurs proches, pour prier et rendre hommage aux victimes. »
«Déjà à l’époque de la création du musée [d’Auschwitz-Birkenau] on se demandait s’il fallait uniquement décrire le passé ou bien expliquer et étudier les principaux mécanismes du système criminel concentrationnaire. Avaient été alors avancées des propositions extrêmes, qui allaient du labourage du site à la sauvegarde et à la préservation de tout ce qu’il serait possible de conserver.
Autre sujet de débat, toujours actuel : l’appellation du musée. Tout le monde n’accepte pas le terme de «Musée d’Etat d’Auschwitz-Birkenau». Les uns estiment que le camp est d’abord un cimetière ; les autres, qu’il s’agit d’un lieu de mémoire, d’un monument ; d’autres encore pensent que ce lieu devrait être un institut de mémoire, un centre d’éducation et de recherche sur le destin des personnes qui y trouvèrent la mort. En fait, le musée remplit toutes ces fonctions, qui ne s’excluent pas mais, au contraire, se complètent.» Auschwitz-Birkenau : Histoire et Présent (2008)
Les Mémoriaux de la Shoah ont la particularité d’être entièrement gratuits là où d’autres, comme les Mémoriaux des Guerres mondiales (Caen, Verdun…) proposent des grilles tarifaires. Généralement, seules les visites guidées pour les groupes sont payantes.
Des récurrences iconographiques : les Monuments aux morts

Monument aux héros du ghetto, Varsovie, Pologne (Creative Commons)
Un Monument aux morts est une construction (sculpture, statue, voire plaque…) visant à commémorer le souvenir des victimes d’un conflit ou des soldats morts pour la Nation. L’édifice reprend souvent les noms des martyrs et est généralement situé à proximité du lieu de l’événement (un champ de bataille par exemple), d’un cimetière, d’une mairie ou sur une place publique. En France, cette forme d’hommage se généralise après la Première Guerre mondiale.
Les Monuments érigés en mémoire des Juifs victimes du régime nazi reprennent souvent les mêmes éléments iconographiques. Le chandelier (Ménorah) est une référence à la fête de Hanouccah, littéralement « Fête des Lumières », qui commémore la révolte des Maccabées en Judée (175 à 140 av. J.-C.) et le « miracle de la fiole d’huile » qui métaphorise l’idée d’une lumière éternelle dans un monde où le peuple juif est menacé. Le lion est quant à lui l’emblème traditionnel de la tribu de Judah (Yehouda), quatrième fils de Jacob selon la Bible, destinée à régner sur la Terre Promise. Étymologiquement, le terme « juif » (Yehoudi) vient donc du nom de cette lignée royale. Enfin, les textes présents sur les Monuments de l’Holocauste sont généralement rédigés en hébreu moderne et en yiddish, langue des juifs d’Europe de l’Est.
Des récurrences muséographiques et scénographiques : le Mémorial qui se dénomme comme tel
Le Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe de Berlin (2005) a la particularité de proposer un « centre d’information » qui se rapproche finalement beaucoup des Mémoriaux de la Shoah de Paris, Milan ou Jérusalem dans le sens où celui-ci propose une exposition permanente et des expositions temporaires. La différence entre eux réside dans leurs fonctions et dans la construction de leur parcours.
Le Dictionnaire de la Shoah explique que « la nouvelle génération de musées […] sont en même temps des centres de recherche et de documentation sur la Shoah, à Jérusalem et Paris (2005), Budapest (2006), Sydney, (2004), à la suite du précurseur United States Holocaust Memorial Museum de Washington (1993) ». Ainsi, le Mémorial de la Shoah de Paris remplit les missions suivantes : recherche-documentation, édition, expositions et activités culturelles, activités pédagogiques et actions de formation, activités hors-les-murs… et organise aussi des groupes de parole et des voyages sur les lieux de mémoire.
Ces « mémoriaux-musées » possèdent aussi des collections qui leur sont propres : documents d’archives, ressources audio et/ou visuelle (fonds photographique, témoignages recueillis après-guerre…), et objets à forte valeur historique, symbolique et émotionnelle (étoile jaune, uniforme de déporté…).
Certains éléments muséographiques et scénographiques se retrouvent dans la majorité des Mémoriaux de la Shoah à travers le monde. Les Murs des Noms reprennent les (longues) listes des personnes déportées en Pologne depuis la ville du mémorial et sont parfois accompagnées de leurs années de naissance.

À gauche : "Mur des noms" du Mémorial de la Shoah, Paris © Dario Crespi, Creative Commons
À droite : "Mur de noms" du Mémorial de la Shoah, Paris © Ninaraas, Creative Commons
Certains mémoriaux mettent en scène les photographies des hommes, femmes et enfants assassinés sur de grands murs qui dépassent largement le visiteur. Des milliers d’yeux le regarde et les sourires figés glacent le sang.

À gauche : "Salle des noms" de Yad Vashem, Jerusalem © Berthold Werner, Creative Commons
À droite : "Mémorial des Enfants" clôturant l'exposition permamente du Mémorial de la Shoah, Paris ©BrnGrby, Creative Commons
Les Mémoriaux de la Shoah prennent aussi à cœur leur devoir d’hommage aux « Justes parmi les nations ». Ce titre est décerné par Yad Vashem (Institut International pour la mémoire de la Shoah, Jérusalem, 1953) au nom de l’Etat d’Israël et répond à « l'obligation éthique [d’Israël] de reconnaître, d’honorer et de saluer, au nom du peuple juif, les non-juifs qui, malgré les grands risques encourus pour eux-mêmes, ont aidé des juifs à un moment où ils en avaient le plus besoin. » (loi relative à la commémoration des martyrs et des héros, dite loi Yad Vashem de 1953). Pour cela, chaque Mémorial utilise un ou plusieurs systèmes honorifiques : Mur des Justes, Allée des Justes, Jardin des Justes… Une partie du Jardin des Justes de Yad Vashem est ainsi dédiée aux habitants de la commune de Chambon-sur-Lignon qui ont collectivement accueilli des centaines de Juifs fuyant les persécutions entre 1940 et 1944.

À gauche : "Crypte du souvenir" de Yad Vashem, Jerusalem © Berthold Werner, Creative Commons
À droite : "La crypte" du Mémorial de la Shoah, Paris ©BrnGrby, Creative Commons
Enfin, les Cryptes accueillent les cendres de victimes de la Shoah pour permettre le recueillement solennel, voire la prière.
Pour aller plus loin :
- Bensoussan, G., Dreyfus, J. M., Husson, E., & Kotek, J. (2015). Dictionnaire de la Shoah. Larousse. « A Présent ». 656 p.
- #mémoire #mémorial #secondeguerremondiale

Les musées au Cambodge, une situation précaire
Sorti de son isolement géopolitique, le Cambodge s’engage dans un développement économique et humain dont le tourisme est l’une des pierres angulaires. Quelle place peuvent avoir les musées dans cet espace en pleine évolution ?
Cour du Musée national du Cambodge © Julien Tea
La crise sanitaire du COVID-19 a profondément marqué la société cambodgienne, dont l’économie est principalement axée sur ses exportations textiles, la construction et le tourisme. Ce dernier secteur représentait 18,7% du PIB national en 2019. Les institutions muséales sont un maillon essentiel de cette « chaîne de valeur » qui, contrairement au cas français, n’a pas fait l’objet d’une politique de soutien d’urgence de la part du gouvernement cambodgien. Dans cette période précaire de chute de la demande touristique, seules les institutions ayant les « reins solides » ou étant adossées à d’autres activités économiques et culturelles ont pu survivre. Les patrimoines angkoriens et mémoriaux bipolarisent le champ culturel et définissent l’identité du Cambodge à l’étranger rendant difficile les tentatives de diversification de l’offre culturelle.
Des musées d’Angkor …
La muséologie cambodgienne est une héritière directe de la muséologie française du début du XXe siècle, époque où sont créées les premières institutions patrimoniales au Cambodge. La toute nouvelle Ecole française d’Extrême-Orient concentre ses activités sur l’immense complexe de temples ruinés de l’ancien empire angkorien, dont il faut dégager l’architecture de la jungle envahissante, et mettre à l’abri la statutaire livrée aux pilleurs (dont l’exemple le plus médiatique est un certain André Malraux…). Le Musée national, inauguré en 1920, répond à la fois à cette nécessité et à la volonté de remettre à l’honneur les arts khmers en construisant conjointement une Ecole des Beaux-Arts dans la plus pure tradition khmère. La muséographie du musée est alors très représentative d’une histoire cambodgienne presque entièrement portée vers la période angkorienne (IXe-XIIIe siècle) qui oblitère la réalité contemporaine du pays. L’aile ethnographique, assez sommaire, n’est mise en place qu’après l’indépendance.
Outre Phnom Penh, plusieurs musées archéologiques de taille très variable ont été ouverts au rythme des découvertes archéologiques, comme le Musée Preah Norodom Sihanouk inauguré en 2015 grâce à l’aide d’entreprises et universités japonaises et présentant les résultats des fouilles du temple de Banteay Kdey. Le musée provincial de Battambang, deuxième musée plus ancien du pays, accueille une exposition sur les fouilles françaises dans les grottes de Laang Spean. Malgré leur discours très hermétique et à visée scientifique, ces musées rencontrent un public nombreux venus expressément visiter les temples d’Angkor.

Musée provincial de Battambang, la statuaire et les colonnades donnent l’impression de rentrer dans un temple angkorien © Julien Tea
… aux musées d’Angkar

Entrée du Musée du génocide – Tuol Sleng © Julien Tea

Premier étage du bâtiment de la prison Tuol Sleng © Julien Tea
A ce pôle muséal célébrant la grandeur passée de l’empire khmer, répond un second pôle axé sur l’histoire du génocide et des atrocités perpétrés par les Khmers rouges et les efforts humanitaires menés dans le pays depuis 1992. A Phnom Penh, un musée du Génocide est créé dès 1979 dans l’ancienne école primaire de Tuol Sleng, rebaptisée prison S-21, où étaient torturés les prisonniers politiques de l’Angkar (de angkar padevat, l’organisation révolutionnaire). Adossée à une visite des Killing fiels, champs où les prisonniers étaient exécutés, la muséographie visait en premier lieu à rendre compte des crimes commis par les Khmers rouges par le biais de chocs émotionnels. Les lieux de mémoire, présents aux alentours des nombreux lieux d’exécution de masse sur le territoire, sont autant de rappels permanents de cette histoire douloureuse et d’éléments d’attraction touristique.
Développement culturel et promotion du développement

Entrée du musée des mines anti personnelles, en dessous de laquelle se trouve une affiche touristique de tir à l’arme automatique © Julien Tea
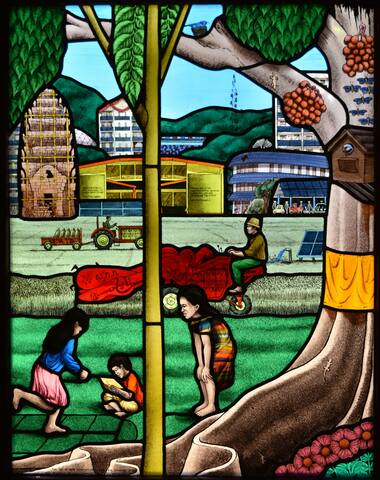
Vitrail du parcours du Cambodian Peace Museum © Julien Tea
Les ONG et organisations internationales se sont également emparées de l’outil muséal pour promouvoir leur action de réconciliation et de développement du pays. Dès 1992, l’ONG franco-cambodgienne Krousar Thmey (Nouvelle Famille) crée des expositions itinérantes touchant tour-à-tour les thématiques de la culture khmère, de la réconciliation nationale et de la préservation de la biodiversité. Les grandes campagnes de déminages sont un sujet privilégié des actions de médiation éducative. Aki Ra, un ancien enfant-soldat reconverti en démineur, décide en 1999 d’ouvrir le Cambodia Landmine Museum qui lui sert autant de source de revenu que d’outil de communication. Un second musée, à la muséographie bien plus immersive et instructive, a été créé par le Cambodian Mine Action Center, organisme étatique chargé du déminage du pays. Enfin, un grand centre d’interprétation, la Cambodia Peace Gallery, fait la promotion du processus de paix au Cambodge et de l’action des peace builders dans le monde. A l’exception du musée d’Aki Ra, présent dans les circuits touristiques, ces musées visent un public local et scolaire dans une optique d’empowerment.
La rentabilité, une boussole prédominante
Extrêmement fragile au sortir du XXe siècle, l’Etat cambodgien n’a pas les moyens de financer la construction ou l’entretien de musées, il fait donc appel à des entreprises privées dont les présidents sont souvent proches du pouvoir. Ainsi, le conglomérat vietnamien Sokimex obtient dans les années 2000 les visas d’exploitation des sites touristiques de la région d’Angkor, avant d’obtenir dans les années 2010 un permis pour le parc national du Bokor. Les efforts sont principalement dirigés vers Siem Reap où se concentre la manne touristique internationale. La recherche de rentabilité pousse les entreprises étrangères à créer des musées toujours plus spectaculaires et axés sur les tempes d’Angkor, comme le Angkor National Museum financé par les frères Vilailuck, actionnaires principaux d’une grande firme de télécommunication thaïlandaise, et qui a fait l’objet de nombreuses critiques pour sa muséographie à la fois spectaculaire et scientifiquement simpliste, ainsi que son aspect de centre commercial. Le Angkor Panorama Museum, sorte de musée panoramique similaire au Musée Panorama 1453 d’Istanbul, est lui symptomatique du mélange entre intérêts privés et géopolitiques : construit et géré par les Studios Mansuade, principale agence artistique d’Etat de la Corée du Nord, le musée a cessé ses activités suite aux sanction onusiennes de 2017. En règle générale, ces créations muséales sont des échecs financiers, les touristes étrangers se satisfaisant déjà largement du Pass hebdomadaire à plus de 100 dollars américains.

Salle des Mille Bouddha du Musée national d’Angkor © Julien Tea
Une légitimation par l’action culturelle
Certaines institutions ou organisation internationales tentent également d’utiliser les musées pour promouvoir leur action, avec plus ou moins de succès. A Siem Reap, la Mekong Ganga Cooperation (association de coopération culturelle regroupant l’Inde, La Birmanie, le Bangladesh, la Thaïlande, le Laos, Le Cambodge et le Vietnam) a créé un musée présentant les pratiques vestimentaires des populations de ses pays membres, avec une visibilité variable des minorités ethniques. Sans véritable soutien scientifique et politique, ce musée fait pour la forme affronte de grandes difficultés dans la constitution de son parcours muséographique. A contrario, le musée Sosoro, construit par la Banque Nationale du Cambodge (BNC) en 2012 et présentant l’histoire de la monnaie et les principes économiques, dénote du paysage muséal par la qualité de son propos scientifique et des espaces interactifs, spécialement dans les séquences liées à la compréhension des outils économiques. Le succès critique de ce musée, a encouragé la BNC à imaginer la création d’un second musée à Battambang (toujours en construction) sur l’histoire de cette région frontalière.

Musée en construction de Battambang dans le quartier historique de la ville © Julien Tea
Les musées cambodgiens revêtent de multiples facettes qui reflètent les enjeux contemporains du pays, entre capitalisme rapace doublé d’un paternalisme culturel, aspiration de la jeunesse au consumérisme, et difficulté à trouver des espaces de libre expression dans un climat de dérive autoritaire. La crise du COVID-19 a révélé la fragilité du modèle économique cambodgien dans le domaine de la culture, première victime de la crise. Personne n’a été épargné, des petits musées provinciaux de Kampot et de Kep au grand parc d’attraction folklorique du Cambodian Cultural Village, sorte de Puy du Fou à la cambodgienne fermé en 2020. Alors que le tourisme chinois n’en est encore qu’à son redémarrage, on peut s’interroger sur la viabilité des grandes institutions survivantes. Qu’arrivera-t-il quand la province de Siem Reap, qui supervise la région d’Angkor, se verra transférer ces nombreux musées pour touristes dont la rentabilité est en berne ?
JT
Pour en savoir plus :
#Cambodge #Tourisme #Muséologie
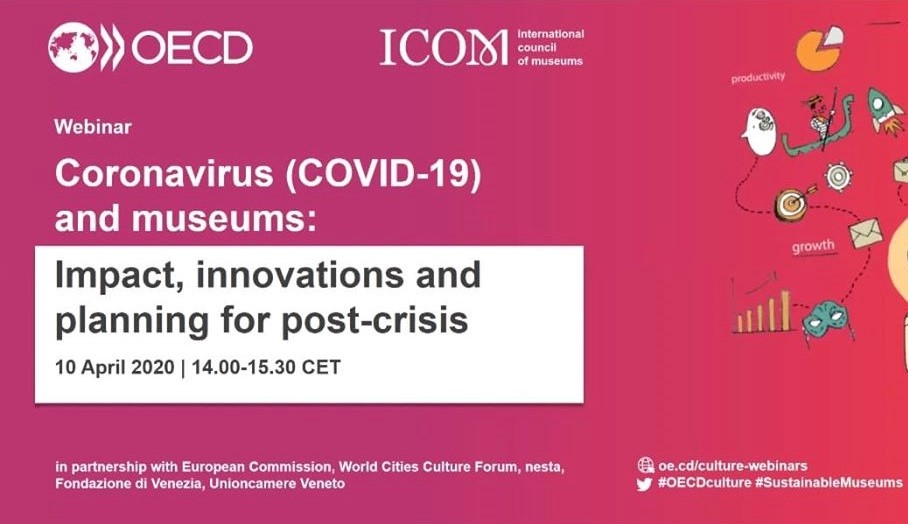
Les musées de demain – Webinaire ICOM et OCDE « Coronavirus and museums : impact, innovations and planning for post-crisis »
Avril 2020, en confinement, je me laisse emporter aux quatre coins du monde. Derrière mon écran, défilent des professionnels de la culture et des musées. L’anglais prend mille et unes couleurs du Canada à la République de Corée en passant par l’Italie. J’assiste en direct au Webinaire (j’ai découvert le sourire aux lèvres ce mot qui signifie séminaire en ligne) organisé par l’ICOM (Conseil International des Musées) et l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Les professionnels se penchent sur l’après crise sanitaire pour les institutions muséales, le webinaire est intitulé : « Coronavirus and museums : impact, innovations and planning for post-crisis » (en partenariat avec la Commission Européenne, World Cities Culture Forum, nesta, Fondazione di Venezia et Unioncamere Veneto). 1400 participants se joignent à moi dont environ 700 européens.
Ekaterina Travkina, membre de l’OCDE, modère le webinaire qui accueille huit participants. Elle donne le rythme, la séance est organisée en trois parties. D’abord, les impacts à court et long termes de la fermeture des musées ; ensuite, l’émergence d’innovations et d’opportunités pour le futur ; enfin, les politiques de soutien au secteur muséal.
Impacts à court et long termes de la fermeture des musées
La première intervenante Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM) au Canada, rappelle que les musées publics ne subissent pas les mêmes sorts que les musées privés. Le MBAM est un musée privé qui bénéficie de subventions de la part de la province montréalaise. Comme une entreprise, il fait face à un défi financier. Concernant son personnel, le MBAM est en grande réflexion, certains membres du bureau refusent de garder des personnes qui ne peuvent pas travailler à 100%. Quant à Nathalie Bondil, pour éviter le pire, elle invite à la créativité. La directrice insiste également sur le fait que les musées ne sont pas les seuls à pâtir de la crise sanitaire, ils font partie d’un écosystème. Un propos qu’appuiera, Joan Roca, le directeur du musée d’histoire de Barcelone (MUHBA) en Espagne, pour qui les musées ne sont que le sommet de l’iceberg du secteur culturel ; il faut soutenir l’entièreté de l’écosystème culturel menacé.
Depuis l’Italie, Mattia Agnetti, secrétaire exécutif de la Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE), parle d’un impact d’une durée de 10 à 12 mois pour les musées. Pour le moment, le numérique s’affirme comme la seule offre que les musées peuvent donner. Lorsque les institutions culturelles vont rouvrir, face au manque de ressources, elles devront piocher dans leurs ressources propres. C’est pourquoi Mattia Agnetti appelle les musées à coopérer à l’échelle internationale.
A la tête du Musée du fer en République de Corée, Inkyung Chang donne les résultats d’une enquête menée par la Korean Museum Association qui traite les conséquences de la crise sanitaire sur les musées fermés depuis le 25 février 2020. Pour le mois de février dans 122 musées privés, l’enquête chiffre à 1 million de dollars américains la perte de bénéfices mensuels. Elle note qu’au moment de l’enquête 40% des musées étaient encore ouverts. Si les grands musées perpétuent le lien avec le public grâce au développement de programmes numériques, ces dispositifs restent hors d’atteinte pour les musées à petits budgets. Pour elle, l’expérience muséale numérique est un nouveau paradigme. Il faut s’approprier les outils technologiques pour éduquer à la culture et échanger avec le visiteur. Les métiers muséaux vont changer en ce sens.
Emergence d’innovations et d’opportunités pour le futur
Selon Joan Roca (MUHBA), les musées changent constamment, cette crise est une opportunité pour innover. Dans les interventions, à plusieurs reprises, la nouvelle définition des musées proposées par l’ICOM à Kyoto est évoquée. Pour Joan Roca, « nous avons besoin d’une nouvelle génération de musées qui combine les innovations culturelles et les mesures sociales d’une part ; avec un développement de l’économie locale d’autre part ». Selon lui, si la révolution est purement technologique, elle sera morte. Joan Roca évoque alors cinq idées pour l’enrichir, cinq révolutions : narrative (créer du discours pour les collections, les musées doivent être des lieux de recherches…), patrimoniale (idée que le musée n’est rien sans ses collections, elles constituent un moyen privilégié pour créer du lien avec le public), de l’organisation (flexibilité du lien avec les autres institutions), des citoyens (les musées sont cruciaux dans les démocraties culturelles ; lier la culture et l’éducation sont la clé pour faire venir les jeunes et le public éloigné de la culture aux musées) et du tourisme (les musées doivent diversifier leurs objectifs, offrir diverses expériences de visite). En effet, de nouvelles valeurs émergent dans le secteur culturel affirme Nathalie Bondil (MBAM). C’est pourquoi, elle souhaiterait voir apparaître deux termes dans la définition des musées de l’ICOM : « inclusion » et « bien-être ». Pour elle, la technologie n’est pas uniquement un moyen promotionnel, elle constitue également de riches archives et documente cette crise : des artistes et professionnels du secteur culturel parlent de leur travail notamment. Le site du ministère de l’éducation canadien a mis en ligne un outil précieux à destination des parents qui font l’école à la maison : un lien vers la plateforme EducArt mise en place par le MBAM, une preuve que l’éducation se fait en osmose avec les musées. Si Inkyung Chang (Musée du fer) précise que le comportement des visiteurs avait changé, Nathalie Bondil ajoute que si les musées doivent s’adapter à de nouvelles mesures sanitaires, la qualité primera désormais sur la quantité. La modératrice Ekaterina Travkina laisse alors planer une question : Est-ce la fin des expositions blockbuster ?
Capture d’écran prise durant la conférence © EB
Le directeur général des musées au ministère italien du patrimoine culturel et du tourisme (MIBACT), Antonio Lampis croit fermement que c’est le temps des alliances. Ces dernières doivent se faire avec la télévision, avec de nouveaux systèmes de paiement (dont le paiement sans contact), des systèmes de contrôles d’entrée aux musées, théâtres, espaces d’écriture… pour créer de nouvelles histoires. Le musée doit être plus durable, être une sorte de Netflix dans lequel le visiteur pourrait voir et écouter une multitude de récits. En Italie, chaque université adopte un musée. Joan Roca intervient, inversement, les musées doivent adopter des universités aussi !
Les politiques de soutien au secteur muséal
Dans l’Union Européenne, la culture est une compétence locale et nationale, l’UE ne peut rien imposer mais elle peut aider. NEMO, le réseau européen des musées a entamé une enquête auprès de 600 musées dans 41 pays de l’UE. Maciej Hofman est directeur général pour l’éducation et la culture à la Commission Européenne, il fait un état des lieux de la situation actuelle. L’UE se veut plus flexible dans ses règles, elle va étirer les délais pour les appels d’offre et, les demandes de budget émises par les institutions vont être évaluées au plus vite afin qu’elles puissent préparer l’avenir au mieux. Actuellement, au sein de l’Union Européenne, les budgets pour une période de sept ans (2021-2027) sont évalués. Pour Hofman, il est important de s’assurer que le budget pour le secteur culturel sera conséquent, un « budget ambitieux » sera défendu. Aussi, il fait mention d’un outil important appelé « Mécanisme de garantie en faveur des secteurs de la culture et de la création », dans le cadre du programme « Europe créative ». 121 millions d’euros sont mobilisés pour la période 2014-2020. Cet instrument à destination des intermédiaires financiers (banques par exemple) propose des financements pour les initiatives des PME du secteur culturel et de la création. Les intermédiaires financiers peuvent choisir où va leur prêt, ils peuvent bénéficier de formations pour mieux comprendre ces secteurs (plus d’informations ici).
Hofman précise que les politiques de collaborations entre les états membres de l’UE et l’UE vont mettre l’accent sur des problématiques abordées au cours du webinaire : la culture et le bien-être, les nouvelles technologies pour les musées, connaître le public numérique, les moyens de lier culture et éducation, la condition des artistes ou encore la culture. Avec l’OCDE, l’UE souhaite maximiser l’impact culturel à l’échelle locale pour le développement.
D’intervenants en intervenants, je perçois la solidarité qui se crée entre les institutions culturelles, elles se rassurent et ensemble, dessinent le futur. Les acteurs culturels, soudés plus que jamais, sont prêts à coopérer pour concevoir des musées plus sociaux et ancrés dans leurs territoires. Avec ce webinaire, les professionnels du secteur muséal ont fait entendre leur voix auprès des organismes qui les soutiennent. Nathalie Bondil (MBAM) conclut la session en évoquant cette citation d’Ernesto Ottone R., assistant du directeur général de la culture à l’UNESCO : « Now, more than ever, people need culture […] Culture makes us resilient. It gives us hope. It reminds us that we are not alone. » Le 22 avril 2020, l’UNESCO fera une réunion en ligne avec les ministères de la culture du monde entier. Pour ce qui est de ce webinaire, il a été enregistré et sera accessible en ligne. D’autres séances ont lieu au mois d’avril 2020 et abordent le secteur culturel au-delà des musées.
Estelle Brousse
#futur
#crise
#coronavirus
Pour aller plus loin :
Guide de l’ICOM et de l’OCDE pour les gouvernements locaux, des communautés et des musées : https://icom.museum/fr/news/developpement-durable-licom-sassocie-a-locde-pour-elaborer-un-guide-a-lintention-des-gouvernements-locaux-des-communautes-et-des-musees/
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/202004/10/01-5268872-les-musees-du-monde-planifient-lapres-covid-19.php
Les intervenants :
- Ekaterina Travkina, coordinatrice – culture, industries créatives et développement local, OCDE
- Peter Keller, membre de l’ICOM
- Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Canada
- Inkyung Chang, directrice du Musée du fer, République de Corée
- Antonio Lampis, directeur général des musées, ministère italien du patrimoine culturel et du tourisme (MIBACT), Italie
- Maciej Hofman, directeur général pour l’éducation et la culture à la Commission Européenne
- Joan Roca, directeur du Musée d’histoire de Barcelone (MUHBA), Espagne
- John Davies, chercheur économique, économie créative et analyse des données, Nesta/PEC
- Mattia Agnetti, secrétaire exécutif, Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE), Italie
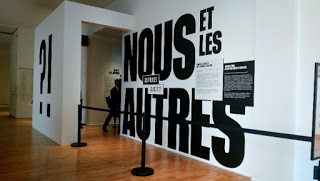
Liberté, Egalité, Préjugés
Lors de sa réouverture en octobre 2015, le Musée de l’Homme annonçait se positionner comme musée agora, le musée au cœur des débats de sociétés. Un an et demi plus tard, le 7 avril 2017, il ouvre sa première grande exposition, Nous et les autres, des préjugés au racisme. Nous sommes à la veille des élections présidentielles, et le musée du Trocadéro inaugure une exposition on ne peut plus ancrée dans l’actualité ! Pari osé ! Pari réussi ? Qu’en est-il ?
Entrée de l’exposition Nous et les Autres au Musée de l’Homme © Juliette Gouesnard
Vous avez-dit une exposition sur le racisme en 2017 ?
Ce n’est pas la première fois que le Musée de l’Homme traite ce sujet. Nous et les autres, est en quelque sorte la mise à jour de l’exposition Tous parents tous différents, qui ouvrait en 1992. A quoi sert une exposition sur le racisme en 2017 ?
Pour les scientifiques, du côté de la génétique, il n’y a plus rien à apprendre – les races humaines n’existent pas – d’un point de vue sociologique, il nous reste à comprendre d’où vient le racisme. C’est ce que ce propose de faire le Musée de l’Homme avec cette nouvelle exposition.
L’exposition propose donc une lecture sociologique du racisme tout en rappelant les données biologiques, génétiques et historiques qui participent à démontrer l’irrationalité des fondements du racisme. L’exposition décrypte ainsi les trois étapes menant au racisme : la catégorisation, l’essentialisation et la hiérarchisation. Une exposition de société, engagée, mais pas moralisatrice ; c’était tout de même le risque avec pareil sujet ! Le Musée de l’Homme ne se positionne pas en donneur de leçons, il propose une lecture strictement scientifique et factuelle. L’exposition est une démonstration toute en élégance, qui titillera les esprits.
Beaucoup d’idées, peu d’objets. Comment rendre attractif une exposition dossier ? Le défi n’était pas évident, mais il est relevé ici avec brio. L’expérience de visite par l’immersion, c’est le parti pris de l’exposition, grâce à une scénographie signée par l’atelier Confino. Des mises en scènes tantôt classiques mais souvent surprenantes favorisent l’aspect ludique, ce qui n’était pas gagné d’avance. La scénographie s’empare des lieux de la vie de tous les jours (la salle d’attente d’un aéroport, le salon d’un appartement, la terrasse d’un café, ou une rue…) et l’exposition s’amuse avec le visiteur en le confrontant à lui-même et aux autres.
L’expérience de visite, la carte gagnante !
Curieuse, je me suis prêtée au jeu, voici mon expérience de visite : L’exposition débute par une première partie, « Moi et les autres, de la catégorisation à l’essentialisation ». Une projection à 260° scanne des passants dans des scènes quotidiennes (aéroport, métro, terrasse de café, etc.), introduisant, l’air de rien, les espaces scénographiques à venir. Toutes les typologies de catégorisations y passent : femme/homme ; origine culturelle, nationalité, milieu social etc. Cet espace introductif me met d’entrée de jeu dans le sujet ! Nous sommes plusieurs dans l’espace, les gens se regardent, le malaise est un peu palpable tout de même ! Le sujet n’est vraiment pas facile !
Exposition Nous et les Autres – Salle introductive © Juliette Gouesnard
 Je poursuis ma visite et entre dans le premier espace immersif, une salle d’attente d’aéroport. Je m’interroge. Pourquoi un aéroport ? Je me revois, attendant mon vol, et pour patienter, observer les voyageurs et imaginer ce qu’est leur vie…tout ça dans ma tête bien sûr ! Mais, dans ces moments-là, sur quoi se fonde mon imagination, des préjugés peut-être ?
Je poursuis ma visite et entre dans le premier espace immersif, une salle d’attente d’aéroport. Je m’interroge. Pourquoi un aéroport ? Je me revois, attendant mon vol, et pour patienter, observer les voyageurs et imaginer ce qu’est leur vie…tout ça dans ma tête bien sûr ! Mais, dans ces moments-là, sur quoi se fonde mon imagination, des préjugés peut-être ?
Avant de m’installer sur un banc pour tester les bornes, je m’arme des définitions nécessaires pour appréhender la suite (Altérité, Assignation identitaire, Catégorisation, Discrimination, Essentialisation, Ethnocentrisme, Préjugé et Racisme). Une fois sur les bornes tactiles, je suis plus sceptique, je m’attends à des jeux, mais ce sont des tests où les réponses sont déjà orientées… je nevois pas forcément le sens de l’exercice, n’ayant pas la main sur les réponses, je reste un peu sur ma faim.
Je quitte l’espace en traversant les portiques d’aéroport, à mon passage, une voix me lâche un petit préjugé : « Tu ne sais pas danser c’est clair ! ».
Exposition Nous et les Autres – L’aéroport des préjugés ©Juliette Gouesnard
Amusée, néanmoins un peu vexée (ha ha), j’entre dans la seconde partie de l’exposition, « Race et histoire ». La scénographie est plus conventionnelle. Je me concentre sur les deux chronologies illustrées d’objets rappelant les grandes dates de l’histoire de l’esclavagisme à la racialisation, tout est plutôt clair. J’entame la suite du parcours, il s’agit de trois exemples de racisme institutionnalisé. La scénographie systématisée, sobre et épurée, voir même austère, m’invite presque au recueillement. La ségrégation aux Etats Unis, le nationalisme des nazis et le cas du génocide au Rwanda sont relatés avec beaucoup de sobriété et de simplicité. Un film très synthétique et très fort, un ou deux objets symboliques et une citation au mur, la juste mesure, point trop n’en faut, le contenu étant déjà très chargé émotionnellement.
Exposition Nous et les Autres – Races et Histoires © Juliette Gouesnard
Après ce rappel historique, l’exposition propose un « Etat des lieux » très complet d’aujourd’hui où toutes les questions sont permises :
« Si les races existent chez les chiens, pourquoi pas chez les humains ? Si les races n’existent pas, pourquoi les gens sont-ils de couleur différente ? Le racisme, c’est seulement contre les noirs et les arabes ? … »
Si ces questions nous paraissent choquantes, le Musée de l’Homme sans aucune crainte, les pose en grand et en gras ! Elles introduisent, semble-t-il, la dernière partie qui nous donnera sûrement des éléments de réponses. En continuant mon chemin, j’arrive devant un rideau de rubans d’ADN. Le ton est donné, les premiers éléments seront scientifiques, et c’est la génétique qui en répondra. Derrière le rideau coloré, je découvre un mur très graphique au vocabulaire des codes de la génétique. J’expérimente un petit jeu interactif très instructif « Ce que l’ADN dit de nous… ». Puis je m’installe devant les deux films d’animations très didactiques sur les données apportées par la génétique. J’y apprends par exemple, qu’entre tous les êtres humains, 99.9 % du génome est identique, ainsi les différences sont trop faibles pour parler de « races ».
Exposition Nous et les Autres – Mur de questions (gauche) et Génétique et populations humaine (droite) © JulietteGouesnard
Continuons la visite. J’entre dans la salle suivante, là encore le ton est donné dès le premier regard, me voilà arrivée dans une véritable DataBase ! Un mur jaune vif, rempli de données : des chiffres, des graphiques, des textes, des illustrations, des cartographies... Un peu rebutant au premier abord au vu de la densité d’informations ! Mais en prenant les choses une par une, on s’y retrouve. Ces données nous renseignent sur la situation en France : quelles formes de racisme ? Qu’en est-il de l’intégration ou du communautarisme et de la discrimination ? Malgré le nombre d’informations, certaines données retiennent mon attention comme ces chiffres plutôt encourageants : « 93 % des enfants d’immigrés se sentent français ».
Exposition Nous et les Autres – Etat des lieux en France © Juliette Gouesnard
C’est en cogitant sur toutes ces données que j’entre dans la pièce suivante, un salon d’appartement, télé allumée. Lascénographie est amusante, l’allusion est réussie ! Je m’installe sur les assises du salon et je comprends assez vite que l’exposition fait un arrêt sur images et décrypte les logiques médiatiques et politiques. L’ambiance dans l’espace est assez conviviale, on échange des sourires ou des regards atterrés avec d’autres visiteurs, quelques minutes de plus et on se serait mis à débattre !
Exposition Nous et les Autres – Décryptages © Juliette Gouesnard
Je sors du salon télé et voilà que je me retrouve à la terrasse d’un café ! L’illusion est parfaite ! Je m’installe à une table, j’ai presque l’impression qu’on va me servir un expresso ! Mais non… mon espoir retombe et mon attention se recentre sur la petite vidéo intégrée subtilement au décor. Elle présente des entretiens entre un journaliste et des scientifiques à une terrasse de café. Le son n’étant pas au top (mais excusé par les aléas du premier jour d’ouverture de l’exposition), je ne m’attarde pas.
Exposition Nous et les Autres – Controverses © Juliette Gouesnard
Je passe alors entre les lettres géantes lumineuses bleues, formant le mot EGALITE et je me crois dans la rue. Au mur, une œuvre urbaine de Patrick Pinon, issue de sa série Vivre Ensemble[1], et en face de moi, une projection de foules marchant à l’unisson pour la paix. Une jolie fin pour l’exposition, qui me laisse un sentiment d’espoir et de confiance en l’humanité !
Exposition Nous et les Autres – La ville-monde © Juliette Gouesnard
Conclusion de cette expérience de visite : je suis véritablement passée par toutes sortes de stades émotionnels ! D’abord la remise en question personnelle qui s’ensuit par l’émotion face aux témoignages de l’histoire, puis des interrogations des plus sensées aux plus idiotes, laissant place à des réponses plus terre à terre et scientifiques, puis je me suis interrogée sur notre société, je me suis laissée surprendre par des données dont je n’avais pas idée, et après avoir laissé mon esprit critique s’exprimer, c’est avec l’espoir et l’envie de combattre que je quitte cette exposition, l’envie d’y croire et d’en parler autour de moi et d’écrire cet article sur l’exposition pour L’Art de Muser !
Je tire mon chapeau au Musée del’Homme !
Si le Rapport de la Mission Musées du XXIème siècle[2] rendu en février 2017, était une charte, le Musée de l’Homme pourrait en être l’un des premiers signataires !
Rappelons le chapitre positionnant le musée du XXIe siècle comme un musée éthique et citoyen, et l’évocation d’un « Manifeste pour un musée humaniste » qui d’abord, « ouvrira largement l’univers des musées à la société contemporaine, en donnera les clés d’interprétations et permettra des ponts entre les cultures ».Puis, « formalisera que chacune des actions du musée, chacun des services s’inscrit dans un cadre plus vaste reposant sur des valeurs (liberté, tolérance, humanisme, ouverture au débat…) qui dépassent les critères strictement matériels et représentent les idéaux de la République et du vivre ensemble. » Avec Nous et les autres, le Musée de l’Homme signe une exposition citoyenne, « une exposition engagée, pas militante …des faits, rien d’autres. » [3]
Voilà un exemple d’exposition qui donne du sens aux musées ! Une exposition dossier, sur un sujet brûlant de société, qui soulève aussi des tas d’interrogations… Comment le public recevra cette exposition ? Quels publics viendront la visiter ? Le risque est que ne vienne qu’un public déjà acquis au sujet. Le défi n’est pas évident ! Il faut peut-être espérer que les institutions scolaires s’emparent de l’exposition pour sensibiliser les plus jeunes. Enfin, en pleine campagne présidentielle, quels risques pour l’exposition de devenir un outil politique ? Le Musée de l’Homme saura-t-il s’en prémunir ?
Juliette Gouesnard
#expositionengagée#expériencedevisite#Muséedel'Homme
Le site de l’exposition :
http://nousetlesautres.museedelhomme.fr/
L’expérience Chrome : https://www.youtube.com/watch?v=VjFfJGBZMV4
[1] http://www.festivaldupeu.org/all/artistesdupeu/pinon.html
[2] http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000177.pdf
[3] EvelyneHeyer, anthropologue au Musée de l’Homme et commissaire scientifique del’exposition.
Magnet Basel : exposer des dossiers d'archives, comment et pourquoi ?
Le thème universel de la migration appliqué au territoire des trois frontières.
En abordant les migrations, les musées s’approprient un thème très présent dans l’actualité. Ceux de Bâle et ses alentours (y compris transfrontaliers) ont fait le choix de montrer comment la thématique a été et est présente sur leur territoire grâce aux archives de la police bâloise des étrangers.
La série d’expositions Magnet Baseltraitait de la zone frontalière des trois pays (Suisse, Allemagne, France). Les différentes expositions ont pris place entre avril et octobre 2017 dans quatre lieux suisses et un allemand. Leur lien avec leurs territoires se retrouve dans leurs thèmes : celle sur les jeunes allemandes qui allaient être employées de maison à Bâle était au Musée des trois-frontière à Lörrach (Allemagne). Magnet Baselétait donc bien reliée à son territoire, ce qui permettait au public de se sentir plus concerné. Malheureusement elle ne pouvait être comprise que par des germanophones, écartant le public francophone de la zone, faute de traduction.
La carte surle site internet de Magnet Basel montre les lieuxd’expositions par des numéros et les histoires par des triangles noirs. (Source : http://www.magnetbasel.ch/)
L’élaboration des expositions
Le projet a été lancé par les archives du canton de Bâle-ville qui ont choisi des dossiers. La sélection s’est faite au sein du fonds de la police des étrangers de Bâle (1917-1970), sur des critères d’intérêt et de légalité, les expositions montrent la très grande diversité des trajectoires de vie de ce fonds. Légalement pour que les dossiers puissent être présentés toutes les personnes mentionnées doivent avoir donné leur accord ou être mortes depuis plus de 10 ans. Dans certains dossiers des zones ont été noircies puisqu’elles ne tombent dans aucunes des deux catégories suivantes. Des éléments plus actuels ne faisant pas partie du fonds d’archive ont également été incorporés dans certaines expositions.
À partir de cette volonté et de ces recherches l’exposition a été conçue entièrement en externe (muséographie, scénographie, graphisme) et en collaboration avec des illustrateurs.
Une source, plusieurs approches
Tout l’enjeu est d’exposer les dossiers choisis de manière compréhensible et cohérente. L’articulation des différents dossiers fait sens à deux niveaux, à l’intérieur de chaque exposition thématique, et les expositions ensemble.
Plusieurs procédés sont utilisés pour exposer les données, avec entrées et des degrés d’implications divers. Deux manières de faire se distinguent : rassembler pour proposer une vision globale, et explorer les différentes histoires de vie en voyant chaque dossier séparément.
Au Museum für Wohnkultur(Musée de l’habitat) dans l’exposition« Bewilligt. geduldet. Abgewiesen » (« Accordé. Toléré. Renvoyé »), une manière de faire correspond une salle. Cette exposition englobe toutes les thématiques de MagnetBasel et montre la très grande diversité des histoires présentes dans le fonds d’archive de la police des étrangers, en s’intéressant à comment et pourquoi les étrangers à Bâle ont pu rester ou au contraire du partir.
La première salle présente chaque dossier et son histoire individuellement. Celles-ci sont illustrées sur des panneaux, disposés tout autour de la salle, qui constituent le premier niveau d’entrée dans l’exposition. Ils accrochent l’œil du visiteur dès son entrée et l’entrainent dans l’histoire grâce à l’illustration. Pour inviter à s’approcher les panneaux commencent avec une accroche, telle que :
« Pourquoi la fuite à Bâle de l’apprenti boulanger Arnold Wochenmark et de Johanna Braunschweig, une domestique, malgré tous les soucis mène en 1945 à une fin heureuse »
La première salle © S.G.
On peut vraiment prendre plaisir à lire ces récits mis en lumière par le dessin. La diversité des illustrateurs enrichis beaucoup ce médium en proposant plusieurs visions et sensibilités artistiques. Les objets liés rendent palpables ces histoires, et on peut facilement imaginer qu’ils permettent au jeune public de s’intéresser à l’exposition. Les visiteurs sont libres d’approfondir, ou non, grâce à la reproduction des dossiers sur une table centrale, et à un rétroprojecteur en libre service pour projeter certains documents des dossiers.
La deuxième salle au contraire rassemble les informations des dossiers, présentées de manière graphique.
Un premier panneau avant d’entrer véritablement dans la salle, remet l’exposition dans ses contextes historiques, avec pour chaque type d’événement une couleur. Il met en regard les événements historiques, internationaux, nationaux, locaux et économiques ayanteu un impact sur les migrations entre 1900 et 1970. Pour l’année1968 par exemple sont marqués : en gris pour Bâle les premières femmes au parlement cantonal, et en rose pour l’international le Printemps de Prague.
Un procédé similaire sert à faire apparaître des typologies de documents ou mentions dans les dossiers, triées par organisme ayant fourni ledocument. Cela fait apparaître des îlots colorés sur les murs de la salle et éclaire sur le rôle de chaque acteur, tels que l’agence pour le travail, les employeurs, la sécurité sociale, les consulats, la police etc.
Au milieu se trouve une table avec des informations complémentaires et une machine à écrire évoquant les bureaux sur lesquels les dossiers ont été constitués.
La deuxième salle © S.G.
Exposer les archives
L’exposition porte sur l’histoire et les histoires de migrations dans la région, mais à travers ce thème c’est aussi l’institution et le fonctionnement des archives qui sont montrées aux publics.
La scénographie évoque les archives dans l’exposition par le mobilier en en reprenant les codes pour la grande table de consultation de la première salle notamment. Leur matérialité est au centre de l’exposition grâce à la vitrine remplie de cartons d’archives qui sert de cloison entre les deux salles d’exposition.
Plus que de simplement voir le visiteur peut expérimenter les archives, les dossiers reproduits sur la grande table de consultation l’invitentà les consulter et à devenir « chercheur ». Cette pratique lui permet de se familiariser avec l’institution, et en tant que citoyen d’en comprendre mieux l’utilité.
Pour les germanophones qui souhaiteraient creuser le sujet, le blog des archives de la ville de Bâle a publié une série d’articles su rles recherches autour de l’exposition. http://blog.staatsarchiv-bs.ch/forscherinseln-magnet-basel/
Bethsabée Goudal

#Archives
#Migrations
#3frontières

Manger au muser
La plupart du temps lorsqu’on mange au musée c’est à l’extérieur des expositions, dans des espaces spécifiques. De très nombreux musées disposent d’un restaurant ou d’une cafétéria dont les produits sont la plupart du temps sans rapport avec les expositions. En revanche certains musées essayent de lier les deux, le repas devenant une prolongation de la visite. C’est le cas du musée de la Piscine à Roubaix ou du LAM à Villeneuve d’Ascq: le musée et l’exploitant du restaurant se sont mis d’accord pour accorder la carte aux expositions temporaires, ou du moins à baptiser les plats en accord avec le propos. Le menu proposé à l’occasion de l’exposition sur Chagall en 2015-2016 à La Piscine est un bon exemple : plusieurs plats d’origine russes étaient proposés et d’autres nommés d’après des œuvres de l’artiste, telle que la salade caesar rebaptisée La fiancée au visage bleu.
Le Préhistomuseum près de Liège (Belgique) va encore plus loin, puisqu’il applique le principe de ses expositions à son restaurant. Tout comme dans les expositions où le visiteur est amené à comprendre la préhistoire et l’archéologie par les expérimentations, à “l’archéorestaurant” le visiteur est invité à remonter le temps en goûtant des plats de différentes époques (de l’antiquité à l’époque moderne). Les recettes ont fait l’objet d’une recherche scientifique de la part d’un spécialiste, l’historien cuisinier Pierre Leclercq.

Photographie issue de l’affiche de l’archéorestaurant © Préhistomuséum
L’Alimentarium de Vevey (Suisse) est confronté à une problématique encore différente, puisqu’il a pour thème l’alimentation. Le restaurant du musée a donc une place particulièrement importante puisqu’il permet d’associer expérience muséale et pratique culinaire. Avant la rénovation de 2016, un lien fort existait entre les deux puisque les visiteurs devaient aller chercher leur repas à la cuisine qui se situait dans l’exposition. Cette cuisine était une sorte de grande vitrine vivante, où les visiteurs pouvaient observer la préparation de repas qu’ils pouvaient ensuite manger s’ils le souhaitaient. Muséographie de l’alimentation et repas forment ainsi un tout et les messages sont transmis sur différents modes. Le musée a été totalement réorganisé depuis, mais les visiteurs peuvent toujours voir la préparation de leurs repas, au moment de choisir leurs plats.
Cuisiner, une action culturelle
L’Alimentarium souhaite que les expositions, démonstrations, repas et activités participent d’une même expérience globale. En effet des activités sont également proposées, principalement des ateliers culinaires et des visites guidées du musée et du jardin. La majorité de ses offres s’adressent aux enfants, le public de l’Alimentarium étant très familial. Au-delà de simple cours de cuisine, il s’agit aussi d’explorer l’alimentation par les cinq sens et de développer leurs capacités gustatives.
C’est aussi ce que souhaite développer Cap Science à Bordeaux avec son “Labo Miam”, un atelier où les enfants sont amenés à découvrir les principes scientifiques qui sous-tendent la cuisine. La préparation des aliments devient une véritable expérience scientifique. En avril et mai 2018 le thème est celui du changement de couleur à la cuisson : des cookies bicolores et du caramel sont réalisés.

Une des expériences proposées par le “Labo Miam” de Cap Sciences © Cap Sciences/ANAKA
Déguster
Une autre forme de mise en pratique, plus classique est la dégustation en fin d’exposition, pour des raisons pratiques. Dans les établissements accueillant du public les réglementations sont très strictes en ce qui concerne l’alimentation ce qui peut freiner la proposition d’une consommation sur place.
C’est d’autant plus complexe pour certains types d’aliments porteurs de problématiques spécifiques tel que l’alcool, or il existe de très nombreux musées dédiés aux boissons en France. Pour les musées de France particulièrement mettre en place une dégustation d’alcool est compliqué, une des solutions peut être la délégation à un service privé mais cela ne règle pas les questions d’ordre social et éthique. Le Musée du vin de Beaune a donc fait le choix de ne pas en proposer sauf occasions exceptionnelles (Journées du Patrimoine, Nuit des Musées…) conscient que si les visiteurs souhaitent goûter les vins, ils trouveront sans problème d’autres occasions en ville.
A contrario la Cité du Vin de Bordeaux même si elle sépare clairement les espaces d’expositions et de dégustations mise beaucoup sur ces dernières. N’étant pas un musée de France et dépendant d’une fondation, elle est de fait libérée de nombreuses contraintes.
Bethsabée Goudal
#Alimentation
#Ateliersculinaires
Dégustations
Déguster
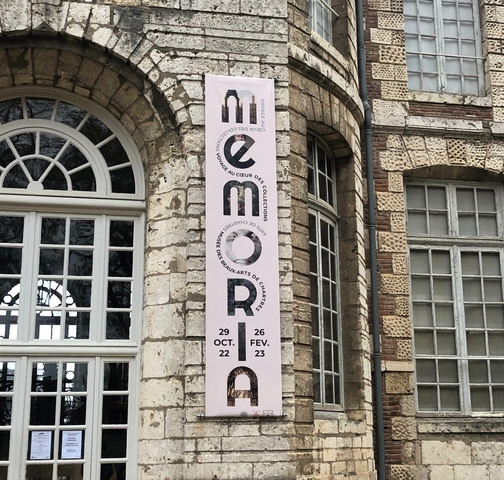
Memoria : le musée de A à Z
Le musée des beaux-arts de Chartres accueille jusqu’en février l’exposition « Memoria. Voyage au cœur des collections ». Cette « exposition-école », réalisée par des étudiant.es en master 2 de l’Ecole du Louvre, décortique les liens entre musées, objets et patrimoines.
image d'introduction : Entrée de l’exposition © M.B
A… un Abécédaire pour (re)découvrir le rôle des musées
Memoria. Voyage au cœur des collections est une invitation à réfléchir sur le rôle d’institutions bien implantées dans le paysage culturel depuis le 19e siècle : les musées. A la croisée de questionnements sur le patrimoine, la mémoire, la transmission, l’héritage mais aussi l’éducation et le loisir, les musées ont de multiples missions, qu’il est difficile parfois de définir. En témoigne les années de discussion de l’ICOM pour arriver à une définition satisfaisante.
L’exposition a été conçue comme un abécédaire, où chaque lettre permet d’évoquer une notion. Un choix qui présente plusieurs avantages : aborder beaucoup de thématiques sans se contraindre à un discours continu et donner une conscience au visiteur de où il est dans l’exposition, qu’il sait finir à Z. Mais surtout, chaque lettre et notion est accompagnée d’œuvres ou d’objets. Ils ne sont pas là pour simplement illustrer le propos. Bien au contraire, ces objets sont la base de la réflexion. Le propos part du cas précis de l’objet pour l’élargir aux questions de patrimoine, mémoire ou musée déjà évoquées. Toutes les œuvres exposées ont été sorties des réserves pour l’occasion, un bon moyen pour le musée de montrer de nouvelles pièces de ses collections.

Vues de l’exposition © M.B
I… une Introduction à la muséologie
Memoria offre un large panorama de thématiques pour découvrir la muséologie au sens large. Les sujets très concrets comme l’inventaire ou l’encadrement des œuvres présentent les missions de conservation, documentation et présentation : les tâches quotidiennes de la vie du musée, en somme.

La lettre E : Encadrement © M.B
A une échelle plus large, des sujets plus généraux questionnent l’essence même des musées. Les cartels sur les chef d’œuvre et l’histoire du goût interrogent sur la neutralité des musées et leur responsabilité dans la construction d’histoire(s) de l’art. En présentant des objets du quotidien, l’exposition interroge également la muséalisation des objets de demain.

La lettre J : Jalon, sur l’évolution du goût et l’œuvre Tuerie de Auguste Préault © M.B
Nous pouvons cependant déplorer que la question des restitutions ne soit pas creusée. Des œuvres kanak (Nouvelle-Calédonie) sont exposées et le cartel Tabou pose clairement la question du regard occidental posé sur ces œuvres déracinées de leur contexte originel. La question, pourtant cruciale, des restitutions et du statut des œuvres extra-européennes dans les collections françaises n’y est pas discutée.
P… vous reprendrez bien un autre Parcours ?
La forme de l’abécédaire invite à un parcours linéaire, dans l’ordre alphabétique. Chaque lettre, de A à X, est associée à une ou plusieurs œuvres et à un cartel qui fait découvrir aux visiteurs une notion issue de la muséologie. Tous les cartels sont conçus de façon identique : une (ou plusieurs) définitions très concrètes du mot concerné, suivies d’un court texte sur la notion en question.
Exemple de cartel : Spoliation © M.B
Si le parcours alphabétique en visite libre se suffit à lui-même, un livret de visite propose 4 mini-parcours supplémentaires, présentés comme des prolongements de l'exposition. Ils ne concernent que quelques lettres du parcours et approfondissent 4 angles plus spécifiques. Le parcours 1 « histoire locale » met en valeur des œuvres liées à l’histoire de la ville de Chartres. La diversité de nature des œuvres exposées permet de proposer un 2ème parcours intitulé « ethnologie ». Le parcours 3 « rôle et fonctionnement du musée » rappelle quelques missions principales des musées, tandis que le parcours 4 « goûts et curiosités » soulève la question de la responsabilité des musées dans la formation du goût.
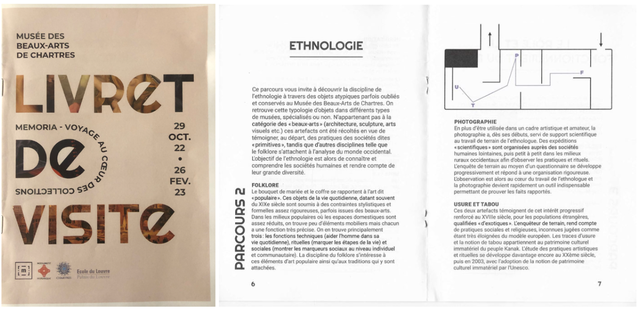
Le livret de visite et le parcours « ethnologie » © M.B
Les 4 parcours ciblés étoffent le propos mais demandent une petite gymnastique du cerveau pendant la visite. Il faut jongler entre les lettres dans la scénographie et son livret de visite pour s’assurer de ne pas rater une étape du parcours tout en ne se perdant pas entre les 4 thèmes. Le plus simple et le plus clair est sans doute de revenir sur les parcours après avoir fait l’intégralité de la visite.
P… un coup d’œil sur la Programmation ?
Pour accompagner l’exposition, les étudiant.es - commissaires ont mis en place une programmation de plusieurs événements, réalisés avec des partenaires locaux. Des visites guidées seront assurées par des lycéen.nes et des podcasts enregistrés avec des collégien.nes sont à écouter dans l’exposition (via un QR code sur les cartels). En février, un spectacle de danse est à découvrir. Enfin, pour les professionnel.les, deux journées d’étude sont organisées. La première sur la mémoire a eu lieu en décembre, la deuxième se tiendra le 21 janvier et abordera le rôle du musée.
E… et le public Enfant ?
Les enfants ne sont pas oubliés, grâce à un petit livret-jeux disponible à l’entrée. Il s’adresse au 7-12 ans. Les notions évoquées dans l’exposition y sont reprises, de façon courte et simplifiée. Des jeux (rébus, points à relier, labyrinthe) basés sur les œuvres de l’exposition accompagnent chaque texte. Ces jeux complètent simplement le texte, ce n’est pas par le jeu que les enfants en apprennent plus sur le musée et ses collections.
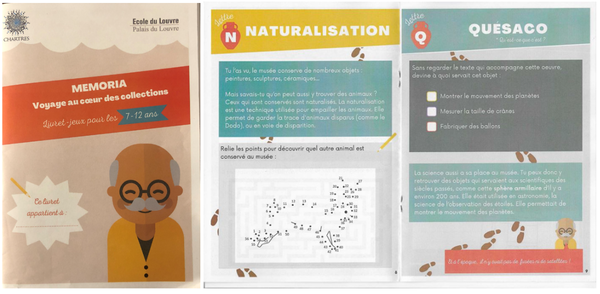
Le livret de visite enfant © M.B
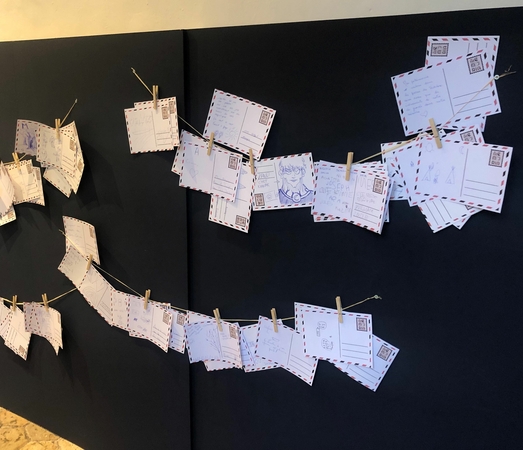
La dernière partie de l’exposition : Allez-y ! © M.B
Myrrha Bouly
Pour aller plus loin
Memoria. Voyage au cœur des collections est accueillie du 29 octobre 2022 au 26 février 2023 au musée des Beaux-Arts de Chartres.
La présentation de l’exposition :
-
https://www.chartres.fr/musee-beaux-arts/expositions-temporaires/memoria
- https://www.ecoledulouvre.fr/es/node/1105
Les coulisses et la programmation culturelle sont à retrouver sur Instagram :
#exposition #muséologie #projetétudiant

Musées d'Art ou Musées-PIB ? À qui s'adresse la relance économique du gouvernement ?
À qui s’adresse la relance économique du gouvernement ?
Dans ses Lettres à Miranda, Quatremère de Quincy écrivait en 1796 que le patrimoine artistique et historique tient à « cette vertu instructive que les étudiants reçoivent, sans s’en apercevoir, de tous les objets qui les entourent » et à « cette force d’habitude qui, comme l’air environnant, vous pénètre de toute part ».
La formule de « force d’habitude » est parlante, tant elle témoigne tout à la fois d’une proximité de l’art que d’une conscience mise en veille. Deux siècles plus tard, c’est le même souffle d’habitude qui teinte la vie des musées. Cette « habitude », c’est celle du Parisien qui ne s’étonne plus des files d’attente, de la prolifération du public et de son entassement sur la place du Louvre, c’est celle de la culture du chef-d’œuvre, qui nous fait penser aux maîtres d’art dans les grandes agglomérations françaises, c’est celle, aussi, d’un tropisme parisien artistique qui continue d’alimenter les décisions publiques.
Relancer la culture : le culte des chefs-d’œuvre parisiens
En proie à la crise actuelle des musées, qu’il ne convient pas ici de répéter et de résumer tant nous l’avons écoutée, l’Etat présentait en septembre 2020 un plan de relance inédit, pourvoyant le patrimoine et les musées d’une aide de 614 millions d’euros. La somme était pharaonique, pour un secteur jugé « non essentiel » lors du confinement. Loin des gros titres, et en se penchant sur la question, on retrouve en quelques clics la logique de cette politique de relance : « 614 millions d’euros » soit « 334 millions pour les grands établissements patrimoniaux soutenant l’attractivité et le rayonnement international de la France », voilà ce que l’Elysée avait jugé comme modèle le plus juste pour redonner à la culture des airs de sûreté. Ces grands établissements patrimoniaux, ce sont, appelle-t-on, des « grands opérateurs nationaux » ou des « opérateurs publics de création ». Autrement dit, et pour l’énoncer de manière simple, on présentait une réforme qui tournait la moitié de sa politique de relance vers « les lieux culturels à forte influence », vers ces hauts-lieux parisiens capables de donner au rayonnement français la force d’en dépasser ses frontières : le Musée du Louvre, le château de Versailles, le musée d’Orsay et de l’Orangerie, le Centre Pompidou ou encore la Réunion des musées nationaux-Grand Palais. Les musées d’art étaient ainsi les favoris.
En somme, l’explication donnée, rationnelle et logique, est de combler les plus grandes pertes et de compenser ces géants muséaux, qui avaient souffert de l’absence de touristes internationaux. Les chiffres-bilan du confinement tombaient : « une chute de 40 à 80% » pour les musées de la capitale. L’équilibre était restauré, puisque les musées régionaux, quant à eux, s’en sortaient bien : une baisse « modérée » de 15% pour le Mucem de Marseille, des sites archéologiques en plein air sauvés par des sorties familiales dominicales ou un musée du Louvre de Lens qui affichait un « été correct ». La crise sanitaire a donc marqué l’écart du paysage muséal. Les institutions parisiennes ont subi la réduction massive du nombre de touristes sur le territoire. L’été 2020 constatait déjà une baisse de fréquentation de plus de 70%. Les musées régionaux ont bénéficié, quant à eux, d’un fort ancrage culturel : le musée demeurait un lieu familier dans le quotidien du public de proximité.
Pourtant, les politiques actuelles refusent de repenser ce modèle. Elles écartent l’idée d’un plan de relance qui valoriserait une transmission culturelle à l’échelle nationale et qui s’appuierait tout à la fois sur un ancrage local et un renouvellement du public français. C’est donc bien toujours le culte du chef-d’œuvre que nous continuons à défendre, puisqu’il est onéreux et exploitable économiquement. Cependant, ce même culte ne faisait plus aucun bruit dans le silence de Paris mis en quarantaine et délaissé par le visiteur étranger. Alors je me demande, à qui sert-il réellement ? D’où vient cette politique muséale obsédée par les créations des prodiges ? Qu’est-elle devenue aujourd’hui ? Et surtout, qu’implique la sur-protection de ces musées nationaux lorsque les frontières fermées qui scellent le déficit des caisses mettent en lumière la primauté de leur rentabilité ?
La genèse du culte : au-delà du Louvre, la « pullulation d’œuvres d’art en régions » (Gazette des Beaux-Arts, 1865)
En 1792, Jean-Marie Rolland, alors ministre de l’intérieur, avait pensé un Muséum français, organique et pédagogique. « Parvenir, autant qu’il sera possible, à une répartition égale des collections » était le projet de départ. En 1801, un décret Chaptal en renforçait le trait. On pensait alors le développement des musées de provinces, alimentés par l’envoi d’œuvres et appuyé sous le concept de Nation. Ce sont plus de 600 musées qui voient le jour à la fin du XIXe siècle. Les motivations sont diverses : apaiser les tensions politiques issues de la Révolution des provinces, égaliser et démocratiser les vertus pédagogiques et citoyenne du musée français ainsi que considérer ses apports commerciaux et touristiques, en ayant déjà en tête l’inéluctable bénéfice d’un rayonnement national. Lyon, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Marseille, Rouen, Nantes, Dijon, Caen, Lille, Mayence, Rennes et Nancy sont les villes choisies. Elles ont en commun d’être dotées d’un noyau de collections publiques, d’un noyau des Beaux-Arts et d’un espace pouvant recevoir des œuvres. C’était, en somme, la première fois qu’une répartition artistique rentrait dans un projet national, pouvant illuminer la capitale et éclairer les « provinces ». Et les chefs-d’œuvre, quant à eux, devaient sans équivoque rester à Paris, capitale culturelle, pris entre le Louvre et Versailles.
A qui servent aujourd’hui les chefs d’œuvres ?
Revenir sur cette genèse permet d’interroger la place que nous accordons aujourd’hui aux trésors des Beaux-Arts. Le projet pédagogique de la fin du XVIIIe siècle était presque organique. Il étendait sur le territoire les modèles artistiques tout en gardant Paris comme noyau dur de l’influence. Aujourd’hui, la richesse esthétique est devenue objet touristique. Mais c’est peut être bien pendant la crise actuelle que les musées devraient, comme l’a souligné l’historien Jean-Michel Tobelem, « réfléchir à leur mission fondamentale qui n’est pas de continuer dans un système productiviste, et augmenter chaque année le nombre de visiteurs car cela rapporte plus d’argent : leur mission est de servir nos concitoyens »1.
En outre, on applaudit l’ancrage local des musées en région qui explique leur endurance face à la crise. Tout est dit, comme si les habitudes d’un public régional étaient garantes du salut des institutions. Mais on ne s’interroge pas sur cette résistance et sur ce qu’elle dévoile sur le rôle et la force d’un musée. On parle de « tropisme », comme si l’histoire de l’art avait mécaniquement poussé les grandes villes touristiques à devenir les lieux communs des chefs-d’œuvre. Et s’ils doivent l’être, ces institutions devraient également interroger les habitudes des Franciliens qui délaissent ces hauts-lieux. Derrière leur histoire et leur sacralisation, on se demande pourquoi ces musées si riches n’ont plus l’ambition d’attirer les Franciliens. Peut être parce que l’ambition du bénéfice, l’obsession de la production ont fait des chefs-d’œuvre le point d’une politique économique amorcée au début du siècle plus que celui d’un plan culturel. A quoi bon redonner envie à certains publics franciliens d’avoir le courage de passer la porte du Louvre si 80% des visiteurs est naturellement livré par le tourisme annuel ? Pourtant, la situation sanitaire nous incite à penser tout autrement.
Le musée-souvenir ou musée-PIB est essentiel, puisque nous avons indéniablement accepté de mettre la culture au service de l’économie. Il devient un problème lorsque sa mission, son devenir et sa place dans la vie publique n’obéissent qu’aux lois des bénéfices et des pertes. Il faudrait s’interroger sur cette protection politique du « tropisme » parisien, et non pas penser qu’elle obéit à des lois physiques ou naturelles qui nous échappent. Ce qui se joue dans la protection de ce musée-PIB est la propre démocratisation des chefs-d’œuvre, comme lieu de savoir et de bien commun. Dès lors que le bruit des pièces et des boutiques souvenirs annihile les échos des œuvres, alors c’est la propre genèse démocratique du musée que l’on délaisse. Et si cette obsession pour le rentable déclinait un jour vers la fin des dimanches gratuits ou celle des tarifs réduits ? Et si l’argent rapporté par les chefs-d’œuvre légitimait un jour la direction totale de ces « grands opérateurs nationaux » ?
Alors ce serait cette même « force d’habitude » - prônée par de Quincy - qui pousserait, par servitude volontaire ou par somnolence, les chefs d’œuvres à mourir lentement. Un plan de relance culturelle dicté par la perte d’un public que l’on ne s’étonne pas d’avoir délaissé est paradoxal. Sans doute parce qu’on ne se demande plus qui il convient d’accueillir dans les maisons des chefs-d’œuvre. Encore est-il que la part de responsabilité entre les musées et le public est incomparable, à l’image de Gustave Geffroy qui pardonnait son absence à une foule envieuse d’accéder aux chefs d’œuvres : « Il ne faut donc pas lui demander de venir, il faut aller la trouver ».
Lien vers la relance du gouvernement
AG
#covid
#Musée d’Art
#chefs d’œuvres
1 Echange avec Jean-Michel Tobelem, professeur à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne : https://www.franceculture.fr/societe/covid-19-comment-vont-les-musees

Musées et communautés autochtones, vers un partage des pouvoirs au musée ?
« Les musées sont des lieux de lutte pour les autochtones. » - Gerald McMaster[1]
Rongomaraeroa, 2019 © Jack Fisher. Te Papa
Dans une ère de réévaluation de l'histoire à travers les études postcoloniales, la prétendue neutralité scientifique des musées se révèle être ancrée dans un modèle occidental dominant. Les objets exposés au sein des musées d’ethnographie, souvent issus de minorités exclues du discours dominant, soulèvent la nécessité d'impliquer les communautés d'origine dans la construction du récit muséal. La notion de partage des pouvoirs au musée se lie fréquemment à la participation communautaire dans la conception des expositions. Cependant, malgré les efforts déployés pour instaurer un dialogue, il n’en reste pas moins que cela reste le musée qui détient le pouvoir de partager ses propres pouvoirs : comment ce partage se matérialise-t-il réellement et dans quelle mesure le partage des pouvoirs au musée est-il envisageable ?
Une co-construction du discours : la voix des communautés dans le propos muséal
À l'heure où le discours muséal revêt autant d'importance que les objets exposés, une approche pluridisciplinaire et une participation communautaire sont devenues cruciales. La co-construction du discours émerge comme un moyen de rééquilibrer le partage de la parole au musée. Cela se concrétise notamment en Amérique du Nord, où des musées communautaires tels que l'Anacostia Community Museum à Washington adoptent ce nouveau paradigme, suivi par les musées autochtones à l’aube des années 1990. Cependant, la question persiste : qui détient réellement la parole au sein d'une communauté et comment cette voix peut-elle être intégrée au discours muséal ?
Le partage du pouvoir discursif et la co-construction du discours s’effectuent selon divers procédés et à différentes échelles. Si l’on prend l’exemple des musées autochtones, depuis les années 1970, les musées privilégient le témoignage. Bien que les témoignages permettent aux communautés de s’exprimer, il n’en reste pas moins qu’ils sont intégrés au récit et à la vision que porte le musée sur le sujet, et ne reflètent pas une véritable approche autochtone. Même si le nombre de participants aux ateliers est élevé, comme il l’a été en 2013 pour l’exposition C’est notre histoire au Musée de la Civilisation du Québec (https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1308-cest-notre-histoire), on peut s’interroger sur l’utilisation de cette voix. Est-elle en réalité mise au profit d’un nouveau discours alternatif ? Le partage du pouvoir discursif semble s’opérer dans un certain cadre contrôlé par le musée. Par conséquent, l’ampleur et la violence des massacres subis par les autochtones, notamment dans des pensionnats[2] jusqu’à la fin des années 1990, ne sont toujours pas mentionnées dans ce nouveau parcours. Cet exemple nous montre un déséquilibre : cette parole est utilisée comme si les communautés faisaient l’objet d’une consultation et non d’une réelle participation à toutes étapes avec le musée.
Légitimité de la transmission culturelle
La légitimité du musée à parler de sujets autochtones est mise en question. Qui mieux que les personnes concernées peut prétendre à la transmission de leur propre culture ? Les partenariats entre musées et communautés reconnaissent cette légitimité, mais naviguent entre le besoin des communautés de s'exprimer et les attentes d'un public occidental habitué au partage global de savoirs. En réalité, trop partager au public reviendrait à désacraliser sa propre culture et la transmettre au risque d’une instrumentalisation faite par le musée. Cette tension se manifeste dans des exemples comme celui du musée Te Papa Tongarewa en Nouvelle-Zélande lorsque l’espace sacré maori Rongomaraeroa (il s’agit d’un marae[3] en maori de Nouvelle-Zélande) ouvre en 2014. Cet espace annexe du musée construit sur la base d’un véritable marae(maison d’accueil sacré), offre aux visiteurs une expérience immersive dans la culture maorie qui permet de mieux comprendre les coutumes en assistant à des rituels. Mais la culture maorie finit par ne plus leur appartenir dès lors que l’espace est mobilisé par des non maoris. De plus, la langue parlée dans un marae traditionnel est le maori. Or, au sein du Te Marae, c’est l’anglais qui prime. Finalement, on pourrait se demander si les communautés ont toujours un pouvoir sur leur propre culture au musée, puisque celui-ci dénature leurs traditions même lorsqu’un partage de la parole est instauré dans le discours. Les maoris ont une approche muséale qui diffère de celle que l’on connaît en occident. Ils estiment que partager au grand public des rituels et des savoirs ancestraux, c’est retirer l’aspect sacré des traditions que les communautés tentent de perpétuer. Raison pour laquelle ce marae subit de nombreux boycotts de la part des communautés autochtones. Cet exemple souligne bien le défi de concilier la reconnaissance et le partage de son histoire autochtone au besoin de préserver ses savoirs dans un cadre communautaire privé.

Visiteurs dans le Rongomaraeroa, 2019 © Johnny Hendrikus. Te Papa
Le pouvoir d’agir sur les collections
Si le partage de la parole et la co-construction du discours est possible au musée, l’est-il aussi avec les objets ? La manière dont les objets sont valorisés dans le parcours muséal varie considérablement. Deux extrêmes se distinguent : l’une esthétisante, comme au Musée du Quai Branly, qui ne résulte pas de collaboration avec les communautés. Et l’autre entièrement autochtone, comme en témoigne la Maison de la culture innue à Longue-Pointe-de-Mingan (Québec) ouverte en 2015 ou celle du Musée Shaputuan ouvert en 1998. Ces deux musées communautaires proposent une pédagogie par des dioramas. Les espaces d’expositions présentent non pas des objets sacrés, mais plutôt le mode de vie nomade des Inuits et les traditions relatives au territoire dans lequel sont installés les deux musées. Ils tiennent véritablement à ce que l’approche muséale soit 100% autochtone, et ce, jusque dans la langue des textes d’expositions et le choix des scénographes et designers. La co-création avec les communautés permet en théorie aux autochtones de décider quels objets mettre en valeur, mais des désaccords subsistent quant à la sélection d’objets esthétiques plutôt que significatifs pour les communautés.

© 2023 Maison de la culture Innue
Le partage des pouvoirs s'étend à la conservation des objets exposés et des réserves. Le musée Te Papa Tongarewa est un des musées respectant au mieux ce partage des pouvoirs sur les objets en conférant aux autochtones une grande capacité d’action sur les collections et leur conservation. En acceptant le cadre conceptuel maori mana taonga, le musée reconnaît la valeur vivante et spirituelle des objets, ce qui vient bouleverser les pratiques de conservation préventive traditionnelles. Ainsi, ce sont les chants et les rituels pratiqués par des maoris qui permettent la conservation des objets. Le musée n’est en réalité que le gardien des collections. Ici, le pouvoir sur la préservation matérielle des objets est entièrement accordé aux communautés.
Autorité et défi d’une redistribution des pouvoirs au sein du musée
Depuis les années 1970, une volonté de renouveler le personnel muséal émerge, notamment dans les musées communautaires et autochtones. Des frictions persistent, mais des exemples tels que le National Museum of American Indian montrent une inversion partielle des rôles au sein du musée. La direction ainsi que les architectes sont issus de communautés autochtones. Le pouvoir hégémonique du musée ayant toujours été détenu par des personnes issues du groupe dominant, un renversement des rôles et de l’autorité s’opère ici. Et il se poursuit dans le champ des expositions temporaires lorsque Richard West, directeur du musée, affirme qu’un représentant des communautés sera nommé dans chaque commissariat.
Malgré les progrès, l'autorité hégémonique du musée demeure. La muséologie participative et la nouvelle muséologie ont ouvert la voie à une participation accrue des minorités, mais une véritable redistribution des pouvoirs reste difficile. Les musées communautaires émergent comme une alternative, offrant une autonomie totale aux communautés, bien que cela soulève des questions sur la portée de la diffusion culturelle puisque le musée conserve une autorité perçue comme scientifique.
L’institution muséale possède encore aujourd’hui le pouvoir de visibiliser une cause. Même si les minorités participent à l’élaboration des expositions ou occupent des postes au musée, une hiérarchie des savoirs entre l’institution et les communautés persiste. La presse et l’opinion publique voient le musée comme un lieu détenant le savoir scientifique. Cela se manifeste particulièrement dans la réception des expositions autochtones au Musée de la civilisation du Québec. L’approche autochtone est critiquée par les journalistes et les spécialistes en musée pour son manque de rigueur scientifique. Relents racistes envers les autochtones ? La presse estime que les communautés investissent trop le champ muséal au point d’occulter la parole des conservateurs d'ordinaire considérée comme scientifique.
La parole d’un musée a encore à ce jour plus de valeur qu’une revendication communautaire aux yeux du grand public. Les pouvoirs au musée se sont partagés. Néanmoins, l’institution muséale continue de faire autorité puisqu’elle donne l’opportunité aux communautés de s’exprimer. Le musée comme institution dispose toujours de son pouvoir de transmission ainsi que du pouvoir décisionnel final.
Vers de nouveaux modèles muséaux
Les défis persistent en raison de la nature hégémonique du modèle muséal occidental. Ce modèle laisse peu de place aux minorités, à leurs langues et à leur culture. Il est vrai que la balance est difficile à trouver lorsqu’un musée souhaite produire pour le grand public tout en se plaçant dans les nouvelles tendances de la muséologie plus exigeante en matière d’inclusion. Mais, si inclure des sujets qui, de fait, ne pourront jamais se plier entièrement au modèle muséal traditionnel n’est pas possible, la solution serait peut-être d’investir un autre type muséal que le modèle dominant, plus adapté à certains sujets. Une alternative émerge avec les musées communautaires, tels que la Maison de la culture innue. Les communautés ne sont plus tenues sous l’autorité d’une institution muséale. Elles exposent ce qu’elles souhaitent et comment elles le souhaitent. En revanche, le public visé n’est pas le grand public, ce qui remet en question la diffusion de la culture à tous. Toute personne non autochtone n’est qu’un invité et n’aura probablement pas accès à toutes les cérémonies et rituels que proposent le centre.
En somme, le partage des pouvoirs au musée, bien que possible dans la forme, demeure complexe dans la pratique. Malgré les avancées vers une participation communautaire qui évolue positivement, le musée conserve l'autorité institutionnelle, des pouvoirs importants sur le discours et les objets. Trouver un équilibre parfait reste un défi, mais les musées communautaires offrent une voie prometteuse pour rééquilibrer le dialogue entre institutions et communautés.
Camille PARIS
Pour approfondir la question des violences vécues dans les pensionnats au Canada :
#muséeautochtone #coconstruction #transmissionculturelle #muséecommunautaire #paratgedespouvoirs
[1] Conservateur, artiste et auteur autochtone originaire de la Siksika Nation dans la province canadienne de Saskatchewan. Il a joué un rôle important dans le domaine des arts autochtones, notamment en tant que conservateur en chef au Musée canadien de l'histoire, ainsi qu’au Musée des beaux-arts de l'Ontario. ↩
[2] Entre 1830 et la fin des années 1990, des pensionnats autochtones financés par le gouvernement canadien ont été créés dans le cadre de politiques assimilationnistes. Les violences infligées aux enfants autochtones étaient systématiques : abus physiques, sexuels et culturels. Ces traumatismes ont laissé des séquelles profondes au sein des communautés autochtones, suscitant des appels à la vérité, à la réconciliation et à la justice. ↩
[3] Un marae représente un espace dégagé considéré comme sacré, utilisé dans les cultures polynésiennes pour des activités sociales, des cérémonies religieuses et politiques, telles que l'intronisation des chefs, les repas cérémoniels, les rituels religieux, etc. Chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, le terme marae fait référence à un espace qui fait face au wharenui, également appelé la "maison d'accueil". ↩
Museu Nacional Vive
Le musée est mort, vive le musée.
Alors qu’il fête ses 200 ans d’existence, le Musée National de Rio de Janeiro s’embrase soudainement. Tandis que les nuages de fumée s’élèvent vers le ciel, les collections s’éteignent peu à peu sur le bûcher de la négligence. Nombreux sont les articles qui décrivent toute l’horreur de la catastrophe qui a frappé le Brésil la nuit du 2 au 3 septembre 2018. Il ne s’agit donc pas ici de faire une énième énumération des pertes aussi colossales qu’inestimables, mais plutôt de faire l’archéologie de cette inhumation et d’entrevoir le phœnix renaitre de ses cendres. Pour ce faire, j’ai interviewé Manuelina Duarte, professeure de muséologie à l’Université de Liège et professeure du programme en anthropologie sociale de l’Université fédérale de Goiás au Brésil (équivalent Master et Doctorat), mais aussi directrice du Département des processus muséaux de l’Institut Brésilien des musées (IBRAM) entre 2015 et 2016.

Manuelina Duarte © Markus Garscha
Emeline Larroudé : De quoi cet incident est-il symptomatique ?
Manuelina Duarte : Cet incident est symptomatique d’une situation de total abandon de la culture et des musées au Brésil, par les politiques publiques. Il y a, depuis le coup d’Etat qui a eu lieu en 2016, tout un ensemble d’actions du gouvernement de Temer, notre actuel président, et d’autres actions déjà annoncées par le prochain président Bolsonaro, qui vont vers la suppression de la culture et de l’éducation publique au Brésil. Dès les premiers jours de sa prise de fonction, Temer a commencé par supprimer le Ministère de la Culture. Après beaucoup de lutte, le Ministère a été rétabli, mais même si le problème n’est pas nouveau, il y a eu de moins en moins de ressources financières pour le Ministère tout au long de l’année. On a eu un accroissement de l’investissement au Ministère de la Culture pendant les gouvernances de Lula da Silva, puis pendant la première de Rousseff, qui était la continuation de celles du Parti des travailleurs. Mais durant son deuxième mandat, les questions de coupes budgétaires pour la culture étaient là, et les réunions et négociations entre le Ministère de la Culture et le Ministère de la Planification et des Finances étaient de plus en plus dures. La décision de Temer de supprimer le Ministère de la Culture le premier jour de sa prise de fonction en dit long sur la façon de voir la culture. La question se posait déjà avec la politique de Rousseff : on avait ces coupes mais toujours l’espoir que la situation financière du pays s’améliore et que l’investissement serait alors plus important. En 2017, le gouvernement de Temer a quant à lui adopté une loi limitant les investissements dans la santé, l’éducation, la culture et les infrastructures du pays : ils ne peuvent dépasser ceux de 2016, et ce pendant 20 ans. Les investissements de 2016 définissent donc les limites maximales des investissements pour les prochaines 20 années. Ce manque d’investissement est la cause de ce qui est arrivé au Musée National, malheureusement. Je peux déjà affirmer que cela va se reproduire dans d’autres musées mais aussi dans des hôpitaux, des écoles et des universités. Ce qui est bien, nouveau aujourd’hui, sera vieux, obsolète et désuet après 20 années sans investissements, et il est à prévoir de grandes tragédies pour les biens et les institutions qui sont déjà à risques.
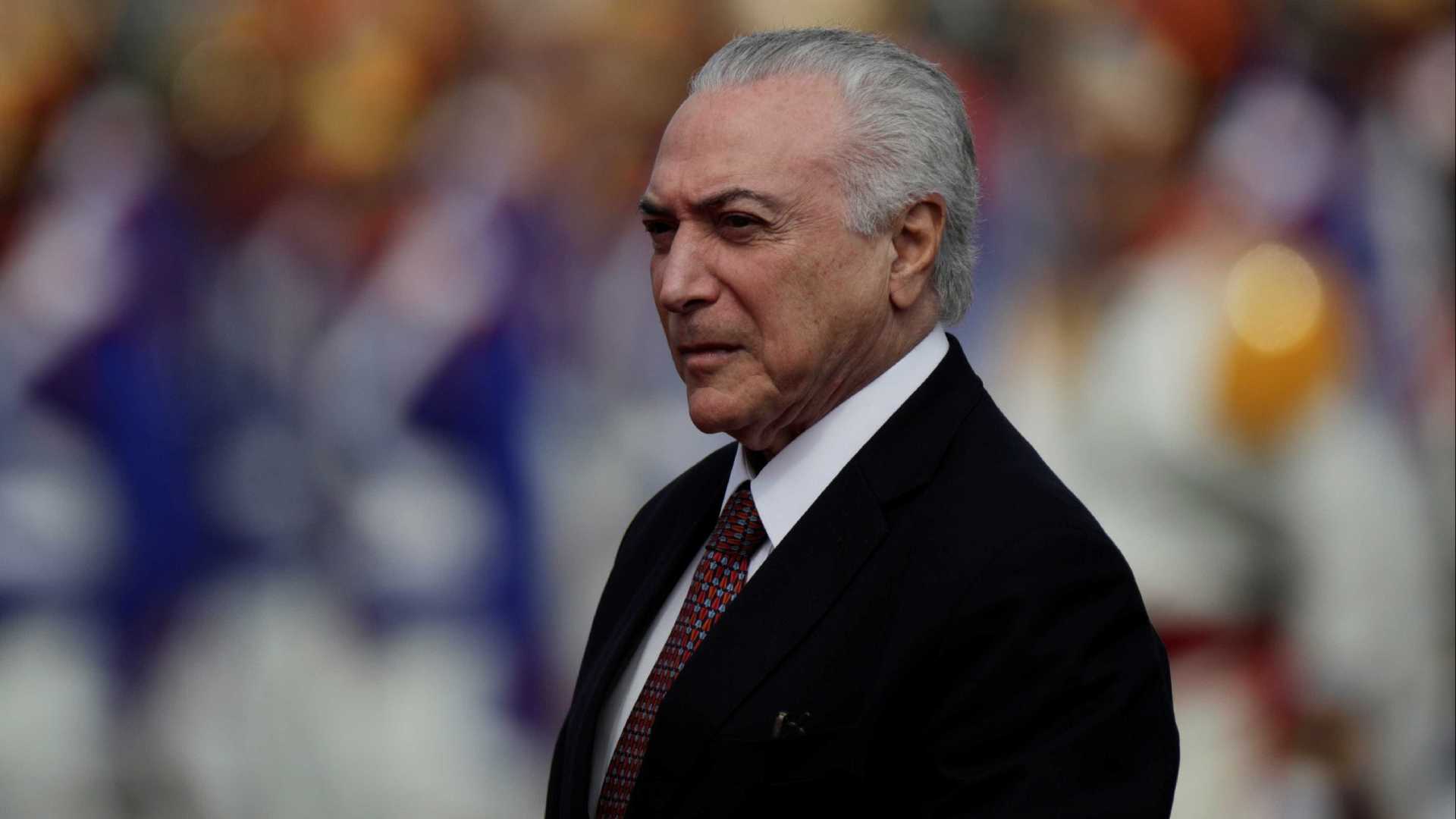
Michel Temer © REUTERS / Ueslei Marcelino
E. L. : Quelles mesures politiques sont prises ? Sont-elles significatives ?
M. D. : Les mesures qui ont été prises juste après l’incendie sont des mesures destinées à « sauver les apparences ». Le gouvernement et les politiciens ont très rapidement annoncé qu’ils allaient reconstruire le musée, et je pense que l’annonce immédiate de cette reconstruction trahit la volonté du gouvernement de contourner le problème et d’éviter toutes les discussions et débats qui devraient se tenir concernant les conditions, non seulement du musée incendié, mais plus globalement de l’ensemble des musées brésiliens. On pourrait apprendre de cette situation tragique pour décider d’investir davantage en amont pour d’autres musées et ainsi faire de la prévention. Que nenni, puisque le gouvernement préfère fuir la discussion. Mais ces mesures prises très vite n’ont pas maintenu cet élan face à la lenteur de notre bureaucratie. Même avec quelques aides internationales, le temps est nécessaire. Une chose importante est cependant en cours, bien qu’elle demande également du temps. Il s’agit d’une archéologie de sauvetage dans les ruines du musée pour essayer de trouver tous les vestiges des collections et les documents qui peuvent aider à reconstruire sa mémoire.
Une mesure politique désastreuse a été engagée par le ministre de la Culture les jours suivants l’incendie. Celui-ci a profité de cet épisode pour dire que le manque de ressources des musées brésiliens est dû à la complexité administrative, pour eux, de recevoir l’investissement privé. Il a donc annoncé la suppression de l’Institut Brésilien des musées qui est l’organe principal du Ministère de la Culture, présidant les 3700 musées brésiliens et responsable direct de 30 d’entre eux. Le musée National de Rio de Janeiro appartient à un autre ministère, non pas l’IBRAM mais le Ministère de l’Education, responsable des universités nationales dont fait partie l’Université Fédérale de Rio de Janeiro. Le Brésil comptant 68 universités fédérales, chacune ayant plusieurs campus et parfois 3 ou 4 musées, on peut estimer que le Ministère de l’Education possède environ 200-300 musées. D’autres musées dépendent de ministères différents, comme le Ministère des Transports ou le Ministère de la Justice. Cependant, sans le vouloir, le ministre de la Culture a laissé échapper que cet incendie était pour lui une « fenêtre d’opportunité ». C’est l’expression exacte qu’il a utilisée, une « fenêtre d’opportunité » pour effectuer les changements auxquels il songeait déjà auparavant : supprimer l’Institut et créer une agence brésilienne des musées. La différence entre l’agence et l’Institut est que l’agence ne va pas vraiment être un organe public gérant directement les musées avec l’argent du gouvernement, mais elle sera moins contrainte par les lois. C’est une institution à la gestion différente puisqu’elle peut recevoir des investissements privés avec plus de facilité. Mais ceux-ci ne sont pas pour autant monnaie courante. En effet, même en étant un musée public, le musée National de Rio de Janeiro pouvait recevoir des investissements. Comme presque tous les grands musées du Brésil, il a une association des Amis du musée qui peut lancer des projets et établir des partenariats avec les sponsors privés. Il y avait à ce titre un projet de renouvellement de 10 millions de réal (monnaie brésilienne, ce qui équivaut à 225 680 euros). Ce projet existait depuis longtemps mais n’a pas réussi à susciter l’intérêt des investisseurs privés. Comme le ministre l’a laissé entendre, l’incendie a donc été utilisé comme une opportunité pour déresponsabiliser le Ministère de la gestion des musées en créant une agence pour remplacer l’Institut. Rien ne dit cependant qu’il y aura plus d’investissements qu’avant car ils étaient déjà très rares. Lorsqu’ils existaient, ils étaient uniquement destinés aux grands musées, donc les petits musées ou musées de tailles moyennes vont être encore plus délaissés qu’ils ne le sont aujourd’hui. C’est un problème vraiment préoccupant, car le ministre de la Culture a réussi à faire signer la suppression de l’IBRAM et la création de la nouvelle agence par le président Temer. C’est exactement pour cette raison que l’incendie a été considéré comme une opportunité, puisqu’il a permis de créer une loi sans concertation du parlement, dans l’urgence. La loi autorise en effet le président, en cas d’urgence, à signer une loi comme celle-ci, bien qu’elle ne soit vraiment valide que si, dans un délai de trois mois, le congrès l’approuve. Pour le moment, cette discussion a étonnement eu pour résultat le maintien de l’IBRAM et, en parallèle, à la création d’une fondation privée qu’il gèrerait afin de pouvoir recevoir plus facilement les dons privés pour la sauvegarde des musées. Mais cela reste une discussion difficile car notre parlement est très peu préoccupé par les questions culturelles. Aucun des politiciens ne veut revoir ou supprimer le coût des pouvoirs publics relatif aux salaires des parlementaires, des juges, des agents publics, mais ils s’accordent à vouloir supprimer ce qui pour eux relève du luxe, comme la culture.

Vue aérienne du musée après l’incendie © AFP / Mauro Pimentel
E. L. : À quels retentissements internationaux peut-on s’attendre ? Des démarches sont-elles déjà mises en place ?
M. D. : On a reçu beaucoup de soutien de tous les pays, du Conseil International des Musées (ICOM), des grands musées internationaux... Quelques-uns comme la France ou l’Allemagne ont annoncé leur appui et même proposé quelques aides financières (à hauteur d’1 million d’euros pour ce qui est des Allemands). En ce moment ont lieu les travaux d’archéologie de sauvetage dans les ruines, de fortifications des ruines pour ne pas avoir davantage de destruction concernant les murs qui sont encore debout aujourd’hui. Plus de 2000 objets ont déjà été retrouvés. La prochaine étape concerne les travaux pour les préparations de projet. Mais le soutien international le plus significatif concerne la question de l’information. Je pense que, plus que d’obtenir de l’argent, on a réussi à informer. Il y a beaucoup de partage des informations liées aux collections détruites du musée National de Rio de Janeiro qui sont dans les bases de données des musées internationaux. Ils nous aident à, d’une certaine façon, regrouper au moins digitalement une partie des données conservées sur les collections perdues. Donc, les musées qui ont sauvegardé des informations, données, qui ont photographié les collections brésiliennes, sont en train de contacter le musée National pour collaborer avec lui. Il y a également une offre internationale du point de vue de l’expertise, pour ce qui est de la restauration, de la reconstruction du bâtiment, etc.

Bannière de la campagne Museu Nacional Vive © UFRJ
E. L. : Comment appréhender cet incident à l’échelle du musée ? Qu’en faire ?
M. D. : Le musée a fait preuve d’une grande réactivité. Rapidement, les équipes se sont réunies pour essayer de sauver tout ce qui pouvait encore l’être, et ce dès l’annonce de l’incendie. Les gens se sont précipités, ce dimanche-là. Les scientifiques, les chercheurs, ont couru au musée pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l’être et qui était moins pris par les flammes. Pour ce faire, ils se sont mis en danger eux-mêmes. Dans les jours suivants, ils ont tous vivement soutenu l’idée que le musée vit encore. Oui, les pertes sont énormes et quasi totales, mais toute la connaissance est là. Les recherches étaient parfois copiées sur des ordinateurs personnels, tout est fait pour que les données puissent être réunies. Je pense qu’à ce moment-là, l’action du service éducatif du musée a été vraiment très forte, importante, symbolique. Il a lancé une campagne : « Museu Nacional Vive » (le musée National vit). Ils ont sensibilisé quelques artistes, beaucoup de Brésiliens ont fait des campagnes volontaires pour demander aux gens qui ont des photos du musée de les partager, ou de faire des dons financiers. Pendant l’incendie, les collections, en brûlant, se sont parfois envolées. Il était donc possible de trouver de petits morceaux de collections d’insectes ou de feuilles de papiers semi-brûlées dans les appartements, les rues, les maisons, les jardins jusqu’à 2km autour du musée, ce qui a également permis de sauver quelques informations. Le service éducatif du musée a donc fait une grande campagne pour retrouver ces morceaux ainsi que toutes les photos, informations et témoignages que les gens pouvaient conserver à propos du musée. Grâce à ce travail colossal, un google street view du musée a pu être réalisé. L’action éducative du musée est particulièrement impliquée, c’est une des parties les plus actives dans ce processus de recomposition du musée qui n’est pas seulement un processus de reconstruction de bâtiment mais bien de reconstruction des liens entre le personnel du musée et la population, autant qu’en interne. Tout le monde a beaucoup souffert émotionnellement, face à cette situation. Tous les événements et actions qui ont eu cours les jours suivants dans les jardins du musée ont été initiés pour prouver, à la population mais aussi à eux-mêmes, que le musée vit encore et qu’il n’est pas mort.
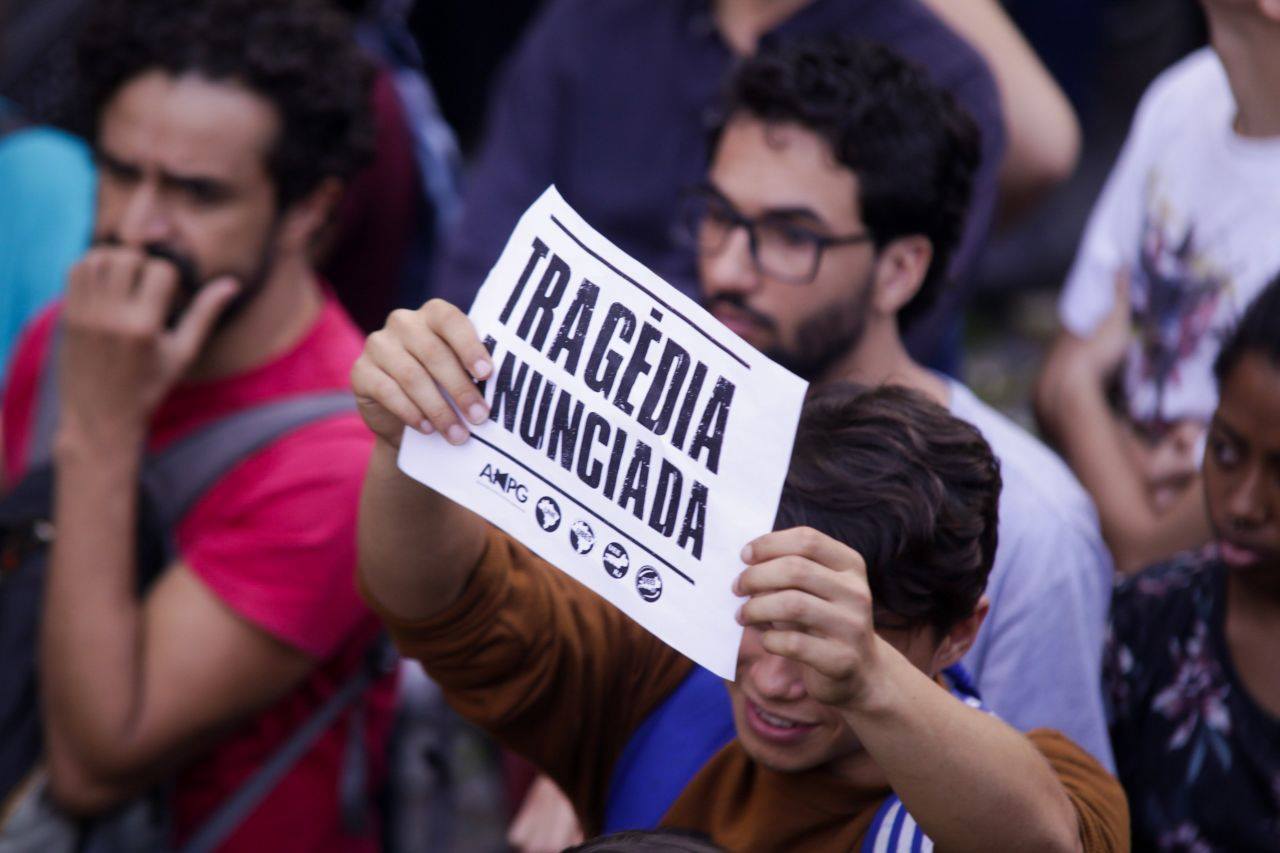
Population mobilisée devant le musée à la suite de l’incendie © Annelize Tozetto
E. L. : Cet événement a-t-il permis l’éveil d’un plus vif intérêt ou d’une sensibilisation plus grande par les brésiliens ? Quelle réaction du public, des visiteurs ?
M. D. : Cet événement a vraiment touché les Brésiliens. Malheureusement, je ne sais pas si l’effet va s’estomper ou au contraire perdurer. Sur le moment en tout cas, la population a été très touchée, très solidaire, particulièrement la population de Rio mais aussi celles des autres villes brésiliennes. Tout le monde a suivi l’événement sur la télévision, c’était un choc. Ils y ont tous été sensibles. La première réaction, notamment des habitants de Rio, a été de visiter non pas le lieu ni les ruines, qui sont protégés par la police pour les investigations, mais le jardin qui les entoure. Le personnel du musée y a organisé des événements les jours qui suivirent l’incident. La population s’y est rendue. Je pense qu’en général, on a constaté une vague d’articles, de réactions dans tous les médias : presse, télé... Tout le monde était préoccupé, par le musée National mais également par les autres musées. Je pense que le plus important est que cela a mis en lumière le fait que le musée National ne serait pas forcément un cas particulier, puisque beaucoup d’autres musées sont également en danger. En effet, le Brésil n’a ni les moyens suffisants ni une politique de prévention qui permettent de dire que les autres musées sont dans un meilleur état et sans risques.

Crâne de « Luzia », plus ancien fossile humain retrouvé au Brésil, dont une partie a été perdue dans l’incendie © Acervo Coordcom
E. L. : Quel musée de demain pour le Brésil ?
M. D. : Le Brésil est un grand pays, pauvre du point de vue économique mais très riche du point de vue de la culture, de la diversité, de la vivacité du peuple etc… Il a beaucoup à gagner avec des processus de muséalisation moins traditionnels, davantage liés à la culture populaire, à la culture vivante, aux savoir-faire, au patrimoine immatériel, tout ce qui se trouve dans le peuple en général et non derrière des vitrines. On a d’importantes collections, mais contrairement à l’Europe, je pense qu’on s’accorde beaucoup plus de libertés pour explorer ces autres modèles de muséalisation. Un événement comme celui-ci montre que concentrer les collections sous une seule institution, dans une seule structure parfois, c’est aussi créer une situation plus à risques qu’opter pour une sorte de décentralisation. Le plus important est la récolte des informations, la collecte, la réalisation des inventaires, des dossiers, des photographies … Mais parfois, ne vaut-il pas mieux ne pas réunir physiquement les collections ? On mène beaucoup d’expériences, au Brésil, d’inventaires participatifs. Ces expériences participatives ne décontextualisent pas les objets dans la mesure où ceux-ci restent chez les propriétaires originels, dans leurs maisons. Ils en sont responsables et vont les transmettre aux futures générations. C’est un véritable modèle, surtout si l’on tient compte du fait que le gouvernement ne semble pas vraiment intéressé à faire les investissements nécessaires pour les institutions. Ce partage de responsabilité mais aussi de propriété avec les communautés, pourrait aussi être particulièrement utile pour les Brésiliens qui n’habitent pas dans les capitales, car les grands musées comme celui-là sont toujours situés dans de grandes villes brésiliennes auxquels tous n’ont pas accès. 80% des quelques 5000 villes brésiliennes n’ont aucun musée. Les musées sont surtout concentrés dans le Sud et le Sud-Ouest du Brésil, régions les plus riches, dans les capitales et sur les littoraux. On a donc un grand désert muséal au Nord, au Nord-Ouest et au Centre du Brésil. Je pense qu’on ne peut occuper ces espaces vides qu’avec la multiplication des initiatives communautaires, des initiatives plus petites et diffusées de manière décentralisée. C’est préférable au fait de créer de grands musées avec des architectes connus dans les capitales du pays. La reproduction du modèle européen, basée sur une perspective courte, ne peut pas réussir à occuper tous ces grands espaces de 8 millions de km² dans un pays qui a toujours dit que la culture ne fait pas partie de ses priorités.
Emeline Larroudé
#museunacionalvive
#lutomuseunacional
#museunacional
Pour en savoir plus :
http://www.museunacional.ufrj.br/

Notre-Dame-des-Landes ou l’émergence d’une utopie « agri-culturelle »
Dans la neuvième édition hors-série du magazine Socialter intitulée « Renouer avec le Vivant », l’anthropologue Alessandro Pignocchi publie une courte bande dessinée dans laquelle il se projette au cœur d’un futur hypothétique. Il imagine une visite au musée : une mère et son enfant contemplent les restes de ce que fut le monde avant le grand renouveau, qui prit pour point de départ les luttes des Zones à Défendre.
Image d'en-tête : Croquis in vivo © MCmarco
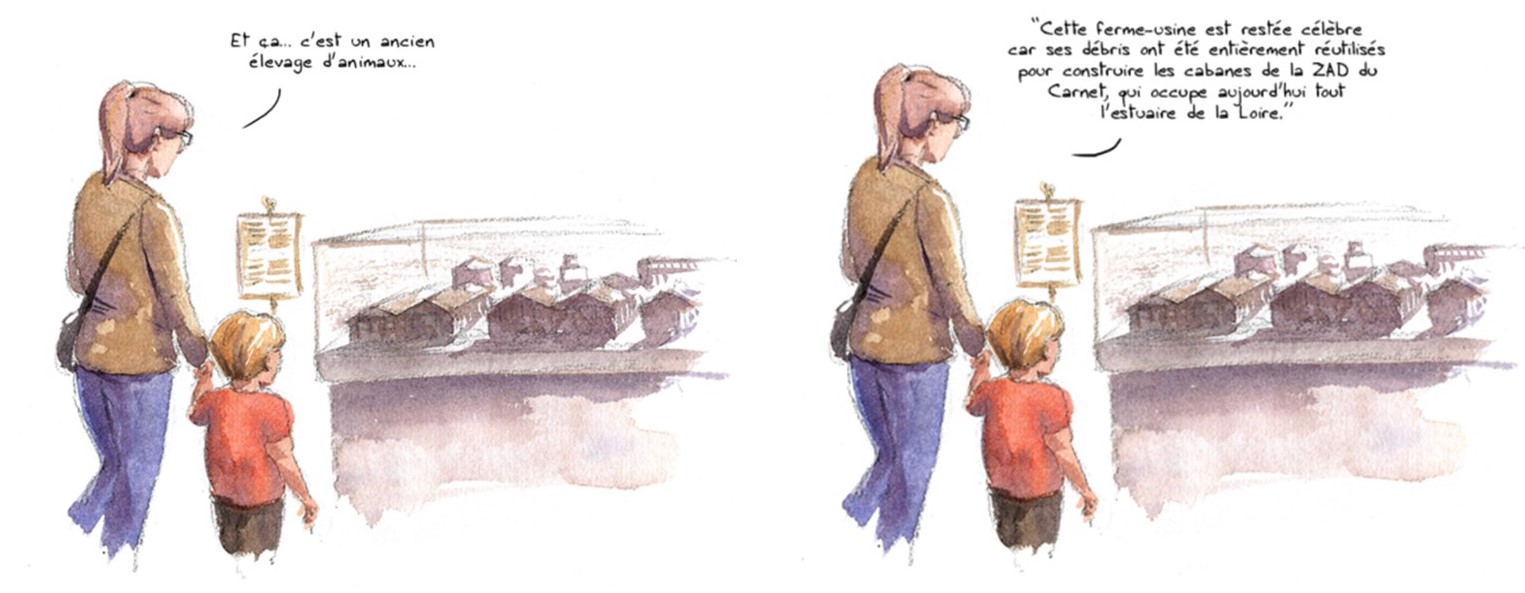
Extrait de la bande-dessinée créée par Alessandro Pignocchi pour le magazine Socialter © Alessandro Pignocchi ; Socialter 2021
Si le nouveau monde n’est pas encore là, il est cependant certain que les problématiques écologiques et sociales soulevées par les occupants des ZAD sont de plus en plus prégnantes au sein de notre société occidentale. La Zone à Défendre de Notre-Dame-des-Landes est un territoire rural où sont pratiquées des activités d’agriculture et d’élevage. Pour autant, l’organisation du site, mise en place par les occupants depuis une dizaine d’années, tend à faire évoluer le statut de cette zone par les activités économiques, artisanales, culturelles et sociales qui y sont pratiquées. Se trouverait-on ainsi confronté à l’émergence d’une véritable zone « agri-culturelle », fruit d’un projet que d’aucuns considèreraient comme utopiste et qui pourtant perdure ?
Le besoin de renouveau
La Zone à Défendre de Notre-Dame-des-Landes est un lieu d’expérimentation collective. Au sein de ce territoire de 1650 hectares se développent, depuis plusieurs décennies, des activités en tout genre. Qu’ils relèvent de l’agriculture, de l’artisanat ou même de la culture, les projets qui « poussent » sur la ZAD se proposent comme de véritables alternatives à nos modes de vies occidentaux contemporains. Ils s’inscrivent au sein d’un territoire en lutte, un territoire « à défendre » contre un système imposé : celui du chacun pour soi, de l’industrialisation à outrance, celui de la mondialisation, de la globalisation et de l’obsolescence programmée. La ZAD de Notre-Dame-Des-Landes constitue de fait un territoire riche aux enjeux très particuliers. Bocage marqué par le mouvement de lutte contre le projet de transfert de l’aéroport de Nantes sur le site de Notre-Dame-des-Landes, il a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes, d’âges et de milieux sociaux très variés, depuis les années 1970. L’abandon du projet de l'Aéroport du Grand Ouest, le 17 janvier 2018, a ouvert la possibilité, pour les quelques trois-cents personnes aujourd’hui installées sur la zone de manière pérenne, de se projeter et d'entreprendre sur le long terme. Il est alors question d’enraciner les initiatives collectives et écologiques, de vie et de lutte partagées, qui s’étaient construites petit à petit sur le territoire. Des expériences de chacun, mais également de la connaissance pointue des milieux et des enjeux locaux, a émergé un projet cohérent et dynamique pour le territoire de l'ex-zone d'aménagement différé.
Territoires pol(ys)émiques
En plus des activités agricoles, ont également émergées sur le territoire de la Zone à Défendre des activités d’artisanat. Les artisans sont regroupés au sein d’un collectif et travaillent en lien avec les autres activités du territoire. Il s’agit par exemple de fabriquer des outils qui serviront aux activités agricoles du territoire. L’objectif poursuivi est bel et bien de créer un « territoire vivant » en renforçant les dynamiques locales et en utilisant des techniques et des matériaux traditionnels. Les zadistes espèrent de fait transmettre et sauvegarder les savoir-faire de métiers qui tendent aujourd’hui à disparaître et qui pourtant font partie intégrante du patrimoine culturel régional. Un véritable écomusée à ciel ouvert.
Ainsi cohabitent sur la ZAD une forge, nécessaire à la fabrication et entretien de l'outillage pour les projets agricoles des alentours et l'atelier de bûcheronnage, une maroquinerie pour la fabrication d'objets artistiques en cuir, mais également un atelier de céramique impliqué dans la fabrication de vaisselle, de sanitaires, éviers et poêles à bois. S’y trouve également un atelier de menuiserie pour la fabrication de manches pour les outils issus de la forge et des objets d’art. Un espace dédié à la papeterie et à la sérigraphie se propose de réaliser du papier, des affiches et des visuels graphiques. Cet espace s’attèle aussi à cultiver des plantes tinctoriales destinées à la confection d'encre végétale. Ces activités artisanales se répartissent dans différents lieux de la ZAD. Il s’agit souvent d’anciennes fermes récupérées par les zadistes pour y établir des « communs » ou espaces communautaires destinés à l’ensemble de la communauté. Ainsi la ferme de Bellevue, située au cœur du territoire, près de la forêt de Rohanne, comprend une cuisine collective, une fromagerie, une boulangerie ainsi que des espaces dédiées à la couture et à la forge. Les habitants de la ZAD ont donc une production foisonnante et originale, en lien direct avec leur mode de vie particulier : un mode de vie rural et ancré dans un climat de lutte depuis des décennies.
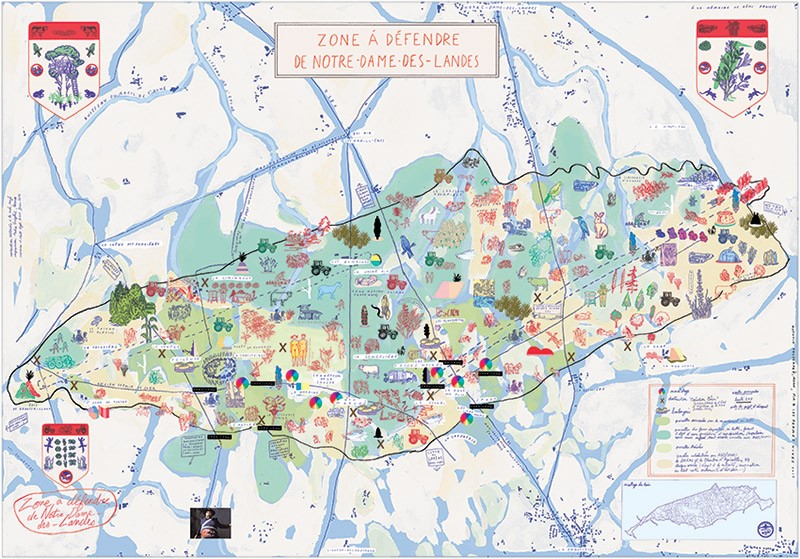
Cette carte dessinée situe les lieux de vie et activités dans la ZAD © Geoffroy Pithon, Quentin Faucompré, Mano et Pia ; éditions À la criée 2016
Mais la ZAD organise également régulièrement de grands évènements et bénéficie d’une vie culturelle riche, ponctuée de concerts, de lectures, de spectacles, de projections, de conférences… Les zadistes le disent eux-mêmes : « Jamais hameau de quelques centaines d’habitant.es n’a connu une telle vitalité socio-culturelle ! ». En guise d’exemple, mentionnons l’espace de la Wardine, situé au nord-ouest du site dans les bâtiments de l'ancienne ferme de Saint-Antoine, qui sert d’espace de discussion. En effet, le collectif en charge de ce lieu particulier souhaite qu’il puisse servir à un « tas d'activités politiques » et programme ainsi régulièrement des rencontres, des projections et des discussions. La Wardine propose également une salle de concert, afin de profiter de musiques expérimentales et « souvent inouïes », une salle de sport où il est possible de pratiquer de la danse, des arts du cirque ou encore de la self-défense, ainsi qu’un espace permettant d’accueillir les enfants du territoire.
Un autre lieu permet de profiter d’activités sociales et culturelles sur le territoire de la ZAD. Il s’agit de l’Ambazada, située quelques kilomètres à l’est de la Wardine. L’Ambazada est un bâtiment construit par les zadistes au cours de chantiers collectifs et à l’aide de matériaux locaux, principalement du bois. Au cœur de la seule pièce de l’édifice s’organise une multitude d’événements culturels, allant des rencontres avec des artistes, des scientifiques ou des auteurs, aux formations relatives aux questions d’agriculture et d’environnement, sans oublier les concerts et les projections. Les occupants de Notre-Dame-des-Landes disposent également de leur propre bibliothèque. Située au cœur du périmètre de la ZAD, sur la parcelle de la Rolandière où l’on rencontre également le « phare », la bibliothèque du Taslu rassemble plus de cinq mille ouvrages. On y trouve ainsi des romans, de la poésie, du théâtre, des bandes dessinées, etc. Les zadistes ont également réuni des fonds thématiques sur l’histoire des luttes, le monde paysan et les diverses activités du territoire.
De la ZAD au musée (et inversement)
La ZAD lance régulièrement, via son site internet, des appels à artistes pour que ces derniers viennent « peupler le bocage d’imaginaires en action ». Le territoire attire donc de nombreux artistes, auteurs, intellectuels. Philippe Graton, photographe, s’est régulièrement rendu à Notre-Dame-des-Landes de 2014 à 2019. En 2020, il exposait au Musée de la photographie de Charleroi ses clichés en noir et blanc présentant des moments de vie et de lutte sur la ZAD.

Photographie publiée dans les Carnets de la ZAD du photographe Philippe Graton © Philippe Graton
Alain Damasio, romancier et Grand prix de l’imaginaire, se rend également régulièrement sur la Zone à Défendre. Là-bas, il se prend à rêver de « musée de plein air » et d’ « opéra arboré ». Notre-Dame-des-Landes est par ailleurs devenue une grande source d’inspiration pour l’auteur, puisque les ZAD sont un des thèmes principaux de son tout dernier roman, intitulé Le Furtifs et publié aux éditions La Volte en 2019. Mais la ZAD de Notre-Dame-des-Landes n’est pas la seule à être à être source de propositions créatives : parmi les créations récentes, citons l'AMusée, un « musée inversé » créé en février 2021 sur la ZAD de Gonesse (Val d’Oise). L’AMusée, aujourd’hui détruit, reposait sur un concept simple : c'est à l'extérieur de ce lieu, et « jusqu'aux confins de l'univers » que se trouve l'Art. L’installation avait donc pour vocation de rendre visible et de défendre un autre rapport à l'Art et prenant la forme d'une cabane en palettes et carton cousu. Trois ouvertures pratiquées dans les murs permettaient d’observer les œuvres éphémères créées pour l’occasion.
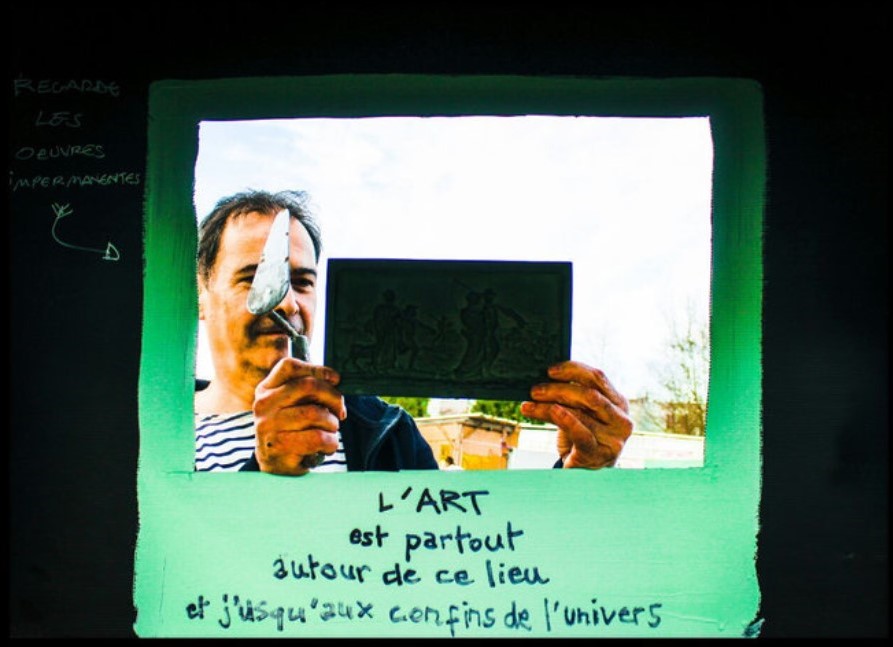
Photo de la performance de l’artiste plasticien Morèje pour l’AMusée sur la ZAD de Gonesse © Vitalia
Finalement, par la remise en question profonde du mode de fonctionnement de nos sociétés « fondées sur les notions de hiérarchie, de domination et d’exploitation », la Zone à Défendre a permis l’émergence de nouveaux modes « d’habitat, de gouvernance et de solidarité » en mettant en place « le partage des communs, le réinvestissement des rituels, la permaculture ou encore la monnaie locale ». Elle semble ainsi bel et bien matérialiser le concept d’hétérotopie (topos : « lieu », et hétéro : « autre » : « lieu autre ») tel qu’il fut définit par Michel Foucault, c’est-à-dire comme une localisation physique de l'utopie. Les hétérotopies seraient ainsi des espaces concrets hébergeant « l'imaginaire ». Car c’est bel et bien cela que nous proposent les occupants de la Zone à Défendre de Notre-Dame-des-Landes: une invitation à repenser nos imaginaires. En effet, selon Philippe Vion-Dury, rédacteur en chef du magazine Socialter, le terme d’imaginaire renvoie à nos représentations « sociales, politiques, temporelles, anthropologiques » et, en définissant ce qui est « bon ou mauvais, normal ou anormal, souhaitable ou non », détermine les normes de la société dans laquelle nous vivons. Ainsi, selon lui, la construction d’un imaginaire collectif revêt une importance considérable dans nos vies, puisque c’est elle qui est à l’origine des logiques d’émancipation ou d’asservissement culturellement acquises. Les « imaginaires alternatifs », qui s’opposent aux imaginaires traditionnels qui ont « fait faillite » entrent aujourd’hui dans nos foyers. Au moment où j’écris ces lignes, nul ne sait si la Zone à Défendre de Notre-Dame-des-Landes réussira à perdurer et à garder son statut d’« antichambre d’un monde nouveau ». Ce qui est pourtant sûr, c’est qu’au sein de cette communauté d’ « artisans-artistes », la culture vit par les gestes au sein d’un véritable musée à ciel ouvert, un laboratoire des possibles.
Image vignette : cabane médicinale et traversée solaire © ZAD NDDL Info
Pour aller plus loin :
ZAD NDDL Infos, la page Facebook des habitants la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Pour retrouver les actualités et les RDV de la ZAD : https://www.facebook.com/zadnddlinfo
Renouer avec le Vivant : https://www.socialter.fr/article/hors-serie-9-renouer-avec-le-vivant-avec-baptiste-morizot
L’Amusée : https://blogs.mediapart.fr/edition/inverse/article/040421/lamusee
La Zone à Défende, du spectacle au rite : https://www.franceculture.fr/emissions/la-theorie/la-transition-culturelle-du-vendredi-17-janvier-2020
(P)artisan.ne.s, le collectif d’artisans de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes : https://zad.nadir.org/spip.php?rubrique96
#ZoneADéfendre #Alternatives #UnAutreMondeEstPossible
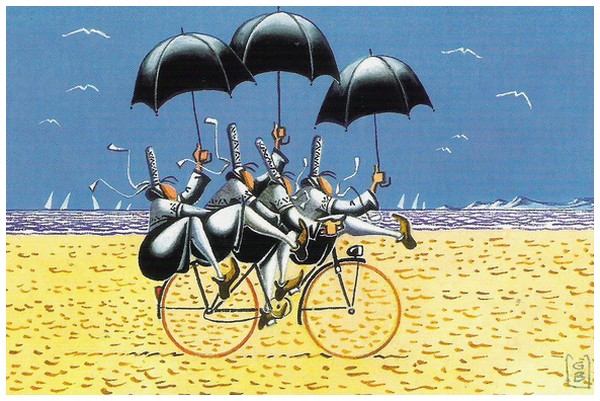
Par une matinée pluvieuse...
De retour dans ma ville natale en Bretagne où il pleut, quoi de plus naturel pour une étudiante en muséographie qui s’ennuie que de se rendre au musée le plus proche ! Le musée en question est un petit musée d’histoire locale et maritime, le Musée Maritime du Cap-Sizun. Il me semble y avoir été une seule fois, il y a très longtemps, à une époque où les musées ne devaient pas beaucoup m’intéresser.
Dans mon souvenir il était rempli d’un bric à brac non identifiable et vraiment vieillot, comme la boutique d’un antiquaire. C’est avec cette image en tête que j’y suis retourné.

© TripAdivsor
Le prix est plus que raisonnable (3€). Après avoir donné mon code postal (le même que celui du musée !), je pénètre enfin dans la première salle.

© J. L.
Bienvenue au Musée Maritime du Cap-Sizun
Eh bien… il s’avère que ce n’est pas très différent de mes souvenirs. Les objets sont exposés absolument partout, à même le sol, sous une table, dans un coin, au plafond… Au fil des salles (17 sur 3 étages !) je me rends compte qu’on peut distinguer au moins 3 périodes de réalisation du musée grâce aux panneaux explicatifs. Certains sont plus lisibles que d’autres, même si dans l’ensemble il y a énormément de texte. Je peine à tout lire, alors je sélectionne selon les sujets qui m’intéressent le plus : la vie à terre, les phares, les ports abris, le sauvetage…
https://www.youtube.com/watch?time_continue=183&v=LrYFC2VW_uQ
© Cinémathèque de Bretagne
Même s’il ne paye pas de mine, ce petit musée me prend dans ses filets. Je découvre une photo que je ne connaissais pas de mon arrière-grand-père, membre de l’équipage du canot de sauvetage d’Audierne dans les années 1960. Plus loin, dans la salle sur la construction navale, des images des anciens chantiers navals du coin, y compris celui que mes parents ont racheté. J’ai déjà vu ces images, mais les voir ici, dans un musée, leur donne une dimension historique que je ne saisissais pas avant. Parmi les photos exposées, je repère des figures familières de mon enfance, un patron de chantier, ses charpentiers et un patron pêcheur.
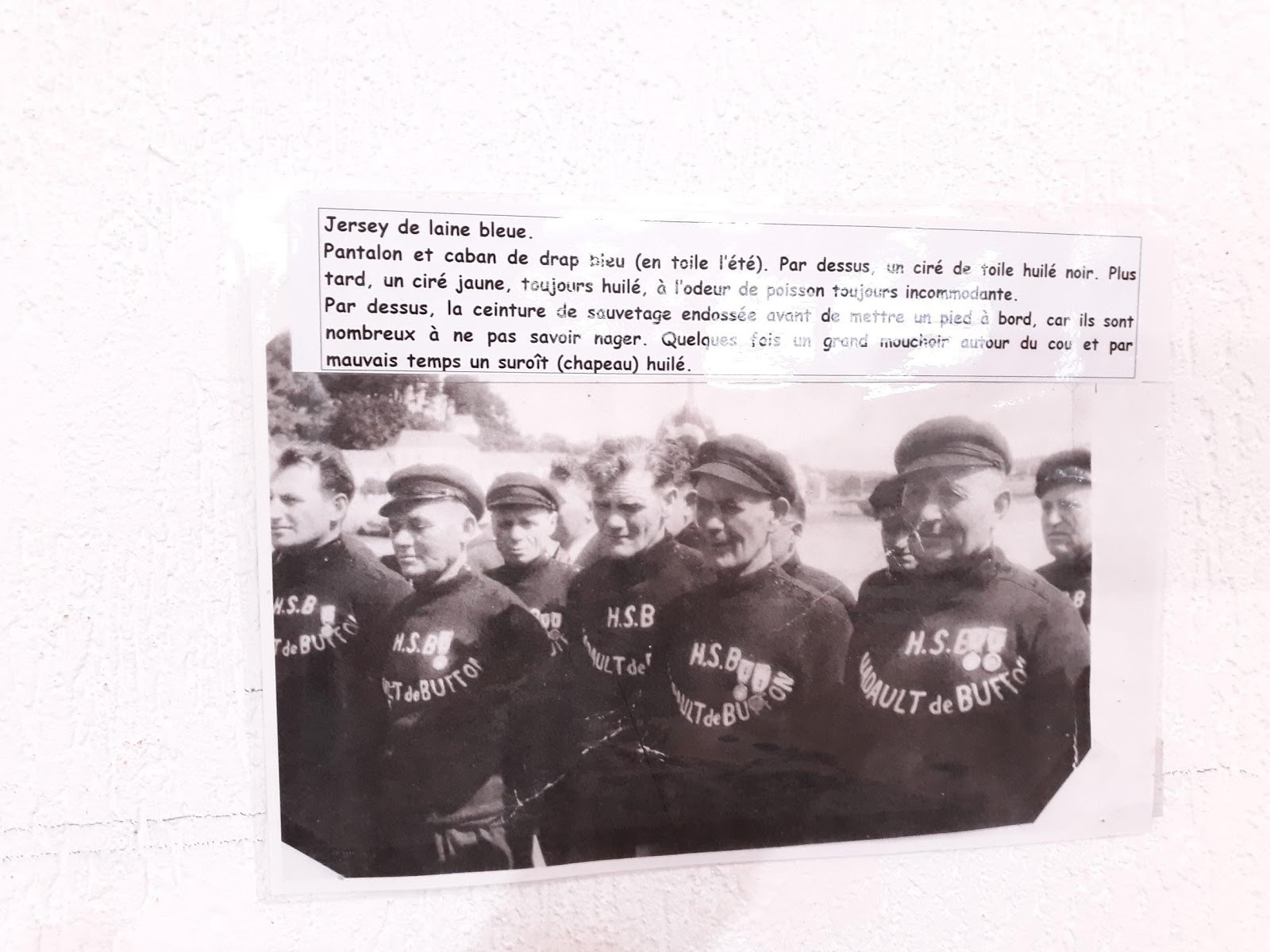
Mon arrière-grand-père Pierre Kervévan, le deuxième à partir de la gauche © J.L.
Au détour d’un panneau sur le phare de la Vieille, j’apprends que les grands blessés pendant 14-18 avaient des emplois réservés, supposés moins pénibles que d’autres. Gardien de phare en était étonnamment un, ainsi que… gardien de musée !
Sans prétention, le Musée Maritime du Cap-Sizun présente des centaines d’objets issus de collectes, de prêts de membres de l’association qui le porte, ainsi que de prêts d’institutions telles que le DRASSM (Département de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines), le service des Phares et Balises… L’association bénéficie du soutien de quelques maquettistes qui donnent régulièrement leurs créations au musée, ce qui enrichit énormément la visite. Naïves ou détaillées, professionnelles ou exécutées avec les moyens du bord, les maquettes réjouissent l’œil du visiteur.

© J.L.
La scénographie hétéroclite fait sourire : ici il s’agit de quelques coraux et coquillages dans une vitrine, puis d’une pièce entière dédiée à un diorama, un lit qui fait office de “vitrine”...


Dioramas © J.L.
Sans en être véritablement, quelques éléments peuvent être qualifiés de “manipulations” : quelques outils paléolithiques disposés dans la première salle sur l’histoire des premiers peuplements du Cap-Sizun, une coupe “tactile” montrant les matériaux utilisés pour la coque d’un canot de sauvetage…
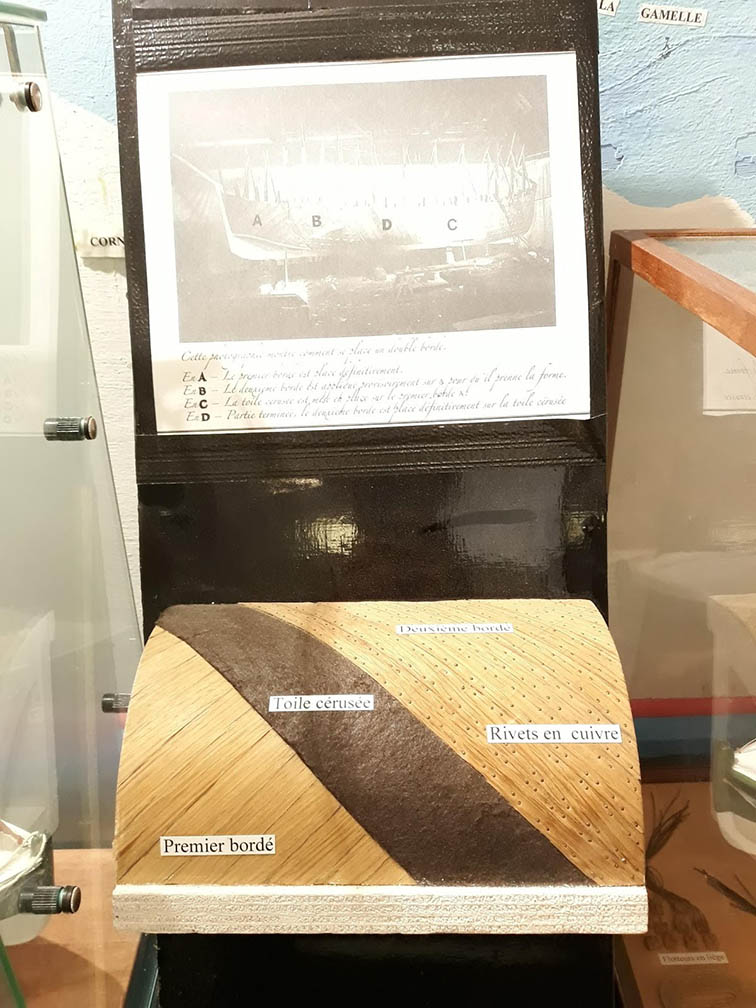
© J.L.
Sans prétention aucune, ce petit musée distille d’innombrables connaissances sur un grand nombre de sujets. Le visiteur découvrira avec plaisir l’histoire du Cap-Sizun, s’amusera devant certaines anecdotes, et s’il est du coin, il risque de retrouver de la famille, des amis ou voisins dans les nombreux portraits des hommes et des femmes du Cap-Sizun présentés tout au long du parcours. Loin d’être délaissé par les touristes (une dizaine de personnes un lundi matin d’août à 10h30 !), il réussit à transmettre à son public l’essence du Cap.
Ce musée ne serait pas grand-chose sans ses bénévoles, qui le font véritablement vivre depuis sa création. Initiateurs des collectes, guides, commissaires d’exposition, ils endossent tous les rôles. C’est aussi grâce à eux que le musée bénéficie de nombreux partenariats, comme c’est le cas pour l’exposition temporaire actuelle sur Les marins de l’offshore.
Toutefois l’apparence hétéroclite du musée et son peu de moyens se répercutent sur la cohésion générale du propos, qui gagnerait à se recentrer véritablement sur le local. La création en 2017 d’un comité de pilotage chargé de l’étude des pistes de refonte laisse présager un avenir prometteur pour le Musée Maritime du Cap-Sizun, s’il aboutit à des pistes concrètes et réalistes.
Sur la route du retour, mon œil est attiré par une affiche jaune et bleue avec un nom bien connu : la Maison Hénaff, à quelques kilomètres d’Audierne. La prochaine fois peut-être ?
Pour en savoir plus :
Rue Lesné
29770 Audierne

Paris libéré
Le feu Mémorial du Maréchal Leclerc de Hautecloque et de la Libération de Paris – Musée Jean Moulin, puis Musée du général Leclerc et de la Libération de Paris – Musée Jean Moulin, a fermé ses portes au public le 1e juillet 2018. Mais ce n’était que pour mieux rouvrir le 25 août 2019, à l’occasion du 75e anniversaire de la Libération de Paris ! Plus qu’une réouverture, il s’agit véritablement d’un déménagement du musée qui en profite par la même occasion pour changer de nom en se muant en Musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin. Une dénomination qui rend hommage aux deux hommes de manière égalitaire, leur donnant le même statut. Il quitte alors sa dalle au-dessus de la gare Montparnasse pour se rapprocher de ses compères du réseau Paris Musées, les Catacombes de Paris, place Denfert-Rochereau.

Vue du square Nicolas Ledoux sur le musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc - musée Jean Moulin © Ch. Batard, Agence Artene
Un nouveau lieu
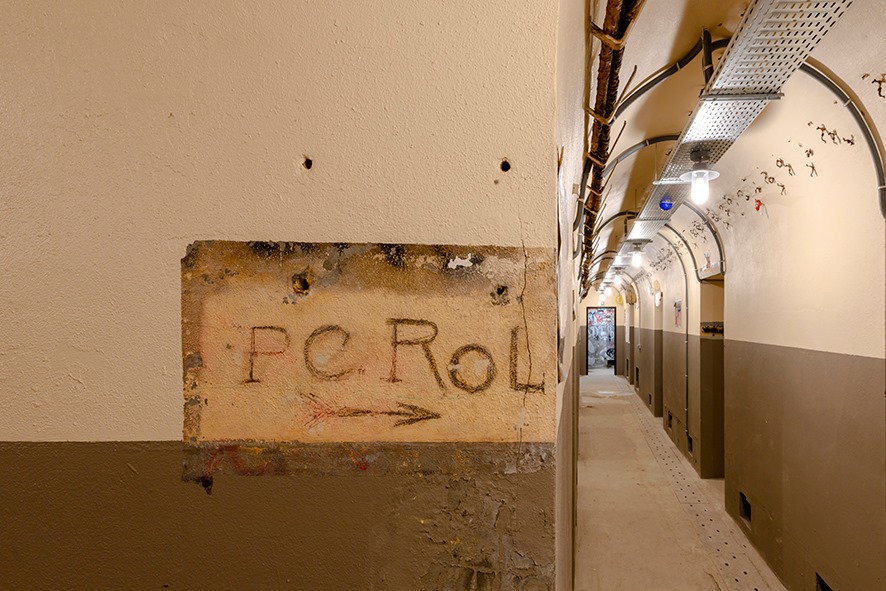
Le poste de commandement du Colonel Rol © Pierre Antoine
Une histoire
Un lieu qui fait d’autant plus sens qu’il permet de proposer la visite de l’abri de défense passive du colonel Henri Rol-Tanguy, membre dirigeant de la Résistance durant la Seconde Guerre Mondiale. Ce niveau -2, accessible par un long escalier de plus de 100 marches, permet d’en percevoir le poste de commandement, avec son bureau, son secrétariat, son central téléphonique, son système de ventilation … Et d’appréhender l’organisation de la défense et les bombardements qu’a connu Paris. Il devient emblématique puisque tout le propos du musée est de questionner « l’engagement au cœur d’un monde en guerre », et de proposer « un regard renouvelé sur l’histoire de Paris et des Parisiens pendant la Seconde Guerre Mondiale ». Il s’agit là d’une histoire incarnée, humanisée, qui s’écrit à travers des portraits, des récits, des objets. C’est un véritable hommage aux résistants de tout ordre. Pour ce faire, quoi de plus évident que de s’intéresser particulièrement aux deux figures mises à l’honneur de par les dons et legs dont le musée a pu faire l’objet : Philippe Leclerc de Hautecloque et Jean Moulin.

Canne du général Leclerc de Hauteclocque. Entre 1931 – 1945 © Stéphane Piera / musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc - musée Jean Moulin (Paris Musées) / Roger Viollet
Deux hommes
Ils semblent ne jamais s’être rencontrés, et pourtant, leur combat était le même. Nés tous deux avant la Première Guerre Mondiale, ils refusent de se résoudre à l’occupation une fois la Seconde Guerre Mondiale venue. Chacun, sans jamais croiser le chemin de l’autre, se bat pour que la France et les Français puissent retrouver un jour leur Liberté.
Philippe de Hautecloque, futur général Leclerc, s’engage dans l’armée tôt, où il excelle de sorte à finir major à l’école de cavalerie de Saumur, puis premier à l’Ecole de Guerre après une mission au Maroc. Il termine seulement sa première année lorsque la guerre est déclarée. Jeune capitaine, il n’accepte pas le repli de ses trouves de la 4e division d’infanterie, il refuse deux fois la captivité et la défaite même blessé. Happé par les appels du général de Gaulle, il le rejoint et tente pour lui de rallier les pays d’Afrique équatoriale à leur cause. Avec un parcours remarquable, il participe à la Libération du pays en commandant la 2e Division Blindée.
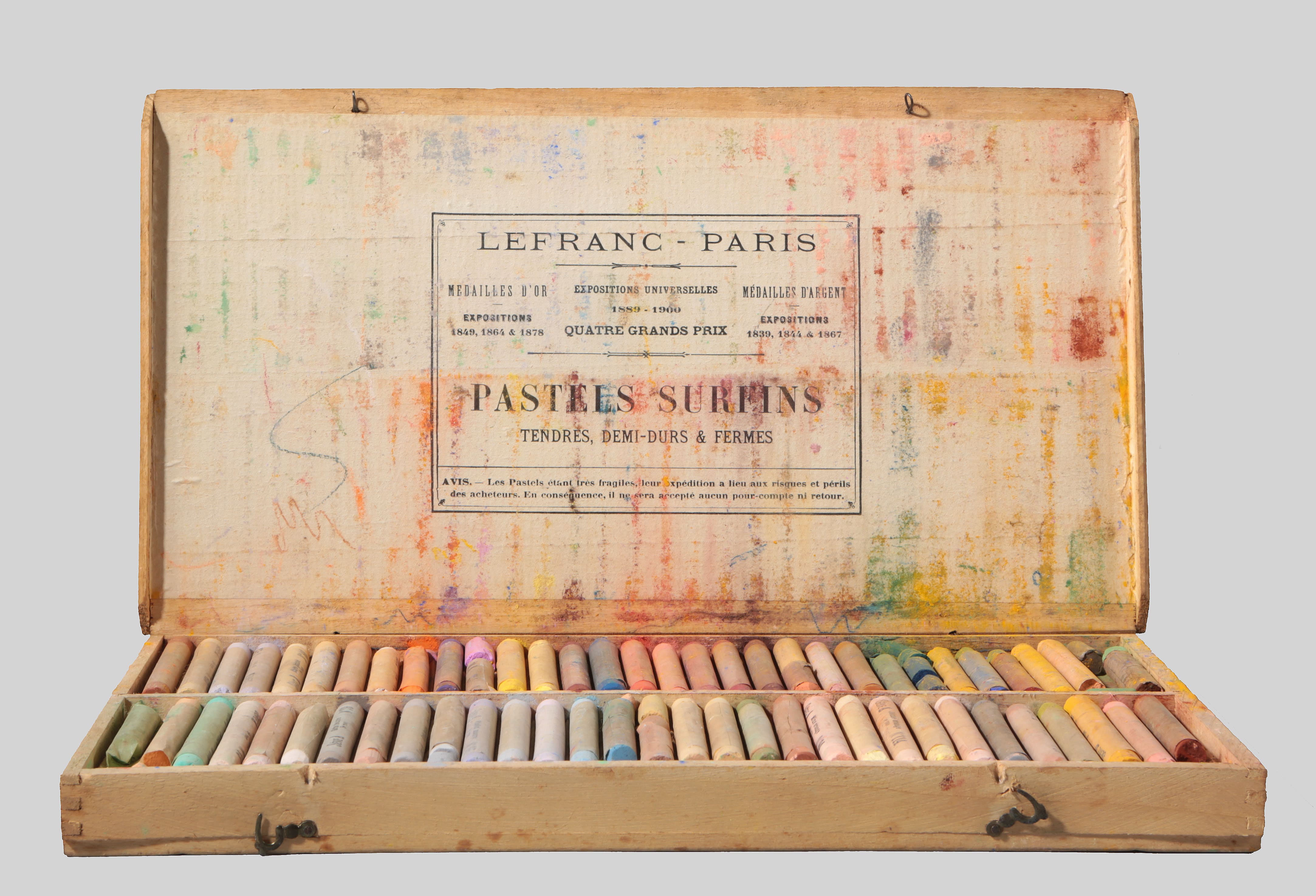
Boîte de pastels de Jean Moulin, don Escoffier-Dubois © Lyliane Degrâces-Khoshpanjeh / musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc - musée Jean Moulin (Paris Musées)
De son côté, Jean Moulin est un habitué des cabinets ministériels, menant une carrière dans l’administration préfectorale avant la guerre. Alors que les Allemands tentent d’avoir sa signature en le torturant, il privilégie le suicide au déshonneur mais est finalement soigné à temps. Il noue alors des contacts avec les « rebelles » jusqu’à, lui aussi, se présenter au général de Gaulle en tant qu’émissaire de la Résistance intérieure. Véritable coordinateur, il essaye malgré les difficultés de structurer les liens avec Londres. C’est aussi un amateur de dessin, ce qui explique ses liens avec Antoinette Sasse, artiste peintre et résistante française dont le legs est à l’origine du musée Jean Moulin inauguré en 1994. Ce goût lui permet d’avoir une couverture officielle : galeriste d’art à Nice où il ouvre un local en 1943. Tout comme Leclerc, il est fait compagnon de la Libération par le chef de la France Libre, Charles de Gaulle, et réussit à réunir le premier Conseil de la Résistance en plein Paris occupé. Ses entreprises sont pour le moins périlleuses et il finit par être arrêté, torturé par différentes Gestapo avant de mourir dans un train l’emmenant en Allemagne.

La 2e Division Blindée place Denfert Rochereau, le 25 août 1944 © Don Franco-Rogelio / musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc - musée Jean Moulin (Paris Musées)
À travers ces différents parcours de vie, le nouveau musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin invite le visiteur à se plonger au cœur de la guerre, où il s’agissait de faire face à des situations exceptionnelles. Loin d’appréhender des faits historiques déconnectés, c’est par le biais de l’individu que l’Histoire est explorée, afin que chacun puisse se projeter dans des tranches de vie tant riches que difficiles. C’est une Histoire humaine, qui permet de prendre une autre mesure de l’écart qui nous en sépare et des liens qui nous y lient. Il ne nous reste donc plus qu’à rendre hommage à ces résistants en se rendant place Denfert-Rochereau pour fêter le 75e anniversaire de la Libération le 25 août prochain ! Une réouverture qui ne pourrait pas faire davantage sens.
Emeline Larroudé
https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr
https://www.parismusees.paris.fr
#MuseeLeclercMoulinLiberationdeParis
#resistance
#secondeguerremondiale
Partez à l'aventure dans les mers du sud avec Jack London, aventurier et écrivain
Je ne vais pas mentir, je n'avais jamais lu aucun ouvrage de London avant d'entendre parler de l'exposition. Enthousiaste à l'idée d'aller découvrir l'exceptionnel voyage de l'aventurier dans le Pacifique sud, je me suis empressée d'aller à la bibliothèque de l'Alcazar pour emprunter un de ses livres. Je suis repartie avec Le peuple d'en bas, récit ethnographique sur … les habitants de l'East end de Londres. Pour l'immersion dans les mers du sud, c'est raté, mais cela me permet de me familiariser avec l'auteur et son écriture. Cette descente dans les quartiers miséreux de la capitale anglaise est d'ailleurs abordée comme une étude ethnographique dans une contrée lointaine. Je l'ai dévoré et au moment où j'écris, je m'apprête à embarquer de nouveau aux côtés de Jack London, cette fois dans le grand nord, grâce au célèbre Croc-Blanc.
Mais revenons à l'exposition. L'aventure commence par un trajet sur la ligne 2 jusqu'à l'arrêt Joliette, puis quelques minutes de marche jusqu'au quartier du Panier où se trouve la Vieille Charité.
Quelques mots sur le lieu d'exposition. La construction de la Vieille Charité a débuté en 1670 dans le but d'accueillir (enfermer, soyons honnêtes) les pauvres. Durant les siècles suivant, le bâtiment sert d'hospice puis est utilisé par l'armée. Au milieu du XXe siècle, la ville de Marseille décide de la rénover, les travaux se terminent en 1986.
La Veille Charité est aujourd'hui un lieu de culture, on y trouve le Musée d'Archéologie Méditerranéenne, le Musée des Arts Africains, Océaniens, Amérindiens (M.A.A.O.A), un cinéma et des expositions temporaires. De son usage premier, le bâtiment a conservé des petites cellules étroites (du moins au rez-de-chaussée).
À bord du Snark, leur voilier, Jack London et son équipage visiteront Hawaï, les Îles Marquises, les Îles de la société (dont Tahiti), les Îles Samoa, les Îles Fidji, les Nouvelles Hébrides et enfin les Îles Salomon, entre avril 1907 et décembre 1908.
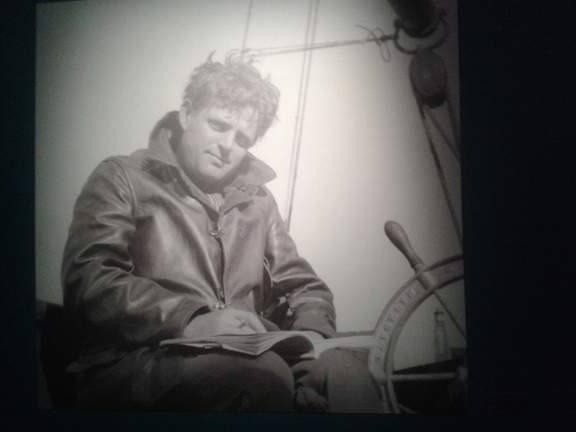
© C. L.
Lorsque l'on pénètre dans l'espace d'exposition, le premier objet exposé est une photo grand format de Jack London. Une première rencontre avec l'aventurier. Juste en face, une grande carte retrace le trajet des London dans les îles du Pacifique, depuis San Francisco jusqu'à la Mélanésie.
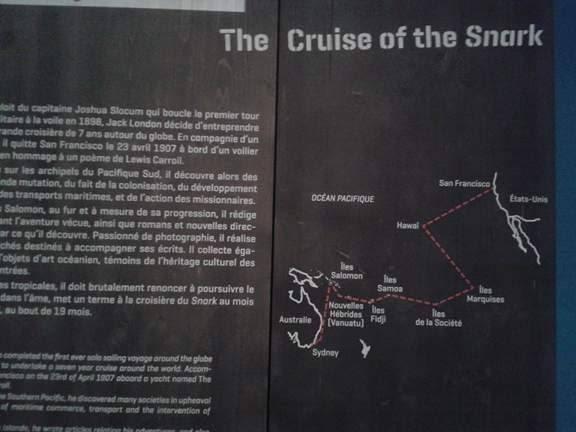
© C. L.
Le parcours est relativement classique mais cohérent et facile à appréhender. Il reprend le trajet effectué par London et son équipage à bord du Snark, son emblématique voilier. Chaque séquence représente une escale et une carte est présente à chaque nouvel espace pour situer géographiquement où l'on se trouve, ainsi que les dates de séjour de nos aventuriers.
L'exposition nous entraîne à la rencontre des peuples autochtones, à travers la présentation d'objets, de photos et de textes écrits par Jack London. À cela s'ajoute des anecdotes sur les conditions de voyage à bord du Snark, notamment les difficultés rencontrées par l'équipage qui manque d'expérience.
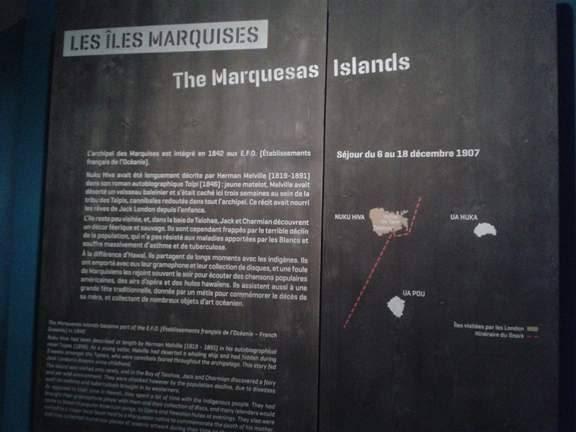
© C. L
D'un point de vue scénographique, la couleur dominante est un vert-bleu rappelant le Pacifique assez réussi. À cela s'ajoute l'utilisation d'un bois foncé qui sert de support aux textes, aux photographies et aux divers objets exposés. Cette teinte met particulièrement en valeur les photographies noir et blanc. L'ensemble est équilibré, la scénographie est assez épurée et au vu du nombre d'objets exposés assez important c'est un bon choix. Dans cet ancien hospice, l'espace d'exposition est divisé en petites cellules qui paraissent vite surchargées. L'exposition se termine dans la chapelle, au centre de la cour intérieure.
© C. L.
Un seul dispositif interactif est proposé dans l'exposition. Il s'agit d'un phonographe, qui s'inspire de celui emmené par notre couple d'aventuriers lors de leur périple, et d'une tablette tactile. À l'aide de cette dernière, les visiteurs peuvent choisir parmi une sélection de chansons, les mêmes que les London avaient choisi pour les accompagner pendant leur voyage. Ce dispositif est intéressant car il permet de découvrir la musique du début du XXe siècle mais également de partager un moment de vie avec les London.

© C. L.
Je regrette qu'une exposition traitant d'un périple aussi exceptionnel ne propose pas une visite plus immersive, alors que le thème s'y prête totalement. Les deux vidéos présentées ne paraissent pas complètement exploitées. Non seulement il n'y a pas de sièges pour les regarder confortablement mais l'une d'elles est sur petit écran (peut-être à cause de sa qualité médiocre). La deuxième, montrant un paysage paradisiaque, donne envie de s'attarder, de se perdre quelques minutes dans les îles du Pacifique, de se laisser gagner par l'ambiance, mais difficile de le faire quand on gêne le passage …
L'exposition dans la forme comme dans le fond manque un peu d'audace, alors qu'elle traite d'un intrépide aventurier. Les récits de Jack London sont de ceux qui font rêver, frissonner, donnent le goût du voyage, une envie d'explorer le monde, de se frotter à l'inconnu, de connaître le danger … Je n'ai pas ressenti cette passion dans l'exposition, qui apparaît alors bien timorée à côté des romans de London. D'autre part, le traitement des collections ethnographiques est très classique. En effet, il me semble essentiel de se questionner sur la mise en exposition de peuples non occidentaux. La représentation de ces cultures et des objets qui s'y rapportent traduit la vision que nous portons sur elles, à aucun la moment la parole n'est donnée aux autochtones que Jack London rencontre dans son expédition.
Cependant, on peut apprécier la transversalité de l'exposition : portrait d'homme célèbre, récit de voyage et ethnographie. Et même si la scénographie est un peu classique, elle m'a beaucoup plu et je l'ai trouvé pertinente au regard de la thématique.
Clémence L.
#marseille
#ethnographie
#voyage
#jacklondon
Pour en savoir plus :
Exposition temporaire au centre de la Vieille Charité à Marseille du 8 septembre 2017 au 7 janvier 2018
https://vieille-charite-marseille.com/expositions/jack-london-dans-les-mers-du-sud

Petit Vade-mecum de la Conservation préventive
Conservation entropique pour œuvre périssable ?
La conservation préventive vise à anticiper et ralentir la dégradation des biens culturels. Des méthodes et des protocoles visant à réduire les effets (climat, lumière, agents biologiques, polluants) permettent de garantir les modalités de stockage et de conditionnement des artefacts. Les pratiques de la conservation préventive couvrent aussi des recommandations de stockage, d’accrochage, d’emballage et de téléchargement. Mais également l’archivage et la documentation en cas de perte ou de vol grâce à des Thésaurus tel que la base TREIMA II et l’Office Central de lutte contre le trafic des Biens Culturels (OCBC), le groupe OVNAAB (pour objets volés de nature artistique d’antiquité et de brocante) ainsi que la base JUDEX. Il existe aussi un système d’alerte
Nous proposons ici de questionner ces pratiques dans les champs de l’art contemporain, afin de mieux cibler au plus tôt les modes de conservations préventives les plus adaptées selon leur contexte et médium. Quelles stratégies adopter selon les œuvres ?
LA CONSERVATION PRÉVENTIVE DANS L’ART “ULTRA”- CONTEMPORAIN EN POINTS CLEFS
Contre le vieillissement, mais pour le vivant ! ou L’art contemporain une histoire (hyper) matérielle à usage de nos crises actuelles
Certaines œuvres d’art contemporaines, par leurs matérialités - des organismes vivants qui se transforment posent question : comment accepter de conserver le périssable ? Le restaurateur est celui qui redonne vit, mais ne doit se poser en traître. Il sauve l’éphémère, mais ne peut rien faire sans les secrets de fabrication. Quand l'artiste est vivant, il rêve qu’il lui transmette son mode d’emploi.
Les nouveaux laboratoires sont constitués d’équipes tout terrains comprenant des : électriciens, taxidermistes, ébénistes, jardiniers, projectionnistes… pour pouvoir tout sauver.
À l’heure où le requin dans le formol de Damien Hirst a déjà été remplacé à l’identique, la question des vernis, des pigments est dépassée par l’accumulation de savoir. L’armada de spécialistes se pose des questions, en pose aux artistes qui n’ont pas toujours des réponses. Les œuvres d’art contemporaines nécessitent un entretien continu et pour ce faire un restaurateur à demeure existe depuis un moment dans des structures aux USA, au Royaume-Unis et en Hollande. En France, si la cathédrale de Strasbourg possède sa maison de chantier à son chevet depuis le commencement de son chantier, les musées ont recours au coup par coup à des spécialistes extérieurs. Ainsi, des œuvres se dégradent dans les réserves et les musées, à défaut de conservation préventive, doivent avoir recours à de lourdes opérations de restauration.
Comment gérer les œuvres d’art contemporaines ? Faut-il repenser le rapport au temps ? Une œuvre d’art se résume-t-elle à son support, aux matériaux employés ? Ou bien à son médium, aux concepts qui la constituent ? En changeant de statut les œuvres ont-elles modifié le rôle des musées ?
Volontés d’artistes - volontés du vivant
Dans les musées, il est très important d’être au contact des artistes vivants. Ce qui constitue un des avantages de l’art contemporain. On peut faire appel à eux. Il s’agit d’une gestion en direct avec les techniciens spécialisés. Pour Catherine Grenier (conservatrice en chef du Patrimoine et historienne de l'art), cela nécessite une réflexion en continu, au moment où l’on achète l’œuvre, au moment où on la présente et au-delà. Quelles seront les meilleures conditions d’expositions? Selon les volontés de l’artiste, elles peuvent être évolutives ou fixes. Il y a aujourd’hui autant de conceptions du devenir de l'œuvre que d’artistes, à l’image des pratiques. Les problèmes d’usures, peuvent par exemple lors de nouvelles expositions de l’œuvre générer de nouvelles contraintes ? Les prises en charge par les mécénats sont cruciales dans ses opérations.

Bianca Bondi, Ectoplasm (son), 2019 dans l’exposition Le Vaisseau d'Or Une proposition de Gaël Charbau à la galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois 36 rue de Seine, 75006 Paris ©Aurélien Mole
Entre réparation mimétique et acception mécanique
Une des premières pièces de Jean Tinguely des collections historiques du centre Pompidou, la méta-mécanique automobile se composait de petits fils de fer rouillé et cassé. Et le centre Pompidou avait demandé à l’artiste s’il pouvait faire quelque chose. Il était alors arrivé avec des morceaux de fer neuf, brillant. Mais ça ne l'intéressait pas de re-faire de la fausse rouille. Il avait alors montré comment il fallait tordre, préparer ses tiges et puis se débrouiller en suivant sa technique après démontage de sa réparation trop brillante. Mais le mécanisme pour remonter la machine était cassé, il n’a pas été remplacé et cette œuvre finalement ne bougera pas, avec l’accord de l’artiste.
Documenter les œuvres dès leur genèse et ou première acquisition
La différence entre la restauration des œuvres de la collection dite historique et la collection contemporaine, est une question de démarche, de réflexion. Comment sont faites les œuvres ? Le comité d’acquisition joue un rôle très important dans cette étape. Il travaille avec les assistantes de conservation, étudie les œuvres en détail. Au moment où l’œuvre rentre dans la collection, elle doit être complètement documentée. Comment l’œuvre a été faite ? Comment l’artiste a trouvé les matériaux ?
Ceci constitue des démarches obligatoires des nouveaux musées d’art contemporain.
Une proposition de réponse à ces problèmes est d’adresser un questionnaire spécifique aux artistes contemporains afin qu’ils livrent le mode d’emploi de leurs œuvres. Afin de combler le manque d’informations par secteurs (art graphique, photographique … ), le questionnaire reste ouvert pour être complété lors de la venue des artistes sur place. L’artiste n’est pas obligé de répondre. Il ne sait pas forcément quantifier les matières qu’il a utilisées lors de la création ou bien ne souhaite pas en faire part.
Les œuvres peuvent être faites de matériaux qui se dégradent extrêmement rapidement et avec des matériaux étrangers aux connaissances des restaurateurs qui travaillent sur des matériaux et œuvres beaucoup plus classiques en adéquation avec la formation qu’ils ont reçue. Faut-il faire évoluer la formation des restaurateurs qui aujourd’hui est divisé par secteurs et techniques ? Ce qui compte c’est l’expérience, c’est souvent du bricolage, comme un antiquaire qui sent le matériau, l’objet afin de le remettre en circulation.
Réseau documentaire
L’œuvre atypique de Daniel Dezeuze de l’époque support-surface témoigne dans son caractère sériel d’évolutions spécifiques aussi nombreuses que le nombre de musées qui la conserve. Il s’agit d’assemblages en réseaux en bandes de placage qui forment des sortes d’échelles. Chaque musée est confronté à des problèmes de vieillissement mécanique : de lacération des bandes de placage, de déformation, d’accrochage, de suspension, de stockage. On a ainsi eu au départ des œuvres à peu près identiques, et maintenant nous avons de nombreuses dérives par rapport au modèle initial, et sont par conséquent de moins en moins homogènes dans leur ensemble.
Aujourd’hui il est important de créer des réseaux où les spécialistes puissent s’informer, afin de ne pas avoir à chaque fois devoir réinventer des solutions, si ces dernières ont été traitées sur des problèmes identiques par d’autres musées. Cela pose la question de la fédération d’un réseau documentaire.
En découle une autre question celle de l’unique et du multiple. Jusqu’à la photographie, une œuvre était en principe unique et autographe. La question du multiple n’est pas la vraie question puisqu'elle est bien antérieure à la photographie si l’on pense aux images imprimées, à la gravure. Mais c’est celle plutôt de l’obsolescence et des œuvres médiatiques. Les matrices sont copiées, mais selon des formats et des standards différents, les soucis de transferts et de téléchargements apparaissent.
Geste artistique et conformité ou divergence du modèle d’origine
Buddha’s Catacomb de Nam June Paik, au musée des sables d’Olonne, acquise en 1996, créé en 1984 avec moniteur bulle des années 1960 tombait en panne. La solution, en accord avec l’artiste, a été de présenter l’œuvre sur un moniteur contemporain de la panne, présentant une image couleur au lieu du noir et blanc. Puis le moniteur JVC a été réparé pour une nouvelle exposition. Puis, le moniteur a été dérobé. La dernière solution de l’artiste fut finalement de refondre une coque selon le modèle d’origine avec un système neuf à l’intérieur. Dans un cas le geste artistique est respecté mais l’œuvre est non conforme, dans le second cas, l’œuvre est plus conforme à l’original mais le geste artistique ready-made du moniteur n’est plus respecté. Ce qui n’est pas sans poser la question des pratiques muséales.
Suivre la vie de l’œuvre
Une mentalité bien ancrée pense que respecter une œuvre suppose de la figer. Une œuvre numérique continue de vivre si on l’a changé de support régulièrement et au bon moment. Cependant l’œuvre ne peut pas être réduite à sa technique. Par exemple les ampoules électriques vont disparaître, beaucoup d’œuvres en sont constituées, comment fera-t-on ? etc … Si on peut le prévoir avec l’artiste, il faut le faire, sinon il faut trouver des solutions possibles afin de rester le plus proche de l’esprit de l’œuvre. Autrement, il faudra déterminer ce qui était le plus important pour l’artiste, et pour le musée ou tout autre responsable de l’œuvre, afin de rendre l’œuvre exposable. Est-ce que c’était de signifier un contexte et dans ce cas il vaut mieux garder l’objet et il n’est pas exposé dans son état initial prévu comme par exemple une sculpture de César dans laquelle une télévision est imbriquée. Nam June Paik, lui n’a pas de soucis pour changer le modèle comme nous l’avons vu. Nous n’avons pas de solutions uniques, mais sont conservées les différentes “peaux” de l’œuvre.
Intégrer la vie, y compris la vie de l’œuvre
Le piano recouvert de feutre de Joseph Beuys a marqué une étape de conservation préventive dans la restauration d’œuvre d’art contemporaine. Avant, les visiteurs pouvant s’approcher du piano, tapotaient les touches recouvertes de feutre. Une proposition a été de retourner le feutre de le doubler tel un col de chemise usé renforcé. Beuys n’a pas du tout aimé la proposition il a donc changé la house, et a créé une nouvelle pièce. La peau et le piano avec sa nouvelle housse constituant ainsi un nouvel ensemble de pièces distinctes.
Intégrer la vie dans l’œuvre, y compris la vie de l’œuvre qui va vieillir, se modifier, voire mourir. Certains artistes programment la mort de leur œuvre, soit si l’œuvre est totalement périssable et disparaît soit on refait l’œuvre et le processus de désagrégation reprend. Pas de solution idéale comme norme, mais essayer de conserver au maximum. On ne peut pas rendre une œuvre vivante comme un humain.
Vanité que la restauration préventive ? Révolte douce que d’échapper à sa fétichisation par le périssable ?
Michel Blazy, peint avec de la Danette en couche infra mince pour obtenir des sortes de laques, glacis. Cependant ce produit est adoré par les souris. Ce type d’œuvre peut “contaminer” le reste de la production. Au Palais de Tokyo, l’artiste, a eu carte blanche en 2007 et comme seule contrainte, celle de ne pas tacher le sol. Il pouvait venir re-alimenter l’ensemble de son œuvre durant toute la durée de l’exposition. Le temps n’épargne rien. Pour Michel Blazy, il est difficile de définir ce qui est vivant ce qui ne l’est pas. Cet artiste travaille donc avec des échelles de temps différentes.
Vendre des kits / dossiers de prévention pour les travaux à base d’aliments ?
L’artiste Michel Blazy fabrique des dossiers afin de re-fabriquer l’œuvre, selon le désir, et l’énergie. Si les conditions ne sont pas réunies, alors l’œuvre restera dans les dossiers, dans cet archivage qui constitue l’œuvre et intègre sa conservation et même l’anticipe par ce format mode d’emploi. Par extension, des enjeux anthropocènes actuels invitent les musées à devenir des bunkers en se prémunissant de guides et kit de suivies voir de survies alimentaires autonomes.
Les contrats : prévoir la conservation des œuvres
Au moment de l’acquisition, il faut prévoir sur les contrats pour les éventuels risques de l’œuvre. Par exemple, les accidents ir-restaurables, peuvent être anticipés par la prise en charge des assurances et le contrat permet d’obtenir que l’artiste re-travail sa pièce en cas d’imprévus, et recréer la pièce manquante en cas d’accident. Ce recours peut être intéressant en cas de rétrospective de l’artiste, s’il y a des difficultés à rassembler des pièces dispersées par exemple. Mais face aux urgences anthropocènes, l’urgence des musées n’est-elle pas de révéler le pouvoir d’action concrète des œuvres plutôt que leurs risques ?
Qu’est-ce que la conservation préventive en quelques points clefs
1 Une gestion a priori lourde mais gérable si anticipée
La restauration a pris de l’ampleur depuis des pratiques artistiques des années 1970. La restauration prévention reste lourde et coûteuse à chaque fois qu’une pièce est prêtée. Mais ce n’est pas une raison de ne pas acheter / acquérir des œuvres sous prétexte qu’elles sont périssables. (La preuve en est avec le travail de Yanna Sterbak. Sa robe de biftecks est facile à refaire, par son mode d’emploi. Certains musées la jettent une fois séchée, d’autres non. On achète la mannequin et le patron. Il faut coudre les biftecks, selon des gabarits de viande approximatifs retenue par un grillage.) On peut se demander ironiquement en cas de situation d’urgence, mais les denrées, surtout d’origine bovine très mal vue actuellement notamment par leur méthane généré, ne seront-elle pas nos réserves alimentaires de demain telles les poires tapées du terroir de Touraine (qui se conservent plus d’une dizaine d’années) ?
2 Qualifier l’œuvre permet de mieux assurer le devenir de l’œuvre et l’usage de savoirs oubliés en cas de crise
La question du statut de l’œuvre est cruciale. Les œuvres sous forme de performances posent la question de la documentation de l’œuvre. Le musée devient par conséquent un accompagnateur d’œuvres en tant que partenaire des artistes dans la conception de ce que va être le devenir de l’œuvre. On remarque que “l’idée de l’œuvre éphémère” dans les années 1970 est pérenne. Cependant des modes de présentation, des processus transcendent l'éphémère.
3 La conservation préventive doit permettre une approche globale afin d’être pertinente et de faire sens.
Elle a pour mission de trouver des modes de présentation qui sont conformes à ce que l’œil contemporain peut voir de la vérité de ses œuvres sans les trahir. La prévention doit donc être inclusive et contextuelle et surtout applicable à l’usage concret de gestions nécessaires à la pérennisation des des collections.
Charlène Paris
Crédit de l'image de haut de page : Michel Blazy, Pull Over Time, exposition du 6 février 2015 au 7 mars 2015 à la Galerie Art Concept
#conservationpréventive
#artcontemporain
#obsolenscencetechnologique
Pour aller plus loin :

Plans-reliefs et questionnaire de Woolf
Aujourd’hui, notre journaliste retrouve Monsieur Plans-Reliefs du Palais des Beaux-Arts de Lille, pour un questions-réponses un peu décalé.
Coline C. : Bonjour Monsieur Plans-Reliefs.
Plans-Reliefs : Bonjour, Bonjour.
CC : Monsieur, nous allons procéder à une série de questions réponses dont le but est d’être le plus naturel possible, vous êtes prêts ?
PR : Tout à fait, c’est parti !
Monsieur Plans-Reliefs se tenant prêt face à nos questions © CC
CC : Les livres marquants de la bibliothèque de vos parents…
PR : Gargantua : cette manière de voir le monde de haut me faisait beaucoup rire.
CC : Les lieux de votre enfance ?
PR : Laissez-moi réfléchir… Dunkerque je crois, oui, Dunkerque. Le marquis de Louvois était alors secrétaire d’Etat à la guerre et avait demandé à Vauban de réaliser un plan-relief de la ville, pour imaginer les fortifications des villes conquises ou en passe de l’être par la couronne française. Moi je me rappelle des dunes, et des premiers bouts de carton.
CC : Dites-moi, avec qui aimeriez-vous entretenir une longue correspondance et pourquoi ?
PR : Les cartes IGN en relief, leur vision naturelle de la géographie m’émeut. Pour moi il s’agit plutôt d’aménagement du territoire, de logique de circulation et de stratégie militaire. Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous apprendre.
CC : Que faites-vous dans vos périodes de dépression ?
PR : J’imagine toutes les façons de me détruire : adopter un bataillon d’insectes xylophages, me mettre à fumer, déjouer le système de climatisation pour causer une fuite d’eau…
CC : Et dans vos périodes d’excitation ?
PR : Je pilote une drône et je regarde le monde devenir mon propre plan-relief.
CC : Votre remède contre la folie ?
PR : Je lis tout ce qui me passe par la main ! J’ai un accord secret avec les gardiens du musée qui m’apportent un peu de leur bibliothèque personnelle, je glane deux trois titres dans les sacs des visiteurs et je demande au personnel de nettoyage de me les emprunter à la bibliothèque. Bien entendu, ma proximité avec la bibliothèque du PBA m’aide aussi beaucoup.
CC : Dans le cas où vous créez une maison d’édition, qui publiez-vous?
PR : Prévert pour rire, un type qui écrit « Quelle connerie la guerre », ce doit être un type chouette.
CC : Vous tenez salon, qui invitez-vous ?
PR : J’ai un goût certain pour l’exploration donc Abd al-Rahman al-Sufi, pour l’amour de la cartographie, la famille Cassini pour les relevés, Bill Ingals pour ses photographies de l’espace. Il y a là tout un univers à découvrir, c’est passionnant.

Monsieur Plans-Reliefs en grand moment de réflexion © CC
CC : Le secret d’un couple qui fonctionne ?
PR : Une heure de TGV entre les protagonistes.
CC : La chose indispensable à votre liberté ?
PR : Les horaires de fermeture du PBA. Ça fait du bien.
CC : Le deuil dont vous ne vous remettrez jamais ?
PR : Les villes que j’ai perdues lors du bombardement du musée des armes et de la guerre à Berlin lors de la Seconde Guerre mondiale. J’ai passé effectivement une partie de ma vie en Allemagne.
CC : C’est un peu intime mais, que trouve – t – on de particulier dans votre chambre ?
PR : Des étoiles phosphorescentes au plafond et une tapisserie que je n’ai jamais eu le temps finir.
CC : A quoi reconnait-on un ami ?
PR : Au regard qu’il porte sur vous. Et à ses pinceaux et ses micro-aspirations. Au temps qu’il ou elle met à vous remettre sur pieds.
Détails sur des ponts lors de la restauration des plans de Tournai par les « amies » de Monsieur Plans-Reliefs © CC
CC : Qui occupe vos pensées nuit et jour ?
PR : Une aiguière à casque bleue et blanche dans le département des objets d’art au rez-de-chaussée du musée. Elle veille sur moi, je veille sur elle.
CC : Vous démarrez un journal intime, quelle est la première phrase ?
PR : Cejourd’huy, vingt-quatriesme jour du mois d’avril 1668, j’ai commencé mon journal pour narrer comment moi, plan-relief sis en ceste bonne ville de Lille, voulus dire les mémoires de ma vie…
CC : Monsieur Plans-Reliefs, merci beaucoup de votre sincérité et de votre spontanéité.
PR : Mais je vous en prie. Si je peux vous être utile en quoi que ce soit, vous pourrez me retrouver au sous-sol du PBA de Lille aux horaires d’ouverture du musée.
Coline Cabouret
#plansreliefs
#hybridité
#stratégie
Pour plus de renseignements au sujet des collections de plans-reliefs en France:
http://www.pba-lille.fr/Collections/Chefs-d-OEuvre/Plans-Reliefs
http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/index.php/le-musee/presentation-de-la-collection/histoire
Un chaleureux remerciement à Florence Raymond pour sa patience et son attention à l’article, ainsi qu’à Alain Mercier, pour la traduction du journal intime dans la langue de Molière.
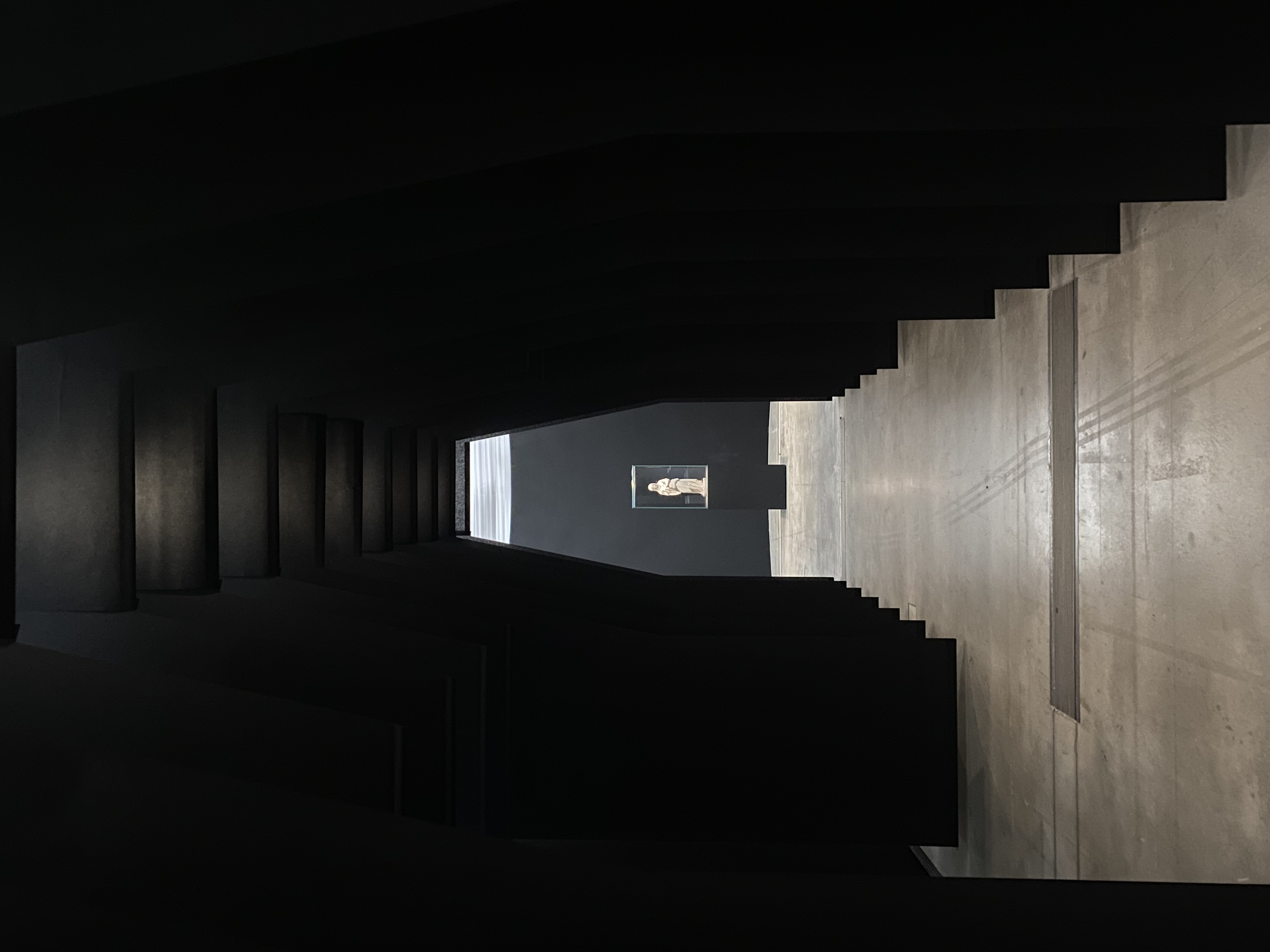
Plongez au fond du gouffre
« Quand on lutte contre des monstres, il faut prendre garde de ne pas devenir monstre soi-même. Si tu regardes longtemps dans l’abîme, l’abîme regarde aussi en toi. » Friedrich Nietzsche, Par-delà le bien et le mal,1886.
Exposition « Mondes Souterrains » au Louvre Lens, mars 2024 © EK
C’est au Louvre Lens, au cœur du bassin minier, que se déroule du 27 mars au 22 juillet 2024 l’exposition « Mondes souterrains. 20 000 lieux sous la terre ».
Imaginé par Alexandre Estaquet-Legrand (conservateur) et Jean-Jacques Terrin (architecte), le parcours commence par les tréfonds de la terre, il immerge dès l’entrée le visiteur dans le plus lugubre et sombre qu'il puisse connaître. Accueilli par la Sybille d’Érithrée de Jean-Jacques Caffieri, le message divin est clair : laissez-vous emportez dans les entrailles d’un monde redouté et inconnu. De par l’immensité du sujet, l’exposition explore par ses quelques 200 œuvres des mythes de différents temps, tout en les reliant à notre époque et au territoire minier.
Un monde énigmatique permettant la création

A gauche : Nathanaël Schaeffer et Julien Aubert, Visualisations issues de simulations numériques du processus de convection et champs magnétiques dans le noyau terrestre, CNRS, 2016-2023 © EK
A droite : Nathanaël Schaeffer et Julien Aubert, Visualisations issues de simulations numériques de la température du noyau terrestre dans le plan de l’équateur, CNRS, 2016-2023 © EK
Le monde souterrain est source de questionnements depuis l’Antiquité. L’exposition retrace l’évolution des perceptions de ces territoires par des œuvres représentant cette géographie hostile, insolite et inconnue. Ainsi, le visiteur peut voir aussi bien la Vue d’une grotte de Jean-Augustin Franquelin que de véritables images de la température du noyau terrestre effectuées par deux chercheurs du CNRS Nathanaël Schaeffer et Julien Aubert.
Tous les orifices de la terre sont exposés : grottes, volcans, cratères... Cet espace est source d’imagination, il incarne la peur, la curiosité et s’immisce dans nos plus lointains cauchemars. Qui n’a jamais eu peur d’entrer dans une grotte étant enfant ? L’exposition permet d’invoquer doutes et souvenirs, d’appeler une imagination débordante, et celle que manifeste aussi une littérature illustrée de Germinal d’Emile Zola à Alice aux pays des merveilles de Lewis Carroll. Plus proche de nous, les grottes deviennent les abris de dessins, de contes enchanteurs, elles s’invitent dans les villas romaines et deviennent le genre grottesche de décors.
Aux tréfonds de la Terre

Gardien de tombeau, Chine.
Que se passe-t-il sous terre ? Telle est la question que soumet l’exposition. Au détour d’un gardien de tombeau de la dynastie des Han de l’est, le visiteur découvre ce monde souterrain investi par les humains, les monstres ou toute autre créature mythologique.

Maurizio Catalan, Mother, 1999 © EK
L’Au-delà est à portée de main par une photographie de Catalan, illustratrice de la crainte viscérale d’être enterré vivant. Nos corps investissent ces terres depuis des siècles. Après cette mort, imposée ou naturelle, la descente aux enfers est irrévocable ; peu importe les croyances ou l’époque, l’enfer a toujours existé, comme le montre l’exposition. Créatures informes, protectrices ou cruelles, les statues, peintures ou objets de cultes permettent d’observer que de tout temps et en toutes civilisations, l’humain pense à l’après vie et souhaite honorer ses défunts afin de, peut-être, avoir une mort plus douce.
Une terre nourricière
L’exposition permet au visiteur de prendre conscience de la richesse de nos profondeurs, de sa fertilité. En effet, cette terre créatrice est mise en valeur par un cabinet de curiosités regroupant des fossiles, pierres précieuses, métaux ou encore ossements. Ces trésors participent à la beauté de ce que l’homme peut créer mais aussi à l’innovation de notre société. Le choix de dévoiler des gemmes, des minéraux, au sein d’une exposition principalement picturale interpelle, permet une pause dans la contemplation et ravive l’éblouissement.
Cueillir les fruits de nos entrailles est le labeur des mineurs, cette mise en valeur rappelle l’implantation du musée. Le mineur brave les dangers, et remonte une source d’énergie de nos sous-sols, au péril de sa vie. Moins profond, les constructeurs de métro du XIXè siècle ponctuent la fin du voyage sous terre dans cette exposition. L’innovation et la modernité reviennent, les mythes sont laissés au temps du passé, l’humain investit les profondeurs pour exploiter la terre selon ses exigences.
L’exposition n’analyse pas les dérives liées au travail des mines de charbon, ou plus récemment de métaux et de sables. Son seul angle est l’héroïsation du mineur. De simples faits historiques sont relatés, ils ne sont pas transposés aux déboires du monde actuel. Il est vrai d’écrire « Aujourd'hui, d'audacieux projets se déploient dans les sous-sols des villes contemporaines. Certains chercheurs et urbanistes pensent que là se situe l'avenir de la vie urbaine. » Car à l’aube de grands fléaux (guerres, crises environnementales et sociales), les mondes souterrains seront probablement les refuges de demain. Ils le sont en ce moment même, certaines populations du monde telles que les Ukrainiens ou les Australiens ont recours à ces mondes souterrains, les uns pour se protéger des bombardements, les autres pour échapper à la chaleur. A l’heure où des milliardaires investissent dans des bunkers-palaces afin de fuir un monde auquel ils ont participé, les 99,9% restants de la population mondiale s’engouffrent dans des métros insalubres. L’exposition n’évoque pas les conditions de travail déplorables des mineurs du monde contemporain. Pour autant, elle permet d’admirer toutes ces beautés exposées, de faire une pause dans ce monde parfois désespérant.
Le Louvre Lens ravit par tant d’œuvres exposées provenant de toutes disciplines, les sciences, l’archéologie ou les arts visuels. Pour autant, cette multitude d’informations visuelle et mentale peut perdre le visiteur, malgré un parcours très structuré. Des mythes, des dieux, des philosophies évoqués ne sont pas expliqués en profondeur. C’est un visiteur à l’œil aguerri et familiarisé au sujet qui appréciera certainement sa visite. Les œuvres exposées, 200, pour être appréhendées nécessiteraient une seconde visite.
Élise Klein
Pour en savoir plus :
Horaires d’ouvertures :
Du mercredi au lundi : 10h – 18h
Fermeture des caisses à 17h15.
Fermé le mardi et certains jours fériés (1er janvier, 1er mai et 25 décembre)
#Mondes souterrains #LouvreLens #Mythes

Protéger le patrimoine en péril : l’action de l’ALIPH pour la sauvegarde de notre mémoire commune
À l’heure de conflits mondiaux, catastrophes naturelles et changements climatiques, le patrimoine culturel est plus que jamais en péril. Qui sont les acteurs qui participent à sa sauvegarde ? L’ALIPH, l'Alliance Internationale pour la Protection du Patrimoine, en fait partie. Lors d’un entretien avec Elke Selter, directrice des programmes de l’ALIPH, j’ai découvert l’ampleur de leurs actions et leur rôle fondamental dans la protection et reconstruction de la richesse culturelle mondiale.
Photographie : Metal work Bala Hissar citadel © AKTC.
Une organisation internationale née de l’urgence
L’ALIPH - acronyme désignant la première lettre de l’alphabet arabe - a été créée en 2017 par la France et les Émirats Arabes Unis, suite à la destruction massive du patrimoine culturel en Syrie, en Irak et au Mali. L'objectif principal de cette organisation est de créer un instrument flexible, capable de répondre rapidement aux menaces sur le patrimoine. L’ALIPH, de par sa structure agile et petite, permet d’intervenir dès les premières menaces, pour protéger les sites culturels en danger.
La fondation est basée à Genève et fonctionne grâce à un financement mixte public-privé, incluant des États membres et des donateurs privés. Elle joue un rôle central en agissant comme pont entre différentes zones d’influence et en récoltant des fonds sur des cycles de 5 ans pour soutenir ses projets.

Al-Omari Mosque from the side of Al Qaisariyya Souq, Gaza Strip, Palestine, January 2025 © RIWAQ.
Des projets de sauvegarde et de reconstruction
Le rôle de l’ALIPH est de fournir des financements et un appui technique à des organisations locales, qui sont les mieux placées pour intervenir sur le terrain. Ainsi qu’un soutien scientifique et politique quand nécessaire.
En matière de relations politiques, l’ALIPH établit des liens avec les autorités locales et religieuses des zones concernées. Bien que l’organisation soit neutre et non gouvernementale, elle se tient à ce que les gouvernements soutiennent un projet de protection du patrimoine.
Parmi les projets soutenus par l’ALIPH, plusieurs ont marqué les esprits. En Irak, l’ALIPH a financé la reconstruction de cinq temples yézidi détruits par Daech. Ces sites ne sont pas seulement importants pour la communauté yézidi mais également pour l’histoire de l’Irak et du monde. En Ukraine, l’ALIPH a contribué à la préservation du patrimoine, en envoyant des matériaux par exemple, un enjeu essentiel dans un contexte de guerre.
Les projets ne se limitent pas uniquement à la restauration de bâtiments. L’ALIPH intervient également dans la lutte contre le trafic illicite d'artefacts, la conservation d'archives ou encore la numérisation de monuments.
Documentary heritage Djenné, Mali, 20 February 2024 © Tiecoura N’Daou.
L’importance de préserver le patrimoine : un enjeu pour l’identité et l’avenir
La protection du patrimoine est essentielle pour plusieurs raisons. Il joue un rôle crucial dans l'identité historique d'une communauté. Les monuments, les bâtiments historiques et les sites archéologiques sont des témoins tangibles de l'histoire et permettent aux générations futures de se connecter à leurs racines. Cela permet de ne pas perdre les traces du passé à cause d’une guerre ou de désastres, et de soutenir ceux et celles qui prennent de grands risques pour protéger ces monuments.
De plus, la préservation du patrimoine contribue à la cohésion sociale en offrant des lieux où les habitants peuvent se rencontrer et interagir autour de leur histoire commune, Mossoul en est un exemple concret. La revitalisation des quartiers historiques ou des sites religieux renforce également l’attractivité touristique, créant ainsi des emplois et des revenus pour les communautés locales.

Tutunji House, Mosul, Iraq, November 2021 © University of Pennsylvania.
Aujourd’hui, la préservation du patrimoine est confrontée à des défis de plus en plus complexes, notamment avec les changements climatiques et les conflits. L’ALIPH, par exemple, élargit son champ d’action pour inclure les sites menacés par les impacts environnementaux, en particulier en Afrique, où un premier appel à projets a été lancé pour protéger le patrimoine face aux changements climatiques. En 2025 l’organisation entend ainsi élargir son champ d’action au-delà des zones de conflit pour inclure d'autres sites vulnérables à l’érosion, aux incendies ou aux inondations.
Un engagement global pour le patrimoine
Le rôle de l’ALIPH est crucial dans la sauvegarde des monuments et des sites culturels menacés. Par son action rapide et agile, elle permet de répondre efficacement aux urgences et de restaurer des symboles forts de l’identité et de l’histoire des peuples. Au-delà de la simple conservation, il s'agit de garantir que ces trésors culturels restent vivants et pertinents pour les générations futures. En collaborant étroitement avec les autorités locales et les communautés, l’ALIPH contribue à une meilleure préservation du patrimoine mondial, tout en valorisant l’expertise des populations, en leur donnant les moyens de protéger leur héritage.
Le travail de l’ALIPH peut être présenté dans des expositions photographiques, comme “Portraits de femmes - Au-delà des pierres “ à l'abbaye de Neimenster au Luxembourg.

Portrait of Rana Salih, Mosul, Iraq, 15 December 2024 © Yunis Qais.
Elise Klein
En savoir plus :
- Tous les projets effectués par l’ALIPH, terminés ou en cours : Nos projets | Aliph Foundation - Protéger le patrimoine pour construire la paix
- Découvrez l’exposition “Portraits de femmes – Au-delà des pierres” : Portraits de femmes_FR by ALIPH Foundation - Issuu
Photographie de vignette : Red Chamber, Khanenko Museum © Yurii Stefanyak
#histoire #sauvegardedupatrimoine #organisationinternationale

Quand l'art contemporain s'invite dans les églises : entre opportunités et polémiques
Chœur de l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce du Plateau d’Assy – Image disponible sur http://www.rhone-alpes.culture.gouv.fr/
L’art abstrait comme terrain d’entente
Tous les coups ne sont pas permis. La liberté d’expression restant tout de même limitée, les artistes et l’Église semblent trouver un terrain d’entente : l’art abstrait. La recherche de spiritualité à travers l’immatérialité rejoint la philosophie de chacune des parties. Il est alors plutôt question de sacré que de religieux. De son côté, le clergé récipiendaire, qui souhaite se détacher d’un art arrogant et triomphaliste, accueille aisément la légèreté de cet art dont la forme abstraite évite l’engagement de débats théologiques.
Commandes d’Etat et polémiques
Pour exemple, entre 1999 et 2004, le discours artistique iconoclaste de l’artiste Claude Rulault était entré en confrontation avec l’avis des paroissiens de l’église de Saint-Prim en Isère. Il repeint le chemin de croix de la même couleur que le mur, couvre de draps les statues des saints et décore les jours de stores aux couleurs primaires. A Jabreilles-les-Bordes en Haute, l’artiste Philippe Favier teste pour la première fois en 2004 l’installation de vitraux-lithophanies, de la porcelaine en fine couche peu translucide ne laissant passer qu’une lumière tristement terne au grand désespoir des fidèles, impuissants.
Intervention de Claude Rutault à l’église Saints-Prim-et-Félicien de Saint-Prim – Image disponible sur https://saintprim.fr/
Ces lieux hautement symboliques sont également le terrain de jeu sournois d’installations contemporaines temporaires provocatrices. La ruse est de créer une œuvre dont le sujet s’accorde avec la tradition chrétienne, de l’envelopper d’un discours moralisateur allant dans ce sens, mais dont l’aspect visuel contredit habilement la proposition. Ce fut le cas notamment de l’œuvre Heaven de Philippe Perrin, exposée en 2006 dans le chœur même de l’église Saint-Eustache. L’œuvre consiste en une couronne d’épines géante en barbelés posée à terre. Les paroissiens l’ont interprété comme un Christ moderne assumant sa souffrance avant la résurrection. Sauf qu’en posant la couronne au sol et en agrandissant ses dimensions, ce cercle de fer allait à l’encontre de l’image de la résurrection tournée vers le ciel, et était perçu plutôt comme une idole que comme un symbole. Son titre Heaven faisait référence à la chanson Stairway to Heaven de Jimmy Page qui, écoutée à l’envers, devient « Highway to Hell », c’est-à-dire « ceux qui proclament le ciel sont ceux qui créent l’enfer sur terre. »
PERRIN Philippe, Heaven, installation à l’église Saint-Eustache de Paris, 2006 © Marc Dommage. Courtoise Galerie Pièce Unique
Des collaborations réussies
Ces dernières années se développent également des interventions plus pérennes. Un exemple précoce est la Kunst-Station à l’église Saint-Pierre de Cologne où, depuis 1987, cohabitent grâce à un comité consultatif des cérémonies religieuses et expositions, ces dernières servant généralement d’outil de réflexion aux homélies. À la chapelle Notre-Dame-du-Marché à Jodoigne (Belgique), ont été installé une tribune télescopique motorisée d’une capacité de cent places, une scène composée de praticables, des cimaises contre les murs de la nef et un équipement de son et lumière pour pouvoir accueillir toute une programmation de concerts et expositions d’art contemporain, parallèlement aux offices qui continuent d’être célébrés.
Exposition et vue sur la tribune télescopique, chapelle Notre-Dame-du-Marché de Jodoigne – Image disponible sur http://www.culturejodoigne.be
Une nouvelle source d’opportunités
L’Église a en effet de bonnes raison d’ouvrir ses portes aux artistes contemporains. Durant des siècles, elle fut l’un des commanditaires majeurs des artistes, faisant défiler au sein de ses murs la succession des styles artistiques, de l’art paléochrétien à l’art contemporain. Au fil des époques, elle n’a cessé d’accorder une importance particulière aux artistes, pour des raisons variées. Aujourd’hui, les interventions artistiques permettent de débloquer des financements et sauver certains édifices voués à la destruction ou l’abandon mais aussi d’accueillir un nouveau public dans ces lieux qui se vident petit à petit. Ces interventions sont également souvent perçues comme des aubaines pour les élus et le secteur touristique. C’est alors toute une myriade de collaborations qui prennent forme entre associations diocésaines, conservateurs, galeristes, opérateurs artistiques et touristiques, municipalités, Régions, Ministère de la Culture, FRAC et bien d’autres encore.
Laurence Louis
#ArtContemporain
#Eglises
#LieuxSacrés

Quand la ville raconte son histoire
Lorsque je voyage dans une nouvelle ville, j’aime aller visiter le musée d’histoire de la ville. Cela me permet de mieux comprendre le lieu où je suis et d’adopter un autre regard lors de mes visites les jours suivants.
Quand j’ai eu l’occasion d’aller à Luxembourg, je n’ai pas dérogé à cette habitude.

La devanture du musée © Fanny DAVIDSE
C’est donc avec curiosité que je pénètre dans Lëtzebuerg City Museum pour y découvrir l’histoire de cette belle capitale européenne, du Moyen Âge à nos jours, et poussant même au-delà avec les projets à venir. Il a ouvert en 1996 et a déjà subi des modifications sur son parcours muséographique et scénographique en 2007. Une deuxième rénovation a été effectuée en 2017.
Ce musée est intrigant car il montre les ambivalences qui peuvent se dégager après une rénovation : la beauté de la nouveauté et la nécessité d’améliorer continuellement quelques détails.
Il y a trois espaces d’expositions : une exposition permanente sur quatre niveaux, une exposition temporaire sur un niveau et une exposition des collections sur un niveau qui ouvrira en octobre 2018. Je souhaite partager avec vous mon expérience de visite de l’espace d’exposition permanente.

Une salle intitulée « La ville et ses habitants © Fanny DAVIDSE
Le musée a adopté un parcours qui se voit de plus en plus dans les musées récemment rénovés : le début de la visite se trouve en sous-sol, la première action du visiteur est donc de descendre pour commencer le parcours puis il remonte au fur et à mesure les niveaux vers la surface. Ce type de déambulation pour un musée d’histoire paraît efficace puisqu’il suit la chronologie, mais je me suis sentie déstabilisée à l’entrée de la visite, qui se situe plusieurs niveaux au-dessus. La signalétique joue alors un rôle crucial.

Une salle intitulée « Eglises, couvents et monastères » © Fanny DAVIDSE
Un code couleur est attribué à chaque niveau et un panneau principal indique la suite de la visite à chaque changement de niveau. Le panneau donne une indication claire avec un graphisme épuré. Cependant, une fois passé ce panneau, la signalétique se réduit en taille, apparaît au sol et passe presque inaperçue aux yeux du visiteur. Les salles offrant bien souvent deux accès pour y entrer et en sortir, je me suis retrouvée à certains moments en contresens de la visite chronologiquement établie.

La signalétique du parcours de visite © Fanny DAVIDSE
Les textes présents dans l’exposition ont su combiner le trilinguisme adopté tout au long du musée (français, allemand, anglais) avec un propos historique concis et percutant en une quinzaine de lignes. Ils apportent l’essentiel historique et restent visuellement légers.
Par ailleurs, trois niveaux de textes sont repris tout au long de l’exposition. Un premier niveau retraçant une période historique, puis un deuxième expliquant un point historique durant cette période et enfin un troisième détaillant ponctuellement les objets en vitrine. Un autre niveau, sous une forme de macaron donne un explicatif architectural sur les parties du musée appartenant à l’ancien bâti. Il y a une excellente complémentarité entre tous ces éléments.
Du côté de l’action du visiteur, il y a une grande part de lecture des textes et d’observation des objets et œuvres présentés. Quelques tiroirs contenant des œuvres fragiles viennent agrémenter la visite, ainsi que des écrans tactiles et dispositifs audio. J’ai beaucoup apprécié la déclinaison du principe d’observation, par le biais de jumelles, d’animation numérique ou de clapet à soulever.
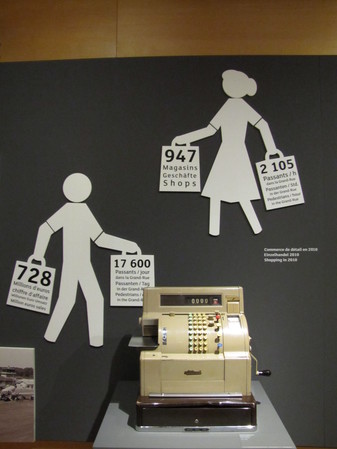
La présentation graphique des data-données © Fanny DAVIDSE
La séquence sur l’histoire contemporaine et la ville actuelle est rythmée de data-données et joue énormément sur la retranscription visuelle et schématique du texte. Un réel effort est présent pour éviter la pure position contemplative du visiteur généralement présente dans les musées d’histoire. Cette facette pourrait être encore plus exploitée, notamment sur des notions complexes ou des points clés de l’histoire de la ville.
Le musée transmet de manière dynamique les clés de compréhension sur la ville. En dépit d’un parcours parfois chaotique, je suis ressortie satisfaite de ce voyage dans le temps. Mes bagages historiques en main, j’étais prête pour visiter les célèbres Casemates, galeries souterraines témoignant du passé de la ville-forteresse.
Fanny Davidse
#museographie
#histoire
#ville
Pour en savoir plus sur le Lëtzebuerg City Museum : http://citymuseum.lu/
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
Quand nos cimetières abritent le matrimoine
Pour une réhabilitation de la notion de matrimoine
Les termes “héritage culturel” et “patrimoine culturel” sont souvent considérés comme équivalents dans la langue française. Étymologiquement, le mot patrimoine vient de “pater” qui signifie “père” en latin. Or, notre héritage culturel ne se résume pas uniquement à ce que nous ont transmis nos “pères”. Le mot “patrimoine” laisse par contre tout un pan de notre culture : celle portée par nos "mères''. Or, les productions des inventeurs, écrivains, chanteurs, compositeurs, sculpteurs, ou encore industriels sont bien plus documentées et mises en lumière que celles des inventrices, écrivaines, chanteuses, compositrices, sculptrices, industrielles, etc. Des femmes, parfois reconnues pour leurs œuvres ou travaux à leur époque, ont été oubliées en quelques décennies.
Image de couverture : Extrait du spectacle Celles d'en dessous © Laure Fonvieille
La notion de matrimoine existe depuis le Moyen-Age mais elle tombe en désuétude au profit de la notion de patrimoine. Depuis une vingtaine d’années, le terme matrimoine est réhabilité pour souligner le rôle que les femmes ont joué dans le développement culturel. L’association Homme-Femme Île-de-France (qui lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes dans les milieux de l’art et de la culture) crée en 2015 les “Journées du matrimoine”. Cet événement entend valoriser l’héritage invisibilisé des précédentes générations de femmes. Il se déroule désormais tous les ans le week-end de la troisième semaine de septembre en écho aux “Journées européennes du patrimoine”.
Une visite atypique proposée par la Cie “La Mort est dans la Boîte”


Extraits du spectacle Celles d'en dessous: Sophie Renou interprète Elisa Bordillon (à gauche) Emmanuelle Briffaud joue Pauline Isabelle Lefèvre-Utile (à droite) © Guillaume Gatteau
Les spectateur.rice.s quittent Madame Lefèvre-Utile pour faire la rencontre de l’excentrique Topette, jouée par Camille Kerdellant. Topette est issue de la grande bourgeoisie nantaise. Chanteuse de rue dans les années 1920, elle formait avec sa sœur le duo “Topette et Carafon”. Titubante, elle accueille les spectateur.rice.s une flasque à la main. Son discours est confus. Elle interpelle les visiteur.euse.s, les provoque, les amuse avant de leur livrer un terrible secret. Fantôme extravagant, elle disparaît subitement en chantonnant entre deux gorgées d’alcool.
La visite se poursuit dans un nouvel espace du cimetière. C’est alors à Yvonne Pouzin-Malègue (1884-1947), jouée par Hélène Vienne qu’est rendu hommage. Elle explique aux visiteur.euse.s comment elle a dédié sa vie à la médecine. Elle soutient sa thèse en 1916 et trois ans plus tard elle devient la première femme médecin des Hôpitaux de France. Elle se consacre alors pleinement au traitement de la tuberculose.


Extraits du spectacle Celles d'en dessous : Camille Kerdellant joue Topette (à gauche) et Hélène Vienne incarne Yvonne Pouzin-Malègue (à droite) © Guillaume Gatteau
La déambulation spectacle se finit sur la tombe de Colette Robertin (1946-2012). La comédienne Manon Payelleville retrace aux visiteur.euse.s la vie et les combats de cette éducatrice et militante de gauche décédée il y a quelques années.
Celles d’en dessous est un spectacle original qui rend hommage aux femmes inhumées au cimetière Miséricorde. Il propose aux spectateur.rice.s de se plonger dans la vie de cinq femmes aux parcours différents qui ont laissé leurs traces chacune à sa façon. Chaque micro-récit s’ancre à un moment clé de leur vie tout en renvoyant à des événements post-mortem. Par exemple, le personnage de Pauline Isabelle Lefèvre-Utile évoque l’évolution de l’entreprise LU après sa mort tandis que le personnage de Yvonne Pouzin-Malègue fait allusion aux progrès de la médecine dans le traitement de la tuberculose. Ces anecdotes ramènent ponctuellement les spectateur.rice.s dans leur époque et assurent le lien entre “celles d’en dessous” et “celleux d’au-dessus”.

Extrait du spectacle Celles d'en dessous, Manon Payelleville incarne Colette Robertin © Guillaume Gatteau
La petite histoire du projet Celles d'en dessous
Le projet Celles d'en dessous naît en 2019 de la rencontre entre Nathalie Bidan et la compagnie « La mort est dans la boîte ». Laure Fonvieille, directrice artistique de la compagnie et metteuse en scène de Celles d’en dessous explique : « Nathalie Bidan est chargée de la valorisation du patrimoine funéraire rennais. Intriguée par le nom de notre compagnie de théâtre, elle a imaginé que nous ne serions pas effrayées à l’idée de faire du théâtre dans un cimetière. Elle avait vu juste ! » [propos recueillis par Elise Franck] C'est ainsi que Laure Fonvieille a imaginé le projet Celles d'en dessous qui entend valoriser les femmes du passé mais aussi donner à voir les cimetières comme des lieux de mort, de vie, de promenades, de mémoire et d’histoire. La première représentation a eu lieu en juin 2019 au Cimetière de l’Est, à Rennes.
Depuis, d'autres spectacles ont été programmés dans les cimetières de Nantes, Rennes et Strasbourg. Si les spectacles sont sur mesure, la démarche est toujours la même. La compagnie effectue une visite du cimetière qu'elle compte investir. Elle repère une dizaine de sépultures. A partir de ce repérage, un choix est arrêté en fonction du contenu qui peut être délivré sur les personnes inhumées et du parcours qui peut être créé entre les tombes.
Afin d’écrire la pièce, la metteuse en scène entame une première phase de documentation grâce à la bibliographie et aux archives existantes sur les protagonistes. Pour le spectacle au cimetière Miséricorde de Nantes, Agathe Cerede, stagiaire au patrimoine funéraire de la ville de Nantes a accompagné dans la compagnie dans ses recherches . Laure Fonvieille a interviewé les associations et les familles des défuntes pour nourrir la pièce. Les textes des pièces sont écrits par Laure Fonvieille mais aussi Manon Payelleville, Sophie Renou et Camille Kerdellant.
Valoriser le matrimoine en ligne.
D'autres initiatives, notamment sur internet émergent pour entretenir la mémoire de ces femmes dont on parle peu ou plus. Le collectif Georgette Sand a par exemple mis en place le Tumblr “Invisibilisées”. Ce Tumblr s’apparente à une base de données valorisant les femmes évincées des manuels d’Histoire ou de sciences. Camille Paix, quant à elle, alimente régulièrement son compte Instagram “Mère Lachaise” avec des portraits et de courts textes. Elle souhaite faire perdurer par ses dessins la mémoire des femmes enterrées au cimetière du Père Lachaise. Son travail est complété d’un plan du cimetière pour retrouver les sépultures des femmes qu’elle illustre.
Extrait du compte Instagram “Mère Lachaise” © Camille Paix
Il se cache dans nos cimetières un matrimoine souvent méconnu. Les artistes d’aujourd’hui s’inspirent de la vie de ces femmes dont on peine parfois à déchiffrer le nom sur les sépultures. Marie Morel, artiste peintre, a par exemple réalisé quatre-cents portraits de femmes ayant joué un rôle dans les domaines scientifiques, politiques, artistiques ou investies dans les luttes sociétales majeures de l’Histoire. Les vies de “celles d’en dessous” continuent donc de nourrir la création contemporaine dans les champs du spectacle vivant, du dessin ou de la peinture. La pièce Celles d’en dessous se jouera de nouveau le 20 mars 2022 au cimetière Miséricorde à Nantes et le 18 septembre au nouveau cimetière de Strasbourg. Serez-vous au rendez-vous pour écouter ce que “celles d’en dessous” ont à vous raconter ?
Image vignette : Cimetière Miséricorde à Nantes © EF
Pour aller plus loin :
-
Celles d’en dessous est un spectacle produit par la compagnie “La Mort est dans la boîte “ : https://cielmdb.com/2018/06/02/celles-den-dessous/ (Mise en scène, costumes et écriture : Laure Fonvieille / Comédiennes : Sophie Renou, Emmanuelle Briffaud, Camille Kerdellant, Hélène Vienne, Manon Payelleville)
-
Compte Instagram Mère Lachaise : https://www.instagram.com/merelachaise/?hl=fr
-
Site internet “Le Matrimoine”: https://www.lematrimoine.fr/
-
Tumblr Les Invisibilisées : https://invisibilisees.tumblr.com/
-
Lien vers le projet artistique de Marie Morel “Les femmes des siècles passés” : http://mariemorel.net/les-femmes-des-siecles-passes/60mapvxu06mj2x6mko9jnvhal9re79
#matrimoine #cimetières #lamortestdanslaboite

Qui suis-je ? La question de l'identité d'un musée sous l'angle de sa dénomination : le cas de la Maison du Textile (Fresnoy-le-Grand)
Dansun contexte où l'on cherche à faire de l'espace muséal un lieu désacralisé et facilement abordable par tous, le terme de « musée » peut être considéré comme étant trop lourd de signification. Certaines institutions muséales choisissent alors de le bannir, auprofit de termes moins effrayants, tels que « espace » , « cité », ou encore « maison ». C'est le caspar exemple de la Maison du Textile, baptisée ainsi dès son origine. Mais cette volonté d'éviter l'emploi du mot « musée » ne nuit-elle pas à la lisibilité identitaire de l'institution ?
La Maison duTextile : musée vivant de la tradition textile en Vermandois
Créée à l'initiative de l'association « Tisserand de Légende », la Maison du Textile a ouvert en 2003 alors que l'atelier était toujours en fonctionnement. Dans la perspective d'un éco-musée, il s'agissait avant tout de montrer au public le travail des artisans sur les mécaniques à bras Jacquard. Deux ans plus tard, l'entreprise textile ferme et le musée lui survit : l'histoire des établissements « La Filandière » nous est retracée par la présentation de 28 ateliers à tisser Jacquard – tous fonctionnels –, de la reconstitution d'une maison de tisserand et d'un jardin de plantes tinctoriales.
De par sa présentation sur le site internet de l'Office de tourisme du Vermandois, ou bien la signalétique qui indique son emplacement, la vocation muséale du lieu est tout à fait avérée. D'où une certaine surprise en y pénétrant.
©N.V.
« Oui ? Vous venez pour quoi ? »
Une fois le seuil de la porte franchi, la personne de l'accueil interroge le « visiteur » sur la raison de sa venue : ce lieu abriterait-il une autre activité que celle du musée ? L'entrée se fait effectivement par un espace boutique relativement bien fourni (linge de table, vaisselle, accessoires brodés, tapisseries, jeux pour les enfants, quelques produits régionaux...). La distinction est donc très mince entre le client de la boutique et le visiteur du musée. Certaines personnes viennent uniquement faire des achats, sans même connaître l'existence de la partie muséale. Si la présence d'un espace marchand est susceptible d'attirer du public, et par extension de faire connaître le musée (la responsable de l'accueil les encourage vivement à venir le visiter), la motivation première du visiteur pose la questionde l'identité du musée, et de sa lisibilité auprès du public.
©M.S.
Il existe donc très nettement un clivage entre la façon dont l'institution elle-même se présente (comme un musée), et la vision qu'en ont certains de ses « clients » (boutique). Cette dernière est peu mise en avant sur le site internet de la Maison du Textile. Elle apparaît uniquement dans la rubrique « service », en tant que « boutique souvenirs en accès libre ». En revanche, sa vocation marchande constitue l'un des points d'appui de la communication du musée : outre la présence de nombreux ateliers créatifs relayés sur les réseaux sociaux, la Maison du Textile accueille également des animations commerciales. Si est vrai que ce genre d'événement est susceptible de faire vivre en quelque sorte le lieu et de lui amener un public potentiel, celui-ci n'est pas forcément intéressé par l'activité textile en elle-même.
© Maisondu Textile
Nul doute que cette dichotomie entre les deux vocations du lieu entraîne un flou identitaire pour l'institution muséale. Et l'utilisation du terme « maison » renforce encore cette imprécision.
D'où l'importance de la terminologie dans la construction de l'identité d'un musée
Même si le terme « musée » est présent dans le sous-titre (« musée de la tradition textile en Vermandois »), le mot « Maison » lui pré-existe dans sa dénomination. Ce terme est parfois utilisé par certains musées, dont le cas le plus fréquent est celui des maisons d'artistes, telles que la Maison Victor Hugo Paris – Guernesey, ou la Maison de Balzac (Paris). Il s'agit alors de muséaliser l'ancienne demeure d'une personnalité connue. Quoi qu'il en soit, il arrive que des éco-musées choisissent également cette terminologie, comme par exemple la Maison du blé et du pain de Verdun-le-Doubs, ou bien la Maison de l'outil et de la pensée ouvrière de Troyes.
Toutefois, la thématique de ces deux musées rend relativement lisible leur vocation... ce qui n'est pas le cas pour la Maison du Textile. Le mot « textile » peut effectivement avoir une connotation plus esthétique : son nom ressemble étrangement à celui d'une enseigne de magasin de décoration (Maison du Monde), ou à celui d'un lieu de création (comme les Maisons de Mode de Lille et de Roubaix, qui ont pour objectif d'encourager la création textile par exemple). Aucune dimension créatrice à proprement parler pour ce qui est de la la Maison du Textile : une partie objets de la boutique provient plutôt des métiers à mécanique Jacquard de Roubaix.
Le terme de « musée » peut donc être capital dans la construction de l'identité d'un lieu culturel. Le contourner par d'autres dénominations ne fait que rendre plus floue sa vocation muséale. Ne vaudrait-il pas mieux que les professionnels du secteur continuent leur travail de démocratisation culturelle, et permettent d'avoir une image moins intimidante et plus sympathique du musée ? Toutefois, il est vrai que le caractère plus large du mot « maison » permet de désigner les différentes composantes d'un lieu hybride, qui propose un ensemble de prestations variées... au risque donc de perdre la lisibilité de l'institution...
Ou de la redéfinir ? L'idée de musée renvoie effectivement à une volonté de conserver le patrimoine. Est-ce à dire qu'en muséalisant un métier, celui-ci est désormais considéré comme appartenantdéfinitivement au monde du passé ? Certains choix de dénomination sont effectivement portés par des convictions : éluder le terme de musée, est-ce lutter contre l'obsolescence de l'activité textile ?
Noémie V.
#identité #maison du textile

Quizz de l'année 2019
BON JEU!
1) 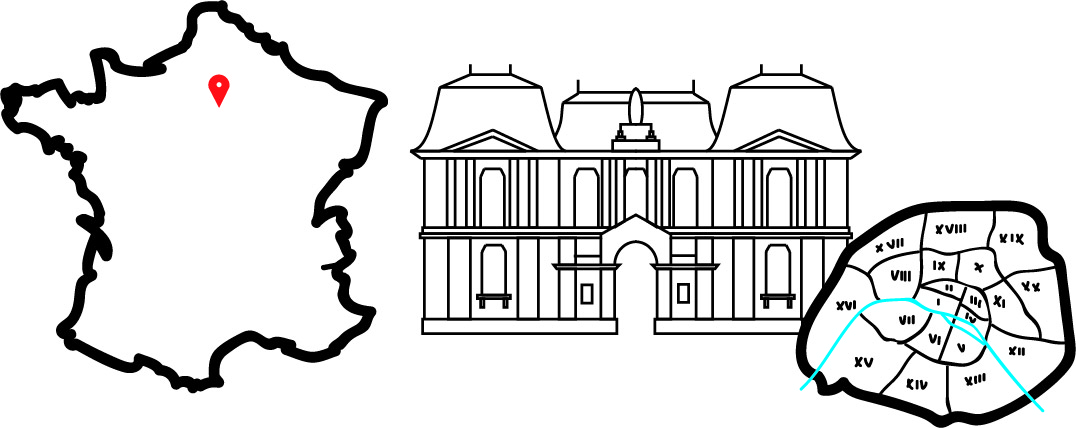
Réponse : Le musée...
En travaux depuis 2016, le Musée Carnavalet est dédié à l’histoire de Paris. L’objectif de cette rénovation est de rendre le « parcours "plus fluide" et d'"apprivoiser" un musée à l'ancienne en contextualisant mieux les œuvres, en les rendant le plus accessibles aux handicapés, en installant des dispositifs numériques.»
2) 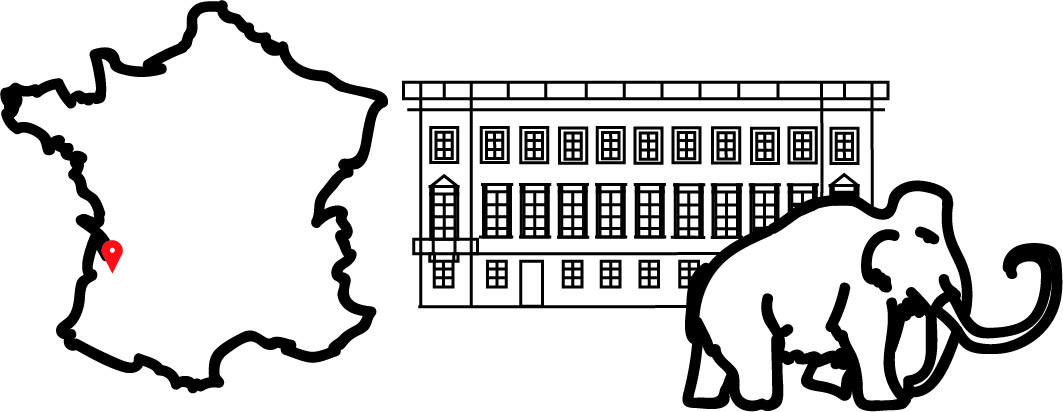
Réponse : Le muséum...
3) 
Réponse: La maison...
La Maison Zola est fermée au public depuis 2011 pour restauration et aménagement d’un musée consacré à Dreyfus dans l’une des dépendances. Cette maison, ouverte au public depuis 1984, a été acquise par Emile Zola en 1878.
4) 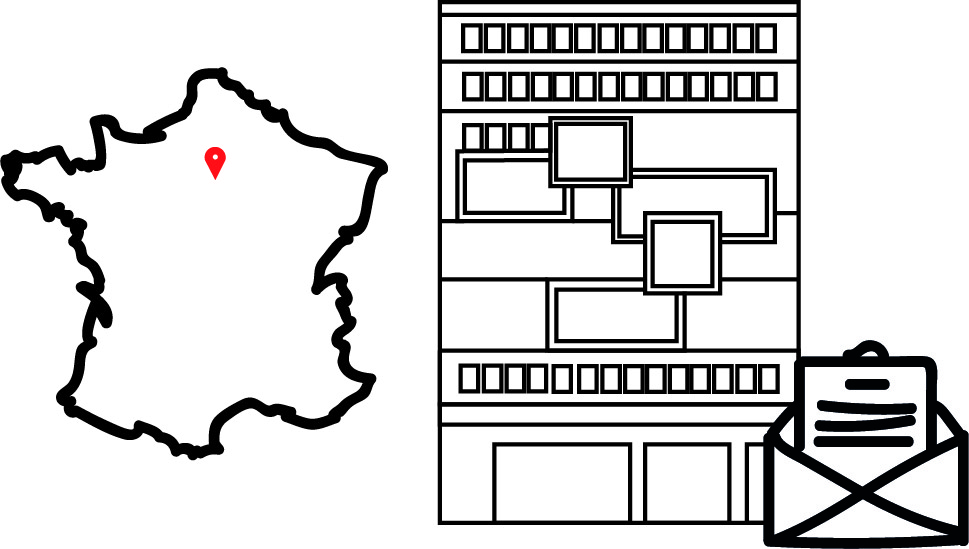
Réponse: Le musée...
5) 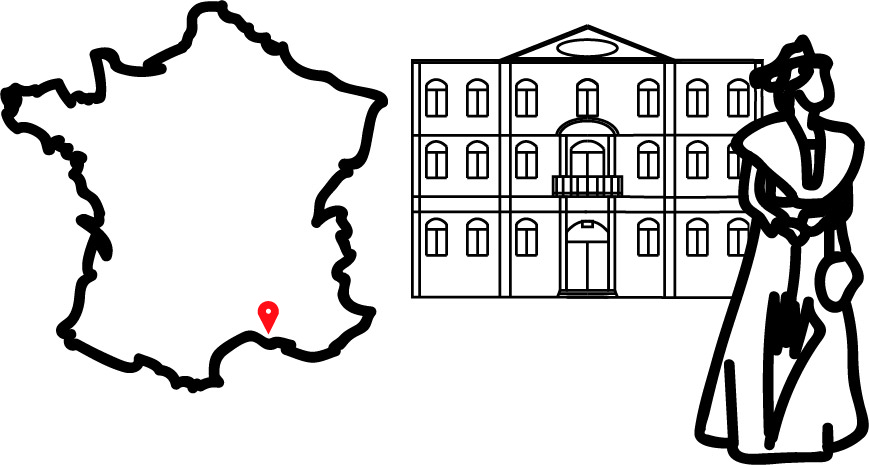
Réponse: Le museon...
6) 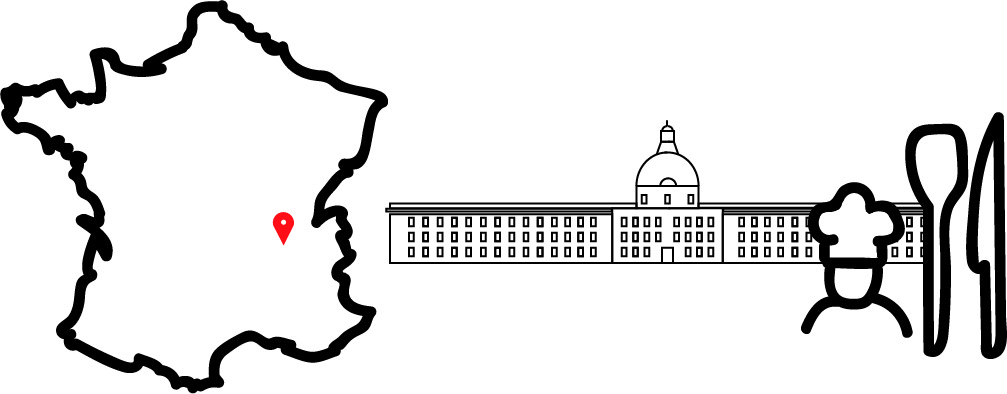
Réponse: La cité...
7) 
Réponse: Le musée...
Le musée de Picardie, construit entre 1855 et 1867, est fermé au public depuis 2017 pour rénovation et extension. Les travaux ont cependant commencé dès 2016. Il accueillera des espaces nouveaux : une salle de conférences, une salle pédagogique, des locaux techniques et des bureaux.
8) 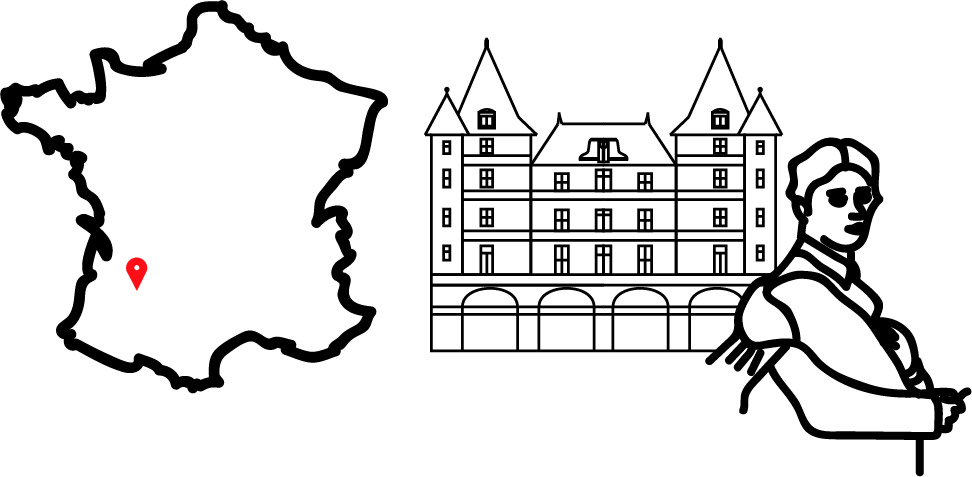
Réponse: Le musée...
9) 
Réponse: La cité...
La Cité de l’économie est une nouvelle institution culturelle dont l’ouverture est prévue au printemps 2019. Elle prendra place dans l’hôtel Gaillard situé dans le 17e arrondissement de Paris. Ce lieu est destiné à expliquer les notions et les mécanismes de l’économie.
10. 
Réponse: Le musée...
Le Musée des Beaux-arts de Dijon fermera ses portes pendant une courte période : du 31 décembre 2018 au 17 mai 2019. Des travaux qui viendront parachever un chantier de rénovation-extension mené depuis bientôt 10 ans dans le musée resté jusque-là ouvert au public.
Clotilde Villain
#2019
#réouverture
#ouverture

Quoi de nouveau au MAM ?
Aujourd'hui, l'Art de Muser vous propose la mise à jour d'un musée. Cliquez ci-après pour lancer l'installation :
Au cœur du Vieux Lyon et du secteur Unesco, l’hôtel de Gadagne accueille le musée d’histoire de Lyon depuis aujourd’hui 100 ans, ainsi qu’un musée à part entière, le Musée des Arts de la Marionnette. Ce musée, auparavant nommé le musée international de la marionnette puis le musée des marionnettes du monde, a intégré le musée d’histoire dès 1950, et fut agrandi en 2009. Unique musée de ce type en France, c’est naturellement à Lyon, lieu de naissance de Guignol, qu’il prend place à la suite d’une décision amenée par George Henri Rivière d’effectuer un important dépôt du Musée National des Arts et Traditions Populaires.

Vue d’une salle du musée jusqu’en 2009 / Terry O’Neill - Musée des Arts de la Marionnette - Gadagne
En changeant de direction en 2015, le Musée d’Histoire de Lyon (MHL) et le Musée des Arts de la Marionnette (MAM) entament une nouvelle refonte, en accord avec leur nature de musées de société, en s’ancrant toujours plus dans leur territoire et leur époque. Du côté du MHL, l’ancienne muséographie du parcours permanent laisse place à quatre nouvelles expositions, inaugurées l’une après l’autre, sur un rythme annuel. Après une première ouverture en 2019 de l’exposition Portraits de Lyon, servant d’introduction au musée mais aussi à la vie lyonnaise, le MHL propose depuis mai 2021 le deuxième volet de cette refonte, Les pieds dans l’eau.

Vue de l’exposition Les pieds dans l’eau ouverte en mai 2021 / Jade Garcin
Des changements chez les marionnettes
Les marionnettes aussi ont droit à une nouvelle jeunesse. Repensé afin de présenter à la fois les origines de la marionnette et la création contemporaine, le MAM devient un modèle d’intégration des contraintes de l’exposition d’un art vivant, ce qui tient d’ une de ses spécificités : sa nature d’exposition semi-permanente… ou évolutive, disons en rotation.. ou peut-être de référence ?
Un problème de définition
Si ce projet était bel et bien présenté comme une exposition “semi-permanente” dans les premières années, les enjeux concentrés dans cette dénomination ne correspondaient pas à ceux réellement présents. Lorsque l’on parle de semi-permanent, on pense à une exposition temporaire durant plus longtemps que la normale, comme la Galerie de la Méditerranée au Mucem, présentée durant 3 ans avant de changer, ou celle du musée ethnographique de Neuchâtel conçue en assemblant différentes expositions régulièrement renouvelées, et unifiées graphiquement.
En évoluant tous les 4 ans, le Musée des Arts de la Marionnette pourrait-il être une exposition évolutive ? Si l’on considère le paysage expographique actuel, cette dénomination semble consacrée à une typologie d’expositions relevant de la production artistique, régulièrement construite avec participation des visiteur·euse·s, en tant qu'œuvre en elle-même. Ce qui ne correspond pas au cas du MAM.
Parler de la “rotation” d’une exposition donnerait à penser que les enjeux derrière seraient purement en terme de conservation préventive des collections, et il serait inexact de penser que cela ne relève que de ça.
Faire référence !
Peut-on alors parler d’“exposition de référence” ? L’on retrouve ce terme non loin de Gadagne, au bout de la presqu’île lyonnaise. Pour Michel Coté, ancien directeur du musée des Confluences, il n’était plus question dans ce cas de parler d’expositions permanentes ou temporaires, mais respectivement d’expositions “de synthèse et de référence” et d’expositions “de déclinaison”. Selon lui ”L’exposition doit faire autorité au sens où ce qu’elle explique doit être rigoureusement fondé sans exclure pour autant la présentation de points de vue différents".
Le Musée des Arts de la Marionnette version 2017/2018 prend le parti de montrer la création marionnettique contemporaine, et de répondre à ses grandes questions structurantes par des exemples de techniques, de compagnies, ou encore de spectacles variés et diversifiés. En multipliant les réponses, les points de vue, ce musée se place alors en tant que référence dans la présentation de compagnies contemporaines et des sujets qui les animent.

Première salle du MAM depuis 2017 / Xavier Scwhebel - Musée des Arts de la Marionnette - Gadagne
Cap sur 2022
En décidant de faire évoluer le parcours tous les 4 ans, le musée se prête à un exercice de réactualisation de son contenu, en exposant de nouvelles pièces de sa collection mais surtout de nouvelles compagnies et des spectacles récemment créés. Il élargit le panorama des techniques, des pays, des thématiques… et complète, cycle après cycle, le le paysage marionnettique contemporain international. Cela apporte aussi un regard neuf sur le parcours muséographique et devrait - cela est souhaité - avoir le même effet sur la fréquentation des publics que l’ouverture d’une exposition temporaire classique.
Quelles spécificités ?
Mettre en place un projet tel que celui-ci engendre cependant des problématiques propres sur différents aspects. La scénographie, la régie, la sphère administrative et bien entendu la muséographie font partie des éléments qui doivent être pensés de manière spécifique à l’exercice.
La muséographie
La réflexion autour du discours sur les objets est un des points clefs de cette forme expographique. Le parcours a été pensé comme une base à réagencer, repenser, reformuler… Il s’appuie sur des questions fortes, autour desquelles s’articulent d’innombrables déclinaisons possibles de réponses. En mêlant collections du musée et dépôts de compagnie et d’institutions, le parcours s’ouvre là encore à de nombreux possibles.
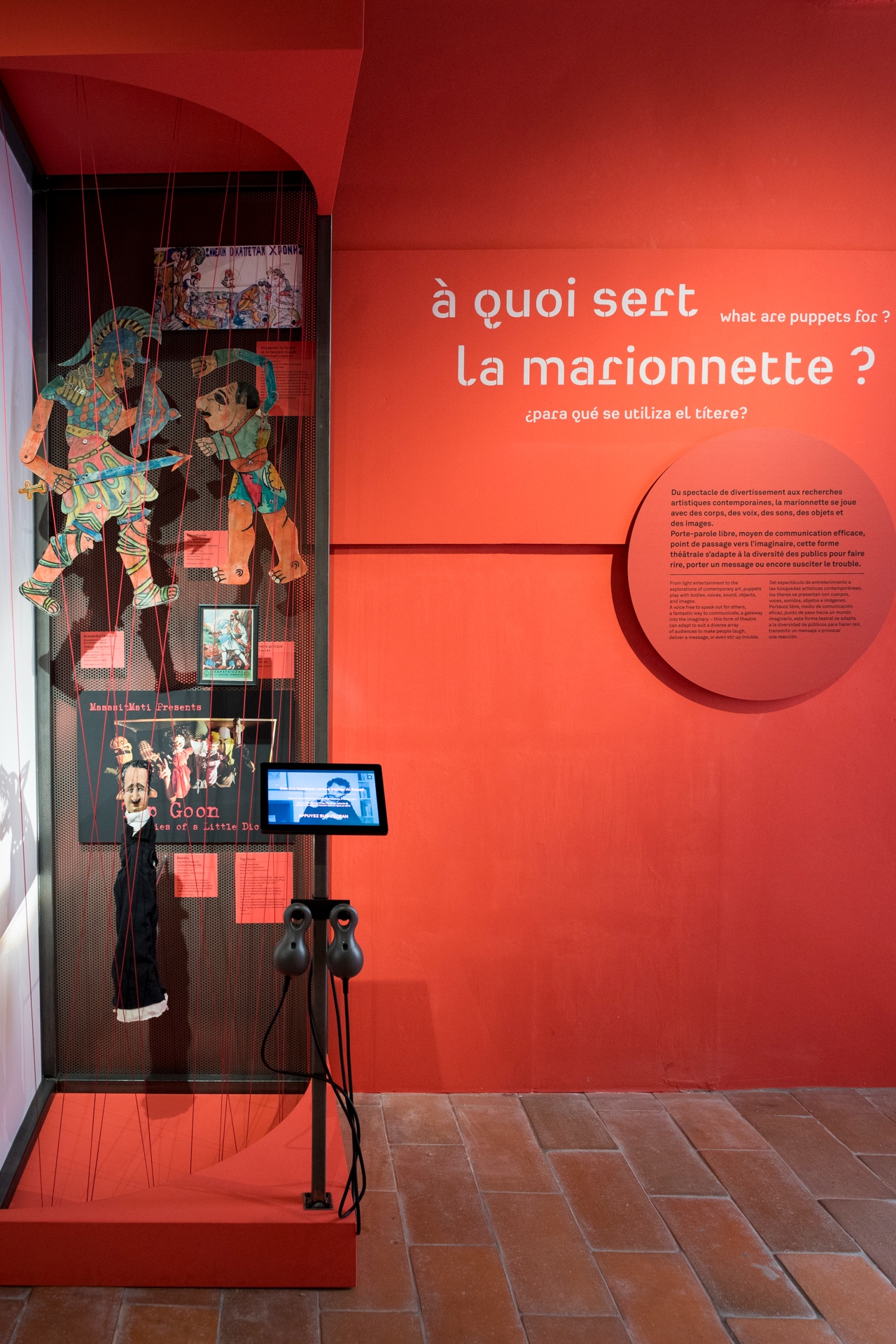
Une des grandes questions structurantes, et vitrine sur “le rire contre l’opression” / Xavier Scwhebel - Musée des Arts de la Marionnette - Gadagne
La scénographie et l’agencement
Renouveler les objets exposés est synonyme de nouveaux soclages, de mouvements dans les salles, de réécriture des textes, mais pas nécessairement de budget permettant de reprendre entièrement l’agencement tous les 4 ans. Ainsi, des astuces scénographiques ont été trouvées pour pallier ces contraintes. On trouve alors au musée des grilles perforées au fond de la plupart des vitrines, sur lesquelles peuvent venir se placer à l’endroit souhaité tous les soclages, réalisés en interne. On peut aussi, sur ces mêmes grilles, placer et replacer les cartels imprimés sur un support aimanté et donc repositionnables à l’infini sans laisser de trace.
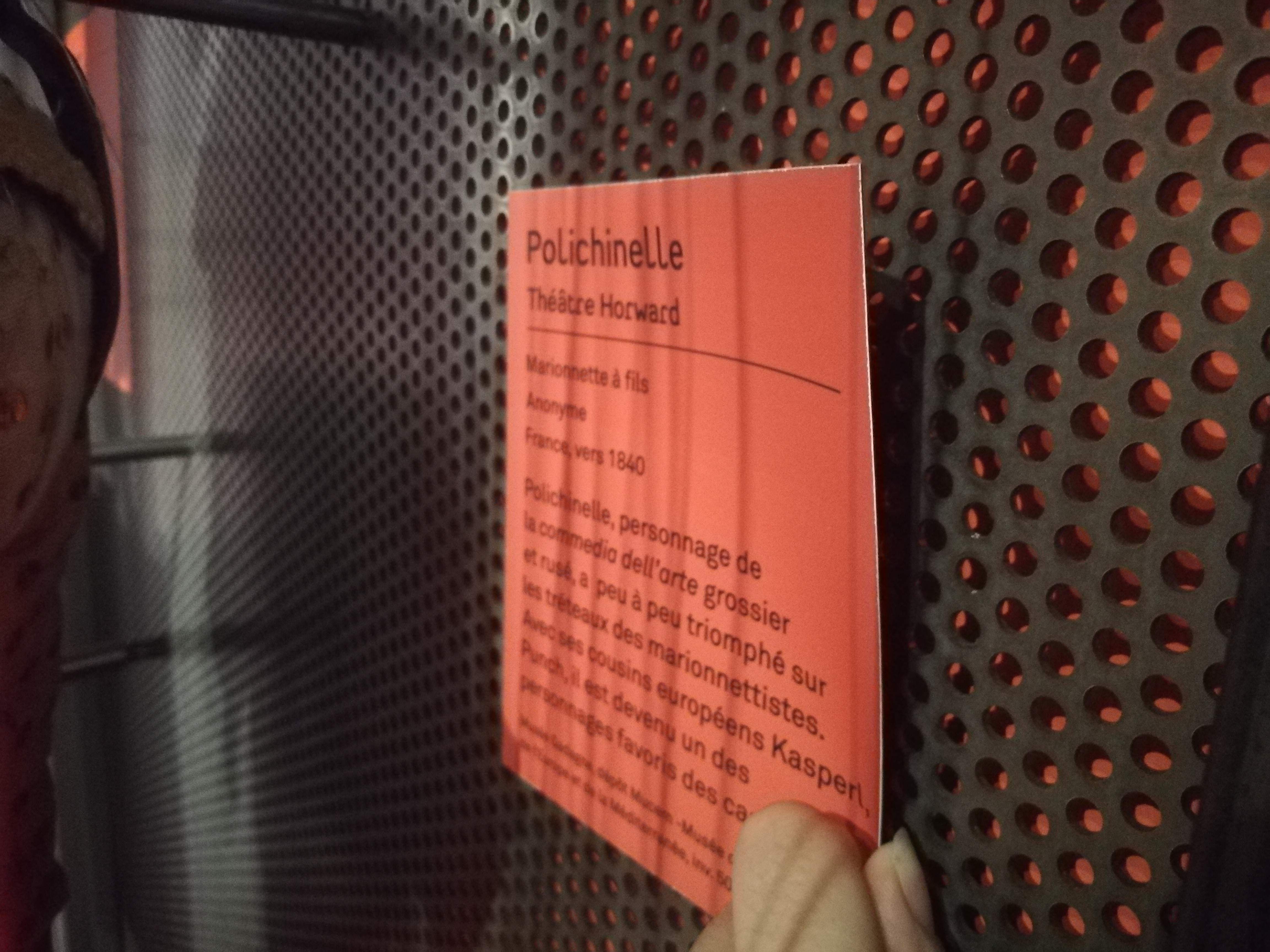
Cartel magnétique et panneau perforé / Jade Garcin
Une question d’organisation
D’un côté pratique, la régie ou encore l’aspect administratif doivent aussi s’adapter à ce format et cette temporalité particuliers. Si certains des objets exposés appartiennent à Gadagne, d’autres sont empruntés à des compagnies pour une durée minimum de quatre années et demi. Cela implique alors un fonctionnement par dépôts, renouvelables, sur cette période. Le lien avec les spectacles vivants se perçoit ici également, car si certaines marionnettes ont arrêté leur tournée, d’autres retrouvent encore ponctuellement leur public, et quittent alors le musée pour une courte durée.
Le renouveau des possibles
Outre son parcours principal, cette exposition propose un espace dit “la salle carte blanche”, prêté à un artiste pour une période de 2 à 3 ans. C’est alors un nouveau lieu pour se renouveler et laisser place à un autre regard. Actuellement, Renaud Herbin y présente son travail à la croisée de la marionnette et de la danse, en laissant une grande part à la matière. Présentée comme une salle à part entière, elle s’intègre en réalité dans le parcours, spatialement, mais aussi en participant à rendre chaque visite unique.
Pour aller plus loin :
#rotation #marionnettes #Gadagne

Redécouvrir un musée, la maison de la Vache qui rit

© C CARON
© C CARON
Je suis invitée à commencer par les caves, lieu historique de l’usine ou Léon BEL lancé sa production de fromage.
Le sas d’entrée me plonge dans la planète BEL avec quelques affiches publicitaires, arbre généalogique et un petit dessin animé mettant en scène la vache qui rit de la préhistoire à nos jours tantôt héroïne, tantôt Joconde. Les affiches et le petit film d’animation sont une manière ludique de faire appel aux souvenirs du public.

(Aménagement 2018) - © Maison de la Vache qui rit

(Aménagement 2013) © Maison de la Vache qui rit
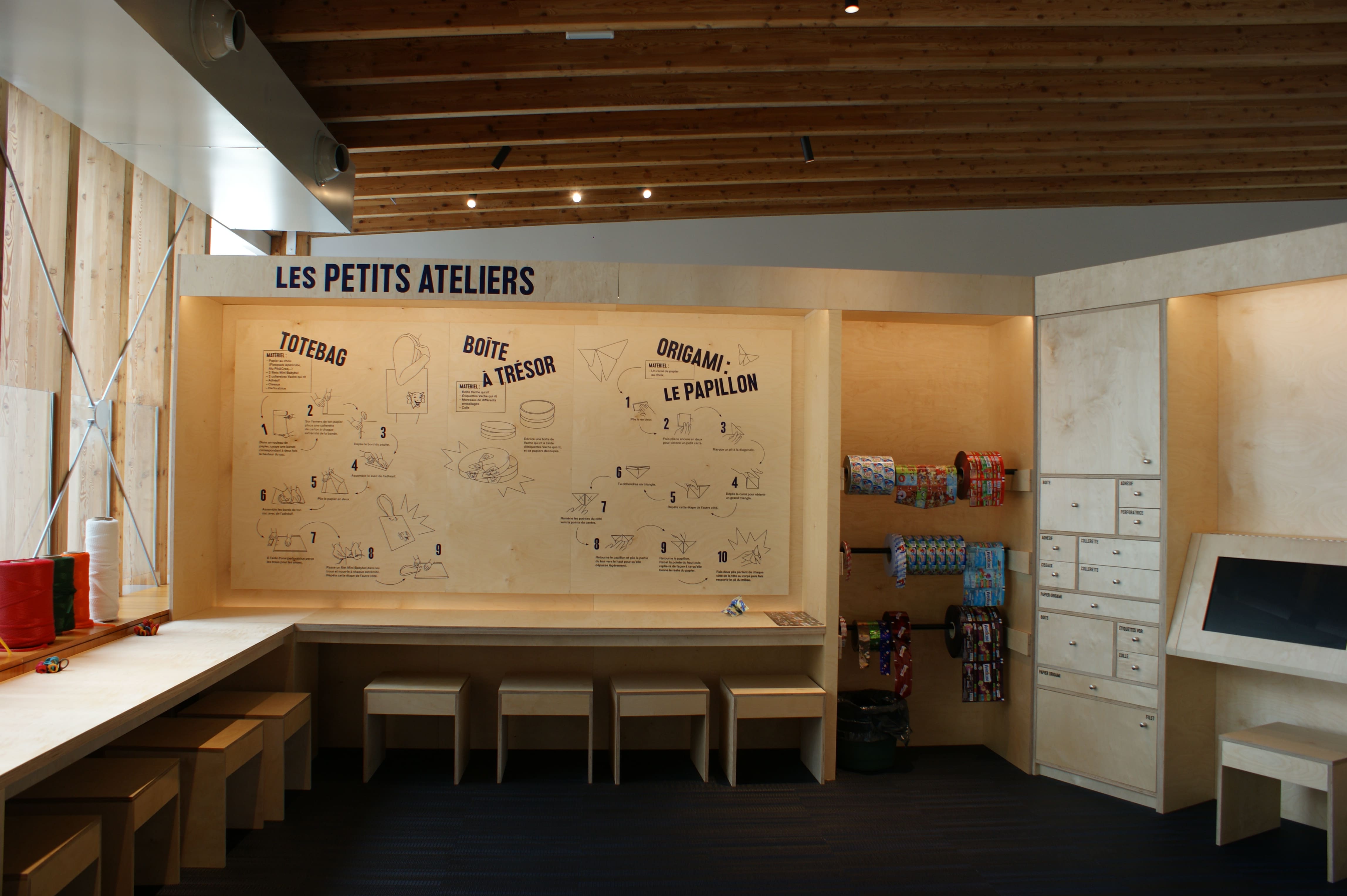
© C CARON
L’étage est divisé en plusieurs ambiances :
- Maquette d’une chaîne de production
- Espace de jeux numérique et créatif
- Espace de projection d’un film illustrant l’exportation du produit la vache qui rit dans le monde entier
- Espace de jeux
- Fondation d’art
- Produits du groupe BEL
Ces items traduisent les valeurs de la Marque et son emprise
Pour les visiteurs habitués, l’espace nouvellement conçu ne fait plus écho aux affiches publicitaires, humoristiques, aux figurines, l’illustration fait place aux questions sociétales du groupe.

Aménagement 2013 © C CARON
Le partis pris de l’équipe muséale, d’un espace immersif où l’on propose de nouveaux modes d’appréhension tout en transmettant les valeurs de marque à la société semble réussi ! le ton de l’exposition est d’ailleurs dans l’émotion (la fierté, l’échange, le jeu, la famille, la gourmandise, grandir). Mobilier moderne, scénographie assez épurée, médiateurs disponibles pour nous accompagner dans des ateliers et répondre à toutes questions. Le site propose peu d’écrans et tablettes numériques, seulement 3 à disposition des enfants des jeux numérique. La volonté d’un musée familial pour échanger et partager semble être une des explications.
Pour l’ensemble des espaces, le visiteur est acteur de sa visite, il choisit ou non de lire les îlots, d’ouvrir ou non les cachettes ou même de s’arrêter sur les hublots de la frise. A l’étage, il peut décider de traverser la plateforme comme se poser pour jouer, fabriquer.
La dimension ludique a été mon fil conducteur, j’ai pu grâce à l’épopée de l’illustration de Benjamin Rabier à la dimension 3D, aux ateliers vivre une visite.
Le dernier espace est l’atelier de cuisine et l’exposition temporaire consacrée, cette année au Sénégal « NAK BOU BEG ».
© C CARON
Cette exposition permet d’évoquer la présence du Groupe au sein de ce pays mais plus largement l’international. L’exposition temporaire invite au voyage et à la découverte d’artistes du Sénégal, artistes peintres, sonore, sculpteur, tricoteuse et graphiste qui se sont rencontrés autour de ce projet. Quel est le point d’orgue de ma visite ? L’écran 180° évoquant l’implantation de la vache qui rit dans le monde (une forte présence humaine, la description des quartiers, des villes en image et l’idée de regard croisé) ? L’atelier de cuisine permettra d’accueillir les ateliers enfants et goûters propose par le service des publics. Ces derniers sont tournés sur la nutrition, la gourmandise et le développement durable. La définition du directeur « Nous avons travaillé à la non définition d’un lieu, afin qu’il soit incubateur d’idée, laboratoire, centre aéré, centre d’art, atelier cuisine et Fab lab. », semble prendre tout son sens dans ces espaces comme l’illustre le concept de l’exposition temporaire.
Camille Caron
1 Laurent BOURDEREAU
2 Explication de Laurent BOUDEREAU dans Connaissance des Arts

Réinventer le musée
Chaque année, de nombreuses structures muséales se lancent dans des rénovations, quand d'autres en sortent. Si chaque projet est unique, et que tous les musées ne poursuivent pas forcément le même but en commençant un chantier de rénovation ou d’agrandissement, une volonté revient souvent : celle d’ « améliorer le confort et l’expérience de visite ».
Dans le cadre d’une rénovation d’un musée ou de la création d’une extension, les institutions ont chacune une démarche qui leur est propre et qui relève du fonctionnement inhérent à la structure. Il existe donc autant de façons de réinventer le musée que de musées. A l’appui d’exemples de musées récemment visités par les étudiants du Master Expographie Muséographie, voici une courte synthèse de ce qui me semble important dans une « bonne » rénovation.
Réinventer… la mise en espace
Dans le cadre d’une rénovation ou de l’agrandissement d’un musée, plusieurs éléments sont remis en questions, repensés, retravaillés, réinventés. Lors de la réouverture, le plus frappant pour le visiteur est le changement de la mise en espace des collections et du propos. On pourrait considérer qu’une rénovation est réussie lorsqu’il est possible de constater une cohérence entre le fond et la forme, entre les contenus et les ambiances. Une mise en espace réussie doit présenter une théâtralisation adaptée, une ambiance particulière qui englobe le spectateur et le fait voyager, rêver, ressentir.
En principe, un projet de rénovation ou d’extension de site démontre une volonté de renouvellement, de changement et de nouveauté. Pourtant, toutes les institutions ne poursuivent pas ce but. L’exemple du Musée Carnavalet de Paris, qui a rouvert en 2021 après quatre ans de travaux, est assez parlant : malgré la rénovation du lieu, la mise en espace reste très classique. Certes, la scénographique s’adapte d’abord au bâtiment : dans le cas de bâtiments anciens et classés, tels que le Musée Carnavalet, créer une scénographie nouvelle et immersive peut s’avérer un défi de taille. De taille, mais pas impossible, puisque c’est le choix qu’ont fait d’autres musées qui présentent le même type de collections. Il en va ainsi du Musée d’Aquitaine, à Bordeaux, avec ses nouveaux espaces consacrés aux XXème et XXIème siècles qui ont ouverts en 2021. Comme Carnavalet, il s’agit d’un bâtiment classé, avec de nombreuses contraintes et une collection variée.
Les collections d’Histoire, comme les collections ethnographiques sont « difficiles » à traiter : éviter la théâtralisation caricaturale, ne pas figer les objets derrière des vitrines… Comment agencer une collection comme celle-ci, et faire face à son aspect « pétrifié » dans le temps et dans l’espace ? Le Musée d’Aquitaine, pour son nouveau parcours, met en avant les mutations de la métropole bordelaise et les aspects attractifs de l'espace aquitain. Il invite à découvrir l'histoire récente de Bordeaux. Sculptures, peintures, objets d'ethnographie et maquettes se mélangent donc à des projections en grand format, des écrans interactifs et des ambiances sonores qui donnent au visiteur une véritable impression de « voyage ». Le tout est scénographié sobrement : les panneaux en bois prennent des formes variées qui rythment subtilement la visite.

Salle du Musée d'Aquitaine de Bordeaux dédiée au XXème siècle© L.G.L.
Une scénographie plus immersive est donc très appréciable aujourd’hui si elle est correctement construite. Le musée de la Chasse et de la Nature, à Paris, qui présente lui aussi des collections variées allant des spécimens naturalisés aux œuvres d’art en tout genre (peintures, dessins, sculptures, tapis, tapisseries, orfèvrerie, céramiques, armes, trophées, armures, meubles, installations, photographies, vidéos…) a fait le choix, tant pour l’étage rénové et rouvert en 2021 que pour les espaces plus anciens, d’une mise en espace immersive au sein de laquelle le visiteur est plongé dans un cabinet de curiosité XXL. Cette originalité fonctionne et fait d’ailleurs la renommée du musée, puisqu’elle laisse au visiteur un souvenir impérissable.

Ambiance « cabinet de curiosités » au Musée de la Chasse et de la Nature, à Paris© L.G.L.
Il est impossible d’évoquer la scénographie immersive sans dire un mot du Naturalis Biodoversity Center de Leyde, rouvert en 2021 après des années de travaux et l’installation des collections dans un bâtiment flambant neuf. Cette rénovation a permis de déployer un parcours immersif sur près de 6000 m², plongeant le visiteur dans une véritable expérience sensible. Naturalis représente le parfait exemple de ce que signifie un « musée d’aujourd’hui » : un musée qui fait la part belle à la scénographie, de plus en plus importante, mise en valeur en tant que telle (on admire autant la beauté du « décor » que la perfection des spécimens naturalisés ou la clarté du discours).
Ainsi, les nouveaux projets muséographiques qui, à l’instar de Naturalis, se veulent modernes, auront tendance à aller vers un parcours très immersif pour faire le lien entre le public et les collections. Cela peut être, on s’en doute, à double tranchant, car il faut toujours veiller à l’équilibre entre la forme et le fond, si l’on ne veut pas tomber dans « l’exposition spectacle » à l’anglo-saxonne, où le fond passe parfois totalement au second plan. Un musée rénové réussi est donc un musée qui donne à voir une scénographie réfléchie.
Réinventer… la médiation
La médiation est également repensée dans le cadre de projets d’extension et de rénovation. Le contact avec les publics est nécessairement remis en cause, et nécessite une réflexion quant au devenir du personnel de médiation.
Le Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux, rouvert en 2021, propose un dispositif de médiation qui n’a, à première vue, rien de novateur, et qui n’est pourtant pas si courant dans ce genre de structure. En effet, le Muséum emploie, en contractuel, une équipe d’une quinzaine de jeunes médiateurs scientifiques, qui déambulent dans les salles du musée accompagnés d’un chariot de démonstration (contenant des spécimens naturalisés, fossiles, minéraux, etc.), et proposent aux visiteurs intéressés quelques explications supplémentaires. La création de ce contact est doté d’un tel potentiel que cette initiative semble être le plus gros atout du Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux.

Un médiateur scientifique et son chariot de démonstration au Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux© L.G.L.
Rien ne remplace la médiation humaine et l’échange pour permettre la compréhension d’un contenu. La création de liens avec la collection au travers d’une personne est sans aucun doute ce qui rend l’expérience mémorable. Je pense notamment aux publics dits « éloignés », qui n’ont pas accès aux musées et à la culture et à qui une institution de ce genre peut paraître obscure, imperméable. La présence des jeunes médiateurs au Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux est une solution pour répondre à cette problématique.
Pour autant, l’apport de la médiation numérique dans les musées n’est pas à négliger. Cela reste un bon moyen de faciliter l’entrée dans le contenu ainsi que son approfondissement. La démocratisation du numérique dans les musées est encore sujet très actuel, bien qu’il soit sur le devant de la scène depuis quelques années maintenant. Sans m’y attarder, j’aimerais pointer du doigt un exemple du « trop » de numérique. Le Muséon Arlaten, rouvert en 2021 après onze années de fermeture pour travaux, a en effet fait le choix de ne plus présenter les cartels des œuvres exposées dans les vitrines. Les informations concernant un objet sont désormais à aller chercher sur des tablettes numériques situées dans les pièces. S’il est évident que l’objet « cartel » peut être repensé dans le cadre d’une réfection de parcours, il semble important de garder, pour chaque objet, un cartel propre et auquel le visiteur peut avoir accès d’un coup d’œil. Cela favorise la découverte, quand l’élément de médiation mis en place par le Muséon Arlaten faillit selon moi à son rôle en favorisant la perte d’informations.
La salle « LivingScience » du Naturalis Biodiversity Center est un espace où sont présentées des collections, où sont organisées des projections, mais également où se trouvent des laboratoires « ouverts » où il est possible d’observer les chercheurs de l’institution en plein travail. Ouvrir ces espaces rarement accessibles aux publics constitue l’un des points forts de Naturalis avec sa pédagogie autour de laboratoires visibles et mis en scène. En misant sur des notions d’ouverture et de transparence, le musée met en exergue ses activités ainsi que les savoir-faire qui participent à leur mise en valeur. Bien plus qu’une vocation éducative, l’institution cherche à avoir un impact sur la vie culturelle, scientifique et sociale. Véritable laboratoire de recherche, Naturalis permet aux publics d’échanger avec ceux qui font la science. Ce procédé tend à valoriser l’implication des publics dans les innovations culturelles et scientifiques, et à créer un engouement pour des sujets hors du commun. La médiation s’insère donc dans un parcours de visite qui se veut participatif à l’aide de dispositifs permettant l’échange et le contact. Faire du visiteur un acteur à part entière, qui développe son propre regard critique, est essentiel.

Le laboratoire ouvert de l'espace "LivingScience" au Naturalis Biodiversity Center de Leyde© L.G.L.
Cet aperçu sommaire n’a pas vocation à servir de référence, mais à montrer que réinventer le musée n’est pas chose aisée. Évidemment, toutes les expositions ne posent pas les mêmes contraintes, spécifiques à chaque lieu. De même, les moyens et liens entre les différents acteurs d’un projet de rénovation ou d’extension sont propres à l’institution et à ses partenaires. Mais dans ces conditions, il convient de bien s’entourer, puisque l’on a constaté par exemple l’importance de la scénographie « médiatrice » et son influence sur le visiteur, l’état d’esprit de ce dernier et son appréciation globale de l’exposition. Une mise en espace intelligente constitue un premier contact réussi entre le public et les collections, mais élaborer des concepts plus modernes pour redonner un nouveau souffle à certains espaces ne suffit pas toujours. La médiation humaine reste indispensable au sein des musées. L’intégration des publics dits « éloignés » ne se fait que grâce au contact humain.
Lucile Garcia Lopez
Pour aller plus loin :
- Compte-rendu de la journée de réflexion « Musée à rénover » du Museon Arlaten
#Rénovation #Muséographie #NouveauxMusées

Rencontrez les Divas à l'Institut du Monde Arabe - point de vue d'Elise
L’exposition Divas a fait de l'œil à Elise et Marco qui l’ont vu de concert sans le savoir. L’occasion était trop belle pour ne pas comparer leur point de vue. Écrits entre quatres yeux, ces deux articles montrent que malgré deux visites différentes, leurs impressions sont au diapason. Au regard de nos compte-rendus, vous pouvez aller voir cette exposition les yeux fermés … et les oreilles grandes ouvertes !
Image d'en-tête : Tenues de scène, exposition “Divas, de d’Oum Kalthoum à Dalida” à l’Institut du Monde Arabe © EF
Le week-end du 22 et 23 mai 2021, les Français.e.s pouvaient courir les bars ou visiter des expositions fraîchement réouvertes. Moi, j'étais au musée. En plus, il pleuvait à Paris : la perspective de finir trempée devant une bière ne m'enchantait guère. Les belles expositions ne manquaient pas et on peut dire que j'avais l'embarras du choix. Je me suis donc décidée pour l'exposition “Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida”. Le samedi, munie de mon billet, je me dirige vers l'Institut du Monde Arabe. Non sans jouer des coudes, je découvre cette exposition sonore et colorée qui dresse les portraits de grandes chanteuses et actrices. L’exposition se déploie sur 1000 m² répartis sur deux étages. Elle suit un parcours chronologique de 1920 à nos jours, avec en toile de fond le contexte historique et politique de l’époque. “ Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida” est une exposition signée Hanna Boghanim et Elodie Bouffard à découvrir jusqu'au 26 septembre 2021.
Une rencontre avec les divas
L’exposition plonge le.la visteur.euse dans l’intimité de ces icônes comme pourrait le faire la presse “people”, relatant leurs amours, divorces et remariage. Il est également question d'exil et de retour en terre natale. Les modules ou salles dédiées aux divas expliquent les moments clés de la carrière de chacune. Le module mettant à l’honneur Dalida permet par exemple de découvrir un pan de sa carrière en Égypte moins connu par le grand public français. L’exposition documente aussi la vie de ces artistes arabes grâce à des interviews inédites, des extraits de presse, des disques, des costumes et parures de scène mais aussi des objets plus personnels leur ayant appartenu. Par exemple, au niveau 2, une vitrine consacrée à Warda expose ses vêtements, son oud, sa valise, ses passeports, son poudrier, son parfum, son livre de chevet ou encore son pilulier. Ces objets personnels sont attendus par les admirateur.rice.s de l’artiste. Par cette mise en vitrine, un statut presque reliquaire est conféré à ces objets du quotidien, créant une rencontre entre le.la visiteur.euse et cette artiste emblématique.

Vitrine dédiée aux objets personnel de Warda, exposition “Divas, de d’Oum Kalthoum à Dalida” à l’Institut du Monde Arabe © EF
Une exposition musicale
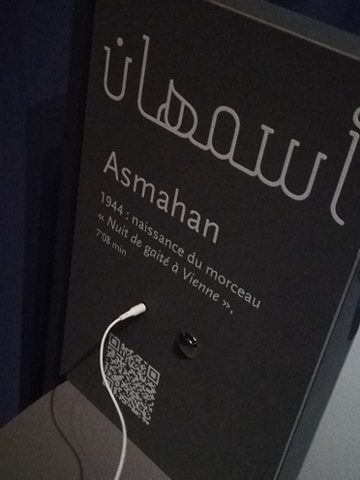
Borne d’écoute, exposition “Divas, de d’Oum Kalthoum à Dalida” à l’Institut du Monde Arabe © EF
Une exposition mettant en lumière des féministes et militantes
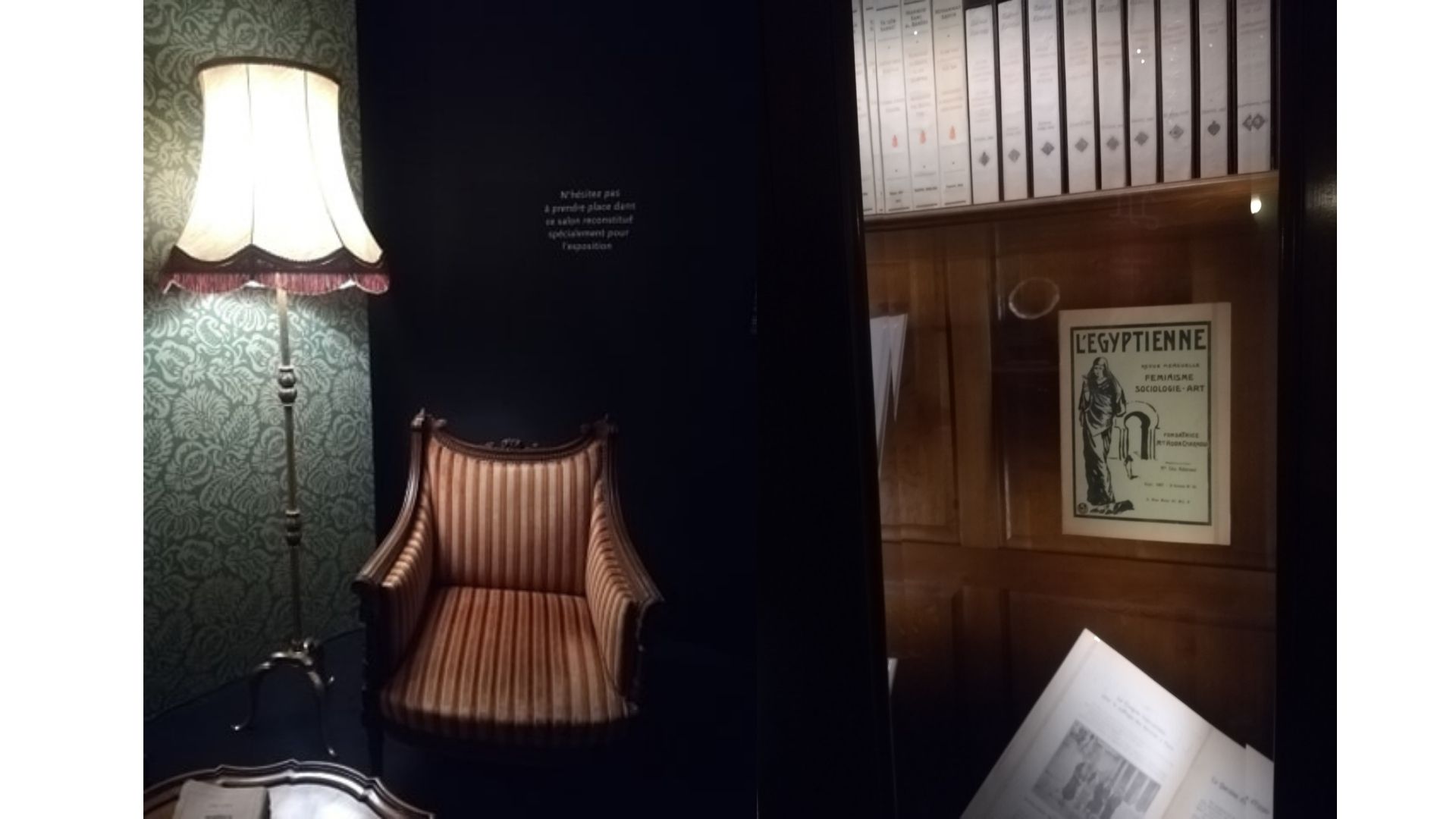
Reconstitution d’une bibliothèque fémniste et d’un salon, exposition “Divas, de d’Oum Kalthoum à Dalida” à l’Institut du Monde Arabe © EF
Fin de visite au pas de course

Collage de Nabil Boutros à partir de photogramme du film “Ma femme est PDG” de Fatîn abdel-Wahab, exposition “Divas, de d’Oum Kalthoum à Dalida” à l’Institut du Monde Arabe © EF

Vitrine inspirée du roman graphique “ô nuit, ô mes yeux” de Lamia Ziadé, exposition “Divas, de d’Oum Kalthoum à Dalida” à l’Institut du Monde Arabe © EF
Il existe d'autres façons de prolonger sa visite. L'Institut du Monde Arabe propose une websérie sur youtube autour des grandes thématiques de l’exposition et une playlist inspirée des divas disponible sur Deezer.
Elise Franck
Le point de vue de Marco est à lire ICI !
Pour aller plus loin
- Playlist Deezer inspirée de l’exposition :https://www.deezer.com/fr/profile/3478685424.
- Web Série : https://www.youtube.com/watch?v=SclFMPjkZ40&list=PLiykn3soZGDkcq6WMh5O3nPCZI3BNjPYb
#divasarabes #IMA #expositionparis

Rencontrez les Divas à l'Institut du Monde Arabe - point de vue de Marco
L’exposition Divas a fait de l'œil à Elise et Marco qui l’ont vu de concert sans le savoir. L’occasion était trop belle pour ne pas comparer leur point de vue. Écrits entre quatres yeux, ces deux articles montrent que malgré deux visites différentes, leurs impressions sont au diapason. Au regard de nos compte-rendus, vous pouvez aller voir cette exposition les yeux fermés … et les oreilles grandes ouvertes !
Image de vignette : Shirin Neshat, Ask My Heart, Looking for Oum Kulthum, 2018 @Marco Zanni
Image d’en-tête : Entrée de l’exposition sous le regard des divas @Marco Zanni
“Diva” : ce mot vous évoque-t-il une grande cantatrice à la vie tumultueuse et indépendante ? Maria Callas, la Castafiore ou Mariah Carey ? C’est pour découvrir un autre type de divas que j’ai bravé la foule du premier week-end de réouverture des musées à l’Institut du Monde Arabe (IMA). L’exposition Divas, de Oum Kalthoum à Dalida présente ces icônes de la musique et du cinéma du monde arabe, en grande partie méconnue du public occidental. Retour sur une (re)découverte musicale et visuelle.
Une rencontre avec les divas
L’exposition plonge le.la visteur.euse dans l’intimité de ces icônes comme pourrait le faire la presse “people”, relatant leurs amours, divorces et remariage. Il est également question d'exil et de retour en terre natale. Les modules ou salles dédiées aux divas expliquent les moments clés de la carrière de chacune. Le module mettant à l’honneur Dalida permet par exemple de découvrir un pan de sa carrière en Égypte moins connu par le grand public français. L’exposition documente aussi la vie de ces artistes arabes grâce à des interviews inédites, des extraits de presse, des disques, des costumes et parures de scène mais aussi des objets plus personnels leur ayant appartenu. Par exemple, au niveau 2, une vitrine consacrée à Warda expose ses vêtements, son oud, sa valise, ses passeports, son poudrier, son parfum, son livre de chevet ou encore son pilulier. Ces objets personnels sont attendus par les admirateur.rice.s de l’artiste. Par cette mise en vitrine, un statut presque reliquaire est conféré à ces objets du quotidien, créant une rencontre entre le.la visiteur.euse et cette artiste emblématiqVitrine dédiée aux objets personnel de Warda, exposition “Divas, de d’Oum Kalthoum à Dalida” à l’Institut du Monde Arabe © EF
Le parcours : “un voyage en quatre actes”
Le parcours est divisé en quatre sections, déployées sur deux niveaux. Les trois premières parties sont chronologiques.
1920 : l’époque des pionnières. Au rez-de-chaussée, le public est accueilli par une introduction sur le Caire au début du XXème siècle. Dans cette capitale cosmopolite, la musique se popularise avec l’apparition des salles de concerts et des disques 78 tours. Les premières chanteuses participent à la naissance d’une industrie musicale et du cinéma. Elles s’appellent Mounira al-Mahdiyya, Badia Massabni, Bahiga Hafez, Assia Dagher. La transformation est aussi sociale, les développements du féminisme dans la bourgeoisie cairote accompagnent la présence nouvelle des femmes seules sur scène.
1930-1970 : l’âge des grandes voix. Cette deuxième section, introduite par un panneau au rez-de-chaussée, débute à l’étage. Dans les années 1930, l’essor du cinéma parlant et de la radio contribue à la starification des interprètes. Elles sont quatre “voix d’or” ‒ Oum Kalthoum, Warda, Asmhahan et Fayrouz ‒ adulées dans le monde arabe pour leur performances scéniques et leur vie.
1940-1970 : le temps des stars de Nilwood. Dans l’après-guerre, le cinéma égyptien domine avec ses comédies musicales ou ses mélodrames. Les intrigues simples laissent toute la place aux nouvelles égéries du grand écran : danseuses (Samia Gamal), chanteuses (Laila Mourab, Sabah) ou actrices (Faten Hamama, Souad Hosni). Le couloir les présentant une à une s’achève sur Dalida, qui débute sa carrière en Egypte en 1954. Cet âge d’or de l’industrie culturelle égyptienne s’éteint dans les années 1970, marquées par plusieurs crises diplomatiques, économiques et politiques.

Les différentes ambiances des trois sections chronologiques @Marco Zanni
La dernière section évoque l’héritage de ces divas des années 1930 à 1970. Ces femmes ont créé un patrimoine culturel populaire et ont traversé de grands changements sociaux ou politiques. La section contemporaine vient justement questionner leur place et leur héritage au regard du monde arabe contemporain. La réutilisation de ces figures indépendantes en fait des personnalités d’actualité, symbole d'émancipation ou d’une recherche identitaire. Elles peuvent devenir au contraire l’exemple critique de l’instrumentalisation du corps des femmes dans les industries du divertissement.

Nabil Boutros, Futur Antérieur : Par ses photomontages utilisants des extraits de films égyptiens des années 1960, l’artiste interroge les promesses sociales d’une époqueavec un regard critique et nostalgique @Marco Zanni
Ce parcours chronologique, principalement sur l’Egypte et le Levant, est classique mais clair. Les sections s’enchaînent avec la même structure, malgré quelques dissonances : introduction, présentation individuelle des divas, un focus culturel ou social. L’affluence m’a fait remarquer les espaces contraints et sinueux. L’abondance du multimédia et des textes, marqués par la succession des divas, donne une certaine redondance et longueur à la visite. Heureusement, l’exposition reste dynamique par sa muséographie centrée sur la notion de “spectacle”.
De la salle de spectacle...
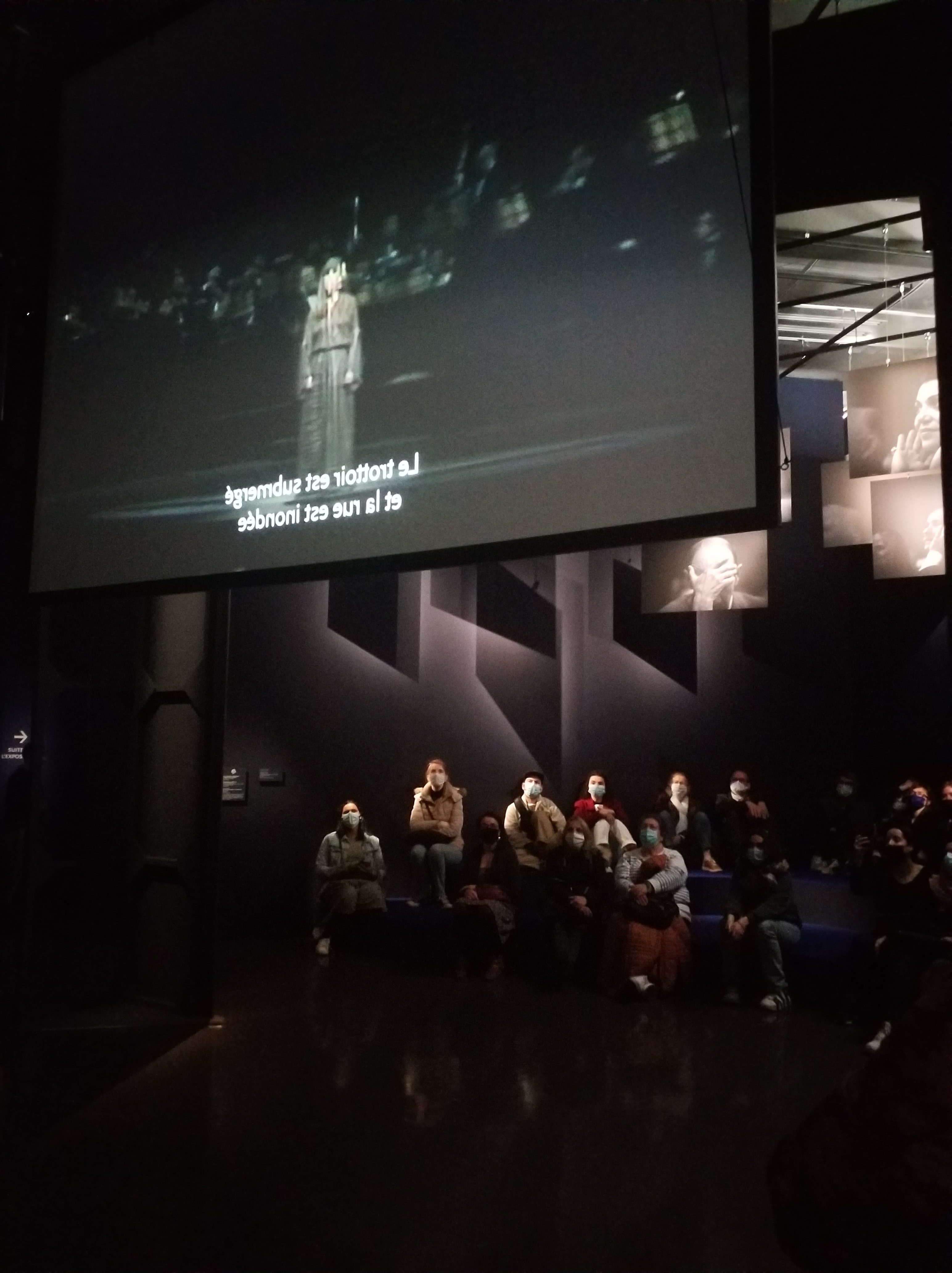
Photo de la salle, avec Fayrouz sur scène @Marco Zanni

Randa Mirsa & Waël Kodeih, Dernière Danse, 2020 @Marco Zanni
La diversité des dispositifs multimédias ou immersifs va de pair avec leur nombre. A noter que la multitude de sollicitations visuelles peut gêner les personnes sensibles aux bruits, aux stimulations visuelles ou aux espaces confinés
… aux vedettes.
Le spectaculaire de l’exposition est également assuré par l’omniprésence de la figure de la vedette, de la diva, de la star.
Les différentes tenues de scène sont ainsi centrales dans l’exposition, en ce qu’elles incarnent la silhouette de la diva autrement que par l’image ou le son. La retenue reste de mise sur le strass et les paillettes : l’ambiance est plutôt celle d’une visite privilégiée en coulisses qu’une débauche de luxe et de sequins. Les robes de scène sont accompagnées de bijoux, coiffes, effets personnels … représentant l’apparence publique et flamboyante des interprètes.

Tenues de Dalida. Le musée a consacré un mini-reportage à leur arrivée dans l’exposition @Marco Zanni
L’emphase est particulièrement mise sur les visages des divas. Elles apparaissent dès l’entrée de l’exposition, projetées sur un grand rideau de fils. Sur chaque panneau leur étant dédié, ces visages apparaissent comme sur des affiches de cinéma. L’en-tête des panneaux, en relief, peut également rappeler les affiches de cinéma. La chanteuse libanaise Fairouz n’est elle pas exposée via ses tenues mais par des affiches placardées sur toute la hauteur du mur.
Des supports plus originaux contribuent à la théâtralisation de la vie des chanteuses et actrices. Celle de la chanteuse syrienne Asmahan est illustrée par une vitrine scénarisée, alternant extraits de films sur plusieurs écrans et des dialogues fictifs diffusés en regard d’objets éclairés.

Vitrine sur la chanteuse Asmahan, chanteuse syrienne divorcée, libre, espionne qui illustre parfaitement l’idée de diva au destin exceptionnel @Marco Zanni
/p>
Une exposition qui se poursuit...
Je ressors de l’IMA avec l’impression d’avoir assisté à une représentation d’anthologie. J’ai surpris plusieurs personnes chantonner leur chanson favorite ou s’émouvoir à la vue d’une vidéo de concert. Difficile de sortir de l’exposition sans avoir des chansons plein la tête, et l’envie d’en découvrir plus. L’IMA a justement mis en place plusieurs dispositifs autour de l’exposition, parfois anecdotiques (un ensemble de filtres Instragram) ou plus documentaires. Une série de mini-vidéos permet d’en découvrir plus sur certaines figures, et une programmation culturelle viendra mettre l’accent sur la place des femmes dans les sociétés arabes. Une playlist donne enfin l’occasion de se replonger dans l’exposition et de continuer de se familiariser avec les grandes voix des divas.
Marco Zanni
Le point de vue d'Elise est à lire ICI !
#divasarabes #IMA #expositionparis

Restitution du Trésor d’Abomey, un acte symbolique
Un contexte politique prédominant
« Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France [...] Je veux que d'ici cinq ans les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. » déclare le président Emmanuel Macron lors de son Discours à l'Université Ouaga I, professeur Joseph Ki-Zerbo, à Ouagadougou (Burkina Faso) le 28 novembre 2017.
Image d'intro : © Sibylle Neveu
Cette déclaration charnière amorce un travail parlementaire et scientifique sur la problématique des restitutions d’œuvres spoliées. Ainsi le 23 Novembre 2018 est rendu le rapport Sarr-Savoy dirigé par l’universitaire et économiste Felwine Sarr, l’historienne de l’art Bénédicte Savoy, sur la restitution du patrimoine culturel africain commandé par le président de la République. Bien que contesté par des conservateurs inquiets à l’idée d’un mouvement qui consisterait à vider les collections, il influence la décision de cette restitution particulière. Ce choix politique tend à la redéfinition des relations franco-africaines, et porte en son sein des enjeux historiques et intellectuels que sont la mémoire coloniale et la nécessité de résilience. Le 26 août 2016 déjà, le Bénin avait déposé une requête restée sans succès. En effet en France, le code du patrimoine a établi depuis l’ancien régime le principe d'inaliénabilité du domaine public, répondant à une posture de responsabilité de l'État, et à la naissance d’une conscience collective de l’intérêt général de ces biens comme res publica. Cela concerne ainsi les biens culturels constituant les collections des musées publics, rendant quasi impossible l’aliénation d’une œuvre. Cependant, un travail parlementaire menant à l’élaboration d’une loi de dérogation à ce principe a rendu possible cette restitution ainsi que le transfert vers le Sénégal du sabre avec son fourreau, dit "d’El Hadj Omar Tall" en novembre 2019.
Le trésor d’Abomey, un bien mal acquis
Le trésor royal d’Abomey ou de Béhanzin, regroupe un ensemble de 26 œuvres ou objets qui furent pillées au Bénin et transportées en France au 19 ème siècle. Il est arraché comme butin de guerre par le général Dodds et ses troupes coloniales en 1882 après le saccage du palais. Le trésor est constitué de statues anthropomorphes de trois rois de l'ancien royaume d'Abomey, les trônes en bois sculpté des rois Ghézo et Glèlè, d’objets d’art et d’objets sacrés comme un tabouret tripode, un récipient et couvercle en calebasse, les portes ornées du palais du roi Glèlè, des pièces de tissu, etc. Ces objets sont envoyés au trocadéro entre 1893 et 1895, puis au musée de l’Homme jusqu’à leur conservation finale au musée du Quai Branly en 2003. Bien que tous les objets africains présents en France ne soient pas issus de pillages, l’accaparement systématique par les troupes coloniales françaises de ces biens souligne la corrélation entre expansion coloniale et expansion des collections favorisant la création et le développement des grands musées ethnographiques français au 19ème.

© Sibylle Neveu
Les murs et les portes des palais d'Abomey étaient ornés de motifs allégoriques faisant référence aux divinités du panthéon fon, groupe ethnolinguistique du Bénin, aux hauts faits des rois, à des épisodes historiques mémorables. Ces ornements permettent le lien entre le roi vivant, ses ancêtres et les divinités vaudou.
Pour les peuples spoliés, pour la jeunesse béninoise, le retour de ces objets représente la possibilité de renouer avec un patrimoine, un savoir-faire, une ancestralité. Nul n’ignore l’importance édifiante de l’art dans l’affirmation culturelle et spirituelle d’une nation, d’une communauté. Originellement, ces objets revêtent un caractère politique, spirituel, ou artistique intrinsèque dont les attributs sont étouffés derrière des vitrines closes européennes. Ben Okri, romancier nigérian disait à propos de la perte de ce patrimoine « Les gens eux- mêmes sont dans une sorte d’exil. Loin du sanctuaire de leurs rêves. »
Ne pas reconnaître le droit de ces pays à disposer de leur patrimoine en leur objectant une présomption d’incapacité à les conserver revient à entretenir une posture néo-colonialiste et infantilisante. Nonobstant, il ne s’agit pas de cloisonner ces œuvres en instituant une posture de restitution automatique mais d’ouvrir un dialogue égalitaire, apaisé entre la France et ses anciennes colonies qui puisse favoriser une circulation de ces biens porteurs d’un héritage universel.
Le musée : un rôle à jouer
Source : capture écran vidéo YouTube chaîne TNT (https://youtu.be/PyY_tjhFNBg)
En 2018 une séquence du blockbuster Marvel Black Panther, illustre la problématique des restitutions du patrimoine africain. Le personnage de Killmonger, jeune homme africain américain, et vilain de la saga Marvel interpelle la conservatrice du musée, personnage condescendant, au sujet des masques présents en vitrine. Il conclut sa tirade par « À votre avis, comment vos ancêtres les ont eus ? Vous croyez qu’ils les ont payés ou qu’ils les ont pris ? Comme tout le reste. » Bien que caricaturale et manichéenne, la présence de cette scène et son fort retentissement au sein des diasporas afro-descendante témoigne de son importance dans le débat public et souligne le rôle du musée dans ce processus. À l’instar du pouvoir étatique, le musée incarne un espace, une institution tutélaire dans l’élaboration de ces réflexions scientifiques, muséographiques, éthiques. Quel est le rôle du musée dans ce processus de restitution ? Selon le rapport Sarr- Savoy 85 % à 90 % du patrimoine africain serait hors du continent. Depuis 2019, hormis le Bénin, six pays (Sénégal, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Tchad, Mali, Madagascar) ont soumis des demandes de restitutions. Au moins 90 000 objets d’art d’Afrique subsaharienne sont dans les collections publiques françaises, sans parler des collections privées.
Ainsi, au-delà de la dimension éminemment politique de cet acte qui interroge sur l’indépendance du musée face au pouvoir politique, la restitution offre la possibilité de repenser le positionnement des musées. D’une part, envisager d’autres options que les restitutions systématiques c’est également repenser les modes de circulations, les modalités d’échanges, expositions, avec les pays concernés. Toujours dans ce sillage, il est nécessaire de poursuivre et de renforcer le travail complexe d’inventaire et de retraçage de l’itinéraire des œuvres. Des questions peuvent être soulevées comme la place du discours postcolonial, la contextualisation des œuvres, l’ouverture d’un débat participatif, une scénographie plus adaptée et peut-être moins esthétisante. D’autre part, alors que l’ICOM a entamé une action de redéfinition de musées, il s’agit de réaffirmer ses ambitions telles que le dialogue des cultures, l’intensification de la recherche scientifique et la nécessité de renforcer ce travail entre les institutions muséales.
Dans ce cas précis, le Quai Branly a intensifié le travail de documentation et de recherches à propos de ces objets afin d’accompagner au mieux la restitution et leur accompagnement. Une exposition du 26 au 31 octobre a eu lieu au musée du Quai Branly en collaboration avec des conservateurs béninois présents à toutes les étapes, le directeur Emmanuel Kasarherou s’exprime en ces termes : “Nous avons décidé avec le Bénin de monter une exposition, de ne pas faire ces restitutions en catimini, avec seulement des caisses qui transitent.” (Le Monde) Ainsi, à partir de novembre, les œuvres regagnent leur terre originelle vers un lieu de stockage temporaire. Elles seront exposées et conservées au futur Musée de l’Épopée des amazones et des rois du Danhomè à Abomey, projet franco-béninois soutenu par l’AFD, aux yeux du peuple béninois qui pourra retrouver l'héritage de ses ancêtres.
Pour aller plus loin :
-
“Restituer ? L’Afrique en quête de ses chefs-d’œuvre” ARTE, film documentaire de Nora Philippe, (83’, 2021)
-
ICOM, Restituer ? Les musées parlent aux musées.
-
Discours sur le colonialisme, Aimé Césaire.
Image vignette : Trois statues des trésors royaux d’Abomey, exposées au Musée du quai Branly à Paris © Sibylle Neveu
#restitutions #QuaiBranly #Bénin
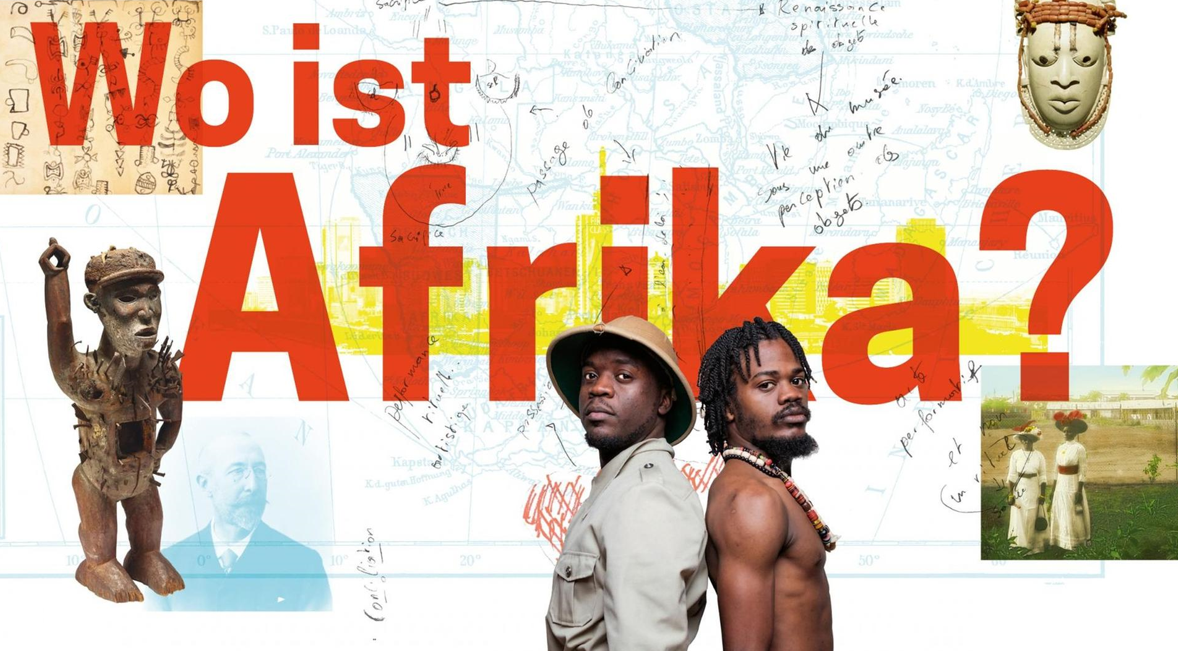
Restitutions de biens culturels au Linden Museum
Les restitutions de biens culturels ont fait l’objet de plusieurs débats ces dernières années, de nombreuses collections publiques européennes ayant été constituées durant la colonisation et le pillage des territoires africains. C’est en 2017, lors du discours d’Emmanuel Macron à Ouagadougou, que la France a réellement entamé une démarche collaborative avec des pays africains, notamment avec le Bénin.[1] D’autres pays européens, dont l’Allemagne, s’étaient déjà engagés dans un dialogue constructif avec les autorités africaines.
En Allemagne, comment cela se passe-t-il ?
Depuis une dizaine d’années déjà, notre voisin s’est engagé avec les structures muséales africaines à restituer des œuvres et objets leur appartenant. En 2022, des œuvres ont été transférées au Nigeria, en Namibie, au Cameroun et en Tanzanie. Le professeur Hermann Parzinger, président de la Fondation du patrimoine culturel prussien, a d’ailleurs déclaré, toujours en 2022, qu’il était important que « les musées allemands aient une attitude très ouverte » sur ces questions, et que l’échange et la coopération étaient les clefs de restitutions réussies.[2] Si cette démarche est bénéfique aux musées africains, qu’advient-il des musées allemands ?
Le cas du Linden Museum
Musée d’ethnographie de Stuttgart, le Linden Museum a été fondé en grande partie durant la période coloniale. Aujourd’hui, l’équipe du musée affiche sa volonté de « prendre des responsabilités face à son passé » et suit les instructions du Deutschen Museumbundes(institution nationale des musées allemands) pour ce qui concerne les restitutions. Ces informations sont consultables sur leur site internet[3], mais dans le musée en lui-même, qu’a-t-il été fait ?
Au début de l’année 2016, le musée s’est réellement penché sur la recherche de la provenance et du contexte de l’acquisition des objets africains. Le musée est organisé de telle sorte que chaque continent a son parcours, dans des salles spécifiques. L’équipe interne a alors choisi de refaçonner les espaces concernant le continent africain afin de relater ses recherches et questionnements. Nommé Wo ist Afrika ? (en français « Où est l’Afrique ? ») ce parcours a été inauguré en 2019.
Wo ist Afrika ?, conçue par qui ?
Ce parcours a évidemment été pensé sur plusieurs années, le sujet étant délicat. Trois ans en amont, l’équipe interne du musée s’est entourée d’habitants de Stuttgart d’origines africaines afin d’ouvrir le dialogue avec ces communautés et ne pas créer de nouvelles erreurs d’appropriation et d’interprétation des collections. La directrice du musée, la Prof. Dr. Inés de Castro, est d’ailleurs particulièrement engagée et alertée sur toutes les questions touchant aux restitutions, c’est elle qui est à l’initiative de ce parcours.
Wo ist Afrika ?, conçue pour quoi ?
Le but de cette exposition n’est donc pas uniquement de présenter les objets mais de redécouvrir les contextes et les récits de ces collections africaines, de les questionner, de découvrir leurs relations avec le musée et avec les peuples africains. L’exposition n’est pas chronologique mais thématique.
La première salle Von Sammlerstücken oder einer ohrenbetaübenden Stille (en français « choses à collecter, ou un silence de plomb »), illustre le décalage entre la frénésie des collectionneurs à l’époque coloniale, et le silence sur la provenance et l’histoire des objets. Nous sommes accueillis par un diorama renommé « Vous êtes là ». Conçue dans les années 1960 à Stuttgart, cette pièce avait pour but de présenter au public un village africain. Le cartel remet en cause son exactitude et alerte sur la différence entre les faits relatés dans l’exposition et la réalité sur place. « Vous êtes là, donc, s’il vous plaît, rappelez-vous : ce n’est pas ‘’l’Afrique’’.»
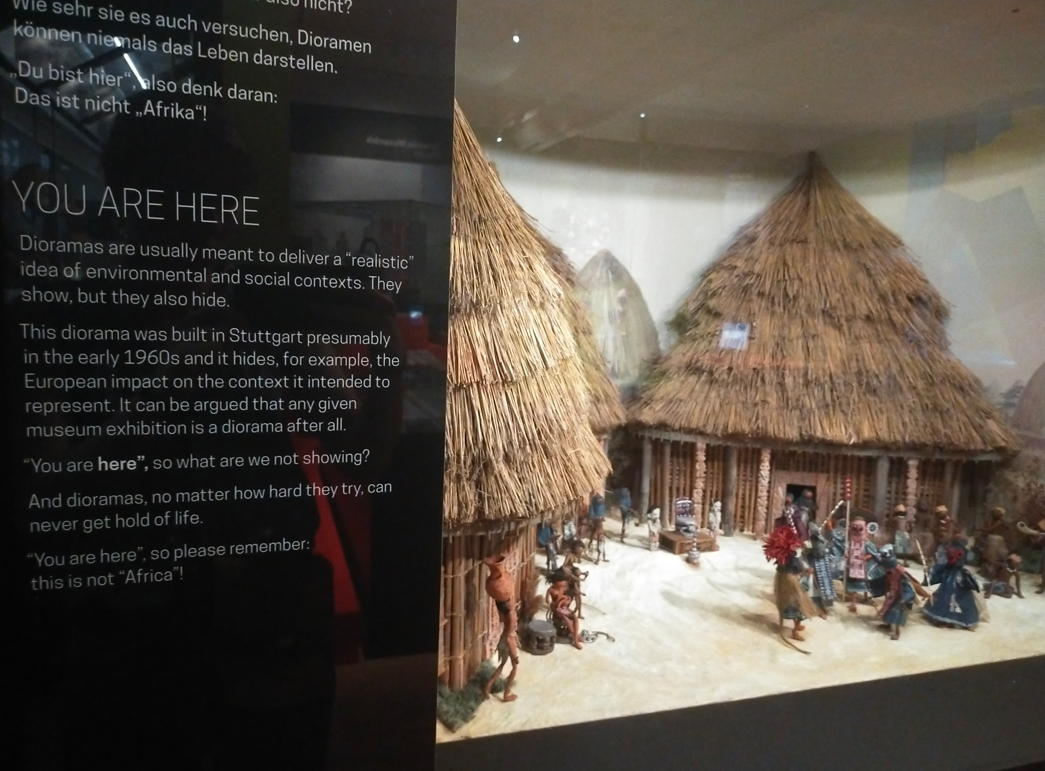
Diorama qui accueille le public, © JD
Dans la deuxième séquence Von S[o]bjekten in Aktion oder kultureller Kreativität(« S[ob]jets performants, ou créativité culturelle »), c’est l’art et l’artisanat de différentes époques qui sont représentés, passant d’une reconstitution d’un atelier de sculpteur de masques à une moto décorée du XXIème siècle.

Deuxième salle de l’exposition © JD
Wo ist Afrika ?, un espace qui évolue ?
Comme les recherches s’effectuent sur le long terme, le musée avait pour volonté de tenir ses visiteurs informés. Une base de données sur un écran, mise à jour régulièrement, permet aux plus curieux de s’informer des dernières découvertes. Certains espaces et dispositifs sont aussi ajoutés au fil du temps.
« Si les objets pouvaient parler » est une installation visible depuis juillet 2023. Un objet des Kikuyu est dans les réserves du musée depuis 1903 mais la base de données interne n’avait aucune information à son sujet. De quoi s’agit-il ? A quoi servait-il ? Y a-t-il encore des gens capables de l’identifier ? Deux cinéastes, Elena Schiling et Saitabao Kaiyare, sont allés au Kenya dans l’espoir de répondre à ces questions. Accompagnés de leur caméra et de l’objet représenté grâce à la réalité augmentée, ils ont interrogé plusieurs personnes. Malgré les différences de générations, les témoignages et réponses sont unanimes : aucun ne comprend pourquoi cet objet, appartenant à leur peuple, leurs ancêtres, se trouve en Allemagne. Cette expédition, présentée par un film, permet au public de faire un pas de côté et de changer de point de vue. Les restitutions ne vident pas les musées, elles enrichissent l’histoire des peuples à qui appartenaient des objets.
Bande annonce "If objects could speak"
Wo ist Afrika ?, et après ?
Dans la troisième et dernière salle Von Bindegliedern oder gemeinsamer Geschichte(« Objets à connecter, ou histoires communes »), les liens entre les Européens et les Africains est au cœur du propos. Par exemple, un espace compare les styles de marché alimentaire, et un autre permet de découvrir un jeu africain très pratiqué. La volonté est de susciter l’interactivité entre les visiteurs.

1ère image : reproduction d’un stand de marché africain comparé à une photo grandeur nature d’un marché européen © JD
2ème image : dispositif pour apprendre à jouer au Mancala © JD
L’exposition se termine sur une vitrine originale : « Qu’est-ce nous allons collecter dans le futur ? ». Un cartel jaune trône au milieu avec un titre : restitué. Une photo d’un objet, son histoire, et c’est tout. Ce masque de chef de tribu, récemment restitué, a tout de même une place importante dans les collections puisqu’il illustre les différents statuts sociaux au sein des tribus. Alors, le musée a décidé d’en garder une trace dans son parcours.

Dernière vitrine du parcours, © JD
Les questionnements autour de la restitution ne se résoudront pas tous en rendant les objets et en exposant uniquement des photos dans les musées européens. Cependant, avec un parcours comme celui du Linden Museum, le visiteur comprend que la restitution n’est pas forcément une perte de valeur pour les musées européens. Ce parcours permet de découvrir une partie du continent africain tout en explicitant les liens du passé, mais aussi le travail qui, aujourd’hui, est conduit autour de ces questions.
Les restitutions n’ont donc pas appauvri les collections, elles ont enrichi le propos, les connexions interculturelles et l’histoire du musée. N’est-ce pas là le rôle d’un musée d’ethnographie ?
Julie Dumontel
Pour en savoir plus :
-
https://www.jeuneafrique.com/1315340/culture/patrimoine-africain-lallemagne-sur-le-chemin-des-restitutions/
-
https://www.deutschlandfunk.de/ausstellung-ueber-kolonialkunst-in-stuttgart-es-geht-um-100.html
#Allemagne #Ethnographie #Restitutions
[1] Article de Carole Assignon, juin 2022 : https://www.dw.com/fr/allemagne-restitution-des-oeuvres-culturelles/a-62293712
[2] Article publié sur le blog concernant la restitution du Trésor d’Abomey au Bénin par la France, par Éva Augustine en 2021 : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2299-restitution-du-tresor-d-abomey-un-acte-symbolique

Retrospective d'une année de pandémie au musée
Voici bientôt un an que la France a connu son premier confinement à cause d’une pandémie au nom désormais bien connu : la COVID-19. Un an que les musées et autres institutions culturelles ont dû fermer leurs portes aux publics, avec certes une petite parenthèse d’ouverture. Un an que les Français sont dans l’attente et l’incertitude. Un an, que nous nous rendons compte, encore plus, de l’importante place de la culture dans nos vies, notre quotidien. Pour ma part, j’ai terminé mes études et mon alternance au sein des Musées de Strasbourg en septembre 2020. Et dès novembre, j’ai éprouvé le manque de cette culture à la nouvelle fermeture des musées. J’aime les musées, ils nourrissent mon savoir et mon imaginaire, ils me font voir le passé, comprendre mon présent et espérer pour le futur. Ils confortent mon regard, le changent parfois, le font grandir toujours. Je sais aussi que cette relation ne va pas que dans un sens, celui de l’attachement du visiteur pour le musée, l’attachement du musée à son public est tout aussi fort. Au-delà de mon propre désarroi face à la fermeture des musées, centre d’interprétation, CCSTI, j’ai voulu savoir comment eux réagissaient et vivaient cette coupure. J’ai donc décidé de prendre le pouls des institutions, est-ce que leurs cœurs battent encore ? Attention spoiler : OUI. Et plus encore.
Pour le premier article de cette série, je me suis tournée vers le tout premier musée que j’ai visité, celui de ma ville natale, le musée d’Art et d’Histoire d’Evreux. J’y ai rencontré Camille Gross, directrice fraîchement arrivée le 2 novembre 2020, trois jours après le début du deuxième confinement et une nouvelle fermeture des musées, mais également Elie Rafowicz, directeur adjoint qui a assuré l’intérim de direction durant l’été. Avec eux nous avons fait le bilan de cette année si particulière, comment garder le lien avec les équipes et les publics, comment occuper les agent·es dans un contexte sanitaire (mais pas seulement) particulier et ce que cela a changé, ou non, dans leur vision de la culture et du rôle des musées.
Garder le lien
Pour une partie de l’équipe, notamment les agent·es d’accueil et de surveillance, la nouvelle fermeture intervenue fin octobre a signifié un retour à la maison. Afin de connaître les équipes, Camille Gross, nouvelle directrice du musée d’Evreux, est venue se présenter quelques jours avant sa prise de poste officielle en novembre. Depuis, le lien se fait par téléphone régulièrement. Si certain·es agent·es ont été redéployé·es dans des résidences autonomes pour personnes âgées afin de veiller au respect du protocole sanitaire par les visiteur·euses, la plupart est assignée à résidence. Comme me l’explique Camille Gross, le ressenti est variable chez les agent·es. Certain·es « ont instauré un nouveau quotidien », d’autres n’ont qu’une hâte : revenir au musée, retrouver les publics et les collections. La relation sociale leur manque. Mais selon la nouvelle directrice, « le retour au travail ne sera pas une évidence », elle prévoit donc de rassurer ses équipes sur le protocole sanitaire validé par la médecine du travail et le référent COVID de la collectivité. En outre, une journée est prévue afin que les équipes retrouvent leur lieu de travail et s’approprient les changements intervenus pendant leur absence : un nouvel accrochage thématique ainsi que la nouvelle exposition dont le commissariat a été réalisé par Elie Rafowicz, le directeur adjoint du musée.
S’il a fallu garder du lien avec les équipes du musée, il a aussi fallu pour l’équipe de médiation et de communication, conserver un lien avec les publics. Comme pour beaucoup de musées, le numérique a été primordial et le service a dû « réadapter ses missions et réinventer sa manière de travailler » m’explique Elie Rafowicz. La page Facebook a été régulièrement alimentée selon un calendrier de publications très dense à destination du public familial et une page Instagram a été créée. Dès la rentrée 2020, le service de la médiation avait lancé des défis numériques à des classes d’écoles du territoire et un lien avait pu être entretenu grâce à l’arrivée d’un référent Éducation Nationale.
Rester occupé
Tout comme le service éducatif, la régie des œuvres n’a pas chômé durant les mois de fermeture. Montage de la nouvelle exposition archéologique, nouvel accrochage thématique dans les salles du musée, mais le service a aussi dû gérer les prêts forcément impactés par la crise, impliquant un suivi accru de la gestion des calendriers. Cependant, la fermeture du musée a permis de se tourner vers des tâches habituellement remises à plus tard par manque de temps : le rangement. En effet, le service a pu réaménager les espaces de travail dans les réserves et ainsi récupérer de la place, qui manque souvent dans les musées. L’équipe a également pu s’atteler à un chantier de reconditionnement.
Mais n’oublions pas non plus que le musée d’Évreux a rouvert rapidement après la fin du premier confinement. Durant cette période, Elie Rafowicz, directeur adjoint, a assumé l’intérim de direction. Il a fallu faire revenir les publics au musée après trois mois de confinement strict, notamment pour l’exposition MMXX de l’artiste bâloise Renée Levi dont deux grands formats sont exposés dans la cour du musée. Mes interlocuteurs m’expliquent qu’un vernissage a eu lieu dans le respect du protocole sanitaire mais que le retour des publics s’est fait difficilement, nécessitant un temps d’adaptation et un besoin de rassurer les visiteur·euses quant aux consignes sanitaires.
Les fermetures prolongées du musée à cause de la crise ont réduit le nombre de visiteurs de plus de la moitié. En effet, sur une année normale, le musée d’Art et d’Histoire de la ville d’Évreux reçoit environ 25 000 visiteur·euses, sur cette année de crise, iels étaient 11 000. Et le retour des publics en 2021 va évidemment être compliqué, comme me l’explique Camille Gross, la visite au musée tient beaucoup de l’habitude, il va donc falloir « dégonfler les angoisses » et « recréer une habitude de visite ».
La fermeture du musée, durant laquelle est arrivée la nouvelle directrice, a bien évidemment mis un coup d’arrêt à la programmation d’évènements ce qui lui a permis de se recentrer sur les collections et d’envisager l’avenir du musée, notamment avec un projet de rénovation et la mise en place de partenariats.

Vue des réserves du musée © Chloé Méron
Renforcer ses convictions
Cette année de crise n’a pas fait cesser de battre le cœur des musées et la passion des personnes qui y travaillent, elle a même renforcer leurs convictions, celles « d’avoir un rôle à jouer au sein de la société ». Pour Camille Gross et Elie Rafowicz, le musée et plus largement la culture, représentent une « bouffée d’oxygène, une soupape de décompression, un moment d’évasion » qui a une importance « quand on voit aujourd’hui les dégâts psychiques des périodes de confinement ». Iels s’accordent à dire que le musée, comme d’autres pans de la culture, contribue à « une forme de thérapie ». Une conviction déjà présente chez la directrice du musée, riche de son expérience au Louvre-Lens, véritable laboratoire de médiations autour de l’art thérapie, mais que cette crise a renforcé. Pour elle le musée « est un lieu de ressourcement physique et psychique ».
Et maintenant...
À la question : « qu’attendez-vous maintenant ? » mes deux interlocuteurs se sont exclamés en chœur « ouvrir ! ». Évidemment, les publics manquent, le musée est quelque peu endormi et attend de retrouver celles et ceux qui sont sa raison d’être. Camille Gross souhaite maintenant « prendre le pouls des habitants par rapport au musée » et même « à l’absence de musée ». Mais pas seulement. L’institution se tourne vers le futur en espérant voir avancer le projet de rénovation mais également de pouvoir élargir son utilisation du numérique avec la volonté de numériser les œuvres afin de les partager avec le plus grand nombre. Une volonté qui devrait pouvoir se mettre en place grâce au partenariat établi avec la Micro-Folie du quartier Nétreville et le concours de la Fabrique des Patrimoines de Normandie. D’autres partenariats devraient voir le jour, notamment avec le spectacle vivant, afin de mettre en place une programmation culturelle pluridisciplinaire et faire vivre le musée d’Art et d’Histoire de la Ville d’Evreux. Car c’est l’essence même du musée, que « ce lieu vive, que les gens se le réapproprient et que cela forme une résistance », voilà la volonté de Camille Gross et Elie Rafowicz qui souhaitent voir le musée devenir un lieu de vie « au cœur de la cité ».

Camille Gross et Elie Rafowicz devant une œuvre de Rénée Lévi © Chloé Méron
Je tiens à remercier Camille Gross, directrice, et Elie Rafowicz, directeur adjoint du musée d’Evreux qui ont accepté de répondre à mes questions, m’ont accueillie au sein du musée et m’ont ainsi permis de prendre une bouffée d’oxygène.
Chloé Méron
#Musées
#Covid
#Toujourslà

Sacré Patrimoine Le temps des cathédrales, est-il culturel ou cultuel ?
Quand on entre dans une cathédrale, une grande porte nous laisse voir un espace tout aussi grand, tant par sa superficie que par sa hauteur. Certains y verront une architecture remarquable, et un refuge de l’histoire des territoires occidentaux, d’autres y verront un lieu de culte où l’on peut encore sentir l’odeur de l’encens de la dernière messe. Cette dualité de visiteur se réunit souvent sur un même point : les guides conférenciers.
La loi 1905 intègre 87 cathédrales françaises, non désacralisées, comme monuments nationaux. Dans ce cadre, ce bâtiment fait partie du patrimoine. Il faut donc le protéger et mettre des dispositifs permettant un accès à sa mémoire par une médiation. L’Etat est donc propriétaire avec des missions assumées par les villes pour mettre en lumière ce patrimoine, et d’autres assumées par l’Église affectataire pour y montrer une autre lumière. Dans ce cadre, l’Etat est responsable de la restauration et peut se permettre de rendre payant certaines parties de la cathédrale comme les tours ou l’accès aux trésors.
C’est là que se pose la problématique : où s’arrête le culte et où commence la culture dans ces lieux qui ont été construits à des faims cultuelles ? La plupart des cathédrales allouent des espaces où le silence est maitre afin de laisser les croyants prier. D’autres interdisent les visites durant les cérémonies. Le choix des dispositifs de médiations et d’expositions est tout aussi intéressants, souvent sous forme d’audioguide pour garder un silence. L’Église aussi peut parfois faire ses propres médiations, mais celle-ci ne sont que très rarement laïque, et peuvent poser questions sur la médiation culturelle du lieu.

Panneau silence à l’arrière du cœur de la Cathédrale d’Amiens 09/10/2025 ©Alys Blanc
Le défi réside dans la gestion pratique de l’espace. La manière dont est définie l’expérience du visiteur culturel et le respect de l’affectation cultuelle. En France, l’État, propriétaire, est contraint de garantir la gratuité de la nef. À Amiens, la gestion de l’espace est fluide entre les visiteurs culturels et cultuels. La nef reste dans un silence religieux, laissant par moments les groupes de visiteurs en quête de petites histoires écouter le guide parlant tout bas. D’autres visiteurs culturels optent pour l’audioguide transmis par l’office de tourisme pour la somme de 6 euros. Le visiteur se retrouve dans une bulle sonore, arpentant le monument sans faire de bruit, participant à cette ambiance de recueillement flottant dans l’air.
Notre-Dame de Paris, quant à elle, se voit depuis toujours assaillie par les touristes, d’autant plus après sa restauration. Notre-Dame de Paris reçoit 12 millions de visiteurs, soit 17 fois plus que la cathédrale d’Amiens. Face au flux de visiteurs, la logique du spectacle s’est imposée : la réservation quasi-obligatoire pour ne pas faire la queue pendant des heures. Même gratuite, celle-ci transpose le lieu de culte dans les codes du grand monument-spectacle. Elle brise l’idée de l’accès spontané pour le culte. Sa splendeur rétablie, les fidèles sont ravis de redécouvrir ce patrimoine, au même titre que les visiteurs culturels. Dans cette chorégraphie de foules chez la grande Dame est proposée sous chaque chapelle, un panneau explicatif des rénovations et des espaces de prière aux pompiers l’ayant sauvée. Mêlant ainsi mémoire patrimoniale et recueillement religieux.
Cet accès gratuit à la Nef en France, n’est pas commune à tous pays. En Espagne, le modèle de laïcité coopérative donne plus de liberté à l’Église. Cela se traduit par une collaboration active de l’État avec les différentes confessions pour organiser leur place dans la société. Le contraste est immédiat et palpable à la cathédrale de Santiago de Bilbao. Ici, dès l’entrée, dix euros sont réclamés afin de visiter avec l’audioguide. L’Église, jouissant d’une plus grande autonomie financière, utilise l’outil culturel (la visite) comme source de revenus directs, là où en France, seuls les trésors et les tours peuvent être monétisés pour la restauration des lieux par l’État. La ligne de partage entre culturel et cultuel, n’est pas spatiale mais temporelle. L’unique garantie de gratuité est l’acte cultuel : la messe. Une fois l’office terminé, l’édifice bascule de nouveau dans sa fonction de monument patrimonial payant.

Photo de la Cathédrale d’Amiens avec deux visites guidées dont une contenant des sœurs 09/10/2025 © A.B.
Le temps des cathédrales est celui d’une cohabitation obligatoire entre le sacré et le patrimoine. La question n’est pas seulement la gratuité ou la monétisation, mais la gestion des nouvelles frontières au sein de l’édifice, qu’elles soient spatiales, sonores ou temporelles. Ces frontières sont fondamentalement poreuses. Le lieu n’est pas divisé ; il est superposé. L’image des sœurs allemandes croisées lors d’une visite guidée à Amiens est l’exemple parfait de cette porosité. Elles écoutent un guide culturel pour un acte de mémoire profondément cultuel.
Blanc Alys
Pour aller plus loin :
https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2116-quand-l-art-contemporain-s-invite-dans-les-eglises-entre-opportunites-et-polemiques
#Cathédrale#Culte#Patrimoine

Salgado Amazônia : plongée sonore dans la forêt brésilienne
Pour une lecture aussi immersive que l’exposition, munissez-vous de vos écouteurs pour écouter la création sonore Amazônia de Jean-Michel Jarre.
Après les incendies très médiatisés de 2019, l’Amazonie a de nouveau fait la une des journaux en mai 2021 en réaction à une étude révélant que la forêt amazonienne brésilienne était désormais émettrice nette de carbone, c’est-à-dire qu’elle rejette désormais davantage de carbone qu’elle n’en stocke. Cette nouvelle alarmante appelle à une prise de conscience de l’urgence écologique et humaine dans laquelle se trouve ce territoire : la déforestation et ses facteurs (exploitation de bois précieux, orpaillage, construction de barrages hydroélectriques, élevage bovin et culture intensive du soja) menacent le biome amazonien en le faisant approcher dangereusement du point de non-retour où celui-ci n’aura plus les moyens de se régénérer. La sécurité et la survie des peuples autochtones est aussi en jeu, l’exploitation illégale des ressources n’hésitant pas à empiéter sur leurs territoires.
C’est à partir du constat de ces prédations que se construit l’exposition Salgado Amazônia, visible à la Philharmonie de Paris du 20 mai au 31 octobre 2021. Plus de 200 photographies de Sebastião Salgado, captées par le photographe au cours de ses nombreux voyages dans la forêt brésilienne entre 2013 et 2019, y sont mises en valeur par la scénographie de Lélia Wanick Salgado. Une création sonore immersive de Jean-Michel Jarre, conçue à partir du fonds d’archives sonores du Musée d’Ethnographie de Genève, entre en dialogue avec ces clichés.
Economiste de formation, Sebastião Salgado débute sa carrière de photographe à Paris en 1973. Il collabore avec plusieurs agences de photographies, dont la célèbre Magnum Photos, jusqu’en 1994 où il fonde Amazonas Images, exclusivement dédiée à son travail. Ses projets photographiques, qui font l’objet de nombreux livres et expositions, le font voyager partout dans le monde. Wim Wenders lui consacre le très beau documentaire Le Sel de la Terre en 2014, qui remporte le prix Un Certain Regard à Cannes. Le projet AMAZÔNIA, consacré à l’Amazonie brésilienne et aux communautés autochtones qui l’habitent, a pour objectif de faire connaître ce territoire et ses habitants et de faire prendre conscience des menaces auxquelles ceux-ci font face. Très engagés pour la causé écologique, Sebastião et Lélia Salgado s’emploient eux-mêmes depuis les années 1990 à reboiser une partie de la forêt atlantique brésilienne dans l’Etat de Minas Gerais, victime de la désertification et de la déforestation. Ils ont créé en 1998 l’Instituto Terra, organisation qui assume des missions de reforestation, de préservation et d’éducation environnementale.
Une plongée visuelle et sonore dans la forêt amazonienne


Photographies aériennes de la forêt amazonienne (vue de gauche)
Jeux d’ombres stylisées au sol (vue de droite) © Marion Roy
Avant même de pénétrer dans la salle, c’est d’abord le son qui enveloppe le spectateur : entre musique concrète et électronique, cette création sonore à la fois inspirée de la bioacoustique et de l’ethnomusicologie saisit par ses basses orageuses et ses mélopées répétitives. Dès l’entrée, la puissance de la musique couplée à la pénombre de la salle transportent le public dans un espace à part, celui de la forêt amazonienne, qui n’est jamais représentée par mimétisme mais toujours évoquée symboliquement à travers une scénographie très minimaliste. Ici, pas de simili-végétaux ni de couleur vert-chlorophylle : les nuances de gris dominent, faisant écho aux photographies en noir et blanc de Sebastião Salgado. Les tirages grand format, encadrés et suspendus à hauteur de buste par un système de filins presque invisibles, sont magnifiés par une lumière qui semble presque émaner de l’intérieur. Cet éclairage crée un jeu d’ombres géométriques, très esthétiques, qui s’entremêlent au sol et mettent en valeur l’objet photographique dans l’espace. La densité de l’accrochage renvoie à celle de la forêt : le visiteur est invité à déambuler entre les quelque deux-cent tirages comme entre autant de troncs, à se perdre sur l’immense plateau ouvert de la salle d’exposition tout en définissant le sens de son propre parcours, en l’absence d’un unique cheminement préétabli. Trois structures elliptiques ponctuent la salle, créant un contraste par leur couleur rouge et leur caractère clos : la forme de ces espaces s’inspire des ocas, habitations traditionnelles communautaires de certains peuples autochtones d’Amazonie, afin de montrer qu’il s’agit d’une forêt habitée, loin de l’image fantasmée d’un « enfer vert » indompté et impénétrable.
Portraits et paysages : visages d’une forêt en péril



Espace ouvert et nuances de gris pour les vues de paysages (vue de gauche)
Espace fermés, formes fluides et couleur rouge des parois des modules inspirés des habitations traditionnelles (ocas) (vue centrale et de droite) © Marion Roy
Le parcours se construit autour d’un dialogue entre ces deux pôles : paysages naturels dans le vaste espace ouvert, portraits de peuples autochtones dans l’espace délimité des ocas.
Afin de rendre compte avec justesse de la diversité du biome amazonien – qui recouvre 63% de la surface du Brésil –, les photographies de paysages font la part belle aux vues aériennes, prises depuis un hélicoptère. Ces clichés, dépourvus de présence humaine, s’organisent selon cinq thèmes principaux : certains, comme celui de la forêt, sont très attendus, tandis que d’autres mettent en valeur des aspects moins connus du territoire amazonien tels que ses zones montagneuses ou l’archipel d’eau douce des Anavilhanas. D’autres encore détaillent des phénomènes spécifiques du biome amazonien, à l’instar des pluies torrentielles et des « rivières volantes » issues de la vapeur d’eau rejetée par les arbres de la forêt, essentielles au renouvellement des stocks d’eau douce de la planète. De courts cartels localisent et contextualisent chaque photographie en lien avec ces thèmes.


Sebastião Salgado, Parc National d’Anavilhanas, archipel fluvial du Rio Negro (Amazonas) (gauche);
Sebastião Salgado, Arbre de la région de la rivière Tapajos, près de Santarém (Pará) © Marion Roy

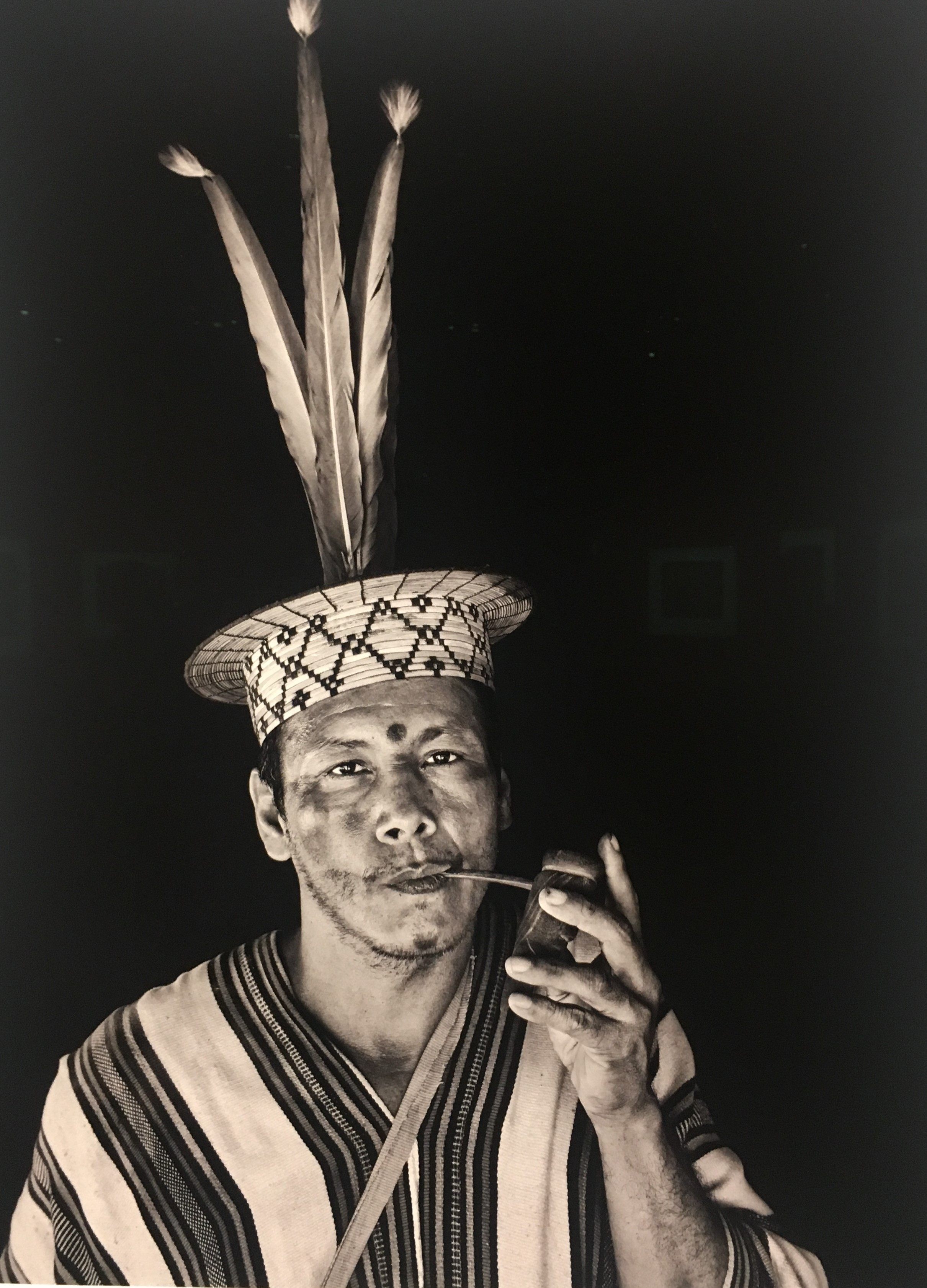

Bela Yawanawá, Village de Mutum, Territoire Indigène du Rio Gregorio (Acre), 2016 (gauche) ;
Chaman Moisés Piyãko Asháninka, Territoire Indigène Kampa do Rio Amônia (Acre), 2016 centre)
Têtê-Shavô, Village Marubo de Morada Nova, Territoire Indigène Marubo de la vallée de Javari (Amazonas), 2018 (droite) © Marion Roy
Ces photographies sont porteuses d’une puissance esthétique indéniable : dans la lignée de sa précédente série Genesis (2004-2011), Sebastião Salgado choisit de montrer la beauté de ce territoire pour convaincre de la nécessité de le préserver. Toutefois, on peut regretter que ces images ne se concentrent que sur l’aspect édénique de cet écosystème, en ne représentant jamais directement la violence des dégradations qui constituent pourtant une réalité de plus en plus préoccupante en Amazonie. Par ailleurs, le choix de séparer les peuples et le milieu dans lequel ils vivent en deux espaces scénographiques distincts, suivant la traditionnelle et occidentale distinction entre nature et culture, semble relativement classique. Cette séparation a néanmoins l’avantage d’être claire et didactique pour un public non spécialiste. Le lien entre les communautés photographiées et leur environnement est en outre établi à travers les vidéos présentées au centre des ocas : celles-ci mettent l’accent sur les luttes autochtones qui sont au cœur des témoignages présentés.
Donner la parole aux peuples autochtones amérindiens

Témoignage vidéo au sein d’un module oca © Marion Roy
Ces courts films documentaires, captés par le journaliste et spécialiste du monde amazonien Leão Serva, donnent directement la parole à des chefs, chamans ou autres représentants autochtones plutôt que de parler en leur nom. La scénographe Lélia Wanick Salgado souhaitait « faire entendre [aux visiteurs] les voix des peuples de la forêt, leur faire comprendre comment ils vivent et perçoivent le monde » (Journal sonore de l’exposition). Le visiteur peut ainsi voir s’exprimer, face caméra et dans leur langue respective, les chefs Afukaka Kuikuro, Kotok Kamayurá, Biraci Yawanawá et Piyãko Asháninka, le chamane Mapulu Kamayurá ou encore Davi Kopenawa Yanomami, le célèbre porte-parole des Yanomami. Ces témoignages viennent compléter les photographies de Salgado en faisant état des problèmes rencontrés par ces peuples face à la situation politique et environnementale au Brésil. Tous les témoignages évoquent les changements dramatiques qui ont eu lieu au cours des dernières décennies : sécheresses et température croissante, incendies, déforestation au profit de l’agriculture, de l’élevage et de l’exploitation du bois, pollution des sols et des rivières du fait de l’activité aurifère, menace des barrages hydrauliques, invasion de groupes de chasseurs… La majorité de ces témoignages n’hésite pas à dénoncer avec force le gouvernement de Bolsonaro, dirigeant climatosceptique qui voit l’Amazonie comme une ressource à exploiter, soutient les gros exploitants de l’agrobusiness et de l’industrie minière et ne cache en rien son hostilité envers les peuples autochtones. De chacune de ces vidéos émane une volonté forte de faire entendre sa voix, de s’organiser afin de résister et de répliquer. Le message qui sous-tend l’exposition passe donc explicitement par ces captations audiovisuelles, destinées à sensibiliser le public occidental à la situation et aux combats autochtones.
Première incursion en territoire bioacoustique
Cette sensibilisation passe aussi par les sens : la forte identité sonore de cette exposition justifie sa présence au sein de la Philharmonie, qui fait ainsi ses premiers pas dans le domaine de la bioacoustique. La création sonore de Jean-Michel Jarre, diffusée en stéréo dans tout l’espace de l’exposition, a été composée en écho aux photographies de Sebastião Salgado. Le pionnier de la musique électronique française, engagé en faveur de l’écologie depuis les années 1970, dit avoir construit cette musique hybride « comme [s’il] disposait d’une boîte à outils, constituée d’objets sonores singuliers », en mêlant des éléments naturels, ethnographiques, orchestraux et électroniques afin d’évoquer la forêt dans l’imaginaire des auditeur·rice·s. Une attention particulière a notamment été portée aux basses fréquences, particulièrement présentes dans un paysage sonore forestier (Journal sonore de l’exposition).
Cette création s’est nourrie des archives du très riche fonds ethnomusicologique du Musée d’Ethnographie de Genève, constitué d’une quarantaine d’heures d’archives dont environ trente ont été recueillies in situ au Brésil et en Guyane entre 1968 et 1992 par des spécialistes du monde amérindien. La composition de Jean-Michel Jarre intègre une quarantaine de sources sonores issues de ces archives, enregistrées entre 1960 et 2019 dans plusieurs lieux de l’Amazonie. A l’origine orientée vers les sons de la nature, cette création accorde finalement autant d’importance à la présence sonore humaine qu’aux éléments sonores non-humains, en accord avec la perspective animiste amérindienne selon laquelle les êtres humains et non-humains partagent la même intériorité. L’audition, la perception et la production du son possèdent une importance particulière du point de vue des peuples autochtones : pour eux, le son permet aux êtres humains, aux êtres invisibles et aux animaux de la forêt de maintenir des liens et de communiquer. La présence de cette pièce sonore au sein de l’exposition permet donc de vivre autrement cette déambulation muséale et d’évoquer la forêt par le sensible.
Deux salles de projection mêlent également expérience visuelle et auditive : des photographies de Salgado y défilent, accompagnées par Erosion (origine du fleuve Amazone) d’Heitor Villa-Lobos – compositeur brésilien qui s’est beaucoup inspiré de l’Amazonie – dans la première salle, et par la création d’un ensemble contemporain brésilien dirigé par Rodolfo Stroeter dans la seconde.
L’intérêt de cette exposition réside justement dans les regards croisés qu’elle porte sur l’Amazonie : regard photographique de Sebastião Salgado donnant à voir la diversité du territoire et des populations qui l’habitent, points de vue des peuples autochtones à travers les témoignages vidéo, évocation sonore de la forêt par la création de Jean-Michel Jarre qui mêle éléments électroniques évocateurs et archives ethnographiques anciennes et récentes. Les perspectives photographiques et musicales, artistiques et documentaires, historiques et actuelles, factuelles et sensorielles, s’enrichissent mutuellement et constituent autant d’entrées possibles pour sensibiliser le public à la complexité du territoire amazonien brésilien et aux menaces écologiques auxquelles il est aujourd’hui confronté.
Marion Roy
Pour aller plus loin :
En parallèle de sa présentation à la Philharmonie, cette exposition ouvrira également à São Paulo, Rio de Janeiro, Rome et Londres, afin d’éveiller le public le plus large possible à la menace écologique qui pèse actuellement sur l’Amazonie.
- La création sonore Amazônia, de Jean-Michel Jarre, est disponible sur YouTube
- Articles et podcasts de la Philharmonie en lien avec l’exposition
- Entretien avec Jean-Michel Jarre
#Salgadoamazônia #Philharmonie #Jean-micheljarre
Salope ! Et autres noms d'oiselles
« Grosse chaudasse », « pute », « sale chienne », « dégueulasse»… et évidemment, « salope ». C’est ce que réunissait l’exposition « Salope ! Et autres noms d’oiselles » à Paris du 29 septembre au 18 octobre 2017 pour une seconde édition, menée par Laurence Rosier, linguiste et écrivaine.
« Salope » ©Eric Pougeau, 2001
A la Fondation Maison des sciences de l’homme, l’exposition mettait l’accent sur un mot, ce mot : salope.
Archétype de l’insulte, ce mot suggère la saleté, la malpropreté, la répugnance, et vise directement les femmes, dites alors « femmes débauchées aux mœurs dépravées » selon la définition officielle. Une insulte qui s’attaque donc à un comportement jugé inapproprié dans une société hautement hypocrite, pensée par des hommes et pour des hommes.
Autour de ces insultes, aux systématiques références sexuelles révélatrices, huit artistes étaient réuni.e.s : Cécilia Jauniau, Sara Júdice De Menezes, Tamina Beausoleil, Martine Seguy, Christophe Holemans, Lara Herbinia, François Harray et Eric Pougeau.
Huit artistes autour de six figures féminines publiques : Marie-Antoinette, George Sand, Simone Veil, Margaret Thatcher, Christiane Taubira et Nabila Benattia.
On peut se demander : quel est le rapport entre Marie-Antoinette et Christiane Taubira ? Entre George Sand et Nabila ?! Une seule réponse : toutes ont été humiliées sous une déferlante d’insultes sexistes.
La mère est la putain
©Tamina Beausoleil
Avez-vous déjà remarqué qu’il n’y a pas d’équivalent masculin au mot « salope » (à ne pas confondre avec « salaud », ayant lui aussi son féminin désuet « salaude »), ou au mot « putain » ? Et, avez-vous aussi déjà remarqué qu’on compare plus souvent les femmes que les hommes à des animaux ? Elle est un thon,une morue, une dinde, une chienne, ou encore une cochonne.
Même lorsqu’on veut insulter un homme, un « fils de pute » nous échappe. Et on se retrouve à insulter sa mère.
Cette réflexion est au cœur des problématiques de l’exposition, qui seveut résolument scientifique, artistique et éducative. Pour Laurence Rosier, il s’agit de « proposer une réflexion en miroir sur l’insulte, à partir d’un choix de figures controversées et mises en regard d’œuvres contemporaines qui interrogent les tabous, la transgression et la féminité ».
Pourquoi insulte-t-on ?
Cette vaste installation entend susciter chez le visiteur une réflexion sur les libertés, les normes, les règles du vivre-ensemble ainsi que sur les discriminations, non seulement sexistes, mais aussi racistes et sociales.
Mathieu GOLINVAUX ©EdA
A travers les différents travaux des artistes, mais aussi à travers la scénographie, on passe de figure en figure, d’insulte en insulte. « Grosse vache pleine d’encre », écrit Flaubert à propos de Georges Sand. « Guenon », scande la foule à Christiane Taubira. « Garage à bites », dit-on de Nabila.
Mathieu GOLINVAUX ©EdA
Puis les portraits de femmes (libres) de Lara Herbina. Des amazones aux Femen pour référence, on peut lire en ces portraits une certaine forme de réappropriation politique de ces insultes. Affirmer ce qu’on est pour contrer ce que l’on dit de nous.
On peut y lire une autre référence : celle du Manifeste des 343, paru dans Le Nouvel Observateur en 1971, présentant la liste de 343 courageuses femmes ayant signer le manifeste « Je me suis fait avorter ». Au lendemain, Charlie Hebdo publiait sa une : « Qui a engrossé les 343 salopes du manifeste sur l’avortement ? »… Charmant.
Alors est arrivé une nouvelle dimension aux insultes : le positionnement.
Femmes libres, capture d’écran vidéo ©Lara Herbina
« Aux États-Unis, Madonna a réussi à se réapproprier les termes de "slut" et de "bitch" avec brio, pourquoi ne pas le faire en France ? », livre Laurence Rosier. Effectivement sont apparus des mouvements comme le « slut walk », soit littéralement « marche des salopes » en français, notamment en 2011 au Canada où des femmes marchaient, fièrement, protestant contre le viol, les violences sexuelles, la culture du viol et la stigmatisation des victimes (appelé aussi « slut shaming »). Il faut alors y lire une ironie qui en dit long, l’ironie de culpabiliser les victimes de viol, en utilisant des termes comme « elle s’est faite violer ». Faux. Elle A ÉTÉ violée.
Une violence verbale, une violence orale constamment vécue, au quotidien, par de nombreuses femmes. Voilà ce que cette exposition a voulu démontrer.
Fin du parcours. On arrive au « mur de la honte », sur lequel chacun pourra inscrire de nombreuses insultes insoutenables, trop employées,trop entendues. De quoi bien se défouler et s'interroger sur le pouvoir des mots.
Puis avant de partir, on frôle le lit en porcelaine conçu par Sara Júdice De Menezes. Un lit défait et immaculé, prêt à accueillir, prêt à réchauffer toutes ces « salopes » trop souvent citées.
©Laura Herbina
Car encore aujourd’hui, beaucoup sont sceptiques quant au féminisme : « on n’en a pas besoin en France » entendra-t-on. Rappeler ces insultes, c’est rendre public le sexisme ordinaire.
J. Parisel
#Féminisme
#8mars
#Journéedesdroitsdesfemmes

Semer la culture, le jardin botanique comme « musée en mouvement »
Face aux enjeux écologiques et sociaux contemporains, les jardins botaniques réinventent leur rôle culturel et éducatif. À la croisée du musée, du laboratoire et du parc public, ils offrent des modèles inspirants de médiation vivante, sensorielle et participative, à même d’inspirer l’ensemble des institutions culturelles.
© Bundesgӓrten 2025
Loin d’être de simples espaces verts destinés à la promenade ou à l’agrément, les jardins botaniques constituent des institutions complexes où se croisent savoir scientifique, transmission culturelle, patrimoine vivant et enjeux contemporains liés à la biodiversité. Historiquement ancrés dans les réseaux savants des universités et des cabinets d’histoire naturelle, ces jardins sont d’abord nés d’un besoin de classifier, de conserver et d'étudier les plantes à des fins médicales, agricoles ou naturalistes. Au fil des siècles, leur rôle s’est élargi, intégrant des fonctions pédagogiques, esthétiques, écologiques et aujourd’hui de plus en plus culturelles.
Dans ce contexte évolutif, les jardins botaniques partagent désormais plusieurs caractéristiques fondamentales avec les institutions muséales : la mission de conservation, la volonté de transmettre des savoirs, la construction de parcours narratifs pour les visiteurs et la mise en œuvre de dispositifs de médiation culturelle. Ils offrent également un terrain fertile pour l’expérimentation de nouvelles formes d’interaction entre publics et contenus, où priment le sensible, l’éthique et l’environnemental. À l’instar des musées, les jardins deviennent aussi des lieux de questionnement sur la place de l’humain dans le monde vivant, sur les récits de l’exploration, du colonialisme botanique et sur les futurs possibles à l’heure de la crise climatique. Dans un monde où les institutions culturelles cherchent à se remodeler, à se rendre plus inclusives, participatives et en prise avec les enjeux de société, les jardins botaniques sont comme des laboratoires d’innovation. Ils déploient des pratiques de médiation où la nature devient support de narration, de contemplation, mais aussi d’engagement. Leur approche souvent multisensorielle, décloisonnée et accessible en plein air, pourrait inspirer une réflexion muséologique renouvelée, ancrée dans une écologie des formes et des relations. Ces dispositifs de médiation, les formes de mise en scène et d’interactions avec les publics peuvent enrichir les pratiques muséales contemporaines.
Les jardins botaniques trouvent leurs racines dans les jardins de plantes médicinales des universités européennes du XVIème siècle, tels que le Jardin de Pise (1543) ou le Jardin des Plantes de Montpellier (1593). Ces espaces étaient initialement destinés à l'enseignement de la médecine, dans une logique de classification et d'observation empirique. Ils se transforment progressivement, à l’époque moderne, en centres d’expérimentation scientifique et en lieux d’accumulation du savoir sur la biodiversité mondiale, notamment grâce à la montée des entreprises coloniales. Le/la botaniste devient ainsi un∙e acteur∙ice central∙e dans la circulation des savoirs et des espèces, souvent au service des intérêts économiques et impériaux. Lucile Brockway (1979) a montré que les jardins botaniques, notamment ceux de Kew (Londres), de Calcutta (Inde) ou du Cap (Afrique du Sud), ont joué un rôle crucial dans la mondialisation des plantes commercialisables (caoutchouc, quinine, thé), révélant ainsi leur ancrage dans des dynamiques d’exploitation et de domination.
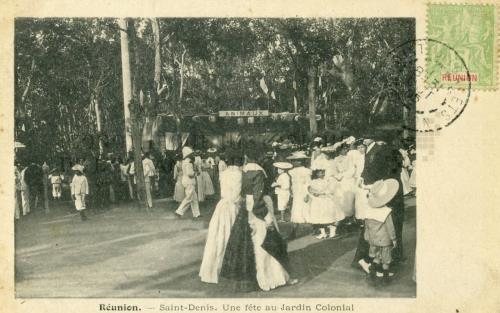
« Saint-Denis, une fête au jardin colonial », (1905-1920), Iconothèque historique de l’océan Indien.
Au-delà de leur fonction scientifique, les jardins botaniques sont devenus des lieux patrimoniaux à part entière, en raison de leur ancienneté, de leur architecture (serres, pavillons), de leurs collections vivantes (arbres remarquables, espèces rares ou historiques), mais aussi de leurs archives botaniques (herbiers, carnets de terrain, correspondances). Leur reconnaissance comme éléments du patrimoine culturel se renforce aujourd’hui, notamment à travers des inscriptions sur des listes patrimoniales locales ou internationales, comme l’inscription du plus vieux jardin botanique au monde créé en 1545, l’Orto Botanico de Padoue (Italie) au Patrimoine mondial de l’UNESCO, en 1997. Ces jardins participent également de l’identité territoriale des villes qui les accueillent. Ils sont souvent considérés comme des « marqueurs symboliques », à la croisée du paysage urbain, du tourisme, et du patrimoine scientifique.

Auteur A. Tosini - G Agostini « dis. in. pictra » - lithographié par « Kiev » ? à Venise. Source inconnue. Réimprimé dans « L'Orto botanico di Padova nell' anno 1842 » par Roberto De Visiani (1842).
Avec leur scénographie végétale, leurs allées thématiques, leurs panneaux explicatifs et parfois leurs expositions temporaires in situ, les jardins botaniques adoptent de plus en plus les codes du musée. Il est possible de parler d’une « muséalisation implicite » du jardin, où les plantes deviennent des objets de médiation, dans une logique à la fois esthétique, didactique et émotionnelle. Les jardins contemporains s’inscrivent alors dans une démarche muséale dès qu’ils organisent un parcours interprétatif, construisent un récit, et mettent en scène une relation entre visiteurs et objets, ici des espèces vivantes. Cette muséalisation passe aussi par une sélection, une conservation (banques de graines, étiquetage) et une transmission des savoirs, au même titre que les musées traditionnels. Certaines institutions illustrent cette hybridation avancée entre musée et jardin botanique. C’est le cas du Muséum national d’Histoire naturelle à Paris, qui a intégré le Jardin des Plantes dans son dispositif institutionnel dès sa fondation officielle en 1793. Le jardin est pensé comme une extension vivante du musée, avec des expositions en extérieur tels que des sculptures animalières (les Éléphants de Lalanne depuis 2012, le Lion flairant un cadavre d’Antoine-Louis Barye en 1854, etc.) , des expositions de biodiversité (ex. : « Préserver la biodiversité : le Jardin des Plantes au secours des animaux en danger » qui a eu de septembre 2021 à septembre 2022, plus récemment dans les Grandes Serres en 2025 « Mille & Une Orchidées »), des dispositifs numériques, des parcours thématiques (comme le sentier de l’évolution) ou encore des projets participatifs (comme l’observatoire de la flore urbaine). Dans d’autres cas, ce sont des jardins botaniques autonomes, par exemple à Genève, Montréal ou Neuchâtel, qui intègrent des salles d’exposition, des médiateur∙ice∙s, des objets patrimoniaux ou des expositions temporaires, fonctionnant selon une logique de musée en plein air.
Plan de l'École de Botanique du Muséum de Paris © MNHN
Malgré cette convergence, les jardins botaniques sont encore rarement intégrés dans les réflexions muséologiques traditionnelles. Ils peinent à être considérés comme de « vrais musées » par les institutions culturelles, en raison de leur nature vivante, de leur statut hybride et de leur dépendance à des logiques scientifiques plutôt qu’artistiques ou patrimoniales. Ils relèvent parfois du ministère de l’environnement, parfois de l’enseignement. Cependant, de plus en plus de chercheur∙se∙s et professionnel∙le∙s plaident pour une reconnaissance pleine et entière des jardins botaniques comme acteurs culturels, capables d’offrir une expérience muséale enrichie, plus ouverte, plus sensorielle et ancrée dans l’urgence écologique actuelle. Les jardins botaniques développent des formes de médiation culturelle innovantes, qui dépassent largement les codes classiques de l’explication scientifique ou naturaliste.
Médiation dans les jardins de l’Epicurium (2017) : un parcours pieds nus pour les enfants © Com’en Histoire
Ces espaces tirent profit de leur dimension vivante et immersive pour susciter une expérience sensible, corporelle, souvent émotionnelle, qui résonne avec les démarches contemporaines de muséographie narrative et incarnée.
Contrairement aux musées où les « normes de participations » sont excluantes de certains comportements : parler à voix haute, toucher, etc. Les jardins permettent une approche multisensorielle : toucher, odeurs, sons, goût, interactions directes avec le vivant, tout en gardant des normes telles que l’interdiction de se rendre dans certaines aires (sortir des sentiers, marcher sur la pelouse). Des initiatives comme les jardins sensoriels tels que le Jardin des Cinq Sens à Yvoire (France), ou certains parcours du Jardin botanique de Genève (Suisse), permettent des visites guidées par les émotions qui mettent en avant la subjectivité du/de la visiteur∙ice et valorisent une relation personnelle au végétal. De plus, plusieurs jardins développent des dispositifs participatifs et inclusifs, allant de la cocréation de parcours à des ateliers de jardinage, de la consultation citoyenne à la médiation par des visiteur∙ice∙s bénévoles. Ces expériences font du visiteur∙ice un acteur∙ice et non un simple spectateur∙ice, rejoignant des dynamiques identifiées dans les musées dits « participatifs ».
Face à la crise écologique, les musées s’interrogent sur leur responsabilité sociale et environnementale. Les jardins botaniques, en tant que lieux historiques de connaissance du vivant, offrent des modèles d’action culturelle à la fois pertinents, accessibles et véritablement contemporains. Les dispositifs immersifs ou sensoriels dans les musées, même non-naturalistes, peuvent s’inspirer de leur pédagogie du vivant, où le public est amené à comprendre par l’expérience. Dans une dynamique de sortie des formats classiques (longues visites guidées, audioguides, supports vidéos, etc.), dans et hors les murs, les jardins offrent une flexibilité muséographique avec des expositions à ciel ouvert, modulables, éphémères ou saisonnières, souvent durables et gratuites. Enfin, l’ancrage territorial et communautaire, généralement très fort dans les jardins via la permaculture, les collaborations avec les écoles, les potagers partagés, peut nourrir une réflexion muséale sur la proximité, la durabilité et l’inclusion des publics. En cela, les jardins botaniques participent à une écologie culturelle : ils proposent une autre façon de faire récit, de faire médiation, de faire lien.
Le Jardin botanique alpin Flore-Alpe (Suisse) propose de nombreux ateliers : découverte des plantes médicinales, peinture végétale, hôtel à insectes, etc. © JBAF-A
Ils invitent aussi à ralentir, à contempler, à écouter, ce que font bien des musées. Cette posture, plus rare dans les musées soumis aux logiques de flux et de performance, peut devenir un contre-modèle fécond.
Les jardins botaniques ne sont donc pas seulement des réservoirs de biodiversité, mais aussi des laboratoires de médiation et de création de lien. À l’intersection des mondes scientifiques, patrimoniaux et culturels, ils inventent des formes originales d’interaction entre publics, savoirs et territoires. Alors que les musées cherchent à se réinventer face aux crises écologique, sociale et culturelle, l’expérience des jardins botaniques mérite d’être prise au sérieux : pour sa capacité à décloisonner les disciplines, à impliquer les publics, à réconcilier l’intellect et le sensible.
Éléa Vanderstock
#JardinsBotaniques #Silenceçapousse #Biosourcé
Bibliographie, en savoir plus :
-
Brockway H. Lucile. Science and Colonial Expansion: The Role of the British Royal Botanic Gardens. Yale University Press, 1979.
-
Clerc Marie, Caviglia Jérôme et Bouju Raphaël. « L’éco-conception des expositions : un enjeu majeur pour les structures muséales et les centres d’expositions », dans : Chaumier Serge et Porcedda Aude (dir.). Musées et développement durable. La Documentation française, 2011, p. 95-100.
-
Frediani Kevin. The Role of Curation in Botanic Gardens: Platforms for environmental and social Transition. Intervention présentée à l'occasion du 2ème Congrès international des jardins botaniques historiques, Vienne, Autriche, 29-31 juillet 2024.
-
Goldstein Bernadette. « Le jardin comme exposition. Pour une muséologie du vivant ». Culture & Musées, 30, 2017, p. 145-163.
-
Grison Pauline. « Les jardins comme lieux et dispositifs de médiation ». Com'en Histoire, publié le 25 janvier 2023. URL : https://doi.org/10.58079/mibj
-
Lenzner Bernd, Latombe Guillaume. « European colonialism has had a lasting legacy on how plants are distributed around the world ». The Conversation, publié le 19 octobre 2022. URL : https://theconversation.com/european-colonialism-has-had-a-lasting-legacy-on-how-plants-are-distributed-around-the-world-192660?utm_source=clipboard&utm_medium=bylinecopy_url_button
-
Nesbitt Mark, Cornish Caroline. « Seeds of Industry and Empire: Economic Botany Collections between Nature and Culture ». Journal of Museum Ethnography, 29, 2016, p. 53-70.

SIDA : de l’oubli aux entrelacs. Une expérience immersive et intime au cœur de Strasbourg
L’exposition Aux temps du sida. Œuvres, récits et entrelacs est présente dans le Musée d’Art Moderne et Contemporain de la ville de Strasbourg (MAMCS) jusqu’au 04 février 2024 pour les 40 ans de la découverte du VIH. En quoi cette exposition, liée à une question de société, nous montre-t-elle que la recherche va de cœur avec la monstration de « la maladie » par le biais de l’art ?
Vue d’installation de l’exposition « Aux temps du SIDA.Oeuvre, récits et entrelacs » au Musée d’Art Moderne et Contemporain de la ville de Strasbourg © M. Bertola / Musées de la ville de Strasbourg
Le SIDA, une maladie de société
L’exposition actuellement ouverte au MAMCS est un témoignage d’une société transformée à jamais par une maladie, un témoignage qui prend ici la forme d’œuvre d’arts. Elle s’ouvre par « Le Couloir du Temps », un mur qui raconte le SIDA sous tous ses aspects à l’aide de textes, de journaux, d’œuvres et d’objets d’aujourd’hui jusqu’à la découverte du virus. Une ligne du temps directement inspirée de la “aids timeline” du collectif d’artistes Group Materialconçu en 1984. Cette introduction rappelle que « le SIDA n’est pas de l’histoire ancienne, il est encore dans notre temps ».

Vue d’installation de l’exposition « Aux temps du SIDA.Oeuvre, récits et entrelacs » au Musée d’Art Moderne et Contemporain de la ville de Strasbourg © M. Bertola / Musées de la ville de Strasbourg
Le SIDA (Syndrome d'Immuno Déficience Acquise) est une maladie causée par le virus du VIH. Depuis sa découverte par l’institut Pasteur, le SIDA n’est pas qu’une maladie d’individus, c’est une maladie de société responsable de la mort de plus de 40 millions de personnes et du bouleversement de la vie de milliards d’autres. Vite apparue à la fin des années 70, le VIH se propageait comme une gangrène dans nos sociétés. Il effrayait et nombre d’atrocités ont été commises. Incompris pendant peu de temps, le SIDA a pourtant rapidement été désigné comme le « fléau homosexuel ». Finalement, qu’est-ce qui a fait le plus de dégâts, le virus ou la société ?
Chacune des salles de l'exposition aborde une thématique en lien avec le SIDA. Celle qui s’intitule « Je sors ce soir », empruntant son titre au roman éponyme de Guillaume Dustan, aux allures de boite de nuit, enveloppée de musiques et de lumière, représente particulièrement bien les risques qu’a fait naître ce virus. Sortir, c’est s’exposer : exposer son corps aux regards, aux rencontres, aux expériences…aux risques. S’exposer à une maladie incomprise. S’exposer à une société aveuglée par la peur. Dans une telle situation, il est normal de se demander « alors, pourquoi sortir ? ». L’exposition nous offre des réponses : par amour, par peur, pour oublier, pour contester, pour soutenir, etc. Face au virus, l’irrationalité dicte nos actions et nos pensées, c’est normal.
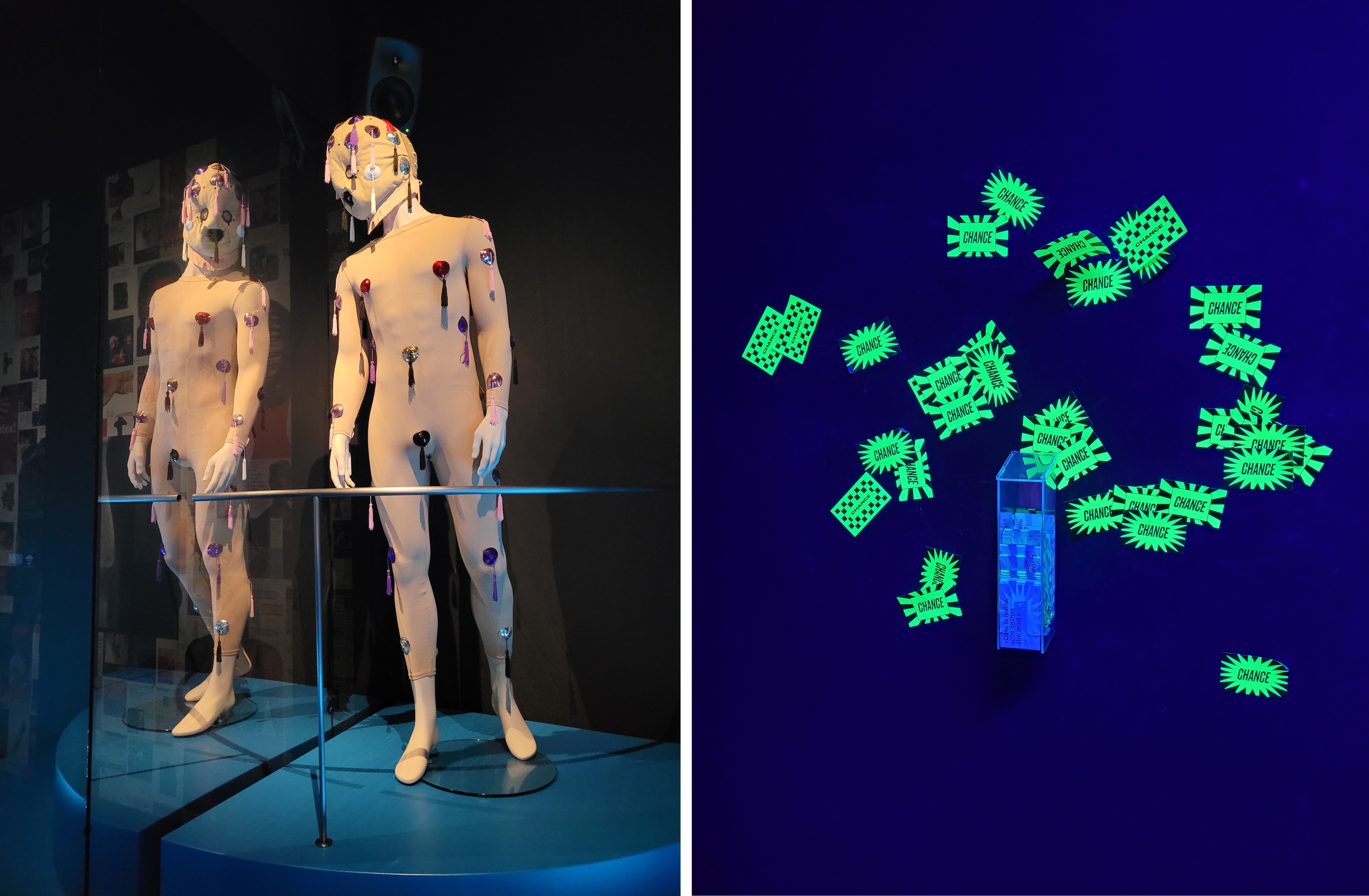
Vue de la salle “Je sors ce soir” de l’exposition « Aux temps du SIDA. Œuvre, récits et entrelacs » au Musée d’Art Moderne et Contemporain de la ville de Strasbourg © Antoine Dabé
Comparée à l’exposition VIH/SIDA du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, l’exposition strasbourgeoises n’aborde pas le sujet suffisamment en profondeur. Les récits et entrelacs annoncés par le titre de l’exposition strasbourgeoise sont relégués au second plan par les œuvres qui dominent. Même exposé dans un musée d’art moderne et contemporain, les questions sociétales de ce sujet d’ampleur doivent rester, à notre sens, une priorité. Nous pouvons néanmoins apprécier la force des œuvres exposées qui choquent et marquent justement, à l’image de cette maladie à la violence inouïe.
Une histoire, globalisée, et globalisante, qui démêle une histoire racisée et pleine de clichés
Le SIDA/VIH est une histoire scientifique, morale, sociétale, mais aussi géographique. Quand l’exposition du MAMCS de Strasbourg nous présente des photographies de Nan Goldin (Photographe Américaine), les œuvres textiles de Fabrice Hyber (Plasticien Français), les grands oubliés sont les pays du “SUD”, les pays où le taux de mortalité de ce virus est le plus élevé, avec plus de 50% des cas d’infection en 2022, et 42% des morts, surtout sur le continent africain.[1]

Vue d’installation de l’exposition « Aux temps du SIDA. Œuvre, récits et entrelacs » au Musée d’Art Moderne et Contemporain de la ville de Strasbourg © M. Bertola / Musées de la ville de Strasbourg
Cet oubli est encore plus net quand ceux de l’hémisphère nord sont très bien représentés. Que ce soit par une photographie de l’artiste Allemand Wolfgang Tillmans représentant une boîte de son traitement contre le virus, aux sculptures de médicament du groupe d’artiste General Idea. La seule œuvre du “SUD” est une toile de l’artiste Chéri Samba, un artiste du Congo qui invite les populations à se rassembler et à protester pour la « Marche de soutien à la campagne sur le SIDA » en 1988.
C’est à ce moment-là que nous réalisons un manque récurrent de contextualisation, que ce soit de la contextualisation de la création de l’œuvre, de l’artiste (nous ne savons pas s’il a décidé de présenter le SIDA en étant séropositif ou non), de sa région, de son pays et de sa génération.
Ce parti pris est aussi marquant du point de vue scénographique. L’agence ROLL, une agence d’architecture new-Yorkaise, a proposé à l'institution un « parcours linéaire ponctué d’ouvertures et de recoupements favorisant la multiplication des points de vue d’une thématique à une autre. »[2] Or, le premier tiers de l’exposition est le plus captivant, entre le mur de présentation et d'accueil (Un signe des temps) à la salle conçue autour d’une moquette rouge et d’une grande tapisserie de Fabrice Hyber, dont nous ne voyons qu’une face. Les deux suivants s’habillent de blanc et nous offre une scénographie “White Cube”, à l’allure d’un hôpital, faite de petite antichambre et de structure en bois. Ce choix traditionnel de présentation des œuvres dessert le propos sociétal et historique, sauf à insister sur un aspect clinique froid.
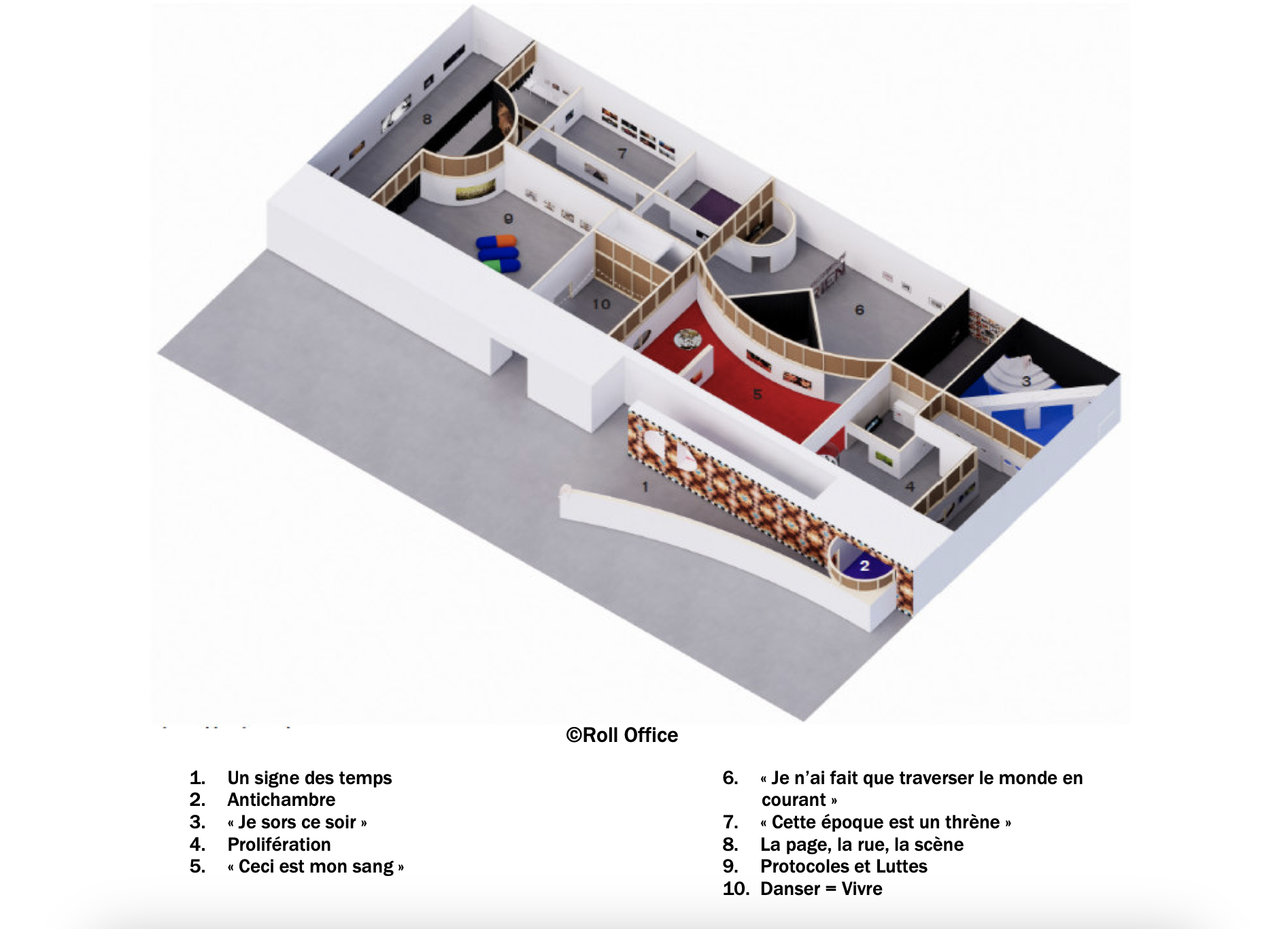
Scénographie de l’exposition « Aux temps du SIDA. Œuvre, récits et entrelacs » par l’agence © Roll Office
Alors, en quoi l’exposition de Strasbourg est-elle innovante sur ce sujet de société ? La valeur artistique des objets et des œuvres prévaut sur le contenu scientifique, ce qui ne nous semble pas pertinent compte tenu de ce qui est abordé.
Mais, dans le hall central du musée, appelé communément la nef, se trouve un espace gratuit avec sa propre programmation : la « Permanence ». Ce “lieu dévolu à la rencontre, à la pause, à l’échange”[3], permet de réunir des médecins, des spécialistes et des associations autour de la lutte contre ce fléau du 21e siècle. Entre conseil, éducation sexuelle et campagne de mécénat pour la recherche scientifique, ce lieu, intimiste, permet à chacun de montrer son intérêt, pour soi comme pour les autres, de se protéger afin de continuer à vivre et à créer. Ainsi, par cette « Permanence », le musée d’art s’ouvre pour devenir un lieu d’échange et d’expression citoyenne, un lieu de société.
Antoine Dabé & Lucas Gasgar
Pour en savoir plus :
- Visite de l'exposition « Aux temps du sida», disponible à l’adresse URL : https://www.youtube.com/watch?v=PIC6mki83eI&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.musees.strasbourg.eu%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo.
#SIDA #ArtContemporain #MuséeArtModerne
[1] Voir sur la page de l’exposition sur le site des musées de Strasbourg. Disponible à l’adresse URL : https://www.musees.strasbourg.eu/aux-temps-du-sida.-%C5%92uvres-r%C3%A9cits-et-entrelacs. Consulté le 29 janvier 2024.
[2] Dossier de presse de l’exposition « Aux temps du SIDA. Récits et entrelacs », disponible à l’adresse URL:https://www.musees.strasbourg.eu/documents/30424/437952888/DP_FR_AUX+TEMPS+DU+SIDA.pdf/a30b06a5-5f6b-a311-21cc-b06c9f93393e?t=1694695008040. Consulté le 29 janvier 2024.
[3] Fiche d'information — Dernières statistiques sur l'état de l'épidémie de sida | ONUSIDA, disponible à l’adresse URL : https://www.unaids.org/fr/resources/fact-sheet. Consulté le 29 janvier 2024.
Sortir des clous (1/2) : Barcelona Flashback, de l’autre côté du miroir
« Sortir des clous » est un diptyque de deux expositions invitant les visiteurs et visiteuses à reprendre le contrôle de la réalité qui s’offre à eux, et à entrer en action. Premier épisode, le Musée d’histoire de Barcelone (MUHBA) et son exposition « Barcelona Flashback », ou comment transmettre les connaissances nécessaires à l’exercice du droit de la ville ?
Salle « Battements urbains » © JT
Le MUHBA, un musée de la longue traîne ?
Le « kit minimum de connaissances » sur Barcelone
Radiographie urbaine, ou la discipline géographique
Salle des « paysages » © JT
Objets-témoins
A travers la géographie, le visiteur a désormais une image assez claire de ce que représente Barcelone aujourd’hui, il est alors temps de se demander commentnous en sommes arrivés là. La salle des témoignages ne regroupe pas des interviews, mais plutôt des objets de toute sortes. Et ils nous parlent :
Certains pensent que je serais mieux dans un autre musée, je ne le vois pas de cette oreille ! Regardez la carte des appels !
Téléphone public à pièces. Composants plastiques et électroniques. Fin du XXe siècle.
Des archéologues m’ont trouvé dans le district de Raval. Où étais-je quand certains se faisaient tuer dans la rue au temps des pistoleros ?
Revolver, XIXe siècle.
Un premier point de vue est tissé, où l’objet est témoin, où sa parole et ce qu’il symbolise prime sur sa fonction. A ce moment du parcours de visite, l’objectif est que les visiteurs et visiteuses aient une idée suffisamment précise de l’histoire vécue de Barcelone et de sa géographie pour commencer à aborder son histoire. Une fois que l’avocat a établi les premiers faits et écouté les témoins, il va commencer à écrire l’histoire, faire un récit.
Salle des « témoignages » © JT
L’histoire par le geste

Vue du pivot d’amphore de la première salle historique © JT
Plus loin dans le temps, une affiche sur les Olympiades populaires de 1936 et une autre question toute d’actualité : « quel est le lien entre Hitler, l’Olympiade et la guerre civile de 1936 ? ». Juste à côté, une petite figurine nous demande : « Quelle mission avait ‘el més petit de tots’ (le plus petit d’entre eux) ? ».

Vue de la seconde salle historique © JT
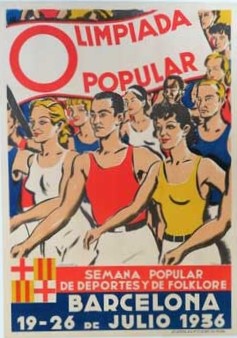

Affiche des Olympiades populaires de 1936 et vue de la figurine El més petit de tots © JT
Connaitre Barcelone pour connaître sa ville
La dernière salle de l’exposition invite le visiteur à connecter l’histoire urbaine de Barcelone à celles des autres capitales européennes. Le dispositif numérique Europa Inter Urbes est un projet mené par le MUHBA en coopération avec les autres musées de ville de son réseau européen pour comparer les villes contemporaines depuis 1850. Cet outil interactif donne la possibilité de comparer dates, données statistiques et photographies pour compléter la « radiographie » de Barcelone.
Dispositif Europa Inter Urbes © JT
Le « kit de connaissance minimal » que nous apporte Barcelona flashback est un appareil critique initiant les visiteurs et visiteuses aux études urbaines et à leur interdisciplinarité. La force de la muséographie du MUHBA est de nous accompagner dans la découverte de la recherche scientifique, ce qui est à la fois une force et une faiblesse, l’exposition n’étant pas calibrée pour le jeune public. De manière générale, on pourrait reprocher à la muséographie de trop se prendre au sérieux et de ne pas ménager aux visiteurs et visiteuses des espaces ludiques permettant d’approcher la connaissance d’une autre manière. Il n’en reste pas moins que Barcelona flashback est une source d’inspiration pour tous les musées de ville.
Julien Tea
Pour en savoir plus :
- ROCA I ALBERT Joan et MARSHALL Tim (eds.), European City Museums, Barcelone, Ajuntament de Barcelona : Museu d’Història de Barcelona, 2023.
#Espagne #MUHBA #Museedeville
[1] Calcul réalisé additionnant les chiffres de fréquentation de 2022 du musée ainsi que de ses espaces patrimoniaux.
[2] Trois moments épistémologiques ont conduit le musée à devenir un laboratoire du musée de ville de demain. Le premier moment date de début 1993, quand a lieu le tout premier colloque international dédié aux musées de ville, à un moment où l’UNESCO cherche à inscrire l’urbain dans son périmètre patrimonial. Le second moment est la formation de l’International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities (CAMOC-ICOM) qui crée à partir de 2008 un réseau global des musées de ville. Un réseau plus régional et informel est créé à l’initiative du MUHBA en 2010, donnant lieux à une déclaration commune en 2013 qui préfigure la philosophie du MUHBA.
[3] Cette théorie, imaginée par Chris Anderson en 2004 dans le magazine Wired, est une adaptation de la théorie mathématique de la longue traîne.
[4] Voir le dossier de presse du 29 mars 2023.
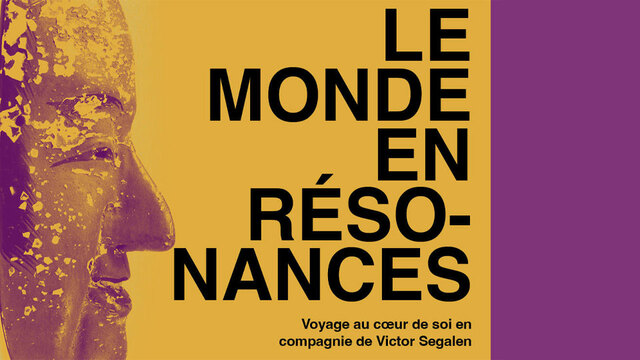
Sortir des clous (2/2) – se dérouter, pour mieux se retrouver, le monde en résonances
Ce deuxième volet de « Sortir des clous » est consacrée à l’exposition Le monde en résonances : voyage au cœur de soi en compagnie de Victor Segalen au Musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux, à voir jusqu’au 30 mai 2025. Pensée comme un dispositif expérimental de psychologie de l’orientation, elle invite les visiteurs et visiteuses à « répondre mieux et de façon ‘créative’ à des changements ou des transitions plus ou moins subies » dans leur vie personnelle.
Espace d’introduction de l’exposition © JT
Respirer, inspirer, expirer

Résonance 5 : Les traces. © JT
Ces moules, la cinquième résonance de l’exposition, sont un pont entre la démarche clinique de Jacques Pouyaud, l’œuvre littéraire de Victor Segalen et la philosophie libératrice d’Hartmut Rosa. Écoutons ce dernier :
« Nous sommes non aliénés là où et lorsque nous entrons en résonance avec le monde. Là où les choses, les lieux, les gens que nous rencontrons nous touchent, nous saisissent ou nous émeuvent, là où nous avons la capacité de leur répondre avec toute notre existence »[1].
 |
 |
Espace intérieur et espace extérieur © JT
La dérive en ville
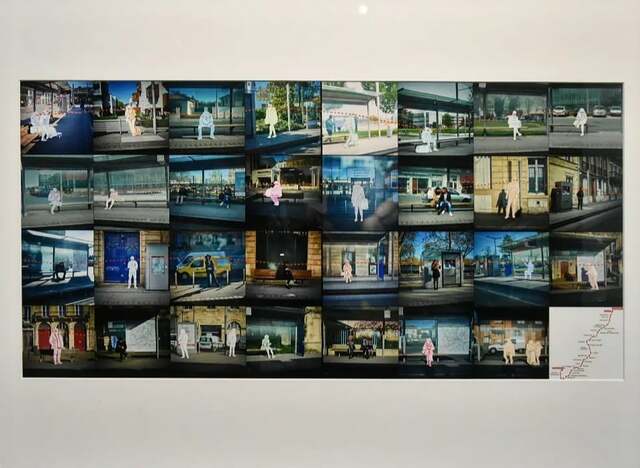 |
 |
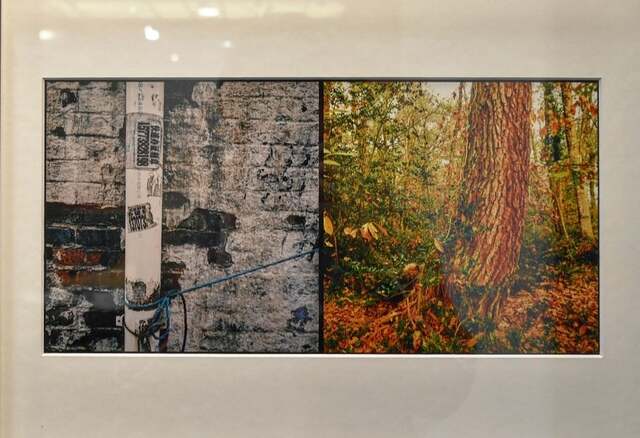 |
Trois des 5 projets photographiques (Les événements de vie et le parcours, L’identité, Le milieu de vie) © JT
 |
 |
Deux objets sans cartel scientifique, le premier appelé « sacrifice », le deuxième « les félures » © JT
« Une ou plusieurs personnes se livrant à la dérive renoncent […] aux raisons de se déplacer et d’agir qu’elles connaissent généralement, aux relations, aux travaux et aux loisirs qui leur sont propres, pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et de rencontres qui y correspondent »[3].
« Nous devons mélanger intimement des zones d’ambiance évoquant la ville et des zones d’ambiance évoquant l’intérieur d’une maison. […] Je considère ce mélange intérieur-extérieur comme le point le plus avancé de notre construction expérimentale »[4].
La stèle, l’objet et la résonance
- Face au midi - la Loi (律), les règles et normes qui s’imposent à nous : quelle est votre expression ou devise préférée ?
- Face à l’Ouest – l’adversité (挑), construire du sens pour surmonter les épreuves : vous faites peut-être face actuellement à des choix, des transitions ? Quelles questions vous posez-vous sur vous-même et votre parcours de vie ?
- Face au Nord – l’amitié (朋), quête d’un milieu de vie par l’intermédiaire d’autrui : quels journaux, séries, émissions, radio, site internet, etc… aimez-vous consulter ou suivre régulièrement ? Décrivez ce que l’on y trouve et les personnes qui y participent.
- Face à l’Est – l’amour (愛), hybridation de deux récits individuels en une forme partagée : quand vous aviez entre 6 et 10 ans, qui étaient vos héros ? En dehors de vos parents, quelles personnes étaient pour vous des modèles que vous admiriez, qu’ils soient réels ou fictifs ?
- Au centre - le soi (中), perdre le midi quotidien : quel est votre plus ancien souvenir d’enfance ?
- Au bord du chemin – (道), chemin fait de hasard et de rencontres : quel serait votre livre, roman, film de chever à emporter sur une île déserte ? Quelle histoire raconte-t-il ?
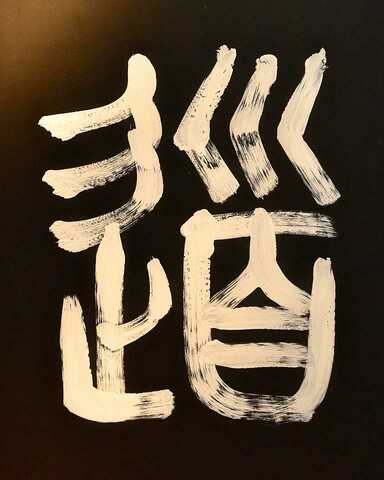 |
 |
Idéogramme calligraphie et espace d’« Au bord du chemin » © JT
Un espace de participation ?

La vitrine centrale est participative, une visiteuse y a déposé une paire de chaussures de danse © JT
Conclusion
Pour aller plus loin :
- Cohen-Scali Valérie, Psychologie de l’orientation tout au long de la vie: défis contemporains et nouvelles perspectives, Malakoff, Dunod, 2021.
- Poyaud Jacques, L’entretien sculptural d’orientation, Habilitation à diriger es recherches, Université de Bordeaux, Bordeaux, 2022.
- Rosa Hartmut, Zilberfarb Sacha et Raquillet Sarah, Résonance: une sociologie de la relation au monde, Paris, la Découverte, 2018.
- Segalen Victor, Stèles, Pei-King, Pei-T’ang, 1912.
Notes

Souvenirs du musée de la Ruhr
A quelques kilomètres d'Essen en Allemagne, le Ruhr Museum conserve l'histoire de cette région très marquée par l'industrie du charbon. Quelle expérience de visite de cet ancien site minier, au cœur du plus grand bassin minier d'Europe ?
Panorama depuis le toit du bâtiment. ©OH
Au loin, nous distinguons les bâtiments d’un rouge brique. La célèbre forme des mines de charbon se détache du paysage. Nous lisons sur la brique « Ruhr Museum ».
Arrivées au pied du bâtiment, la hauteur des murs nous surpassent. Pour entrer au musée, quelques dizaines de mètres plus haut, nous montons dans l’escalator. Au fil de la montée, le panorama se dévoile avec ses étendues de forêts.
Nous arrivons à un vaste étage. Le comptoir de l’accueil est au centre. Des panneaux en allemand sont suspendus pour indiquer des directions. Une fois le billet de visite en main, un plan du site nous permet de constater l'ampleur du site. Ancien centre minier, l'espace d'exposition permanente fait 4 500 mètres carrés. A cela, s'ajoute 1 000 mètres carrés d'espaces d'expositions temporaires. Un détour au vestiaire pour déposer nos effets personnels, le regard rieur de la surveillante des casiers à entendre notre accent français dans les « Hallo » qui retentissent gaiement.
La scénographie a été faite par HG Merz, un studio de Stuttgart. La visite commence par une cage d’escalier, indiquant que nous sommes à vingt-quatre mètres du sol. Nous lisons « Panorama », un mot facile à comprendre, transparent. La curiosité nous pousse à suivre ce panneau qui tapisse plusieurs espaces du lieu. Nous montons. 45 mètres. 54 mètres. 65 mètres. Nous voici en haut du bâtiment : le paysage reste marqué par l’industrie. En effet, la région de la Ruhr contient le plus grand bassin industriel d’Europe. Ce dernier commence au sud de l'Angleterre, descend jusqu'au nord de la France, celui de la Belgique et se termine en Allemagne. La présence de charbon a multiplié le nombre de sites industriels. De ce fait, la région regorge de sites classés au patrimoine de l’UNESCO, de musées retraçant l’histoire de la mine, transformations de sites industriels en « coulée verte », pôle de recherche et haute technologie. Le devenir de ces structures monumentales recèle bien des enjeux politiques.
Puis vient le moment de comprendre l’histoire de cette région, en redescendant étage par étage dans un voyage pensé comme la descente du charbon. Des escaliers aux teintes jaunes orangées nous rappellent le feu des mines. La collection est riche de 25 000 pièces géologiques, archéologiques et historiques. Certains objets ont plus de 120 ans. La collection de sciences naturelles et d'archéologie vient du monde entier, mais la grande majorité provient de la région de la Ruhr. Ces dix dernières années, la valorisation s’est concentrée sur l'histoire naturelle de la région, en particulier les environnements de travail et de vie à l'ère industrielle.
Escaliers du musée de la Ruhr. ©OH
Dix-huit mètres. Première salle. Le mot « Présent » se détache du reste de l'espace. Accueillies par des cimaises en forme de rubans Leds blancs, des photographies, des visages, des instants capturés sont maintenant exposés comme témoins d’une époque. Nous traversons cet espace qui met en scène l’histoire du lieu, non sans une once d'attachement à ces images, témoins de leur temps. Un contraste intéressant joue avec notre perception de la salle : le blanc éclatant des cimaises irradie dans la pénombre de la pièce dont la structure est restée intacte.
Des colonnes blanches ponctuent la salle au fond de l’étage. Leur blanc perce la pénombre pour mettre en lumière un objet dans chaque colonne. À la fois mémoire collective et signe du temps, les éléments racontent, chacun à leur façon, un usage, un savoir-faire. Nous déambulons entre les colonnes sans en voir la fin. Des objets du quotidien, des éléments plus atypiques, des matières... Tous utilisés dans le passé. A la sortie de cette salle, le fil coupé d'un ascenseur rappelle la fin de l'industrie du charbon. Nous prenons conscience de l'importance d'illustrer les mémoires, les souvenirs encore présents.

Espace d'exposition du premier étage. ©OH
La visite continue. Nous descendons. Douze mètres. Étage sur la mémoire. Un sens large est donné à ce mot. Cela nous surprend : la mémoire est si souvent rattachée aux rapports sociaux et non aux éléments biologiques. L'espace d'exposition comprend des fossiles, des statues, des strates de la couche terrestre, des animaux empaillés, des paysages d'une autre époque... Nous voyageons des premiers vestiges de vie aux espèces contemporaines. L'exposition prend vie dans le bâtiment très peu modifié après la fermeture de l'industrie. La scénographie garde les pleins et les vides de l'espace : des fossiles au fond d'un silo, des statues dans le recoin d'une voûte... L'éclairage est tamisé, l'ambiance intimiste. Nous nous sentons liés à ces objets, curieux de comprendre leur présence ici. Les cartels sont épurés, les textes de salles sont disponibles sur une application développée par le musée. Nous permettant de comprendre la visite en français, ce logiciel décompose le musée en différents secteurs, en dehors des pôles pré-définis. Un texte, lu par une voix numérique ou par soi-même, donne les clés de compréhension de chaque espace.
Nous poursuivons. Un étage plus bas. Six mètres. Nous lisons « Histoire ». Un mot valise qui nous questionne. Toute cette visite n'était-elle pas là pour faire vivre l'histoire du site ? Située dans une ancienne pièce de triage du charbon, cette partie de l'exposition est traitée tout en longitude pour représenter une perspective temporelle. L'espace est décomposé comme le récit d'un roman, nous en ressentons des chapitres. 5 chapitres pour présenter l'histoire de la Ruhr. Le prologue débute à la formation du charbon il y a plus de 300 millions d'années. Puis, l'histoire continue avec une allée au centre de la pièce. Incitant le visiteur à s'allonger, des images projetées au plafond évoquent les débuts de l'industrialisation, l'essor de l'industrie du charbon et de l'acier puis vient l'industrialisation de masse. Sur un autre dispositif, sont illustrés les ravages de la guerre, la reconstruction et l'évolution structurelle, encore questionnée aujourd'hui. Le reste de l'exposition est en dehors de notre champ de vision, pour un voyage hors les murs. Parallèlement, nous découvrons sur la lignée voisine les aspects politiques, économiques, sociaux de l'industrie de la mine aux différentes époques : le monde du travail, le mouvement ouvrier, l'immigration, l'évolution de la population et leur mode de vie. Enfin, nous observons les conditions naturelles et conséquences de cette industrie : les matières premières, la destruction de l'environnement et les programmes de renaturation. Une ouverture laissant place aux questionnements qui découlent de la place de l'industrie de nos jours. Le musée semble très conscient des enjeux environnementaux, sociaux, durables... Entre souvenirs et avenirs.
Olympe HOELTZEL
Pour en savoir plus :
#expositions #Allemagne #histoire

Spoliations nazies : exposer, entre tabous et nécessité
Le 17 avril 2019, ont été rendus publics les statuts de la Mission de recherche et de restitution des biens spoliés entre 1933 et 1945, créée par le ministère de la Culture dans le but d’étudier les biens au passé trouble dans les musées français, étrangers ou présents sur le marché de l’art. Depuis quelques années et à chaque restitution, le sujet des spoliations d’œuvres d’art pendant la Seconde Guerre mondiale passionne le grand public et les expositions sur ce sujet se succèdent depuis l’après-guerre, mais ne se ressemblent pas.
De 1939 au années 1950 : des spoliations aux premières expositions
L’art a occupé une part importante dans la politique et la suprématie voulue par l’Allemagne nazie : rejet de l’art moderne considéré comme dégénéré, création du musée du Führer à Linz et accaparement des biens des Juifs d’Europe. Le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris et dès fin aout, l’ambassadeur d’Allemagne Otto Abetz commence à saisir les biens de collectionneurs et marchands d’art juifs. Les pillages seront ensuite dirigés par l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), aidé des politiques du régime de Vichy comme l’aryanisation des biens. Les objets confisqués transitent d’abord au Louvre puis dès octobre 1940 au Jeu de paume où Rose Valland, attachée de conservation française, note clandestinement les mouvements d’œuvres durant la guerre. Au total, près de 100 000 objets sont envoyés en Allemagne et 60 000 reviennent à la Libération grâce aux Alliés et aux fameux Monuments Men connus du grand public depuis le film homonyme de Georges Clooney en 2014. De ces 60 000 œuvres revenues, 45 000 sont restituées aux familles dans l’immédiate après-guerre grâce au travail de la Commission de la Récupération Artistique (CRA).

« Salle des martyrs » du Jeu de Paume où étaient stockées les œuvres d’art considérées comme dégénérées dans le but de les détruire ou les échanger contre des œuvres plus classiques appréciées des nazis. © 1940. Archives du Ministère des Affaires étrangères.
Entre juin et août 1946, une exposition est organisée à l’Orangerie des Tuileries intitulée Les chefs-d’œuvre des collections privées françaises retrouvées en Allemagne par la Commission de récupération artistique et les services alliés. Cette exposition ne s’intéresse pas vraiment à la provenance des œuvres ni aux « collections privées françaises » mais mentionne plutôt dans le catalogue, le destin des œuvres pendant la guerre comme celles destinées au musée d’Hitler ou celles choisies par Goering pour sa collection particulière. Le but de cette première exposition, quelques mois après la signature de l’armistice, est de montrer idéologiquement, ce que représente le pillage de ces collections privées. L’Etat semble se les approprier dans le texte d’introduction du catalogue, rédigé par Albert S. Henraux, président de la CRA :
« Voilà nos chefs-d’œuvre revenus sur la Place de la Concorde, théâtre de la dernière bataille de la capitale et de sa délivrance. Guérie de ses blessures, elle aussi, l’Orangerie les recueille après leur long exil et les replace, à l’ombre des drapeaux alliés, dans leur atmosphère, celle de Paris et de la France. »
En 1949, une exposition est consacrée aux bibliothèques spoliées à la Bibliothèque de l’Arsenal, les « Manuscrits et livres précieux retrouvés en Allemagne » et la CRA est dissoute cette même année. 15 000 œuvres restent sans propriétaires. Il est décidé d’en vendre 13 000, à travers plusieurs ventes organisées par les Domaines et de sélectionner 2000 œuvres afin de les laisser à la garde des Musées Nationaux dans le but de les restituer, les fameux MNR (Musées Nationaux Récupération). Le décret du 30 septembre 1949, qui décide de la création d’un inventaire provisoire spécial pour ces œuvres indique aussi la nécessité de les exposer en vue de leur identification par leur propriétaire et c’est ce qui se passe entre 1950 et 1954 au musée national du château de Compiègne. Les œuvres MNR non restituées furent ensuite mises en dépôts au Louvre, au musée d’Orsay, au musée national d’art moderne et dans plusieurs musées de régions, en attente de leur éventuelle restitution, où la plupart se trouvent encore aujourd’hui.
Les années 1990 : le temps des éclaircissements
Entre les années 50 et les années 90, on oublie. Beaucoup de personnes ayant vécu l’Holocauste veulent s’affranchir de ce passé difficile, le sujet est tabou dans les familles et certaines, décimées, laissent derrière elles peu, voire aucuns souvenirs de leur possession à leur ayants-droits. Les Français redécouvrent cette question en 1995 avec le discours de Jacques Chirac qui reconnait la part de la France dans la déportation des Juifs puis avec le livre du journaliste portoricain Hector Feliciano, Le musée disparu qui pointe du doigt le peu de préoccupation des musées français sur ces œuvres particulières qu’ils conservent. C’est pourquoi dès 1996 est mise en ligne la base Rose Valland, le site de référence recense les MNR et indique leur historique connu. Un article du Monde datant du 27 janvier 1997 et titrant « Les musées détiennent 1955 œuvres d’art volées aux juifs pendant l’Occupation », remet le feu aux poudres, et cette même année plusieurs expositions présentent les MNR dans cinq grandes institutions françaises : le Louvre, le musée d’Orsay, la Manufacture de Sèvres, le château de Versailles et le musée d’art moderne Georges Pompidou. Ces expositions avaient pour volonté de présenter ces collections et de taire les rumeurs naissantes sur la passivité des musées entre les années 50 et les années 90, où seulement 6 restitutions ont eu lieu. Cette volonté de remettre les pendules à l’heure se retrouve dans le texte d’introduction du catalogue, rédigé par Jean-Jacques Aillagon alors directeur du musée national d’art moderne :
« J'ai la conviction que cette transparence est le seul moyen de couper court à la suspicion, à la rumeur, à la tentation du sensationnel, de mettre un terme à l'oubli et à toute possible complaisance à l'égard de l'iniquité. J'estime qu'il est du devoir de l'établissement public qu'est le Centre Georges Pompidou de permettre à tout un chacun de porter un regard lucide sur ces œuvres auxquelles l'Histoire a conféré un statut particulier, un destin tragique. »
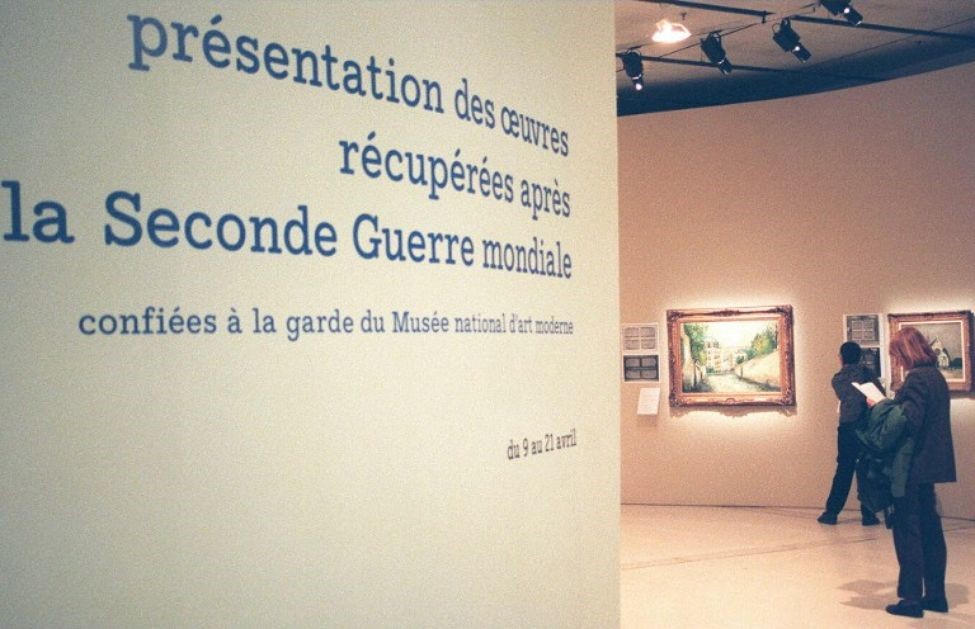
Entrée de l’exposition de 1997 au musée national d’art moderne. Au fond, deux toiles, leurs cartels et des photographies du revers des toiles avec étiquettes, inscriptions qui témoignent parfois du cheminement des œuvres © AFP
Dans un article de Libération, publié lors de l’ouverture de l’exposition au musée d’Orsay, encore disponible en ligne vingt ans après, la raison de ces expositions est la même mais la finalité, étonnamment, n’est pas vraiment celle de la restitution pour le ministre de la Culture de l’époque :
« Ce qui pouvait être restitué l'a été depuis cinquante ans, affirme Philippe Douste-Blazy. Il n'y a rien à cacher. J'espère que des gens, parce que nous les montrons par tous les moyens possibles, pourront récupérer leurs tableaux. Mais on pense qu'il y en aura très peu. Très probablement. Le geste est symbolique. Un demi-siècle après la guerre, il s'agit plutôt de faire de l'histoire que de rendre des objets d'art qui ne sont pas réclamés. »
Et pourtant, toujours en 1997 Alain Juppé, premier ministre, demande un rapport ministériel, publié en 2000, la Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France ou Mission Matéoli qui fera date et particulièrement son volet sur les spoliations « Le pillage de l’art en France pendant l’Occupation et la situation des 2000 œuvres confiées aux musées nationaux » rédigé par Didier Schulmann et Isabelle Le Masne de Chermont. Le sujet redevient central également sur la scène internationale avec en 1998, la Conférence de Washington où 44 pays décident d’ouvrir leur archives et de remettre la recherche de provenance au cœur des préoccupations. Et cela fonctionne, on dénombre 32 restitutions entre 1997 et 2008.
Depuis 2008 : une dynamique de recherche et d’exposition proactive
En 2008, organisé conjointement au musée d’Israël de Jérusalem puis au musée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris, l’exposition A qui appartenaient ces tableaux ? est la dernière grande exposition sur le sujet des spoliations en France. 53 tableaux MNR y sont présentés à travers plusieurs sections parlant précisément de l’histoire de ces œuvres : les saisies des services nazis, les opérations d’échange de l’ERR, les restitutions d’après-guerre, les acquisitions sur marché parisien, les œuvres de provenance inconnue et les restitutions faites à la France en 1994. Dans cette exposition, ce n’est donc plus juste une présentation mais une véritablement exposition présentant l’histoire et l’itinéraire de ces œuvres, également retracé dans le catalogue de l’exposition :
« Le cartel prend une place démesurée et ce ne sont plus les œuvres qui sautent aux yeux, mais leur destin de marchandise et les méandres tragiques de leur circulation. » Alain Dreyfus, Artnet.fr, 09/09/2008
Depuis, les musées de régions s’inspirent de cette démarche et s’ouvrent à ces problématiques en valorisent les MNR déposés dans leurs collections. Les présentations thématiques se multiplient. La plus connue, suite à la publication du livre 21 rue de la Boétie d’Anne Sinclair sur la vie et le destin de son grand-père le galeriste Paul Rosenberg a eu lieu une exposition homonyme au musée Maillol en 2012. Nous pouvons aussi citer L’Art victime de la guerre en 2012 à Bordeaux et dans les musées d’Aquitaine, Face à l’histoire en 2017-2018 au LAAC de Dunkerque mettant en parallèle 6 MNR et des œuvres contemporaines d’artistes ayant connus la guerre, MNR, les tableaux de la guerre au musée des Beaux-Arts de Rennes en 2016-2017 et plus récemment, la mise en place controversée de deux salles dédiées aux MNR en 2017 au Louvre, le texte de ces dernières n’employant pas une fois, dans un premier temps, le mot « juif ». Dernièrement, un espace de médiation dévoilé en février 2019 au musée des beaux-Arts de Poitiers, rend visible l’histoire et le parcours de ces œuvres spéciales au plus grand nombre dans le parcours permanent.

Raphaëlle Martin-Pigalle, responsable des collections devant l’espace de médiation conçu autour des MNR du musée de Poitiers
© Dominique Bordier pour La Nouvelle République, 06/02/19
On observe aussi de plus en plus la mise en ligne de pages internet dédiés sur le site des musées mettant en valeur cette histoire particulière et les conditions de réclamation ainsi que de cartels développés retraçant la provenance connue de ces œuvres comme à l’exposition Pastel du Louvre des XVIIème et XVIIIème siècle en 2018 ou au musée des Beaux-Arts d’Angers, attirant l’attention des visiteurs sur la situation particulière de ces œuvres.
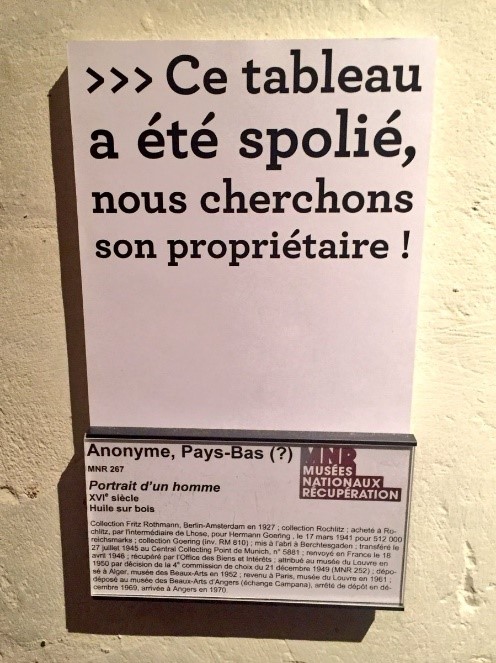
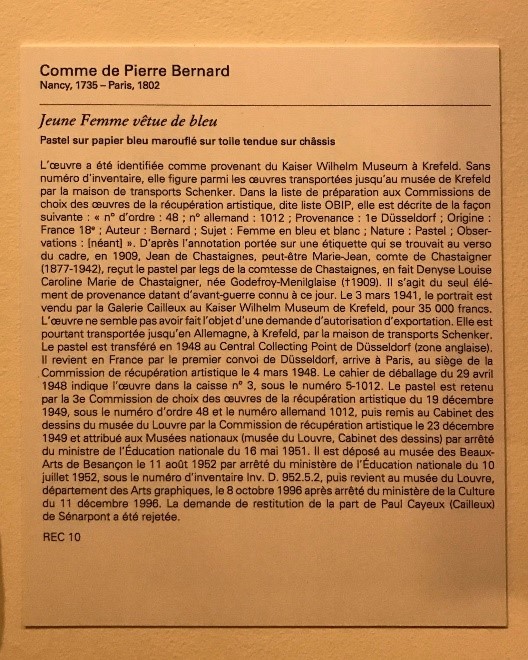
Cartel MNR du musée des Beaux-Arts d’Angers © Pierre Noual, Twitter / Cartel MNR lors de l’exposition
Pastel du Louvre des XVIIème et XVIIIème siècle © Alexandre Curnier-Pregigodsky, Twitter
Il semble absolument nécessaire de mentionner la provenance connue de ces œuvres, mais celle-ci peut toutefois étouffer le visiteur sous une masse d’informations. Aussi, il serait peut-être pertinent de représenter le parcours complexe des œuvres sous la forme de schéma, comme ce fut le cas à l’exposition 21 rue de la Boétie à Libourne avec un compromis intéressant entre nécessité d’informer et pédagogie !
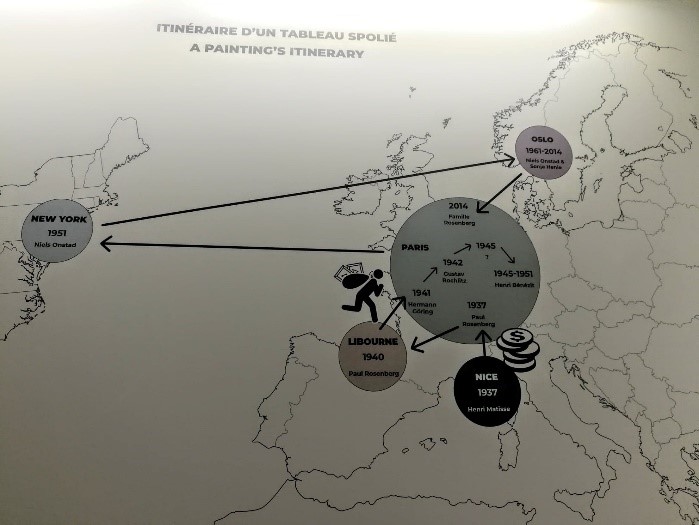
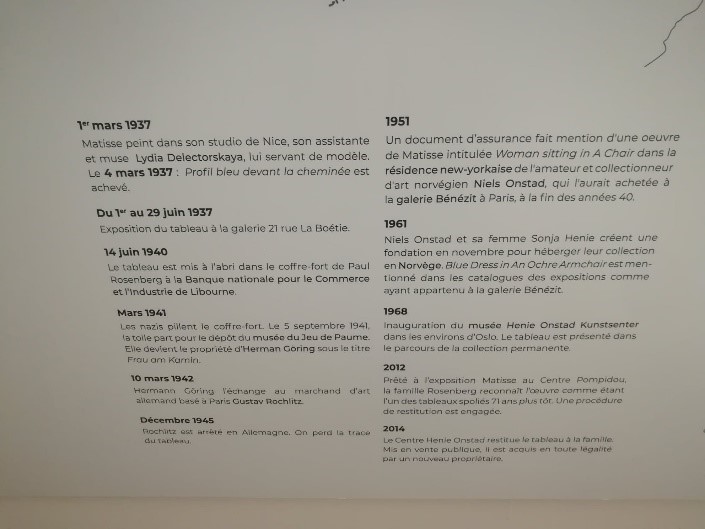
Itinéraire d’un tableau spolié : schéma et dates clés pour comprendre le parcours complexe d’une œuvre de Matisse à l’exposition 21 rue de la Boétie à Libourne © Cloé Alriquet
Enfin, des initiatives innovantes sont également développées ces dernières années comme la bande dessinée numérique disponible en ligne intitulée Le portrait d’Esther où le lecteur se glisse dans la peau d’une famille découvrant son passé et le destin d’une œuvre spoliée, créé par le musée des Beaux-Arts d’Angers en 2016 et débouchant sur une exposition des planches originales en résonnance avec les MNR du musée. Du côté du numérique, une exposition virtuelle Spoils of war du musée numérique UMA, a été inauguré suite à un financement participatif en septembre 2018, où l’on se balade dans une exposition numérique autour des spoliations et plus étonnant, un hackaton, un marathon de développement informatique a même eu lieu en octobre 2018 au musée de Niort dans le but de mettre en valeur les MNR du musée !
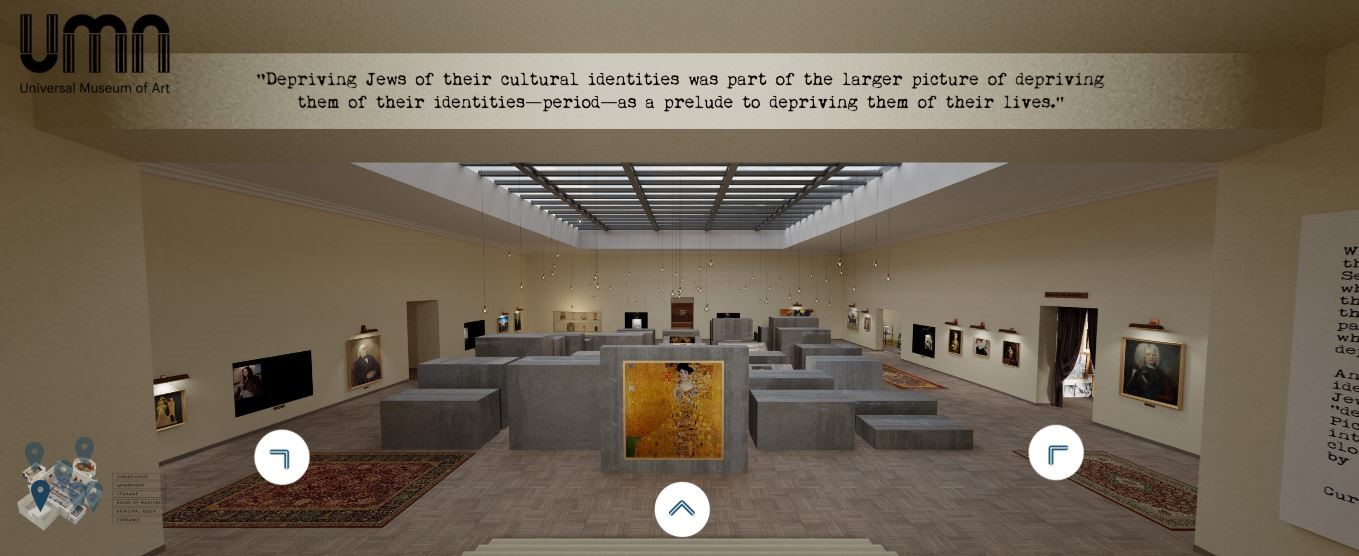
Capture d’écran de l’exposition numérique « Spoil of Wars » de l’UMA avec au premier plan le célèbre tableau de Klimt « Portrait d’Adèle Bloch Bauer », spolié et restitué aux ayants droit en 2006.
Depuis 2014 : L’après Gurlitt et le rôle affirmé du chercheur de provenance
En 2014, était révélé dans la presse allemande la découverte de milliers œuvres dans un appartement munichois, chez Cornelius Gurlitt, fils du marchand d’art allemand controversé Hildebrandt Gurlitt. La donation de ces œuvres au musée des Beaux-Arts de Berne à la mort de Cornelius entrainera un programme de recherche sur la provenance de ces œuvres, et en 2017 à deux expositions conjointes, une première sur l’art dégénéré au musée des Beaux-Arts de Berne et une seconde sur les spoliations nazies au Bundestkunsthalle de Bonn qui relancera l’intérêt mondial sur les recherches de provenance. Fin 2018, l’exposition Gurlitt est présentée au Gropius Bau de Berlin et en parallèle ont lieu les 20 ans de la Conférence de Washington, renouvelant au niveau international l’importance et l’actualité de ces problématiques avec une importance donnée à la formation et au métier du chercheur de provenance. La mise en valeur de ce travail, qui était plutôt invisible avant, se ressent aussi dans l’exposition Gurlitt où le public est accueilli dans la salle finale par un médiateur-chercheur pour répondre à leurs questions et les guider dans la recherche sur ordinateur.

Vue de l’espace final de l’exposition Gurlitt à Berlin, Gropius Bau, novembre 2018 © Cloé Alriquet
La dernière restitution à ce jour de cette collection, date du 8 janvier 2019 où le Portrait de femme de Thomas Couture a été rendu aux ayants droit de l’ancien premier ministre français Georges Mandel. Ce dernier est exposé depuis fin mars au côté d’une œuvre restituée d’Odilon Redon découverte sur une vente aux enchères et Georges Romney ancienne œuvre MNR, et d’une photographie du dos d’un tableau de John Constable restitué en 2017 au Mémorial de la Shoah dans l’exposition Le marché de l’art sous l’Occupation sous le commissariat de l’historienne de l’art Emmanuelle Polack. Ces trois tableaux sont accrochés dans la salle de « L’atelier du chercheur de provenance » où de nombreuses ressources sont présentes et une permanence est organisée le dimanche pour répondre aux interrogations des visiteurs ou de familles spoliées. Plusieurs expositions vont ouvrir en 2019 sur ces problématiques : une salle sur les œuvres spoliées de Paul Rosenberg au Centre Pompidou le 22 mai 2019, une exposition sur Rose Valland au musée Dauphinois de Grenoble à l’automne…
Cet article s’ouvrait sur la création d’une Mission de recherche et de restitution des biens spoliées entre 1933 et 1945 au ministère de la Culture ce printemps. Celle-ci fait suite à un rapport demandé en 2017 par la ministre Audrey Azoulay et remis à Françoise Nyssen par David Zivie sur l’état des lieux de la recherche de provenance en France. Ce rapport redéfinit les priorités autour de la recherche de provenance dont le but principal est évidemment d’étudier, d’une part les MNR et d’autre part les œuvres des musées nationaux acquises sous l’Occupation en vue de leur restitution éventuelle, mais également de valoriser ces questions auprès du grand public comme le montre un paragraphe des statuts officiels : « elle veille à la sensibilisation des publics et des professionnels aux enjeux soulevés par les spoliations de biens culturels intervenues entre 1933 et 1945 et par la présence de biens spoliés dans les institutions publiques».
On ne peut désormais qu’espérer que cette nouvelle dynamique donnera lieu à une future grande exposition française ! A suivre…
Cloé Alriquet
#exposition
#spoliations
#restitution
Pour aller plus loin :

STO LAT ! La Polonia a cent ans
Une convention relative à l’émigration et à l'immigration est signée le 3 Septembre 1919 entre la France et la Pologne. Celle-ci a organisé le déplacement d’un demi-million de travailleurs polonais en France, permettant à cette dernière de répondre à la pénurie de main d’œuvre causée par le Première Guerre mondiale et, pour la Pologne, de résoudre en partie le problème de la misère des populations rurales, dans un pays à la structure agraire et au secteur industriel insuffisamment développé. L’immigration s’est en conséquence implantée dans les régions fortement meurtries par la guerre et, notamment, le Pas-de-Calais (115 300 habitants dans les régions minières, soit 22,7 %, en 1931 mais aussi sur les terres agricoles pour environ 15 %). Cent ans après, le Département du Pas-de-Calais, par le biais de ses Archives départementales, souhaite interroger l’empreinte des Polonais sur son territoire ainsi que la mixité qui a résulté de son insertion à la population locale, en commémorant l’un des événements fondateurs de son histoire récente.
Retracer cent années de la vie d’une communauté est loin d’être aisé. Souvenirs, ressentis, expériences, chacun a sa propre histoire. L’exposition invite le visiteur à (re)découvrir cette communauté polonaise au travers de thèmes au sein desquels sont abordés les points forts de ce siècle. Ces thèmes sont transversaux : certains peuvent couvrir une longue période alors que d’autres sont attachés à un fait ou un moment donné. Le choix des différents thèmes s’est porté sur ce qui existe de commun entre des communautés distinctes ; cela dans le but de parler à l’humain présent en chacun d’entre nous. Travaillés sous le prisme des Polonais du Pas-de-Calais, les thèmes se répartissent entre entre le travail, l'école, la Seconde Guerre mondiale, les coutumes, les expulsions, la vie associatives et bien d'autres encore.

Vue de l'exposition « Sto Lat ! La Polonia a cent ans ». © Serge Chaumier
La scénographie, conçue par l'agence Présence, se prête au concept itinérant de l'exposition. Chaque thème correspond à un module associé et le parcours en comporte douze. Il était primordial que la scénographie soit le miroir des thématiques en valorisant les archives proposées. Celles-ci se déclinent sous plusieurs formes : des reproductions aux fac-similés en passant par des originales, une multitude de supports est proposée aux visiteurs afin qu'ils puissent s'approprier ces archives, leur patrimoine.

Visiteur utilisant un fac-similé. © AD62 – Laï Nam Thai
Les médiations avec le public sont au cœur de l'exposition. Elle se compose d'abord de quatre dispositifs pédagogiques qui proposent principalement aux enfants de découvrir différentes facettes de la culture polonaise. Associées avec le thème du module qui la comporte, elle se répartissent ainsi :
- pour le travail à la mine, le jeu « Trouve Charlowski » permet de découvrir les métiers de la mine reliés aux différentes lampes de mineurs qui se sont succédées au travers des époques ;
- en rapport avec l'émergence du commerce polonais, les enfants doivent deviner quels étaient les produits transportés par un marchand ambulant polonais ;
- afin de faire découvrir les fêtes polonaises, une activité s'appuyant sur les mots amène les joueurs à déchiffrer les différentes coutumes qui ponctuent une année ;
- enfin, en parallèle du thème « cercle familial » qui évoque la musique, les jeunes visiteurs sont invités à recréer un orchestre polonais.

Vue de deux médiations au sein des modules thématiques. © Serge Chaumier
L'exposition est le fruit de nombreux partenariats. Elle fut conçue et réalisée, principalement, en collaboration avec la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin, l'Institut des civilisations et études polonaises (ICEP) de Lens, le master expographie-muséographie (MEM) de l'université d'Artois et l'École supérieure des arts appliqués et du textile (ESAAT) de Roubaix. En effet, un travail en amont avec ses étudiants a permis de réaliser un parcours sonore formé de cinq dispositifs indépendants chacun relié à un témoignage audio et un objet-totem relié à un thème de l'exposition : le travail, l'école, le cercle familial qui évoque la cuisine et la musique ainsi que celui des traces actuelles qui aborde le langage oral mixte communément appelé « chtiski ».
Pour information, l’exposition se déroule du 3 septembre au 24 novembre 2019 à la Maison syndicale des mineurs de Lens. Celle-ci aura ensuite vocation à être itinérante. L’accès à l’exposition est gratuit ainsi que toutes les prestations proposées.
Elise Mathieu
#Exposition
#Pologne
#Centenaire
Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires à votre visite sur le site des Archives départementales du Pas-de-Calais :
http://www.archivespasdecalais.fr/Actualites/Exposition-Sto-Lat

The museum of everyday life
Ce qui est un déchet pour quelqu'un, est peut- être un trésor pour un autre. C'est avec cette philosophie en tête que Clare Dolan a créé le "Museum of Everyday day", le musée de la vie quotidienne dans la région du Vermont, à Glover aux Etats-Unis en 2011.
Infirmière, marionnettiste et philosophe, c'est avec ses idées et son activisme au sein de la compagnie de théâtre "Bread and Puppet" que Clare a développé au fur et à mesure des années la volonté de créer ce musée qui rend gloire aux objets de l'ombre, ceux que l'on oublie...
Image d'introduction : "Mirror, Mirror" 2016 © clare dolan
A quoi peut ressembler un musée non rempli d'objets rares, mais avec des objets de tous les jours ? A quoi peut ressembler un parcours de visite non traditionnel qui défie l'exposition des objets et leurs cartels ? Et comment peut -il être possible de créer une exposition avec des objets banals, étranges, de curiosités, amateurs, hors du cadre... Avec en esprit la participation de bénévoles, une collecte d'objets via des donateurs et chinés.

"Draw the Line and Make Your Point: the Pencil and the 21st Century" 2013 © Clare Dolan
Les visiteurs réguliers du musée sont plutôt des artistes, des habitants de Glover, des passants un peu curieux, des étudiants, des collectionneurs d'objets atypiques, qui donnent également de leur temps pour construire les expositions, le bâtiment et sa rénovation. Engagé, les bénévoles peuvent également devenir médiateurs de visite guidée et animateurs de performance artistique au musée, qui a pour objectif d'illuminer l'avant et l'arrière, l'essentiel, la relation entre les objets et les Hommes ?
A force de toujours rester au même endroit, dans notre train-train quotidien, on en oublie l'environnement qui nous entoure. A Glover, on reçoit et examine les objets à travers leurs vies, leur histoire singulière, et toutes leurs utilisations dans l'histoire Humaine. A chaque exposition, un objet est mis en avant. La première exposition, en 2011 avait pour thématique l'allumette. A partir d’une collection de boîtes d'allumettes était retracée l’histoire de cet objet : son invention, et son utilisation à travers les décennies. On pouvait également y découvrir des instruments de musique (violon et banjo) en allumettes, des théâtres miniatures en boîte d'allumettes, un bestiaire extérieur et géant d'allumettes à travers le monde, ainsi que d'autres curiosités traitant de la friction, de la cendre, du bois qui brûle, de l'étincelle, de la chaleur entre des personnes qui s'aiment...
En 2012, le thème était "L'incroyable histoire de l'épingle", collection provenant du monde entier en relation avec un essai philosophique de Christopher Morley en 1920, qui rend hommage à l'épingle à nourrice comme cadeau de l'humanité : elle a permis d'attacher deux bouts de tissus ensemble, et ainsi de tenir chaud, rassembler les individus autour du feu, créer des liens sentimentaux, de haine, de convivialité, construire des civilisations jusqu'à devenir le symbole de cultures alternatives, ou à contre-courant comme le mouvement Punk dans les 60/70.
Se sont enchainées une exposition sur le stylo en 2013, la brosse à dent en 2014, la poussière en 2015, le miroir en 2016, la cloche et le sifflet en 2017, la clef et les serrures en 2018, les ciseaux en 2019, et enfin le nœud et la corde depuis 2020,toujours présentée.
Une logique low-tech est également mise en avant : il y a très peu de numérique (seulement pour des éclairages, mises en ambiance). L'objet peut aussi servir à provoquer l'éveil, la réflexion et faire travailler son imaginaire. Chaque objet est un prétexte à évoquer une idée sous-jacente : l'exposition "Bells & Whistles", la cloche et le sifflet en 2017, avait en double lecture l'engagement de mettre les objets avec une seule utilisation en opposition au téléphone portable avec quoi tout est possible : prendre des photos, aller sur internet, téléphoner, jouer, lire, se repérer, écouter de la musique, se connecter aux réseaux sociaux, calculer, trouver un restaurant... Le minimalisme de la fonction d'un sifflet met en avant l'importance des origines, de la recherche de la source, du tangible, de l'accessible, de l'essentiel et de l'honnêteté qui ne va jamais trahir. Cela permet aussi d'aborder le son, le bruit, la révolte, cet objet permet de se faire entendre pour donner son opinion, en débattre, protester contre l'Injustice !
Malgré la longue histoire de la clef et les serrures, le pas de côté de l'exposition "Locks & Keys" en 2018 met en avant (en plus d'un historique de la création de la serrure : de 3 blocs de pierre aux portes blindées des banques) un sentiment essentiel dans l'histoire de l'Humanité : l'inévitable satisfaction de pouvoir se cacher et se protéger des autres. Cela est-il une preuve d'un échec à vivre tous en harmonie ? L'Humain n'est-t'il pas un animal social, avec un besoin maladif de partager, de serrer dans ses bras, et de s'ouvrir à l'autre ? Pouvons-nous encore faire autrement, ou est-il trop tard ?
Interrogée sur la difficulté d'exposer de tels objets, Clare réponde que justement, cela permet de mettre en lumière des sujets politiques aux Etats-Unis comme le rôle clef de la corde dans l'histoire du meurtre des Afro-Américains.
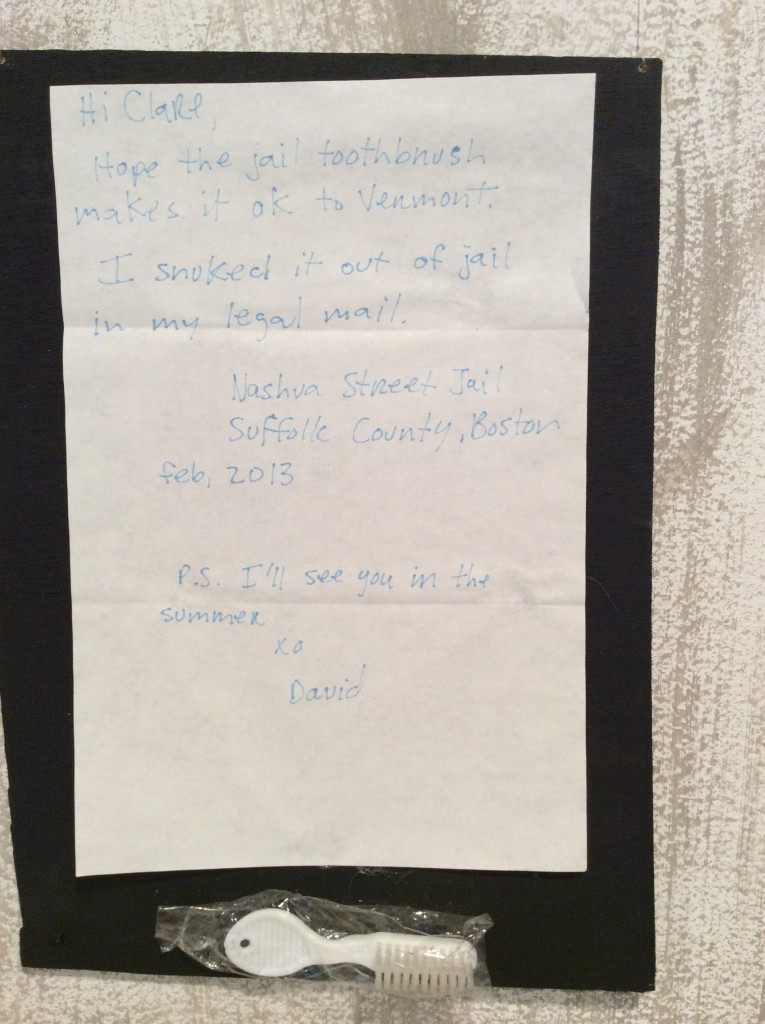
Lettre pour l'exposition "Toothbrush from Twig to Bristle In All Its Expedient Beauty" envoyé par un prisonnier avec sa brosse à dent à Clare, 2014 © Clare Dolan
Le parcours de visite :
"Allumer la lumière quand vous entrez, et n'oublier pas de l'éteindre à la sortie" ! Le musée se décompose en 3 séquences : la première, une salle d'écriture, de théorisation, et de publication philosophique à propos de la relation humain/objet, des méthodes de conservation et leur inventaire. La deuxième, une scène intérieure/extérieure pour accueillir les performances, spectacle de marionnettes, activités extérieures avec le public toujours en écho avec l'exposition en cours. La troisième (et la plus importante), le musée, qui rend tangible le travail théorique, la mise en place des pensées expérimentales de l'équipe muséographique du musée. "Fais ce que tu penses"... La visite peut être individuelle ou en groupe, seule ou guidée par ceux qui ont aidé à la conception l'exposition ou avec l'équipe présente au musée, tous prêts à vous transmettre leur passion pour l'inhabituel. L'équipe du musée met un point d'honneur sur une de ses missions principales, les workshops ! Elle souhaite, et le plus possible, intégrer ceux qui le souhaitent dans des ateliers et partager leur passion, leurs connaissances et laisser l'alchimie entre les participants prendre corps. Pour cela des résidences avec des artistes sont ponctuellement organisées, ainsi que des formations aux échasses, à la création de marionnettes en papier mâché, avec éventuellement des interventions de voisins de tous âges, et de collègues d'autres musées.
Nous sommes dans une société où on vénère l'exotique, l'autre, le rare et le précieux, autant que des célébrités... Cependant, n'est-il pas important de nous créer une place qui nous ressemble ? Nos histoires de vie sont toutes aussi singulières, et la connexion avec les objets qui nous accompagnent tout au long de notre existence mérite bien d'en faire un musée.
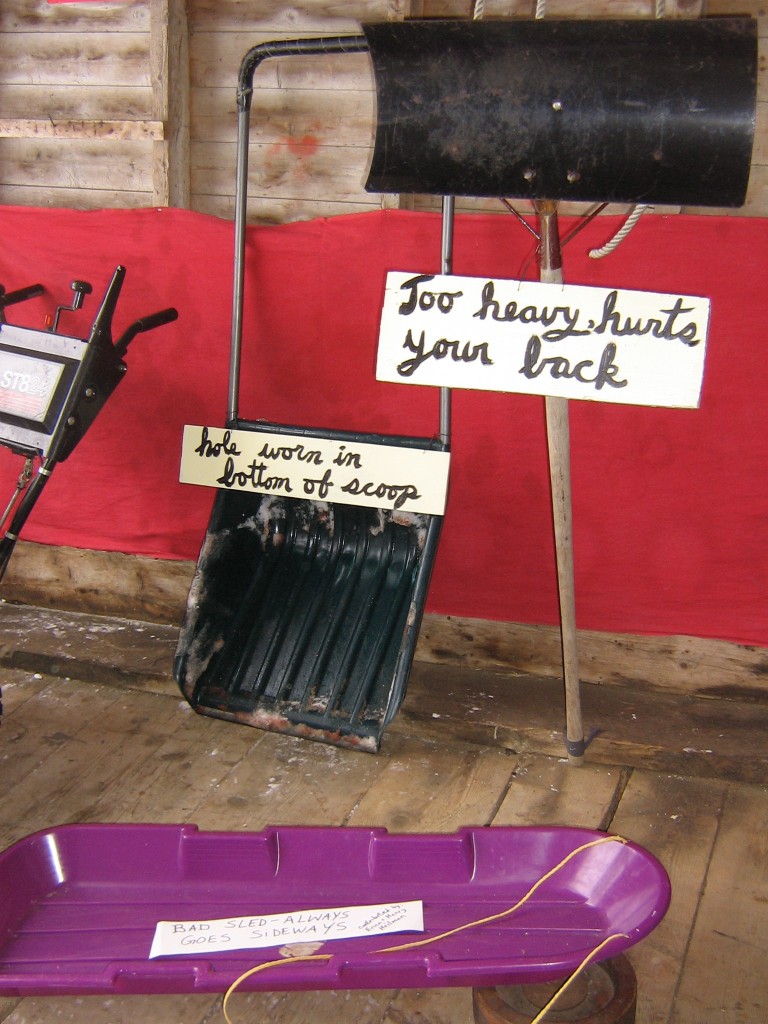
Cartel experimental © Clare Dolan
Pour aller plus loin :
- Site du musée : https://museumofeverydaylife.org/
- Constasoria/mediation "The Answers to Four Questions" https://www.youtube.com/watch?v=14xgE6AEQbk
- Hurricane Manifesto #1 : https://www.youtube.com/watch?v=bLfb0hi4Gk4&t=11s
- Constatoria/mediation "Hurricane Manifesto #1" à l'Ecosocialist Convergence de Northampton sur le changement climatique en 2012 : https://www.youtube.com/watch?v=bLfb0hi4Gk4&t=11s
#MediationSingulière #NosInclassables #PatrimoineSociété

Tim Burton, Le Labyrinthe : exposer l’artiste ou exposer l’œuvre ?
« Y’a-t-il un médecin dans la salle pour me dire si je suis mort ? » Tim Burton.
L’exposition « Tim Burton, Le Labyrinthe », présentant des billets allant de 22 à 26 euros, se déroule du 19 mai au 20 août 2023 au Parc de la Villette. Avec près de 100 œuvres exposées au total, elle fait suite à une première itinérance qui a eu lieu à Madrid dans l’espace Ibercaja Delicias, pour laquelle elle eut connu un franc succès, accueillant près d’un demi-million de visiteurs. Dès le seuil, le visiteur fait face aux dents acérées d’un monstre gigantesque. Il est ensuite invité à entrer dans la gueule d’une deuxième créature imaginaire aux yeux luminescents. La scénographie de l’exposition, réalisée par Alvaro Molina reprend le principe du labyrinthe : le visiteur fait son choix de parcours en activant un bouton qui lui permet de choisir sa porte : quatre possibilités s’offrent à lui. Impossible de revenir en arrière.

© Fabien Morasut
L’objectif de cette exposition est double : proposer une expérience immersive qui fait écho à l’esthétique du réalisateur Tim Burton, et découvrir ou redécouvrir l’œuvre du cinéaste. De ce point de vue l’expérience est réussie. Différentes salles présentent des statues grandeur nature des personnages des films les plus célèbres du réalisateur (la Reine Rouge d’Alice aux Pays des Merveilles, Edward Scissorhands d’Edward aux Mains d’Argent ou encore Jack Stellington de l’Étrange Noel de Monsieur Jack) ainsi que des œuvres issues de ses tournages (accessoires, décors, costumes, bandes originales). De plus, une multitude d’œuvres tels que des croquis, des dessins, des tableaux, permettent de toucher du doigt le processus de travail du cinéaste, passant systématiquement par le dessin et l’image pour construire la narration de ses films :
« De nombreuses personnes pensent que mes films ne reposent que sur leur seule esthétique, qu'ils sont fondés là-dessus. Ils n'arrivent pas à imaginer que tout ce que j'ai fait doit avoir une signification, ne serait-ce qu'à titre personnel et même si je suis le seul à la connaitre. Et plus les éléments sont absurdes et plus je dois être sûr de comprendre leur sens caché. Voilà pourquoi le cinéma nous fascine tant. Les films frappent à la porte de nos rêves et de notre subconscient », Tim Burton entretiens avec Mark Salisbury.
Quant à l’expérience immersive, l’exposition dévoile un parcours thématique plutôt qu’un parcours linéaire qui révèle la filmographie du réalisateur : les salles abordent des thèmes chers à l’artiste tel que les clowns ou encore les jouets terrifiants. L’idée est de traverser le tumultueux esprit créatif de Tim Burton par la mise en place d’un univers physique avec des matériaux et des lumières différentes. Des décors grandeurs natures tel que des sucres d’orge géants et des lumières colorées théâtralisent une expérience à l’esthétique pop et gothique gaiement monstrueuse.

© Fabien Morasut
« Était-il une bête, pour être à ce point ému par la musique ? », « La métamorphose », Franz Kafka, 1915.
Ainsi pendant près d’une heure (durée du parcours de visite) nous nous hasardons dans l’exposition aux tonalités surréalistes. Nous regrettons quelque peu de ne pas pouvoir appréhender davantage les aspects techniques de l’œuvre du réalisateur : ses jeux d’ombres et de lumières, ses inspirations, ses cadrages et ses mouvements de caméra. L’expérience immersive aurait également pu impliquer encore plus le spectateur, notamment par le biais de manipulations ou de jeux participatifs. Ceci étant, la rétrospective de Tim Burton présentée au MOMA en 2010 avec près de 700 œuvres explorait déjà les différents courants d’inspiration de l’artiste de son enfance jusqu’à aujourd’hui ainsi que son processus de travail, selon le conservateur Ron Magliozzi. Des décryptages des effets spéciaux de ses films jusqu’à la projection des films qui l’ont inspiré, la vie du célèbre cinéaste et de son œuvre ont déjà été minutieusement traitées. Le choix d’une scénographie labyrinthique pour cette exposition révèle ainsi davantage d’une expérience proposée pour les visiteurs. Ni exposition d’auteur, ni exposition d’œuvres, une véritable expérience immersive à partager et à vivre en famille est proposée, notamment par la mise en place d’un décorum original burtonien qui ne laissera personne indifférent !

© Fabien Morasut
Theo Balcells
#Lavillette, #Timburton, #exposition
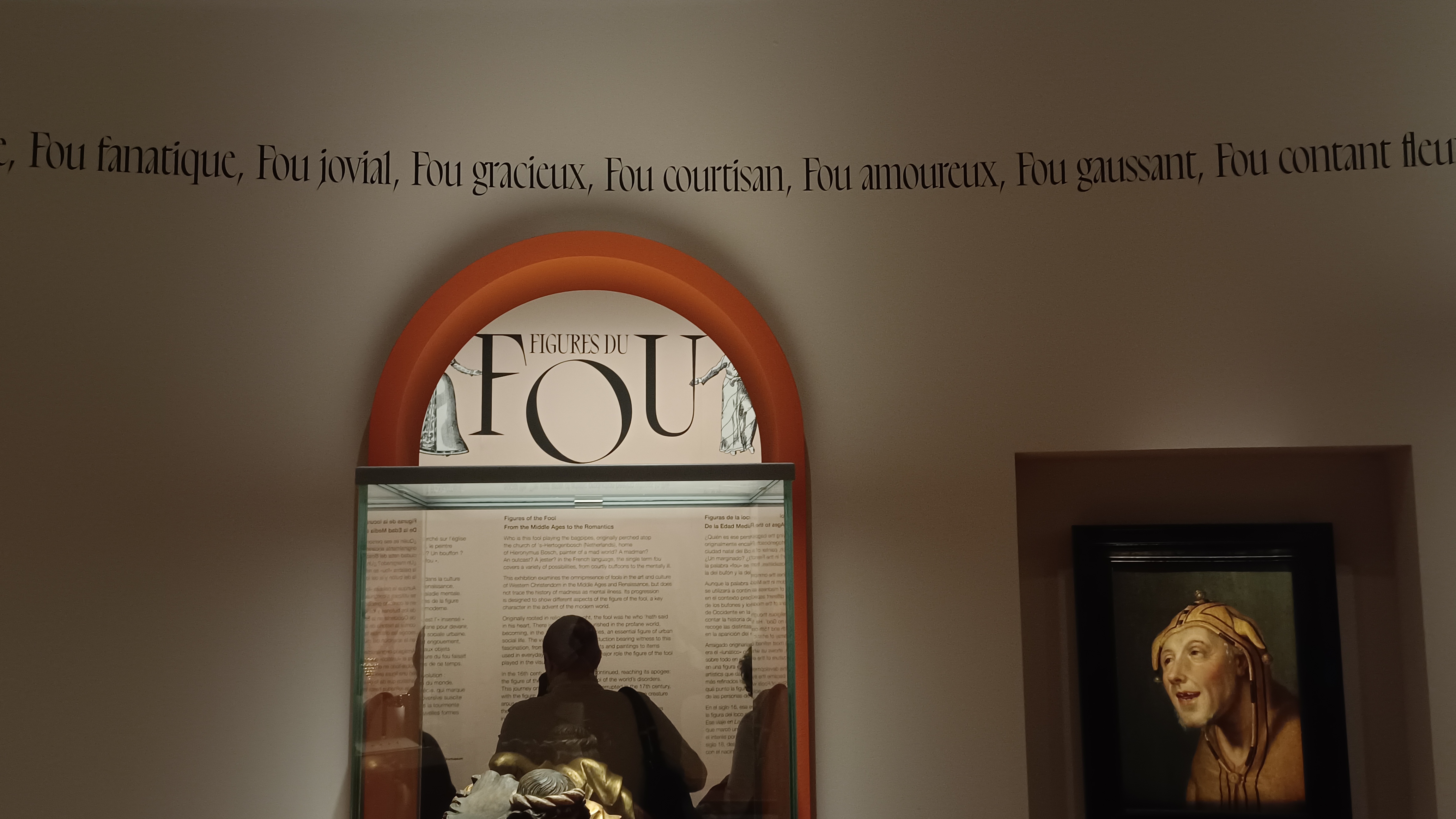
TOUS FOU !
Les fous, invités de marque du Musée du Louvre. Quelles histoires et représentation de la folie ?
scénographie de l’exposition. crédit T.Lops
Le 16 octobre 2024, le musée du Louvre a inauguré l’exposition Figures du fou. Du Moyen Âge aux Romantiques qui durera jusqu’au 3 février 2025. Cette exposition a pour but de retracer l’évolution de la figure du fou dans l’histoire de l’art. La notion de fou et de folie a inspiré la création artistique depuis de nombreux siècles, aussi bien dans le domaine de la littérature que dans celui des arts visuels. L’exposition rassemble plus de 300 œuvres parmi lesquelles des dessins, gravures, sculptures, objets d'art et peintures sur panneau. Avant d’aborder l’analyse de cette exposition, il convient d’abord d’en définir les termes. Qu’est-ce qu’un fou ? Qui peut fièrement prétendre à ce titre ? Selon la définition du Robert, “un fou est une personne atteinte de troubles, de désordres mentaux”, ou encore “une personne qui se comporte d'une manière déraisonnable, extravagante.” Vous vous reconnaissez ? Non ? C’est bien triste…
Mais l’objectif de cet article n’est pas de se plaindre de l’uniformité des individus, qui n’ont jamais été plus individualistes et pourtant plus indiscernables qu’aujourd’hui, mais simplement d’analyser la muséographie de l’exposition, qui nous montre le regard des artistes (plus ou moins ordinaires) sur leurs concitoyens extra-ordinaires.
La volonté muséographique de cette exposition est donc de montrer l’évolution du regard porté sur les individus définis comme “fous” de la fin du 15e siècle jusqu’au 19e siècle en Europe. Mais aussi comment la notion même de fou et de folie a évolué au cours de cette période. L’histoire nous est racontée de manière chronologique, avec des œuvres empreintes d’humour. Car les fous, qu’ils soient observateurs ou observés, peintres ou peints, c’est drôle, jusqu'à ce que ça ne fasse peur… et là c’est moins drôle, ce que nous verrons plus tard. D’abord l’exposition : elle se développe de manière très cohérente et intelligible, avec un parcours chronologique se divisant en quatre thématiques principales. La première, Folie et religion, examine la dualité entre les « fous de Dieu », tels que saint François d'Assise, et les saints visionnaires, illustrant comment la folie était perçue dans un contexte spirituel. La seconde, la Folie amoureuse, expose des manuscrits ou illustrations de récits chevaleresques où les héros, « fous d’amour », sont mis en avant, montrant comment la passion pouvait être assimilée à une forme de folie. La troisième partie introduit la notion de “fous de cour”. Cette thématique se concentre sur les bouffons qui, par leurs critiques et leur humour, occupaient une place particulière dans les cours royales, permettant une remise en question des normes sociales. La quatrième partie de l’exposition, “folie et société”, explore comment, lors de carnavals et de fêtes populaires, la folie prenait le pouvoir, inversant les rôles sociaux, permettant au fou de devenir roi et offrant une critique subversive des structures de pouvoir en place. Cette conclusion illustre la manière dont la folie servait de miroir aux normes sociales et aux comportements humains.
Les visiteurs, tous silencieux et respectueux, sont invités à se déplacer dans dans un parcours à la disposition spatiale pas spécialement folle, c’est à dire, pour reprendre notre définition, ni atteinte de troubles ou de désordres mentaux (imaginez un espace atteint de désordre mental, cela serait fou) ni déraisonnable ou extravagante. Une scénographie à l'esthétique sobre et épurée afin de ne pas distraire l’attention du public et de valoriser les œuvres tout en le transportant dans l’histoire.

Sculpture d’un fou. crédit T.Lops
La salle la plus dépourvue de couleurs ou de textes muraux avec une typographie un peu singulière est celle abritant les gravures et peintures des maîtres flamands Jérôme Bosch et Pieter Bruegel, l’ancien et le jeune. Véritable apothéose de l’exposition, cette salle met en relation des gravures, dessins et peintures attribués à l'un et l'autre des peintres flamands pour qui ce thème est particulièrement important. Dans cette salle un détail amuse: un dessin attribué à Bosch sur le cartel, signé de la main de Bruegel. Erreur de muséographie ou de référencement ? Dessin réalisé par l’un et offert “in mano propria” à l’autre ? De quoi rendre fou un visiteur curieux…
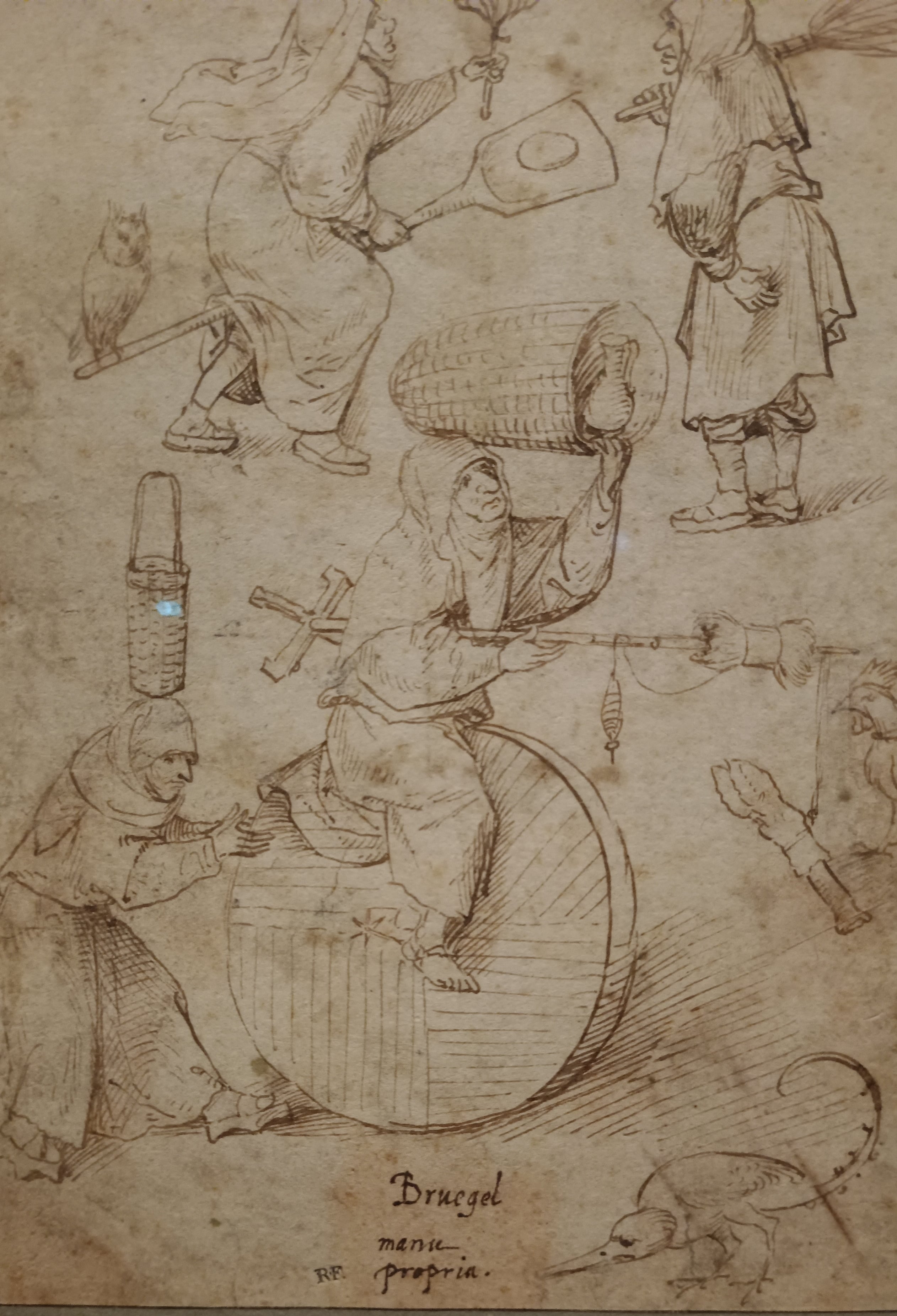
Dessin attribué à Bosch crédit T.Lops

Inscription sur le dessin. crédit T.Lops
Cartel d’exposition crédit T.Lops
Cette mise en scène est parfaitement adaptée au sujet, et dans la salle précédant celle des maîtres, une série de sculptures représentant des bouffons exécutant des pas de danse, en alternance avec des portraits de fou de rois sont disposées sur une cimaise en demi-cercle, comme dans une valse folle, invitant le visiteurs à rentrer dans le cercle et a executer un tour afin de passer devant chacune des sculptures, prenant ainsi part a la danse. L’invitation est subtile mais elle prouve une intelligente volonté de faire dialoguer le visiteur avec le sujet.

Scénographie en demi cercle “valse folle” crédit T.Lops

Scénographie en demi cercle “valse folle” crédit T.Lops
La muséographie propose aussi une prise en compte des enfants lors de leur visite. Au début de l'exposition, une cocotte est proposée pour le jeune public. Tout au long du parcours, des cartels simplifiés expliquent certaines œuvres sur un ton léger et proposent ensuite au jeune visiteur d’activer la cocotte. Sur celle-ci sont écrites un certain nombre d’actions permettant à l'enfant de verbaliser sa visite et les émotions ressenties face aux œuvres, mais aussi de s’amuser en imitant les œuvres ou de communiquer avec son accompagnateur en décrivant ou échangeant avec lui sur ce qu’il est en train d’observer. Cette initiative peu coûteuse est extrêmement intéressante car elle permet à l’enfant de créer son propre parcours de visite, mais aussi de créer du lien avec son accompagnateur et transforme l’exposition en espace ludique et pédagogique, sur un thème en premier lieu non adapté pour le jeune public.
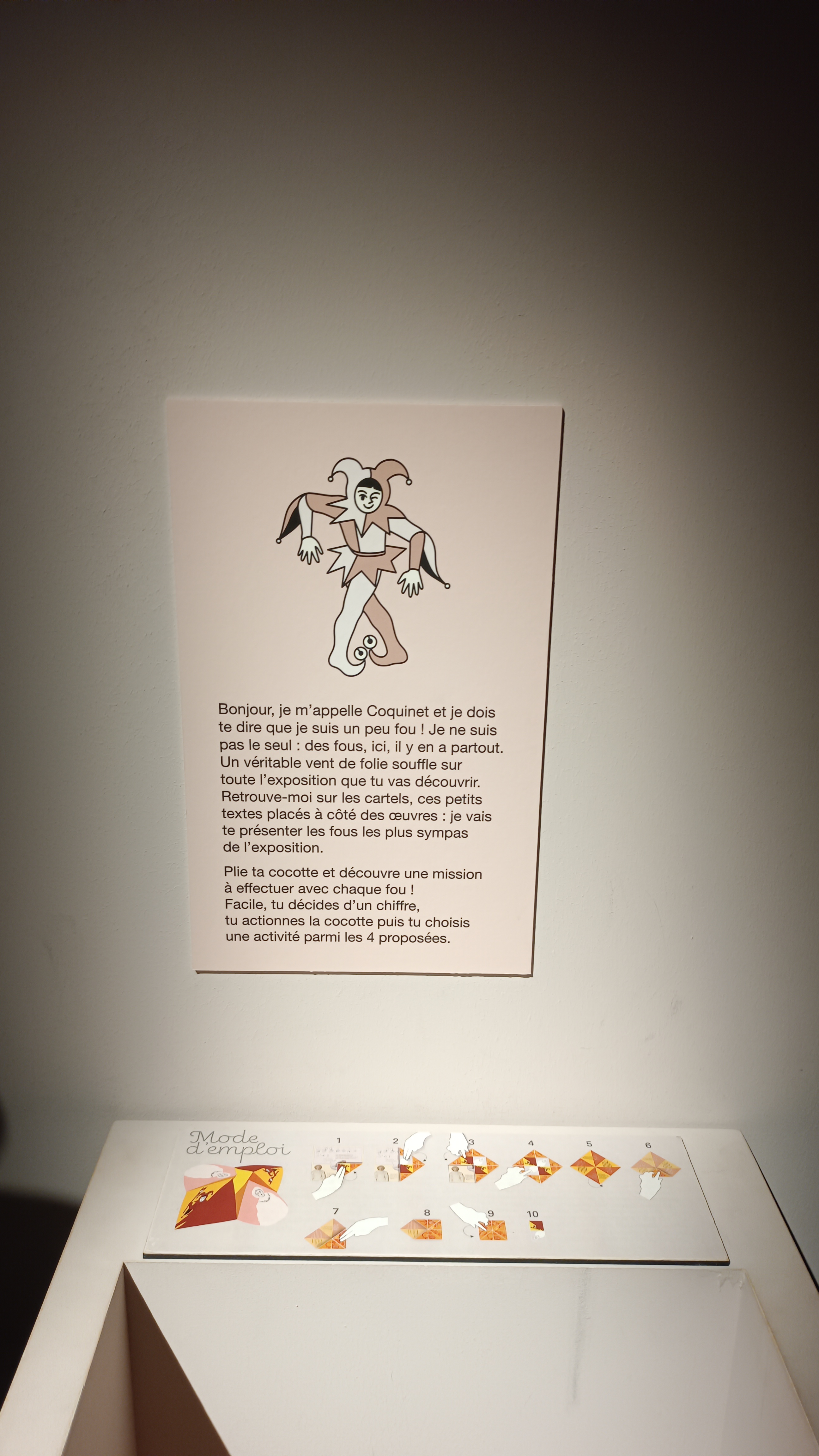
Cocotte pour le parcours enfant. crédit T.Lops
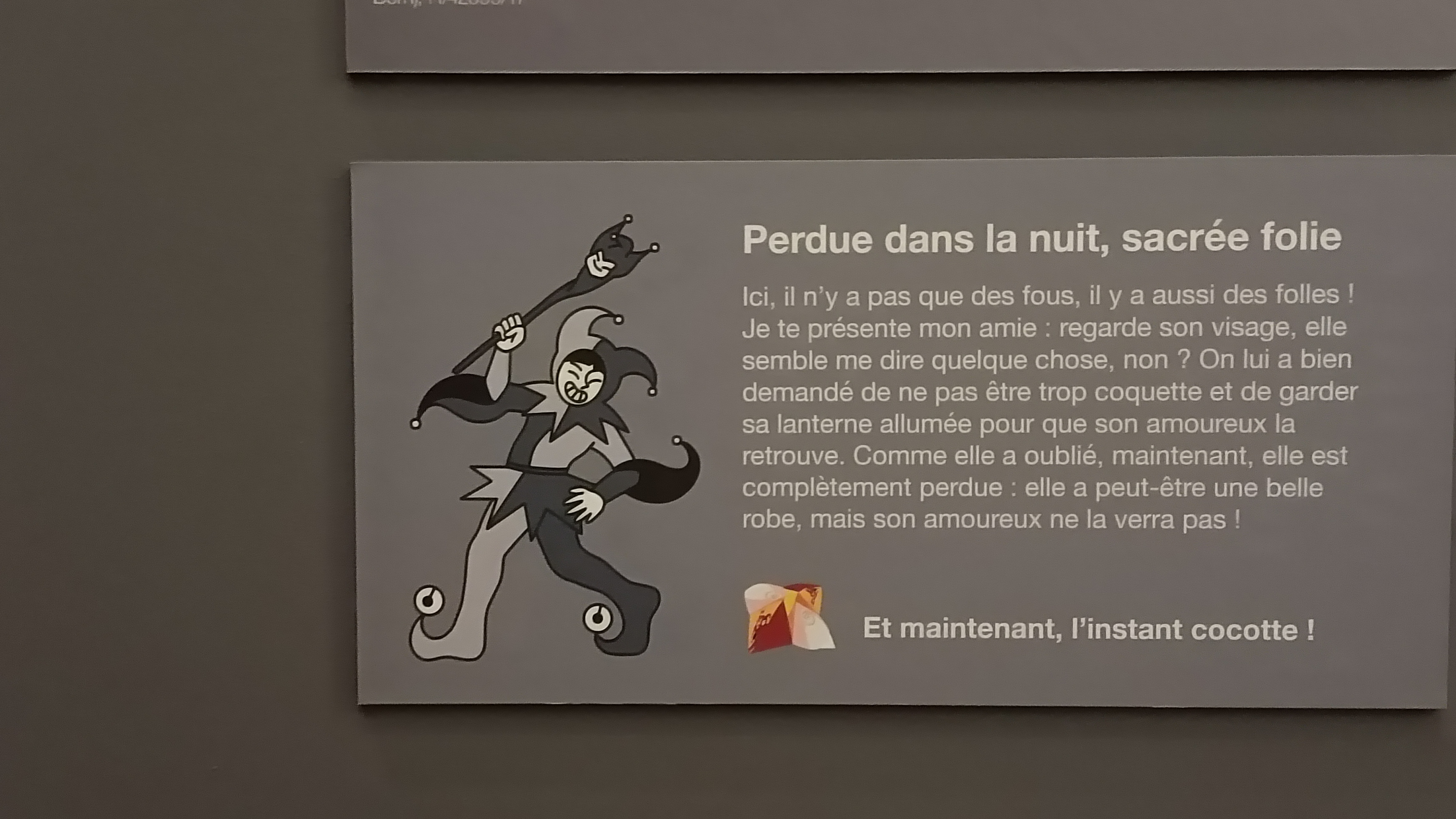
Cartel du parcours enfant. crédit T.Lops
Le thème de la folie a été maintes fois utilisé dans des espaces d’exposition, comme notamment dans le musée du Dr Guislain à Gand. L’édifice du musée, dont la construction a été finalisé en 1857 et qui est un des premiers centres psychiatriques européens, propose des expositions tournées sur l’histoire de la psychiatrie et sur l'art en lien avec la folie, ainsi que sur le regard porté sur la folie dans une période plus contemporaine. Ses expositions permanentes et temporaires, tel que l’exposition Déséquilibre (du 12.10.2019 au 30.12.2025) explorent la frontière entre le normal et l'anormal, offrant une réflexion sur la manière dont la société perçoit et traite la maladie mentale. Situé dans les bâtiments du premier institut belge de psychiatrie, le musée présente des thématiques liées à la santé mentale. La scénographie vise à provoquer une réflexion sur les concepts de normalité et d'anormalité. Le musée cherche à déconstruire les préjugés entourant la maladie mentale, en offrant une perspective historique sur la psychiatrie et en exposant des œuvres d'artistes ayant une expérience directe de la folie. Il s'agit de sensibiliser le public aux réalités de la santé mentale et de promouvoir une compréhension plus nuancée de la diversité psychique. Outre la différence d’approche de la thématique, la programmation du musée du Dr Guislain diffère de l'exposition du Louvre par son public cible. En effet, le musée gantois attire des visiteurs intéressés par l'histoire de la psychiatrie, l'art brut et les questions de santé mentale. Alors que le Louvre s'adresse à un large public international, des amateurs d'art aux spécialistes, en proposant une exploration esthétique et historique de la folie dans l'art. L’exposition offre également des ressources éducatives et des conférences pour approfondir le sujet ainsi qu’un cycle de concerts et spectacles vivants dans l’auditorium du Louvre en lien avec l’exposition.
En conclusion, il est plutôt rassurant de voir que le musée du Louvre a su apporter une touche d’intelligence et d’humour à une thématique aussi complexe que celle de la folie. L’exposition Figures du fou. Du Moyen Âge aux Romantiques se distingue par son approche muséographique originale, qui réussit à raconter une histoire riche et cohérente tout en offrant une analyse fine de l’évolution de la perception de la folie à travers les siècles. Les œuvres sont intelligemment sélectionnées et agencées dans un parcours intelligible et esthétiquement sobre, peut-être pas assez “fou” ? mais servant parfaitement le propos. Elles invitent les visiteurs, jeunes et moins jeunes, à une certaine réflexion sur notre perception actuelle du sujet tout en leur permettant d’admirer et de s’amuser. Cette exposition parvient plutôt bien à faire dialoguer passé et présent, art et société, sérieux et légèreté, offrant ainsi une belle folie artistique à contempler. Dans un monde carnavalesque post élection américaine, ou les fous sont devenus rois, un peu de réflexion et d’émerveillement ne font jamais de mal.
Tano Lops
POUR ALLER PLUS LOIN:
https://www.louvre.fr/expositions-et-evenements/expositions/figures-du-fou
https://www.familinparis.fr/exposition-figures-du-fou-au-musee-du-louvre/?utm_source=chatgpt.com
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/10/22/au-musee-du-louvre-l-art-de-representer-la-demence_6358309_3246.html?utm_source=chatgpt.com
#expositions #Louvre #folie
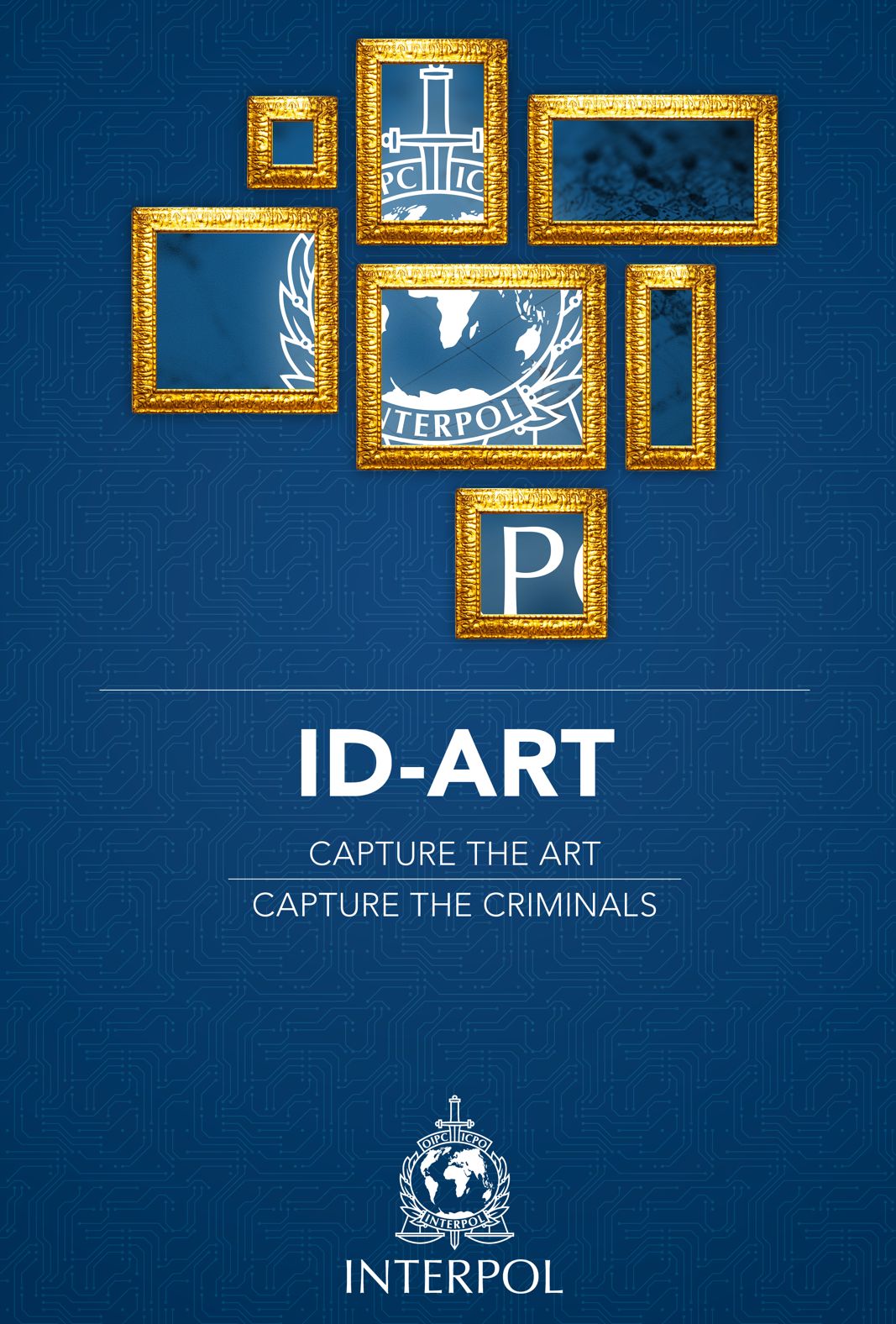
Trafic d’art : l’open data contre le marché noir
Septembre 2018, fouilles sur le Dolmen de la Combe de Bonne Fille, Ardèche. Deux personnes, équipées de détecteurs de métaux, sillonnent un champ à la recherche de « trésors ». Se voyant repérés, ils disparaissent avant que les autorités soient prévenues. Quelques jours plus tard, lors d’une visite sur des dolmens alentour, la directrice de fouilles constate plusieurs creusements au pied d’une dalle de chant, probablement faits par des pilleurs dotés des mêmes détecteurs pour empocher quelques objets archéologiques.
Juillet 2021, exposition « Traits d’Egypte. Marcelle Baud » au musée Bargoin, Clermont-Ferrand. La présentation du travail de cette égyptologue-dessinatrice inclut de nombreuses copies d’œuvres de musées. Parmi celles-ci, le dessin d’une statuette inachevée de Néfertiti accompagné par un moulage en plâtre du même objet. Le cartel nous apprend alors que l’original, conservé au musée égyptien du Caire, a été volé lors du printemps arabe, en 2011 ; il n’est toujours pas retrouvé à ce jour.
Ces deux histoires, parmi de nombreuses autres, ont un point commun, le vol d’œuvres d’art et d’archéologie, pour une jouissance personnelle ou afin d’alimenter un marché noir lucratif. Celui-ci représenterait environ 10 milliards de dollars par an selon l’UNESCO, le marché de l’art licite ayant généré un peu plus de 50 milliards de dollars en 2020[1]. De la méconnaissance de la réglementation au pillage volontaire comme source de revenus, ces pratiques mettent en péril le patrimoine culturel mondial. Et l’augmentation de la demande comme la facilité des ventes sur internet encouragent les vols, les fouilles clandestines et le pillage de monuments anciens.

Dessin et reproduction en plâtre d'une statuette de Néfertiti, et sa fiche de signalement INTERPOL. © C.C.
Une prise de conscience mondiale
Si la prise de conscience de la nécessité de protéger légalement le patrimoine culturel, dans le cadre des conflits armés, apparaît à la fin du XIXe siècle, il faut attendre 1954 pour voir un premier texte officiel sur ce sujet[2]. Cette année-là, l’UNESCO rédige une convention internationale, la Convention de la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Elle reconnait « l’immunité des biens culturels » et prévoit ainsi de les protéger et d’assurer leur sauvegarde en tant que « patrimoine culturel de l’humanité entière ».
Cependant, l’amplification des conflits armés depuis les années 1980, ainsi que l’instrumentalisation des destructions du patrimoine par les groupes extrémistes – les Bouddhas par les Talibans en 2001, Palmyre par Daech en 2015 pour ne citer que les exemples les plus médiatisés – ont poussé les institutions à aller encore plus loin. Le 24 mars 2017, le Conseil de sécurité des Nations Unis adopte à l’unanimité la résolution 2347, mobilisant ainsi les États membres « contre la destruction et le commerce illicite de biens culturels spoliés pendant les conflits armés ». Ainsi, ce texte prévoit la mise en place d’un réseau de refuges pour les biens culturels menacés, incite les États à instaurer « une large coopération policière et judiciaire », et crée un fonds international pour mener à bien ces missions.
Une coopération internationale pour des saisies records
Cette coopération entre les instances internationales et les autorités nationales a conduit ces dernières années à des saisies records de biens spoliés, ainsi qu’à de nombreuses arrestations. INTERPOL, Europol et l’Organisation mondiale des douanes (OMD) ont mené de vastes opérations sur les différents continents pour tenter de démanteler les réseaux de trafiquants[3]. En 2019, ce sont 19 000 objets archéologiques et d’art qui sont alors retrouvés, accompagnés de plus d’une centaine d’arrestations. En 2020, une opération de plusieurs mois a permis d’établir un nouveau record, avec plus de 56 400 objets saisis, des livres et des monnaies anciens, des peintures, des sculptures, des biens archéologiques… Des enquêtes sont en cours, afin de déterminer tous les acteurs impliqués dans ces trafics, avant que la question de restitution aux pays d’origine ne soit évoquée.
Des unités de coordination opérationnelles ont été mises sur pied par ces trois institutions, en réponse à l’intensification de ce trafic, et son ampleur mondiale. En effet, rares sont les pays qui ne sont pas concernés, soit en tant que pays source, possédant un riche patrimoine, soit comme plateforme de transfert et de transit, soit comme région à forte demande d’objets de ce type. L’opération de 2019 s’est ainsi déroulée sur 103 pays, celle de 2020 sur 31 États. Les opérations de contrôle ont lieu tout autant sur les frontières et les points de passage tels que les gares et les aéroports, que chez des particuliers, dans des maisons de ventes ou même dans des institutions culturelles.
De nouveaux projets de lutte
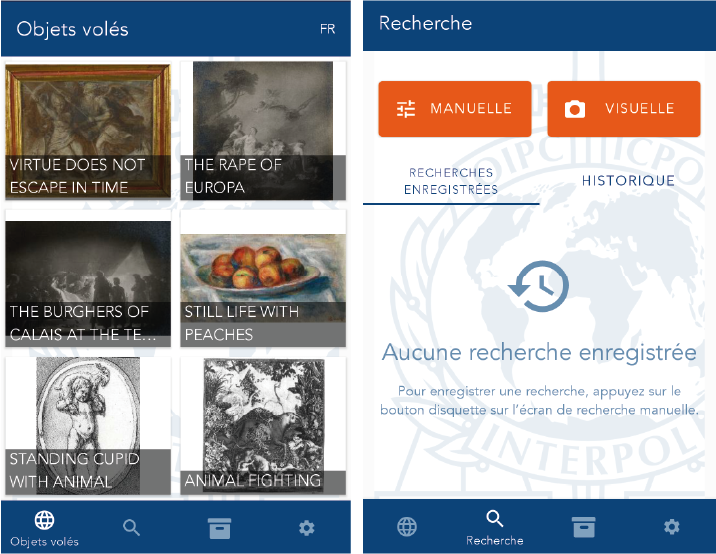
Base de données et moteur de recherche dans l'application ID-Art. @ C.C.
Ces deux projets sont innovants par le fait qu’ils vont permettre au grand public de se sentir concerné et de s’impliquer dans la lutte contre ce marché noir, véritable trafic lucratif qui participe au financement du crime organisé[4]. Ainsi que le rappelle le Secrétaire général d’INTERPOL, Jürgen Stock, « la protection du patrimoine dans les conflits modernes ne peut être envisagée uniquement sous l’angle de la problématique culturelle ; il s’agit d’un impératif de sécurité ». Souhaitons donc à ces opérations de porter leurs fruits et qu’elles se multiplient, pour préserver notre patrimoine pour nous et les générations futures.
Chim Cholin
Pour aller plus loin :
- les sites d’INTERPOL et de l’UNESCO.
Notes :
[1] Voir le Global Art Market Report. (↩
[2] Voir l’histoire de la législation internationale sur le patrimoine culturel par l’UNESCO ici. ↩
[3] Les résultats de 2019et 2020sur le site d’INTERPOL↩
[4] Ces deux projets sont récents, ce sont surtout les polices nationales qui ont obtenus des résultats positifs pour le moment. ↩
Vignette : La page d’accueil de l’application ID-Art. © C.C.
Image d’introduction : le Dolmen de la Combe de Bonne Fille, un site isolé vulnérable aux détecteurs de métaux. © C.C.
#BlackMarket #PatrimoineEnDanger #CircArt
Tribulations d'une francophone au Canada
Dans le cadre d’un stage effectué entre mars et août 2016 au Canada, j’ai eu la chance d’être invitée à un colloque international sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, organisé à l’Université Laval de Québec. En tant que francophone en visite au sein d’une province très riche artistiquement et historiquement, je tenais à découvrir des institutions culturelles locales. Raison pour laquelle j’ai visité le Musée de la Civilisation à Québec-Ville.
Le Musée de Civilisation de Québec © Musée de la civilisation
Inauguré en 1988 par le gouvernement du Québec, le Musée de la Civilisation fut créé dans un contexte de diversification sociétale, marqué par une importante immigration, et une volonté d’affirmation de l’identité nationale québécoise face au reste du pays. Par-delà l’ambition du gouvernement de développer les politiques culturelles, l’établissement représente la figure même du projet muséal novateur, à l’origine d’une rupture qui va contribuer à l’apparition des musées dits de société. Ce terme qui regroupe les musées d’ethnographie, d’ethnologie, d’histoire, et de la vie locale, désigne des institutions qui favorisent une approche pluri thématique, valorisant les différentes composantes de la vie sociale.
En tant que visiteuse étrangère qui a l’habitude de fréquenter des institutions culturelles françaises, mon premier constat à la suite de cette visite au Musée de la Civilisation, est l’importance de la place accordée à la démocratisation, et l’élargissement des publics. En conciliant son ambition de valoriser la société québécoise, et de s’élargir à d’autres civilisations humaines, cette institution se distingue également par une politique d’exposition innovante, axée sur l’interaction et la participation. Au total, ce ne sont pas moins de cinq expositions basées sur l’identité québécoise, ou d’envergure internationale qui étaient présentées ; parmi lesquelles deux m’ont particulièrement marqué.
Ma visite débuta avec Lignes de vie, la plus importante exposition consacrée à l’art contemporain aborigène au Canada, réalisée en collaboration avec le Kluge-Ruhe Aboriginal Art Collection de l’Université de Virginie. Elle témoigne du processus de création des premiers peuples d’Australie, qui s’inspirent de traditions artistiques existant depuis plus de 60 000 ans, et de la manière dont elles s’inscrivent au sein des grands mouvements artistiques contemporains. A travers un espace ouvert qui joue sur les variations de lumières, ainsi que sur le contraste des couleurs, la visite immersive nous plonge littéralement dans l’ambiance de l’environnement australien (le bleu pour le ciel, le marron pour la terre, et le vert pour la végétation).
Lignes de vie© Musée de la civilisation
Y sont présentées une centaine d’œuvres (artefacts, masques, sculptures et tableaux) qui traite du devoir de mémoire, en rappelant les cruautés impunies et subies par les Aborigènes. Le numérique y possède une place importante puisque trois montages vidéo à vocation documentaire ponctuent la visite, et permettent d’étayer notre regard face à cet art ancestral. Deux bornes interactives sont également à la disposition du visiteur, et complètent les informations apportées par les cartels, permettant ainsi de situer l’œuvre géographiquement et historiquement ; puis d’avoir accès à l’interprétation des histoires racontées à travers les œuvres.
Lignes de vie © Musée de la civilisation
Le parti-pris de l’exposition est d’avoir choisi un parcours non pas géographique mais thématique, divisé en trois zones. Tout d’abord, une zone qui s’intitule « Terres de rêves » rappelle que les premières créations réalisées par ces Autochtones étaient éphémères car conçues à l’aide d’éléments organiques, (tels que la roche, le sable ou encore la terre) et comment au fil du temps, ces œuvres se sont adaptées aux nouveaux médiums. La seconde zone, appelée « Terres de Savoirs » fait ressortir l’influence des éléments de la nature et des légendes ancestrales, ainsi que l’impact qu’a leur identité spirituelle dans leur pratique artistique. Enfin, la troisième et dernière section, « Terres de pouvoirs », témoigne du rôle de leur art, en tant que revendication identitaire, et vecteur des aspirations politiques de ces peuples.
Ma visite se poursuivit par une autre exposition : C’est notre histoire, Premières Nations et Inuit du XXIème siècle, qui traite d’un sujet à travers une approche spatio-temporelle : à la fois revenir sur le passé, évoquer le présent, et envisager l’avenir des 93 000 Autochtones et Inuits qui peuplent la province québécoise à l’heure actuelle. Le terme Premières Nations désigne les Indiens vivant au Canada, qu’ils possèdent le statut d’Indien ou non. L’usage de ce terme s’est répandu au cours des années 1970, afin de remplacer le mot « Indien », considéré alors par certains comme étant choquant. On compte actuellement plus de 600 Premières Nations, et plus de 60 langues autochtones au Canada.
Cette exposition est le résultat d’une collaboration entre le Musée de la Civilisation, et la Boîte Rouge vif, une association sans but lucratif québécoise œuvrant à la valorisation des cultures autochtones. Ensemble, ils ont sollicité onze nations autochtones vivant au Québec, dont ils ont rencontré les représentants à l’occasion d’assemblées consultatives organisées sur deux ans. Au total, ce ne sont pas moins de 800 personnes issues de 18 communautés différentes, qui ont participé à la mise en place de ce projet.
C’est notre histoire, Premières Nations et Inuit du XXIème siècle © Studio du Ruisseau, SMQ
En présentant plus de 450 objets issus des collections du musée (armes, instruments, maquettes et vêtements entre autres), le rôle même de C’est notre histoire, réside dans sa volonté d’amener le visiteur à réfléchir sur ce que signifie être Autochtone au XXIème siècle. Les choix scénographiques ont consisté à partir d’une vaste salle, au design résolument contemporain, dans le but de symboliser le regard neuf à travers lequel le Musée de la Civilisation souhaite aborder les questions relatives aux Premières Nations.
Des archives audiovisuelles, ainsi que des projections sur écran (réalisées grâce à l’appui de l’Office national du film du Canada) sont disséminées au sein du parcours, et illustrent à merveille le propos véhiculé à travers les œuvres présentées. Par ailleurs, six bornes audio ont été installées, permettant ainsi de compléter notre visite par l’écoute d’un récit élaboré par Naomi Fontaine, jeune auteure innue.
De même que pour l’exposition précédente, un parcours thématique divisés en cinq sections différentes fut privilégié. La première, intitulée « Ce que nous sommes aujourd’hui - la réserve, nos communautés », aborde l’héritage, le mode de vie, ainsi que la réalité aujourd’hui à laquelle sont confrontés les Premières Nations. La deuxième section, « Nos racines », évoque la diversité culturelle autochtone, ainsi que la traversée effectuée au Nord de l’Amérique il y’a 12 500 ans.
Quant à la troisième section, « La grande tourmente », elle traite du choc des civilisations dû à 400 ans de colonisation, empreints de changements et de résistances. La quatrième section, « La décolonisation - La guérison », étudie les revendications culturelles et politiques qui ont été menées, en vue d’aboutir à une reconnaissance, et à un rétablissement des faits historiques. Enfin, pour ce qui est de la cinquième section : « De quoi rêve-t-on pour l’avenir ? », cette dernière fait état des ambitions et des craintes actuelles ressenties par ces communautés autochtones.
C’est notre histoire, Premières Nations et Inuit du XXIème siècle © Jean-François Vachon, la Boîte Rouge Vif
L’intérêt de ces deux expositions réside dans le choix des œuvres, qui dans les deux cas, mettent parfaitement en lumière les traditions ancestrales, ainsi que la fierté de ces peuples, qui n’ont jamais cessé de revendiquer leur existence. La documentation y possède également un rôle primordial, avec des outils en libre-accès pour le visiteur, qui complètent de manière juste les informations dont il dispose au sein de ces deux parcours.
Les deux parcours certes, portent sur deux thématiques différentes, mais véhiculent un message revendicateur commun, à savoir : comment réparer les préjudices injustement subies par ces deux civilisations, et de ce fait, transmettre aux futures générations pour ne pas oublier les erreurs commises ? Le visiteur ne peut qu’être touché par la richesse de la création artistique aborigène, par la culture, et le mode de vie hérité de traditions ancestrales chez les Premières Nations, ainsi que les Inuits. Ce qui le conduit à réfléchir à sa propre place au sein de la société actuelle.
Joanna Labussière
#Civilisations
#Héritage
#Traditions
#Québec
Pour plus d’informations : https://www.mcq.org/fr/

TripAdvisor au Château de Ferney-Voltaire
Le château de Ferney Voltaire a ré-ouvert ses portes en juin 2018, après plus de deux ans de travaux.
L’ancienne demeure de Voltaire a été totalement rénovée et un nouveau parcours de visite a été imaginé, repositionnant l’homme des Lumières au centre de son château, qu’il acquit en 1758.
Voltaire reconstruit ce château à sa guise et aménage également le parc, créant son verger, son potager, ainsi qu’une charmille où il aime se promener. Il fait de sa demeure un lieu intense de vie sociale et littéraire. Il y continue son combat contre l'intolérance et écrit quelques 6000 lettres, le Dictionnaire Philosophique, le Traité sur la Tolérance, des tragédies... Il donne des représentations théâtrales au château et reçoit des hôtes venus de toute l'Europe des Lumières. Voltaire s’affiche également comme le bienfaiteur, le patriarche de Ferney, créant de l’emploi en développant notamment l’industrie des montres de Ferney.
A la mort de Voltaire, le château a eu une succession de propriétaires qui ont tour à tour permis de conserver l’âme du maître des lieux, en modifiant pourtant plus ou moins la distribution des pièces : La chambre de Voltaire change de place et devient un véritable lieu de mémoire, la cloison tombe entre la salle à manger et la bibliothèque. L'État acquiert finalement ce lieu en 1999.
A la manière d’une page trip advisor, voici des avis de personnes célèbres, majoritairement contemporaines à Voltaire suite à leur visite du lieu et leur rencontre avec Voltaire. Des parties de ces propos ont bien été écrites par les personnes en question. Nous les avons extraits de leur contexte, à la manière d'opinion d'internautes.
Château de Ferney Voltaire




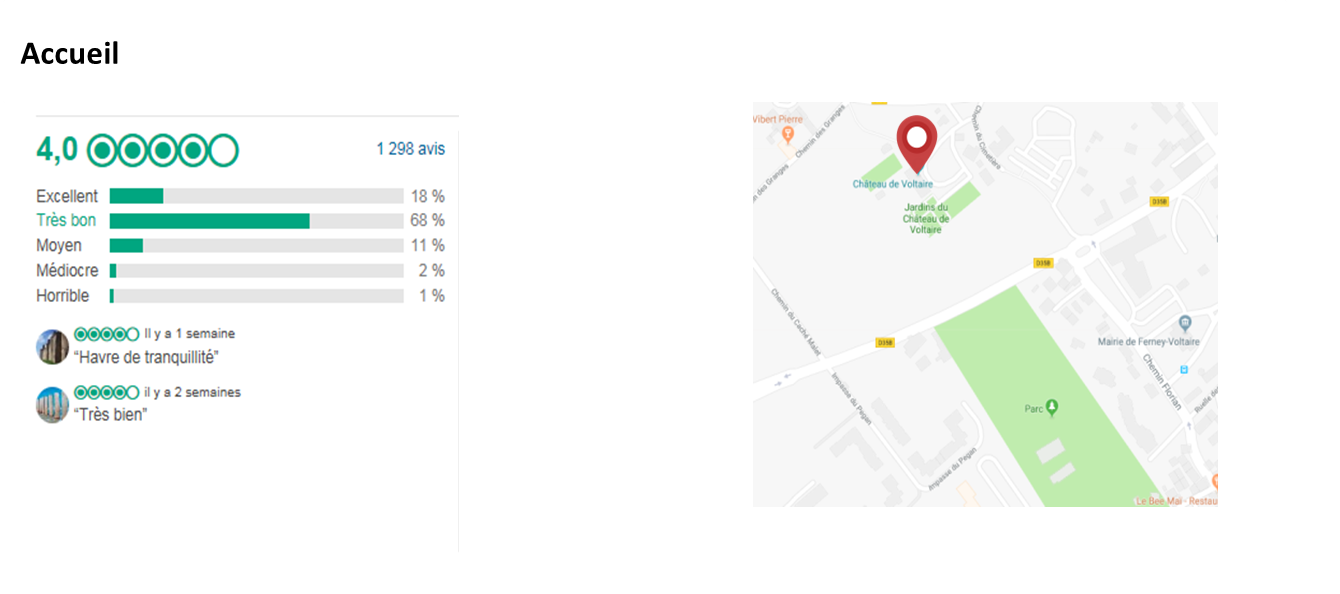
Infos pratiques
Le château est ouvert de 10h à 17h tous les jours, et de 10h à 18h du 1er avril au 30 septembre. Dernier accès 45 minutes avant la fermeture.
Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 6,5€
Accès en Bus par les lignes Y et F, arrêt Ferney mairie
Accès en voiture : parking municipal à 5minutes à pieds
Avis
Madame de Genlis :
Je suis de passage à Ferney en 1776. Je n’apprécie pas beaucoup le personnage, et je trouve ces écrits de fort mauvais goût. J’avoue m’être finalement laissé charmer par l’homme.
Il organisa une promenade en voiture. Il fit mettre ses chevaux, et nous montâmes dans une berline, lui, sa nièce, madame de Saint Julien et moi. C’est un homme qui aime son jardin, domaine. Il nous mena dans le village pour y voir les maisons qu'il a bâties et les établissements bienfaisants qu'il a formés. Il est plus grand là que dans ses livres, on y voit là sa bonté ! On ne peut se persuader que la même main qui écrivit tant d'impiétés, de faussetés et de méchancetés, ait fait des choses si nobles, si sages et si utiles pour son village, qu’il aime montrer à ses invités et dont il parle simplement avec bonhomie. Il vous instruit de tout ce qu'il a fait, et cependant il n'a nullement l'air de s'en vanter (je ne connais personne qui pût en faire autant).
En rentrant au château la conversation a été fort animée. On parlait avec intérêt de ce qu'on avait vu. Malgré un très fort niveau sonore au repas et l’impression que monsieur de Voltaire est toujours en colère contre ses gens, le moment fut très plaisant e je ne suis partie qu'à la nuit. Monsieur m'a proposé de rester jusqu'au lendemain après dîner, mais j'ai voulu retourner à Genève.
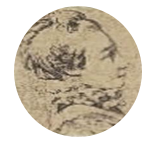 Amélie Suard, juin 1775 :
Amélie Suard, juin 1775 :
En juin 1775, j’obtiens enfin le but de mes désirs et de mon voyage à Genève, je rencontre Monsieur de Voltaire, que j’admire tant. Quel personnage, quel homme, quelle demeure !
Jamais les transports de sainte Thérèse n’ont pu surpasser ceux que m'a fait éprouver la vue de ce grand homme ! Il me semblait que j'étais en présence d'un dieu ! Rencontrer enfin celui longtemps chéri, adoré ! Enfin il m’était donné de pouvoir lui montrer toute ma reconnaissance et tout mon respect. Quel honneur pour moi qu’il accepta de me recevoir chez lui, qu’il me laissa partager sa demeure, son quotidien. Quel bonheur que de goûter les produits de son potager, de son verger, et son bon vin (car Monsieur possède de nombreuses vignes), je suis conquise !
 Edward Gibbon :
Edward Gibbon :
Je vais chez Voltaire en voisin à l’été 1763. J’assiste à l’une de ses performances théâtrales. Mais je reste un peu mitigée. La pièce jouée était pourtant ma préférée : L'Orphelin de la Chine. Voltaire incarnait lui-même Gengis mais il m'est apparu comme un comédien vociférant et manquant de naturel.
Peut-être ai-je aussi été trop frappé par l'absurdité de la scène : Voltaire, 70 ans, sous les traits d'un conquérant mongo. Perturbant…
 Jean Le Rond d’Alembert, 1770 :
Jean Le Rond d’Alembert, 1770 :
Je suis allé à Ferney en 1770, j’y avais emmené avec moi le jeune Condorcet. J’ai trouvé Voltaire si plein d’activité et d’esprit qu’on serait tenté de le croire immortel ! Il fait dans son canton plus de bien que n’en ont jamais fait les évêques d’Annecy depuis François de Sales.
C’est toujours un honneur pour moi que de le tenir informé des affaires de la capitale. J’ai séjourné longuement aux Délices, sa précédente demeure à Génève, mais on sent qu’il a fait de sa demeure à Ferney son véritable havre de paix, qu’il s’y est installé en patriarche de son village et qu’il gère ses affaires à sa guise, tel un homme libre, âgé mais apaisé.
 Condorcet :
Condorcet :
Je n’ai que 27 ans lorsque Jean Le Rond me fait l’honneur de m’amener avec lui voir son ami Monsieur de Voltaire.
C’est un privilège pour moi que de rencontrer ce vieil homme si lettré, si brillant, véritable symbole de notre époque. Je me sens alors si jeune et vierge de tous savoirs ! Mon cœur bat la chamade lorsque j’aperçois le grand homme. Je me sens alors si petit, qui suis-je donc face à lui ? Mais il m’approche avec la plus grande considération et le plus grand respect. Il me considère comme un égal et dit de moi que je serai le continuateur de l’œuvre commune par-delà de sa propre mort.
Je n’oubliai jamais ses paroles, je n’oubliai jamais cette intense rencontre.
 Boswell :
Boswell :
Je suis anglais, élève d’Adam Smith, je suis très intéressé par les grands hommes. Je suis passé à Ferney en 1764.
C’est pour moi un château enchanté, tenu par un magicien, qui me fit l’honneur d’apparaitre peu avant le diner. Quel homme savoureux, quel homme brillant ! Voltaire m'a ravi avec ses nombreux traits d'esprit. Je le fis parler anglais. Lorsqu'il parle notre langue, il est animé d'une âme tout à fait britannique, c’est admirable. Et Il a de l'humour. Il est tout à fait extravagant.
J’ai passé une merveilleuse soirée au château de Ferney Voltaire, que je suis loin d’oublier, et que j’ai hâte de partager avec mes compatriotes anglais à mon retour.
 Princesse Daschkov :
Princesse Daschkov :
Monsieur de Voltaire nous a longuement promené à travers ses terres. Il nous fit découvrir le joli village de Ferney, dont il contribua vivement au développement. Fatiguée par cette longue ballade, je suggérai de rentrer, mais il décida de nous amener dans les appartements de sa nièce Madame Denis. Nous discutons un peu avec la dame en tête à tête mais très vite son oncle nous rejoint pour le souper. Je fus surpris du caractère très simple de sa nièce, qui contraste avec l’extravagance de monsieur.
Lorsque nous primes congés, Voltaire demanda à me revoir lors de mon séjour à Genève. Je lui demandai alors la permission de venir le voir certains matins afin d’apprécier sa compagnie dans son cabinet ou son jardin. Une permission qu’il m’accorda sans réserve. C’est avec grand plaisir que je retournai plusieurs fois dans ce château au si joli jardin.
 Madame d’Epinay :
Madame d’Epinay :
Je pars pour Genève en 1758, j’y séjourne jusqu’en 1759.
J’ai toujours été un peu réservée à l’égard de Voltaire, je ne saurais vraiment dire pourquoi mais le personnage ne m’attire pas confiance.
Cependant, à mon arrivée chez Voltaire, ce déjà vieil homme semble très aimable, plus gai que ce que j’imaginais, et même assez extravagant. Un ton de familiarité s’installe assez vite entre nous. Il m’a fait tout plein de déclarations les plus plaisantes du monde. Un hôte d’excellente compagnie, à la demeure très plaisante.
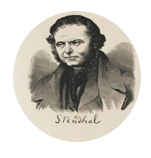 Stendhal :
Stendhal :
Je n’ai pas eu la chance d’être un contemporain de Voltaire, mais en me rendant chez lui une trentaine d’années après sa mort, j’ai tout de même eu l’impression de m’approcher au plus près de ce grand homme.
A Ferney, on m'a répété le conte suivant : Voltaire, en homme d'esprit, voulait tout faire par lui-même; il avait tracé avec sa plume le plan du château qu'il faisait bâtir. Il avait indiqué les murs d'un trait; mais quand on fut au premier étage, toutes les pièces parurent petites, et on s'aperçut que, dans le plan, Voltaire avait oublié l'épaisseur des murs. Mon grand-père, était allé cinq fois à Ferney. Il m’avait conté ses rencontres avec Voltaire.
Lors de ma visite, tout semblait comme je l’avais imaginé d’après les récits de mon grand-père. Sa chambre était encore parfaitement dans l’état où il la laissa en partant pour Paris peu avant sa mort : tenture de taffetas bleu passé, portraits du roi de Prusse, de Madame du Châtelet, de Lekain, une belle demeure, remplie d’âme. Ses livres étaient remplis d'une infinité de petites marques en papier de trois lignes de large et six pouces de long: elles portaient un mot. Quand Voltaire voulait un fait, il grimpait au haut de l'échelle de sa bibliothèque, et lisait rapidement les mots de toutes les marques d'un volume.
J.S.
#Ferney-Voltaire,
#château
#Voltaire
#CMN
#Centre des Monuments Nationaux,
#Patrimoine

Un jardin botanique est-il un musée ?
Lieu de diffusion de la culture scientifique au même titre qu’un muséum, le jardin botanique ne répond cependant pas aux mêmes contraintes d’exposition – et d’ailleurs, s’agit-il d’un lieu d’exposition comme un autre ? Peut-on le considérer comme une structure muséale, et quelles sont les contraintes inhérentes à ce type d’établissement particulier ? Avant de tenter de répondre à ces questions, intéressons-nous à trois grands facteurs qui influencent l’organisation d’un jardin botanique :
- La nature majoritairement vivante (et donc en constante évolution) de ses collections
- Ses espaces généralement situés en extérieur, soumis aux intempéries ainsi qu’à une luminosité, une hygrométrie et des températures changeantes
- La nécessité de ne pas dénaturer le paysage ni empiéter sur l’espace vital des espèces présentées
Gérer des contraintes environnementales spécifiques
Si les musées d’intérieur peuvent la plupart du temps concevoir leur scénographie et leur programme d’expositions sans se soucier de facteurs météorologiques, ces derniers impactent beaucoup le fonctionnement des jardins botaniques. Citons par exemple le jardin du Haut Chitelet, situé au cœur des Vosges : une importante épaisseur de neige le recouvre en hiver, et la route le reliant au reste du monde est alors coupée. Les lieux restent donc fermés une grande partie de l’année (d’octobre à juin), avec un taux de visiteurs très dépendant de la météo. D’autres structures telles que le Jardin des Plantes de Paris bénéficient de conditions plus stables mais doivent faire preuve de vigilance quant au critère de respect des paysages, les architectes ayant imposé des consignes strictes liées aux perspectives et à l’organisation spatiale des différents éléments. L’esthétique d’un jardin repose en effet sur son décor végétal, entretenu de façon à créer une harmonie de couleurs et de formes grâce à l’agencement précis des diverses espèces de plantes. Un trop grand nombre de supports écrits ou de dispositifs de médiation risquerait de gâcher le tableau en créant des obstacles visuels et en faisant de l’ombre aux végétaux. Contrairement à un musée d’intérieur, il est ici impossible d’utiliser des murs pour optimiser l’espace (sauf dans les bâtiments de type serres). Par ailleurs, n’oublions pas que l’aspect du jardin évolue en fonction des saisons et que cela doit être pris en compte par le muséographe : un dispositif proposant d’observer les fleurs d’une plante non pérenne pourra s’avérer pertinent pendant la période printemps/été, mais il perdra tout son intérêt en automne/hiver, quand les fleurs en question seront fanées.
Certains établissements présentent aussi une contrainte topographique. C’est le cas du jardin Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy, où le relief très vallonné rend le terrain inégal et complique l’accessibilité de certaines zones pour les publics ayant des difficultés de déplacement. Malgré tout, les jardins botaniques ne sont pas toujours dénués d’éléments scénographiques : au jardin Jean-Marie Pelt, des microarchitectures en bois viennent s’ajouter aux panneaux pédagogiques et se fondent harmonieusement dans le paysage. Un parcours thématique sur la faune sauvage exploite quant à lui le décor naturel pour illustrer le contenu textuel grâce à des « fenêtres d’observation ».

FDispositif et élément scénographique exploitant le milieu naturel (jardin Jean-Marie Pelt) – © M.T.
Etant donné la difficulté d’installer des écrans dans la partie extérieure où ils risqueraient de se dégrader rapidement, les dispositifs numériques se présentent souvent sous forme de QR codes et autres applications pour smartphones, ou encore de locations de tablettes et audioguides. Seuls les espaces intérieurs offrent des conditions plus propices à l’installation de dispositifs fragiles – quoique cela ne se vérifie pas toujours : les serres tropicales, par exemple, ne sont pas forcément adaptées puisque parfois très humides. Les contraintes liées à l’environnement peuvent cependant être compensées par la mise en place d’activités de type ateliers, jeux de pistes, conférences, soirées à thème, etc. Une programmation culturelle dynamique et des expositions temporaires peuvent ainsi hisser le jardin botanique au même niveau de médiation que n’importe quel musée d’histoire naturelle.
Créer des passerelles entre différentes branches scientifiques
Le discours des différents jardins ne se réduit pas obligatoirement au monde végétal – il peut aussi inclure des sujets en lien avec la zoologie et l’écologie, car les plantes font tout autant partie de la biodiversité que les animaux et les micro-organismes avec lesquels elles interagissent étroitement. Ainsi, le Haut Chitelet présente tout au long de son parcours des sculptures en bois représentant des espèces animales de la région des Vosges, tandis que le jardin Jean-Marie Pelt propose des dispositifs d’observation de la faune. Ces éléments, loin d’être superficiels, permettent de faire comprendre au public les interactions fondamentales existant entre tous les organismes, et ainsi éviter de transmettre l’image erronée d’une flore séparée du reste du monde vivant. Cette stratégie nécessite néanmoins d’être mûrement réfléchie, car elle possède un double-tranchant : les animaux captent plus facilement l’attention des visiteurs, au risque de faire passer les végétaux au second plan. Les parcs zoologiques et aquariums n’incluent d’ailleurs généralement pas du tout (ou très peu) de notions botaniques dans leur discours, preuve de l’existence d’un fort déséquilibre en termes d’attractivité.

Exemple de sculpture animalière au jardin du Haut Chitelet – © M.T.
Diffuser, conserver, étudier : les trois missions du jardin botanique
Parallèlement à leur mission de diffusion des connaissances, les jardins botaniques remplissent deux fonctions moins tournées vers le public mais tout aussi essentielles, et qui les rapprochent des musées : la conservation et la recherche scientifique. Cela inclut notamment l’inventaire de la flore régionale et mondiale, l’enrichissement d’un fonds patrimonial (ouvrages, herbiers), la formation spécialisée, ainsi que les échanges de graines au sein de l’IPEN (International Plant Exchange Network). Chaque année en moyenne, le jardin Jean-Marie Pelt reçoit ainsi 1 400 lots de semences et en expédie 2 000 à d’autres membres du réseau. Il propose également des publications et s’implique dans des enjeux de société liés à la botanique – comme le problème des pollens allergisants – tout en mettant à disposition la base de données des herbiers nancéiens. Le Haut Chitelet, quant à lui, abrite une « nursery » de plantes cultivées hors sol dans l’attente d’être intégrées aux collections. Ces spécimens ont pour les uns été collectés dans la nature et pour les autres légués par des collectionneurs privés ou institutions. Ils sont gardés à l’écart pendant leur période d’adaptation, dans une zone interdite d’accès au public et uniquement dédiée à la conservation.
Le rôle des jardins botaniques dans le paysage de la recherche pose par ailleurs une question propre aux structures présentant des spécimens vivants : celle des espèces invasives. Le Haut Chitelet s’est ainsi trouvé confronté à une difficulté lorsque l’une des plantes exotiques qu’il présente, le lysichiton américain (ou faux arum), a été déclarée interdite de détention en Europe en raison de la facilité avec laquelle elle colonise les écosystèmes, au point de menacer les espèces locales. Les équipes ont déposé une demande d’autorisation de détention, mais si le jardin ne répond pas aux conditions imposées par la nouvelle législature, il pourrait être amené à devoir se séparer de cette espèce.

La nursery du Haut Chitelet et quelques plants de lysichitons américains – © M.T.
Les jardins botaniques remplissent donc les mêmes missions qu’un musée, développent des stratégies similaires pour capter et satisfaire un large public, et sont amenés à nourrir une importante réflexion d’ordre scénographique. Les contraintes auxquelles ils sont soumis du fait de leur implantation en extérieur les rapprochent par ailleurs des zoos, et en font des structures situées à mi-chemin entre le muséum et le parc de loisirs en plein air. Cette alliance du discours scientifique à l’art paysager et aux activités de promenade offre aux visiteurs une expérience intellectuelle et sensorielle complète – un musée idéal, en somme ?
M.T.
Des liens pour aller plus loin :
Le Jardin d’altitude du Haut Chitelet
Le Jardin des Plantes de Paris
L’IPEN (International Plant Exchange Network)

Un musée au plafond bleu
En pleine zone urbaine (ou non), au creux de nos campagnes ou proche de friches industrielles : les jardins éclosent et égrènent nos offres culturelles. Quels en sont les enjeux ?
image d'introduction : Museum Insel Hombroich ©Alexis
S’évader au grand air, fouler l’herbe de ses pieds nus, sortir de sa masure et se reconnecter à notre Nature : un rêve, une scène idéale pour beaucoup de citadins durant la succession de plusieurs confinements. Road trip, vagabondage, vivre l’ailleurs, reconnexion à la nature et expérience simple : la fréquentation des jardins ne fait qu’augmenter.
Rattachés à des musées, les jardins sont considérés comme un prolongement extérieur d’une exposition, comme une salle à part entière. Sont alors pensés la muséographie et la scénographie de ces lieux. Cependant, ce rayonnement ne s’arrête pas à la structure muséale : potager, jardin naturel, jardin artificiel, jardin botanique, jardin pédagogique, jardin de contemplation, de plaisir, de promenade, collaboratif, associatif, de repos… Éphémère ou permanent : des lieux de tous les possibles, où les fantasmes d’un monde plus lent et vertueux s’expriment. Découvrons les ensemble.
Un feu créativement destructeur
Le Jardin Éphémère, Place Stanislas ©Claire Delon - Exposition “Le Feu Effleure !” ©Mélanie Terrière
“Nous ne sommes plus sur une crise, mais un changement de modèle climatique [...] personne ne peut le nier” annonce Isabelle Lucas, adjointe au Maire de Nancy, à l’ouverture du Jardin Éphémère à Nancy, édition 2022.
Chaque année d’octobre à novembre, le Jardin Éphémère place Stanislas est le rendez-vous automnal attendu par les Nancéien.nes. Lieu de promenade, de délectation, d’engagement, de surprises et d’expérimentation : c’est un événement qui, depuis plusieurs années, aborde notre relation avec Dame Nature.
Depuis plusieurs éditions, une récurrence s’installe au choix de la thématique annuelle : la municipalité souhaite utiliser le Jardin tel une œuvre engagée et y aborder des thématiques brûlantes. “Terre ou désert ?", “Eau de vies”, “Place à l’arbre”... Cette année, “Le Feu effleure” est annoncé en lien avec le Congrès National des Sapeurs-Pompiers : un jardin hommage au travail effectué pendant les feux de cet été. Sont également proposés des visites guidées, des créations d'œuvre d’art contemporain, des ateliers et une exposition temporaire au milieu des buissons.
Tantôt engagé ou visuellement accrocheur, comment par le jardin et la nature, sensibiliser tous les publics, tout en valorisant un savoir faire local ? Un manifeste pour valoriser des connaissances nécessaires à une transition écologique évidente. 36 000 visiteurs y ont participé cette année.
Un Eden allemand

Museum Insel Hombroich ©Alexis - Museum Insel Hombroich ©Alexis
Une harmonie entre la nature et l’art, un parc idyllique de 20 hectares entre plénitude et zénitude : en tout cas, c’est comme ça qu’on nous le vend.
Autre exemple : le Museum Insel Hombroich est un lieu perdu au fond de la campagne allemande. Les visiteurs ne s’y bousculent pas même les jours de beau temps. Ils peuvent y savourer un temps de calme, de repos et de contemplation en pleine nature. Tantôt jardin, parfois musée : s’y chevauchent et s'entremêlent plusieurs bâtiments abritant des collections privées d’art contemporain et sentier en friche où poussent champignon et mousse. Cette œuvre humaine entre en résonance avec l'œuvre naturelle.
Passé l'accueil, un univers parallèle qui s’ouvre à nous : étangs, lacs, verdure luxuriante, sentier sinueux, fleurs, herbes folles et dansantes, plantes exotiques, prairies où le temps semble être arrêté. Dans ce jardin, c’est la nature qui prend ses droits, et l’humain qui l’accompagne et la contemple. Bien que tout soit aménagé artificiellement, ce n’est pas par la force et le contrôle qu’il est pensé : au contraire. Ce n’est pas un jardin à la française, mais plutôt du type anglais : on s’y pavane, s'arrête, s'étend dans l'herbe. Les visiteurs se laissent surprendre par des bâtiments entre deux bambous ou deux hortensias : on y vit son soi et sa curiosité. Il n’y a pas de parcours imposé. A chacun sa propre interprétation, place au lâcher prise.
Au détour d’un chemin, même si nous sommes dans un musée jardin, nous ne tombons pas nez à nez avec des cartels ou des textes de salles, mais directement avec des œuvres abritées ou en pleine nature. Ce n’est pas un lieu d’apprentissage pur : le public est amené à se demander comment l’objet est arrivé ici, d’où il vient, et comment s'intègre-t-il dans son nouvel environnement : il y mobilise son imaginaire, ses sens et se sent à l’aise. Au calme. Le bruit du vent est perceptible, le craquement des feuilles résonne, les buissons semblent se déplacer et les oiseaux s’époumonent. Une ode à la vie.
Le parc est construit sur un ancien site industriel aux allées géométriques et rangées. En 1994, le site est réaménagé : tout est pensé en courbe, asymétrique, le plus naturel possible où des œuvres en acier rouge corrodé rencontrent une nature au feuillage multicolore. Un pied de nez à cette époque industrielle dévastatrice. C’est radical.
Un simple carré de terre


Le jardin des simples et des saveurs oubliées ©La Ferme du Temps Jadis
La ferme du temps Jadis à Auby est un écrin de nature, une ferme et un musée d'anciens matériels agraires dans le Nord Pas-de-Calais. Sous l'appellation “écomusée”, ce lieu revendique son mode de fonctionnement bénévole, sous forme d’adhésion à leur association à but non lucratif, collectif, ludique et pédagogique. Une revendication assumée : la nécessité de transmettre un savoir-faire essentiel pour mieux appréhender les années à venir. Faire germer, faire une bouture, planter, transplanter, arroser, patienter… Y germent près de 150 variétés de plantes aromatiques, médicinales, tinctoriales dont l’origine ancienne intrigue et fascine.
“Ce jardin permettra de faire découvrir certaines plantes qu’on trouve à l’état naturel, qu’on peut considérer comme de la mauvaise herbe mais qu’on peut utiliser dans la cuisine, pour soigner des brûlures…” détaille le président de l’association et porteur du projet : Jean-Pierre Lesage. La transmission est le leitmotiv du projet : (ré)apprendre à utiliser ses mains, à produire sa propre alimentation et en comprendre le processus.
Ce n’est pas seulement la vue qui est mise à l’honneur : bien que les couleurs du site apaisent, le toucher et l’odorat sont également mobilisés. Un sentier à parcourir pieds nus afin de ressentir les différentes matières terrestres est proposé : terre, boue, écorce ou lin séché. Les bénévoles de l’association proposent d’y apprendre à créer son propre purin, de s’informer sur l’art du compostage et d’apprendre à cuisiner les légumes du potager de saison. Des chantiers participatifs gratuits sont annoncés, et mobilisent les habitants locaux à planter des arbres fruitiers et d’étendre les vergers déjà existants. Des nids d’oiseaux sont installés ainsi que des refuges pour les animaux. Ce maillage végétal et écologique est destiné à rétablir une faune et une flore qui étendent ses racines sur un paysage rongé par le travail minier.
Un avenir fait de plantes
C’est un constat général, la fréquentation des musées n’est pas similaire à ce qu’elle était avant la pandémie. Certains pourraient annoncer que les publics sont moins curieux : ne sont-ils pas juste ailleurs, en pleine nature, à la recherche d’un sens nouveau, plaisir et délectations ?
A l’heure où on pense chaque jour aux sales années à venir, où une transition écologique n’est peut-être plus suffisante, les Jardins (et ils sont nombreux!) offrent un havre de sérénité, d’espoir, de relaxation afin de mieux appréhender le futur à venir. Chérissons-les, et découvrons-en d'autres !
Museum Insel Hombroich ©Alexis
Alexis
Pour en savoir plus :
-
Japon, l’art du jardin zen - Arte
-
Série de documentaire (4 vidéos) - La vie sauvage d’un jardin - Arte
-
Série de documentaire (3 vidéos) - La nature, l’art et nous - Arte
-
Azur et Asmar - Le jardin de Jénane - Gabriel Yare
#jardin #transitionecologique #musée
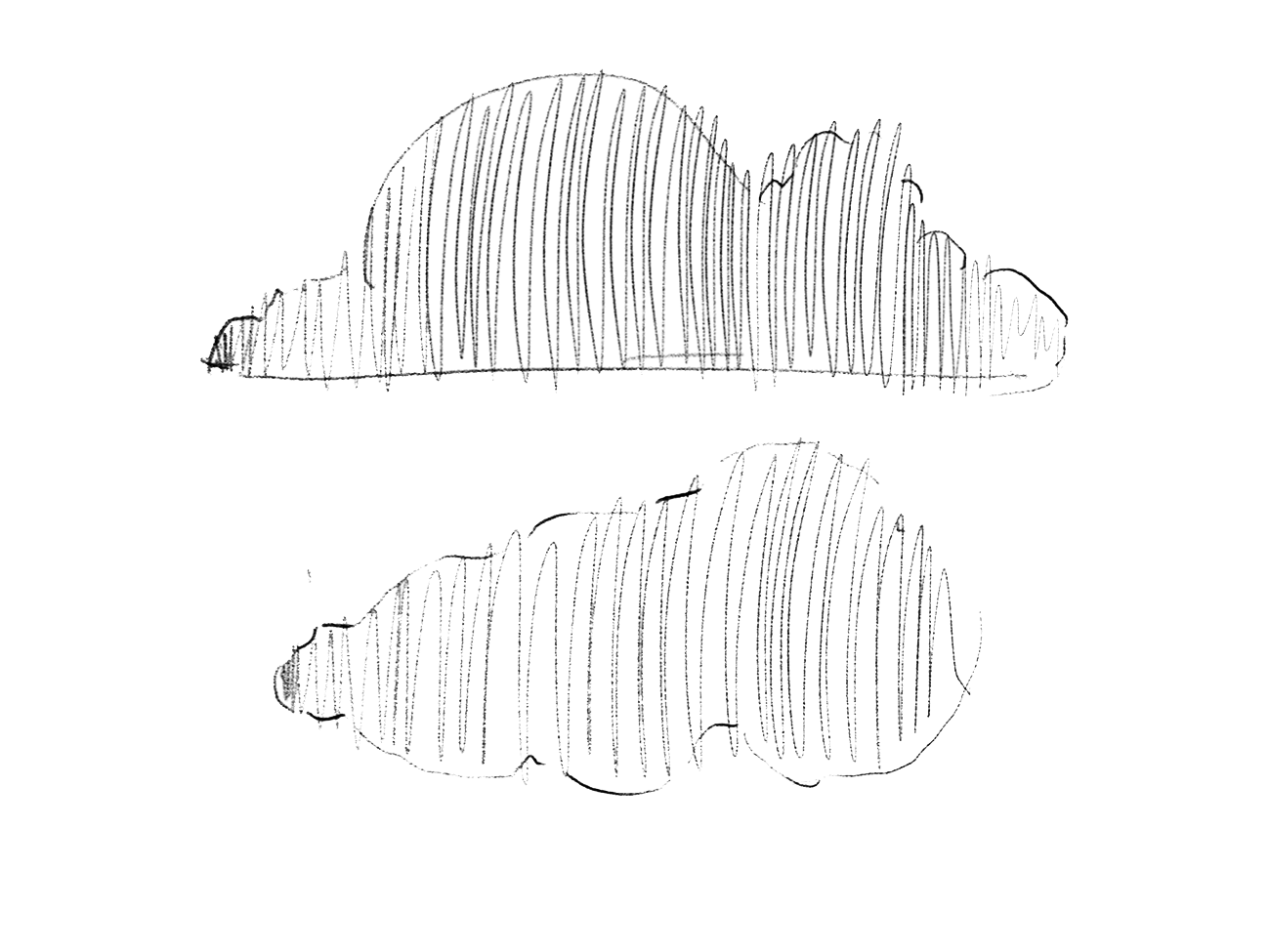
Un musée virtuel de Gaza
Un collectif d'artistes Gazaouis se regroupe au MuCEM afin d’échanger autour de leur nouveau projet : SAHAB, la création d’un musée virtuel de Gaza. Dans une ville ou il n’y a pas de musée (et bien d’autres institutions manquent à l’appel), cet échange relance l’espoir et l’engagement de créer un lieu de culture pour une population qui en est privée de par la guerre en Palestine.
Les Gazaouis au MuCEM
Le MuCEM à Marseille a été inauguré en 2013 suite à la nomination de la ville “Capitale Européenne de la Culture”. De par ce titre, une multitude d’actions culturelles, et surtout de chantiers de rénovations ont eu lieu à Marseille : construction du dit musée, rénovation complète du Musée d’Histoire de Marseille et construction de l’Ombrière miroir du Vieux-Port. En soi, une somme d’argent colossale pour redynamiser la 2e ville de France, et en faire le poumon culturel du bassin méditerranéen.
Revenons au MuCEM. En ses murs, un endroit dédié aux échanges entre professionnels et scientifiques, incubateur de bonnes idées : le MuCEMLab. Situé au Fort Saint-Jean, c’est un espace consacré à la recherche et la formation. Y prennent place des cours et des conférences, des séminaires de recherche, des journées d’études et des colloques ouverts aux chercheurs, aux étudiants, mais aussi à tout public curieux d’y participer.
Présentation du projet au MuCEMLab ©AP
Le mercredi 1er juin, j’ai pu assister à la présentation d’un projet : SAHAB, le musée des futurs de Gaza.
Actuellement en résidence à la Cité internationale des arts à Paris, le collectif HAWAF (Mohamed Bourouissa, Salman Nawati, Mohamed Abusal et Sondos Al-Nakhala) se retrouve au MuCEM et nous fait part de la situation à Gaza : c’est un territoire sous blocus et embargo, ou toute construction physique n'échappera pas à la destruction par bombardement. C’est une ville isolée du monde. Il n’y a aucune institution culturelle, ni de musée physique. Pourtant, la topographie et l’histoire de la ville sont très intéressantes : c’est une ville historique, une ancienne plaque tournante du commerce eurasien depuis les anciennes civilisations. Sous terre, se cache un nombre incalculable de trésors. Gaza s’étend sur 365km² pour 2 millions d’habitants, qui s'intéressent à leur histoire.
Dans ce contexte particulier, une grande scène artistique contemporaine émergente existe pourtant (dont fait partie le collectif HAWAF) et propose des projets innovants, avec une forte volonté de transmission d’un héritage culturel mis à mal depuis des décennies de guerre.
D’après les artistes, c’est la rencontre de l’art et de la culture populaire qui est le meilleur moyen pour développer une société, le musée étant le garant du maintien et du rayonnement de cette culture.
Revenons à notre collectif… Le projet qu’il porte a été initié par l’Institut français, implanté à Gaza depuis 1989. Cet institut accompagne la scène artistique en proposant des échanges et des résidences en France. C’est un projet qui se veut heureux, en contraste avec la situation à Gaza. L’envie principale est de parler de la ville, et de créer un projet fédérateur qui dépasse le noyau dur des artistes.
SAHAB, le musée virtuel
C’est de ces envies que la décision de créer un musée numérique et virtuel a émergé. Il ne pourra pas être détruit physiquement et demandera un budget beaucoup moins élevé. Les outils nécessaires sont à disposition, ainsi que le savoir-faire : les Gazaouis, dispersés dans le monde de par les migrations, ont pour habitude de travailler avec des outils numériques. Les artistes ont également une formation d’art numérique.
SAHAB, le nom du projet signifie “le nuage”. Il porte la même signification que CLOUD en anglais, et est donc lié au numérique. De plus, un nuage dans le ciel appartient à tous. L’idée de construire un musée nuage est née.
Sa forme suivra le principe de la sédimentation : comme une strate, y sera présenté le passé et le présent de l’histoire de la ville. Chaque ligne de cette strate représente une histoire singulière.
Sahab, un musée virtuel ©AP
Qu’est-ce qui est important dans ce projet ?
Pour commencer, un mot : isolement. C’est leur lutte principale. Les populations sont isolées du monde. Ensuite, la notion de communauté : ils souhaitent la recréer, et la rendre visible. “Rebuild the community… Throught the immaginary museum !” disent-ils.
Après de multiples discussions avec la Cité des Arts, la discussion tourne autour des collections qu’un musée virtuel peut posséder. S’en dégagent 4 pistes : des collections plutôt archéologiques ? Folkloriques ? D’art moderne ? D’art contemporain ?
Un éco-musée de Gaza ?
Les collections autour du folklore ont provoqué le plus d’engouement. Partir de l’histoire des habitants et des objets qu’ils possèdent pour constituer une collection et permettre de créer un lien entre les communautés et le musée. Cela n’est pas sans rappeler l'avènement du musée des ATP au bois de Boulogne.
De plus, à Gaza, il y a un mélange entre les gazaoui et les Palestiniens des autres villes qui ont apporté une culture différente. Il y a donc un terreau et une richesse culturelle populaire extrêmement riche.
La première exposition pourrait être “What it means to have a museum in Gaza ?”, soit “Qu’est-ce que cela représente d’avoir un musée à Gaza ?”. C’est une collecte à partir d’enfants et ado de Gaza en leur posant cette même question.
Des réflexions sont menées notamment sur l’intégration des enfants dans ce processus de création : peut-être en ayant des jours dédiés pour eux dans le musée virtuel ? Un coin interdit aux adultes ?
De fait, l’envie principale est de stimuler l’imagination et de continuer à rêver : “Et si on avait… Et si on avait… Et si on avait…” se posent sans cesse les artistes. C’est un musée imaginaire, mais qui s'ancre dans la réalité. Celle des Gazaouis.
Les habitants possèdent chez eux des trésors à valoriser ©AP
Un projet similaire avait vu le jour en 2015, le “Palestinian Museum”. Cependant, il fut énormément critiqué dès son inauguration car il n’y avait aucune collection, et que cela avait coûté une somme d’argent considérable avec son architecture monumentale. La première exposition portait également sur des interviews en format numérique car le musée était fermé à ce moment-là. Il y a peu de nouvelles de ce musée depuis. C’est l’avantage de vouloir créer un musée virtuel, c’est l’affranchissement envers le bâti. Des liens sont tout de même tissés entre différentes structures du Proche-Orient autour de ce projet.
Y ont eu lieu des coopérations entre des musées parisiens comme Orsay et L’Institut du Monde Arabe. Le projet SAHAB est un héritier de ce mouvement qui n’a pas réussi à donner fruit, et pour cause. Pour le moment.
De ce constat est né le projet d’une deuxième exposition : faire part de tous les essais de création de musée en Palestine, bien nombreux entre 1992 et 2002.
Pour l’économie du projet, des pistes sont déjà avancées : le collectif répond à des appels à projet, compte sur des subventions pour son développement, et prévoit de créer une économie autour des nft et des tokens. Cependant, avec la chute de ces derniers ces dernières semaines, il est difficile d’imaginer une économie durable autour de cette monnaie.
Pour finir, la question principale reste la façon d’intégrer des habitants de Gaza et de la diaspora palestinienne à ce projet. Pour rappel, l'électricité est disponible quelques heures par jour, et l’accès à internet non systématique. Les artistes répondent que, de toute manière, quand rien n'existe, tout est possible. C’est un projet qui donne l’opportunité à la rencontre de quelle que soit sa nature. Un musée virtuel fait sens. Surtout quand, de par la guerre qui ravage des pays et l’immigration qui s'ensuit, il est plus facile de connecter les communautés du monde entier plutôt que de se rendre à Gaza pour visiter un musée.
Des actions dans Gaza, “online/offline” ©AP
Alexis
Pour en savoir plus :
Il y encore peu d'informations sur ce projet. À venir !
#patrimoine #société #numérique
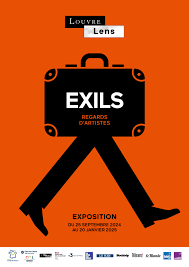
Un projet de conception partagée intégré à l’exposition EXILS-Regards d’artistes
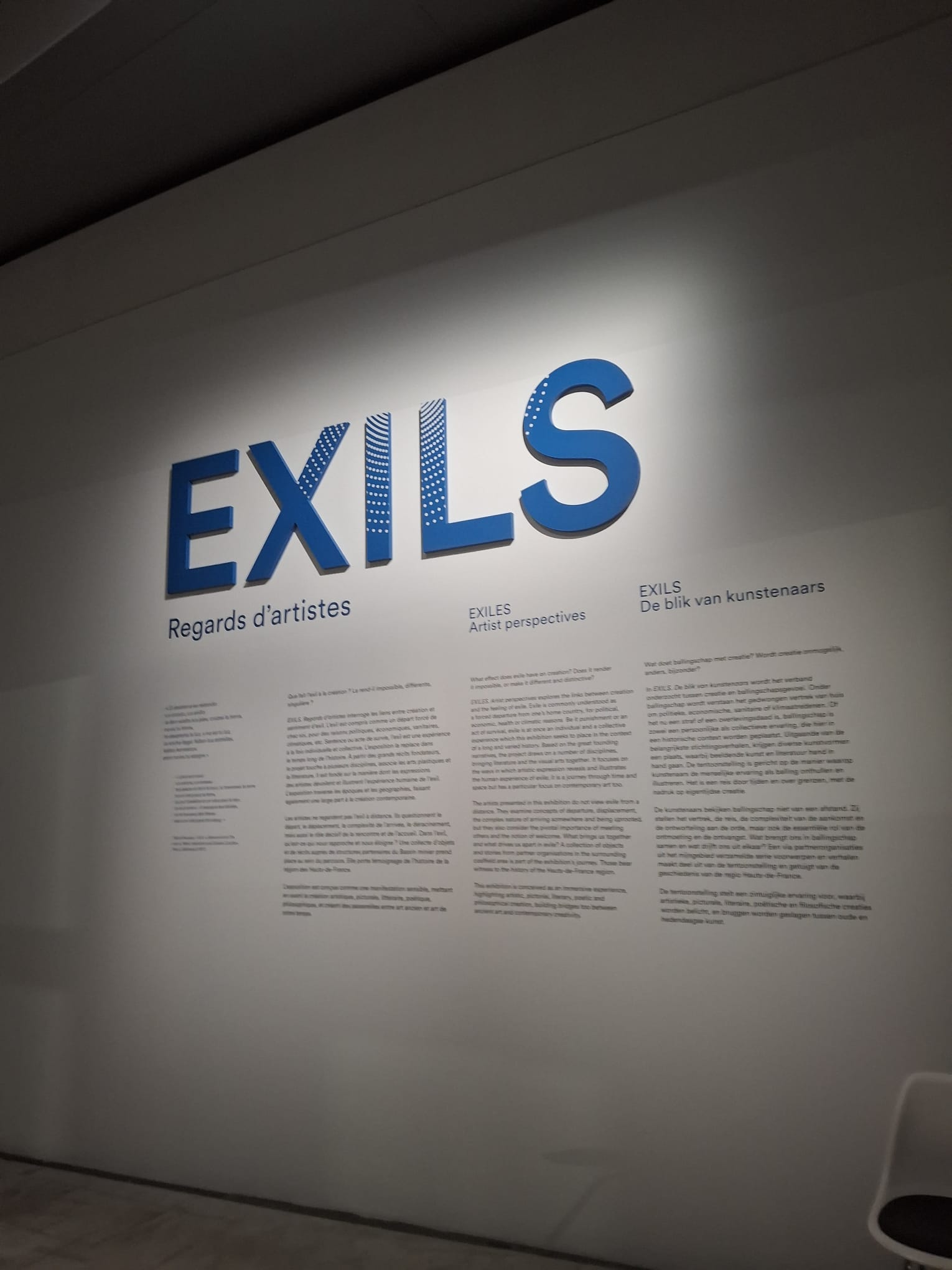
Musée du Louvre-Lens, ©Pauline Mabrut
En position centrale au musée du Louvre-Lens se trouve le public, présent dès la conception d’une exposition. Annabelle Ténèze, directrice du musée, et Dominique de Font-Réaulx, commissaire de l’exposition, ont pensé pour une section de l’exposition Exils, Regards d’artistes un projet participatif et inclusif, mené avec le concours de plusieurs structures partenaires.
Musée du Louvre-Lens, ©Pauline Mabrut
Six associations oeuvrant pour les populations du territoire ont travaillé sur le projet :
- l’APSA-CADA, Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (Liévin)
- l’association Femmes en avant (Liévin)
- le Centre socioculturel Alexandre Dumas (Lens)
- le Centre socioculturel François Vachala (Lens)
- l’association La Cimade (Lens)
- le SAVI, Service d’Accompagnement vers l’Intégration pour les mineurs immigrés (Béthune)
Avec eux, dix étudiants répartis en trois groupes de trois ou quatre, issus des divers parcours du Master 2 de l’École du Louvre.
Une exposition - porte d’entrée d’un dialogue entre art et territoire
L’exposition a trouvé terre d’asile à Lens, où elle a toute sa place. Le musée est ancré dans le bassin minier dont le développement a été rythmé par plusieurs vagues de migrations. De nombreux habitants du territoire, en quête d’un travail, ont vécu l’exil ou sont enfants ou petits-enfants d’immigrants. Aujourd’hui encore, le Pas-de-Calais vit au quotidien la présence et le passage de migrants qui tentent une traversée périlleuse vers le Royaume-Uni sur des canots de fortune.
Une partie de l’exposition a été construite en lien avec treize habitants du territoire lensois à qui fut proposé d’embarquer pour une aventure profondément humaine et à l’image de l’exposition. Port de départ : la présentation du projet par les associations aux potentiels témoins. Les structures partenaires ont retenu ceux dont le récit et les traces d’exils étaient les plus représentatifs et en phase avec l’exposition. Puis ont eu lieu les rencontres entre étudiants et habitants, suivies d’une longue traversée commune : une année riche d’écoute, d’échanges et de partages d’expériences.
Une collecte d’objets
Les habitants « témoins », présélectionnés par les associations, ont été invités à confier au musée le temps de l’exposition un ou des objets qui pour eux symbolise(nt) l’exil. Le Louvre Lens est Musée de France, mais sans collection permanente : pour l’exposition Exils, la notion de prêt, plutôt que de dons comme au Musée National de l’Histoire de l’Immigration, a tout de suite instauré la confiance et rassuré les témoins. Les habitants ont eu tendance à proposer de beaux objets (comme les assiettes de Marguerite de Hongrie) car l’espace du musée leur est d’emblée assimilé au prestige. Cette réaction questionne les codes du musée car elle s’oppose au principe d’Exils : ici ce sont des objets de sens et de mémoire familiale qui ont été prêtés. Ils sont des récepteurs et des traces de l'histoire d’exilés sur trois générations et sont traités au même titre que des œuvres d’art : leur état est étudié avant et après l’exposition et leur manipulation est délicate et professionnelle.
Précieux ou quotidiens, ces objets ont été emportés avec soi, rachetés en France ou encore offerts. Certains sont directement rattachés à Lens comme le collier de cheval (de la mine ou des maillots de football, ce qui permet aux habitants de la ville de s’y identifier. Ils rappellent aussi qu’au plus fort de son activité, le bassin minier rassemblait trente-deux nationalités.

Collier de Flageolet, cheval de fond de l’arrière-grand-père
Collier de cheval en bois, cuir et métal, Flandre-Occidentale, Belgique, 1850-1950
Musée du Louvre Lens © Pauline Mabrut
« Cet objet, je pense que je l’ai prêté pour que le regard des autres sur les personnes qui sont étrangères soit différent. Qu’ils se disent : “Après tout, cet objet, il est là, il a vécu presque toute sa vie dans nos mines, sur Lens, mais il représente autre chose.” […] Et les questions qu’ils vont se poser derrière : “Pourquoi est-il arrivé là ? Pourquoi il est comme ça ? Qu’est-ce qu’il peut nous raconter ? Et nous, dans notre propre histoire ?” Jocelyne D., Cimade, Lens
Un recueil de témoignages
Des paroles ont aussi été recueillies et Exils en mesure la charge émotionnelle. L’objet est pour certains prêteurs la cristallisation d’un récit qu’ils partagent.
L’escale suivante a été l’étude et l’analyse des échanges : les étudiants ont proposé les objets et les séquences audios collectés au commissariat de l’exposition. Ils ont décidé, ensemble, des objets qu’ils souhaitaient exposer (et qui pouvaient l’être). La sélection de 17 objets n’en a finalement laissé que peu de côté, il s’agissait surtout de choisir parmi plusieurs objets proposés par un même témoin.
La rédaction des commentaires, pour les cartels par exemple, a été faite par les étudiants et en lien avec les associations partenaires. Ils ont été validés après relecture par toutes les parties concernées.
« Le souvenir des calebasses, pour moi, c’est tous les jours en fait. Et encore ça me suit, parce que, malgré que je sois en France, elles sont avec moi. Pour moi, c’est un beau souvenir. C’est comme si j’étais toute avec ma famille ici et tout ce que j’avais fait toute petite. Mon souvenir, il me suit. C’est pas grand-chose, mais, pour nous, c’est grand-chose ». Mariam (Maya) D., Femmes en avant, Liévin
Assiettes de Marguerite
Hongrie, vers 1930-1940, céramique
© Musée du Louvre-Lens
« Le but, ce n’est pas de parler de l’assiette. L’assiette, c’est le moyen – c’est le médium, j’allais dire – d’arriver, d’accéder à la mémoire ». Famille Tillman-Farkas, Deboudt – Éric D., Lens-Salome
Une scénographie ouverte
La scénographie ouverte affiche une volonté de ne pas établir de différences entre chefs-d’œuvre historiques, œuvres d’artistes contemporains, et objets de la collecte. L’emplacement de cette dernière avait déjà été plus ou moins défini puisque la commissaire l’avait pensé dès le début du projet comme une partie intégrante de l’exposition. Le mobilier est bien intégré, c’est pourquoi les étudiants sont peu intervenus sur cet aspect même s’ils ont pu participer à plusieurs rendez-vous avec le scénographe Maciej Fiszer. Ils ont présenté la liste des objets retenus et des propositions scénographiques pour leur intégration dans le parcours de l’exposition. C’est un travail qui a permis d’opter pour des bornes d’écoute permettant de découvrir les témoignages audio, de décider des mises à distance, des mises sous vitrine, du choix de la couleur de la section, de la disposition des objets entre eux...
Deux étudiantes ont pris part à l’installation intégrale des œuvres au moment du montage de l’exposition. Pour l’installation plus précisément de la collecte, elles ont été rejointes par ceux qui avaient pu faire le déplacement. Tous ont travaillé ensemble aux côtés de la directrice du Louvre-Lens et de la commissaire de l’exposition.
Cette section de l’exposition montre, en se penchant sur les traces de l’exil, que c’est un vécu toujours actuel. Elle interroge la manière de vivre au quotidien une nouvelle vie, dans un autre territoire. Sa conception partagée rejoint le propos même de l’exposition. Exils, avec un « s », parle de tous les exils dans leur diversité et sous toutes leurs formes qu’ils soient contraints, volontaires ou imaginaires. Elle aborde les multiples motivations qui peuvent pousser à quitter une terre natale. Cette partie traite aussi de diversité, de rencontres, d’écoute et d’échanges. Les récits personnels, comme il en va de tous les exils, se rattachent à une histoire commune. Une dimension historique et universelle se dégage donc de cette section particulière pour rejoindre celle de l’ensemble de l’exposition.
Pauline Mabrut
Merci
Je remercie les étudiants qui ont pris part à ce projet d’avoir accepté de partager leur expérience.
Pour aller plus loin :
- Le Dossier de Presse de l’exposition
https://www.ecoledulouvre.fr/sites/default/files/media/document/Dossier%20de%20presse_Exils_FR_BD%20planche%20%281%29.pdf - Le Dossier Pédagogique
https://www.louvrelens.fr/wp-content/uploads/2024/09/Dossier-pedagogique_Exils_2_page_BD.pdf - Une présentation vidéo,
par la commissaire de l'exposition, Dominique de Font-Réaulx
https://youtu.be/FLAN8vQ9Ex8?si=CptMQuaR00ZfETxc - Une présentation vidéo, par la directrice du Louvre-Lens, Annabelle Ténèze
https://www.bfmtv.com/grand-lille/replay-emissions/bonsoir-lille/exils-une-nouvelle-exposition-temporaire-au-louvre-lens_VN-202409240740.html
AUTRES EXPOSITIONS EN LIEN AVEC LA THÉMATIQUE
- Biennale de Lyon : Les voies des fleuves – Crossing the water
En cours, 21.09.2024 au 05.01.2025
La Biennale d'art contemporain de Lyon, manifestation créée en 1991, a un ancrage local, basé sur le dialogue et l'échange avec les populations.
« Avec La voix des fleuves - Crossing the water, les artistes sont invités à aller à la rencontre des populations et de savoirs-faire qui deviennent autant de sources d’inspiration, d’expérimentation que d’occasions de co-création » (Dossier de Presse)
https://fisheyeimmersive.com/evenement/biennale-de-lyon-les-voix-des-fleuves-crossing-the-water/ - Exposition installation Monte di Pietà
Terminée (du 29 juin au 21 juillet 2024)
Le Festival d'Avignon, fondé en 1947, est une manifestation du spectacle vivant contemporain.
"Fruit d’une collaboration entre Lorraine de Sagazan et Anouk Maugein,l'installation Monte di Pietà met à nu l’injustice, et la douleur qu’elle provoque. La metteuse en scène et la scénographe ont pour l’occasion collecté quelque deux-cents objets : ces objets sont liés au souvenir traumatique de violences ou de crimes, mais leurs propriétaires n’ont pourtant pu se résoudre à les jeter. Étiquetés et consignés, ces objets s’accumulent dans l’espace pour ériger un sanctuaire de chagrin." - Archives du Festival
https://festival-avignon.com/fr/edition-2024/programmation/monte-di-pieta-348720
#LouvreLens #Exils #Collecte

Une année verte pour les musées ?
Dans un contexte où les préoccupations environnementales prennent une place de plus en plus prépondérante, les musées se trouvent confrontés à un défi de taille : comment rester fidèles à leurs vocations tout en s’adaptant aux exigences d’un monde en mutation ? Ces temples de savoir sont désormais interpellés à réinventer leurs propres récits, à écrire une nouvelle page de leur histoire, teintée de vert et d’engagement écologique. Les musées jouent un rôle dans la sensibilisation du public aux enjeux écologiques et dans la promotion de pratiques durables. Cependant, la nature même de leurs activités, souvent énergivores et génératrices de déchets pose un dilemme : comment assurer la préservation des œuvres tout en préservant l’environnement ?
Image libre de droit, Tungart7©
2024, une année charnière dans la transition écologique ?
Depuis quelques années, une attention croissante est portée à la question de l’engagement écologique des musées, et l’année 2024 s’annonce comme une période encore plus intense. Ayant fait des questions de durabilité un axe fort, ICOM France franchit une nouvelle étape pour la décarbonisation du domaine muséal. Cette année, deux nouveaux projets ont été lancés par ICOM France pour accompagner les musées dans la transition écologique les musées en France.
Avec pour thème « Les musées, acteurs de la transition écologique », les dernières rencontres des musées de France, organisées à Paris en décembre 2023, étaient placées sous le signe de la lutte contre le changement climatique. L’un des objectifs fixés par le ministère de la Culture est que d’ici 2025, chaque structure culturelle dispose d’un bilan ou d’un référentiel carbone. C’est dans ce cadre qu’un partenariat entre le Ministère de la Culture et l’ICOM a été conclu pour lancer le projet « Référentiel Carbonne », une initiative ambitieuse réunissant une quinzaine de musées français non-encore soumis à l’obligation légale de procéder à un bilan carbonne de leur structure, répartis sur l’ensemble du territoire français et représentatif de la richesse du réseau. Accompagnés par un cabinet de conseil spécialisé, ces établissements entreprennent le calcul de leur empreinte carbonne et l’élaboration d’un plan de décarbonisation individuel. Les résultats seront analysés afin de concevoir un outil de mesure d’empreinte carbonne réplicable, ainsi qu’une stratégie pour la transition écologique de l’ensemble de la filière muséale. C’est d’ailleurs le travail qu’à commencer à entamer Paris Musées pour l’ensemble de son réseau.
Le projet « Prenons le contrôle du climat », déclinaison française du programme international de Ki Culture « Getting Climate Conctrol Under Control », a pour objectif la révision des normes de conservation ainsi que la réduction de la consommation énergique des musées. Sur une période de 18 mois, les dix musées participants suivent un programme de formation et d’actions adaptées encadrées par des experts en conservation et en gestion climatique. Grâce à ces outils, ces musées collectent et analysent les données nécessaires pour opérer des ajustements sans compromettre la conservation de leurs collections.
En cohérence avec les objectifs du projet « Prenons le contrôle du climat », qui a été sélectionné parmi les 13 lauréats du programme « Alternatives Vertes 2 » du plan d’investissement France 2030, cet appel à projet vise à catalyser la transition écologique des entreprises culturelles. Ce dispositif, doté de 25 millions d’euros et opéré par la Banque des Territoires a pour ambition de favoriser l’émergence d’alternatives vertes innovantes et réplicables, capable de transformer les pratiques culturelles.
Des initiatives vertes et responsables
Ces projets de grande envergure illustrent les champs d’études et d’actions à venir pour cette année 2024. Cependant comment les musées peuvent-ils s’engager en faveur d’une transition écologique ? Est-il possible de conjuguer contraintes budgétaires et vœux écologiques ?
La production d’une exposition et sa scénographie font partie des deux enjeux majeurs d’écoresponsabilité. Des initiatives telles que la Réserve des arts à Pantin, qui soutient le secteur culturel dans l’adoption de pratique de l’économie circulaire, ainsi que la gestion des dons par la Direction Nationale d’Intervention Domaniales (DNID), et des expositions écoconçues comme « Expérience Goya » (octobre 2021 – février 2022), la première exposition que le Palais des Beaux-Arts de Lille a conçu dans une démarche écoresponsable, démontrent l’importance du réemploi des matériaux et des ressources. Il est, par ailleurs, intéressant de noter qu’une exposition écoconçue peut coûter en moyenne 30% moins cher.
Dans cette quête vers une gestion plus verte, d’autres défis se dressent sur le chemin des musées. Maîtriser la consommation énergétique, repenser la mobilité des visiteurs ou encore opter pour des matériaux d’impression plus respectueux de l’environnement ne sont que quelques-uns des défis à relever. Mais la créativité et l’innovation sont au rendez-vous ! Des solutions comme l’éclairage intelligent, les initiatives de covoiturage pour se rendre aux musées, l’édition de livres ou de catalogues ou encore, l’utilisation de papier recyclé et d’encre écologique apportent une touche de fraîcheur dans ce paysage en mutation.
Pour financer ces initiatives, plusieurs aides sont mises à disposition pour inciter les musées à entamer leurs transitions écologiques. Le Fonds Vert, lancé en 2022, finance des projets présentés par les collectivités territoriales et leurs partenaires publics ou privés ; France 2030 et notamment l’appel à projet Alternatives Vertes ; ou encore l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) sont des acteurs qui soutiennent les actions de ces musées. La question de la formation des agents publics aux questions écologiques est primordiale. Les agents des musées de Rouen seront ainsi formés, à l’horizon 2024, par le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale).
Focus sur Paris Musée, « acteur du changement »
Lors de la récente session d'ICOM France, Paris Musée a été mis à l'honneur pour ses efforts en faveur d'expositions plus respectueuses de l'environnement. Depuis sa création en 2013, l'établissement public a adopté une approche proactive en concevant ses expositions temporaires avec une optique de réutilisation. Cette démarche a été renforcée dès 2020, avec une réelle volonté de promouvoir l'économie circulaire. Les expositions sont désormais planifiées en intégrant dès le départ les enjeux du développement durable à toutes les étapes de réflexion et d'innovation. En 2023, un plan d'action ambitieux a été lancé pour réduire l'empreinte environnementale, établir les principes directeurs de la politique de développement durable et positionner Paris Musée en tant que moteur du changement. Au cœur de cette démarche, se trouve l'implication et la sensibilisation du personnel et du public, avec des formations professionnelles internes proposées.
Paris Musées s'active et déploie de nombreuses initiatives pour devenir un véritable "acteur du changement". Des événements plus respectueux de l'environnement, la végétalisation des musées, une politique d'achat plus responsable, ainsi que la mise en place de points d'eau pour éviter l'utilisation de bouteilles en plastique témoignent de l'engagement de l'institution envers la durabilité. La mobilisation du public est également au cœur des préoccupations, avec des initiatives telles que des conférences sur la biodiversité à la maison Balzac, des conférences sur l'écologie et l'art au Musée d'Art moderne, et une programmation culturelle axée sur l'écoresponsabilité au musée Carnavalet.
Julie Bertrand, directrice des expositions et des publications de Paris Musées, a présenté les initiatives écoresponsables de l'institution. Depuis juin 2020, Paris Musées explore activement les questions d'écoresponsabilité, en particulier en ce qui concerne l'écoconception des expositions. En partenariat avec l'entreprise Atemia, l'institution travaille sur un calculateur d'impact carbone qui aidera à piloter les expositions de manière plus écologique, tout en permettant une meilleure gestion budgétaire à long terme. Cet outil analysera l'impact de la production et de la communication des expositions, ainsi que les déplacements du public. Deux outils sont en cours de conception : un calculateur d'impact carbone, basé sur la collecte de données auprès de différents prestataires, et Eco-expo©, un outil d'auto-évaluation qui accompagne les équipes dès la phase de conception des expositions. Paris Musées est également lauréat du projet Alternatives vertes 2 pour la mise en place d'une plateforme de calcul et d'analyse de l'impact des expositions. Cependant, ce processus représente un défi en termes de temps et de charge de travail pour les équipes projet.
Au-delà des murs de Paris Musées, adopter une approche écoresponsable dans le secteur culturel exige un changement radical de perspective. Malgré les défis supplémentaires que cela peut impliquer pour les équipes, intégrer des pratiques durables est essentiel. Promouvoir la durabilité ne signifie pas compromettre la qualité ou l’impact des projets, mais plutôt les améliorer. Dans un monde où les e-mails semblent être le langage universel, choisir des pratiques écoresponsables dès le départ est peut-être le premier geste que nous pouvons tous faire… Après tout, chaque clic de souris compte !
Emma Laverdure
#transisitionecologique #musée #écologie #développementdurable
Pour en savoir plus :
- Communiqué de presse, lauréat de l’appel à projet « Alternatives Vertes 2 » : https://www.culture.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/france-2030-annonce-des-23-laureats-de-deux-dispositifs-de-soutien-aux-transitions-numerique-et-ecologique-de-la-culture
- Le défi de la transition écologique dans les musées de France et les Maisons des Illustres : https://www.culture.gouv.fr/regions/DRAC-Ile-de-France/Actualites/Actualite-a-la-une/Le-defi-de-la-transition-ecologique-dans-les-musees-de-France-et-les-Maisons-des-Illustres
- Le guide d’éco-conception par Universciences : https://www.universcience.fr/fileadmin/fileadmin_Universcience/fichiers/developpement-durable/_documents/guide_eco_conceptFR.pdf

Une statue à la gloire impériale
Dans le cadre des recherches menées pour l'ouvrage “L'Hôtel des Troupes de montagne. Un Hôtel de commandement du Second Empire. 160 ans d’histoire militaire à Grenoble.” ,je me suis rendue aux archives de la ville de Grenoble avec la conservatrice du musée des Troupes de montagnes. La lecture des échanges épistolaires entre la Ville de Grenoble et le Ministère de la Guerre à permis de retracer l’histoire de la statue équestre de Napoléon Ier ainsi que le rôle des militaires lors de l’inauguration de la statue à la gloire impériale. Voici son parcours qui nous permet de savoir comment, malgré son malmenage, elle peut encore, elle aussi faire vivre le mythe Napoléonien de nos jours.

La statue équestre de l’Empereur Napoléon Ier La Rencontre, bronze, dépôt en 1920 du Centre National des Arts plastiques, Ministère de la Culture et de la Communication, département de l’Isère, hiver 2020 © Musée des Troupes de montagne
Connaissez-vous la remarquable statue de l’Empereur Napoléon Ier trônant dans les alpages de l’Isère ?
La statue de Napoléon Ier, qui se dresse aujourd'hui à Laffrey, n’a pas toujours eu comme beau panorama les montagnes de la Matheysine et la vue sur le lac. Plusieurs questions se posent légitimement sur les raisons et sa date d’arrivée en ce lieu, sur ses origines, son auteur et son commanditaire. Dans le cadre de la rédaction de l’ouvrage de l’Hôtel des Troupes de montagne : un Hôtel de commandement du Second Empire, 160 ans d'histoire militaire à Grenoble, la découverte de correspondances dans les Archives municipales nous révèle l’envers du décor de son inauguration. C’est grâce aux échanges de lettres écrites entre les autorités militaires et la Ville de Grenoble que nous pouvons savoir aujourd’hui comment et combien cet événement n'aurait jamais pu avoir lieu sans les moyens de l’Armée. Son incroyable périple a pu ainsi être retracé : du projet de sa commande à son exposition actuelle en passant par la mise en place d’envergure qui fut nécessaire à l’événement de son inauguration.
Les origines de la commande de cette statue prestigieuse
La statue actuelle à Laffrey est l'œuvre du sculpteur Emmanuel Frémiet (1824-1910). Célèbre pour ses sculptures équestres, telle que l’iconique Jeanne d’Arc Place des Pyramides à Paris, il fut l’élève de François Rude. La statue de l’Empereur Napoléon Ier fut commandée sous le Second Empire et réalisée en 1867. Son commanditaire, Napoléon III, neveu du Premier empereur des Français, décida de payer cette statue monumentale avec sa propre cassette personnelle. D’un poids de près de quatre tonnes, en bronze, coulée par le fondeur Charnod, elle fut érigée au centre de la Place de Verdun actuelle, nommée jadis Place d’Armes. Impériale, administrative et prestigieuse, cette nouvelle place n’est pas choisie uniquement pour sa bonne taille (160 m X 140 m), mais surtout pour ce qui est alors, durant le Second Empire, un haut lieu de concentration des pouvoirs. Cette place appelée aussi “Place Napoléon” est bordée au nord par l’Hôtel de commandement des Troupes de montagne actuel, ancien Hôtel de commandement de la 22e division.

Maquette de la statue de Napoléon Ier par Emmanuel Frémiet, cartes postales, ed. Martinotto frères, XIXe siècle, Pd.4.206.1 & Pd.4.206.2 © Bibliothèque Municipale de Grenoble
Une statue au service du souvenir impérial
Cette statue de Frémiet commémore la journée décisive qui permit à Napoléon, en route vers Paris, de reprendre le pouvoir. Elle représente la scène de “la Rencontre” du 7 mars 1815, où Napoléon Ier au retour de l'Île d’Elbe, rencontre les troupes royales chargées de l’arrêter aux abords de Grenoble. La scène fait suite au débarquement de l’Empereur, au Golfe-Juan le 1er mars 1815. Napoléon prit alors la route des Alpes, l’actuelle Route Napoléon afin de gagner Paris. La route est jugée plus favorable que celle empruntée par les royalistes de la vallée du Rhône. Il passe par le plateau Matheysin, le 6 mars par Corps, puis La Mure et se dirige vers Grenoble. Le 7 mars, à l’entrée de Laffrey, sur la plaine, un bataillon du 5e de Ligne envoyé par Louis XVIII l’attend pour l'arrêter. Napoléon Ier s’avance, seul sur sa monture caparaçonnée, au-devant des troupes, dans cette plaine désormais nommée la Prairie de la Rencontre. Il prend alors la parole : “Soldats du 5e de Ligne, je suis votre empereur, reconnaissez-moi !”, s’approche à portée de fusil des soldats indécis, entrouvre sa redingote et dit “S’il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur me voici.” Le 5e de Ligne abaisse les armes. Plus tard Napoléon affirme au général Cambronne “C’est fini. Dans huit jours nous serons à Paris.” Le 20 mars, depuis le Palais des Tuileries, il met en place un Empire doté de deux chambres législatives.

Maquette de la statue de Napoléon Ier par Emmanuel Frémiet, bronze et plâtre, avant 1868, 30x34x13 cm, MG 1204 © Musée de Grenoble
Une inauguration hautement symbolique :
Si le choix du thème de la sculpture est hautement symbolique, le choix de la date de son inauguration ne l’est pas moins. Le Maire de la Ville de Grenoble, Jean-Thomas Vendre, la fait ériger autour de trois jours de festivité. La foule est considérable pour l’admirer le 17 août 1868, soit deux jours après une fête religieuse importante, celle de l’Assomption le 15 août, mais surtout le jour de la fête de Napoléon. La cérémonie d’inauguration de la statue du 17 août marque l’apothéose de trois jours de fête nationale débutée à la mi-août. Les festivités sont officiellement lancées par Monsieur le Président le 10 août à midi précise.
Le rôle des Troupes en garnison à Grenoble :
Un mois avant l’événement, le Maire de Grenoble demande au général de la 22e division de pouvoir loger les étrangers pour le concours musical de l’inauguration de la statue. Pour cela, 280 à 300 tentes d’officier doivent être mises à disposition de l’Autorité municipale. Ces tentes doivent être rendues à Grenoble dans les magasins de l’État le 19 au plus tard, soit à peine deux jours après la fin des festivités. Les bons rapports entre l’Armée et la ville, contribuant aux bonnes conditions du rayonnement des arts à l’international, sont rendus possibles par des engagements précis. En effet, le maire se porte entièrement caution pour toutes les éventuelles dégradations pouvant survenir au matériel auprès de l’administration militaire.
La charge de Corvée de mise en place et de désinstallation revient à 150 à 200 militaires moyennant contribution. Le Maire considère qu’il est “préférable de faire faire ce travail par des militaires ayant fait campagne que par des ouvriers civils qui n’en auraient nullement l’expérience”. À la demande du Maire de Grenoble, ce sont les militaires, sous ordre du colonel de Bouxeuille, directeur de l’École d’artillerie, qui ôtent les arbres de la Place d’Armes gênants selon les indications du jardinier en chef. Quelques jours avant l’événement, la ville met en place des orangers en acceptant la suggestion de verdure du colonel. Elle orne la partie du quai Napoléon sur laquelle doivent se placer les autorités et les invités pour assister au feu d’artifice. Ce ne sont pas moins de 450 places qui sont mises à disposition à cet endroit. Le 12 août, deux jours avant l’événement, le Maire s’assure de faire vérifier l’estrade et sa solidité désirable par l’architecte, il serait désastreux que l’estrade n’ait pas une structure assurée.
De pair avec la sécurité, l'enivrement est pensé : le maire, soucieux de l’éclat de la solennité de l’inauguration, fait distribuer par la ville, aux troupes en garnison à Grenoble, des rations supplémentaires d’un litre de vin. Afin de réserver les provisions pour les festivités, les hommes de corvée et leur maréchal-des-logis, pourront se présenter pour prendre livraison chez le marchand local, à cinq heures du matin, Place des Tilleuls, le 17 août. Ces rations extraordinaires de vin sont prévues en comptant l’effectif de corps d’élite de la gendarmerie. Pour le dîner du 17 août, dressé sur la terrasse, le nombre de couverts est fixé à 210. Le restaurateur de la Ville de Grenoble dispose de cinq jours afin de prendre ses dispositions.

La statue équestre de l’Empereur Napoléon Ier, sur la Place de la Constitution ou Place d’Armes, faisant face à l’Hôtel de la Division, 1868, Pd.4 (613) © Bibliothèque Municipale de Grenoble
Qui est invité ?
Le 12 août, les invitations aux personnes importantes de la ville sont annoncées. Le secrétaire en chef de la Mairie, le receveur municipal, l’architecte, le chef d’octroi, le commandant des pompiers, le receveur de l’hospice, le jardinier en chef, le régisseur de l’usine à gaz, le conservateur du Musée, le conservateur du Muséum, le conservateur de la Bibliothèque, le directeur de l’École professionnelle avec M. l'Aumônier, le directeur du Degré Supérieur, le directeur de l’École chrétienne, le directeur de l’École de sculpture, directeur de l’École de Dessin sont conviés. Les membres du conseil municipal sont invités à la cérémonie solennelle du 15 août. Pour le dîner du 17 août à l’Hôtel de Ville, le Colonel de la 3e de ligne, les membres de la Cour et ses Tribunaux sont conviés. Malheureusement, au grand dam du Maire, le commandant du 13e BCA (bataillon de chasseurs alpins), ne peut assister au banquet offert par la Ville.
Un cortège au rythme des feux d’artifice...
Le feu d’artifice de l’année 1867, avait été reporté par le Ministre de la Guerre. Pour ce tir grandiose du 17 août 1868, la ville de Grenoble concourt à la dépense engendrée. Mais ce sont les plus experts en matière de feu, les artilleurs de la 22e division, qui s’occupent des tirs de canons. Afin de convenir d’un endroit approprié, les autorités avec le colonel de Bouxeuille, directeur de l’École d’artillerie, décident des lieux de départ de tirs appropriés pour que l’événement se passe en toute sécurité. Les reflets dans l’eau de l’Isère des tirs depuis le pont suspendu et le pont de pierre, nouveau à l'époque, sont parfaitement spectaculaires. Mais, ces deux endroits ne suffisent pas. On installe d’autres pièces de canon sur les quais de l'Île Verte pour encore plus de tirs ! L’Île Verte, particulièrement illuminée par un entrepreneur spécifique pour l’occasion, nécessitera même 50 hommes de corvée, en plus des ouvriers pour la manutention. L’éclat de cette cérémonie est assuré par un déroulé bien réglé autour des tirs de canons. Ainsi, il est prévu que les troupes de garnison doivent passer dès onze heures et demie du matin sur la Place d’Armes avec les sapeurs-pompiers de la ville et ceux des communes voisines, qui se rendent à Grenoble, à cette occasion.
Après les discours officiels, ces troupes opèrent un défilé au-devant de l’estrade occupée par les autorités, c’est-à-dire entre cette estrade et la statue. La cérémonie est annoncée, en grande pompe, par une salve de 101 coups de canon tirés du Fort de la Bastille et les principales portes de la ville. Le soir, un feu d’artifice est tiré sur le pont suspendu par les soins de l’École d’artillerie avec le concours de la ville. Ce feu est tiré à huit heures et demie précises. Il faut deux divisions afin de prendre position avec le matériel ! L’une encadre la rue de Lionne, l’autre se positionne sur la Place de la Simaise. De nouvelles salves sont tirées sur le quai de l’Île verte. Dans les intervalles du feu d’artifice, un détachement de 300 hommes est disséminé sur les hauteurs du fort. Et comme rien n’est assez grandiose à la gloire de l’Empereur, ses hommes simulent une petite guerre et tirent des fusées à étoile de couleur !
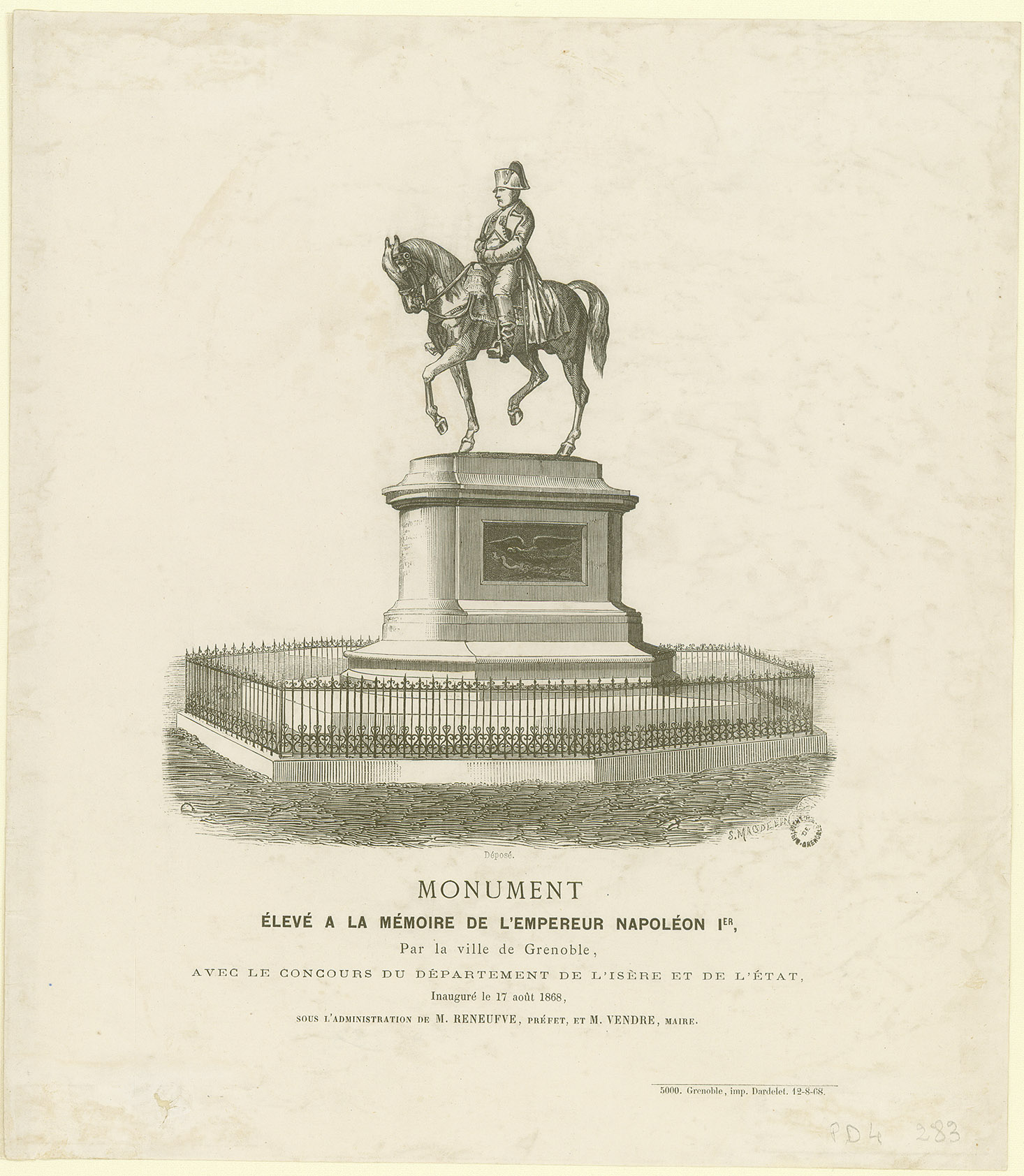
Monument élevé à la mémoire de l'empereur Napoléon Ier, 1868, Pd.4 (283) © Bibliothèque Municipale de Grenoble
et, surtout, de la musique !
La musique a un rôle central dans l'événement. Qu’elle soit, militaire, religieuse ou artistique, sa diversité donne le ton à chaque moment de la cérémonie. Le 15 août, à dix heures trois quart, le corps de sapeurs-pompiers forme une haie d’honneur, adossé au péristyle de l’Hôtel de ville, à droite sur la Place Saint-André. Pendant ce temps, Messieurs les Officiers, non pourvu de commandement, se rendent au salon de réception. À dix heures et demie le corps municipal et ces fonctionnaires prennent place en rangs et se dirigent vers l'Hôtel de la préfecture pour y prendre monsieur le Préfet et les autres fonctionnaires municipaux. Le cortège se rend ensuite à l’Hôtel de la Division, le lieu de pouvoir, des militaires par excellence. Puis, les militaires continuent de donner la marche à suivre au cortège en musique.
À quatre heures du soir, le corps de sapeurs-pompiers forme une haie sur le passage du cortège tout en accompagnant en musique les membres du jury du concours musical jusqu’à la Place Grenette. Le 11 août, le Maire de Grenoble demande à ce que les cours des casernes soient disposées pour les différents concours d’instrumentaux. Pour cela des escaliers sont disposés sur la place. Une médaille est même prévue pour le concours musical, les arts sont reconnus. À cet effet, le Commandant du 13e BCA donne au maire 100 francs pour l’achat de celle-ci. L’exécution de la cantate est assurée par le 47e régiment d’infanterie de Chambéry. Elle est réunie à celle de la musique du 3e de ligne, et à des éléments de localités. Autant de voix et sons martiaux magnifiant l’évènement nécessitent des moyens à la bonne mesure du profit de tous les spectateurs.
Les militaires musiciens sont donc aux bons soins de la ville pour se loger, se nourrir et être indemnisés. Leur transport fait même l’objet d’une demande, le 25 juillet, de gracieuseté à titre de service public spécial selon les appuis favorables et puissants du colonel de la 47e ligne et du général de la 22e division, Adolphe de Monet. La bonté du Ministre de la Guerre accorde cette faveur. Le 12 août, moins d’un mois après la demande, le Lieutenant chef de musique de la 47e de ligne reçoit de la ville, un billet de la banque de 200 francs pour les frais de voyage allers et retours avec une réduction de 40 pourcents pour les militaires qu’il dirige.
La musique militaire est omniprésente durant toutes les festivités. Les membres de la musique du corps de sapeurs-pompiers rejoignent la scène et la musique du 3e régiment de ligne, pour faire entendre alternativement son morceau d’harmonie sur la terrasse du jardin de ville pendant le banquet donné par la ville le 17 août à cinq heures trente du soir. À sept heures trente, le banquet opulent continue au rythme de la musique du 3e de ligne. L’auteur de la musique d’une cantate s’adresse même directement au chef de musique du régiment de la 47e ligne de Chambéry pour l’orchestration de son œuvre, c’est dire la confiance que l’artiste porte aux militaires. Le festival de musique est présidé par le grand compositeur Hector Berlioz. Apprécié pour ses qualités de chef d’orchestre, il est invité par le Maire de Grenoble Jean-Thomas Vendre. L’artiste effectue son dernier voyage à Grenoble, ville de résidence de sa famille, avant son décès six mois plus tard.
Un piquet de quinze hommes est détaché un quart d’heure d’avance pour faire le service religieux à la cathédrale. Le samedi 15 août, à onze heures et demie très précise du matin, à l'issue de l’Office donnée, un hymne latin chrétien, Te Deum, solennel est chanté à l’occasion de la fête de l’Empereur. Afin de bien vouloir assister à la cérémonie, le corps municipal est prié, trois jours avant l’événement, de se réunir à l’Hôtel de ville à dix heures et demie pour se rendre à l’Hôtel de la Préfecture, Place d’Armes. À l'issue du service religieux, le corps municipal est conduit à l‘Hôtel de ville, toujours musique en tête. Immédiatement après le corps de sapeurs-pompiers se rend sur la Place d’Armes où il est passé en revue avec la Troupe de la garnison par M. le général Comte de Monet, commandant de la division Militaire et premier occupant de l’Hôtel de Commandement.
La foule venue acclamer l’Empereur est ravie. Les plus pauvres ne sont pas oubliés : l’administrateur de la Ville leur affecte la somme de 3500 francs conformément à la délibération du Conseil municipal.
Le devenir de la sculpture après l’inauguration de 1868
Pour compléter la sécurité, cette fois en termes d’équipement urbain durable, la confection d’une grille est demandée pour entourer le monument. Dès le 10 juillet, elle est commandée au même architecte choisi pour ce projet de statue. Il avait lui-même choisi les candélabres des socles de pierres posés devant l’entrée principale du monument. Le 20 août, les dernières pierres prennent place, prêtes à recevoir la grille. Elle permet de remplacer la clôture provisoire en planches. Elle est mise en place juste après l’inauguration et une fois le nivellement de la place effectué. Ce dernier exigea dix à douze jours de travail !
Deux ans plus tard, le monument aux grands hommes fut tristement retiré et mutilé lors de la chute du second Empire en 1870, le 4 septembre précisément. Par chance, il est soigneusement conservé dans les réserves du Musée-Bibliothèque. La sculpture, accompagnée de deux bas-reliefs de François Gilbert, fut restaurée à Paris. Depuis 1929, elle a été recontextualisée sur le lieu de passage historique, de Napoléon Ier, nommé “la route napoléonienne" à Laffrey au bord du lac. Elle est installée selon le dessein de l’architecte Louis Fléchère au moment où la Troisième République se réconcilie avec Napoléon Bonaparte incarnant la grandeur de la France pendant et après la Révolution française. Depuis, Napoléon et son cheval surplombent le paysage de la route Napoléonienne en ce lieu fort de sens.

La statue équestre de l’Empereur Napoléon Ier La Rencontre, bronze, dépôt en 1920 du Centre National des Arts plastiques, Ministère de la Culture et de la Communication, département de l’Isère, hiver 2020, hiver 2020 © Musée des Troupes de montagne
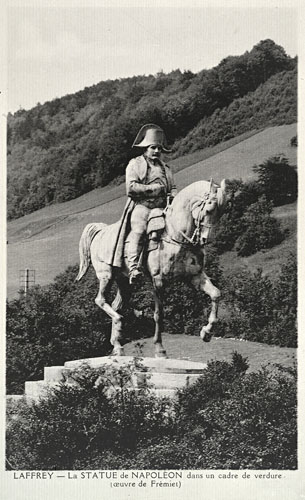
Laffrey - la statue de Napoléon dans un cadre de verdure © Musée d’Orsay, Fonds Devuisson
Charlène Paris
#brève d’apprentissage #sculpture #patrimoine #conservation #gestioncollection #CNAP #histoire-mémoire #patrimoine-société
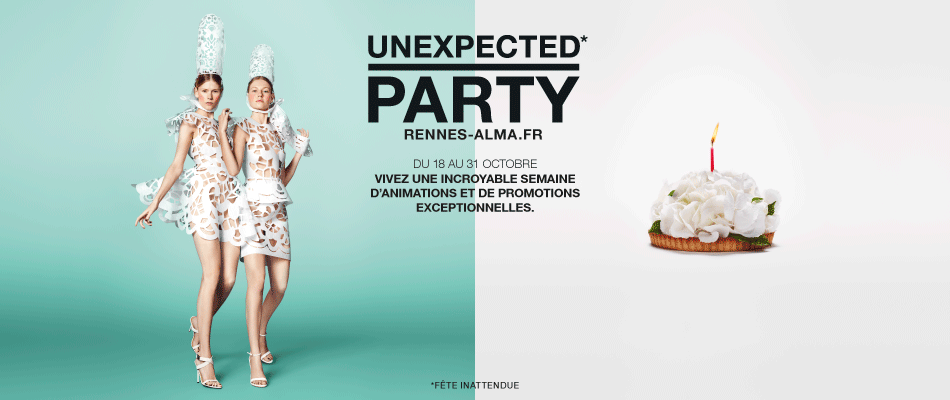
Une visite muséographique décoiffante
Cet été, j’ai eu l’occasion de mêler médiation des collections et présentation du travail de muséographe lors d’une visite guidée. Comment aider les publics à porter un œil critique sur les objets de musée et les manières dont l’institution les présente ?
Le musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc a mis en place pour l’été 2020 un programme de visites consistant à présenter un objet des collections du musée exposé dans les galeries permanentes et à faire suivre cette présentation d’une discussion pour ouvrir le débat avec les visiteur.se.s présent.e.s. L’angle d’approche est libre et se fait selon la sensibilité de l’intervenant.e qui anime la visite. Cet.te intervenant.e peut faire partie du personnel du musée, ou non, et a le champ libre pour aborder les collections à sa manière : une restauratrice du patrimoine a proposé une analyse matérielle d’un coffre de mariés tandis qu’un archéologue a organisé une visite gustative autour d’une bouteille en verre de la section archéologie sous-marine.
Intervenante d’un jour, j’ai choisi de présenter un objet exposé dans un parcours intitulé « clichés bretons ? » qui revient sur la création et l’évolution de l’image de la Bretagne et des Côtes d’Armor au fil du temps. Cet objet n’est pas au sens propre un objet de musée : il n’est pas inventorié dans les collections, n’a pas fait l’objet d’une commission d’acquisition, n’est pas protégé au titre des collections des musées de France. Il s’agit d’une affiche publicitaire. Elle a été collectée spécifiquement pour ce parcours de visite et pourra être conservée ou non par le musée au moment où ce parcours de visite sera remanié ou retiré.
La galerie « clichés bretons ? »
Un musée d’art et d’histoire n’est pas un musée des beaux-arts ; le musée de Saint-Brieuc peut ouvrir des questionnements d’autre nature que l’esthétique ou l’histoire de l’art car il se positionne comme musée de société. La galerie « clichés bretons ? » a vocation à soulever la question de l’iconographie actuelle qui entoure la Bretagne, en la replaçant dans un contexte historique et en permettant d’en identifier les acteurs et leurs intentions. À ce titre, l’affiche publicitaire que j’ai sélectionnée pour la visite a une valeur ethnographique. Elle nous parle de la société d’aujourd’hui, pour peu qu’on soit prêt.e à la percevoir comme un témoignage, une trace produite par des acteurs donnés à un moment donné, avec des intentions précises. Et c’est aux muséographes, concepteurs de l’exposition, que revient la tâche de rendre cette trace lisible et compréhensible comme telle par des visiteurs. Après tout, pourquoi approcherait-on cette publicité comme une preuve que la coiffe bigoudène a pris toute la place dans l’imaginaire de la Bretagne, plutôt que comme une œuvre photographique esthétique mettant en scène des jeunes femmes séduisantes ? Le visiteur, si tant est qu’il suive les intentions des concepteurs qui ont pensé le parcours et que le parcours produise sur lui l’effet escompté, est amené à voir l’image dans ces deux dimensions en même temps, à avoir lui-même une approche sémiologique. Mais est-ce toujours le cas ?
Une image au croisement des normes de beauté et du folklore breton
Lors de ma visite, j’ai présenté l’objet en déclinant la date et les conditions de sa création (le premier anniversaire du centre commercial Alma à Rennes), pour commencer par une mise en contexte factuelle. J’ai ensuite évoqué tout de suite le fait que cette image relève du marketing, puisqu’elle a pour rôle d’être attractive pour faire venir des consommateur.ice.s au centre commercial : il s’agissait de situer les intentions qui ont présidé sa production. Puis j’ai proposé une description de la publicité : les personnages photographiés sont deux jeunes femmes à l’image retouchée typiques des iconographies publicitaires, à ceci près qu’elles portent une coiffe bigoudène et une robe taillée dans la même dentelle que les coiffes. Peuvent ensuite naître des interrogations : pourquoi cette coiffe-ci ? Pourquoi les robes et les coiffes sont-elles faites de la même matière et sont-elles ainsi assimilées ? La dentelle des robes (même s’il s’agit en fait de robe en papier) renvoie-t-elle à l’imaginaire de la lingerie, ou des coiffes traditionnelles ? Pourquoi trouvons-nous cette image séduisante ? Mon interprétation : les normes de beauté féminine de notre époque croisent ici une mise en scène d’un folklore régional qui symbolise à lui seul toute la Bretagne, le centre commercial exploitant le folklore à seule fin de se singulariser dans le paysage marketing.
Toutes ces questions relèvent de l’analyse des images, de la sémiologie. Il s’agit de percevoir la composition, les couleurs, les figures de style en somme, d’une image, et d’en tirer des informations sur ce qu’un centre commercial du XXIe siècle fait au folklore breton et à l’image des femmes en produisant cette publicité.
Le travail muséographique : orienter l’analyse des visiteurs
Mais pour aborder cet objet sous un angle muséographique, il ne suffit pas de produire un discours critique sur l’image. Il faut mettre en lumière de quelle manière cette publicité est positionnée dans un musée pour véhiculer du sens. Cette image n’est pas isolée, elle est incluse dans une vitrine, elle-même incluse dans une galerie qui regroupe des vitrines thématiques.

La vitrine « Iconographie contemporaine »
dans laquelle est incluse la publicité du centre Alma (invisible sur cette photo car affichée plus haut sur le mur), photographie : Dominique Morin
Le rôle des concepteurs d’exposition est de faire en sorte que l’organisation des espaces muséographiques les uns par rapport aux autres, leur contenu, leur disposition, leur taille, leur organisation interne, tout cela fasse sens de manière à ce que les visiteurs puissent percevoir les objets de la manière dont on a voulu les mettre en place. Peut-on aujourd’hui, au musée de Saint-Brieuc, voir l’affiche publicitaire du centre Alma comme une production qui joue sur une iconographie stéréotypée et limitée de la Bretagne ?
Passé le temps de l’analyse de l’image, j’ai donc mis l’accent sur la manière de la présenter dans un contexte spécifique : une vitrine intitulée « iconographie contemporaine » qui fait face à celle qui regroupe des coiffes traditionnelles briochines et s’intitule « coiffes d’hier, musées d’aujourd’hui ? ». Cette vitrine-ci montre des coiffes locales, a contrario de la coiffe bigoudène (dans le Finistère) présente systématiquement dans l’imagerie bretonne : la muséographie est pensée pour que les visiteur.se.s s’interrogent alors sur l’usage récurrent de la coiffe bigoudène pour symboliser la Bretagne toute entière, au détriment de la diversité réelle des costumes.

La vitrine « coiffes d’hier, musées d’aujourd’hui ? », photographie : Dominique Morin
Il faut noter aussi que ces deux vitrines se situent à la fin du parcours « clichés bretons ? » et que le visiteur a présent à l’esprit aussi les sections précédentes : la Bretagne rurale, la Bretagne touristique, la Bretagne habitée. Toutes ces sections montrent des ensembles iconographiques contextualisés : la ruralité bretonne fantasmée par les peintres d’ailleurs depuis le 18e siècle, les revues, affiches et cartes postales qui encouragent le tourisme, ou encore la production des portraitistes locaux qui ont photographié la société de Saint-Brieuc dans la première moitié du 20e siècle. C’est en ayant déjà vu tout cela que les visiteur.se.s abordent les dernières vitrines, comme j’ai pu leur rappeler.
En reprenant les thématiques abordées dans le parcours de visite, j’ai souhaité attirer l’attention sur la manière dont le propos est construit et véhiculé par les objets, peintures, photographies et textes qui composent l’exposition. De cette manière, il ne s’agit pas d’éveiller un regard critique sur l’iconographie seulement, mais aussi sur la muséographie elle-même : le discours tenu par un musée n’est qu’un discours parmi d’autres, lui-même situé dans le temps et produit par des acteurs, et qui s’appuie sur des dispositifs que l’on peut apprendre à décrypter.
Marie Hubert
#muséographie
#coiffesbretonnes
#SaintBrieuc

Valoriser les artisans dans le milieu muséal
Celles et ceux exerçant des métiers artisanaux portent sur eux le poids de représentations négatives parfois lourdes. La vision binaire des professions dites intellectuelles et manuelles semble toujours bien ancrée en France. La séparation de la pensée et du faire est le résultat d’une longue histoire et du croisement de pensées occidentales passées. Des individus en payent aujourd’hui le prix fort, celui de la croyance que l’artisan exerce un métier purement empirique, et qu’il ne fait pas usage de sa réflexion et de son intelligence.

Édition originale de l’Encyclopédie, 1753, Planches tome III, Pl. I., Coutelier © 2016 Mazarinum - Les collections numériques
de la Bibliothèque Mazarine
Le rôle des musées sur la représentation des métiers artisanaux
Les métiers d’artisans : tous assez beaux pour être exposés ?


« Balenciaga, l’œuvre au noir » à l’atelier-musée Bourdelle, 2017 © CD

« Archéologie d’une ville romaine, Ratatium » au Chronographe à Nantes, 2020 © CD

Musée du 11 Conti à la Monnaie de Paris, 2018 © CD

Ateliers de fabrication de la monnaie visible depuis l’exposition du Musée du 11 Conti à la Monnaie de Paris, 2018 © CD
Le Musée des Maîtres et Artisans du Québec

Exposition permanente du Musée des maîtres et artisans du Québec (MMAQ) © BY-SA 3.0
Des expositions sur l’intelligence des métiers manuels, est-ce que ça existe ?

« Des mains pour penser », Musée des arts et métiers traditionnels, Salles-la-Source 2017 © Photothèque Conseil départemental de l’Aveyron
Pour aller plus loin :
« Tempêtes sur les représentations du travail », Laurence Decréau, 2018
« Une pédagogie par l’objet », Histoire du Cnam : https://www.arts-et-metiers.net/musee/une-pedagogie-par-lobjet

Venez prendre l'air au musée...Entretien avec le service conservation du Musée de Nancray
« Enraciner davantage à la terre nos frères paysans, leur donner raisons des grandeurs et leurs métiers1 »
Et pour y parvenir, le moyen était un musée de type musée de Plein Air, c'est-à-dire « un ensemble de bâtiments, généralement des maisons de paysans ou d'artisans, démontés et reconstruits dans un parc, qu'on peut aisément visiter ensemble sans pour cela faire le tour d'une province 2 ».
Sandrine Guillaume travaille au service conservation du Musée de Plein air de Nancray, son métier ? « C’est les mêmes missions que dans un musée : on entretient, inventorie, on effectue des veilles sanitaires, on étudie, et on renseigne les bases de données, c’est à une échelle un peu démesurée, on parle de fourchette mais aussi de maisons et bâtiments annexes ».3
Mais qu’est-ce qu’un musée de plein air ?
Pour Georges Henri Rivière :
« Les musées de plein air sont des musées de maisons extraites de leur milieu et transférées dans des enceintes exploitées muséographiquement »
Face aux demeures en péril, deux options prévalent : la sauvegarde in situ, préférée par le service des monuments historiques et la Fondation du patrimoine, ou le sauvetage des constructions menacées de disparition par le démontage et remontage sur un même site, c’est l’option des musées de plein air de Nancray.
Au Musée des Maisons comtoises : en voulant rassembler sur un site vierge tous les types de l’habitat comtois, les fondateurs du musée ont fixé là un objectif redoutable. La diversité des types est vaste, les matériaux mis en œuvre dans les maisons sont le plus souvent lourds ; les unités écologiques et ethnologiques sont bien séparées.
Au regard de la définition du musée de société donnée par la FEMS, on s’aperçoit que le musée, s’il valorise bien le patrimoine de la région, a aussi une mission dans la participation à la vie active (réflexion, débats, expérimentations) et dans les liens avec la recherche.
Les collections :
L’originalité de musées de ce type tient dans la nature des collections à la fois mobilière et immobilière puisque les maisons (des XVII, XVIII et XIX e siècles) sont des pièces de collections à part entière et auxquelles il faut ajouter les collections accessoires de végétaux et d’animaux.
Comme la plupart des musées de plein air, le musée de Nancray a opté pour le principe du démontage intégral d’une maison et de son remontage sur le site en respectant scrupuleusement leurs techniques de constructions, ne remplaçant que les pièces défectueuses.

© C CARON
Le musée possède environ 20 000 objets dont la moitié sont inventoriés. Seuls 15 % sont exposés.
Depuis la création du musée en 1983, les acquisitions se sont toujours faites par donations spontanées au Musée. Aujourd’hui faute de place, la politique d’acquisition est suspendue. Seuls les dons de petits objets sont étudiés. L’autre élément d’explication est que le projet scientifique est culturel n’a pas donné de prospective d’enrichissement des collections. Toutefois le service ressent la nécessité d’acquérir des objets postérieurs à 1950.
Camille : Pourquoi ce musée est-il particulier ?
Sandrine : « Il y a quelque chose de particulier, ce musée c’est chez moi, il y a les objets de chez moi, les maisons, le fonctionnement des pièces, les odeurs… c’est toute mon enfance (originaire de franc-comtois et plus précisément du Haut Doubs) : Tout y est concentré ! »
Pouvez-vous expliquer le démontage, remontage d’une maison ?
Le remontage, c’est un puzzle géant, un mécano, toutes les pièces sont numérotées. Après les difficultés du remontage dépendent de la maison. A l’époque l’abbé Garneret4 était notamment aidé par des régiments militaires, aujourd’hui le musée fait appel à des association de chantier de réinsertion entre autres. Chaque procédure dure entre deux et quatre ans.
L’ancienne conservatrice a défini des micro régions, le musée ne devait pas être un village. C’est une ballade en Franche Comté, comme le souhaitait l'Abbé Garneret. On a reconstitué les paysages des régions. Aujourd’hui on écarte pas mal de dons car on possède un édifice qui caractérise toutes les microrégions. Il nous manque la maison vigneronne et une fontaine lavoir. 5
Il faut que l’on s’attache à réfléchir à l’enrichissement des collections (qui s’arrête à 1950), il faudrait que l’on collecte du contemporain comme un poste de douane.

© C CARON
Comment réalise-t-on une veille sanitaire d’une maison de collection ? Comment valoriser, protéger une maison de collection ?
Il y a deux temps (ouvert 7 mois)
Veille hivernale :
On se rend dans les maisons tous les quinze jours, on fait le tour.
On regarde, on observe, comme un petit objet, les fissures, les moisissures...
« La maison de collection, je la traite de la même manière qu’une fourchette. Cela demande évidemment plus de travaux de réparation, de valorisation. »
- Le niveau d’ensablement : Faut-il décaisser la maison à cause du piétinement.
- Les pierres ont-elles bougé ?
- La lambrichure
- La charpente
- Les champignons
- Les fuites de toit : On regarde beaucoup le toit, car c’est un point noir dû à l’âge des maisons, et que celle-ci sont non habitées (elles se dégradent plus facilement). C’est notre préoccupation en hiver !
- Les volets dégondés
- Les serrures
- Les vitres cassées
- Les arbres et l’environnement proche.
Puis, on établit une liste de priorités qui sera arbitrée au moment du budget.
En saison la veille est sur les objets, la plupart reste dans les maisons, accessible au public. Cette veille est hebdomadaire.
Comment se réalisent les restaurations ? Comment cela se décide-t-il ?
« Le site a trente-cinq édifices. Ça dépend des travaux. On est sur un budget d’investissement donc on peut se permettre un peu plus de latitude.
C’est aussi compliqué, on peut faire des réparations courantes mais sur certaines maisons, nous n’avons pas le Savoir -faire, il faut contacter des spécialités qui ont des agendas à trois ans. Il donc important d’anticiper. Tout ça demande du temps, de l’argent. Le temps que nous mettions cela en place la procédure, la maison continue de se dégrader. On ne peut pas mettre les éléments en quarantaine comme un tableau. C’est cet aspect qui est vraiment différent. On est à l’extérieur, on ne peut pas lutter contre les éléments. Quelle précaution prendre selon les restaurations, les dégâts ? »
Les maisons, qui sont des objets de collections ont été démontées, remontées soit en respectant les matériaux d’origines ou les techniques et savoir-faire d’origine, mais comment faites-vous pour conserver ce patrimoine (pertes des savoir-faire, indisponibilité des matériaux) ?
C’est tout le débat, lors du remontage fin des années 70, début des années 80, choix architecturaux pris. Aujourd’hui, on ferait plus. On réfléchit aux matériaux ou aux techniques
Si les artisans disparaissent demain, les services techniques peuvent compenser mais ce n’est pas leur corps de métier. Effectivement dans les années à venir cela va être compliqué.
Cette problématique est souvent évoquée à la FEMS car les musées de plein air ont des petits budgets. Et cela rejoint la question primordiale : C’est quoi un musée de plein air ? Vis-à-vis d’un édifice même si tu reconstruis à l’identique, avec les techniques, tu crées des problèmes structurels qui prend des portions importantes au fil du temps.

© C CARON
Et dans Trente ans… ?
« Bonne question ! Je ne sais pas
- On peut envisager plusieurs solutions : la construction de nouveaux bâtiments, qui seront les lieux d’expositions
- On peut vider les maisons et les faires visiter comme œuvre à part entière
- On peut imaginer regrouper collections dans des lieux moins dégradés.
Nous n’avons pas fini dans le mouvement d’œuvres. Il est difficile de se projeter à trente ans ».
Camille Caron
#museepleinair
#nancray
1L’abbé Jean GARNERET
2Extrait du programme scientifique et culturel rédigée par Marie SPINELLI FLESCH
3Quelle est la mission du service de conservation d’un musée de plein air ?
4L’aventure de L’abbé Garneret : https://www.maisons-comtoises.org/fr/musee-nancray-grand-besancon/historique
5Cependant, si l’édifice est pertinent, on revient pour une deuxième visite avec un architecte, le CAUE et des spécialistes. Si l’action peut être faite, on enclenche un long processus d’études (de faisabilité, élaboration de budget, enquête auprès des habitants, découverte de l’architecture (est-ce, une architecture qui a rayonné sur les villages ? ), de l’environnement paysagers des édifices. On essaie de recréer les conditions. On réalise plusieurs inventaires pour retrouver les objets correspondants et on se pose la question de la muséographie. A quelle époque doit-on muséographier la maison ?
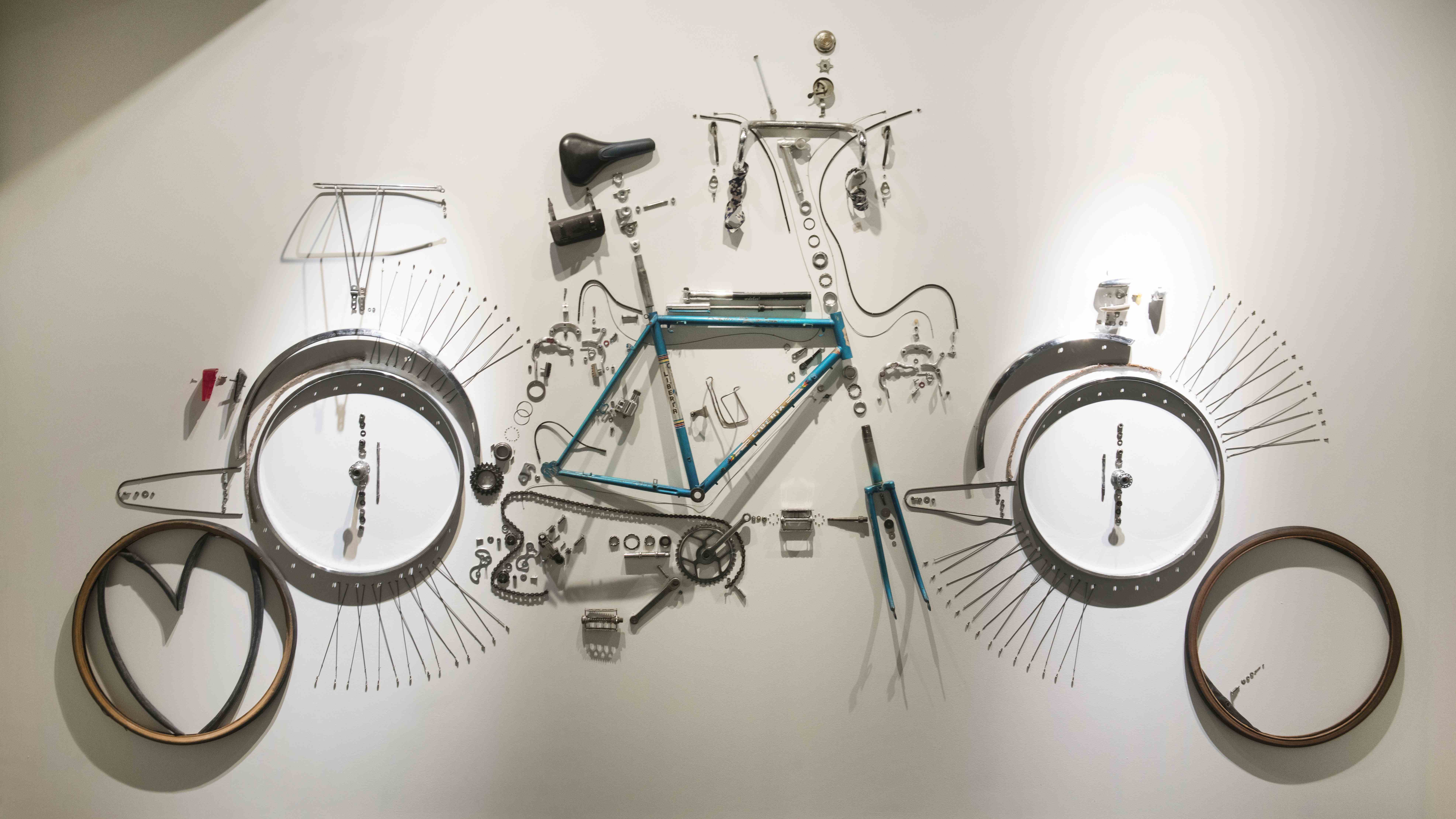
Vers la vélorution et au-delà : les pratiques cyclistes en question au Musée dauphinois
De la mécanique au voyage poétique : un parcours en huit étapes
Vue de la première salle de l’exposition. A gauche, l’installation « Les mille et une pièces d’un vélo », réalisée par l’association La Clavette Grenobloise et le Musée dauphinois (2020) et la photographie de Pierre Duvert, « Le p’tit vélo dans la tête, atelier de réparation de vélos participatif et solidaire » (2019) © Denis Vinçon

Gianluca Gimini, Six diptyques issus du projet Velocipedia (2009) © Denis Vinçon
La deuxième étape de l’exposition – intitulée Vélo, je t’aime, moi non plus – s’intéresse ainsi au vélo comme objet d’affection. On s’approprie son vélo en le rendant unique par sa décoration : certain·e·s le peignent ou lui ajoutent des paniers sur mesure, comme le font les protagonistes des clichés de Pierre Duvert, photographe enquêtant sur les usages contemporains du vélo dans les territoires urbains et ruraux de l’Isère. D’autres vont plus loin et transforment leurs vélos en simili-Harley Davidson, comme Doc et sa « Kustom » rouge, si ressemblante qu’on se demanderait presque ce que fait une moto dans une exposition sur le vélo ! Rempart contre le drame du vélo volé, le cadenas matérialise littéralement l’attachement que porte le cycliste à sa monture : un vélo posé contre le mur en est bardé. En regard, deux carcasses de vélo rouillées trouvées dans l’Isère témoignent, telles deux « vanités vélocipédiques », de la fin tragique des montures abandonnées.


Chopper de Jacques, Tall bike de Morgan, Vélo-virgule de Lucas Aulagnier (vue de gauche) ; Kustom rouge de Doc, 2019 (vue de droite) © Denis Vinçon
La troisième section – Petites roues pour culottes courtes – s’intéresse au rôle que joue le vélo au cours de l’enfance : tenir l’équilibre sur son vélo, sans les petites roulettes, constitue un véritable rite de passage dans la vie d’un·e enfant. Un petit bicycle en bois de la fin du XIXe siècle de la fin du XIXe siècle, dit « michaudine », illustre cette étape. L’inévitable chute est évoquée, avec beaucoup d’humour, par un flacon d’éosine contenu dans une armoire à pharmacie musicale. La photographie de famille a toute sa place dans cette section, avec à la fois des clichés du début XXe siècle montrant que le vélo était à l’époque un marqueur social fort, et des images plus récentes collectées par le musée à l’occasion de l’exposition. Chaque cliché est accompagné d’une anecdote, témoignant de la dimension mémorielle forte dont sont porteuses ces photos-souvenirs de moments partagés à bicyclette.
Familles de cyclistes : espace dédié à la valorisation de la collecte menée par le Musée dauphinois autour des souvenirs liés à la pratique cycliste © Denis Vinçon
La question du genre, qui apparaît dès la naissance de la bicyclette, est évoquée dans la quatrième séquence, nommée Le Surmâle en référence à Alfred Jarry, écrivain mais aussi cycliste notoire. Le graphisme du texte de salle, comme la photo « Rocco et ses frères » de Fabienne Radi, évoque le lien entre vélo et virilité par de facétieuses formes phalliques. Conséquence des discours hygiénistes nés dans les années 1870, l’opposition genrée entre le « vélo viril » et la simple bicyclette réservée aux femmes est matérialisée par un modèle dit « masculin » – à la barre horizontale – et un autre « féminin » – au cadre ouvert –, présentés côte à côte. L’accent est mis sur le rôle du vélo comme outil d’émancipation pour les femmes, tant revendiqué par les pionnières du cyclisme fin XIXe siècle que par les participantes des actuelles vélorutions féministes. Le tandem central conclut cette section, invitant à une réconciliation des deux genres autour d’une monture partagée.
Graphisme en forme de « roues-bignolles », évocation imagée du fameux « vélo viril » ; « Rocco et ses frères » de Fabienne Radi ; modèles de vélos dits « féminin » et « masculin » © Denis Vinçon
Les champion·ne·s s cyclistes, « forçats de la route », font l’objet de la cinquième étape du parcours : celle-ci aborde le dépassement de soi, mais plutôt que de faire l’apologie des champion·ne·s, elle s’attache à questionner l’aura mystique qui entoure ces sportif·ve·s iconiques dans l’imaginaire collectif. Pour matérialiser cette vénération, un podium central met en avant ces cyclistes légendaires – dont Jeannie Longo est la seule femme – et certaines de leurs reliques, comme une réplique du premier maillot jaune du Tour de France. Franck Philippeaux mentionne l’un des projets qui avaient été proposés pour cet espace : l’intention était de créer dans cet espace une « chapelle » matérialisant l’adoration vouée aux grand·e·s coureur·reuse·s cyclistes, en accentuant sa dimension mystique par l’éclairage et la scénographie. Finalement, seul le podium aura été conservé. La thématique du dopage, « fruit défendu » du cyclisme, est évoquée sous le titre bien trouvé « Héros in, héros out ». La place du Tour de France dans la culture populaire est illustrée par la présence de caricatures, de planches de bandes dessinées et d’une roue musicale qu’il faut faire tourner pour tomber aléatoirement sur une ritournelle inspirée des idoles de la petite reine. Encore une fois, l’art n’est pas en reste, avec la création de la vidéaste contemporaine Isabelle Rozenbaum ou encore la machine à faire des courses de vélo d’Itzel Palomo : dans ce dispositif ludico-artistique, les vélos restent fixes mais deux petites figurines permettent à un duo de visiteur·euse·s de comparer leur coup de pédale à celui des champion·ne·s.


Podium des champions cyclistes (vue de gauche) © Denis Vinçon ; La course, œuvre ludico-artistique d’Itzel Palomo (vue de droite) © Marion Roy
Une fois les cyclistes exceptionnel·le·s présenté·e·s, c’est aux cyclistes urbain·e·s, figure plus anonyme et quotidienne, que s’intéresse la sixième section nommée A pied, à vélo, en auto, une ville pour tous. S’y entrecroisent politiques d’aménagement urbain, motivations utilitaires pour les « vélotaffeur·euse·s » et convictions politico-écologistes portées par les « vélosophes » défenseur·euse·s d’un modèle de société favorisant les déplacements alternatifs à la voiture individuelle. La série de photographies artistico-documentaires de Pierre Duvert s’intéresse aux usages contemporains du cyclisme urbain en Isère, et notamment aux ateliers de réparation de vélo participatifs et solidaires, lieux d’échange accompagnant les cyclistes vers la « vélonomie », qui fleurissent à Grenoble. Le « code du cycliste » et autres campagnes de sensibilisation incitent à une réflexion sur les bonnes pratiques vélocipédiques dans des villes où la voiture est encore reine.
La septième séquence, Alpes cyclables, revient sur les pratiques sportives en s’ancrant dans le territoire montagnard. Cette étape fait état de la diversité des sports cyclistes, comme le VTT ou le vélo de randonnée. Le cyclotourisme est notamment présenté comme une alternative au modèle économique aujourd’hui fragile des sports d’hiver et fait le pari de redynamiser le tourisme en montagne dans des stations mythiques comme Les 2 Alpes ou L’Alpe-d’Huez. Une partie des collections exposées, dont la tenue fluo du champion VTTiste Jacques Devi, a été prêtée par l’association grenobloise Génération Mountain Bike, porteuse d’un projet de musée autour de leur collection naissante.

Tenue du champion VTTiste Jacques Devi (vue de gauche) © Denis Vinçon
La huitième et dernière section, consacrée au voyage à vélo – « Partir un jour sans retour » – conclue l’exposition sur une touche de poésie, en présentant plusieurs dimensions du cyclovoyage, dont le voyage au long cours. Le vélo Liberia de Franco Nicotera, équipé de sacoches et d’une ombrelle, témoigne du périple de cinq ans de l’Italo-Grenoblois à travers 66 pays. Le « Voyage d’Aimé », illustré par les planches de BD de Nardo, retrace l’aventure d’Aimé Juge, parti en 1935 pour une aventure d’une dizaine de jours dans les Alpes françaises, entre le Vercors et la Suisse, consignée dans un petit carnet. Le dernier mur de l’espace est consacré au Voyage au bout du Jardin, démarche artistico-poétique de Richard Forget et Marine Ponthieu partis faire le tour des 180 m de leur jardin-monde à bicyclette. Ce micro-périple a été traduit sous la forme d’une carte sérigraphiée par la graphiste Camille Martin. Le rendu, à la fois esthétique et décalé, permet de finir le parcours sur une dernière touche onirique.


Vélo Liberia du cyclovoyageur Franco Nicotera (vue de gauche) ; Carte sérigraphiée du Voyage au bout du Jardin (vue de droite) © Denis Vinçon
Murs blancs, jeux de mots et curieux vélos : les clés d’une exposition qui roule
Ces huit temps rythmant l’exposition sont unifiés par la scénographie très sobre et épurée de Jean-Paul Camargo : les murs blancs, ponctués de photos grands formats imprimés sur toile, font le pari de la simplicité. Ce design minimaliste donne une identité visuelle à l’ensemble du parcours à travers des clins d’œil visuels récurrents, à l’image des vitrines sur roues et roulettes de toutes tailles qui ponctuent le parcours. Ce parti-pris permet également une réelle mise en valeur des expôts, et notamment des nombreux modèles de vélo présentés – historiques, mythiques ou insolites. Peu d’objets proviennent des collections du Musée dauphinois ; les principaux musées prêteurs sont le Musée Géo-Charles d’Échirolles, le Musée National du Sport de Nice et le Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne dont le parcours permanent est dédié au cyclisme. Par ailleurs, de nombreux objets ont été empruntés à des particuliers, des associations et des institutions locales. Les « vélos d’Isère » se différencient par des cartels spécifiques qui permettent de les repérer tout au long du parcours, mettant ainsi en valeur le patrimoine de la région.

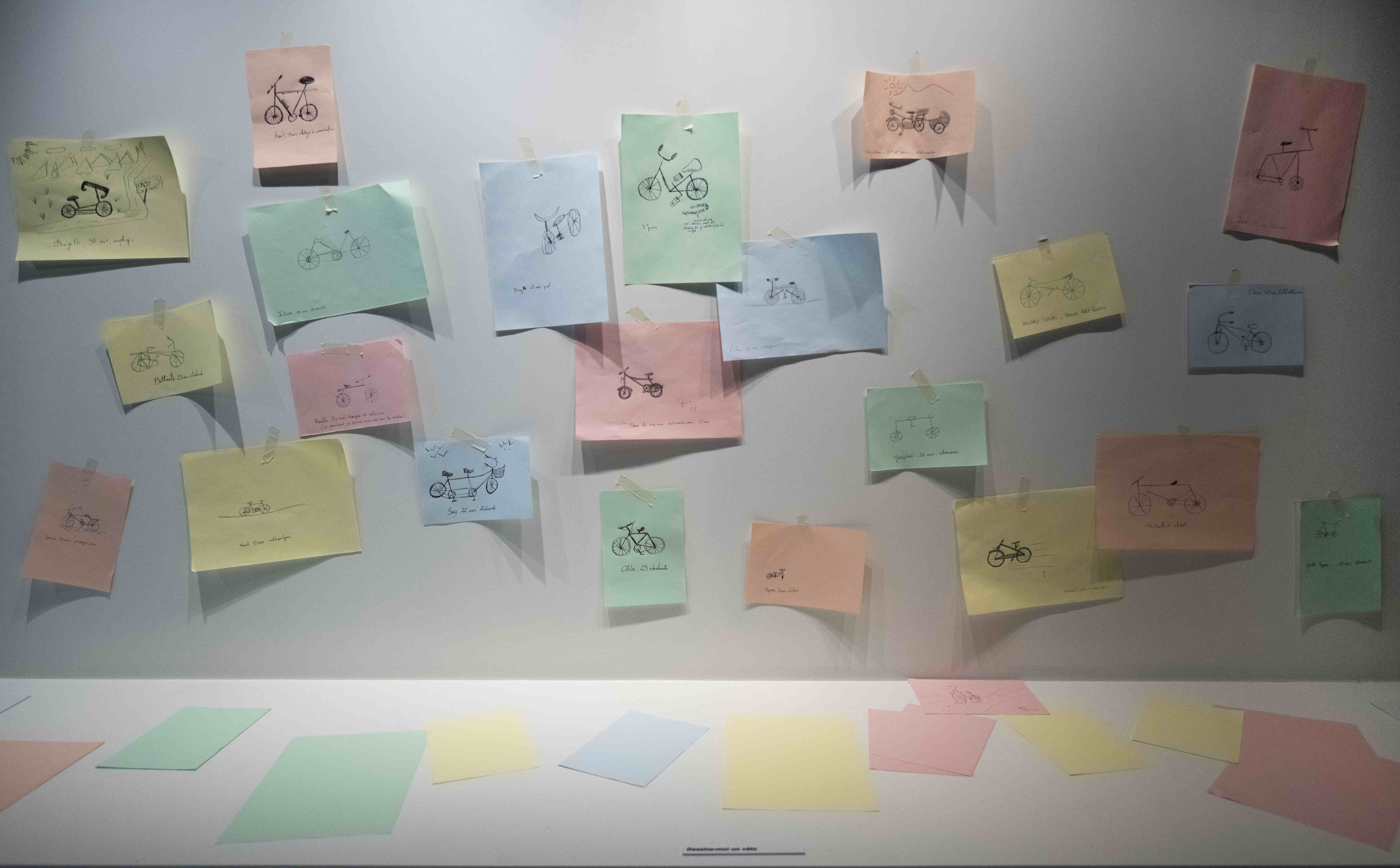
Roue musicale (vue de gauche) © Denis Vinçon ; Cartel « Vélo d’Isère » (vue centrale) ; Dessins de visiteur·euse·s sur le mur d’expression à la fin de l’exposition © Marion Roy
Le vélo étant un objet humble, il autorise l’usage de l’humour : les titres et textes de salle rivalisent de facéties cyclo-sémantiques (mention spéciale à « Ceci n’est pas un vélo », « Pois, pois mon pois » ou encore au jeu de mot bien trouvé « Héros in, héros out »), donnant un ton décalé très plaisant à toute l’exposition. La culture populaire y a toute sa place, à travers la bande-dessinée, les revues sportives et de loisir, et surtout la musique, mêlant standards musicaux anciens et actuels, en cohérence avec les affinités du commissaire Franck Philippeaux qui avait également conçu l’exposition Si on chantait ! La la la la en 2017. Des points d’écoute, où l’on peut aussi bien entendre Joe Dassin que les Wampas ou Bénabar, sont présents de manière récurrente dans les différentes séquences à travers des dispositifs de présentation originaux (cornets acoustiques, roue musicale, armoire à pharmacie sonore…) dont certains sont des réemplois d’expositions antérieures du Musée dauphinois.
L’expérience visiteur·euse
En tant que visiteur·euse, il est aisé de relier l’une ou l’autre des pratiques vélocipédiques abordées dans l’exposition à sa propre expérience cyclable. L’ancrage dans la région, matérialisé par les partenariats établis ou encore la collecte de témoignages et de photographies, permet d’incarner véritablement le propos. La présentation d’initiatives locales et contemporaines, telles que les vélorutions ou les ateliers de réparation participatifs et solidaires, fournit au public des pistes concrètes pour changer leurs propres pratiques. La présence d’œuvres artistiques entretient tout au long du parcours la « poétique vélocipédique » mentionnée dès la première séquence.
Un bémol cependant : l’exposition étant assez longue et très écrite, il est aisé de s’essouffler en fin de parcours, autour de la section sur les sports cyclistes en montagne. Néanmoins, le choix de consacrer l’ultime étape de l’exposition au thème du voyage donne un réel dynamisme à cette dernière salle, en présentant au public des initiatives poétiques et décalées qui donnent envie de partir pédaler sur les routes. L’exposition s’achève sur un mur d’expression libre où les visiteur·euse·s sont invité·e·s à dessiner leur propre version du vélo sur des feuilles colorées, en écho à l’œuvre de Gianluca Gemini présentée en tout début de parcours : si aucun croquis n’est mécaniquement exact, les résultats éclectiques montrent le riche imaginaire qui se développe autour de la petite reine.
Marion Roy
Pour en savoir plus :
-
Présentation de l’exposition et dossier de presse sur le site du Musée dauphinois.
-
Visite de l’exposition à bicyclette par Les Mondaines (vidéo) .
-
La revue L’Alpe consacre un numéro entier au thème du vélo : L’Alpe, n°77, « Le vélo, petite reine de la montagne », 2017.
Autres expositions sur le vélo
-
Musée d’art et d’industrie de Saint-Etienne, parcours permanent Cycles
-
Musée Géo-Charles, Échirolles, « Art et bicyclette » : iciet ici.
-
Historial de la Vendée, « A bicyclette ».
#Unamourdevélo #Vélorution #Muséedauphinois

Vi(d)e, les déserts
Comment faire une exposition sur un sujet où il n’y a, a priori, peu de contenu à exposer ?
C’est ce que le défi que s’est lancé le Muséum National d’histoire naturelle avec la nouvelle exposition au Jardin des plantes “Déserts”, du 2 avril au 30 novembre 2025. L’espace muséographique de 850m² prend peu à peu vie pour révéler les traces de vie des déserts actuels et l’adaptation de ses êtres vivants.
© Muséum National d’Histoire Naturelle
Parcours de l’exposition : du vide à la vie
L’exposition se découpe en 4 séquences : une première sur la définition du désert, une seconde sur les adaptations de la faune et de la flore, une autre sur l’adaptation des hommes et la dernière, plus courte, sur l’exploration scientifique.
L’entrée commence par la définition du désert choisie par le Muséum : il s’agit de zones émergées marquées par une grande aridité. Les précipitations y sont rares et irrégulières. Dans les déserts chauds, l’évaporation est intense, tandis que dans les déserts froids, l’eau se trouve sous forme de neige ou de glace. Ces lieux mythiques ne seront pas traités par ses imaginaires, l’histoire de sa formation ou de son exploration. C’est une approche contemporaine et scientifique qui est choisie. La mappemonde sur la première table situe les déserts chauds et polaires, qui sont évoqués tout du long de l’exposition. La seconde table, explique leur point en commun et une notion clef : l’aridité. Puis, une grande table avec des manipes et audio permet de comprendre la composition des déserts et une vitrine expose des roches sculptées par les éléments naturels. Ce premier espace est entouré d’une grande projection d’images désertiques vides, où panoramas et focus sur des grains de sables au ralenti défilent.
© Muséum National d’Histoire Naturelle
Pour quitter cette zone sableuse, il faut suivre des traces d’animaux et passer dans un couloir, évoquant un canyon. Alors, des cervidés, rongeurs et insectes font leurs apparitions… Au lieu de proposer de les exposer par zones géographiques ou espèces, le choix a été de les regrouper par moyen d’adaptation. Visuellement, cela se traduit par un jeu de couleurs dégradées allant du bleu ciel, au blanc, jusqu’à un beige sablé. Les tables sont thématisées : “ne pas en perdre une goutte”, “renaissance éphémère”, “attention à la surchauffe ”; “froid, moi ? jamais !”, “les sens en éveil”. Les différentes formes de vie sont voisines, parfois terrées dans le canyon, perchées dans un cactus, pour évoquer leurs habitats naturels et surprendre les publics.
© Muséum National d’Histoire Naturelle
Une dernière espèce trône fièrement pour faire la transition avec la section sur l’adaptation humaine : le dromadaire. Symbole du nomadisme, ce compagnon de route est accompagné d’une table numérique tactile de près d’un mètre pour zoomer sur les dizaines de caractéristiques qui en font un roi de la vie en milieu extrême. L’humain aussi essaye de s’adapter : par ses habitations avec la yourte ou la tente touarègue selon son degré de mobilité, ses objets nomades, sa garde-robe et le travail de la terre avec notamment la création d’oasis… Ces savoir-faire sont présentés à travers des objets, des multimédias et par la présence de témoignages vidéos de populations vivants dans différentes régions.
Enfin, l’exposition se clôt sur l’exploration scientifique actuelle, avec des témoignages de l’expérience sensible de 5 chercheurs , faisant aussi partie du comité scientifique.
Une médiation accessible et du low-tech
La présence d’éléments de médiation multisensorielle et parfois low-tech dans l’ensemble du parcours permet de rythmer la visite pour les petits et grands, et de s’arrêter pour rencontrer une espèce en particulier.
La première partie, commençant par deux cartes, une notion-clef complexe à comprendre (l’aridité) et une ambiance sonore très présente, est très bien compensée par la grande table de médiation pour continuer d’intéresser les publics. Les publics peuvent écouter au casque le chant des dunes, voir la palette étonnante des couleurs des sables ou faire souffler le vent sculpteur de dunes.
© Muséum National d’Histoire Naturelle
Chaque grande section a plusieurs bornes accessibles : carte du monde légendée tactile, stromatolites, pierres des déserts, empreintes de petits et grands animaux, et même couches de peau d’ours pour expliquer comment il garde sa chaleur.
© Tiphaine Schriver, Muséum National d’Histoire Naturelle
© Muséum National d’Histoire Naturelle
Les dispositifs low-tech, par leurs illustrations, simplicité et efficacité, rappellent parfois la créativité de la littérature jeunesse. En tirant une feuille, une roche est sculptée par le vent. En tournant une manivelle, des fleurs éclosent grâce aux quelques gouttes de pluie tombées. Un lemming est dérangé dans son terrier si une plaque givrée est soulevée. En allumant une petite lumière, les veines d’un lapin aux immenses oreilles apparaissent. Il est même possible de sentir les vibrations du rat kangourou en posant une main sur une plaque !
© Muséum National d’Histoire Naturelle
Un fil rouge “menaces” discret
Des focus “menaces” sont disposés dans chaque partie. Ce choix muséographique, de distiller ces alertes sur l’environnement dans l’ensemble des 4 séquences, permet d’éviter une section entière uniquement sur ce sujet (et encore moins en fin d’exposition): dès l’entrée, cela pourrait être anxiogène ou rude pour les publics.
Il n’y a pas eu de volonté assumée de fondre les menaces dans le discours et de ne plus en faire un sujet à part ou en plus. Cependant, leurs dispositions dans le parcours est discrète : la couleur marron de ces focus se détache peu de la direction artistique de l’exposition. De plus, certaines sont dans des recoins moins visibles. Ainsi, elles ne sont pas clairement identifiées par les publics.
© Muséum National d’Histoire Naturelle
Tiphaine Schriver
#désert #lowtech #Sciencenaturelle #accessibilité
En savoir plus
○ Site web de l’exposition : https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/expo-deserts
○ Catalogue : à venir
○ Du 2 avril au 30 novembre 2025

Visions Chamaniques. Arts de l'Ayahuasca en Amazonie péruvienne
« Les dessins sont nous-mêmes, notre propre rivière, tous nos ornements. Jamais les Blancs ou d’autres personnes puissantes ne pourront nous les enlever » Agustina Valera Rojas / Ranin Ama
L'exposition "Visions Chamaniques : Arts de l'Ayahuasca en Amazonie péruvienne" transporte les visiteurs dans un voyage à travers les traditions chamaniques et les expressions artistiques des peuples autochtones de l'Amazonie péruvienne. En explorant les mystères de l'ayahuasca, cette exposition révèle la puissance de cette plante sacrée dans la vie spirituelle et culturelle de sa région. À travers une variété d'œuvres d'art, des peintures hypnotisantes aux sculptures colorées, elle offre un aperçu sur la connexion intime entre l'art, la nature et la spiritualité dans l'Amazonie péruvienne.
La collection du musée du quai Branly – Jacques Chirac est mise en dialogue avec une sélection d’œuvres d'artistes contemporains Shipibo-Konibo, dont une peinture murale spécialement réalisée par les artistes de l’Asociación de Shipibas Muralistas Kené Nete de Lima. Cette exposition met en lumière les évolutions contemporaines de cet art visionnaire autochtone. La légitimation de la dimension visionnaire de l’art Shipibo-Konibo, parfois contestée par certains chercheurs, est examinée à travers les prismes de la patrimonialisation, de la promotion touristique et de l'affirmation culturelle.
Une parole directe accordée aux artistes et auteurs
Cette exposition met en avant plusieurs perspectives culturelles et prismes de vues d'artistes, de chamanes, d'anthropologues ou d'autres experts soucieux de la préservation et la transmission des traditions chamaniques de l'Amazonie. Cet aspect est tenu tout au long de l’exposition qui laisse une grande place à la parole des artistes et auteurs de l’Amazonie péruvienne, notamment ceux de la communauté Shipibo-Konibo dans la région de l’Ucayali au Pérou. La première section de l’exposition se concentre sur la culture, l'art et l'artisanat des Shipibo-Konibo, en mettant en avant les œuvres et les objets qui représentent les kené, emblématiques de la production artistique de ce peuple. Connus sous le nom de kené, ces motifs graphiques et géométriques sont appliqués sur divers supports tels que textiles, poteries, sculptures et compositions de perles.

Img. 1 vue de l’espace « Les kené shipibo-konibo : un art visionnaire autochtone ». Le tableau représentant une pluralité de kené. © CP
La particularité de l’exposition est que ses textes et ses cartels intègrent de nombreuses citations d'artistes et d'auteurs-chercheurs shipibo-konibo, ce qui transmet directement leurs voix. Lorsque cela est possible, les cartels fournissent à la fois le nom civil péruvien et le nom shipibo-konibo de ces artistes et auteurs, offrant ainsi une reconnaissance culturelle complète. Tout ceci est mentionné dans un petit cartel « avertissement » en début de section. Ce cartel mentionne également l’utilisation de deux ouvrages [1]contemporains de chercheurs péruviens qui ont largement servi à l’élaborer le contenu scientifique de l’exposition, ils ont d’ailleurs fait l’objet de citations ou de références directes dans les textes et cartels.
Cette exposition ne se contente pas seulement de mettre en lumière les artistes, mais également l’expertise des chercheurs et anthropologues péruviens, citant explicitement leurs ouvrages en début et en fin d'exposition. Il ne s'agit pas de donner à entendre leur parole, car ils auraient pu être interviewés pour l'exposition, mais de plutôt valoriser leurs ouvrages, qui ont joué un rôle crucial dans la reconnaissance des kené en tant que patrimoine culturel national du Pérou. Ce qui souligne ainsi les luttes et les victoires de certains chercheurs. Cette démarche place la connaissance scientifique de ces anthropologues péruviens au cœur du discours scientifique de l'exposition. On observe une véritable volonté de mettre en avant les contributeurs qui ont documenté ce que nous contemplons dans l’exposition. Cette initiative louable permet aux peuples autochtones de légitimer leur parole au musée.
Place accordée aux pratiques chamaniques et leur apprentissage
L'exposition propose également une plongée dans les pratiques chamaniques de l'Amazonie péruvienne. Quels sont les outils de leurs pratiques ? Comment les utiliser ? Quels sont leurs bienfaits ? Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans la seconde section de l’exposition « les outils de la cure chamanique ». Cette exposition se concentre sur les créations artistiques sous l’effet d’ayahuasca, et sur des pratiques chamaniques péruviennes, en particulier celles des shipibo-konibo. Les plantes nous sont présentées dans leur contexte d’utilisation pour guérir les corps des patients à travers des rituels filmés diffusés au sein de l’exposition. A savoir que toutes les plantes exposées viennent du marché de Pucallpa au Pérou. De plus, chaque plante ou rituel est aussi nommé en langue shipibo-konibo.
L’exposition propose une contemplation artistique, explore les relations complexes entre le chant, le dessin et les plantes médicinales dans la formation des chamans. Les motifs traditionnels appelés kené ne sont pas de simples décorations artistiques, ils se retrouvent également au cœur même des pratiques chamaniques. Pour les shipibo, les kené brodés ou peints sont presque comme des partitions musicales qu’il suffirait de suivre du doigt pour être guidé dans son chant. Leur exploration offre un aperçu de la manière dont la musique et l'art visuel se rejoignent dans la pratique chamanique, ceci grâce à une ambiance sonore immersive, avec trois chants de rituels shipibo de Claudio Sinuiri Lomas et Amelia Panduro. Une manière de nous transporter dans un chant de guérison ou un autre censé amplifier les pouvoirs amoureux.
L'exposition ne se limite pas à une exploration visuelle, elle engage également les sens olfactifs. Le musée a mis en place un orgue à parfum, permettant aux visiteurs d'explorer les fragrances des rituels chamaniques de la culture péruvienne. Ces parfums, spécialisés chez certains guérisseurs, sont utilisés à des fins thérapeutiques, de purification et d'attraction de l'amour ou de l'amitié. Ils ont été spécialement élaborés par une communauté péruvienne à partir de plantes locales.


Img. 2 Vue de l’orgue à parfums chamaniques © CP Img. 3 Espace “Les outils de la cure chamanique” © CP
L’essor d’un tourisme chamanique : un regard occidental sur l’ayahuasca requestionné
Comment parler d’ayahuasca sans parler de tourisme chamanique ? Depuis les années 1990, un nombre croissant d'Occidentaux se rendent en Amazonie péruvienne pour s'immerger dans les pratiques associées à l'ayahuasca, alimentant ainsi l'émergence d'un "tourisme chamanique" qui induit des changements économiques et culturels significatifs dans la région.
La fin de l’exposition propose une rétrospective de l'histoire de l’ayahuasca à travers le prisme occidental. Depuis sa découverte au XIXe siècle jusqu'à son exploration dans le domaine de l'ethnobiologie, puis la diffusion des résultats de recherches sur cette substance hallucinogène encore énigmatique pour les Occidentaux, cette section met en lumière l'évolution de l'intérêt occidental pour l'ayahuasca. Elle souligne également l'émergence d'un tourisme chamanique de masse à la suite de la diffusion de ces recherches auprès du grand public. Plus récemment, l'intérêt croissant de la communauté scientifique pour les propriétés thérapeutiques des substances psychédéliques a stimulé une nouvelle vague de recherches sur l'ayahuasca ces dernières décennies.
Cette section est particulièrement pertinente puisqu’elle juxtapose le regard contemporain occidental sur l'ayahuasca et les interactions historiques des Occidentaux avec cette substance en Amazonie. Elle met en lumière la manière dont des terres appartenant aux autochtones ont été le terrain de recherches européennes dès le XIXe siècle, s'étendant ensuite avec l'émergence de la contre-culture américaine à partir des années 1960. Cette perspective révèle comment certains se sont approprié cette substance et ont tissé tout un récit autour d'elle, la rendant ainsi extrêmement attrayante et mystique pour un grand public souvent peu informé de ses effets et dangers.

Img. 4 Salle reprenant chronologiquement l’histoire de l’ayahuasca. © CP
Quel effet ça fait l'ayahuasca ? Une expérience hallucinogène au musée
Tout au long de l'exposition, l'ayahuasca est un sujet récurrent, mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette substance, la question persiste : quels sont ses effets ? Heureusement, la conclusion de l'exposition offre une réponse à cette interrogation en proposant aux visiteurs une expérience de réalité virtuelle de 18 minutes les plongeant au cœur d'un voyage hallucinogène sous l'effet de l'ayahuasca.
La dernière salle du parcours explore les effets de l’ingestion d'ayahuasca sur les artistes contemporains péruviens et internationaux, mettant en lumière la façon dont cette tradition ancestrale continue de nourrir l'inspiration, nourrit les récits visuels et les expressions artistiques contemporaines, notamment à travers des productions audiovisuelles telles que celles de Jan Kounen. L'artiste néerlandais s'est lancé le défi de recréer l'expérience de l'ayahuasca grâce au cinéma en utilisant des images de synthèse.
Lors de cette expérience hallucinogène virtuelle, les visiteurs sont transportés par le chant d'un guérisseur traditionnel shipibo, évoquant un état de transe inspiré des rituels. Ils sont plongés au cœur des paysages amazoniens et des rituels chamaniques par des images vibrantes et sons envoûtants. Cette expérience VR ajoute une dimension immersive pour comprendre les pouvoirs de cette boisson dont les effets peuvent perdurer jusqu'à six heures après ingestion. En raison d’images sensibles et parfois terrifiantes, l’activité n’est accessible qu’aux personnes de + de 13 ans et déconseillée aux personnes qui ont une épilepsie. Une mise en garde est d’ailleurs annoncée à l’entrée puisque le film comprend aussi des images d’insectes mouvants qui pourraient gêner certains insectophobes.
Camille PARIS
#ayahuasca #autochtones #amazoniepéruvienne #chamanisme
Pour en savoir plus :
- Le dossier de presse de l’exposition :https://m.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/1-Edito/6-Footer/1-Espace-presse/DP_VISIONS-CHAMANIQUES_VDEF.pdf
[1]Agustina Valera Rojas et Pilar Valenzuela Bismarck, Koshi Shinanya Ainbo : el testimonio de una mujer shipiba, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2005. Et Luisa Elvira Belaunde, Kené: arte, ciencia y tradiciôn en diseño, Instituto Nacional de Cultura del Perü, Lima, 2009 ↩

Visite au Musée Vivant du Cheval

Fig. 1 : Entrée du bâtiment des Grandes Ecuries abritant le musée – © M.T.
La singularité de l’établissement apparaît sitôt le seuil franchi : nous pénétrons en effet non pas dans un musée mais dans d’authentiques écuries occupées par des chevaux, poneys et ânes qu’il est possible d’observer dans leurs boxes et leurs stalles. Chacun possède une plaque à son nom, et nous pouvons également apercevoir des éléments de leurs harnachements dans des alcôves réservées à la sellerie. Ces animaux représentent une partie de la quarantaine d’équidés qui participent aux spectacles et démonstrations se déroulant régulièrement dans les carrières et sous le dôme des Grandes Écuries. Des trophées de chasse historiques achèvent de conférer une atmosphère particulière à cette longue salle haute de plafond, où plane l’odeur caractéristique d’un centre équestre. L’entrée du musée proprement dit survient de manière presque anecdotique : nous sommes invités à nous engager dans un couloir entre deux boxes et pénétrons dans un lieu à l’architecture singulière. Le musée est divisé en une quinzaine de petites salles en enfilade faisant le tour de la Cour des Remises. L’ensemble forme un carré autour de ladite cour où se dresse une carrière d’entraînement. A intervalles réguliers, il nous faut sortir à l’air libre et faire quelques pas en extérieur pour accéder au tronçon suivant, car toutes les salles ne sont pas directement accolées. Cette alternance intérieur/extérieur donne à la visite un rythme particulier et permet, avec un peu de chance, d’assister à une reprise d’équitation dans la carrière. Car ce n’est pas pour rien que l’on parle de musée vivant : loin de se résumer à un simple lieu d’exposition d’objets, les Grandes Écuries accueillent quotidiennement des cavaliers qui viennent s’y entraîner devant le public, en dehors des heures de spectacles. Des démonstrations de dressage d’une durée de 30 minutes sont même incluses dans le prix du billet d’entrée. Problème : elles n’ont pas lieu en décembre ni en janvier, or ce détail n’est stipulé nulle part. Il a fallu que j’aille me renseigner à l’accueil pour apprendre qu’il n’y avait pas de démonstration le jour de ma visite. Outre ma déception, j’ai trouvé dommage d’avoir payé le prix habituel sans pouvoir profiter de l’ensemble des prestations annoncées sur le site Internet et dans la brochure. Une réduction du prix aurait été appréciable pour compenser cette absence de démonstration.

Fig. 2 : Le public peut déambuler entre les boxes des chevaux et assister aux entraînements des cavaliers – © M.T.

Fig. 3 : Le contenu souvent technique des salles est accompagné de médiations ludiques pour les enfants – © M.T.

Fig. 4 : Chevaux de carrousel exposés à la fin du parcours dans une ambiance poétique – © M.T.
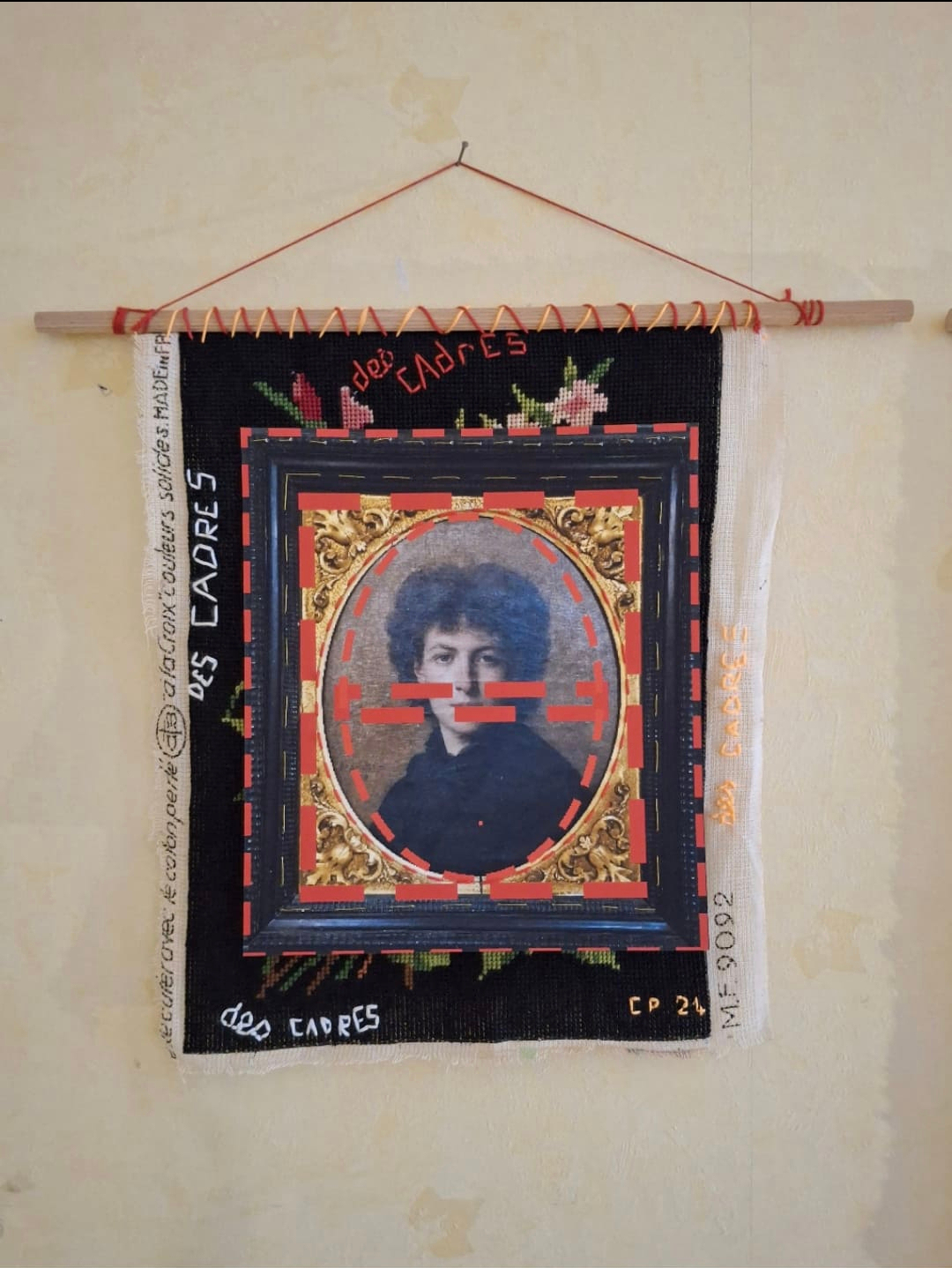
Visite et revisite : des expositions en écho, hommage à l'illustre enfant du pays
Bédarieux : une ville culturelle enracinée dans son histoire
Petite ville de 6 000 habitants nichée en Occitanie, Bédarieux intrigue par son calme et sa discrétion. Au loin, le viaduc reliait au XIXe siècle le bassin minier au réseau ferré vers la Méditerranée. La ville, en plein essor industriel, prospéra pourtant jusqu’au milieu du XXe grâce à l’industrie textile, les tanneries, les fours à chaux, la chimie et la construction mécanique.
«L’endroit n’a rien d’une destination touristique, encore moins d’un bassin d’emploi dynamique. Les rares passants rencontrés le reconnaissent volontiers : la vie a déserté la ville depuis bien longtemps » affirme le rédacteur en chef de Libération, le 21 avril 2021. Bédarieux apparaît même comme une ville de « taiseux » …
Loin des destinations touristiques ou des bassins d’emploi, elle n’en affiche pas moins une belle ambition. Comme rétorque son maire avec humour : « Il faudrait que vous vous penchiez sur les villes comme la nôtre... pour montrer celles et ceux qui se battent pour redresser ces coins de France trop longtemps délaissés, mais pleins d’avenir ! ».
A présent, Bédarieux s’épanouit à travers l’art : ce renouveau passe par une dynamique culturelle forte. Nouveau cinéma, salles de spectacles, médiathèque, festivals… la ville propose une diversité d’activités. La Maison des Arts, située dans l’ancien Hospice Royal Saint-Louis classé Monument Historique, regroupe depuis 2003 un Espace d’Art Contemporain reconnu pour ses expositions d’artistes locaux et internationaux.
Bédarieux est aussi marquée par l’émergence d’espaces de création privés comme « Le 31 ». L’artiste Nicolas Bexon, tombé amoureux de la ville, s’y est établi et s’investit pleinement. Avec une vie associative dynamique et des habitants engagés, Bédarieux prouve qu’elle sait allier discrétion et créativité pour se réinventer.
Le peintre du pays à l’honneur : exposition “Pierre Auguste Cot - La Collection”
Pierre Auguste Cot, né à Bédarieux, a toujours gardé un lien fort avec sa ville natale malgré son succès parisien. Propriétaire du Mas Tantajo, il y passait ses étés à peindre, entouré de sa famille, organisant des soirées conviviales avec ses amis comme Alphonse Daudet. Il offrait également des toiles et réalisait des portraits pour les habitants. Depuis 1947, un buste sur la place qui porte maintenant son nom rappelle l’attachement de la ville à cet artiste emblématique.
En 2024, l’exposition « Pierre Auguste Cot – La Collection » célèbre son œuvre et son héritage en exposant plusieurs de ses toiles. Le vernissage a réuni plus de 500 personnes, et de nombreux élèves et visiteurs ont ensuite découvert ses peintures, enrichies par des prêts d’institutions régionales comme le Musée Fabre de Montpellier. L’exposition est dynamisée par les élèves du Lycée des Métiers de Fernand Léger qui ont participé à la reconstitution d’un salon semblable à celui de Cot. La collecte de dons pour restaurer les œuvres de Cot a été organisée par la Fondation du Patrimoine, représentée par Jean Lavastre, délégué territorial de l’Hérault.
Pour le maire, cet événement permet aux habitants de redécouvrir un artiste qui incarne à la fois l’ouverture et l’ancrage de Bédarieux dans son patrimoine.
Les femmes à l’honneur
L’exposition met en lumière les représentations féminines dans l'œuvre de l'artiste.
La première salle présente six portraits de femmes, soulignant leur place importante dans son travail, qu’il s’agisse de proches ou de Bédariciennes. Le « Portrait de Madame Gervais » témoigne de la délicatesse avec laquelle Cot peignait ses modèles féminins, souvent issus de la bourgeoisie. Le buste de Madame Cot attire également l’attention dans la première salle.
Espace d’Art Contemporain (Bédarieux), © Pauline Mabrut
Ces œuvres témoignent de la formation rigoureuse que Cot a reçue auprès de ses maîtres, tels que Alexandre Cabanel.
Dans la seconde salle est exposée une peinture d’une prestance déroutante : “Mireille faisant l’aumône à la sortie de Saint-Trophime”, dans laquelle est représentée Mireille pleine de grâce et de grandeur, offrant quelques pièces à un mendiant dont le modèle était un jeune bédaricien.
Pierre-Auguste Cot revisité
L'exposition "Cot Revisité" se tient dans l’Atelier d’Art de Nicolas Bexon, où 25 artistes contemporains membres de l’association des 4CM (Créatrices et Créateurs du Caroux au canal du Midi) réinterprètent les œuvres de Pierre Auguste Cot.
Avec le soutien logistique de la mairie, cette exposition pose la question : que penserait Cot, l’artiste académique, des réinterprétations contemporaines de ses œuvres ? À l’époque, l’artiste répondait aux attentes ; aujourd’hui, il suscite réflexion et émotions.
L’exposition offre un parcours surprenant, où les artistes jouent avec humour et profondeur, toujours avec talent. Cette réinvention vivante de l’œuvre de Cot, après plus de 150 ans, réveille son héritage et invite les Bédariciens à découvrir ce grand artiste trop méconnu.
Parmi les œuvres, une jeune Ophélia, tablette tactile en main, observe silencieusement les visiteurs, tandis que sa robe (symbolisée par la robe de mariée de la mère de l’artiste) suspendue au mur ajoute un air mystérieux, nous faisant penser au travail de Sophie Calle.
Atelier d’Art Nicolas Bexon (Bédarieux), © Pauline Mabrut
Les artistes réinterprètent le célèbre "Printemps" avec des touches humoristiques ou provocatrices : des peintures retravaillées, des poupées Barbie mises en scène, une balançoire suspendue au-dessus d'un petit bassin…
Les femmes peintes par Cot sont au cœur de la question de l’émancipation féminine au fil des âges. L’artiste Catherine Philippe symbolise cette réappropriation par des éléments forts : un cintre portant un fœtus dénonçant les souffrances liées à l’avortement, et une autre œuvre, "La Prison Dorée", où une femme est prisonnière de barreaux d’or. “Mon travail créatif consiste à revisiter l’histoire de l’art avec un regard féministe, en utilisant des reproductions d’œuvres connues et reconnues sur lesquelles j’ajoute des éléments afin de rendre compte du vécu des femmes” explique l’artiste sur un cartel de l’exposition. Un hommage puissant à la lutte pour les droits et les libertés des femmes, brodé sur les œuvres.
Atelier d’Art Nicolas Bexon (Bédarieux), © Pauline Mabrut
L’« Orage » de Cot a été réinterprété, avec l’ajout de l'article 213 du Code civil de 1804 : « Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari ». Ainsi, la supposée Virginie devient l’otage de son compagnon, le toit du foyer se tissant peu à peu au-dessus de sa tête.
Atelier d’Art Nicolas Bexon (Bédarieux), © Pauline Mabrut
Revisiter une œuvre, c’est aussi revisiter l’Histoire de l’Art et réfléchir au rôle de l’artiste dans la société de son époque. De nombreux artistes participant à cette initiative ont évolué du figuratif vers l’abstraction ou le conceptuel, tout en abordant l’œuvre de Cot avec respect, et en l’ancrant dans les questions contemporaines mais déjà rencontrées dans le passé. Comme il l’est spécifié, l’art contemporain peut parfois déstabiliser, et certains visiteurs pourraient être surpris par ces interprétations modernes de l’artiste. Mais cette démarche est aussi une manière de s’approprier l’œuvre pour n’en retenir que l’essentiel, ce que chaque artiste a fait avec sa manière de percevoir les tableaux de Cot.
Un petit clin d'œil à David Beckham, qui, en arborant fièrement deux tableaux de Cot tatoués sur ses mollets, a permis à l’artiste bédaricien de conquérir des millions de fans de foot – et d’autres, probablement moins habitués des musées, mais tout aussi impressionnés par ses muscles !
Atelier d’Art Nicolas Bexon (Bédarieux), © Pauline Mabrut
La revitalisation des petites villes rurales est essentielle et à encourager. Bédarieux, avec Pierre Auguste Cot, dispose d’un héritage artistique précieux mais longtemps sous-exploité. Comme le souligne une commerçante qui a participé au jeu de piste “à la recherche des œuvres de Cot” en parallèle de l’exposition, pour beaucoup d’habitants, Cot n’était jusqu’à récemment que le nom de la place ou de l’arrêt de bus. Son œuvre restait largement méconnue car peu mise en avant par la ville. Pourtant, grâce à des expositions et des actions culturelles ambitieuses, Bédarieux exploite davantage ce patrimoine et l’affiche en tant que fierté. Ces initiatives permettent non seulement de reconnecter les habitants à leur histoire, mais aussi de dynamiser la ville, de s’ouvrir à la culture et d’attirer un nouveau public. Chaque commune, lorsqu’elle dispose d’un artiste local ou d’une richesse patrimoniale, peut saisir cette opportunité pour se dynamiser. L’art a ce pouvoir de transformer les territoires en leur redonnant vie et cohésion.
Pauline Mabrut
Pour aller plus loin :
Extrait du journal municipal de décembre 2024, Bédarieux :
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/Journal-Municipal/2024/12/Journal-municipal-Decembre-2024-Webpdf.pdf
Dossier de Presse de l’Exposition :
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/Presse/2024/11/Dossier-de-presse-Exposition-PA-COTpdf.pdf
A propos de Cot, Association Résurgences, Bédarieux :
https://resurgences.weebly.com/pierre-auguste-cot.html
Autres actions culturelles en lien avec la thématique :
Du 21 au 30 novembre : jeu de piste à la recherche des œuvres de Cot à travers les différents commerces de la ville, permettant de gagner des bons d’achat et des places de cinéma.
Le vendredi 27 décembre à 18h30 : Conférence "Pierre Auguste Cot, le bédaricien" par l'association Résurgences, à l'Espace d'Art Contemporain.
Le vendredi 3 janvier à 18h30 : Concert d'orgue par Marc Chiron, à l'église Saint-Louis (hommage et improvisations sur des tableaux de Cot, en écho à l’exposition Pierre Auguste-Cot - La Collection).
Le samedi 11 janvier à 18h30 : Conférence "La restauration du Prométhée Enchaîné" par Roos Campman, à l'Espace d'Art Contemporain.
Autres expositions en lien avec la thématique :
Barbara Chase-Riboud : Quand un nœud est dénoué, un dieu est libéré
“Jusqu'en janvier 2025, huit grands musées parisiens honorent l'artiste américaine Barbara Chase-Riboud. L'exposition présente une quarantaine d'œuvres de bronze et de soie, explorant des thèmes tels que l'histoire culturelle et la représentation des femmes.” - Ville de Paris
Louvre Couture, objets d’art, objets de mode
“Du 24 janvier au 21 juillet 2025, le Musée du Louvre à Paris propose une exposition explorant les liens entre les chefs-d’œuvre de ses collections et des pièces de mode créées par de grands noms du milieu. Cette mise en miroir souligne l'influence des arts sur la création textile, avec une attention particulière aux représentations féminines.” - Toute l’Europe
#PierreAugusteCot #CotRevisité #Bédarieux #Revisit
Visiter un cimetière : morbide ?
Cimetière Saint-Roch, Grenoble © GM
Balade théâtrale au cimetière Saint-Roch de Grenoble

“ Entre MAD Tech ® et Madame, Monsieur

Extrait de la pièce de théâtre de l'Élan Théâtre © GM
Visite guidée de la construction du cimetière paysager de La Source, dans le Loiret

Cimetière paysager de La Source © EK

Cimetière paysager de La Source © EK

Cimetière paysager de La Source © EK
Une mode en devenir ?
Pour en savoir plus :
- Article d’Elise Franck, “Quand nos cimetières abritent le matrimoine” : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2305-quand-nos-cimetieres-abritent-le-patrimoine
- Article de Manon Lévignat, “Peut-on jouer avec la mort ?” : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2018-peut-on-jouer-avec-la-mort